
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/351283760
Preprint ■ May 2021
DOI: 10.13140/RG.2.2.33426.38089
READS
254
CITATIONS
0 1 author:

French Embassy in Sarajevo
29 PUBLICATIONS 2 CITATIONS
Some of the authors of this publication are also working on these related projects:
project Our ancestors the Gauls, tha Slavs and the Dravidians View project project Our ancestors the Gauls the Slavs the Dravidians and the Burushos View project
All content following this page was uploaded by Xavier Rouard on 03 May 2021.
L’Odyssée des Gaulois et des Slaves de l’Inde du Nord-Ouest vers l’Europe, par Xavier ROUARD
Abstract : this study, which first aim was to demonstrate the correspondences between Gaulish and Slavic languages, between which I found 500 common words, also allowed me to demonstrate, on the basis of linguistic, genetic, archaeological and religious data, that these matches were linked with Neolithic expansion of agriculture and pastoralism from North-Western India and Pakistan to Iran, Mesopotamia, Anatolia, the Caucasus, the North of the Black Sea, Danubian and Balkanic Europe, and farther to Gaul and Iberia, where Neolithic farmers took part in the formation of the megalithic civilisation which developed from 5.000 BC. This explains the linguistic matches I established between Gaulish and Dravidian languages - 250 common words from the 500 words I studied (and 160 with Burushaski), as well as similarities I found in the organisation of the Society and religion, which lead certain researchers to suggest, on the basis of the spread of the very ancient haplogroup H2-P96 from India to Western Europe, that the first Europeans and the proto-Dravidians had a very ancient common origin.
Extrait : cette étude, dont l’objectif initial était de démontrer les correspondances entre le gaulois et les langues slaves, entre lesquelles j’ai trouvé 500 mots communs, m’a en outre permis de démontrer, sur la base de données génétiques, archéologiques et religieuses, que ces correspondances étaient liées à des migrations Néolithiques d’Inde et du Pakistan du Nord-Ouest vers l’Iran, la Mésopotamie, l’Anatolie, le Caucase, le Nord de la Mer Noire, l’Europe danubienne et balkanique, la Gaule et l’Ibérie, où les agriculteurs néolithiques ont contribué à former la civilisation mégalithique qui s’est développée à partir de -5.000. Cela explique les correspondances linguistiques que j’ai établies entre le gaulois et les langues dravidiennes - 250 mots communs sur les 500 mots étudiés (et 160 avec le bourouchaski), et les similitudes constatées dans l’organisation de la société et la religion, qui amènent certains chercheurs à suggérer, sur la base de la diffusion du très ancien haplogroupe H2-P96 de l’Inde à l’Europe de l’Ouest, que les premiers Européens et les proto-Dravidiens avaient une origine commune très ancienne.
XXX
On retrouve de nombreuses racines communes entre le gaulois et les langues slaves, et notamment les langues slaves du Sud, ainsi que le lituanien et le slavon, langues proto-slaves, attestant des liens étroits entre les Gaulois et le monde slave ancien, que je détaillerai dans un premier temps en vue de démontrer que les concordances linguistiques que je présente dans la seconde partie de cette étude sont fondées.
Il existe deux théories principales pour le peuplement de l’Europe et la formation des langues indo -européennes. La théorie conventionnelle, celle des kourganes, place le foyer originel des langues indo-européennes dans les steppes pontiques vers -6.000. Une théorie alternative lie la formation des langues indo-européennes à l’arrivée de l’agriculture en Europe depuis l’Anatolie il y a 8.000 à 9.500 ans. Cette dernière me semble mieux à même d’expliquer la formation des langues langues archaïques européennes, dont les langues des Balkans et le Gaulois.
Selon la théorie des kourganes, la moitié des Européens actuels descendraient des cavaliers des steppes de la culture Yamna qui, venus du Caucase et de l’Iran, voire de l’Altaï, du Pamir ou de l’Hindou-Kouch, se seraient installés dans les steppes du Sud de la Russie et de l’Ukraine au contact de populations sédentaires proto-slaves, dont celles de la culture de Cucuteni-Tripolje (qui serait à mes yeux d’origine dravidienne, comme celles de Vinca, Butmir et Visoko). La culture Yamna serait génétiquement liée aux 3/4 à celles de la céramique cordée et de la hache de combat, qui se seraient diffusées de la Russie aux Pays baltes, à la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie, l’Allemagne et la Gaule. Ces cultures seraient à l’origine de toutes les langues indo-européennes et des peuples slaves, celtes et germaniques, expliquant les similarités du gaulois avec le slave et l’indo-européen.
Selon cette théorie, l'indo-européanisation a suivi les progrès de la culture des kourganes, venue dans la steppe russo-ukrainienne depuis la Sibérie centrale en -5.000. La première vague de migration, vers -4.400/4.200, a créé les Anatoliens. La seconde, vers -3.400/3.200, a créé les Phrygiens, Germains, Balto-Slaves, Illyriens et Celtes. La troisième, vers -3.000/2.800, a créé les Daco-Thraces, Grecs, Arméniens et Indo-Iraniens. Les Germains, Baltes, Slaves, Celtes, Italiques, Illyriens et Phrygiens seraient tous issus de la culture des kourganes via la culture de la céramique cordée, et les Indo-Iraniens s'y rattacheraient via la culture d'Andronovo. Intéressons-nous de plus près à la seconde vague, qui aurait eu lieu vers -3400/3200, à la fin de Kourgane III et migré dans toutes les directions à partir des territoires « kourganisés » du Nord-Ouest de la mer Noire, où s'est constituée la culture d'Usatovo, amalgame de culture kourgane et de culture de Cucuteni. Cette seconde vague s’est heurtée vers le Sud à la culture de Cernavoda I, dont les représentants ont dû refluer vers le Sud pour s'établir en Macédoine, en Bulgarie et jusqu'en Anatolie occidentale, notamment à Troie. Les cultures de Cucuteni-Tripolye, Vinca, Butmir et Petresti, dans les Balkans, ont été disloquées. Une nouvelle entité culturelle s’est développée dans la région balkano-danubienne par la fusion des cultures de Cemavoda I et de « l'Ancienne Europe ». On l’a nommé Cemavoda III en Roumanie, Boleraz en Slovaquie et Baden dans le bassin du moyen Danube. Créant un vaste complexe culturel « balkano-danubien », elle a étendu son influence à tout le bassin du Danube, de la Roumanie et la Bulgarie à la Yougoslavie, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, l'Autriche et l'Allemagne méridionale et centrale jusqu'au lac de Constance et à Nordlingen Ries, où elle a donné naissance à la céramique de Furchenstich et à la culture de Rössen III. Au milieu du IVème millénaire, la « kourganisation » du bassin supérieur du Danube a créé les cultures de Mondsee, Altheim et Pfyn. Les rites funéraires kourganes se sont imposés dans la région de l'Elbe et de la Saale et en Bohême. La culture kourgane s’est répandue dans la plaine du Nord, provoquant la mutation de la culture des gobelets à entonnoir en culture des amphores globulaires, puis de la céramique cordée. Dans le dernier quart du IVème millénaire, toute la carte culturelle de l'Europe s’est trouvée bouleversée. La civilisation celtique, née des cultures des champs d'urnes, Hallstatt et La Tène, est issue des cultures d'Unetice et Vucedol, nées de celle de Baden, issue d'une « kourganisation » des cultures locales de « l'Ancienne Europe ». Cette théorie expliquerait les contacts très anciens des Celtes avec les proto-Slaves des Balkans mais est critiquée.
Selon Bernard Sécher, les Yamnas ont migré vers la basse vallée du Danube vers -3.100 et un groupe a poursuivi sa route vers les Balkans et fondé la civilisation de Cernavoda. Un second groupe a fondé la civilisation de Baden en Hongrie et a remonté le Danube jusqu’en Suisse. Un troisième groupe est allé rapidement vers l'Europe occidentale vers -3.000, du nord de l'Italie à la péninsule ibérique en passant par le sud de la France. C’était un peuple de marins, de cavaliers et de métallurgistes. Il aurait créé la culture campaniforme, présente dans tout le Sud de l’Europe du Portugal à la Hongrie en passant par le Sud de la France et le Nord de l’Italie et l’aurait diffusée par la mer le long de l’Atlantique jusqu’aux îles britanniques, apportant la culture des statues menhirs de la civilisation de Majkop, proche de celle de Yamna, et contribuant à la civilisation mégalithique qui s’est développée en Gaule de l’Ouest et dans les îles britanniques, régions d’Europe qui ont à cette époque acquis la plus forte concordance génétique avec les Yamnas, qui auraient achevé de construire Stonehenge, prenant le relais d’agriculteurs venus d’Anatolie (issus de Dravidiens de Çatal Höyük ou Göbekli Tepe ?) en -6.000 par la péninsule ibérique et le littoral atlantique français, selon une étude génétique de Nature, Ecology and Evolution. Un groupe d’archéologues a proposé d’associer le développement de la culture campaniforme à l’arrivée d es premiers Celtes en Europe occidentale, du fait que ce peuple parlait probablement une langue proto-celtique.
Ces études tendent à corroborer la thèse évoquée de longue date par des historiens français selon laquelle les Gaulois descendent des Cimmériens (kymru signifiant compatriote en gaulois), qui seraient issus de la civilisation Yamna. Les Thraces, proches des Cimmériens, les Illyriens, les Sarmates et les Vénètes seraient également originaires du Nord de la Mer Noire. Vers -5.000, les ancêtres des Indo-Européens occidentaux, dont les Ligures (dont le nom viendrait du dravidien gori, montagne) et les Gaulois, auraient construit un empire en Ukraine, Russie du Sud-Est, Moldavie, Roumanie et Carpates. La tribu gauloise des Boudins serait même restée sur les bords du Don. Tous ces peuples auraient poursuivi leur migration, certains vers la Pologne (Vénètes), d’autres vers la région danubienne, se joignant à la civilisation de Hallstatt (Celtes, Cimmériens, Illyriens et Vénètes), d’autres vers les Balkans (Thraces et Illyriens), d’autres vers l’Anatolie (Thraces, Cimmériens, Vénètes et Celtes). Chassés d’Anatolie, les Cimmériens, Celtes et Vénètes auraient poursuivi leur migration vers la Gaule. Ce n’est toutefois qu’à la fin de l’âge du bronze, vers -1.500, que la civilisation de Hallstatt et des champs d’urnes a commencé à se diffuser de la région du Danube vers la Gaule, ce qui pose la question de la pertinence de cette théorie pour expliquer l’origine de la civilisation mégalithique qui s’est épanouie en Gaule à partir de -5.000.
Diverses études apportent des éléments de réponse à cette question, dont une étude de l’UNESCO, qui évoque des migrations d’Asie vers l’Europe au 7ème millénaire av. J. C., et une étude de l’Université de Toronto, qui explique la proximité avec le sanskrit des langues slaves archaïques, tel le vieux slavon (lié au vieux bulgare) et le slovène, par des contacts très anciens. Cette proximité, que l’on retrouve en gaulois, peut s’expliquer par l’apport au gaulois des Vénètes, dont les Slovènes sont issus et dont le nom serait issu du sanskrit vind, connu, familier, selon cette étude. S. Zaborowski, dans L’origine des Slaves, souligne les liens très étroits des Vénètes avec les Gaulois dès la naissance de la civilisation de Hallstatt, puis en Gaule, en Italie du Nord, en Bohème, en Pannonie et en Illyrie, où les Gaulois n’étaient entourés que de Slaves et se sont fondus dans la population locale. Une étude roumaine souligne aussi les liens très anciens de la civilisation pélasgienne carpato-danubienne avec les Indo-Aryens védiques, antérieurs à la civilisation des kourganes. Une autre étude souligne les similitudes entre le dravidien, les langues caucasiennes, le roumain, l’albanais, l’étrusque et les langues ibériques.
André de Paniagua, dans plusieurs ouvrages, conforte cette thèse en suggérant que les Celtes et les Vénètes seraient en partie issus de Dravidiens venus de l’Inde primitive, qui se serai ent mêlés aux peuples des steppes venus de l’Altaï pour s’installer en premier lieu dans le Caucase et au Nord de la Mer Noire et former la culture des kourganes, et poursuivre ensuite leur migration vers la région danubienne et les Balkans, puis l’Europe occidentale, où ils auraient diffusé la culture mégalithique dravidienne. Il évoque à cet égard la diffusion de l’Inde au Caucase, aux Balkans, à l’Italie et à la Bretagne, des termes dravidiens vel, vin, blanc (beli en sl. c., balaros, vindos en gaulois), et kar, kara, noir (crni en sl. c.), que l’on retrouve dans le nom du lac blanc de Van et d’Erevan en Arménie, de la blanche Albanie du Caucase et des Balkans, de la Mer noire (kara deniz en turc), de la montagne noire du Monténégro (crna gora en slave), des Vénètes de l’Adriatique (dont le nom viendrait du dravidien adru, étendue d’eau, comme celui de l’Oder - Odra en polonais, où les Vénètes se sont également fixés), des blanches Venise et Vindobona (Vienne), des Carpates (enceinte noire en dravidien) et de la blanche Valachie, de Vannes la blanche et Carnac la noire, de la blanche Albion et la noire Calédonie. Les Celtes seraient « les Célestes du feu » en dravidien et les Gaulois « les Coqs », du dravidien kur/kori/koli qui aurait évolué en Galli. Selon les linguistes Allan Bomhard et John Kern, ces migrants dravidiens, dont le foyer d’origine serait l’Iran, puis la vallée de l’Indus, sont en partie remontés vers la Sibérie centrale et il est donc plausible qu’ils se soient mélés aux peuples des steppes pour poursuivre leur migration vers l’Ouest. La Gaule avant les Gaulois évoque aussi cette migration venue d’Orient, qui aurait pu apporter la culture mégalithique que les Dravidiens ont développée en Inde et construire les menhirs de Carnac. Le mot druide viendrait du dravidien, comme celui de Zalmoxis, grand prêtre thrace qui serait à l’origine du druidisme gaulois. Une étude de Jean-Louis Brunaux, du CNRS, évoque aussi les origines indiennes de la religion gauloise, attestées dès l’époque mégalithique.
L’ancienne théorie d’André de Panaguia est corroborée par de nombreuses études génétiques et archéologiques. La carte ci-dessous, réalisée dans le cadre d’un projet géno-géographique de National Geographic financé par IBM, résume bien ces migrations et le rôle majeur que l’Inde a joué dans la diffusion d’une civilisation venue d’Afrique de l’Est tant vers l’Asie du Sud-Est que vers les steppes d’Asie centrale, l’Europe et l’Afrique du Nord. Elle corrobore la théorie d’une migration dravidienne depuis la vallée de l’Indus vers l’Europe, d’une part, et le Moyen et le Proche Orient, puis l’Afrique du Nord, d’autre part. Il y manque toutefois de mon point de vue les migrations des peuples des steppes entre l’Altaï et l’actuelle région Ouigour - où se sont installés les Tokhariens, qui seraient venus de l’Occident - et les steppes du Nord de la Caspienne et de la Mer Noire, d’une part, ainsi qu’entre l’Iran, l’Anatolie et les Balkans, ou encore entre l’Iran, le Caucase et le Nord de la Mer Noire, qui ont joué un rôle majeur dans la formation des langues indo-européennes en établissant une zone de contact au Sud du Caucase autour de la région des monts Zagros à l’Ouest de l’Iran, liée à la civilisation dravidienne de la vallée de l’Indus à l’Est, et à l’Anatolie, au Caucase et à la Mésopotamie à l’Ouest, comme le montre la seconde carte :
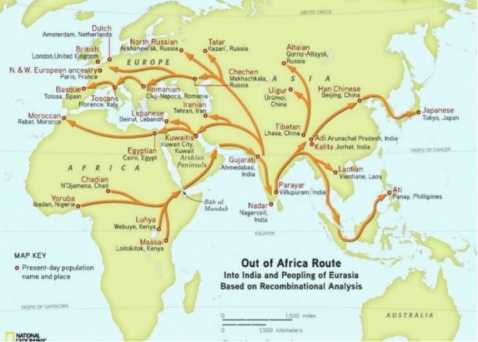
(Source : Genographic Project web site. http://www-03.ibm.com/press/us/en/photo/35881.wss )
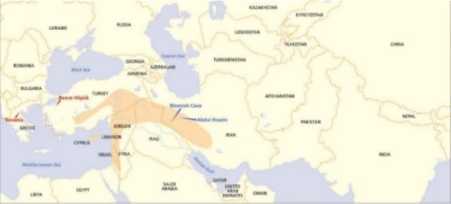
(Source : Université Gutenberg, Mayence, qui souligne les liens de l’Anatolie avec l’Inde dravidienne)
Carte de la zone de contact où s’est diffusée la culture dravidienne de la vallée de l’Indus vers l’Iran (Zagros), la Mésopotamie (Ubaïd), l’Anatolie (Çatal Hoyük, Gobekli Tepe), les Balkans (Vinca, mais aussi les autres cultures balkaniques de l’ancienne Europe, dont Butmir et Visoko) et jusqu’en Gaule (mégalithes de -5.000 à Barnenez, Carnac, Gavrinis (Bretagne) et dans le bassin parisien, culture de Glozel), ainsi que vers Majkop (Nord-Caucase) jusqu’en Gaule du Nord (bassin parisien) et du Sud (Fontbouisse, Languedo c), sites mégalithiques français où l’on retrouve des éléments caractéristiques des cultures d’Ubaïd et de Majkop selon Iurii Mosenkis, qui souligne que les Dravidiens et le clergé néolithique des Balkans et d’Europe occidentale étaient liés et que la langue de culte de Vinca pourrait être le dravidien, évoquant l’étymologie dravidienne de divers mots de l’écriture de Vinca.
Une étude d’Anton Perdih, Continuity of European Languages from the Point of View of DNA Genealogy, sur les liens entre la diffusion des langues et celle des haplogroupes G2a, R1a et R1b témoigne aussi de migrations entre la région de l’Indus, la Mésopotamie, l’Anatolie, les Balkans, la Gaule et les îles britanniques, ainsi que vers l’Egypte, l’Afrique du Nord et la péninsule ibérique à des dates cohérentes avec la diffusion de la culture mégalithique et la formation de la culture des Balkans, infirmant la théorie d’une diffusion de celle-ci vers l’Est. Une étude de Carlos Quiles, Indo-European demic diffusion model, conforte cette étude en évoquant la diffusion des haplogroupes R2 M479 (dravidien, karvélien et ouralien) en Ibérie, R1a M420 (indo-ouralien) et R1b M343 (présent notamment à Zagros) dans le Sud de la France, ce qui plaide selon lui pour une migration vers l’Europe par le Sud. Selon l’article de Maciamo Hay L’histoire génétique du Bénélux et de la France, paru sur le site Internet Eupedia en 2017, basé sur de nombreux tests génétiques, les agriculteurs néolithiques venus d’Anatolie et des Balkans ont en outre apporté des haplogroupes de type H et J1c, caractéristiques des Dravidiens, dont les haplogroupes H1 et H2, très présents chez les Dravidiens, qui se sont diffusés en Hongrie et dans les Balkans et ont été retrouvés en Gaule selon YHRD, témoignant de liens anciens. Plusieurs études génétiques françaises, dont une thèse très bien documentée de Maïté Rivollat, confirment que les haplogroupes G2a, N1a, K1a, T et H ont migré en Gaule au néolithique depuis le Pakistan, l’Iran, l’Anatolie, le Caucase et les Balkans d’où ils venaient.

Carte de diffusion de l’haplogroupe G2a selon Anton Perdih
|
f{ J \v | ||
|
, Vf I ........- r.--- 1 „ . . / 7,500 8,000 5,000 i rr '''wîo*.—h? |
Rlb 22,800 18.00* | |
|
5,000 * ' 7,600 |
J-........... \ ; | |
|
'un | ||
|
1*100 | ||
Carte de diffusion de l’ haplogroupe R1b selon Anton Perdih

Carte de diffusion de l’haplogroupe R1a selon Anton Perdih
Anton Perdih estime que ces migrations anciennes ont formé les langues indo-européennes, et que celles-ci, et en particulier le celte, se sont formées sur une base proto-slave, et que ces migrations remettent en cause la théorie des kourganes. Elles contribuent également à mes yeux à expliquer la présence de mots d’origine altaïque et dravidienne en gaulois, mais également en slave. Une étude canadienne, The Homo Neanderthalis and the Dravidians : A Common Origin and Relation to Harappan Civilisation and Vedas, estime que les Dravidiens, Sumériens, Egyptiens, Etrusques, Celtes et Basques avaient une même origine, avaient conservé des gènes néanderthaliens - en particulier les Basques - présentaient une même déficience du métabolisme du cholestérol à l’origine d’autres déficiences génétiques, parlaient et écrivaient une langue commune akkado -dravidienne et avaient adopté un modèle semblable de société matriarcale basé sur le culte de la Déesse-mère. Une étude sur l’haplogroupe H2 parue sur Wikipédia estime aussi que le fait que l’haplogroupe H2-P96, considéré par certains comme l’haplogroupe originel de la lignée paternelle des premiers Européens du fait de son ancienneté, soit présent en Gaule, Ibérie, Germanie, Helvétie, Italie, dans la région balkano-danubienne, mais aussi en Arménie, Iran, Afghanistan, Pakistan et Inde, accrédite une origine commune des premiers Européens et des Dravidiens.

Carte de diffusion de l’haplogroupe H Y-ADN : H2 s’est diffusé à Vinca et en Europe de l’Ouest mégalithique
Source : YHRD, selon lequel les haplogroupes Y-ADN H1 et H2 se sont diffusés en Gaule, ce qui est également attesté par les études collectives Ancient genomes from present-day France unveil 7,000 years of its demographic history, menée par Samantha Brunel, et Ancient genome-wide DNA from France highlights the complexity of interactions between Mesolithic hunter-gatherers and Neolithic farmers, menée par Maïté Rivollat, qui évoquent la présence de l’haplogroupe H2 sur le territoire de la France actuelle. Cette migration est corroborée par celle de l’ancien haplogroupe indien H2 P96, arrivé en Europe vers -10.000 par la Méditerranée et les Balkans selon l’étude génétique Using Y-chromosome capture enrichment to resolve haplogroup H2 shows new evidence for a two-Path Neolithic expansion to Western Europe, à laquelle a également participé Maïté Rivollat.
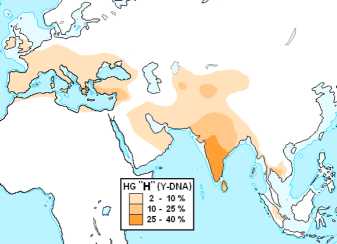
Carte de diffusion du gène H Y-ADN, dont la présence en Europe est également confirmée sur le site Eupedia Source : Anthrogenica, forum de discussion sur la génétique et l’anthropologie
Ces deux cartes montrent clairement que l’haplogroupe H, caractéristique des Dravidiens, s’est diffusé d’Inde vers l’Iran, l’Anatolie, l’Ukraine, l’Europe danubienne et les Balkans jusqu’en Gaule et en Ibérie, mais aussi vers l’Asie centrale, ce qui plaide pour des contacts entre les Dravidiens et les peuples des steppes, d ont les Tokhariens. Michael St Clair, dans The prehistory of language from the perspective of the Y-chromosome, estime que l’haplogroupe H2 P-96, qui s’est diffusé en Europe à l’Aurignacien, et l’haplogroupe H1 M-3061, qui s’est diffusé en Asie du Sud-Ouest et au Moyen-Orient, puis en Asie du Sud, étaient tous deux issus des haplogroupes HR M-578, puis HR M-2713, qui serait d’origine africaine. Ces haplogroupes seraient liés à l’haplogroupe G M-201 (ou G2a P-15) que l’on retrouve chez les Dravidiens et en Gaule, comme les haplogroupes R2 M-479 et R1 M-420 - issu de l’haplogroupe R M-173 comme l’haplogroupe irano-dravidien R1a Z-93 et l’haplogroupe européen R1b M-343. On retrouve aussi en Gaule l’haplogroupe J2 M-172, présent en Asie du Sud-Ouest, au Caucase, en Iran, en Asie centrale et chez les Dravidiens. La diffusion de tous ces haplogroupes plaide pour une migration vers l’Europe depuis la région comprise entre la vallée de l’Indus, l’Iran et l’Anatolie.
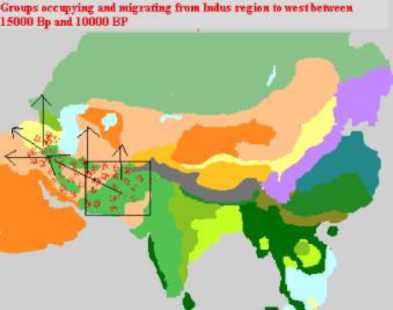
Cette carte est tirée d’une intéressante étude de Narendra Katkar réalisée pour l’Académie française des Sciences Après le dernier maximum glaciaire : la troisième migration, qui évoque trois migrations successives de la vallée de l’Indus vers l’Europe, vers -50.000, -40.000/-35.000 et -15.000/-10.000. La seconde a apporté l’aurignacien en Europe et une culture matriarcale dont la Vénus de Brassempouy témoigne en France. Elle est attestée par des découvertes récentes dans la région de Zagros datées de -35.000. La troisième, mieux documentée par de nombreuses données génétiques, a apporté en Asie centrale, en Anatolie, dans le Caucase et en Europe des haplogroupes indiens comme le G M-201, le H M-52, le R1a M-417, le R2 M-124, le K M-9, le L M-20, le J2b2... La généticienne Evelyne Heyer, dans l’Odyssée des gènes et Genetic Traces of East-to-West Human Expansion Waves in Eurasia, évoque aussi trois vagues de migration Est-Ouest en Eurasie dès l’Aurignacien, apportant des statues de Vénus comme la Vénus de Lespugues, et souligne le rôle majeur de l’Asie centrale dans ces migrations, notamment dans l’expansion de l’haplogroupe R et des langues d’Asie centrale. Elle souligne la proximité génétique des Tadjiks du Pamir avec les Européens. La présence en Europe des anciens haplogroupes indiens C et F Y-ADN et M et U2 mt-ADN à l’Aurignacien tend aussi à conforter cette théorie. Selon M.-O. Rondu, une migration au Gravettien, qui a déjà apporté l’haplogroupe R1b en Europe, est à l’origine des pyramides de Visoko en Bosnie-Herzégovine. D’autres études génétiques estiment que ces migrations anciennes ont apporté les haplogroupes I (I M170) and I2 (I P215), présents en France dès l’Aurignacien, portés par 80% des prêtres zoroastriens, trouvés dans des sépultures mégalithiques, qui ont amené leur religion. Selon l’étude de Csaba Barnabas Horvath How Eurasia was born, publiée par International relations quarterly, cet haplogroupe est originaire d’Asie centrale. Il était présent au Zagros. D’autres études génétiques, comme Estimating the Impact of Prehistoric Admixture on the Genome of Europeans, menée par Isabelle Dupanloup, confirment qu’une migration majeure de fermiers néolithiques a atteint toute l’Europe depuis l’Anatolie à partir de -8.000, apportant une part importante du génome européen (de 20% dans les îles britanniques à 30% en France et 75% dans les Balkans), essentiellement Anatolienne (50% en moyenne) et Basque (35% en moyenne, près de 50% en France) et à un moindre degré nord-africaine et nord-est asiatique, cette dernière se limitant à l’ Europe de l’Est et la Finlande. Cette migration a également pu contribuer à la diffusion de la langue dravidienne, dont le célèbre généticien, linguiste et historien Luca Cavalli-Sforza souligne, dans The Basque population and ancient migrations in Europe, qu’elle était parlée à l’origine de l’Asie mineure au Proche Orient, à l’Iran et à l’Inde. Elle a donc pu être diffusée par les agriculteurs néolithiques des Balkans à la Gaule à partir de -8.000 et contribuer à la formation des langues indo-européennes. Cela est attesté notamment par la diffusion du Caucase à la Gaule et à l’Ibérie, avec les gènes basques attestés par les études évoquées ci-dessus, des langues ibéro-caucasiennes, qui ont de nombreuses concordances avec le dravidien et ont donné naissance aux langues ibériennes et basques.

Carte de diffusion des haplogroupes mt H2a et H2a1 (source Google Earth/Family tree DNA/M.-O.Rondu 2020)
Cette carte est issue des travaux du chercheur Marc-Olivier Rondu, qui a publié sur Academia plusieurs études bien documentées, dont The discreet Origin of H2a1 MtDNA and its sudden Eurasian Expansion offer a unique Testimony about what remained from the Natufians, the Neolithic Revolution in Near East and Chalcolithic in Lesser Caucasus, témoignant de la diffusion en Europe de la civilisation du pastoralisme pour le lait depuis les montagnes iraniennes du Zagros et le Caucase à partir de -7.000, qui a apporté des haplogroupes mt-ADN H2a et H2a1, spécifiques à la région du Sud-Caucase, en parallèle des haplogroupes Y-ADN R1a M-417, R1a M-420, R1a M-458, R1a Z-282 et Z-93, R1b M-343, R1b M-415, R1b-V88, L1a, J1-M267, J2a et J2b, qu’il relie notamment à une migration proto-dravidienne dans le Sud-Caucase, attestée en particulier par la présence de l’haplogroupe dravidien L1/LM-20 dans le Sud-Caucase vers -8.500. Il évoque également à l’appui de cette thèse la diffusion des toponymes en van, vand (foret, montagne, étendue d’eau en dravidien), pand (lié aux bergers, que l’on peut lier au Dieu Pan, à la fabrication du fromage et au roi tamoul Pandion de la Mer Noire) et don (rivière, que je lie au dravidien tundna, verser de l’eau) de l’Inde à l’Espagne et au Portugal, le culte de l’arbre dans la région de Gilan (Nord de l’Iran, appelée alors Hyrcanie, ce qui évoque la foret hercynienne des Gaulois), la diffusion du mégalithisme et de statues de Vénus comme la Vénus de Brassempouy. Il souligne le role majeur du Sud-Caucase dans la diffusion de ces gènes en Europe, mais aussi dans les Steppes de l'Oural et de la Volga.
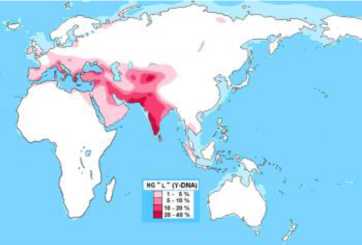
Carte de diffusion de l’haplogroupe L - Source Wikipédia
The Oxfordhandbook of Ancient Anatolia souligne aussi que le Néolithique s’est étendu du Nord-Ouest de l’Iran vers l’Anatolie et le lie à la culture zarzienne des Monts du Zagros, qui s’est développée à la fin du Pléistocène. D’autres chercheurs, comme Mojtaba Shahmiri, estiment que les Gaulois étaient originaires de la région Sud-Caspienne du Golistan, preuves archéologiques, religieuses et linguistiques à l’appui. Selon lui, plusieurs tribus gauloises, comme les Sénons, liés aux Semnani, les Atrébates, liés aux Atropatene, et les Volcae Tectosages venaient d’Iran. De fait, j’ai pu trouver dans ses études des similitudes entre les langues élamite et gilaki et le gaulois, corroborées par The Gilaki language, publiée par l’Université d’Uppsala. L’étude Gaelic/Gaulish and Gilaki/Galeshi people & Haplogroup R1b, publiée sur le site Internet Anthrogenica, souligne aussi les liens entre les Gilaki/Galeshi et les Gaulois, évoquant à l’appui d’une migration de ces peuples vers la Gaule qu’ils étaient originaires de la montagne boisée d’Hyrcanie, également appelée Golistan, qui, selon d’ancien nes sources akkadiennes, il y avait une foret appelée Arqania au Sud du Caucase comme, selon d’anciennes sources grecques, une région appelée Hyrcanis in Lydie, que Strabo évoquait une migration d’Hyrcanie, que Pline mentionnait les montagnes boisées d’Hercynium en Dacie et Hyrcani en Macédoine, outre la foret Hercynienne de Germanie, auxquelles j’ajouterai la région du Quercy en Gaule, toutes liées à perkunyo, montagne boisée en proto-Celte, et au mot dravidien perkuni, signifiant pousser pour les arbres. L’auteur mentionne aussi la similitude de la fête religieuse celte de Beltane avec la fête religieuse Gilaki de Bal Novruz. Enfin, comme le montre la carte de M. Shahmiri ci-dessous, il y a des statues-menhirs très semblables au Sud de la mer Caspienne et en Gaule. Plusieurs études génétiques montrent clairement que l’haplogroupe R1b, et en particulier l’haplogroupe européen R1b M269, caractéristique des Celtes, ont migré de la Sibérie du Sud vers le Nord-Ouest de la Chine, où se sont installés les Tokhariens, le Nord-Ouest du Pakistan et de l’Inde, le Tadjikistan, l’Ouzbékistan, le Turkménistan, l’Iran, l’Arménie, le Caucase, l’Anatolie, les Balkans et l’Europe de l’Ouest, comme le montre la seconde carte, publiée sur Wikipédia. La troisième carte montre clairement que cet haplogroupe est présent à une fréquence assez élevée de 20-40% de la mer Caspienne à l’Assyrie, l’Arménie et la Syrie, ce qui tend à accréditer l’existence controversée d’une langue celtique dans cette région, l’Euphratique. La théorie de l’origine Indo-Iranienne des Celtes est aussi corroborée par l’intéressante étude de Shrikant Talageri The full Out of India case in short revised and enlarged 20/7/2020, The Rigveda and the Aryan Theory: A Rational Perspective, selon laquelle l’une des tribus Rigvédiques les plus occidentales, les Druhyus, installée au Nord du Pakistan, a migré tôt vers l’Afghanistan, la Caspienne, puis la Gaule, apportant la religion celtique, qu’il considère comme la plus proche de la religion védique, cette tribu ayant selon lui donné son nom au mot druide en Gaulois, mais aussi au mot
drug, ami en Slave. Cette migration pourrait être liée à la diffusion du bourouchaski, lié aux Anus de la même région, qui ont aussi migré vers l’Ouest.
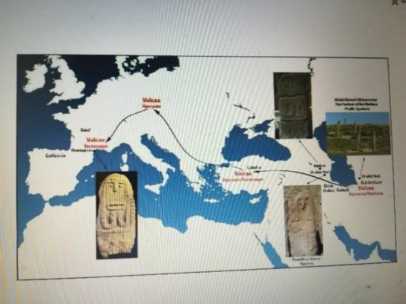
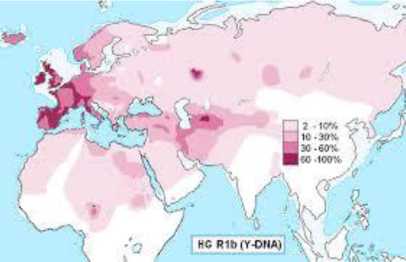
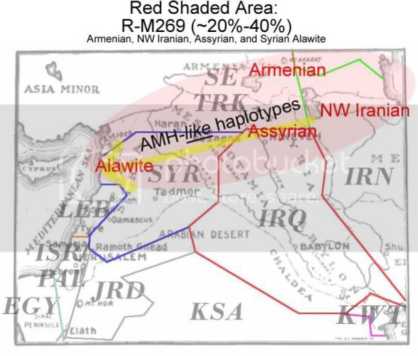
Une thèse d’Anna Szecsenyi-Nagy sur le génome du Néolithique Carpato-Danubien, Molecular genetic investigation of the Neolithic population history in the western Carpathian Basin, publiée par l’Université de Mayence, montre clairement que le génome de cette population est étroitement lié à l’Anatolie, au Caucase, à la Syrie, l’Iraq, l’Iran, et plus à l’Est l’Afghanistan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Pakistan, comme le montre la carte ci-dessous. Elle souligne aussi les similitudes génétiques entre les peuples archaïques des Balkans et de France, dont les Basques.

La carte de la diffusion de l’haplogroupe R1b présentée ci-dessous, publiée sur le site indo-european.eu, confirme que celui-ci s’est diffusé depuis la Sibérie vers le Nord-Ouest de la Chine, l’Asie centrale, l’Iran, le Caucase, l’Anatolie, les Balkans et l’Europe occidentale. Selon l’étude de Csaba Horvath How Eurasia was born, publiée par International relations quarterly, l’haplogroupe R descend de l’haplogroupe P1, qui est arrivé il y a 29.000 ans de l’Asie maritime du Sud en Sibérie orientale et Asie centrale, où cet haplogroupe reste présent à des fréquences assez élevées (28% dans l’Altaï, 17% chez les Ouighours, 10% chez les Turkmènes et 9% dans le Nord de l’Iran), ce qui tend à conforter la migration méridionale de l’haplogroupe R1b.
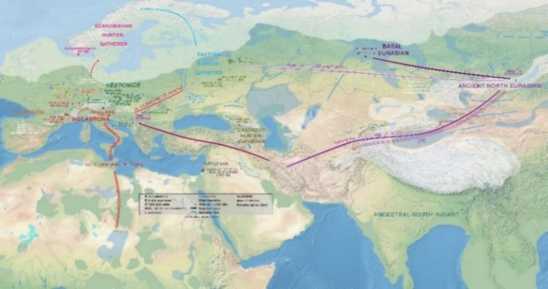
Le pionnier de l’archéologie pré-historique, Gordon Clyde, évoquait déjà dans les années 30 la migration d’une culture pastorale alpine, marquée notamment par l’élevage de chèvres et la culture du seigle, de l’Himalaya au Zagros, au Caucase, à l’Anatolie, aux Balkans et aux Alpes, comme le montre une carte tirée d’une étude de l’archéologue Maxime Brami sur Gordon Clyde, The Invention of Prehistory and the Rediscovery of Europe: Exploring the Intellectual Roots of Gordon Childe's 'Neolithic Revolution' (1936).
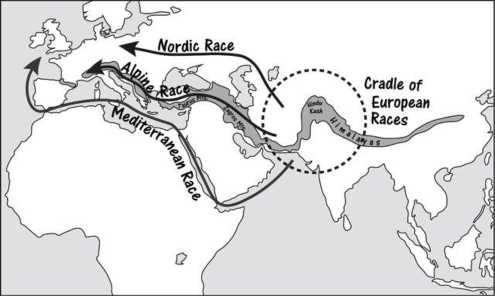
L'origine des principaux haplogroupes en Inde du Nord-Ouest est soulignée par George Van Driem dans A prehistoric thoroughfare from the Ganges to the Himalayas, comme le montrent les cartes ci-dessous :

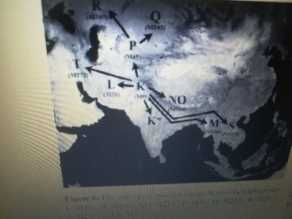
Plusieurs autres études intéressantes réalisées par des chercheurs occidentaux tendent également à corroborer la théorie Out of India, comme Some unlikely tentacles of early Indo-European, d’Angela Marcantonio et Girish Nath Jha, qui souligne les liens du PIE avec le Sanskrit védique, ainsi qu’avec d’autres langues indiennes comme les langues dravidiennes et austronésiennes, les langues d’Asie occidentale comme le Mitanni et les langues caucasiennes. Koenraad Elst souligne aussi l’origine indienne du PIE dans divers papiers comme Why Linguistics necessarily holds the key to the solution of the Indo-European Homeland question, situant le foyer originel en Inde du Nord-Est. Wim Borsboom présente une théorie originale dans Global Holocene Seafaring and Landcrossing Out of India Migration Hypothesis, soutenue par de nombreuses données génétiques et archéologiques, selon laquelle des navigateurs du Pakistan et de l’Inde du Nord-Ouest se sont installés dans toutes les zones côtières européennes en apportant l’ancien haplogroupe européen I, ce qui conforte la route méditerranéenne mentionnée sur la carte de l’étude de Maxime Brami sur Gordon Clyde. Une intéressante étude sur la migration des souris avec l’homme, Of mice and men, de Premendra Priyadarshi, montre que les souris domestiques ont commencé à migrer d’Inde entre -15.000 et -10.000 vers l’Iran, l’Anatolie et la France.
Une étude très fouillée du chercheur indien Rajan Menon conforte, sur la base de nombreuses découvertes génétiques récentes, ainsi que du développement de l’agriculture depuis l’Inde, l’idée d’une migration venue de la vallée de l’Indus, berceau d’origine des Dravidiens, vers la région de Zagros en Iran, vers -7.700/-7.400, puis vers -6.250 vers la région de la Volga, le Caucase et l’Anatolie, puis vers les Balkans et l’Europe occidentale. A l’appui de cette thèse, Rajan Menon évoque l’arrivée en Ibérie (Els Trocs, Pyrénées) dès -5.100 du gène R1a1a, dont il souligne l’origine indienne, et en particulier dravidienne (nb : il s’agirait en fait du gène R1b1, la présence à Els Trocs du gène J1c3, de même origine, corroborant cette hypothèse), et l’analyse de chèvres datées de -5.000 en France, démontrant que l’une était originaire du Pakistan et l’autre d’Asie centrale via le Nord de la Mer Noire. Selon lui, cette migration est également à l’origine de la civilisation mégalithique de Majkop, au Nord-Caucase.
Une étude française d’Yvesh sur la culture de Vinca souligne que cette culture s’est diffusée jusqu’en France, où l’on a découvert des objets semblables aux cultures de l’Indus et d’Ubaïd, dont à Glozel, Allier, un symbole phallique bisexué semblable au linga-yoni védique, des statuettes de Dieu-poisson - avatar de Vishnou dans la religion védique -, semblables à celles de Vinca, datées de -5.000, et des tablettes gravées préceltiques issues de la langue de l’Indus selon K. Schildmann (portant des signes très semblables à ceux de l’écriture de Vinca, des pyramides de Visoko (Bosnie), de Sumer (Ubaïd) et du Mas d’Azil (Ariège) selon une étude hongroise) de 2.500 av. JC, voire plus anciennes, cette datation étant incertaine. Cela conforte l’hypothèse de cette migration ancienne, comme les similitudes relevées par Alain de Benoist entre l’écriture de Vinca et celle de la vallée de l’Indus.
Ces études récentes confortent les conclusions d’Amédée Thierry qui, dans l’Histoire des Gaulois, évoquait déjà la migration des Cimmériens de Khersonèse taurique vers le Danube, la Gaule, puis le pays de Galles. Selon lui, les Cimmériens ont occupé en Gaule, vers -500, un territoire délimité par la ligne de la Seine et de la Marne au nord, la Saône à l’Est, la Garonne au Sud et l’Atlantique à l’Ouest. Ils ont fondé une confédération autour de la confédération armoricaine, conduite par les Vénètes, incluant les Nannètes (Loire atlantique), les Curiosolites, les Ostimes (Finistère), les Redons (Rennes), les Abrincates et les Uxelles (Cotentin), les Baïocasses et les Lexoves (Calvados), à laquelle se sont associés les Andes (probablement liés aux Antes, peuple slave de la région du Don, du Dniepr et de la Mer Noire), les Turones, les Carnutes, les Sénons (Y onne), les Lingons (du plateau de Langres, dont le nom pourrait venir de linga, symbole religieux phallique dravidien), les Cénomans, les Aulerkes (dont le nom de l’un des peuples, les Branovices, installés à Avallon, atteste d’une origine slave), les Pétrocores, les Santons (Saintonge), les Pictons (Poitou), et les Lémovices (Limousin). A. Thierry évoque aussi parmi les peuples cimmériens les Boïens ou Boghi (dont le nom viendrait du cimmérien bug, signifiant terrible, lié à Bog, Dieu en slave), dont plusieurs tribus se sont établies en Gaule et qui ont fondé en Bohème une confédération cimmérienne. Selon A. Thierry, une seconde vague de Cimmériens s’est installée en -300 sur un territoire compris entre la Seine, la Marne, les Vosges, le Rhin, la mer du Nord et la Belgique actuelle, dont les Leukes (Lemkes ?), les Médiomatrices (Moselle), les Rèmes (Reims), les Suessons (Soisson), les Bellovaces (Beauvais), les Calètes (pays de Caux), les Ambiens (Somme), les Atrébates (Artois) et les Morins (Boulonnais). Il est intéressant de constater que cette liste recoupe en celle des peuples slaves cités par P. Serafimov, et que les Atrébates (reliés à trem, village en vieux slave) et les Ambiens (reliés à oba, tous deux en slave) ont également des noms liés au slave. Selon A. Thierry, les Cimmériens sont à l’origine du druidisme en Gaule et en Angleterre, que le Chef de la première invasion cimmérienne, Hu, Heus ou Hesus, surnommé le puissant, qui était prêtre, aurait introduit. A. Thierry évoque en outre les Ligures ou Ligors, qui ont précédé les Gaulois en Gaule, dont le nom serait selon lui dérivé du slave gora car ils étaient originaires d’une chaine de montagnes. Il précise aussi que les Gaulois, dans leurs migrations vers le Danube et l’Illyrie, ont côtoyé des peuples sarmates et cimmériens tels les Bastarnes et sont à l’origine de peuples gallo-illyriens tels les Scordisques, Iapodes, Carnes et Taurisques.
En effet, les Gaulois (dont Sénons et Boïens), ont migré vers l’Italie et les Balkans dès -587 et de nouveau depuis l’Italie vers l’Europe danubienne et les Balkans vers -300, où, sous le nom de Scordisques, ils ont créé une fédération avec des peuples pannoniens et illyriens de langue sarmate, qualifiée par divers historiens de Gaule illyrienne, et poursuivi leur progression vers la Macédoine et la Grèce. Après leur défaite à Delphes en -279, certains sont revenus en Gaule, d’autres se sont fixés en Thrace ou en Galatie anatolienne, et d’autres sont revenus dans la région située entre la Save et le Danube d’où ils étaient venus, avec Singidunum (actuelle Belgrade) comme capitale, du nom des Syginnes, peuple thraco-cimmérien originaire de la Volga. Une étude serbe souligne la grande proximité des Serbes, dont le nom viendrait de Sarmate, avec les Sarmates-Scythes-Vénètes, qu’ils auraient suivi de la Mer Noire vers les Balkans et avec lesquels ils auraient partagé le même alphabet runique. Le chercheur français Pouqueville estime que les Illyriens parlaient aussi une langue proto-slave, bien que l’on en connaisse peu de choses. Ces migrations ont donc sûrement donné aux Gaulois une occasion complémentaire de côtoyer des peuples slaves anciens qui ont pu influencer la langue gauloise. Les Boïens, originaires de Bohême, ont en outre installé des avant-postes en Silésie, en Galicie polono-ukrainienne et en Transylvanie.
L’analyse d’A. Thierry recoupe celle de P. Serafimov qui souligne, dans Slavic influences in the ancient Gaul, que les noms de nombreuses tribus gauloises, de nombreux toponymes géographiques et noms de Dieux sont d’origine slave. P. Serafimov cite plusieurs peuples Boïens installés en Gaule, les Aedui (Eduens, reliés à la tribu thrace des Aedii), les Bituriges Cubi (de turg, trg, marché et kupiti, acheter), dont l’origine slave est corroborée par le nom de leur chef le plus célèbre, Belovèse, qui a mené l’attaque des Gaulois sur Rome en -587, les Volcae Tectosages de Toulouse, l’une des tribus Galates d’Anatolie ( de volk, loup), les Cabales (de kovali, forgerons), les Petrogorii (reliés à vetrogorji, collines ventées par l’Atlantique), les Belovaci (de bel, blanc, ves, village), les Lemovici (reliés aux Lemkes d’Ukraine), les Nervii (reliés aux Neures d’Ukraine), les Ostimii (de ostatni, derniers, car ils vivaient à l’extrémité Ouest de la Gaule), les Saluvii (de slavuj, célèbre), les Velavii (de Velavji, hommes de valeur), les Segusiavii (de sekati, couper, sejati, semer), les Mandubii d’Auxois, les Meduli (de med, miel), les Cadurci, les Santons, les Ruthènes d’Ukraine, les Vénètes. Il évoque aussi la présence de nombreux toponymes slaves en Gaule, dont 300 en Bretagne, qui accréditent l’origine slave des Vénètes, et des noms de Dieux comme Baco, vénéré à Chalons sur Saône, qu’il relie à Bhaga, Dieu dravidien, Bago en scythe et Bog, Dieu en Slave. Il évoque les similitudes linguistiques entre les langues gauloise, scythe et thraco-cimmérienne, les liens des Slovènes, Vénètes et Etrusques avec les Gaulois et souligne que, selon Diodorus Siculus, les Cimmériens ont migré d’Asie vers l’Atlantique et les mers du Nord de l’Europe. Il précise que selon Hérodote et Hyppolytus, le grand prêtre de la tribu thrace des Gètes, Zalmoxis, surnommé le Scythe, serait à l’origine du druidisme gaulois, ce que corrobore l’étymologie thrace du mot druide. P. Serafimov relie le mot Scythe à skitati se (errer en bosnien). Il conclut des similitudes linguistiques avec le scythe et le thrace que les contacts des Gaulois avec les proto-Slaves sont très anciens. L’Histoire des Gaules et des conquêtes des Gaulois, de J. Martin, parvenait à la même conclusion dès 1752, évoquant les liens très anciens des Gaulois avec les Thraces et les Illyriens, la venue ancienne des Bébryces, Thraces de Bythinie, et des Argonautes de Colchide en Gaule depuis le pays des Cimmériens ainsi qur la première expédition de Ségovèse en Illyrie vers -587. Une étude récente du chercheur Bernard Sergent conforte cette thèse, évoquant l’arrivée de trois tribus celtes dès -800 en Thrace anatolienne par les Balkans depuis la région de Hallstatt, les Doliones, les Mariandynes et les Bébrykes, dont le nom est proche de ceux de la capitale des Eduens, Bibracte, et du peuple pyrénéen des Bébryces. Il évoque aussi la tribu thrace des Edones, d’origine celtique, dont le nom fait penser aux Eduens, ainsi que la présence des Vénètes et des Cimmériens en Anatolie. Les Eduens, installés dans le Morvan de mes ancêtres, qui se vantaient auprès des Romains de leurs origines troyennes et que Jules César appelait Aedui ou Aedii, seraient-ils réellement venus de cette région de Troade où vivaient ces tribus celtiques ? Je relève par ailleurs que plusieurs noms de tribus (Petrogorji, de « montagnes rocheuses », Mandubii, « éleveurs de bétail » de l’Auxois, Velavji, « hommes valeureux », Calètes, de Kali, héros en dravidien), ont une étymologie dravidienne crédible.
Pavel Serafimov souligne aussi, dans Celto-Slavic similarities, la similarité des rites religieux et funéraires et de l’architecture entre les Gaulois et les Slaves des Balkans et l’importance du travail des métaux pour les deux peuples. Par exemple, les Stecci apportés en Bosnie-Herzégovine par les Vlasi, issus selon Leopold Contzen des Scordisques, d’origine gauloise, qu’il qualifie de Stari Vlasi (Vieux Gaulois), rappellent les menhirs bretons, ce qui n’est guère étonnant compte tenu des migrations déjà évoquées, et le trésor de Vix, dans la Bourgogne de mes ancêtres, serait d’origine Vénète, Vix se situant sur la route des métaux que ces derniers contrôlaient.
L-G du Buat-Nançay souligne également que, parmi les principaux peuples qui ont pris part aux grandes expéditions gauloises, les Sénons seraient d’origine cimmérienne, les Volques ou Volgues Tectosages seraient originaires de la région de la Volga et du Don et issus des Saces, peuple proche des Scythes et des Sarmates, de même que les Boïens, qui seraient issus des Daces Pames, tribu sace parlant une langue proche de celle des Sarmates, qui faisaient partie des Scordisques d’Illyrie et ont pris part à la création de la Galatie septentrionale sur les bords du Don (Tanaïs) au voisinage des Scythes. Leur nom peut par ailleurs être rapproché de celui du peuple montagnard des Bojks, mélange de Vlasi et de Ruthènes, installé aux confins de l’Ukraine et de la Pologne.
Une intéressante étude serbe de Dejan Milosavljevic souligne également le rôle majeur des Vénètes, par leur migration depuis la région du Don et du Dniestr vers la Thrace, les Balkans, l’Autriche, l’Allemagne et la Gaule, puis les îles britanniques, ainsi que des Carnes et Illyriens qui les auraient accompagnés, dans la proximité du gaulois et des langues celtes avec les langues slaves des Balkans. Certains chercheurs établissent même un lien entre les Carnutes de Gaule et les Carnes slovènes, qui sont effectivement présentés comme Gaulois par Leopold Contzen. En sens inverse, cette étude serbe souligne l’importance des Sénons dans la diffusion de la langue celte par leurs migrations vers les Balkans, et notamment vers l’actuelle Bosnie-Herzégovine, suggérant par exemple qu’ils auraient donné leur nom à la Sana, ce qui est plausible compte tenu que Leopold Contzen présente clairement les Scordisques comme issus des Gaulois qui ont pris part au sac de Rome, dont les Sénons faisaient partie, et situe leur implantation en Serbie et en Bosnie-Herzégovine actuelles. Plusieurs autres sources évoquent la migration des Sénons de la région d’Ancône, en Italie, où s’étaient également installés des Vénètes de l’Adriatique, vers les Balkans, la Grèce, puis la Galatie, où le Brennus Sénon de l’attaque gauloise sur Delphes, qui ne serait pas mort en fin de compte, se serait rendu à l’invitation du roi de Bythinie. Cette étude serbe évoque également le rôle des Vlasi, Celtes venus d’Occident, dans la diffusion de la culture celte, en particulier dans l’actuelle Bosnie-Herzégovine. Elle souligne aussi le rôle d’autres peuples dans cette proximité lingui stique, comme les Ruthènes, qui se seraient rendus en Gaule selon César, et les Boïens - partis de la région du Danube, où s’étaient aussi installés des Gaulois autour de Bratislava vers -300 -, qui étaient donc en contact avec eux, vers la Gaule, où ils se sont installés sous la protection des Eduens, auxquels ils étaient très liés, entre Loire et Allier à la suite de la bataille de Bibracte dans le Morvan de mes ancêtres. La localisation de l’oppidum des Boïens, Gergovie, fait toujours débat, mais il pourrait selon diverses sources se trouver non loin de ma maison familiale dans la Nièvre, à Saint Révérien, Saint Pierre le Moûtier ou Saint Parize le Châtel, ou encore à Sancerre, dans le Cher, cette dernière hypothèse étant toutefois jugée moins plausible par les auteurs d’une étude sur les Eduens.
Au vu de ces études, il est vraisemblable que les Gaulois soient venus depuis l’Inde par le pourtour de la mer Noire, où s’étaient installés, entre l’Ukraine, la Colchide, l’Anatolie et la Thrace, les Cimmériens, les Celtes, les Dravidiens et les nomades Scythes, Thraces, Sarmates et Saces, dont les Celtes et les Cimmériens étaient proches, ce que corroborent entre autres les similitudes linguistiques du gaulois avec le thrace et le bulgare.
Certains chercheurs, dont François Pouqueville, estiment que les peuples celtes et slaves se seraient fondus en un seul. Celte et Slave seraient issus du même mot, clavo ou slava, gloire, et les Sénons auraient donné aux Slaves leur premier roi, Samo, qui a unifié les Slaves de la Lusace à la Slovénie. Astérix serait donc un peu bosnien...
Etude linguistique
L’étude de P. Serafimov Celto-Slavic similarities montre que le gaulois est la langue celtique la plus proche des langues slaves, ce qui est logique compte tenu des liens très anciens et très étroits des Gaulois avec le monde proto-slave, attestés par ces études. Il montre la proximité du gaulois avec les langues slaves des Balkans, comme le bulgare et le slovène, auxquels j’ajouterais le bosnien, et avec le tchèque. Sur la base des dictionnaires gaulois référencés à la fin de mon étude et de celle de Pavel Serafimov, j’ai recensé 500 mots gaulois liés au slave (dont 400 au bosnien), soit environ la moitié des mots gaulois identifiés. Parmi ces racines communes, on trouve :
Aimer : lubi, j’aime lubiu, lié à ljubit en sl. c., ljubiti en BSCM, lubjo en PIE et lubh en sanskrit Demander : peta, je demande petami, apparenté à pitat en sl. c., pitati en BSCM
Donner : da, je donne dami, lié à dat (sl. c.), dati (BSCM), da (PIE, sanskrit), ta (drav.), ntan (bour.), duna (élam) Distribuer : danos, rattaché à la même racine, dati en BSCM, da en PIE et en sanskrit et ta en drav., ntan en bour. Savoir, guider : vedo, je sais vedu, lié à vedet, savoir, voditi, guider en BSCM, vidjeti, voir en BSCM (je comprends), weid, savoir, voir, wed, mener en PIE, veda, vid en sanskrit, veda, du, guider, vida, voir en glozélien Coucher : leg, je couche legu, lié à lezat en sl. c., lezati en BSCM, leg en PIE, lag, poser en kartvélien Vouloir : vel, je veux velu, lié à velet (tchèque), velti (lituanien), weltis, (PIE), vouloir, venti, vouloir, aval, vel, désirer (drav.), lié à avillos, désirable (gaulois), awaaji, j’ai besoin de (bour.), zelit, désirer (sl. c.), zeljeti (BSCM) Adorer : voleo, j’adore volu, qui renvoie à voljeti, aimer en BSCM, vilaï, désirer, aimer en dravidien Penser : meno, lié à minit, penser en tchèque, men, penser en PIE, nen, man, penser en dravidien Acheter : prina, j’achète prinami, serait lié au russe krenut, acheter, au PIE krin et au sanskrit krinati Entendre : cleu, j’entends cluiu, lié à klas, oreille (BSCM, slave), kleu (PIE), kel (drav), dokoyal (bour.), entendre Tenir : je tiens, delgu, lié à dalaga (glozélien), derzu, je tiens (russe), drzati (BSCM), darza (bulgare), derg (PIE)
Frapper : bi, je frappe biu, que l’on peut rattacher au sl. c. bit, frapper, biti en BSCM, pattu en dravidien Connaitre : gn, je connais gnoiu, connu, gnatos, lié à znat, znaiu, savoir, connaître en russe, znati en BSCM, connu, poznati en bosnien, gnosketi en PIE, gnotos, connu, janati en sanskrit, kan en drav., henas en bourouchaski Dire: spatus, sagio, lié à skazat, dire (russe), kazati (BSCM), le p remplaçant k en gaulois, esa (drav.), etas (bour.) Vivre: biu, buio (Glozel), lié à zit (sl. c.), zivjeti (BSCM), jivati (sanskrit), biyu (altaïque), pu (drav.), ba, ji (bour.) Voir : vid, lié à vida (glozélien), videt (sl. c.), vidja (bulgare), vid (thrace), vidjeti (BSCM, slovène), vid (sanskrit) Porter : ber, je porte, beru, lié à brat, beru en russe, au sens d’emporter, brati en BSCM, bhero en PIE, poru, beru en dravidien, baart, apporter en bour. beru a de nombreux sens, je prends, je porte, j’emporte, je supporte, je rapporte, je juge, j’interprète un rêve, je gagne, j’obtiens, je passe du temps, je dure, j’endure, je donne.
Porter une opinion : berna, également lié à beru en gaulois et dravidien, bhero en PIE, ou barne, parler en bour.
Porter un jugement : barnami, aussi lié à beru, bhero en PIE, d’où juge, barn, et jugement, britu, barne (bour.)
Etre : bi, beto, je suis, esmi (jesam en BSCM), soyez, biete, lié à bit (sl. c.), biti (BSCM), bhu en sanskrit, ba en
bourouchaski, pu, puttu en dravidien (venir à l’existence, naître), biyu en altaïque, buion, existence en glozélien
Se lamenter : ceio, lié à kajati se, se lamenter en bulgare, regretter en BSCM, et à l’avestan kay
Glorifier : clebos, lié à slavit, glorifier en sl. c., slaviti en BSCM, du PIE klewos, gloire
Respirer : adiat, serait apparenté à dah, respirer en bulgare, disati en BSCM, duh en PIE
Parler : labaraio, garo, lala (Glozel) lié à govorit, parler (sl. c.), laprdati (argot bosnien), laparaki, gar (géorgien),
lapana (sanskrit) lapana, parler, galaba, discuter, paraï, kuru, parler, beron, langage (drav.), laau, baret, gar (bour.)
Parler : radio, rada (glozélien), lié à reci (BSCM), paraï (drav.), parler, iac, lié à jazik, langue (sl. c.), yek (bour.)
Protéger : cavo, lié à cuvat, protéger (vieux bulgare), cuvati, garder (BSCM), ka, protéger (dravidien)
Prend : gabi, lié au vieux slave gabati, à gepi, prend (bulgare), zgrabi, prend (BSCM), gabis (Vinca), kavar (drav.) Crier : iegumi, eigu en glozélien, lié au vieux slave jekati, à yek, crier en evenk (altaïque), yek, nommer (bour.) Boire : je bois, ibu, epa (glozélien), lié à piju, je bois (russe), pijem, je bois (BSCM), pibati (sanskrit), pi (kalash) Aller : je vais, agu, itao, lié à idti, idu (russe), ici, idem (BSCM), iti (sanskrit), agu, aydu, aller (drav.), hatya, je vais (kalash), hata, go, marcher (bour.), hajde (BSCM) ; le mot dérivé adagu, lié à odeidu, odem, (sanskrit uditi, drav. odu) a de nombreux sens : je vais, je conduis, je pousse, je place, je mets en mouvement, j’impose, j’inflige, je donne, je lève, j’apporte, je mets en avant, je prends une femme, je commence, j’entreprends, je procède à Aller : poudo, lié au BSCM putovati, voyager, poci, aller, au PIE pent, route et au dravidien pogu, aller Aller : steigo, que l’on peut relier au bulgare stigat, venir, à stignuti, stici en BSCM, arriver et à steigho en PIE Conduire : itaro, également lié à itao et aux mêmes racines slaves, PIE, à hata (bour.) et idaru (drav.), voyager Venir : davo, lié aux mêmes racines, à doidti en russe, doci en BSCM et va, venir en dravidien Conduire : covegno, suvendo, lié au sl. c. vodit, voditi en BSCM, et au dravidien kum, avec et vandi, aller Marcher : voreto, lié à varvja, marcher (bulgare), walesac sie, errer (polonais), valaï, marcher (dravidien)
Courir : restu, lié à hrjasti, courir en ukrainien, riskati en vieux bulgare, serait lié au vieux slave gresti
Filer : teko, apparenté à utekat, filer en slave, otuka, odu en dravidien, courir
Gémir : stanio, serait apparenté à stana, gémir en bulgare, stenjati en BSCM
Mélanger : mesga, lié à mesja en bulgare, mijesati en BSCM, mesati en slovène, du PIE miksejo
Discuter : galo, lié à galca en dialecte bulgare, golos, voix en sl. c., galgaljo en PIE, galaba en drav., gar en bour.
Marcher : keto, qui renvoie à setati en BSCM, se promener, setam en bulgare, hata en bourouchaski
Accuser : comsoudo, rattaché au sl. c. sudit, juger, suditi en BSCM
S’asseoir : sedo, rattaché au sl. c. sedet, sjesti en BSCM, sed en PIE, sidati en sanskrit, sit in bour., rester immobile Diffamer : cablaro, que l’on peut relier à klebeta en bulgare et klevetati en BSCM
Couper : seco, lié au sl. c. sekat et au PIE sek, couper, sjeci en BSCM, sek (Vinca), sekuris, hache (PIE), sagaris, hache (scythe), sekira, hache (BSCM), sagari, faucille (dravidien), skarc, couper (bour.), sahsi, couper (élamite) Acquérir : cabo, que l’on peut relier à kupit, acheter en slave commun, kupiti en BSCM, kon en dravidien Festoyer : comedo, lié à edo, manger, jest (sl. c.), jesti (BSCM), edmi (PIE), ite (altaïque), kum et jam (dravidien) Manger : edo, lié à jesti, jedem, manger (BSCM), edmi (PIE), ad (sanskrit), jam (drav.), ite (alt.), eda, eza (Glozel) Appeler : galo, que l’on peut relier à volat en slave et à glasati se en BSCM, kal en dravidien, gar en bourouchaski Adhérer : glina, lié à glina, argile en slave et à gloido en gaulois, glu, klej, colle en sl. c., du PIE glej, kol en drav. Désirer : lato, qui renvoie à laska, amour en tchèque, laskati, complimenter en BSCM, pourrait venir de l’alt. Lécher : leigo, qui renvoie à lizat, lécher en slave, lizati en BSCM, last, lécher en bourouchaski Se reposer, se calmer : samo, sama en glozélien, serait lié à smiriti se en BSCM, sam, tranquille, samis en PIE Sauter : skak, renvoie à skakat, sauter en slave, skakati en BSCM, du PIE skek, sauter, du dravidien kuti Gratter : skrib, renvoie à skrobat, gratter en slave, skrabati en BSCM Crier : skrizda, renvoie à kricat, crier en slave, kricati en BSCM, krosati en sanskrit Glisser : sleid, renvoie à slizgat, glisser en slave, sklizati en BSCM, pourrait être issu du dravidien lamba S’arrêter, se dresser, se maintenir : staio, lié à sista (Glozel), stoit (sl. c.), stajati (BSCM), sta (PIE), dstay (bour.) Fondre : taio, que l’on peut rattacher à taiat en slave, taliti en BSCM, titami en PIE, tajin en ossète, tao en bour.
Couler : liyo, que l’on peut relier à lit, verser en tchèque et liât, verser en slovaque, lijevati en BSCM
Poser : sista, dérivé de sta, être debout, sista (Glozel), lié à stat (sl. c.), stajati (BSCM), sta (PIE), dstay (bour.)
Chercher : sagi, que l’on peut lier à iskat, chercher en vieux slave et russe et à segh, chercher en PIE
Pâtir, souffrir : passa, patha (glozélien) lié à patit (sl. c.), patiti (BSCM), même sens, patu (drav.), souffrir
Porter : troga, lié à traga, tirer (glozélien), tragat (sl. c. et roumain), trainer, viendrait du dravidien tocana, porter
Epargner : smerto, renvoie à sberegat en russe, épargner
NDR : selon le dictionnaire français-gaulois, la première personne du singulier se termine en u, en iu ou en mi pour les verbes en a. On peut en déduire les terminaisons proposées, sans certitude, semblables au slave.
Papa, père : tatis, tata en glozélien, lié à tata en slave, ater, lié à ata en slovène, otac en BSCM, tata et attas en PIE, tata et attam en drav, atta en élamite, tati et tata en bour., qui aurait également donné le français maître Mère, maman : matir, mama, lié à mat et mama en slave, mater, mati en BSCM, mama en bour., amman, atteï en drav., amma en élamite, Mamma, Matrikas, Déesse-mère en dravidien, qui aurait donné le français matrone Homme : viro, vira (glozélien), lié à wiros, homme (PIE), oior, homme (scythe), ferta, homme (bulgare), vyras, homme (lituanien), vir, homme (Vinca), vir, homme valeureux (drav.), wer (kartv.), biru (bour.), viril en français Femme : dea, lié à da, mère en scythe et en géorgien, deva en slovène, djeva en BSCM, vierge, taj, mère en Drav. Femme : bena, que l'on peut relier à zena, femme en slave, le b remplaçant le g en gaulois, ainsi qu’à gwen en PIE, pen en dravidien et genis, reine en burushaski. Le mot bona désigne également une femme en bosnien. Frère : brater, qui renvoie à brat en slave commun, bhrater en PIE
Sœur : suesor, suestos, que l’on peut lier à sestra, sœur en slave, swesor en PIE, sis en glozélien, sutu en élamite Jeune fille : geneta, lié à Yo, Déesse de la fécondité en glozélien, de Yoni, Déesse-Mère de la culture dravidienne de l’Indus, zena, femme (sl. c., BSCM), jani, femme (sanskrit), cinnadi, jeune femme (drav.), genis, reine (bour.) Fille : morugena, lié à zena, femme (sl. c., BSCM), genis (bour.), mari, jeune, et zana, femme en élamo-dravidien Fille : duxtir, lié à doc, fille (russe), dasteija, fille (bulgare), dasin, fille (bour.), dughter, fille (PIE), ir, fille (drav.) Fils, garçon, enfant : mapos, magos, maqa en glozélien, lié à momak en BSCM, le k étant remplacé par un p en gaulois, PIE maqos, dravidien maka, mago, altaïque muko ; muskatos, jeune homme, lié à muskarac en BSCM. Neveu : neptos, que l’on peut relier à necak, neveu en BSCM, de nepot, neveu (PIE), anip, parent (élamite) Nièce : nepta, que l’on peut relier à necakinja, nièce en BSCM, de nepot, neveu (PIE), anip, parent (élamite) Belle-mère, beau-père : svekru, svekrno, liés à svekrva et svekar en BSCM, issus du PIE, skus, skir en bour. Veuve : widwa, que l’on peut lier à vdova en sl. c., udovica en BSCM
Descendant : selos, serait lié à celjad, famille, descendant en bulgare, comme en BSCM, à l’altaïque kelu-me Famille : catus, relie à kentas, enfant en thrace, cado, enfant en ancien slave et BSCM, et canda, enfant en drav.
Agneau : ognos, ogna en glozélien, apparenté à jagnja, agneau en slave, jagnje en BSCM, egnos en PIE Brebis : ovica, ovi en glozélien, lié à ovca, brebis en sl. c., notamment en BSCM, owis en PIE, huis en bour. Berger : ovitarios, lié également à ovca, et à ovcar, berger en BSCM et slovène, avipala en sanskrit Chat, chatte : cattos, catta, lié à kot, chat en polonais, katta en PIE, viendrait du dravidien kotti, chat Oie : gansis, lié à ges, gus, guska, oie en polonais, russe et BSCM, gans en PIE, gaso en altaïque Corbeau : branos, lié au mot slave vrana, corneille, notamment en BSCM, du PIE worn Corbeau : garanos, est apparenté à gavran (BSCM), garvan (bulgare), karaku (drav.) garuuyo (bourouchaski) Corbeau : krouk, que l’on peut relier à kruk, corbeau en polonais au dravidien karaku et au bour. garuuyo Hérisson : egi, lié au slave jez, hérisson en slave, notamment en BSCM, du PIE eghi
Vache : keva, lié à gu, vache, guta, Déesse-vache (Glozel), goveda (slovène), gava (sanskrit), kev, veau (drav.), korova (russe), krava (BSCM), vache, karuvu (drav.), vache, karnon, drav. kor, bour. kar, corne, har, boeuf Chouette : cava, lié à sova en bulgare, slovène et BSCM, le c remplaçant le s en gaulois, ga en altaïque Castor : beber, lié à bober en slovène et bobar en bulgare, dabar en BSCM et à bhebhros en PIE Cheval : caballos, lié à kobila, jument, notamment en BSCM, drav. seval, étalon, PIE kablnos, bour. kabut Cheval : marca, lié à marca en thrace, mrha en slovène, mrkov en serbe, markos en PIE, morv en altaïque, mari, jeune cheval, jument en dravidien
Cheval : komonj, cheval de bataille en slave, d’où est issu konj, cheval en sl. c., serait lié à cammanios, équitation
en gaulois, lié à konk, cheval en celte, qui renvoie à kanam, nourriture pour chevaux en dravidien
Taureau: tarvos, de tura (bulgare), tur (russe, tchèque), taru (Vinca), taureau, toru, boeuf (drav.), tor, corne (bour.)
Porc : su, sua, su en glozélien, lié à svinja, porc en slave et en BSCM, et sus, swinos en PIE, su en sanskrit
Porc : orko, que l’on peut lier à prasa en slave, prase en BSCM, porc, porko en PIE avec perte du p
Cerf : elantia, est apparenté à jelen en slave et notamment en BSCM et à elen (PIE), ilaru (drav.), elgit (bour.)
Poulet : cerca, lié à kurica en sl. c. et kokos en BSCM et à kerkos, poule en PIE, kor, coq en dravidien
Poule : kerka, lié au sl. c. kura, poule, kokoska en BSCM, kerkos, poule en PIE, et kor, poule en dravidien, koska étant le pluriel de kor en dravidien, ce qui consolide cette étymologie
Chèvre sauvage : iorcos, lié à jarac, bouc (BSCM), jorkos (PIE), elgit (bourouchaski), era (drav.), chèvre Loup : volpos, lié à volk en slave, vuk en BSCM, le p remplaçant le k en gaulois, viqo, vlqo en PIE Belette : assa, rattaché au tchèque jasienka, au BSCM lasica
Chamois : kamoke, lié à kamzik en tchèque, serait lié au drav. gana, troupeau d’ovins, à l’élamite kumas, bouc Carpe : karpa, que l’on peut relier à karp ou kapr en slave
Saumon, esturgeon : asso-esox, lié à losos, saumon (slave), jesetr (BSCM, slave), jazin (altaïque), esturgeon Grue : garanos, lié à zuraw, grue en polonais, au PIE gerh, au dravidien kuruku, au bourouchaski garuuyo, héron Fourmi : morvi, qui renvoie à mravenec, fourmi en tchèque, mrav en BSCM, morwi en PIE Escargot : selekio, renvoie à slimak, escargot en polonais, sleimaks en PIE
Ours : matu, lié à medved en sl. c., issu du sanscrit madhvad, mangeur de miel, matu, miel en dravidien Ecureuil : viveros, lié à wiewiorka, écureuil en polonais, vjeverica, écureuil en BSCM Patte : uranka, lié à ruka, bras en russe et en BSCM, lié au dravidien eraka, bras, au bourouchaski ren, main Petit animal : milo, lié à mali, petit en slave, milo, petit et cher en BSCM, et à mari, jeune en dravidien
Des mots liés à l’agriculture :
Siège, selle : sedlon, sedo, relié à sedlo, selle en slave et en BSCM, sedla, siège en PIE
Avoine : ieva, lié à evja, grain (vieux slave), java (sanskrit), juwari (Kalash), viya (dravidien), baï (bour.)
Seigle : sata, lié à zito, seigle, notamment en BSCM, lié à sitya en sanskrit, sita, sorte de blé en glozélien
Houe : kapia, serait apparenté à kopac, houe en bulgare, et à kopati en BSCM
Lin : lino, qui correspond au vieux slave linu au russe len et au BSCM lan, du PIE lino
Pieu : stabo, apparenté à stobor en bulgare, et à stablo, tronc en BSCM
Labourer : aratro, arare, lié à orat, labourer en sl. c., orati en BSCM, ar en drav, har en bour, harpi en élamite Agriculture, cultiver, labourer : aro, lié à la même racine, du PIE aratron, arjo, du dravidien ar, du bour. har, gark Agriculteur : artaios, lié aux mêmes racines, que l’on peut lier au vieux slave ortaj, au bour. har, au drav. uravan Charrue, araire : ario, lié à la même racine, qui serait issue du scythe arei, laboureur, ar en drav., har en bour. Charrue : aratro, lié à oralo, charrue (bulgare), orat, orati, labourer (slave, BSCM), (k)ar(u) (drav.), har (bour.) Joug : jugo, yuka (Glozel), lié à igo (BSCM), jeugom (Vinca), jugom (PIE), yuga (sanskrit), nukam (dravidien) Grain : carnu, que l’on peut relier à zrno en BSCM et en tchèque, karn, moudre en dravidien, gur, blé en bour. Graine : asiam, lié à semo (Glozel), sjeme, graine (BSCM), semn en PIE, simbi en dravidien, siman en élamite Grain : granio, lié à gran (tchèque), granio (PIE), hrana, nourriture (BSCM), gur, blé (bour.), karn, moudre (drav.) Serpe: serro, renvoie à serp ou srp (sl. c., BSCM), serpe, srpa (PIE), sagari, faucille (drav.), bisars, faucille (bour.) Pelle : palo, renvoie à bel, pelle en bulgare, ainsi qu’à lopata, pelle, en sl. c. et en BSCM Meunier : melitorios, lié au slave melit, moudre, mljeti en BSCM, melo en PIE, mel, broyer en dravidien Moudre : melo, même racine, lié à melo (PIE), mole (alt), mel, broyer en mastiquant (drav.), mul, gruau (bour.) Traire une vache : mlitsi, qui renvoie à mleko, lait en slave, mlijeko en BSCM
Des mots liés à la nourriture ou à la boisson :
Pitance, vie : biveto, lié à biée, existence (BSCM), jivatu, pitu (sanskrit), phiti (bour.), nourriture, putu (drav.) Nourriture : mastia, lié à meso, viande ou mast, graisse (BSCM), mas en sanskrit, mos en kalash, viande Eau : od ou boglo, lié à voda en slave, wodr ou woda en PIE, eau, otam en dravidien, bodoo en bourouchaski Vin : vinom en gaulois, apparenté à vino, vin en slave et notamment en BSCM, woinom en PIE Cuisinier : poppos, pep, lié à pekar, boulanger (BSCM), peqo (PIE, altaïque), bege, feu, becc, cuire (drav.), le p remplaçant le k en gaulois, paé en sanskrit, paqu, miche de pain (bour.), pec, chaud (kalash), peéi, cuire (slovène) Cuisinière : popa, lié aux mêmes racines ; on peut relever que klopa signifie nourriture en bosnien Boulanger : poperos, lié aux mêmes racines, pekar en BSCM, paqu, miche de pain en bourouchaski Cuisine : pobano, lié aux mêmes racines, du PIE peqtis, cuisine
Sel : salo, lié au slave sol, notamment en bosnien, salto, salé, slan en BSCM, lié à sal en PIE
Miel : melu, lié à med, miel en slave et en BSCM, melit en PIE, madhu en sanskrit, mattu en dravidien, aussi lié
à mel, doux en dravidien, que l’on retrouve dans le caucasien mal, mel, résine en élamite, mel, vin en bour.
Hydromel : medu, lié à med, miel en sl. c. et BSCM, madhu en sanskrit, mattu en dravidien, mel, vin en bour.
Oignon, ail : cremo, kasnina, rattaché au bulgare kromid, kremusom en PIE, et à cesnok, ail en slave
Lait : bligu ou melgos, lié à mlijeko en BSCM ou moloko en russe, molgije en PIE, mal en dravidien
Graisse : smer, smero, enduire, lié au polonais smar, graisse, du PIE smerus, mast en BSCM
Pomme : aballo, lié à jabalka (bulgare), jabuka (BSCM), abolo (Vinca), abelos (PIE), balt (bourouchaski)
Myrtille : brucos, lié à boruvka en tchèque, borowka en polonais, borovnica en BSCM
Carotte : mekon, qui renvoie au russe markov, carotte, mrkva en BSCM, mrka en PIE
Soupe : iutta, jusko, lié à juha, soupe en croate, issu du sanskrit jus, du dravidien jupa, aliment liquide
Farine : mlato, lié à mole (alt.), melit (sl. c.), moudre, mljeti (BSCM), mul, gruau, gur malao, millet en bour. Pâte : tausto, que l’on peut rattacher à testo, pâte en slave, tijesto en BSCM
Jus : sugo, lié à sok, jus en slave et en BSCM, soukos en PIE, voire au dravidien saru ou au bour. cel, jus
Cuiller : leiga, qui renvoie à lizica, cuiller en slave, zlica en croate, leigla en PIE
Auberge : kurmi-tegos, maison où l’on boit de la bière (kremon en PIE), relié à krcma en slave
Chêne, bois : dervo, lié à drvo, bois (BSCM), daru (thrace), druea (Vinca), dru (sanskrit), dara (glozélien)
Hêtre : bagos, que l'on peut relier à buk, hêtre en slave, bukva en BSCM, bego en PIE, behek en bourouchaski Orme : lemo, apparenté au russe ilem, orme
If : ivos, eburos, liés à iva, saule en russe et BSCM et à bor en bulgare, BSCM et slovène Erable : abolos, lié à javor en BSCM et en tchèque et à jablan en BSCM, peuplier
Cormier : kormia, lié à kormit, nourrir (sl. c.), krmi, (BSCM), kur, nourriture (drav.), garma (bour.) kurmi, bière
Tilleul : leima, qui renvoie à lipa, tilleul en slave et notamment en BSCM et à leipa en PIE
Aulne, verne : verna, lié à vrba en BSCM et en tchèque, saule, issu du PIE wernas
Pin : osno, apparenté à sosna, pin en russe, polonais, tchèque
Foret : gorca, lié à gorica, petite foret en bulgare, gora, montagne boisée en BSCM
Pommeraie : abalon, lié à iablon, pommier en russe, et à jabuka en BSCM
Hêtraie : bokonia, que l’on peut relier à buk, hêtre, bukva en BSCM, bego en PIE, behek en bourouchaski Bocage : leno, que l’on peut relier au slave les, foret
Verger : baciua, lié à basta ou baca, jardin en bosnien, bagh, jardin en sanskrit, basi, verger en bourouchaski Branche : canka, lié à sanka, branche (vieux bulgare), kankus (langue de Vinca), konka (drav.), sak, bras (bour.) Foret : ceto, ketiya, lié à ceta (bulgare, slovène), cetinarja, forêt de résineux en BSCM, katu en dravidien Arbuste : prestio, lié à krzak, buisson (polonais), hrast, chêne (BSCM), issu du PIE krsnos, buisson
Des noms liés à la nature :
Marécage : bagno, lié au polonais bagno, mucuno, relié à mocvara en BSCM et à mokriste en bulgare, lato, que l’on peut rattacher à blato en bulgare, slovène et BSCM, lat en PIE, bel en bour. et ula, boue en dravidien Parcelle de terre : olca, lié à polosa en slave, plasa en BSCM, avec perte du p, pallam, parcelle en dravidien Mer : mori, lié à morje en sl. c. et en BSCM, mar en thrace, mori en scythe, mari en PIE et en dravidien Fleuve : danu, lié à Danube, Danu (Vinca), Don, Dniepr, Dniestr, Rhône (Rhodanus), à l’Odon breton, au scythe et PIE danus, au drav. tundna, verser de l’eau, à l’élamite da, au kartv. dun, couler, au bour. dala, canal Fleuve : renos, qui renvoie au Rhin, et cours d’eau, iko, seraient liés à rijeka, rivière en slave avec perte du r et à rei, couler en PIE, à aru, orivu, rivière en dravidien, oruku, couler en dravidien
Cours d’eau : onna, d’où sont dérivés la Saône, l’Una, la Sana, la Bosna, lié au drav. amm, élamite hun, eau
Cours d’eau : proudis, que l’on peut rattacher à prud en slave, courant et à oruku, couler en dravidien
Glaise : glesa, glisia, qui renvoie à glina, argile en slave et notamment en BSCM
Source : beru, lié à izvor en BSCM et en bulgare, lié à bheru, source en PIE, uru, source en dravidien
Lac : louco, qui renvoie à lokev en slovène, ou à loky, mare, lakus, lac en PIE, lanka, vallée en ossète
Pont : briva, lié à brv, pont, tronc d’arbre en slovène, brivna en bulgare, brvno en BSCM, bhrewa en PIE
Lande : landa, qui correspond au russe liada et au BSCM landa, friche, londhom, terre en PIE
Plaine : lano, lié à poljana, plaine, polje, champ (sl. c. et BSCM), plano, plat en PIE, pallam en dravidien
Terre : ialo, lié à ila, boue (bulgare), ilovaca, terreau (BSCM), jalov, terre stérile (BSCM), ula (dravidien)
Colline, mont : briga, bergo, barro, lié à brdo, brijeg, colline (BSCM, slovène, bulgare), breg, brig (serbe), berg
(thrace), breg (géorgien), berkat (bour.), bhroigos, sommet en PIE, porraï, colline fortifiée en dravidien
Colline, mello, serait apparrenté à mola, colline en vieux bulgare, et au dravidien malaï, colline
Colline : cambos, peut être lié à kapa en thrace, kopa en slovène, koppa, kumba en dravidien, colline
Dune, colline, tumulus : duno, dumyon, lié à dun (thrace), djuna (bulgare), dina (BSCM), don (bour.) et dimmi
(dravidien), qui aurait donné dimb, kourgane en PIE et roumain ; kourgane viendrait aussi du dravidien
Rocher : acamno, lié à kamen, pierre (sl. c., BSCM), acmon (thrace, PIE), kal (dravidien), uhuma (élamite)
Dalle : lica, qui viendrait de plita, mais que l’on peut aussi relier à lana, plateau en glozélien, planina, montagne
en BSCM, qui viendrait de terrasse rocheuse, le p tombant en gaulois et à litica, falaise en BSCM
Sommet : corro, lié à krai (bulgare), okris (PIE), sommet kar, rocheux (drav.), goro (bur.), har (élam), pierre
Ciel : nemos, lié à nebo, ciel (sl. c. et BSCM), nabha (sanskrit), vannam (dravidien avec perte du va)
Nuage : neblos, qui renvoie également à nebo, ciel, au PIE nhebes, nuage et à vannam en dravidien
Vent : ventos, qui renvoie à veter en sl. c. et en BSCM, à vatas en sanskrit, à vata, vandu, vent en dravidien
Temps humide : wolko, que l’on peut lier à vlhko, humide en tchèque et slovaque, vlazan en BSCM
Soleil : sonno, sauli, lié à sonce (slave), sunce (BSCM), saul (scythe), sul en dravidien, brûler, sa, soleil en bour.
Coucher de soleil, occident : sauli-sedata, de sauli, soleil et sedet, s’asseoir en slave
Lune : louna, que l’on peut rattacher au russe luna, lune, louksna, lune en PIE, ilanka, briller en dravidien Nid : nizdo, qui renvoie à gniezdo, gnijezdo en BSCM, issu du PIE nisdos
Des mots liés au corps et à la santé :
Tête : gabala, lié à golova, glava tête (russe, BSCM), ghebhla (PIE), bhala, front (drav.), gapal, tête (bour.)
Bras : brek, en celte, que l’on peut relier à ruka, bras en slave, notamment en BSCM, eraka (drav.), ren (bour.)
Genou : glin en gaulois, lié à koleno en slave, koljeno en BSCM, kel en PIE, kel, kanu en dravidien
Cheveu : voltos, lié à volos, cheveu en russe, vlasi en BSCM, wolnos en PIE, varasa en avestan, val en dravidien
Ventre : bru, lié à brukho, ventre en russe, bricho en tchèque, bura en dravidien
Oreille : aus, apparenté à usho, oreille en bulgare, uho, oreille en BSCM, ousis en PIE
Œil : ops, oklo, lié à oko, œil (sl. c.), oqos (Vinca), aks, vue, kon, œil (drav.), elci, oeil (bour.), oci, yeux (shina) Nez : nasios, qui renvoie au sl. c. nos, issu du PIE neh, pourrait être lié au dravidien muso, nez, mos in bour. Vue : okulos, également apparenté à oko, œil en slave, aks, vue en dravidien
Sourcils : bruvi, lié à brovi (russe), obrve (BSCM), bhrus (PIE), buru (drav.), sourcils, bur (bour.), cheveux
Bouche, lèvre : bussu, lié à pusa, bouche (tchèque), baiser (BSCM), bukka, bouche (drav.), buk, gorge (bour.)
Bouche : stam, oza (glozélien), lié à usta, bouche (bulgare, BSCM, slovène et russe), os (PIE), utatu en dravidien
Barbe : granda, qui renvoie à broda, barbe en slave, brada en BSCM, issu du PIE bharda
Joue : likko, que l’on peut relier à lico, visage en slave, lice en BSCM
Cou : varro, relié à vrat, cou en bulgare, BSCM et slovène
Fesse : tucna, serait apparenté à tucno, gras en slave...
Anus : cuzdo, serait apparenté à gaz, anus en bulgare, du bourouchaski skus, anus
Langue : jectis, lié à jazik, langue en Slave, jezik en BSCM, et au PIE egtis, au bour. jungus, langue
Front : talo, apparenté à celo, front en vieux slave et en BSCM, lié à talaï, tête en dravidien
Cœur : kridyo, que l’on peut lier à srdce en sl. c. et en BSCM, au PIE kert et au dravidien hrdro, cœur
Sang : croeso en gaulois, relié à krov, sang en russe, krv en BSCM, krews en PIE, kuruti en dravidien
Peau : cuda, rattaché à koza, peau en Slave, notamment en BSCM, viendrait du sanskrit kosa
Dos : akrestia, renvoie à krast en bulgare et à krsta en BSCM
Gorge : guesia, renvoie à gusa en bulgare et en BSCM
Santé : slano, relié à cijelen, soigné en BSCM et à celenie, soin en bulgare
Maladie : balo, lié à bol, douleur (sl. c., kartv.), bolan, malade (BSCM), vali, faire mal (drav.), bal, malade (bour.) Toux : kuso, que l’on peut lier à kasel en sl. c., kaSalj en BSCM, toux, khos en bourouchaski, tousser Pus : goru, qui renvoie au bulgare gur, pus
Des chiffres, qui renvoient au slave et au lituanien, ainsi qu’à l’indo-européen et au sanskrit :
Un : oinos en gaulois, ena en glozélien, lié à vienas en lituanien, au slovène eno, au dravidien onn, au bour. hen, premier, remos, lié à pre, devant en serbe, purme, avant en bur., le p tombant en gaulois ou au scythe arima, un Deux : duo, dui en celte, lié à dva, dvje en slave commun, dva en glozélien, allos, second, lié à altan, deux (bour.) Trois : tri, identique en slave commun, troisième, tritos, treci en BSCM
Quatre : petuar, qui renvoie à kietury en lituanien, le p remplaçant le k en gaulois, cetiri en BSCM
Cinq : pempe, lié à pet (BSCM), cinquième pimpetos, même racine, ancu (drav.) avec perte du p, cendo (bour.)
Six : swech en celte, qui renvoie à sest en slave commun et en BSCM
Sept : sait en celte, qui renvoie à sedem dans plusieurs langues slaves ou à sedam en BSCM
Huit, oxto en gaulois, prononcé okhto, qui renvoie à osem en slave, osam en BSCM, ettu en dravidien
Rouge: rudos, lié à rudy, rouge (tchèque), rid, roux (BSCM), rudhros (PIE), arattam (drav), bardum (bour), rouge Bleu : livo, lié à sliva, prune en slave commun, sleiwos en PIE, le gaulois perdant le s, voire du kartvélien kliavi Bleu-vert : glaston, renverrait à zelen en bulgare, BSCM, ghlastos en PIE, giltir, au sens de jaune-vert en bour. Blanc: balaros, lié à belo, blanc en sl. c., bhlaros, blanc en PIE, vel, val, blanc en drav, bel, borom, blanc en bour Blancheur : balio, qui renvoie à belo, blanc en slave commun, bhlaros en PIE, val en dravidien Noir : dubus, lié à dim, fumée en slave commun (enfumé, donc noirci), dumas en bour., dhubnos en PIE Gris : letos, signifie aussi âgé, serait lié à ljeto, dans le sens d’année en sl. c., paraïtu en dravidien, âgé Jaune : gelo, gilvos, lié à zelt (bulgare), zolt (slovène), zut (BSCM), ghltnos (PIE), giltir, briller, jaune (bur.)
Des mots désignant le froid ou la chaleur :
Neige : snig, qui renvoie à snieg en slave, snijeg en BSCM, sneighs en PIE
Glace : iegis, lié à led, glace (sl. c.), iegis (PIE), giye, snow (bour.) serait issu du proto-ouralique jeng Neige : ladgo, qui renvoie aux mêmes racines
Chaleur : tepes, lié à teplo, chaud (slave), toplo (BSCM), teps, chaud (Vinca), tep (kartv.), ted (dravidien) Chaleur (animale) : lato, ljet en sl. c., lié à lato, été en polonais, ljeto, été en slave et en BSCM
Chaud : gormo, lié à goriatchi, chaud (russe), gorjeti, brûler (BSCM), gher (PIE), greh (drav.), garum (bour.)
Des mots liés au savoir liés au sl. c. veda, science, au sanskrit veda, savoir, au drav. vidvas, homme éduqué:
Sagesse, sage : veda, vedos, lié à veda (glozélien), veda, sagesse, vedec, sage (slovène), vittia (Vinca), sagesse Connaissance : vedio, suvidias, lié à vednost, connaissance en serbe, veda, science en tchèque, veda en glozélien Devin, prophète : vatis, lié à vjestac, sorcier en BSCM, vidlua, sorcière en gaulois, wedya, prière
Des mots liés au pouvoir et à la guerre :
Gaulois : Gal, lié à gala, puissant (glozélien) au slavon golema, puissant, au bulgare golemeja se, être fier, golemec, personne puissante, au BSCM golem, géant, à galnos, pouvoir et gaulois en PIE, à kali, héros en drav. Celte : Kelt, serait lié à clouto, glorieux (klutos en PIE), apparenté à clavo, gloire, kalve en glozélien, slava en sl. c., ou à kaleto, dur, héros, apparenté au bulgare kalen, au PIE kaletos, dur et à kali, héros en dravidien Gloire : clavo, livo, kalve en glozélien, lié à slava, gloire en sl. c., le c remplaçant le s en gaulois, klewos en PIE Puissance : vlato, lié à vela en glozélien, vlast, pouvoir en sl. c., au PIE wehl, diriger et au dravidien val, fort Présider : versed, qui signifie être assis au-dessus, renvoie à predsjedati, présider en BSCM Chef : cen, penno, lié à kan en vieux bulgare, pan en polonais et en tchèque, kon, chef en dravidien ; cen signifie tête en dravidien, comme pen, tête, penno en gaulois, désignant aussi Dieu en dravidien, qui pourrait être à l’origine du nom du Dieu Pan adoré par les Dravidiens et les Gaulois, notamment dans l’actuelle Crimée Chef : counos, lié à kan, chef en bulgare et altaïque, knez, prince en BSCM, kon, chef en dravidien Chef : brennos, serait apparenté à barin en russe, maître ou seigneur
Chef : vlatos, lié à vladar, dirigeant (BSCM), vlast, pouvoir (sl. c.), vela (glozélien) et vel, chef en dravidien Commandant : vellaunos, lié à vladar, dirigeant (BSCM), vlast, pouvoir (sl. c.), vela (glozélien), vel (dravidien) Souverain : valos, lié à vladar, souverain (BSCM), vela, chef en glozélien, vel, roi, chef en dravidien Maître : valo, lié à balen, maître en thrace, veljak, maître en slovène, vela, chef en glozélien, vel en dravidien Justice : viroioniia, que l’on peut relier à verit, croire, vjerovati en BSCM, au PIE weros et au bour. warc Loyauté : virido, relié à verit, croire, vjerovati se, se faire confiance en BSCM, au PIE weros et au bour. warc Loi : kanis, que l’on peut relier à zakon, loi en slave et en BSCM, ou à kaznit, punir en slave Serviteur, vassal : vassos, qui renvoie au BSCM vazal
Assemblée : comboro, lié à sabor (BSCM, bulgare), zbor (slovène), kampala (drav.), kaa bar, discuter avec (bur.) Assemblée : comrato ou rato, est lié à rada en ukrainien, assemblée
Assemblée : samonios, lié à sejm, assemblée en polonais et à samanam, assemblée en sanskrit
Vérité : virotus, lié à la racine vjero de vjerovatno, vraisemblable en BSCM, au PIE weros et au bur. warc
Peuple : teuta, touta en glozélien, lié au Dieu Teutates, Teta en glozélien, à teuta, peuple en PIE et illyrien, teuto
en langue de Vinca, tanda, todu, foule en dravidien, tjude en thrace et en vieux bulgare, qui aurait donné ljudi,
gens en sl. c., qui pourrait aussi être lié à lidos, foule en gaulois, lao, peuple en glozélien, et au PIE lewd, peuple
Victoire : budi, serait apparenté à pobeda, victoire en russe, pobjeda en BSCM
Soldat : katos, lié à cetnik, soldat en bulgare, ceta, brigade en BSCM et slovène, kanta en dravidien
Combattant : rakatos, que l’on peut rattacher aux mêmes racines et à katos, raukos, dur en PIE
Bataille : katu, kata en glozélien, lié aux mêmes racines, à kotora, combat en russe, bitka, bataille en BSCM,
kadu, faire la guerre en dravidien, katti, épée en dravidien, kadi, blesser en dravidien, pataï, bataille en dravidien
Fort : kater, lié à kata, camp en vieux bulgare, au katun des Vlasi en BSCM, à kottaï, fort en dravidien
Combattre : batu, lié à pata, biti, battre en scythe, bit, battre en slave, biti en BSCM, pattu en drav, bet en élamite
Combat : battu, lié à bit, battre en sl. c., bitka, bataille en BSCM, pattu en drav, battre, bet en élamite, combattre
Groupe, troupe : ceterna, apparenté à ceta, brigade en BSCM et slovène, katu en drav, hit, armée en élamite
Groupe : corio, lié à hor (BSCM), hora (bulgare), groupe, koijos (PIE), hol (bour.), armée, kuran, défense (bour.)
Unité armée : drungos, serait apparenté à drunga, unité armée en vieux bulgare, et à druzina, détachement en
BSCM et famille en slovène, drug, ami au sens compagnon d’armes, du PIE dreugho
Troupe : slougo, qui renvoie à sluga en slave, serviteur, sloughos en PIE
Glaive : cladibo, lié à kalica en bulgare, kljewos en PIE, katti en dravidien et kladivo, marteau en sl. c.
Des mots liés à la religion :
Dieu : Devos, lié à Divos en glozélien, deva, vierge, djeva en BSCM, Deivo, Deiva (Vinca), devu en dravidien Dieu : Mogetios, Mogon, lié à moguci, puissant (BSCM), mogho, pouvoir (PIE), magado (dravidien)
Dieu : Baco, dieu adoré à Chalon sur Saône, lié à Bog, Dieu en Slave, Bago en scythe, Bhaga en dravidien Lug : l’un des plus importants Dieux gaulois, vénéré également par les Serbes, dont le nom est lié à luc, lumière (sl. c.), velicham (drav), balichom (bour), luk (élam). Une trentaine de noms de Dieux gaulois sont liés au slave. Belenos : important Dieu gaulois, lié au Dieu slave Belebog, Velinas en lituanien, lié à vel en dravidien Druide : drui, de daru, arbre (thrace), drvo (sl. c.) et vid, voir (thrace), vidjeti (sl. c.), Der, Dieu, vid, voir ? (drav.)
Montagne : perkunio, lié à perkunas en lituanien, perkunjom en PIE, renvoie au Dieu slave Perun, Perune en kalash, à erkos, foret de chènes en gaulois, à la mythique foret hercynienne des Gaulois, dont le nom viendrait du dravidien perkuni, pousser (pour les arbres), confortant l’origine dravidienne de la religion gauloise.
Foret sacrée : drunemeton, foret sacrée des Galates, serait issue de daru, bois en thrace, lié à drvo, derevo en slave, et nemo, lié à nebo, ciel, ou de deru, bois, nemeton, sanctuaire en PIE, ou de Der, Dieu, vanam, foret, ciel, montagne, que l’on peut associer à foret sacrée en dravidien, avec perte du va en gaulois. Le fait que plusieurs montagnes boisées tirent leur nom de vanam (Morvan en France, Van en Suisse), comme les montagnes sacrées dravidiennes Vindhya en Inde, qui auraient donné leur nom au mont Vindius (ou Vinnius) en Asturie (Espagne), où Pline plaçait déjà la tribu indienne des Bolinges (il nomme aussi les Télougous Trilinges), et à vidua, foret en gaulois, conforte cette étymologie dravidienne, cohérente avec l’origine dravidienne de la religion gauloise. Les Dravidiens seraient à l’origine du culte de l’arbre. Les Glozéliens préceltiques priaient déjà Jana, Déesse de la Foret, ancêtre de la Diane romaine. Même le mot français foret pourrait venir de poril, foret en dravidien. Sacrifice : odberto, que l’on peut rattacher à od, de et beru, prendre et à ida, donner en sacrifice en glozélien Sacré : noibo, lié à nebo, ciel (sl. c.), nemo, ciel, nemu, lieu sacré (Glozel), vanam, ciel (drav), nap, Dieu (élam) Louer, rendre un culte : mol, mola en glozélien, lié à moliti, prier en BSCM, voire à moli, parler en dravidien Louange, prière : malo, molatus, mlatio (glozélien) lié à molitva, prière en BSCM, voire à moli en dravidien Glorifier : moleio, lié à la même racine, issue du PIE moldhos, prière, voire à moli, parler en dravidien
Des mots liés au temps :
Jour : diio, din en gaulois, lié à den en slave et dan en BSCM, dinos en PIE, din en dravidien, den en bour.
Soir : ucher, veskero en celte, lié à vecer en slave commun, notamment en BSCM, wespros en PIE
Nuit : nox (prononcé nokh) ou nocs, lié à noc en sl. c. et en BSCM, noqti en PIE, maxa en dravidien
Maintenant : nu, aussi en glozélien, lié à nu (russe, BSCM), no (polonais), nu (PIE), nana (drav.), muu (bour.)
Journée : lat, lié à ljeto, désignant une période de temps variable selon les langues, latom en PIE
Aujourd'hui : sindidiu ou se divos, lié à segodnia, aujourd’hui en russe, djeu en PIE et sid, jour en dravidien
Hier : gdesi, que l’on peut lier au polonais gdzies, autrefois
Période de temps : remessos, lié à vrijeme en BSCM, vremia en russe, temps
Mois : mid en gaulois, mana en glozélien, lié à miesiac, mjesec en BSCM, mez en abkhaze, mens en PIE Année : bletho, serait apparenté à ljeto, année en slave commun et en BSCM
Hiver : giamos, lié à zima, hiver (polonais), zima (BSCM), gil, froid en alt., giye, snow, ghamo, glace (bour.) Automne : autumnos, lié à tama en glozélien, dumno, sombre, temno ou tamno en BSCM, dumas en bour.
Eté : samos, serait lié au osen, jesen, automne en slave, et à sinni, été en bourouchaski
Printemps : vesna, lié à vesna (sl. c.), prénom serbo-croate, Déesse du printemps, wesenos (PIE), vaa (dravidien) Des noms liés au travail et aux métiers :
Travailleur : arat, lié à kara, travailleur (glozélien), ratay, travailleur (bulgare) radnik, travailleur (BSCM), au
scythe arei, laboureur, au PIE dratis, travail, drator, travailleur, à l’alt. ar, au bour. har, au drav. uravan, agriculteur
Forgeron : gobantion, lié au sl. c. et BSCM kovac, kowal en polonais, kebed en avar, kol en dravidien
Forge : gobali, qui renvoie aux mêmes racines, kovacnica en BSCM
Médecin : legis, apparenté à lekar, médecin en slave et en BSCM, lecit, soigner en slave
Serviteur : adbero, dérivé du sl. c. brat, prendre et du PIE ad et bher
Serviteur : slugo, est apparenté à sluga, serviteur en slave commun, slougho en PIE
Des noms liés à la vie quotidienne :
Maison : demo, dama en glozélien, lié à au sl. c. dom, maison, foyer en BSCM, demos en PIE, domate en bour.
Hutte : buta, lié à budka, hutte en bulgare, bhut, habitation en PIE et bitu, maison en dravidien
Hutte : barga, apparenté au vieux slave borg, toit sur 4 piliers, et au polonais brog, au tchèque brh
Toit, abri : kleta, lié à kleta, cave en BSCM, habitation, hutte en slave, kuti, maison en drav., kutu, hutte en bour.
Abri : krovos, lié à krov, toit en BSCM et en slave, serait lié au dravidien kir, couvrir
Lieu clos : gorto, lié à gorod, ville (russe), grad (BSCM), gara (kartvélien), gordhos (PIE), koritu (dravidien)
Village : trebo, lié à l’ancien slave trem, au russe terem, à threbo, habitation en PIE, tharbai, pile de pierres (bour)
Habitation: vastu, lié à ves, village (tchèque/slovaque), wies (polonais), vis, village (sanskrit), vata, maison (drav)
Résident : adsedo, lié à sjedioc, résident en BSCM, sedos, résidence en PIE, dérivé de sidet
Porte : dvoro, lié à dver, porte en russe, dveri en BSCM, dhworis en PIE, tora, ouvrir en dravidien
Coin : kut, relié à kut en BSCM et en tchèque et kat en bulgare, du PIE kant, coin
Table : stalo, qui renvoie à stol, table en slave et en BSCM, stolos en PIE, tol en dravidien, d’où vient dolmen Charbon : gluuo, gluvo, qui renvoie à ugol, charbon en russe, ugalj en BSCM, ghol, brûler en bourouchaski Hache : biion viendrait de bit, frapper en slave commun, biti en BSCM, pattu en dravidien Lumière: lukno, lié à luc (slovène), lac (bulgare), leuks (PIE), velitchna (drav), balichom (bour), luk (élam) Stylo : brukos, lié à ruka, main, eraka en dravidien, rukopis, manuscrit en slave, rekopis, stylo en polonais
Feu : aedu, lié à ad, enfer (bulgare), Aedui (Eduen, d’aidwos, ardent, aedo en glozélien) Aedii, tribu thrace ancêtre des Eduens selon P. Serafimov, du PIE ater passé par le thrace, dont sont issus vatra, feu en BSCM, tchèque, roumain, âtre (français), liés à vata, maison, foyer en dravidien, aidho, brûler (PIE), odi, chaleur en drav. Lit : legio, que l’on peut rattacher à lezat, lezet, être allongé en sl. c., lezati en BSCM, leghejo en PIE Panier : kista, lié à kos, panier (slave et BSCM), kesa, sac (BSCM), kasjo (langue de Vinca), kista, panier (PIE) Galoche, botte : kaluga, lié à kalosza, botte en polonais, kalose, galoche en BSCM
Manteau : brato, est lié à vretiste, habit, en vieux bulgare, et pourrait être lié à bat, peau de mouton en bour.
Cape : gobano, lié à kabat, manteau en tchèque, kaput, manteau en BSCM, au dravidien kappu, couvrir
Toile : lotna, lié à plotno, toile en slave, platno en BSCM, et à lino, manteau de laine en gaulois, dérivé de wlana,
laine en gaulois, lié à vlno, laine (sl. c.), vuna (BSCM), ulana (sanskrit), ou philam, vêtement en laine (bour.)
Cave : cauna, serait apparenté à konoba, auberge en BSCM et lié à kaiva, cave en dravidien
Corde : segno, apparenté à sukno, corde en bulgare et toile en BSCM
Chaine : reigo, renvoie à veriga en bulgare et en slovène, et à reigo, lien en PIE
Pot : krokano, lié à kracaga en bulgare, krcag, pichet en BSCM, à krcma, auberge, au dravidien kurky, pot Balle : glavom, qui renvoie à glava, tête en slave et notamment en BSCM Bâton : matigon, qui renvoie au russe motyka, motika en BSCM, du PIE mat
Saleté : muso, lié à musor, ordures en russe, pourrait être lié à makku, saleté (drav.), mos, coulée de boue (bour.) Des noms liés aux moyens de transport :
Navire : louga, renvoie à lodka, barque en slave, lada, nom de navire ancien en BSCM
Véhicule : vegnos, lié à vozilo, véhicule en BSCM, vezti en vieux slave, char, weghnos en PIE, vandi en dravidien Roue : koros, kolo, relié à kolo, roue en slave, kel en PIE, kal, roue en dravidien, larokores, rond en burushaski Char à 2 roues : kolisato, lié à kolo, roue en slave, kocija, kolica en BSCM, kal, chariot en dravidien Chariot : polo, lié aux mêmes racines avec transformation du k en p en gaulois, au dravidien pul, chariot Chariot : carruca, lié à karuca en bulgare, karoca, kolica (BSCM), kers (PIE), karun, avancer (bour.), kal (drav.) Char : carri, lié à kara en tchèque, kocija, karoca, kolica (BSCM), kers (PIE), karun, avancer (bour.), kal (drav.) Char à deux places : essedum, issu de sedo, assis en slave
Des mots auxiliaires :
Qui : pos, lié à kas en glozélien, ko (BSCM), le p remplaçant le k en gaulois, qos (PIE), ka (altaïque), ke (bour.) Quiconque : nepos, également en glozélien, que l’on peut relier à neko en BSCM, le k étant remplacé par un p en gaulois. Au demeurant, le son k est revenu en français dans qui et quiconque, neqos en PIE, ke en bourouchaski Négation: ne, forme de négation slave, issue du PIE ne, non, lié au bour ne...ne, ni...ni, naa, à l’élamite ina, non Non : ni, qui renvoie à nie, non en slave, issu du PIE ne, non / oui : to en gaulois glozélien, lié à da en slave Avant : ris, lié à prije, pre, avant en BSCM, le p tombant en gaulois, peru, grand en drav., purme, avant en bour. A droite : dexsiuo, dessu, lié à desno (BSCM, bulgare, slovène), dexsi (PIE), daksina (drav.), domo (bour.)
A gauche : laibos, rattaché à ljevo en sl. c. et en BSCM, laiwos en PIE
Et : a, l’un des termes utilisés pour et en slave, peut-être lié à ka en bourouchaski
Je, moi, à moi : mi, datif en slave, sme, lié à sam (BSCM), sve, lié à svoï en sl. c., issus du PIE suo et bour. su, moï, mon (Glozel), lié à mi (bour.)
Tu : ti en celte, identique au slave et au BSCM, issu du PIE tu
Ton : to, que l’on peut rattacher à tvoï en slave et en BSCM, issu du PIE
Nous : mu, lié à mi, nous en slave, en BSCM et en bour., ve, vous en glozélien, lié à vi en sl. c., wa en bour. Beaucoup : menneki, lié à mnogo, beaucoup en sl. c. et en BSCM, menegh en PIE, mikka en dravidien Tout : ciallos, lié à tout, cjal en bulgare, cio, cjel en BSCM, cel en slovène, koilus en PIE, khol en burushaski De : es, qui renvoie à iz, de, en russe, en BSCM et en slovène
Entre : medio, apparenté à entre, medu en BSCM ou mezdu en russe et en bulgare, du PIE medios
Dessus : ver, lié au bulgare varhu, dessus, au russe verkh, au slovaque et au BSCM vrh, au dravidien varaï
Près de : okk, que l’on peut rattacher à près de, oko en BSCM ou okolo en sl. c., rakkukan en dravidien
Sous : vo, apparenté à pod en slave, le p se transformant en v en gaulois, upo en PIE, ipa en glozélien
Vers : do, lié à do, vers en sl. c. et en BSCM, ko, lié à k, ko, vers en sl. c. et en BSCM
Superlatif : samo, sama, semblable au superlatif russe et à sam, très en bourouchaski
Le même : samal-isto, lié à samo, isto, le même (sl. c), samo-isto (BSCM), samo (PIE), samam (dravidien)
Comme : samalo, même racine, issu du PIE samo, du dravidien samam, lié à zamalo, presque en BSCM
Ceci : emo, lié à evo, voici en BSCM, eno en PIE, ana en dravidien, ama en kartvélien, ea, ceci en glozélien
Cela : ta en gaulois glozélien, lié à taj en BSCM, cela, ta, cela en langue de Vinca, te, cela en bouroushaski
Tous les deux : ambi, relié à abi en thrace, ambu en drav., ambo in bour., oba en slave et en BSCM, tous les deux
Nom : anmen, qui renvoie à nama, nom en glozélien, meno, nom, ime en BSCM, issu du PIE nomen
Obscurité : temello, tama en glozélien, lié à temnota, tama, obscurité (sl. c., BSCM), tamra (drav.), teman (élam.) Dette : dulgo, ou dulgiton, lié à dolg, dette en russe, dug, dette en BSCM, dhleghla en PIE Pensée : menman, lié à mnenie, opinion (russe), mijenje en BSCM, men (Vinca), man (dravidien), pensée Opinion : meno, lié à mnenie, opinion (russe), mijenje, opinion (BSCM), man, pensée (dravidien)
Jugement : messi, qui renvoie au slave myslenie, et à misljenje en BSCM, avis
Joie : veso, qui renvoie à vesolo, gai en slave, veselje, joie en BSCM, assus, joie en bourouchaski
Rage : veco, relié à bes en bulgare et à bijes, colère en BSCM, vitaï, fureur en dravidien
Rage, fureur : buryon, lié à buria, tempête en sl. c., au drav. bura, burka, bruit du vent qui souffle, au bour. burui
Murmure : dordo, relié au bulgare dardorja, murmure, lié au PIE drdajo et au dravidien dardarn
Ami : rios, lié au slave priatel, au BSCM prijatelj, le p tombant en gaulois, du PIE prijos, cher
Camarade : combratir, lié à brat, frère en slave, issu du dravidien kum et du PIE bhrater
Union : veriugon, lié à verit, croire, vjerovati se, se faire confiance en BSCM, voir à jugom, joug
Songe : sounos, que l’on peut relier à son, rêve, sanjati, rêver en BSCM et à supno en PIE
Partie : dalio, lié à djal (bulgare), dio (BSCM), del (slovène), partie, delo (PIE), del, couper (bourouchaski)
Pointe : banna, serait apparenté à bonela, fourchette en bulgare
Fête religieuse: litu, lita (Glozel) lié à likovati, fêter (BSCM), lessu (drav.), cérémonie religieuse, asus, joie (bour)
Voyage : podo, lié à putovanje, voyage en bosnien, pent, route en PIE, put en BSCM, pogu en dravidien
Surface : talamos, lié à tela (glozélien), tilo, surface tlo, sol (sl. c.), de tala, terre (sanskrit), talam, dol en dravidien
Vie, existence : bitu, buti, buion en glozélien, lié à bitje, vie en bulgare et en slovène, biée en BSCM, au sanskrit
bhuti, au drav putu, venir à la vie, à l’existence, au bour ba, exister, lié aussi à bitos, immortel, éternel en glozélien
Monde, univers : bitu, lié au sl. c. bit, biti en BSCM, être, putu en dravidien, ba, être, exister en bourouchaski
Etre, créature : bivos, que l’on peut rattacher aux racines des deux mots précédents
Désir : clani, que l’on peut rattacher à zelja, ceznja, désir en BSCM
Peur : boto, lié au sl. c. boitsia, avoir peur, bojati se en BSCM, bhi, bhajate en sanskrit
Réponse : atepos, que l’on peut relier à odpoved, réponse en tchèque, lié à atake, réponse en abkhaze
Tombeau : logan, que l’on peut rattacher à lezat, lezet, être allongé en sl. c., lezati en BSCM
Or : goltam, que l’on peut rattacher au slave zoloto, zlato, or, au PIE ghltom et à giltir, briller en bourouchaski
Naissance : berreton, lié au tchèque et au BSCM porod et issu de beru, peru, naissance en dravidien
Merveille : coudi, lié à cudan en BSCM et cudowny en polonais, merveilleux, kuus en bourouchaski, magique
Tour : keliknon, lié à kula, tour en bosnien, au PIE keliknom et au dravidien kula, forteresse
Amour : lubi, qui renvoie à ljubov en russe, ljubav en BSCM, amour et au PIE lubjo, aimer
Amour, chaleur brulante, passion : gratu, lié à grjet, chauffer en slave, gorjeti en BSCM, greh en dravidien
Baiser : bust, lié à buzi en polonais, pusa en tchèque et BSCM, baiser, bhusajo, embrasser en PIE
Langage : iaxti, qui renvoie à jazik en slave et à jezik en BSCM, langue, à egtis (PIE), ian (drav.), jungus (bour.)
Foule : lidos, lié à ljudi en slave et en bosnien, gens, lao, peuple en glozélien, et au PIE lugtos, multitude
Profit : sukoro, que l’on peut rattacher à korist, profit en slave et en BSCM
Poids, fardeau : trodma, lié à trud, travail, effort en bulgare et russe, trudnoca, grossesse en BSCM
Force, pouvoir : nertos, lié à aner et nara, homme en thrace et en scythe, nara en glozélien, nerez, animal male
en bulgare, neresec, ours sauvage en slovène, et à nertos, force en PIE, nerri, le plus haut en dravidien
Aspect : vida, lié à vida en glozélien, vid en slave, aspect, de videt, voir, du PIE weid et du sanskrit vid
Voleur : tati, que l’on peut lier au vieux slave, au slovène et au BSCM tat, voleur, au dravidien tirutan, voleur
Des adjectifs :
Fin : tanos, qui renvoie à tenki, fin en russe, tanak en BSCM, tanu en sanskrit, thaanum, long en bourouchaski Clair : argio, lié à jarki (serbe, russe), jarak (bulgare), yarii (bour.), uru (drav.), lumière solaire, pourrait aussi dériver de hargin, dragon en bourouchaski, qui aurait également donné argentum, argent en gaulois Brave : art, lié à rat, la guerre en BSCM, ratha, char de guerre en glozélien, peut être lié à ar, noble en dravidien Sombre : dumno, temis, temelos, lié à temno (sl. c.), tamno (BSCM), sombre, tima, dumas (thrace), tem (scythe), temos (PIE), tamra (drav.), teman, soir (élamite), dim, fumée (sl. c. et BSCM), dumas (bour.), dhumnos en PIE Profond : dubno, apparenté à duboko, profond en BSCM, dno, fond en slave, dhubno en PIE Nouveau : novios, apparenté à nov, nouveau en bulgare, BSCM, slovène, newos en PIE
Vrai : veros, relié à la racine vjero de vjerovatno, vraisemblable en BSCM, weros en PIE, warc en bourouchaski Silencieux : tauso, takha en glozélien, que l'on peut relier à tichy, silencieux, tisi en BSCM, tausos en PIE Grand: maros, lié à maros (thrace), mera (slavon), mahan (sanskrit), marru (drav.), marin (bour.), magari (kartv.) Grand homme: maroviros, issu des deux mots de vieux slave mera-vyras, du drav marru-vir, du bour marin-biru Grand : balco, lié à velik (bulgare, BSCM, slovène), bolchoï (russe), bel (PIE), bal, grandir (dravidien)
Juste : viroiono, que l’on peut relier à verit, croire, vjerovati en BSCM, à weros en PIE et warc en bourouchaski Loyal : viros, que l’on peut relier à verit, croire, vjerovati se, faire confiance en BSCM, weros (PIE), warc (bour.) Plein : lano, lié à pleno, plein en slave, le p tombant en gaulois, ulano, remplir en glozélien, issu du PIE pleno
Meilleur : velio, que l’on peut rattacher à bolje, meilleur en BSCM, bedjos en PIE et au dravidien vel Mort : marvos, lié à martav, mort en bulgare, mrtav, mort en BSCM, du PIE mrtos ou mrvos, issu de l’indoiranien Mara, démon de la mort (également en glozélien et en slave), et à margu, mort en dravidien Sanglant : crovos, que l’on peut relier à krov, sang, krv en BSCM et krews en PIE, kuruti en dravidien Cruel : craudio, que l’on peut aussi lier à krov, sang, krv en BSCM, krews en PIE, kuruti en dravidien Battu : gano, serait apparenté à gnati, battre en vieux bulgare, pourrait venir de gan, être blessé en bourouchaski Vivant : bivos, bitos en glozélien, lié à zivi, vivant en slave commun, ziv en BSCM, gihwo en PIE, ba en bour. Clair, asno, jessinos, as en glozélien, rattaché à jasno, clair en bulgare et en BSCM Dernier : ostimos, lié à ostatak, dernière partie en bulgare, ostalo en BSCM, postmos en PIE Bon, réjouissant : vessu, lié à veselo, réjouissant en slovène et en bulgare, veseo en BSCM, assus en bour.
Jeune : ioin, lié à iuna en slavon, iovanti, au vénète iuvants, au PIE juwon, au dravidien jovu, au bour. yua, fils Chaud : vritu, gritu, lié à vroc, chaud, gret, chauffer (slovène), vruc, grijeti (BSCM), greh (drav.) garum (bour.) Glorieux : cluto, klutos en PIE, lié à clavo, gloire, slava en slave, pourrait être à l’origine de Celte Haut : agranio, lié à gore, montagneux en bulgare, en haut en BSCM, et à gori, haut en dravidien Haut : ardus, serait apparenté à rid, point haut en bulgare, et au dravidien kara, haut
Furieux : baran, lié à buren, tempétueux (bulgare), buran (BSCM), et au drav. bura, bruit du vent qui souffle Furieux : luto, lié à ljut, furieux en slovène, en bulgare et en BSCM, du bour. latet, froncer les sourcils Rapide : bruios, lié à brz, rapide en tchèque et en BSCM, barz, rapide en bulgare, du PIE bhersi Lent : mallo, mergio, que l’on peut lier à medleno en russe ou à po malo, lentement en sl. c.
Agé : letos, lié à ljeto, année en slave, notamment en BSCM, leto en PIE et paraïto, âgé en dravidien
Faible : cleio, est apparenté à keljav en bulgare, ou à slab en BSCM
Fort : crip, est apparenté à krepak en bulgare, slovène et BSCM, krepas en PIE
Fort : acu, serait apparenté à jak, fort en slovène, bulgare et BSCM, issu du PIE ac
Dur, héros : caleto, lié à kalen, dur (bulgare), kaleto (PIE), kali (dravidien) pourrait être à l’origine de Kelt
Dur : craudio, lié à korav (bulgare), krut (BSCM, slovène), krutas (PIE), kuro (bour.), kuruti (dravidien), dur
En bonne santé : iaccos, ieca en glozélien, lié à jak, fort en bulgare, slovène et BSCM et au PIE jekos
Puissant : mogeti, lié à mogast, puissant (bulgare), moguci (BSCM), magadan (serbe), magado (dravidien)
Grand : magos, maga en glozélien, que l’on peut relier aux mêmes racines liées à mogt, pouvoir en vieux slave
Noble : magalo, lié à magota, noble, (vieux bulgare), moguci (BSCM), maq (abkhaze), magado, brave, roi (drav.)
Enceinte : beranto, lié à beru, peru, naissance (dravidien), beremennaia, enceinte (russe), brena en BSCM
Court : kerto, lié à kratki ou korotki, court en slave, kratak en BSCM, kortk en vieux slave, kuru en dravidien
Cher : druto, que l’on peut relier à drogi, drag, drahy en polonais, BSCM et tchèque
Gras, gros : smeru, que l’on peut relier à smer, graisse, et au polonais smar, graisse, du PIE smerus
Transparent : glano, qui renvoie à glasnost, transparence en russe
Mou : leino, qui renvoie à lenivy, paresseux en slave, lijen en BSCM, leni, faible en PIE, len, tranquille en bour. Paresseux : lisco, qui renvoie aussi à lijen, paresseux en BSCM et à leni, faible en PIE, len, tranquille en bour. Nu : noxto, qui renvoie à nahy en tchèque, nagy, nag en BSCM, nocados en PIE Sucré : suado, que l’on peut relier à sladki en slave, sladak en BSCM, sucré, issu du PIE swadus Premier, suprême : veramus, lié à arima en scythe, alem en vieux bulgare, ver en gaulois, au-dessus, lié au russe verkh, sommet, vrh en BSCM, lié au PIE vers, au drav. varaï (haut) ou peru (grand), au bour. beru et à l’alt. vara NB : sl. c. : slave commun ; PIE : proto-indo-européen : drav. : dravidien ; kartv. : kartvélien ; alt. : altaïque ; BSCM : bosnien-serbe-croate-monténégrin ; bour. : bouroushaski, élam. : élamite ; mots en gras : gaulois
Au-delà des concordances lexicales, sur la base du Précis de Gaulois Classique, d’Olivier Piqueron, le gaulois partage avec le slave nombre de concordances grammaticales. Les mots ont trois genres en gaulois, masculin, feminin et neutre, comme en slave, et se déclinent avec des cas similaires. Il y a des verbes imperfectifs et perfectifs en Gaulois comme en slave et la conjugaison des verbes et la formation des participes sont semblables comme par exemple les auxiliaires gaulois du futur byu, qui peut être lié à budu en russe, bivaju, je serai en BSCM, et syu, similaire à cu en BSCM, comme il y a deux formes de futur en gaulois et dans les langues slaves, notamment des Balkans. Il n’y a pas de verbe avoir en gaulois, remplacé par “à moi est” comme en russe. Les pronoms personnels, adjectifs possessifs et prépositions sont semblables en gaulois, slave, dravidien et bour.
Igor Tonoyan-Belyayev, dans son étude In search of the oldest common Indo-European Urheimat: preliminary linguistic evidence from Dravidian, souligne que le dravidien et l’indo-européen sont les deux seules familles de langues eurasiatiques à posséder un système des trois genres grammaticaux, masculin, feminin et neutre, comme le Slave et le Gaulois. Elles ont aussi un système similaire de voyelles et de déclinaisons avec le nominatif, l’accusatif, le génitif, l’instrumental et le locatif, des pronoms similaires, une formation semblable du pluriel, des systèmes verbaux semblables, en particulier pour la formation du participe présent et du futur et du passé avec un participe. Il souligne en particulier que le dravidien partage avec le celte et l’italique un suffixe b très semblable pour former le futur. Il estime que certaines de ces caractéristiques sont partagées avec le turcique, ce qui accrédite l’hypothèse que le dravidien s’est étendu vers l’Anatolie et l’Asie centrale. Il mentionne des correspondances lexicales entre le dravidien et les langues indo-européennes. En termes de calendrier, il propose de placer le Sprachbund ou la séparation d’une macrofamille au Néolithique un à deux millénaires avant le début de l’Age de Bronze dans une région de peuplement très ancien (soit entre -5500 et -4500 BC ou probablement un peu plus tôt). Il propose de placer le foyer originel commun dans une région comprise entre la Vallée de l’Indus-Saraswati et l’Iran du Sud-Est. Il souligne qu’à cette époque aucune langue indo-européenne séparée n’existait, tous les dialectes PIE différant peu entre eux et ressemblant au résultat d’une reconstruction correcte du PIE. D’abord, le PIE commun et le dravidien commun se sont séparés, le dravidien est parti vers l’Inde du Centre et du Sud, puis le PIE a commencé à se séparer et la plupart de ses locuteurs ont quitté l’Asie du Sud. Je suis globalement d’accord avec cette hypothèse. Toutefois, estimant que certains proto-Dravidiens ont également migré vers le Caucase, l’Anatolie, les Balkans et l’Europe de l’Ouest, je placerais la formation de ce foyer originel commun plus tôt, vers -8.500, pour qu’elle soit cohérente avec l’expansion of agriculture depuis l’Anatolie il y a 8.000 à 9.500 ans, la formation de la civilisation de Vinca vers -6.000 et la formation de la civilisation mégalithique en Gaule vers -5.000. J’étendrais également le foyer originel vers la région du Zagros et de la Mer Caspienne qui a joué un rôle majeur, l’haplogroupe celte R1b-M343 étant originaire d’Iran selon le site internet Eupedia.
Dravidian theories, de R. Swaminatha Aiyar, souligne aussi les concordances lexicales et grammaticales entre les langues dravidiennes, le sanskrit, l’avestan et les autres langues indo-européennes. J’ai pu en particulier trouver dans cette étude des similitudes frappantes entre les pronoms démonstratifs bosniens et dravidiens, qui partagent la rare caractéristique d’avoir trois formes différentes en fonction de la distance (proche, intermédiaire et lointaine). Le BCSM, le dravidien et le bour. partagent un mode interrogatif utilisant le préfixe da. Cette étude souligne aussi des similitudes entre le dravidien et le balto-slave pour le mode causatif, exprimé en tamoul par le suffixe pi, similaire au suffixe conditionnel slave bi. J’ai trouvé d’autres similitudes dans les suffixes et préfixes et les terminaisons verbales entre le dravidien, les langues slaves et le gaulois. On retrouve l’article le en bourouchaski, francais, dans plusieurs langues slaves des Balkans et en romani. En outre, j’ai trouvé de nombreux mots cités dans mon étude, ainsi que d’autres mots corroborant les concordances lexicales entre ces langues.
Comme le souligne le linguiste suisse Meier-Brugger, dans son ouvrage de référence Indo-European linguistics, cette étude montre que le celte, issu de la culture Yamna, dernière phase de l’unité linguistique, « a des liens anciens avec l’indo-européen oriental, dont sont issus le grec, le phrygien, l’indo-iranien et le slave, et en particulier avec les langues du Sud des Carpates, dont le thrace, l’illyrien, les langues slaves des Balkans, l’ukrainien et les langues du Nord-Caucase » - qui remonteraient au Vème millénaire av. JC. Ces conclusions rejoignent celle du linguiste K-H. Schmidt sur les liens anciens entre le celte et l’indo-européen oriental (indoiranien, balto-slave, phrygien, grec, albanais), l’arménien et le géorgien. L’indo-européen n’est pas un mythe évoque ainsi, sur la base de l’étude de Norman Bird The distribution of Indo-European root morphemes, 601 racines celto-grecques, 523 racines celto-indo-iraniennes, 703 racines celto-germaniques et 554 racines celto-baltes, soit plus que les 546 racines celto-italiques. K-H. Schmidt cite des exemples de correspondances entre le celte et les langues indo-européennes orientales, absentes entre le celte et l’italique, qui l’amènent à s’interroger sur la pertinence du classement du celte dans les langues indo-européennes occidentales. Michael Meier-Brugger, comme K-H. Schmidt, remet en cause de ce fait la notion fréquemment employée de langues italo-celtiques, soulignant qu’il n’y a pas eu de phase initiale italo-celtique et que les contacts du celte avec l’italique sont plus récents, et classant le celte avec le germanique et le balto-slave. De fait, mon étude montre que, lorsqu’il y a plusieurs racines indo-européennes, le gaulois a repris des racines semblables au slave (par exemple lubi pour amour, boglo pour l’eau et glin pour genou, alors que le français a repris par la suite les racines indo-européennes amajo, aqa et gonu). L’influence du germanique sur le gaulois est également plus tardive car c’est le gaulois, langue dominante, qui a influencé à l’origine la formation du germanique, avant que ce dernier reprenne l’ascendant lorsque la puissance gauloise a régressé. Les Cimmériens seraient au demeurant les ancêtres, non seulement des Gaulois, mais des Cimbres et des Sicambres, et donc des Francs. Certains les donnent aussi comme ancêtres des Slaves, d’autres les estiment pour le moins étroitement liés aux proto-Slaves ukrainiens comme les Neures. Le linguiste Eric Hamp place le cimmérien dans une branche indo-européenne incluant le germanique, les langues balto-slaves, le pré-hellénique, le thrace, le dace, l’illyrien, l’albanais et le messapien. Le linguiste Christopher Beckwith place le celte avec le balte, le slave, l’albanais et l’iranien. Marija Gimbutas lie les Celtes aux Germains, Balto-Slaves, Phrygiens et Illyriens, ainsi qu’aux Indo-Iraniens par l’intermédiaire de la culture d’Andronovo. La convergence de ces analyses crédibilise la thèse des liens du celte avec le slave.
Il apparaît en outre clairement qu’une part significative des racines du gaulois similaires au slave est apparentée à l’indo-européen, au sanskrit et au dravidien. A. Bomhard situe le foyer originel des langues nostratiques (indoeuropéen, dravidien, altaïque, kartvélien) au Sud du Caucase, vers -8.000, d’où ces dernières se seraient diffusées vers le foyer de la langue indo-européenne reconnu par la plupart des chercheurs, du Caucase au Nord de la Mer Noire. Les correspondances linguistiques frappantes que j’ai pu constater entre le gaulois, le slave, le dravidien, l’altaïque et le kartvélien dans son ouvrage A comprehensive introduction to Nostratic linguistics et dans divers dictionnaires de dravidien plaident de fait pour un foyer originel commun. Selon The Cambridge handbook of areal linguistic, le dravidien est à la base du sanskrit et des langues indo-iraniennes. Ces correspondances peuvent notamment s’expliquer par l’apport des Cimmériens, venus de l’Altaï, du Pamir ou de l’Hindou Kouch, dont les liens avec l’indo-iranien sont attestés. Je relève enfin que le gaulois apparaît encore plus proche du slave que de l’indo-européen, ce qui est logique au regard notamment des liens étroits entre les Gaulois et les Vénètes.
Addendum : dravidien, bourouchaski, français et langues slaves
Bien que cela dépasse le strict cadre de cette étude, je suis frappé par l’influence du dravidien, et à un moindre degré du bouroushaski, non seulement sur le gaulois, mais aussi sur le français et les langues slaves.
Au-delà des correspondances linguistiques déjà signalées, d’autres similarités méritent d’être signalées entre le français moderne et le dravidien, et à un moindre degré avec le bourouchaski :
- aller : la conjugaison irrégulière du verbe français viendrait des verbes dravidiens alaï, va et ir (al en glozélien)
- venir : proche de va, venir en dravidien
- arriver : proche d’aruvu, approcher en dravidien
- aimer : très proche du dravidien amar, aimer
- être : serait apparenté à iru (prononcé itru), être en dravidien
- porter : très proche du dravidien poru, porter, et du bourouchaski baart, apporter
- payer : très proche du dravidien pay, payer
- tirer : proche des mots dravidiens tira, ouvrir une porte, iru, tirer
- murmurer : très proche du dravidien murmuru, murmurer
- chouraver : proche de karav, voler en dravidien et de cara, voleur en glozélien
- pâtir : proche du dravidien patu, souffrir
- paraitre : proche de par, paraitre en dravidien et d’apara, apparaître en glozélien
- pleuvoir : proche de poli, pleuvoir en dravidien
- verser : proche de var, verser en dravidien
- immerger : très proche de murgu, plonger en dravidien
- taper : proche de tappu, taper en dravidien
- terminer : proche de tirmanam, terminer en dravidien
- naitre : proche de naru (prononcé natru), naître en dravidien
- connaitre : proche de kan, connaitre en dravidien
- paver : proche de pavu, paver en dravidien
- cumuler : proche de kummal, cumuler en dravidien
- parler, parole : proche de paraï, parler en dravidien
- rouler, roue : lié à uruli, roue en dravidien, mais roue, rota en gaulois, vient de urutu, rouler en dravidien
- tarir, aride : proches du dravidien tarisu, terre aride
- hululer, hulotte : seraient dérivés d’uleï, hurlement en dravidien
- papa : proche d’appa, père en dravidien
- maman : très proche du dravidien amman, maman signifiant grand-mère en dravidien, et du bour. mama
- mec : très proche du dravidien mac, mari, issu de ma, mâle en dravidien
- fille, fils : pourraient venir de pillei, enfant en dravidien, pilili, enfant aimé en bourouchaski
- mari, mariage : viendraient du dravidien mari, fils
- clan : proche de kulan, famille, clan en dravidien
- charrue : particulièrement proche du dravidien karu, charrue, et du bourouchaski har, charrue
- pâture : proche du dravidien pata, enclos pour les animaux domestiques
- cîme : proche du dravidien cimmaï, sommet d’une montagne, cima en glozélien
- campagne : proche de kampana en dravidien, territoire cultivé
- orée : proche d’oram, bord en dravidien
- rivière : proche du dravidien orivu, rivière, et ru est proche du dravidien aru
- dune : proche du dravidien dimmi, colline et du bourouchaski don, monticule
- plaine : proche de pallam, plaine en dravidien
- caillou : très proche du dravidien kal, caillou, qui aurait aussi donné cairn en celte
- sud : viendrait du dravidien sudu, chaleur
- gel : serait lié à kulir, froid en dravidien, proche également du bourouchaski ge, neige
- genou : viendrait du dravidien kanu, genou
- cœur : proche du dravidien karal, cœur, et du bourouchaski guru
- cou, col : proche de kalam, cou en dravidien
- pied : proche de padi, pied en dravidien
- muqueuse, moucher : dériveraient du dravidien mukku, nez
- bouche : proche de bukka, bouche en dravidien, et de buk, gorge en bourouchaski
- molaire : pourrait être issu de mel, broyer en mastiquant en dravidien
- miel : très proche de mel, doux en dravidien
- sucre : proche de sakkarai, sucre en dravidien, sucre de canne, kannal en dravidien
- pomme : très proche de pom, fruit en dravidien, phamol, fruit en bourouchaski et de poma, fruit en glozélien
- orange : issu de narangaï, orange en dravidien, nar, sentir, d’où pourrait être issu nala, sentir en glozélien
- soupe : proche de suppu, manger un aliment liquide en dravidien
- couteau : proche de katti, poignard, glaive, couteau en dravidien
- bol : proche de vallam, coupe, récipient rond en dravidien
- bouteille : proche du dravidien putil, bouteille
- diner : proche de tin, manger en dravidien
- saveur : proche de savi, goût, saveur en dravidien
- bataille : très proche du dravidien pataï, bataille, lié également à combat, combattre
- cape, chape, chapelle : très proches du dravidien kappu, couvrir
- coton : proche de kottan, coton en dravidien
- cabane : le mot français (et celte) dériverait également du dravidien kappu, couvrir
- hutte : proche de kuti, hutte, maison en dravidien, kutu, hutte en bourouchaski
- cave, caverne : très proches du dravidien kavi, souterrain
- manoir : très proche du dravidien mana, maison
- château : pourrait dériver de kottaï, fort, qui est passé en gaulois
- salon, salle : proche de salai, grande pièce en dravidien
- mur : très proche de murru, mur en dravidien
- tison : dériverait du dravidien ti, feu
- seau : serait lié au dravidien sal, seau
- charbon : proche du dravidien kari, charbon de bois, charbon
- mémoire : pourrait être lié au dravidien ninei, se souvenir
- mot : proche de mot, mot en dravidien
- navire : proche de navay, navire en dravidien, et de nau, navire en glozélien et en gaulois
- ambre : proche d’ambar, résine fossile en dravidien
- plus, plusieurs : viendraient du dravidien pal, beaucoup
- période : pourrait être issu de porudu, temps en dravidien, comme pora en slave
- an, année : proche d’andu, année en dravidien
- liesse : proche de lessu, liesse religieuse en drav., assus, joie en bour, litu, fête religieuse en gaulois, lié à liturgie
- sénile : très proche du dravidien senal, vieux
- calme : proche du dravidien camm, calme
- valeureux : serait dérivé du dravidien val, fort, brave
- mort : apparait lié à margu, mort en dravidien, qui aurait pu donner morgue
- varié : viendrait du dravidien veru, autre, différent
- aigu : proche de akku, aigü, acéré en dravidien
- sec : proche de sukku, sec en dravidien
- petit : proche de pittu, petit en dravidien
- vain : proche de vin, vain en dravidien
- hilare : proche de killar, hilare en dravidien
- beau, bel, belle : proche de pol, beau en dravidien
- mature, maturer : proche de mudir, maturer en dravidien
- furie : proche de veri, grande colère en dravidien
- vache : proche de baca, veau en dravidien
- bouc : proche de bakar, bélier en dravidien, beskaret, bélier en burouchaski
- bouc : proche de boka, bouc en dravidien et de buc, bouc en bourouchaski
- chèvre : proche de kuri, chèvre en dravidien
- bourrin : proche de bur, cheval en ancien dravidien
- coq : proche de kokkokko, coq en dravidien
- coucou : serait issu du dravidien ku, crier
- papillon : proche de pupili, papillon en dravidien
- aigle : proche d’agil, aigle en dravidien
De même, j’ai repéré des correspondances entre le slave, le bourouchaski et le dravidien, absentes en gaulois :
- voler : karav en dravidien, que l’on peut relier à krast en slave
- peser : vakaï en dravidien, que l’on peut relier à vaga, poids, balance en slave
- souffrir : mukku en dravidien, maq, douleur en bourouchaski, que l’on peut relier à muciti, torturer en slave
- frapper : udeï en dravidien, est proche d’udarit
- avoir besoin : nadu, proche de nado en russe
- aller, marcher : sel en dravidien pourrait être à l’origine du passé irrégulier d’aller en sl. c. sel
- cuire : varit en russe pourrait dériver du dravidien varu
- jardin : sad en slave, lié à sagu en dravidien, plantation, saka, légume
- chat : may, que l’on peut relier à macka, chat en slave
- maison: kuti, kuchtchu en dravidien, kutu, hutte en bour, que l’on peut lier à kuca en bosnien et au finno-ougrien
- nourriture : bukhta en dravidien, bukhti, manger, aurait donné bukra, pain en kartvélien, buchta en slave
- froid : kulir en dravidien aurait donné kholod en russe
- pauvre : bida en dravidien, que l’on peut relier à bida, misère en slave, biedny, pauvre en slave
- pauvre : missukan en dravidien, que l’on peut rapprocher de siromasan en bosnien
- je : le dravidien et le burushaski ya, ye est identique au slave et proche du français
- orange : narangaï en dravidien a donné naranca en slave, de nar, sentir, d’où nar grenade en slave
- moitié : le dravidien pal est très proche de pol, moitié en slave
- court : kuru en dravidien, est proche de korotki en russe, kratki en slave et court en français
- nuage : mugil en dravidien, est proche de mgla, brouillard en polonais
- hutte : salaï en dravidien est proche de salas en russe
- sucre : sakkarai, proche de sakhar en russe
- chène : dub, lié au drav. tumb, espèce d’arbre, tom en bour; les Dravidiens seraient à l’origine du culte de l’arbre.
- gorge ; kural, gol, proche de gorlo en russe, kerki, proche de krk en tchèque, gorge
- forteresse : kula, pourrait avoir donné kula, tour en bosnien
- sec : sukku, proche de sukhoï, susi en slave
- ce : avaï, proche de ovo en bosnien
- sol : dol en dravidien, que l’on peut rapprocher de na dole, en bas, en slave
On retrouve également de nombreux mots d’origine dravidienne en kartvélien, comme cikni, petit, lié à cikka, petit enfant, ciki, petit en bour., ou laparaki, parler, issu de laba, paraï, qui a donné labaraio, parler en gaulois, et palabre en français, ou taj, mère en dravidien, qui aurait donné da, mère en géorgien et dea, femme en gaulois.
R. Caldwell souligne aussi de nombreuses correspondances avec les langues scythiques, notamment finno-ougriennes, attestant des contacts des Dravidiens avec les peuples des steppes sibériennes. Il considère que globalement, le dravidien est plus proche des langues indo-européennes occidentales que du sanskrit, ce qui atteste à ses yeux de contacts plus anciens et plus étroits avec ces langues.
Cette vision est partagée par le chercheur tamoul G. Devanayan, qui évoque une migration des Dravidiens vers la Mésopotamie, l’Egypte et l’Afrique du Nord, ainsi que vers l’Anatolie et l’Europe occidentale. G. Devanayan s’appuie en partie sur l’ouvrage de Nicolas Lahovary “Dravidians in the West”, évoquant les liens des Dravidiens avec la culture méditerranéenne pré-indo-européenne, et notamment les Basques et les Kartvéliens, et situant leur patrie d’origine en Mésopotamie, ce que G. Devanayan conteste toutefois, estimant qu’ils venaient de l’Inde. Il souligne les nombreuses correspondances linguistiques avec les langues anglo-saxonnes et germaniques, mais aussi avec le français, comme le montrent les nombreux exemples qu’il donne, que j’ai limité aux plus pro bants.
J’ai recensé 250 mots d’origine dravidienne et 160 mots de bourouchaski, soit la moitié et près du tiers des mots gaulois proches du slave, et 100 mots d’origine dravidienne en français, attestant de l’étroitesse de ces contacts.
Même le Morvan de mes ancêtres pourrait tenir son nom du dravidien mara, obscur et vanam, montagne boisée sacrée, la correspondance étant encore plus frappante avec le nom de l’oppidum de Morvennum, et le nom du peuple éduen - Aedii, d’aidwos, ardent - du Morvan, viendrait du dravidien odi, chaleur.
Cela conforte l’hypothèse d’une migration dravidienne vers -8.000 qui serait passée par le Caucase et le Nord de la Mer Noire, et l’Anatolie, et aurait poursuivi son chemin vers les Balkans, l’Italie et la Gaule, et de contacts étroits des Gaulois avec les Dravidiens, dont l’on retrouve la trace jusqu’en français, ces similitudes linguistiques étant corroborées par des données génétiques, archéologiques et religieuses. De nombreux chercheurs soulignent à cet égard les liens des cultures balkaniques de « l’ancienne Europe » avec la culture dravidienne de l’Indus.
Toutes ces études renforcent la théorie d’un peuplement de l’Europe depuis l’Inde et le Pakistan du Nord-Ouest, l’Iran, le Caucase et l’Anatolie, créant une culture proto-Indo-Méditerranéenne, ce qui relativise l’importance pour le peuplement de l’Europe de la théorie des Kourganes, qui aurait toutefois apporté 28% du génome français selon l’étude menée par Samantha Brunel Ancient genomes from present-day France unveil 7,000 years of its demographic history. Elles crédibilisent aussi les correspondances linguistiques que j’ai établies entre le Gaulois et le Dravidien (250 mots dravidiens et 160 mots bourouchaski sur 500 mots gaulois/slaves). Une étude publiée dans Science, Mapping the Origins and Expansion of the Indo-European Language Family, tend aussi à renforcer cette théorie. Elle évoque deux hypothèses concurrentes pour l’origine de la famille linguistique indo-européenne. La vision conventionnelle en place le foyer originel dans les steppes pontiques il y a environ 6000 ans. Une hypothèse alternative affirme que ces langues se sont répandues depuis l’Anatolie avec l’expansion de l’agriculture il y a 8000 à 9500 ans. A l’aide d’approches phylo-géographiques bayésiennes, couplées aux données lexicales de base de 103 langues indo-européennes anciennes et actuelles pour modéliser l’expansion de cette famille et tester ces hypothèses, cette étude conclut à un soutien décisif à une origine anatolienne sur une origine steppique, tant le calendrier supposé que la localisation des racines de l’arbre linguistique indo-européen collant avec une expansion de l’agriculture depuis l’Anatolie il y a 8000 à 9500 ans. Une carte tirée de cette étude place clairement l’origine des langues indo-européennes entre l’Inde du Nord-Ouest, le Pakistan, l’Afghanistan et l’ Iran, vers la mer Caspienne et le Zagros, qui serait selon moi le foyer originel des langues dravidiennes et indo-européennes, et montre des liens étroits entre les langues indo-iraniennes, caucasiennes et anatoliennes, ce qui plaide clairement pour la formation des langues indo-européennes dans cette région avant -8.000, selon les dates indiquées dans cette étude. La formation de l’Indo-Européen dans cette région pourrait aussi être attestée par l’intéressante langue Bourouchaski du Nord du Pakistan, qui selon l’étude de Michael Witzel Origin and Development of Language in South Asia: Phylogeny Versus Epigenetics? allie des caractéristiques des langues dravidiennes, sanskrites et caucasiennes et partage en particulier la numération vigésimale avec le Dravidien, le Caucasien et le Basque, qui a laissé des traces en Français (vimsati, vingt en Dravidien, pourrait même avoir donné vingt en Français). L’intéressante étude de Simon Greenhill, The shape and tempo of language evolution, place le bourouchaski entre le kannada, langue dravidienne, l’hindi, les langues caucasiennes et le basque, ce qui atteste également de son caractère archaïque. L’archéologue ukrainien Iurii Mosenkis souligne aussi les liens du Bourouchaski, qu’il juge très archaïque, avec les langues déno-caucasiennes, les langues indo-européennes, l’arménien, le phrygien et les langues paléo-balkaniques. La théorie des Kourganes est aussi questionnée par Anatole Klyosov d’un point de vue génétique, l’haplogroupe R1b des Yamnas, R1b-Z2103, étant quasi absent d’Europe, qui porte 90% de R1b-P312, absent de la culture Yamna.
Cette étude place en outre la formation des langues balto-slaves autour de -5.500, contredisant les théories selon lesquelles elles seraient apparues bien plus tard et accréditant les théories de linguistes réputés comme M. Meier-Brugger, K-H. Schmidt, N. Bird, E. Hamp ou C. Beckwith, soulignant les liens anciens entre le Celte et les langues indo-européennes orientales comme l’Indo-Iranien et le Slave, dès le 5ème millénaire av. JC. Le caractère proto-slave de la langue de Vinca conforte cette théorie. Je m’étonne dès lors que cette étude ne place le Celte qu’à l’Ouest de l’Europe alors qu’il était présent de longue date en Europe danubienne et dans les Balkans.
Le cadre temporel fixé dans cette étude est cohérent avec l’expansion de l’agriculture depuis l’Anatolie, avec le développement du mégalithisme, qui a migré, selon l’archéologue ukrainien Iurii Mosenkis, avec la religion et la langue dravidiennes, du Zagros (-10.000) vers Çatal Hoyük (-7.400/-6.200), Vinca (-6.000/-4.000) et la Gaule, où le mégalithisme s’est développé à partir de -5.000, et avec des études d’ADN ancien, qui attestent que 30% du génome français, en majorité d’origine anatolienne et basque, est arrivé au Néolithique, dont les haplogroupes Y-ADN H2, I-M170 and R1b, présents de l’Iran, l’Anatolie et les Balkans à la Gaule et caractéristiques de l’ADN mégalithique, la présence des haplogroupes dravidiens H2, ainsi que L-M20 (trouvé notamment au Sud-Caucase, mais aussi en Europe du Sud), attestant de la composante dravidienne de cette migration Néolithique.
Une autre étude, Global Picture of Genetic Relatedness and The Evolution of Humankind, parue en 2020 dans Biology, souligne le rôle majeur de l’Eurasie centrale (Asie centrale, Iran, Caucase) dans la transmission des gènes, les peuples dont les gènes sont les plus diversifiés, comme les Ouigours, les Azerbaïdjanais, les Ouzbeks et les Iraniens, portant en part à peu près égales des gènes européens, moyen-orientaux, indiens et chinois. Cette étude montre clairement que les migrations du Néolithique ont fortement modifié le génome européen en apportant des gènes moyen-orientaux, notamment anatoliens (40%), en proportion égale aux gènes des chasseurs-cueilleurs originels (40%). Des gènes indiens se sont diffusés en quantité décroissante en Iran (20%), dans le Caucase (14%) et en Europe (5%). Des gènes arctiques et sibériens se sont surtout diffusés en Europe du NordEst (15% contre 5% ailleurs). Enfin, des gènes africains se sont surtout diffusés en Europe du Sud (10% en Espagne et 7% en Italie). Cette étude conforte la théorie d’une migration majeure au Néolithique depuis l’Inde et l’Asie centrale vers le Caucase, l’Anatolie et l’Europe, en partie par les Balkans, en partie par l’Afrique du Nord.
L’Asie centrale, au carrefour de ces influences, apparait comme un candidat très sérieux au titre de foyer originel de l’ancêtre des langues indo-européennes, dravidiennes et ibéro-caucasiennes, dont le Bourouchaski, qui serait venu de l’Altaï, apportant également des éléments linguistiques altaïques, ainsi que les haplogroupes R1a et R1b, qui se sont dispersés du Sud de la Sibérie vers l’Europe, serait un vestige archaïque comme le Kalash, langue archaïque indo-aryenne du Pamir. Cette dispersion est également corroborée par des découvertes archéologiques dans l’Altaï, le Pamir et l’Ouzbékistan, datant du Gravettien, selon des chercheurs comme Marcel Otte. Cette première migration a déjà apporté l’haplogoupe R1b en Italie (Villabruna, -14.000) en France (- 12.000) et en Serbie (-11.000) et été à l’origine des pyramides de Visoko selon Marc-Olivier Rondu (The Epigravettian pipelines of Visoko (Bosnia-Herzegovina), sur Academia). Cette migration ancienne majeure pour le peuplement de l’Europe depuis l’Anatolie et le Caucase est aussi corroborée par l’étude A major Y-chromosome haplogroup R1b Holocene era founder effect in Central and Western Europe, de Natalie Myres et al.
L’origine pamirienne présumée de l’haplogroupe L-M20, porté par 15% des Bourouchos et 25% des Kalash, trouvé dans le Caucase et jusqu’en Europe du Sud, l’origine pamirienne des gènes bulgares, selon u ne étude de Slavyan Stoilov, et la proximité des gènes des Tadjiks du Pamir avec les gènes européens selon Evelyne Heyer plaident aussi dans ce sens, de même que le fait que l’on retrouve des traits des langues pamiriennes en thrace, bulgare, macédonien, albanais et aroumain, langue des Vlaches, comme bac, bergerie en bourouchaski, bacija dans les langues des Balkans, et zamiina, terre en bourouchaski, proche de zemlja, terre en slave, ce qui pourrait expliquer que le nom de Zalmoxis, grand prêtre thrace qui serait à l’origine du druidisme, soit présumé d’origine dravidienne. La présence en bourouchaski de mots proches du français liés au pastoralisme et à l’agriculture (ter, pâture montagnarde, proche de terre, belis, brebis, agneau, proche de bélier, buc, bouc, har, charrue, phamol, fruit, proche de pomme), à la famille (mama, maman, bapo, papa, pilili, enfant, proche de fils, fille), au corps humain, (guru, cœur, buk, gorge, proche de bouche), ou phu, feu, ser, servir, je, semblable à je et à ja en slave, le, semblable à le et aux articles de plusieurs langues des Balkans, ainsi que la présence en gaulois, slave et français de nombreux mots dravidiens et bourouchaski cités dans cette étude, plaide sans nul doute pour une migration liée à l’expansion du pastoralisme et de l’agriculture depuis l’Asie centrale et les confins de l’Inde vers le Caucase, l’Anatolie, les Balkans et l’Europe occidentale au Néolithique, attestée par l’arrivée en France de chèvres porteuses de gènes d’Asie centrale et du Pakistan, qui a apporté une langue indo-européenne très archaïque, alliant des éléments des langues indo-européennes archaïques d’Inde et d’Anatolie, des langues dravidiennes et de l’élamite et des langues altaïques et ibéro-caucasiennes, qui a contribué à la formation des langues indo-européennes et dont le bourouchaski, classé par le célèbre linguiste Eric Hamp comme la langue indo-européenne la plus archaïque, proche de l’indo-hittite, est un vestige. Selon l’étude de Csaba Barnabas Horvath, How Eurasia was born, publiée par International relations quarterly, le bourouchaski a été la première langue parlée sur le plateau iranien, avant d’être supplanté par l’élamo-dravidien puis par l’indo-européen, ce qui tend à confirmer l’antériorité du Bourouchaski et l’hypothèse que celui-ci, ainsi que l’élamo-dravidien, ont pu contribuer à la formation des langues indo-européennes.
Sources :
- Dictionnaire français-gaulois, Jean-Paul Savignac, Editions La Différence
- La langue gauloise, Georges Dottin, Editions L’Arbre d’Or
- Dictionnaire gaulois-français, Patrick Cuadrado
- Précis de gaulois classique, Olivier Piqueron
- Celto-Slavic similarities, Pavel Serafimov, expert bulgare des Celtes
- Slavic influences in the ancient Gaul, Pavel Serafimov, Giancarlo Tomezzoli
- Neo-Gaulish-English dictionnary, Edward Hartfield
- Etymological dictionary of Proto-Celtic, Ranko Matasovic, expert croate des Celtes
- The Celtic languages in contact, University of Postdam
- Histoire des Gaulois, Amédée Thierry
- Histoire des Gaules et des conquêtes des Gaulois, Jacques Martin
- La Gaule avant les Gaulois, Alexandre Bertrand
- The origin of Slavs, S. Zaborowski
- Histoire ancienne des peuples d’Europe, Louis-Gabriel du Buat-Nançay
- Langues et origines des peuples de l’Europe antique, Raymond Delattre
- Les premiers habitants de l’Europe, Henri d’Arbois de Jubainville
- L’arrivée des Indo-Européens en Europe, Jacques Freu
- Indo-Européens : à la recherche du foyer d’origine, Alain de Benoist
- Les origines celtiques, La civilisation néolithique, Les monuments mégalithiques, André de Paniagua
- http://rage-culture.com/les-vamanavas-le-peuple-a-lorigine-de-la-maiorite-des-europeens-modernes/, basé sur
les récentes découvertes de la génétique
- http://infos-scientifiqueshvperborennes.over-blog.com/2018/05/qui-etaient-les-cavaliers-vamna.html. basé sur
une étude génétique de David Reich, de l’Université d’Harvard
- https://bsecher.pagesperso-orange.fr/Genetique R1b.htm, Bernard Sécher
- Les statues-menhirs de Méditerranée occidentale et les steppes, Bernard Sécher
- Mémoires sur l’Illyrie ancienne et nouvelle, François Charles Hugues Laurent Pouqueville
- Les premiers Celtes d’Anatolie, Bernard Sergent, revue d’études anatoliennes
- Civilisation gênante, la culture Vinca, Yvesh (Yves Herbo), qui relie cette culture à celle de Glozel
- Glozelic etymological dictionnary, Paulo Stekel, relevant les liens entre Glozel, Visoko, Sumer et Inde ancienne
- The Schildmann decipherment, Kurt Schildmann, linguiste allemand expert des langues anciennes, dont le sumérien et la langue de l’Indus, qu’il a déchiffrée, comme les tablettes de Glozel, révélant des correspondances avec les langues anciennes des Balkans et de la civilisation mégalithique jusqu’en Bretagne (Carnac, Gavrinis). Je relève en outre que le symbole du caducée s’est diffusé de l’Inde à Sumer, l’Anatolie, jusqu’à Gavrinis.
- Klâra Friedrich and Gâbor Szakâcs, rovasirasforrai.hu/Comparison-between-signs
- L’origine orientale de la religion celtique, Jean-Louis Brunaux, CNRS
- Treci narod gde nas zapadnoevropski istoricari svrstavaju su Kelti, Dejan Milosavljevic
- Die Wanderungen der Kelten, Leopold Contzen
- Etude du magazine Nature, Ecology and Evolution sur les bâtisseurs de Stonehenge
- A Grammar of Modern Indo-European, Third Edition de Carlos Quiles, Fernando Lopez-Menchero
- Indo-European linguistics, Michael Meier-Brugger
- Indo-European Cognate Dictionary, Fiona Mac Pherson
- The Oxford introduction to Proto-Indo-European, Mallory-Adams
- THE INDO-IRANIAN LANGUAGE FAMILY, THE HYPOTHETICAL PROTO INDO-EUROPEAN LANGUAGE AND A HYPOTHETICAL HOMELAND, Rajan Menon
- A Dravidian etymological dictionary, T. Burrow, M. B. Emeneau
- A comparative grammar of the Dravidian, de l’évèque Robert Caldwell
- The primary classical language of the world, G. Devanayan
- Dravidian origins and the West, Nicolas Lahovary
- Dravidian theories, R. Swaminatha Aiyar
- Dravidian Çatal Hoyük, Ubaid, Balkan and West European neolithic priest elite, Iurii Mosenkis
- In search of the oldest common Indo-European Urheimat: preliminary linguistic evidence from Dravidian, Igor Tonoyan-Belyayev
- The expansion of Indo-European languages, Eric Hamp
- Encyclopedia of Indo-European culture, Mallory-Adams
- A comprehensive introduction to Nostratic linguistics, Allan Bomhard
- Armenian and Celtic, towards a new classification of early Indo-European dialects, Karl-Horst Schmidt
- The Celts and the Slavs: on K-H. Schmidt’s hypothesis on the Eastern origin of the Celts, Viktor Kalygin
- INDO-ARYAN-AND-SLAVIC-LINGUISTIC-AFFINITIES, Hindu Institute of Learning, Toronto
- L’installation en Europe septentrionale et occidentale des peuples carpatho-danubiens à l’ère proto-historique
- L’indo-européen n’est pas un mythe, Thomas Pellard, Laurent Sagart & Guillaume Jacques
- The distribution of Indo-European root morphemes: (a checklist for philologists), Norman Bird
- Le phénomène indo-européen, linguistique et archéologie, Histoire de l’Humanité, UNESCO
- The discreet Origin of H2a1 Mt-DNA and its sudden Eurasian Expansion offer a unique Testimony about what remained from the Natufians, the Neolithic Revolution in Near East and Chalcolithic in Lesser Caucasus, Marc-Olivier Rondu
- The Epigravettian pipelines of Visoko (Bosnia-Herzegovina), Marc-Olivier Rondu
- The Kurgan culture, Marija Gimbutas
- Continuity of European Languages from the Point of View of DNA Genealogy, Anton Perdih
- The prehistory of language from the perspective of the Y -chromosome, Michael St Clair
- Indo-European demic diffusion model, Carlos Quiles
- L’histoire génétique du Bénélux et de la France, Maciamo Hay
- The Homo Neanderthalis and the Dravidians: A Common Origin and Relation to Harappan Civilisation and Vedas
- Ancient genomes from present-day France unveil 7,000 years of its demographic history, Samantha Brunel
- Ancient genome-wide DNA from France highlights the complexity of interactions between Mesolithic hunter-gatherers and Neolithic farmers, menée par Maïté Rivollat
- Using Y-chromosome capture enrichment to resolve haplogroup H2 shows new evidence for a two-Path Neolithic expansion to Western Europe, Maïté Rivollat et al.
- Après le dernier maximum glaciaire : la troisième migration, Narendra Katkar, Académie française des Sciences
- L’Odyssée des genes, Genetic Traces of East-to-West Human Expansion Waves in Eurasia, Evelyne Heyer
- How Eurasia was born, Csaba Horvath, publiée by International relations quarterly
- Estimating the Impact of Prehistoric Admixture on the Genome of Europeans, menée par Isabelle Dupanloup
- The Basque population and ancient migrations in Europe, Luca Cavalli-Sforza
- The Oxford handbook of Ancient Anatolia
- The Gilaki language, publiée par l’Université d’Uppsala
- Gaelic/Gaulish and Gilaki/Galeshi people & Haplogroup R1b, publiée sur le site internet Anthrogenica
- The full Out of India case in short revised and enlarged 20/7/2020, The Rigveda and the Aryan Theory: A Rational Perspective, Shrikant Talageri
- Molecular genetic investigation of the Neolithic population history in the western Carpathian Basin, Anna Szecsenyi-Nagy, publiée par l’Université de Mayence
'Neolithic Revolution' (1936), Maxime Brami
- A prehistoric thoroughfare from the Ganges to the Himalayas, George Van Driem
- Some unlikely tentacles of early Indo-European, par Angela Marcantonio et Girish Nath Jha
- Why Linguistics necessarily holds the key to the solution of the Indo-European Homeland question, Koenraad Elst
- Global Holocene Seafaring and Landcrossing Out of India Migration Hypothesis, Wim Borsboom
- Of mice and men, Premendra Priyadarshi
- Burushaski etymological dictionary, Ilija Casule
- Burushaski: an extraordinary language in the Karakoram mountains, Dick Grune
- Origin and Development of Language in South Asia: Phylogeny Versus Epigenetics? de Michael Witzel
- The shape and tempo of language evolution, Simon Greenhill et al.
- Mapping the Origins and Expansion of the Indo-European Language Family, Science
- Global Picture of Genetic Relatedness and The Evolution of Humankind, Biology
- major Y-chromosome haplogroup R1b Holocene era founder effect in Central and Western Europe, Natalie Myres et al.
View publication i