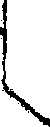
r
x.^,, „ __ ,
i ’ ; :
l A .
Grammaire comparée des langues indo-européennes. Tome 1 / par M. François Bopp ; traduite sur la seconde éd. par M. [...]
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
Bopp, Franz (1791 -1867). Auteur du texte. Grammaire comparée des langues indo-européennes. Tome 1 / par M. François Bopp ; traduite sur la seconde éd. par M. Michel Bréal,... ; registre détaillé rédigé par M. Francis Meunier. 1866-1875.
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le cadre d'une publication académique ou scientifique est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source des contenus telle que précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus générant directement des revenus : publication vendue (à l'exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit payant, un support à vocation promotionnelle etc.
CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE 2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :
- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.
- des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter utilisation.commerciale@bnf.fr.
DES
LANGUES
INDO-EUROPÉENNES
LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET C
BOULEVARD SAINT-GERMAIN, N" 77.
DES
LANGUES INDO-EUROPÉENNES
COMPRENANT
LE SANSCRIT, LE ZEND, L’ARMENIEN LE CREC, LE LATIN, LE LITHUANIEN, L’ANCIEN SLAVE
^LE GOTHIQUE ET L’ALLEMAND
VS v L / ),
\
..jW
,V
V1
TRADUITE
SUR LA DEUXIÈME ÉDITION
Tït^ü iiwrvra-".'
/SV
D’UNE INTRODUCTION
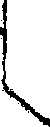
r
x.^,, „ __ ,
i ’ ; :
l A .
PAR M. MICHEL BREAL
CHARGÉ nu COURS DF, GRAMMAIRE COMPARÉE AU COLLÈGE DE FRANCE
TOME PREMIER
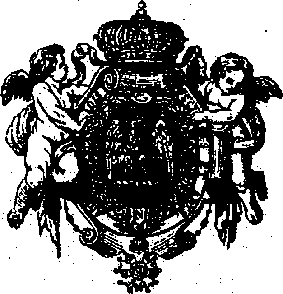
PARIS
M DCCC LXVI

En présentant au lecteur français une traduction de la (Mammaire comparée de M. Bopp, il ne sera pas inutile de donner quelques explications sur la vie et sur les œuvres de l’auteur, sur la part qui lui revient dans le développement de la science du langage et sur les principes qui servent de fondement à ses observations. Mais, avant tout, nous demandons la permission de dire les motifs qui nous ont décidé à entreprendre cette traduction.
Quand la Grammaire comparée de M. Bopp parut en Allemagne, elle fut bientôt suivie d’un grand nombre de travaux, qui, prenant les choses au point où l’auteur les avait laissées, continuèrent ses recherches et complétèrent ses découvertes. Un ouvrage dont le plan est à la fois si étendu et si détaillé invitait à l’étude et fournissait pour une quantité de problèmes des points de repère commodes et sûrs :• une fois l’impulsion donnée, cette activité ne s’est plus ralentie. Nous osons espérer que le même livre, singulièrement élargi dans sa seconde édition, produira des effet Analogues en.France, et que nous verrons se former
également parmi nous une la mille de linguistes <[ui poursuivra l’œuvre du maître et s’avancera dans les routes qu’il a frayées. Par le nombre d’idiomes qu’elle embrasse, la Grammaire comparée ouvre la carrière a des recherches tort diverses, et se trouve comme située à l’entrée des principales voies de la philologie indo-européenne: quelle que soit, parmi les langues de la famille, celle dont on entreprenne l’étude, on est sûr de trouver dans M. Bopp un guide savant et ingénieux qui Vous en montre les affinités et vous en découvre les origines. Non-seulement il replace tous les idiomes dans le milieu où ils ont pris naissance et il les lait mieux comprendre en les commentant l’un par l’autre, mais il soumet chacun d’entre eux à une analyse exacte et fine qui commence précisément au point où finissent les grammaires spéciales. Que nos philologues se proposent des recherches comparatives ou qu’ils veuillent approfondir la structure d’un seul idiome, le livre de M. Bopp les conduira jusqu’à la limite des connaissances actuelles et les mettra sur la route des découvertes. .
Mais la traduction de cet ouvrage nous a encore paru désirable pour une autre raison. A vrai dire, les travaux de linguistique ne manquent pas en France, et notre goût pour .ce'genre d’investigation ne doit pas être médiocre; s’il est permis de mesurer la faveur dont jouit une science au nombre des livres qu elle suscite. Parmi ces travaux, nous en pourrions citer qui sont excellents et qui valent à tous égards les plus savants et les meilleurs de l’étranger. Mais, pour parler ici avec une pleine franchise , la plupart nous semblent loin de révéler celte série continue d’elTorts
et cette unité de direction qui sont la condition nécessaire du progrès dune science. On serait tenté de croire que la linguistique n’a pas de règles fixes, lorsque, en parcourant le plus grand nombre de ces ouvrages, on voit chaque auteur poser des principes qui lui sont propres et expliquer la méthode qu’il a mventee. T res-différents pai le but qu’ils ont en vue et par l’esprit qui les anime, les livres dont nous parlons offrent entre eux un seul point de ressemblance : c’est qu’ils s’ignorent les uns les autres, je veux dire qu’ils ne se continuent ni ne se répondent; chaque écrivain, prenant la science à son origine, s’en constitue le fondateur et en établit les premières assises. Par une conséquence naturelle, la science, qui change continuellement de terrain, de plan et d architecte, reste toujours à ses fondations. Ce n’est pas de tel ou tel idiome, encore moins d’un point spécial de philologie que traitent ces ouvrages à vaste portée : leur objet habituel est de rapprocher des familles de langues dont rien jusque-là ne faisait pressentir l’affinité, ou bien de se prononcer sur 1 u~ nité ou la pluralité des races du globe, ou de remonter jusqu’à la langue primitive et de décrire les origines-de la parole humaine, ou enfin de tracer un de ces projets de
langue unique et universelle dont chaque année voit augmenter le nombre. À la vuct de tant d’efforts incohérents,
le lecteur est tenté de supposer que la linguistique est encore dans son enfance, et il est pris du même scepticisme qu’exprimait saint Augustin, il y a près de quinze siècles, quand il disait, à propos d’ouvrages analogues, que l’ex-plicàtiondes mots dépend de la fantaisie de chacun, comme f interprétation'des songes.
La plupart des sciences une période d’anarchie, et
expérimentales ont traversé c’est ordinairement au défaut
de suite, à l’amour exclusif des questions générales, à l’absence de progrès qu’on reconnaît quelles ne sont pas constituées. La grammaire comparée en serait-elle encore là? faut-il croire qu elle attend son législateur.? Pour nous convaincre du contraire, il suffit de jeter les yeux sur ce qui se passe à l’étranger. Tandis que nous multiplions les projets ambitieux que l’instant d’après change en ruines,
ailleurs l’édifice se construit peu à peu. Cette terre inconnue, ce continent nouveau dont tant de navigateurs nous parlent en termes vagues, comme s’ils venaient tous d'y débarquer les premiers, d’exacts et patients voyageurs l’explorent en divers sens depuis cinquante ans. Les ouvrages de grammaire comparée se succèdent en Allemagne, en se contrôlant et en se complétant les uns les autres, ainsi que font chez nous les livres de physiologie ou de botanique; les questions générales sont mises à l’écart ou discrètement touchées, comme étant les dernières et non les premières que doive résoudre une science; les observations de détail s’accumulent, conduisant à des lois qui servent à leur tour à des découvertes nouvelles. Comme
dans un atelier bien* ordonné, chacun a sa place et sa tâche, et l’œuvre, commencée sur vingt points à la fois, s’avance d’autant plus rapidement que la même méthode, employée par tous, devient chaque jour plus pénétrante et plus sûre. - : ' :
De tous les livres de linguistique, l’ouvrage de M. Bopp est celui où la méthode comparative peut être apprise àvec le plus de facilité. Non-seulement Fauteur l’applique avec
de précision et de délicatesse, mais il en met à nu les procédés et il permet au lecteur de suivre le progrès de ses observations et d’assister à ses découvertes. Avec une bonne foi scientifique plus rare qu’on ne pense, il dit par quelle conjecture il est arrivé à remarquer telle identité, par quel rapprochement il a constaté telle loi; si la suite de ses recherches n’a pas confirmé une de ses hypothèses, il ne fait point difficulté de le dire et de se corriger. L’école des linguistes allemands s’est principalement formée à la lecture des ouvrages de M. Bopp : elle a grandi dans cette salle d’expériences qui lui était sans cesse ouverte et où les pesées et les analyses se faisaient devant ses yeux. Ceux mêmes qui contestent quelques-unes des théories de l’illustre grammairien se regardent comme ses disciptes, et sont d’accord pour voir en lui, non-seulement le créateur de la philologie comparative, mais le maître qui l’a enseignée à ses continuateurs et à ses émules.
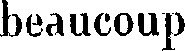
e
doivent rester près à leurs , nous
Tels sont les motifs qui nous ont décidé à traduire l’ouvrage de M. Bopp : nous avons voulu rendre plus accessible un livre qui est à la fois un trésor de connaissances nouvelles et un cours pratique de méthode grammaticale. Il est à peine nécessaire d’ajouter que nous ne songions pas aux seuls linguistes de profession, en entreprenant une traductiou qui sans doute ne leur eût pas été nécessaire. Il y a parmi nous un grand nombre d’hommes voués par état et par goût à l’enseignement et à la culture des langues anciennes : ils ne veulent ni ne étrangers à des recherches qui touchent d travaux. C’est à eux surtout que, dans nof
destinons le présent, ouvrage, pour quils apprécient la valeur de celle science nouvelle et pour qu ils s en approprient les parties les plus utiles. Si les études historiques ne sont plus aujourd’hui en Fiance ce quelles étaient il v a cinquante ans, si les leçons de littérature données dans nos écoles ne ressemblent pas aux leçons littéraires qu’ont reçues nos pères et nos aïeux, pourquoi la grammaire seule resterait-elle au meme point qu au commencement du siècle? De grandes découvertes ont été laites : les idiomes que l’on considérait autrefois isolément, comme s’ils étaient nés tout à coup sous la plume des écrivains classiques de chaque pays, ont été replacés à leur rang dans l’histoire, entourés des dialectes et des langues congénères qui les expliquent, et étudiés dans leur développement et leurs transformations. La grammaire, ainsi comprise, est devenue à la lois plus rationnelle et plus intéressante : il est juste que notre enseignement profite de ces connaissances nouvelles qui, loin de le compliquer et de l’obscurcir, y apporteront l’ordre, la lumière et la vie.
Ce serait, du reste, une erreur de croire que toutes les recherches grammaticales doivent nécessairement embrasser à l’avenir l’immense champ d’étude parcouru par M. Bopp. 11 y a plus d’une manière de contribuer aux progrès de la philologie comparative. La méthode qui a servi pour l’ensemble de la famille indo-européenne sera appliquée avec non moins de succès aux diverses subdivisions de chaque groupe. Quelques travaux remarquables peuvent servir de modèle en ce genre. Un des plus solides esprits de l’Allemagne, M. Corssen, en rapprochant le la-
Un de ses frères, l’ombrien et l’osque, et eu comparant le latin à lui-même, c’est-à-dire en suivant ses transtorma-Lions d’âge en âge, a renouvelé en partie 1 étude dune langue sur laquelle il semblait qu’après tant de siècles d’enseignement il ne restât plus rien à dire. La science du langage peut encore être abordée par d’autres côtés. Les rechercherd’épigraphie, de critique verbale, de métrique, les études sur le vocabulaire d’un auteur ou d’une période littéraire, sont autant de sources d’information qui doivent fournir à la philologie comparée leur contingent de faits et de renseignements. Aujourd’hui que les grandes lignes de la science ont été marquées, ces travaux de détail viendront à propos pour déterminer et, au besoin, pour rectifier ce qui ne pouvait, dès le début, être tracé d’une façon définitive.
Ce ne sont ni les sujets, ni les moyens de travail qui feront défaut à nos philologues. Mais en cherchant à provoquer leur concours, nous ne songeons pas seulement à l’intérêt et à l’honneur des études françaises. Il faut souhaiter pour la philologie comparée elle-même quelle soit bientôt adoptée et cultivée parmi nous. On a dit que la France donnait aux idées le tour qui les achève et l’empreinte qui les Fait partout accueillir. Pour que la grammaire comparative prenne la place qui lui est due dans toute éducation libérale,pour quelle trouve accès auprès des intelligences éclairées de tous pays, il faut que l’esprit français y applique ces rares et précieuses qualités qui, depuis Henri Estienne jusqu’à Eugène Burnouf, ont été l’accompagnement obligé et la marque distinctive de l’éru-
dilion dans notre contrée, La France, en prenant part à
ces études, les répandra dans le monde entier. En même temps, avec ce coup d’œil pratique et avec cet art d<* classer et de disposer les matières que l’étranger ne nous conteste pas, nous ferons sortir de la grammaire comparée et nous mettrons en pleine lumière les enseignements multiples quelle tient en réserve. Une lois que la science du langage aura pris racine parmi nous, aux fruits quelle donnera, on reconnaîtra le sol généreux ou elle a été transplantée.
H.
L’auteur de la Grammaire comparée y M. François Bopp, est né à Mayence, le 1 h septembre 1791. Il fit ses classes à Aschaffenbourg, où sa famille, à la suite des événe--ments militaires de cette époque, avait suivi l’Électeur. On remarqua de bonne heure la sagacité de son esprit, ses goûts sérieux et réfléchis, ainsi que sa prédilection pour l’étude des langues : non pas qu’il eût une aptitude particulière à les parier ou à les écrire; mais son intention, en les apprenant, était de pénétrer par cette voie dans une connaissance’ plus intime de la nature et des lois de l’esprit humain. Après Leibnitz, qui eut sur ce sujet tant de 'vues profondes et justes1’, Herder avait appris à l’Allemagne à considérer les langues autrement que coinme
de simples instruments destinés à l’échange des idées : il avait montré qu’elles renferment aussi, pour qui sait les interroger, les témoignages les plus anciens et les plus authentiques sur la façon de penser et de sentir des peuples. Au lycée d’Aschaffenbourg, qui avait, en partie, recueilli les professeurs de l’Université de Mayence, M. Bopp eut pour maître un admirateur de Hercler, Charles Win-dischmann, à la fois médecin, historien et philosophe, dont les nombreux écrits sont presque oubliés aujourd'hui, mais qui joignait à des connaissances étendues un grand enthousiasme pour la science. Les religions et les langues de l’Orient étaient pour Windischmann un objet de vive curiosité : comme les deux Schlegel, comme Creuzer et Gœrres, avec lesquels il était en communauté d’idées, il attendait d’une connaissance plus complète de la Perse et de l’Inde des révélations sur les commencements du genre humain. C’est un trait remarquable de la vie de M. Bopp que celui dont les observations grammaticales devaient porter un si rude coup à l’une des théories fondamentales du symbolisme ait eu pour premiers maîtres et pour premiers patrons les principaux représentants de l’école symbolique. La simplicité un peu nue, l’abstraction un peu sèche de nos encyclopédistes du xvme siècle avaient suscité par contre-coup les Creuzer et les Windischmann; mais si M. Bopp a ressenti la généreuse ardeur de cette école * et si la parole de ses maîtres l’a poussé à scruter les mêmes problèmes qui les occupaient, il sut garder, en dépit des premières impressions de sa jeunesse , sur le terrain spécial qu’il choisit, toute la liberté d’esprit de! observateur. Les doctrines de Heidelberg ne trou-
blèrent point la clarté de son coup dœil, et sans lavoir cherché, il contribua plus que personne à dissiper le mystère dont ces intelligences élevées, mais amies du demi-jour, se plaisaient à envelopper les premières productions de la pensée humaine.
Après avoir appris les langues classiques et les principaux idiomes modernes de l’Europe, M. Bopp se tourna vers l’étude des langues orientales. Ce qu’on entendait par ce dernier mot, au commencement du siècle, c’étaient les langues sémitiques, le turc et le persan. On savait toutefois, grâce aux publications de la Société asiatique de Calcutta et aux livres de quelques missionnaires ou voyageurs, qu’il s’était conservé dans l’Inde un idiome sacré dont l’antiquité dépassait, disait-on, l’âge de toutes les langues connues jusqu’alors. On ajoutait que la perfection de cet idiome était égale, sinon supérieure, à celle des langues classiques de l’Europe. Quant à la littérature de l’Inde, elle se composait de chefs-d’œuvre de poésie tels que Sacoun-talâ, récemment traduite par William Jones, d’immenses épopées remplies de légendes vieilles comme le monde et de trésors de sagesse comme la philosophie du Védanta, Le jeune étudiant prêtait l’oreille à ces renseignements dont le caractère vague était un aiguillon de plus. II résolut d’aller à Paris pour y étudier les idiomes de l’Orient et particulièrement le sanscrit.
Un ouvrage resté célèbre, qui se perd, après les premiers chapitres, dans un épais brouillard d’hypothèses, mais dont le commencement devait offrir lé,plus vif intérêt à l’esprit d’un linguiste,ne fut sans doute pas étranger à cette décision. Nous voulons parler du livre de Frédéric
Schlegei k Sur la langue el la sagesse des Indous r> Malgré de nombreuses erreurs, on peut dire que ce travail ouvrait dignement, par l’élévation et la noblesse des sentiments, l’ère des études sanscrites en Europe. H eut surtout un grand mérite, celui de pressentir l’importance de ces recherches et d’y appeler sans retard 1 effort de la critique.
rfPuissent seulement les études indiennes, écrivait ceSchlegel à la fin de sa préface, trouver quelques-uns de ce ces disciples et de ces protecteurs, comme l’Italie et ce l’Allemagne en virent, au xve et au xvie siècle, se lever ce subitement un si grand nombre pour les études grecques ce et faire en peu de temps de si grandes choses ! La renais-ffsance de la connaissance de l’antiquité transforma et rare jeunit promptement toutes les sciences : on peut ajouter cr qu’elle rajeunit et transforma le monde. Les effets des ce études indiennes, nous osons l’affirmer, ne seraient pas s aujourd’hui moins grands ni d’une portée moins génère raie, si elles étaient entreprises avec la même énergie et fç introduites dans le cercle des connaissances européennes, ce Et pourquoi ne le seraient-elles pas? Ces temps des Mé-cf dicis, si glorieux pour la science, étaient aussi des temps rrde troubles et de guerres, et précisément pour ritalie rc ce fut l’époque d’une dissolution partielle. Néanmoins il rr fut donné au zèle d’un petit nombre d’hommes de pro-r duire tous ces résultats extraordinaires, car leur zèle était cr grand, el il trouva, dans la grandeur proportionnée
crd’établissemenls publics et dans la noble ambition de
' ■ . • ■ . ■■ ■ _ • ■ . .. ■ t *
a quelques princes, l’appui et la laveur dont une pareille ce étude avait besoin à ses commencements, n
Paris était alors, de l’aveu de tous, le centre des études orientales, grâce à sa magnifique Bibliothèque et à la présence de savants comme Silvestre de Sacy, Ghézy, Etienne Quatremère, Abel Rémusat. En ce qui concerne la littérature sanscrite, il s’était formé à Paris, depuis i8o3, un petit groupe d’hommes distingués qui recueillait avec une curiosité intelligente les renseignements venant de l’Inde sur une matière si peu connue. Un membre de la Société de Calcutta, Alexandre Ha mil ton, fut le maître de cette colonie savante : retenu prisonnier de guerre après la rupture de la paix d’Amiens, il employa ses loisirs à passer en revue et à cataloguer la belle et riche collection de manuscrits sanscrits formée pour la Bibliothèque du roi, dans la première moitié du xvme siècle, par le Père Pons : en même temps, par ses conversations, il introduisait dans la connaissance du monde indien Langlès, le libéral conservateur des manuscrits orientaux, Frédéric Schlegel, Chézy, qui devait plus tard monter dans la première chaire de sanscrit fondée en Europe, et Fauriel, dont la curiosité universelle ne se contentait pas des littératures de l’Occident. Quelques années après, le célèbre critique Auguste-Guillaume Schlegel venait à son tour à Paris préparer ses éditions de l’Hi-tôpadèça et de la Bhagavad-Gîtâ. Le trait distinctif du plus grand nombre de ces savants était une aptitude à s’assimiler les idées* nouvelles qui est rare en tout temps-mais qui l’était surtout à l’époque dont nous parlons.
Tou tel ois, co groupe d hommes, en cpii se résumaient alors les études sanscrites de l’Europe, avait ses cotes faibles, ses préférences et ses préventions. N ayant aucun moyen de contrôler les assertions de 1 école de Calcutta, qui écrivait elle-même sous la dictée des brahmanes, il était obligé à une confiance docile ou réduit à des suppositions sans preuve : ainsi que le dit quelque part Chézy, on ressemblait à des voyageurs en pays étranger, contraints de s’en reposer sur la bonne foi des truche-mans2. Frédéric Scblegel, comme les autres, puisait sa science dans les Mémoires de la Société de Calcutta : il adaptait les faits qu’il y apprenait à une chronologie de son invention et à une philosophie de 1 histoire arrangée d’avance. Tout ce qui touchait aux doctrines religieuses, aux oeuvres littéraires, à la législation de 1 Inde, sollicitait vivement l’attention de ces écrivains et de ces penseurs; mais les travaux purement grammaticaux jouissaient auprès d’eux d’une estime médiocre. On regardait l’étude du sanscrit qui, il faut le dire, était alors rebutante et hérissée de difficultés, comme une initiation pénible, quoique nécessaire, à des spéculations plus relevées. Par la rigueur et la sagesse de son intelligence, plus portée à l’observation qu’aux systèmes, par son indépendance d’esprit, qui ne s’en rapportait à personne et ne se prononçait que sur les faits constatés, par la préférence qui l’entraînait aux recherches grammaticales, le jeune et modeste philologue qui, en 1812, arrivait à Paris, formait un contraste frappant avec ces savants qui représentent, dans l’histoire
des études sanscrites, l’age de loi et d’enthousiasme. Le futur auteur de la Grammaire comparée devait inaugurer une période nouvelle : il apportait avec lui l’esprit d’analyse scientifique.
M. Bopp passa quatre années à Paris, de 181 a à 1816, s’adonnant, en même temps qu’à l’étude du sanscrit, à celle du persan, de l’arabe et de l’hébreu. Nous trouvons dans son premier ouvrage l’expression de sa reconnaissance envers Silvestre de Sacy, dont il suivit les cours, et envers Langlès qui, outre les collections du Cabinet des manuscrits, mit à sa disposition sa bibliothèque particulière, l’une des plus riches et des mieux composées qu’on pût trouver alors. Plus heureux que ses prédécesseurs, réduits à apprendre les éléments de la langue sanscrite dans des travaux informes, il eut entre les mains les grammaires de Carey1, de Wilkins3 4 et de Forster5 : le Râmâyana et l’Hitôpadêça de Sérampour, publiés par Carey, furent les premiers textes imprimés qu’il eut à sa disposition. En même temps, il tirait des manuscrits de la Bibliothèque des matériaux pour ses éditions futures. La guerre qui mettait alors aux prises l’Allemagne et la France ne put le distraire de son long et paisible travail ; comme un sage de l’Inde transporté à Paris, il était tout entier à ses recherches, et, au milieu de la confusion des événements, il gardait son attention pour lès chefs-d’œuvre de la poésie sanscrite et pour série des faits
si curieux et si nouveaux qui se
r
découvraient à son es-
pvit. % .
Le premier résultat de son séjour de quatre ans a raiis
fut cette publication dont l’Allemagne se prépare à célébrer comme un jour de fête le cinquantième anniversaire. Le livre a pour titre : » Du système de conjugaison de la langue sanscrite, comparé avec celui des langues grecque, latine, persane et germanique1.» Cet ouvrage, intéressant à plus d’un titre, mérite bien, en effet, d’être regardé comme faisant époque dans l’histoire de la linguistique. Nous nous y arrêterons quelques moments, pour examiner les nouveautés qu’il renferme.
III.
Ce qui fait l’originalité du premier livre de M. Bopp, ce n’est pas d’avoir présenté le sanscrit comme une langue de même famille que le grec, le latin, le persan et le gothique, ni même d’avoir exactement défini la nature et le degré de parenté qui unit l’idiome asiatique aux langues de l’Europe. C’était là une découverte faite depuis longtemps. ^affinité du sanscrit et de nos langues de l’Occident est si évidente, e^e s'étend à un si grand nombre de mots et à tant de formes grammaticales, quelle avait frappé les yeux des premiers hommes instruits qui avaient entre' : . i **
1 Francfort-surde-Mein, 1816. La préface, qui est de Windischmann, est datée du 16 mai 1816. Le 16 mai 1866, une fondation, qui portera le nom de M. Bopp et à laquelle concourent ses disciples et ses admirateurs de tous pays, sera constituée h Berlin pour l’encouragement des travaux de philologie comparative.
pris l’étude de la littérature indienne. L'idée d’une parenté reliant les idiomes de l’Europe à celui de l’Inde ne pouvait guère manquer de se présenter à l’esprit d’un observateur érudit et attentif1. On attribue d’ordinaire à William Jones l’honneur d’avoir, le premier, mis en lumière ce fait qui est devenu l’axiome fondamental de la philologie indo-européenne. Mais vingt ans avant Jones et avant l’Institut de Calcutta, le même fait avait déjà été publiquement exposé à Paris. H y aura bientôt un siècle que l’Académie des inscriptions et belles-lettres a été saisie de la question.
L’abbé Barthélemy s’était adressé, en 1763, à un jésuite français, le P. Gœurdoux, depuis longtemps établi à Pondichéry, pour lui demander une grammaire et un dictionnaire de la langue sanscrite. H le priait en même temps de lui donner divers renseignements sur l’histoire et la littérature de l’Inde. En répondant en 1767 au savant helléniste, le P. Cœurdoux joignit à sa lettre une sorte de mémoire intitulé : « Question proposée à M. 1 abbé rr Barthélemy et aux autres membres de l’Académie des cr belles-lettres et inscriptions, » Cette question est conçue ainsi : te D’où vient que dans^a langue samseroutane il se cr trouve un grand nombre deSnqts qui lui sont communs ce avec le latin et le grec, et surtout avec le latin8?'» À
1 On sait que les ressemblances de l’allemand et du persan ont été observées de bonne heure; mais on les expliquait par des conjectures aujourd’hui abandonnées. Il est constaté à présent que ces analogies proviennent de la parenté générale qui unit tous les idiomes indo-européens, et que les langues germaniques n’ont pas avec le persan ou avec le zend une affinité plus étroite qu’avec le sanscrit.
2 Le missionnaire ajoutait ces derniers mots pour prévenir une objection
INTRODUCTION, l’appui de son assertion, le P. Cœurdoux donnait quatre listes de mots et de formes grammaticales1. Il remarque que l’augment syllabique, le duel, l’a pnvaJ^e^nvjggt en sanscrit comme en jrec. Pour justifier quelques-uns drsês rapprochements, il donne des indications sur la prononciation des lettres indiennes : ainsi aham ne ressemble pas, à première vue, à ego; mais il faut observer que le h sanscrit est une lettre gutturale ayant un son analogue à celui du g. Le c' de calur répond au q de quatuor. Résolvant enfin lui-même la question qu’il posait à l’Académie, il réfute par d’excellentes raisons toutes les explications qu’on pourrait avancer en se fondant sur des relations de commerce ou sur des communications scientifiques, et il conclut à la parenté originaire des Indous, des Grecs et des Latins2. Dans une lettre subséquente, il ajoute qu’il a tmnv£ rTantrps identités entre le sanscrit, 1 allemand et
l’esclavon.
Nul doute que si l’Académie, en 1768, eût possédé un philologue éminent comme Fréret3, cette communication
qu’on ne devait pas manquer de lui opposer, celle d’un emprunt fort aux
royaumes grecs fondés dans le voisinage de 1 Inde. ^
1 II rapproche, par exemple, dânam de donmn, dattmn àedatum, vira de virius, vidhavâ de vidua, agm de ignis, nava de noms, divas de dtes, madhya àe médius, ant^d-Àé-inter, janürt de genitriæ. Il met le présent de Vindicatif et le potentiel du verheasmi en regard de eipl et de stm. U compare les pronoms personnels et interrogatifs en sanscrit , en grec et en latin. Il rapproche enfin tes noms de nombre dans les trois langues.
3 Mémoires de VAcadémie des Inscriptions et Belles-Lettres, t. XLIX,
p, 6Ü7-607. . . .
* * Voyez, par exemple, aux tomes XVIII et XXI de \Histoire de l Académie des Inscriptions, l’analyse de deux mémoires de Fréret intitulés : Vues générales sur l’origine et le mélange des anciennes nations et Observations gé-
ne fût pas restée stérile. Malheureusement l’abbé Bar-Ihélemy s’en remit sur Anquetil-Duperron du soin de répondre au missionnaire. Le traducteur du Zend-Avesta poussait jusqu a la passion le goût des recherches historiques; mais il n’avait aucun penchant pour les spéculations purement grammaticales, et les rapprochements d’idiome à idiome, comme ceux que proposait le P. Cœur-doux, lui inspiraient une invincible défiance. Persuadé que les analogies signalées étaient chimériques ou provenaient du contact des Grecs, il laissa tomber ce sujet de discussion pour entretenir son correspondant des questions qui lui tenaient à cœur. Le peu d’empressement qu’il mit A publier les lettres du missionnaire les empêcha d’avoir sur d’autres l’effet quelles n’avaient pas produit sur lui-même. Lues devant l’Académie en 1768, elles ne furent imprimées qu’en 1808, après la mort d’Anquetil-Duperron, à la suite d’un de ses mémoires. Dans l’intervalle, les études sanscrites avaient été constituées et la question soumise par le P. Cœurdoux à l’Académie des Inscriptions posée par d’autres devant le public. .
a La langue sanscrite, disait William Jones en 1786 dans cr un de ses discours à la Société de Calcutta1, quelle que ccsoit son antiquité, est d’une structure merveilleuse; plus «parfaite que la iari'gpe grecque, plus abondante que la «langue latine, d’une culture plus raffinée que Lune et « l’autre, elle a néanmoins avec toutes les deux une parenté
nérales sur Vorigine et sur Vancienne histoire des premiers habitants de là Grèce. Dans ces mémoires, le pénétrant critique essaye déjà la méthode el pressent quelques-unes des découvertes de la linguistique moderne.
1 Recherches asiatiques, t. 1, p. 4a«.’ : .
«si étroite, tant pour les racines verbales que pour les formes grammaticales, que cette parenté ne saurait être « attribuée au hasard. Aucun philologue, après avoir exa-cf miné ces trois idiomes, ne pourra sempecher de recontt naître qu’ils sont dérivés de quelque source commune, ffqui peut-être n’existé plus. II y a une raison du même ce genre, quoique peut-être moins évidente, pour supposer ttque le gothique et le celtique, bien que mélangés avec « un idiome entièrement différent, ont eu la meme ori-ttgine que le sanscrit; et l’ancien persan pourrait etre ce ajouté à cette famille, si c’était ici le lieu d’élever une « discussion sur les antiquités de la Perses
Sauf la supposition d’un mélange qui aurait eu lieu pour le gothique et pour le celtique, le principe de la parenté des langues indo-européennes est très-bien exprimé dans les paroles de William Jones. 11 est intéressant, en outre, de remarquer que, dès le début des études indiennes, le sanscrit est présenté comme la langue sœur et non comme la langue mère des idiomes de l’Europe. Presque.en même temps que W. Jones, un missionnaire, Allemand d’origine, qui avait longtemps séjourné dans l’Inde, le Père Paulin de Saint-Barthélemy, publiait à Rome des traités où il démontrait, par des exemples nombreux et généralement bien choisis, l’affinité du sanscrit, du zend, du latin et de l’allemand. La même idée se retrouve enfin dans le livre de Frédéric Schlegel dont nous avons déjà parlé, où elle sert de support à une vaste construction historique.
* Maïs si l’on avait déjà fait des rapprochements entre
les divers idiomes indo-européens, personne ne s’était encore avisé que ces comparaisons pouvaient fournir les matériaux d’une histoire des langues ainsi mises en parallèle. On donnait bien les preuves de la parenté du sanscrit et des idiomes de l’Europe; mais ce point une fois démontré, on semblait croire que le grammairien était au bout de sa tâche et qu’il devait céder la parole à l’historien et à l’ethnologiste. La pensée du livre de M. Bopp est tout autre : il ne se propose pas de prouver la communauté d’origine du sanscrit et des langues européennes; c’est là le fait qui sert de point de départ et non de conclusion à son travail. Mais il observe les modifications éprouvées par ces langues identiques à leur origine, et il montre l’action des lois qui ont fait prendre à des idiomes sortis du même berceau des formes aussi diverses que le sanscrit, le grec, le latin, le gothique et le persan. A la différence de ses devanciers, M. Bopp ne quitte pas le terrain de la grammaire; mais il nous apprend qu’à côté de l’histoire proprement dite il y a une histoire des langues qui peut être étudiée pour elle-même et qui porte avec elle ses enseignements et sa philosophie. C’est pour avoir eu cette idée féconde, qu’on chercherait vaine- ' ment dans les livres de ses prédécesseurs, que 1&: philo* r,; logie comparative a reconnu dans M. Bopp, et non daim William Jones ou dans Frédéric Schlegel, son premi maître et son fondateur.
est bien autrement pénétrante que celle dé s Il y a entre le sanscrit et les langues d^1 ressemblances qui se découvrent à premièi
Par une conséquence naturelle, l’analyse de M. Bopp

Il if .i.. 4
J V
frappent tous les yeux; il en est d’autres plus cachées, quoique non moins certaines, qui ont besoin, pour être reconnues, d’une étude plus délicate et d’observations multipliées. Ceux qui voyaient dans l’unité de la famdle indo-européenne un fait qu’il appartenait au linguiste de démontrer, mais dont les conséquences devaient se développer ailleurs qu’en grammaire, pouvaient se contenter des analogies évidentes. Mais M. Bopp, pour qui chaque modification faite au type de la langue primitive était comme un événement à part dans 1 histoire qui! composait, devait approfondir les recherches, mettre au jour les analogies secrètes et raviver les traits de ressemblance effacés par le temps. Si ses rapprochements surpassent en clairvoyance et en justesse tout- ce qui avait été essayé jusqu’alors, il ne faut donc pas seulement en faire honneur à la pénétration et à la rectitude de son esprit. La supériorité de l’exécution vient chez lui de la supériorité du dessein : la meme vue de génie qui lui a montré un but qu’avant lui on ne soupçonnait pas, lui a fait trouver des instruments plus parfaits pour y atteindre.
Le livre de M. Bopp renfermait une autre nouveauté, non moins importante : pour la première fois un ouvrage ■ de grammaire se proposait l’explication des flexions. Ces lettres et ces syllabes qui servent à distinguer les cas et . les nombres dans les noms, à marquer les nombres, les personnes, les temps, les voix et les modes dans les verbes, avaient toujours été considérées comme la partie la plus énigmatique des langues. Tous les grammairiens
les avaient énumérées : aucun n avait osé se prononcer sur leur origineJ.
Fort récemment, Frédéric Schlegel, dans son livre cf Sur la langue et la sagesse des Indous n, avait émis à ce sujet une théorie singulière, que M. Bopp a expressément .contestée plusieurs fois6 7, et que contredisent les observations" débouté sa vie. 11 ne sera donc pas inutile d’en dire ici quelques mots. L’hypothèse de Schlegel, qui se rattachait dans sa pensée à un ensemble de vues aujourdhui discréditées, n’a pas d’ailleurs entièrement disparu. Elle se
retrouve, avec toute sorte d’atténuations et de restrictions, dans beaucoup d’excellents esprits qui ne songent pas à en
tirer les mêmes conséquences et qui ne se doutent peut-être pas* où ils l’ont prise.
* Selon Schlegel, les flexions n’ont aucune signification par elles-mêmes et n’ont pas eu d’existence indépendante. Elles ne servent et n’ont jamais servi quà modifier les racines, c’est-à-dire la partie vraiment significative de la langue. D’où proviennent ces syllabes, ces lettres additionnelles si précieuses dans le discours? elles sont le produit immédiat et spontané de l’intelligence humaine. En
même temps que l’homme a créé des racines pour exprimer ses conceptions, il a inventé des éléments lorrnatifs, des modifications accessoires, pour indiquer les relations que ses idées ont entre elles et pour marquer les nuances dont elles sont susceptibles. Le vocabulaire et la grammaire ont été coulés d’un même jet. Dès sa première apparition, le langage fut aussi complet que la pensée humaine qu’il représente. Une telle création peut nous sembler surprenante et même impossible aujourd hui. Mais l’homme, à son origine, n’était pas l’être inculte et borné que nous dépeint une philosophie superficielle. Doué d’organes d’une extrême finesse, il était sensible à la signification primordiale des sons, à la valeur naturelle des lettres et des syllabes. Grâce à une sorte de coup d’œil divinateur, il trouvait sans tâtonnement le rapport exact entre le sou et l’idée : l homme d aujourd hui, avec ses facultés oblitérées, ne saurait expliquer cette relation entre le signe et la chose signifiée quune intuition infaillible feisait apercew^^ ancêtres. D’ailleurs, poursuit Schlegel, toutes les races n’ont pas été pourvues au même degré de cette faculté créatrice. Il y a des langues qui se sont formées par la juxtaposition de racines significatives, invariables et inanimées, le chinois, par exemple, ou les langues de l’Amérique, ou encore les langues sémitiques; ces idiomes sont régis par des lois purement extérieures et mécaniques. Ils ne sont pas incapables, toutefois, duo certain développement : ainsi l’arabe * en adjoignant , sous la forme d’edfixes, des particules à la racine , se rapproché jusqu’à un certain point des langues indo-europeennes, Mais ce sont ces dernières seules qui méritent véritable-
ment le nom de langues à flexions; elles sont les seules, continue l’auteur dans son langage figuré, qu’il semble parfois prendre à la lettre, où la racine est un germe vivant, qui croît, s’épanouit et se ramifie comme les produits organiques de la nature. Aussi les langues indoeuropéennes ont-elles atteint la perfection dès le premier jour, et leur histoire n’est-elle que celle d’une longue et inévitable décadence1.
Quand on examine de près cette théorie, on voit qu elle tient de la façon la plus intime au symbolisme de Greuzer, Le professeur de Heidelberg appuyait aussi ses explications sur cette faculté d’intuition dont l’homme était doué à l’origine, et qui lui révélait des rapports mystérieux entre les idées et les signes; il parlait des dieux, des mythes, des emblèmes, dans les mêmes termes que Schlegel des formes grammaticales : tous deux se référaient à une éducation mystérieuse que le genre humain, ou du moins une portion privilégiée de la famille humaine, aurait reçue dans son enfance. Aux assertions de Greuzer, Schlegel apportait le secours de sa connaissance récente de 1 Inde# Après les études qui venaient de le conduire jusqu au berceau de la race, le doute, assurait-il, n était plus possible : la perfection de fidiome, non moins que la ma-? jesté de la poésie et fa grandeur des systèmes philosophiques, attestait que les ancêtres des Indous avaient été éclairés d’une <rsagessey> particulière2.
A ces idées qui ne manquaient pas d’une certaine ,ap-parence de profondeur, M. Bopp se contenta d opposer
1 Ouvrage cite, p. kh et suiv. '
3 Delà le titre de iouvrage de Schlegel. '
quelques faits aussi simples qu’incontestables. Il avait choisi pour sujet de son premier travail la conjugaison du verbe, c’est-à-dire l'une des parties de la grammaire où l’on peut le plus clairement découvrir la vraie nature des flexions. Il montra d’abord que les désinences personnelles des verbes sont des pronoms personnels ajoutés à la racine verbale, te Si la langue, dit-il, a employé, avec le génie prête voyant qui lui est propre, des signes simples pour re-« présenter les idées simples des personnes, et si nous cr voyons que les mêmes notions sont représentées de la trmême manière dans les verbes et dans les pronoms, il et s’ensuit que la lettre avait à l’origine une signification ccet quelle y est restée fidèle. S’il y a eu autrefois une cf raison pour que mâm signifiât cc moi a et pour que tam cc signifiât celuic’est sans aucun doute la même raison ccqui fait que bhavâ-mi signifie «je suis a et que bhavar-ti cc signifie ce il est a. Du moment que la langue marquait cc les personnes dans le verbe en joignant extérieurement «des lettres à la racine, elle n’en pouvait légitimement cc choisir d’autres que celles qui, depuis l’origine du lance gage, représentaient l’idée de ces personnes1, a
Il fait voir de même que la lettre s, qui, en sanscrit comme en grec, figure à l’aoriste et au futur des verbes, provient de l’adjonction du verbe auxiliaire as cc être a à la racine verbale : {xot,%-é<7-o-ficu, ôX-étt-ü) renferment la même syllabe &<r qui se trouve dans êcr-fxév, sct-t/2. Les futurs et les imparfaits latins comme ama-bam, ama-bo, contiennent également un auxiliaire, le même qui se trouve
1 Système de conjugaison de la langue sanscrite, p. 1 ^7.
3 Ouvrage cité , p. 66. Cf. la Grammaire comparée, S 648 et suiv.
dans le futur anglo-saxon en beo, bys> bytk; c’esi la racine bhû ffêtren, qui, à l’état indépendant, a donné au latin le parfait fui et à l’allemand le présent ich Un, du bisl1.
Par ces exemples et par beaucoup d’autres du même genre, il montre que les flexions sont d’anciennes racines qui ont eu leur valeur propre et leur existence individuelle , et qu’en se combinant avec la racine verbale elles ont produit le mécanisme de la conjugaison. On ne saurait priser trop haut l’importance de ces observations. La théorie de Schlegel ouvrait une porte au mysticisme; elle contenait des conséquences qui n’intéressaient pas moins l’histoire que la grammaire, car elle tendait à prouver que l’homme, à son origine, avait des facultés autres qu aujourd’hui, et qu’il a produit des oeuvres qui échappent à l’analyse scientifique. C’est, un des grands mérites de M. Bopp d’avoir combattu cette hypothèse toutes les fois qu’il l’a rencontrée et d’avoir accumulé preuve sur preuve pour l’écarter des études grammaticales.
La troisième et dernière nouveauté que nous voulons relever dans l’ouvrage qui nous occupe, c’est l’indépendance que, dès ses premiers pas, M. Bopp revendique pour la philologie comparative, en regard des grammaires, particulières qui donnent les règles de chaque languir Avant lui, on s’en était tenu, pour l’explication des formes sanscrites, aux anciens grammairiens de l’Inde* brooke résume Pânini; Carev et Wilkins transportent dsfns leurs livres les procédés grammaticaux qui sont en ItésagtV'
, ' '' v V 'T' V ï^' T'1"
. ■ . .. ...
k, ’ ' '' ' " ' . ' ' •’ •’
P. 96. Cf. la Grammaire comparée, § 5a6. f ■
dans les écoles des brahmanes. On concevait à peine l’idée d’une autre méthode : l’opinion générale était qu’il fallait s’en rapporter à des maîtres qui joignaient une si prodigieuse faculté d’analyse à l’avantage d’enseigner leur langue maternelle. M. Bopp n’est pas l’élève des Grecs et des Romains; mais il n’est pas davantage le disciple des Indous. ce Si les Indous, dit-il1, ont méconnu quelquefois fcl’origine et la raison de leurs formes grammaticales, ils ff ressemblent en cela aux Grecs, aux Romains et aux mo-crdernes, qui se sont fait souvent une idée très-fausse de cf la nature et de la signification des parties du discours les cc plus importantes, et qui mainte fois ont plutôt senti que cc compris l’essence et le génie de leur langue. Les uns cc comme les autres ont pris pour sujet de leurs observations leur idiome déjà achevé ou plutôt déjà parvenu au cc delà du moment de la perfection et arrivé à son déclin; et il ne faut pas s’étonner s’il a été souvent pour eux une cc énigme et si le disciple a mal compris son maître. Il est cc certain que chez les Indous les méprises sont plus rares * cc parce que dans leur idiome les formes se sont conservées cc d’une façon plus égale et plus complète; mais il n’en est cc pas moins vrai que, pour arriver à une étude scientifique cc des langues, il faut une comparaison approfondie et phi-cclosophique de tous les idiomes d’une même famille, nés crd’une même mère, et qu’il faut même avoir égard à cc d’autres idiomes de famille différente. En ce qui concerne cela langue sanscrite, nous ne pouvons pas nous en tenir cc aux résultats de la grammaire des indigènes; il faut pé-ccnétrer plus avant, si nous voulons saisir l’esprit des
1 Ouvrage cité, p. 56.
tf langues que nous nous contentons d’apprendre machi-«nalement dans notre enfance.»
Si l’on se reporte à l’époque où ces lignes ont été écrites, elles paraîtront d’une grande hardiesse : elles étaient l’annonce d’une méthode nouvelle. M. Bopp prend dans chaque grammaire toutes les observations dont il reconnaît la justesse, de même qu’il emprunte tantôt à l’école grecque et tantôt à l’école indienne les termes techniques qui lui paraissent nécessaires et commodes. Mais, ainsi qu’il le dit, il ne reconnaît d’autre maître que la langue elle-même, et il contrôle les doctrines des grammairiens au nom du principe supérieur de la critique historique.
Après avoir indiqué les idées essentielles du livre de M. Bopp, il resterait à citer quelques-uns des faits qu’il renferme, pour montrer à quels résultats la méthode comparative conduisait dès le premier jour. Il n’y avait pas longtemps que l’école hollandaise, représentée par Hemsterhuys, Valckenaer, Lennep et Scheide, avait essayé de renouveler l’étude de la langue grecque en y appliquant les procédés de la grammaire sémitique et en divisant les racines grecques en racines bilitères, trili-tères et quadrilitères. On ne doit pas s’étonner si une pareille tentative ne produisit que des erreurs : ainsi aflâw (considéré à tort comme le primitif de iWj/fju) est ramené par Lennep à une racine raca, tèpmw à réptû, Spnw à èpéw. M. Bopp ne devait pas avoir de peine à prouver* par la comparaison des verbes sanscrits sthâ, tnp9 sHp1,
1 Plus tard, M. Bopp devait montrer que trîp, srïp supposent d’anciennes formes tarp, sarp, (Voyez Grammaire comparée, Si.)
combien ces éliminations de lettres étaient arbitraires. Mais ce qui, chez les savants que nous venons de nommer, doit surprendre plus que toutes les erreurs de détail, cest l’idée qu’ils se faisaient encore des racines, car non-seulement ils comptent Yto du présent de 1 indicatif parmi les lettres radicales, et ils voient, par exemple, dans "kéytù une racine quadrilitère, mais ils font servir les désinences grammaticales à l’explication des dérivés : ainsi est rapporté à un prétendu parfait àfzfza à \é%is à XiXsüûM, à 'tièncLTCtt. Pour la pre
mière fois, dans le livre de M. Bopp, on voit figurer de vraies racines grecques et latines; pour la première fois, les éléments constitutifs des mots sont exactement séparés. Appliquant aux verbes grecs la division en dix classes établie par la grammaire de l’Inde, il reconnaît dans S1S03fit, l't/lrffjLt les racines So et efîa, redoublées de la meme façon que dans daddmi, tishthdmi; il montre que les formes comme prfyvvp-sv 9 S&txvvfi&v, §<x,iv\j{L£v doivent etre décomposées ainsi : piriy-vv~p.sv 9 Ssix-vv-fisv, Æcu-vv-ftev, et que ces verbes correspondent aux verbes sanscrits de la cinquième classe, tels que su-nu-mas; il rapproche, comme exemple d’un verbe» de la huitième classe, le grec tocv-v-fLSV du sanscrit îan-u-nias; il montre enfin que le v est une lettre formative dans les verbes comme xptvo), x\ivw9 réfitvéo, dont les racines sont xpf, xXi, TspA
Frédéric Schlegel avait déjà reconnu l’identité des infinitifs sanscrits en tum, comme sthâtum, dâtum, avec les supins latins comme statum, datum. Mais M. Bopp, allant
■ : ' • •* r • . - . ‘ '
1 Cf. Grammaire comparée, S 109* et suiv.
plus loin dans cette voie, explique ces mots comme des accusatifs de substantifs abstraits formés à l’aide du suffixe lu. Il en rapproche les gérondifs sanscrits comme sihitvâ, dans lesquels il reconnaît l’instrumental d’un nom verbal formé de la même façon. On peut voir dans la Bibliothèque indienne d’Auguste-Guillaume Schlegel 1 l’étonnement que lui causait une analyse aussi hardie : il devait arriver souvent à M. Bopp de soulever des réclamations dans les camps les plus divers. Ceux qui avaient appris le grec et le latin à l’école de l’antiquité, ceux qui avaient étudié le sanscrit dans les livres de l’Inde, comme ceux qui expliquaient les langues germaniques sans sortir de ce groupe d’idiomes, devaient à tour de rôle être déconcertés par la nouvelle méthode. Au point de vue élevé où ii se plaçait, les règles des grammaires particulières devenaient insuffisantes et les faits changeaient d’aspect en étant rapprochés de faits de même espèce qui les complétaient et les rectifiaient.
IV.
Le livre de M. Bopp parut en 1816, à Francfort-sur-le-Mein, précédé d’une p ice de Windischmann et suivi de la-traduction en vers ae quelques fragments des deux épopées indiennes8 9. Le roi de Bavière, à qui Windisch-
matin lut un de ces morceaux, accorda au traducteur un secours pécuniaire qui lui permit daller continuer ses études à Londres. M. Bopp y connut Wilkins et Colebrooke; mais il fut surtout en rapport avec Guillaume de Hum-boldt, alors ambassadeur de Prusse à la cour d’Angleterre. Il eut l’honneur d’initier à la connaissance du sanscrit le célèbre diplomate, depuis longtemps renommé comme philosophe, et qui venait de se montrer linguiste savant dans ses travaux sur le basque. L esprit lucide et net du jeune professeur servit peut-être jusqu a un certain point de correctif à cette large et puissante intelligence, qui arrivait quelquefois à l’obscurité, en recherchant, comme elle excellait à le faire, dans les lois de la pensée, la cause des phénomènes les plus délicats du langage L
En 18âo, M. Bopp fit paraître en anglais, dans les Annales de littérature orientale, un travail qui reprend avec plus d’ampleur et de développement le sujet traité dans son premier ouvrage2. L’auteur ne se borne plus,
sitaîre, qui s’était fait l’auditeur du cours de Ghézy, avait vu le parti quon devait tirer de la langue de l’Inde pour éclairer la grammaire grecque. Il a indiqué avec plus de détail ses vues sur ce sujet, dans un articl séré, en i8a3, dans le Journal asiatique (t. III). Ce nest pas ici le lieu dexa-miner pourquoi ces commencements n’ont pas été suivis, en France, d un effet plus prompt et plus général.
1 Comme modèles de cette analyse philosophique ou Guillaume de Hum-holdt est incomparable, on peut citer les écrits suivants : De 1 écriture phonétique et de son rapport avec la structure des idiomes (i8a6); Du duel (t 828); De la parenté des adverbes de lieu avec les pronoms dans certaines
langues (1880).
s Ce travail a été traduit en allemand parle docteur Pacht, dans le recueil de Gottfried Seebode : Nouvelles archives de philologie et de péda-
' : .. iA: 7 .
gogie. 1827. .
cette fois, à l’étude du verbe : il esquisse déjà sa Grammaire comparée. Quelques lois phoniques sont indiquées; il présente pour la première fois la comparaison si intéressante entre les racines sémitiques et les racines indoeuropéennes, qu’il devait développer plus tard dans le premier de ses Mémoires lus à l’Académie de Berlin, jet qu’il a peut-être trop condensée dans un des paragraphes de sa Grammaire comparée; il donne déjà de l’augment, qu’il identifie avec Y a privatif, l’explication qu’il reproduira dans son grand ouvrage h
Revenu en Allemagne, M. Bopp fut proposé par le gouvernement bavarois comme professeur à l’université de Würzbourg; mais funiversité refusa de créer une chaire nouvelle pour des études qu’elle jugeait peu utiles. II passa alors un hiver à Gôttingue, où il fut en relation avec Otfried Müller. En 18â 1, sur la recommandation de Guillaume de Humboldt, devenu ministre, il fut appelé comme professeur des langues orientales à l’université de Berlin. Il se partagea dès lors entre son enseignement et ses écrits, qui se sont succédé sans interruption jusqu’à ce jour.
De 1824 à i833, il inséra dans le Recueil de l’Académie de Berlin six mémoires, moins remarquables par leur étendue que par leur importance ; ils contiennent en germe sa Grammaire comparée. Nous ne voulons pas lès analyser ici 2. Mais il est intéressant d’observer comment 10
peu à peu, à mesure que des sujets d'information nouveaux se présentent devant lui, l’auteur élargit le cercle de ses recherches.
Aux langues qui lui avaient servi pour ses premières comparaisons, il ajoute d’abord le slave10, ensuite le lithuanien2. Ce fut pour lui un surcroît de richesse et une mine pleine d’agréables surprises, car ces langues, très-riches en formes grammaticales, se sont mieux conservées, à quelques égards, que le reste de la famille. Se référant à ces points de rencontre, M. Bopp regarde les peuples letto-slaves comme les derniers venus en Europe, et il admet qu’une parenté plus intime relie leurs idiomes au zend et au sanscrit. Nous devons dire qu’il a été contredit sur ce sujet par un philologue particulièrement versé dans l’étude du slave et du lithuanien. M. Schleicher conteste le lien spécial de parenté qu’on voudrait établir entre les deux langues asiatiques et les langues letto-slaves, et c’est dé la famille germanique qu’il rapproche ces derniers idiomes.
La découverte du zend ouvrit une autre carrière, à l’activité de M. Bopp. Ce fut, comme il le dit, un des
t8a5. Du pronom réfléchi.
i8à6. Du pronom démonstratif et de l'origine des signes casuels. i8ag. De quelques thèmes démonstratifs et de leur rapport avec diverses préposi-tiens et conjonctions.
t83i. De l’influence des pronoms sur la formation des mots. t833. Des noms de nombre en sanscrit, en grec, en latin, en lithuanien et en ancien slave. *«- Des noms de nombre en zend.
(Tous ces mémoires ont paru en brochures à part. )
1 Grâce aux travaux de Dobrowsky, de Kopitar, de Schaflarik.
9 Avec l’aide des grammaires de Ruhig et de Mieloke,
c
triomphes de la science nouvelle, car le zencl, dont le sens était perdu, fut déchiffré en partie par une application de la méthode comparative. Jusque-là, M. Bopp«s’était servi du persan moderne pour ses rapprochements; mais le persan, qui est au zend ce que le français est au latin, ne présente qu’anomalies et obscurités sans le secours de l’idiome dont il est sorti. H est vrai que Paulin de Saint-Barthélemy, faisant preuve d’un véritable sens philologique, avait déjà reconnu, à travers la transcription défectueuse d’Anquetil-Duperron, un certain nombre de mots communs au zend, au sanscrit, à l’allemand et aux langues classiques. Mais les doutes injustes qui pesaient sur l’authenticité de la langue de l’Avesta mpêchèrcnt d’abord M. Bopp d’entrer dans la même voie. Ce fut Rask qui, le premier, par des raisons toutes grammaticales, leva les scrupules. Eugène Burnouf commença bientôt après le déchiffrement qui fut un de ses plus grands titres de gloire. En faisant lithographier un manuscrit du Ven-didad-Sadé, il permit à M. Bopp de prendre sa part d’un travail qui s’accommodait si bien au tour de son esprit. Il s’engagea entre les deux savants une lutte courtoise de pénétration et de savoir : l’estime qu’ils faisaient l’un de l’autre est marquée dans les comptes rendus qu’ils ont réciproquement donnés de leurs découvertes11.
Nous arrivons à un travail qui marque une direction nouvelle dans les recherches de M. Bopp. Dans ses premiers ouvrages, il s’était surtout occupé de Tanaiyse des
formes grammaticales. 11 fut conduit sur un autre terrain, non moins fécond en enseignements, par la Grammaire allemande de Grimm. Si M. Bopp a frayé la route en tout ce qui touche à l’explication des flexions, Jacob Grimm est le vrai créateur des études relatives aux modifications des sons. Cette histoire des voyelles et des consonnes, qui ne peut sembler inutile ou aride qu’à ceux qui sont toujours restés étrangers à l’examen méthodique des langues, venait de trouver dans l’illustre germaniste le plus délicat et le plus séduisant des narrateurs. 11 avait montré, par la loi de substitution des consonnes allemandes, combien est important le rôle des lois phoniques dans la formation et dans la métamorphose des idiomes12. Allant plus loin encore, il avait analysé la partie la plus subtile du langage, savoir les voyelles, et ramené à des séries uniformes, qu’il compare lui-même à l’échelle des couleurs, les variations dont chaque voyelle allemande est susceptible. Mais ici il se trouva, sur un point capital, en désaccord avec M. Bopp. Ce n’est pas le lieu d’exposer la théorie de Grimm sur l’apophonie (ablaut)2 : il nous suffira de dire que, non content d’attribuer à ces modifications de la voyelle une valeur significative, il y voyait une manifestation immédiate et inexplicable de la faculté du langage. M. Bopp combattit cette hypothèse comme il avait combattu la théorie de Frédéric Schlegel sur l’origine des flexions. Il s’attacha à montrer, par la comparaison des autres idiomes indo-eüropéens, que l’apophonie, telle quelle existe dans
les langues germaniques, n’a rien de. primitif,- que les modifications de la voyelle n entraînaient, à l’origine, aucun changement dans le sens, et que ces variations du son étaient dues à des lois d’équilibre et à l’in fluence de l’accent tonique1. Une fois attiré vers ce nouveau genre de recherches, M. Bopp continua ses découvertes; il fit connaître l’origine des voyelles indiennes n et II, montra la présence du gouna et du vriddhi dans les langues de l’Europe, distingua dans la conjugaison les désinences pesantes et légères, dans la déclinaison les cas forts et les cas faibles, et établit ces lois qu’il a ingénieusement appelées lois de gravité des voyelles.
Après vingt ans de travaux préparatoires, le moment parut enfin venu à M. Bopp d’élever le monument auq uel son nom restera désormais attaché. II commença en 1.833 la publication de sa Grammaire comparée13 14 15 16. L’impression produite par cet ouvrage fut grande : tous les esprits sérieux furent frappés du développement des recherches? de la simplicité des vues principales, de la nouveauté et de
l’importance des résultats, Lugène Burnou!, qui lendit compte du premier fascicule dans le Journal des Savants, dit que ce livre resterait, *c sous la forme que lui avait donnée l’auteur, comme l’ouvrage qui renferme la solution la plus complète du problème que soulève l’étude comparée des nombreux idiomes appartenant a la famille indo-gei ma-üique1. d Une traduction anglaise, due à M. bastwiek, parut sous les auspices de l’illustre Wilson®.
Les ouvrages de linguistique qui commencèrent dans le même temps à se multiplier en Allemagne, firent encore ressortir l’importance du livre de M. Bopp, quils complétaient ou qu’ils continuaient par certains cotés. 11 faut au moins nommer ici M. Pott3, le savant etymologiste, et M. Benfey4, qui poussa de front les études de grammaire comparée et les études sanscrites. Pendant que se publiait la Grammaire comparée, paraissait aussi le grand ouvrage où Guillaume de Humboldt montrait, avec une finesse et une profondeur singulières, quels enseignements on pouvait tirer, pour l’analyse de l’esprit humain, de 1 examen historique et comparatif des langues5. Le mouvement phi—
:dJournal des Savants, i833, p. 4i3.
Londres. 3 volumes, 1845*53. Celte traduction est arrivée u sa Iroi-
sième édition.
3 La première édition des Recherches étymologiques de M. Pott est de i833. La seconde édition, encore inachevée (1869-61), a subi un remaniement complet, qui en a fait un livre nouveau.
A Los principaux ouvrages de M. Benfey sont le Lexique des racines grecques (1839), l’édition du Sâma-véda (f8A8), la Grammaire sanscrite (185s), l’édition du Pantchatantra (1869). Depuis 1862, M. Benfey dirige une re-
.vué de philologie, intitulée : Orient et Occident.
5 De la langue kawie, t836-39, 3 volumes in4°. — ï/introduetion
iologique, qui depuis ne s’est plus ralenti, se manifestait avec éclat: parmi cette variété de travaux, le livre de M. Bopp était comme l’ouvrage central, auquel la plupart de ces écrits se référaient ou qu’ils supposaient implicitement. Essayons donc de nous en rendre compte et de dégager, à travers la multiplicité des faits et des observations de détail, les principes qui y sont contenus.
La vue fondamentale de la philologie comparative, c’est que les langues ont un développement continu dont il faut renouer la chaîne pour comprendre les faits qu’on rencontre à un moment donné de leur histoire. L’erreur de l’ancienne méthode grammaticale est de croire qu’un idiome forme un tout achevé en soi, qui s’explique de lui-même. Cette hypothèse, qui est sous-entendue dans les spéculations des Indous aussi bien que dans celles des Grecs et des Romains, a faussé la grammaire depuis son origine jusqu’à nos jours. Mais s’il est vrai que nos langues modernes sont un héritage que nous tenons de nos ancêtre^ ' si, pour nous rendre compte, en français ou en italieir,-du ; mot le plus usuel et de la forme la plus simple, il faut monter jusqu’au latin, si le grec d’aujourd’hui est incom^ préhensible sans la lumière du grec ancien, le même pr^iK eipe conserve toute sa force pour les idiome^ de rantiquîté, et la structure du grec et du latin restera pour nous mie énigme aussi longtemps que nous voudrons l’expliquer
forme une œuvre à part : De la différence de structure des langues et do > son influence sur le développement intellectuel du genfelîuniain
par les seules informations quils nous fournissent. Gomment comprendrons-nous pourquoi l’italien dirigere fait au participe direlto, ou pourquoi le français venir fait au présent singulier je viens et au pluriel nous venons, sans le secours de la conjugaison latine et sans la connaissance des lois phoniques qui ont présidé à la décomposition du latin ? Mais sommes-nous plus en état de dire sans sortir du grec pourquoi (Soifait à l’aoriste êGcuXov, ou pourquoi eifxi fait rjv à l’imparfait? 11 sérait impossible, sans l’aide de la langue mère, d’indiquer d’une façon satisfaisante le lien de parenté qui unit le substantif français jour à la syllabe di renfermée dans lundi, mardi; mais l’affinité du grec Z sus avec son génitif fais est-elle plus apparente? Le grec et le latin, pas plus que le français ou l’italien, ne sauraient rendre compte des formes grammaticales qu’ils emploient, et, dans le plus grand nombre des cas, ils ne donnent pas la clef de leur vocabulaire| Ce serait une étrange.illusion de croire qu’un idiome entre dans l’existence en même temps qu’un certain groupe d’hommes commence à former un peuple à part. Quand Romuîus assembla ses bergers sur le mont Aven tin, les mots, l’organisme grammatical qui devaient composer le langage de ses descendants, étaient créés depuis des siècles. Pour découvrir les origines d’une langue, il ne suffit donc pas interroger les documents qui nous l’ont conservée, quelque anciens qu’ils puissent être. La question première, celle de la formation, resterait impénétrable, si la philologie comparative ne fournissait d’autres moyens d’investigation et d’analyse.
La grande expérience tentée par M. Bopp a prouvé
qu’en réunissant en un faisceau tous les idiomes de même famille, on peut les compléter l’un par l’autre et expliquer la plupart des faits que les grammaires spéciales enregistrent sans les comprendre. Il est inutile de donner ici des exemples : le livre de M. Bopp en est rempli de la première à la dernière page. Il nous montre, à travers la diversité apparente de tant d’idiomes, le développement d’un vocabulaire et d’une grammaire uniques. Ce n’est pas que chaque langue ne porte en soi un principe de rénovation qui lui permet de modifier le type héréditaire et de substituer en quelque sorte des organes nouveaux aux mots usés et aux formes grammaticales hors de service. Mais si les langues ont été justement comparées à des monuments dont on renouvelle constamment les parties vieillies, il faut ajouter que les matériaux qui servent à
'..V'V;-; ’sw'ïr'.HysS!
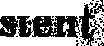
:■ .L
réparer les brèches sont tirés de l’édifice lui-même. Le verbe français a perdu les formes personnelles du passif, mais il les remplace à l’aide d’un verbe auxiliaire et d’un participe qui sont aussi anciens que le reste de la langue française. De même, en latin, le passif n’a plus de seconde personne du pluriel; mais la forme en mini qui eu lijint lieu (amamini, monemini) est un participe moyen formes grecques, comme <piÂovfjtei>o», T<fAeop,ej>oi, atte l’antiquité17.
$
.. ..... - -......
■' '‘'lïÿÿ-je! " '
iér^ërlisd
■ ■! W M ■ ■ v‘4r.,
1 <1 p
1 iÿv:v.
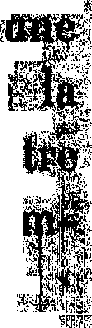
Chaque mot, chaque flexion nous ramène filiation directe jusqu’aux temps les plus langue : mais la philologie va encore plus avant eUntbïï de quelle nature sont les éléments qui Ont
poser le langage. Elle constate que les idiomes indo-européens se réduisent, en dernière analyse, à deux sortes de racines : les unes, appelées racines verbales, qui expriment une action ou une manière d’être; les autres, nommées racines pronominales, qui désignent les personnes, non d’une façon abstraite, mais avec l’idée accessoire de situation dans l’espace. C’est par la combinaison des six ou sept cents racines verbales avec un petit nombre de racines pronominales que s’est formé ce mécanisme merveilleux, qui frappe d’admiration celui qui l’examine pour la première fois, comme il confond d’étonnement celui qui en mesure la portée indéfinie après en avoir scruté les modestes commencements. L’instinct humain, avec les moyens les plus simples, a créé un instrument qui suffit depuis des siècles à tous les besoins -de la pensée. La Grammaire comparée de M. Bopp est l’histoire de la mise en œuvre des éléments primitifs qui ont servi à former la plus riche comme la plus parfaite des familles de langues.
Cependant le livre de M. Bopp n’est pas resté à l’abri de la critique. Nous avons essayé d’en exposer l’idée mère et d’én faire voir les mérites : nous croyons qu’il est aussi de notre devoir d indiquer les principaux reproches qu’on a pu adresser à l’auteur h
Une lacune qui a été signalée quelquefois, c’est l’absence de la syntaxe, c’est-à-dire de cette partie de la grammaire qui est traitée d’habitude avec le plus de dé- 18
veloppement. 11 est naturel que les règles de construction tiennent une large place dans les livres qui enseignent à parler ou à écrire une langue; mais le dessein de M. Bopp est tout autre. Il ne veut pas nous apprendre le maniement pratique des idiomes dont il nous retrace les origines, les affinités et les changements. 11 en écrit l’histoire, ou plutôt il a choisi dans cette histoire, trop étendue et trop compliquée pour les forces d’un seul homme, la phonétique et la théorie des formes, La tâche, ainsi réduite, était encore assez grande pour satisfaire l’ambition et pour suffire au travail d’une vie entière.
Mais la lacune qu’on a remarquée s’explique encore par une autre raison. La syntaxe d’une langue consiste dans l’emploi qu’elle fait de ses formes grammaticales; pour rapprocher, à cet égard, plusieurs idiomes entre eux, et pour tirer de ces rapprochements des conclusions historiques, il faut d’abord établir, d’une façon incontestable, quelles sont les formes grammaticales qui, par leur origine, se correspondent. Avant de comparer le rôle du datif grec à celui du datif latin, il est nécessaire de savoir si la comparaison porte sur deux formes congénères K La tâche la plus pressante de la philologie indoeuropéenne était donc l’étude des flexions. Entreprise trop tôt r la syntaxe comparative aurait manqué de. priïH cipes solides, sans avoir, comme les syntaxes spéciales, l’utilité pratique pour excuse2. * _
’ Voyez Grammaire comparée, $ 177.
3 Un premier essai de syntaxe comparative a été tenté par M. Albert Hojfer, dans son 'traité : De l'infinitif, particulièrement en sanscrit. Berlin,, 18/10. On trouvera deux articles de M. Schweizer, sur l’emploi de Tablatif
Dans un ordre d’idées tout différent, on a tait une autre objection à M. Bopp. On lui a reproché d attribuer au sanscrit une importance excessive, et de ramener trop souvent le reste de la famille au modèle de la langue de l’Inde. Il ne faudrait pas s’étonner si la philologie comparée, créée par des indianistes, avait d’abord traité avec prédilection l’idiome qui jetait tant de lumière sur ses frères. Mais il faut ajouter que M. Bopp, parmi ses contemporains et ses émules, est celui qui a le moins cédé à cette préférence; mieux que personne et dès ses premiers ouvrages1, il a fait voir le parti qu’on doit tirer du grec et du latin, et même de l’allemand et du slave, pour corriger et pour compléter le sanscrit, que des lois phoniques d’une extrême rigueur, ou une prononciation vicieuse ont parfois mutilé ou altéré. En isolant et en prenant à la lettre certaines phrases de M. Bopp, on pourra faire croire qu’il regarde le mot sanscrit comme le prototype des mots congénères ; mais toutes les sciences comparatives se servent d’abréviations convenues, que le lecteur n’a pas de peine à interpréter. Le sanscrit étant
et de l'instrumental, dans le Journal pour la science du langage , de M. Hœ-fer. Mais le plus grand nombre de remarques sur la syntaxe comparative se trouve dans le livre de M. Adolphe Regnier : Etudes sur l idiome des Ve-
das et les origines de la langue sanscrite, Paris, 1855.
1 * Je ne crois pas, dit M. Bopp dans les Annales de littérature orientale (i8ao), quil faille considérer comme issus du sanscrit le grec, le latin et les autres langues de l’Europe... Je suis plutôt porté b regarder tous ces idiomes sans exception comme les modifications graduelles dune seule et même langue primitive. Le sanscrit s’en est tenu plus prés que les dîalecles congénères... Mais il y a des exemples de formes grammaticales perdues en sanscrit qui se sont conservées en grec et en latin.*
l'idiome dont nous avons gardé les monuments les plus anciens et dont les formes grammaticales sont d’ordinaire les plus intactes, il est naturel qu’il serve de point de départ aux recherches ; parmi ces sœurs inégales en âge et en beauté, le chœur est mené par l’aînée et la plus belle. On ne veut pas nier d’ailleurs qu’il est quelquefois arrive à M. Bopp de mettre, d’une façon un peu imprévue et sans intermédiaires suffisants, le sanscrit en présence d un idiome qui n’y touche que de loin. Mais cette critique doit moins s’adresser à la Grammaire comparée qu aux mémoires spéciaux dont nous parlerons tout à l’heure.
Un reproche qu’on ferait peut-être avec plus de raison à M. Bopp, c’est de trop laisser ignorer à ses lecteurs combien les recherches de linguistique sont redevables aux grammairiens de l’Inde. S’il faut louer 1 illustre savant d’avoir réservé à leur égard tous les droits de la critique européenne, on peut regretter qu’il ait quelquefois relevé leurs erreurs, tandis que les hommages qui! leur rend sont muets. Ce ne fut pas un médiocre avantage de trouver une langue toute préparée d’avance pour l’étude grammaticale, par ceux mêmes qui la maniaient, et de n avoir qu’à appliquer aux idiomes de l’Occident des procédés d’analyse que la science européenne, depuis plus de deux mille ans, n’avait pas su trouver. Le classement méthodique des lettres d’après les organes de l’appareil vocal, l’observation du gouna et du vriddhi, les listes de suffixes , la distinction de la racine et du thème, ce sont là, parbcii beaucoup d’autres idées neuves et justes, des découvertes qui ont passé de plain pied de la grammaire indienne dans la grammaire comparative; mais ce que, par-dessus tout,
nous devons aux écoles de l’Inde, c’est l’idée dune grammaire expérimentale, nullement subordonnée à la rhétorique ni à la philosophie, et s’attachant à la forme avant de s’occuper de la fonction des mots. Si à une clairvoyance admirable il se mêle beaucoup de subtilité, si nous avons employé, pour un usage qu’on ne soupçonnait pas, des procédés qui avaient été inventés dans un dessein tout différent, il n’en est pas moins juste de reconnaître que le progrès accompli, depuis cinquante ans, par les études grammaticales est dû, en grande partie, a la connaissance de la méthode indienne. Comme tous les novateurs, M. Bopp a été plus frappé des défauts que des mérites d’un système qu’il a perfectionné en le simplifiant. Il faut ajouter que M. Bopp a d’abord appris à connaître les grammairiens indiens, non dans leurs livres originaux, mais par les traductions desCarey, des Wilkins, ou ils gardaient leur air étrange et leur subtilité en perdant leur brièveté et leur précision.
^ Il nous* reste, avant de quitter le grand travail de M. Bopp, à faire quelques remarques sur la composition et sur le style de cet ouvrage. La Grammaire comparée est un livre d’étude savante; quoique le langage de 1 auteur soit d’une parfaite clarté, on ne saurait le lire sans une attention soutenue. Chaque mot a besoin d etre pesé sous peine d’erreur. Supposant son lecteur non-seulement attentif, mais bien préparé, M. Bopp distribue ses développements d’une façon un peu inégale : il passe vite sur les principes généraux et il insiste sur les particularités; il dit en quelques mots qn’il adopte 1 opinion d un auteur et il s’étend sur les faits qui la limitent ou la rectifient.
Les grandes lois ne ressortent peut-être pas toujours assez au milieu des observations secondaires, et le ton uni dont M. Bopp expose ses plus belles trouvailles fait qu’on n’en aperçoit pas du premier coup toute l’importance. Le passage continuel d’un idiome à un autre est un procédé d’exposition excellent, parce qu’il nous montre comment l’auteur a poussé ses recherches et comment il a fait ses découvertes; mais il exige chez le lecteur de la suite et de la réflexion. C’est la plume à la main, en s’entourant autant qu’il est possible des livres cités par M. Bopp, qu’il faut étudier la Grammaire com/parée. Outre l’instruction, on y trouvera alors un très-sérieux attrait, en découvrant la raison et l’origine des règles que tant de générations se sont transmises sans les comprendre, et en voyant peu à peu un jour nouveau éclairer et transformer des faits que nous croyions connaître depuis l’enfance.
VI.
■ * ■ ■ % -Une fois la Grammaire comparée conduite à bonne lin,
et en attendant le dernier remaniement qu’il devait lui donner, oùM. Bopp allait-il tourner son zèle infatigable? H restait encore quelques idiomes indo-européens qu’il avait laissés en dehors de ses rapprochements, soit quedes moyens de les étudier lui eussent manqué, soit que les textes qui nous les ont conservés fussent trop récents ou trop courts. Il y consacra les mémoires que, de 1838 à i85i, il inséra dans le Recueil de l’Académie de Berlin. Mais ces essais, il faut le dire, se ressentent de l’insuffisance des documents sur lesquels ils s’appuient. N’àyant pas à sa
disposition des matériaux étendus, il est parfois obligé de recourir à des comparaisons lointaines et à des rapprochements aventurés. C’est ici que se découvrent les dangers# d’une méthode qui, pour être employée avec sûreté, suppose la connaissance complète et approfondie des idiomes auxquels elle s’applique.
Un mémoire de M. Pictet sur les langues celtiques venait d’être couronné par l’Institut de France h M. Bopp, partant de cet écrit qui s’inspirait directement de sa méthode, et s’aidant, en outre, des livres de Mac Curtin et d’O’ Reilly, essaya sur le rameau celtique l’étude qu’il avait faite sur les autres branches indo-européennes2. Cependant le celtique occupe peu de place dans la seconde édition de la Grammaire comparée : l’auteur reconnut sans doute que les matériaux dont il disposait étaient trop rares et la lumière renvoyée sur le reste de la famille trop faible et trop incertaine. II ne paraît pas avoir eu l’idée de dépouiller le grand ouvrage de M. Zeuss, qui, grâce à des moyens d’information dont avaient manqué ses prédécesseurs, a fondé enfin l’étude comparative des langues celtiques sur une base large et solide \
Un curieux problème de linguistique ramena M. Bopp vers l’extrême Orient. Dans son grand ouvrage sur la langue kawie, Guillaume de Humboldt avait exposé comment la
1 A. Pictet, De l’affinité des langues celtiques avec le sanscrit. Paris, 1837.
3 Des tangues celtiques au point de vue de la grammaire comparative. Mémoires de f Académie de Berlin, i838.
3 Zetiss, Grammatica celtica. Leipzig, 1853. — M. Schleicher, dans son excellent Gompendinm de la Grammaire comparée des langues indo-européennes, s’est servi de cet ouvrage et a régulièrement rapproché les formes celtiques des formes congénères des autres idiomes.
civilisation brahmanique se répandit de l’Inde dans les îles de la Malaisie et de la Polynésie. M. Bopp cherche à rattacher au sanscrit un certain nombre de mots des langues malayo-polynesiennes 19. Mais, si nous en croyons les spécimens qu’il nous donne, le sanscrit souffrit de singulières deformations dans la bouche de ces peuples incultes. Tout l’organisme grammatical a disparu : le vocabulaire seul a subsisté. «Ces idiomes se sont dépouillés de leur ancien vetement et en ont revêtu un autre, ou bien, comme dans les langues des îles de la mer du sud, ils se montrent à nous dans un état de nudité complète, n M. Bopp est le premier à nous avertir que des observations ainsi limitées à la partie la moins caractéristique d’un idiome, doivent être accueillies avec précaution.
Les mémoires subséquents sur le géorgien2, sur le bo-russien3 et sur l’albanais4 se ressentent plus ou moins de cette même difficulté qui résulte de la jeunesse relative et de la maigreur des documents mis à contribution. On en pourrait dire à peu près autant pour l’arménien que l’auDe la parenté des langues malayo-polynésienncs avec les langues indoeuropéennes. Mémoires de l'Académie de Berlin. i84o.
Les Membres caucasiques de la famille des langues indo-européennes. i846. — L'auteur, dans ce mémoire, traite surtout du géorgien,rdWès une grammaire de G. Bosen. ,
3 De la langue des Borussiens. Mémoires de l’Académie de Berlin. 1853..
— Le borussien ou ancien pntssien est un dialecte de la famille lithuanienne ! présentant certaines particularités qui ont disparu des autres dialectes. JL s est éteint au xvnc siècle : le seul souvenir qui nous en reste est une traduction, d’ailleurs très-fautive, du petit catéchisme de Luther.
4 De l’albanais et de sesaffinités. Mémoires de l’Académie de ferlin. i854.
— L’auteur s’est surtout servi de l’ouvrage de Hahn. — Tous ces Mémoires ont paru aussi comme brochures à part.
leur, déjà engagé dans la publication de la seconde édition de la Grammaire comparée, y fit un peu tardivement entrer en ligne. L’origine iranienne de l’arménien paraît incontestable ; mais la grammaire de cette langue a subi des modifications trop profondes, et son système phonique est encore trop peu connu pour que les rapprochements avec le zend et le sanscrit ne semblent pas quelquefois prématurés.
Tout en poussant de la sorte ses travaux de philologie comparative, M. Bopp ne négligeait aucun moyen de faciliter l’accès de la langue qui lui avait donné l’idée et la clef de ces recherches. Grammaires, vocabulaires, textes, traductions, il a tout mis en œuvre pour rendre l’étude du sanscrit plus simple et plus aiséel. Sa Grammaire sans 19
i iy i nuu (j J i u i\.
f.
critc a subi autant et plus de remaniements encore que la Grammaire comparée : après deux premiers essais, il la condensa en un petit volume qui est un modèle de sain, critique et d’exposition lumineuse. Le succès de ce livre est attesté par trois éditions que distinguent l’une de l’autre de constantes améliorations. Pour ses publications de textes.il choisit, avec un bon goût parlait, les épisodes les plus intéressants et, en même temps, les plus faciles des deux principaux poëmes épiques de l’Inde. C’est à M. Bopp que nous devons le texte et la première traduction exacte de l’histoire de Nala, devenue justement populaire en Allemagne. Nous lui devons aussi cette délicieuse idylle de Sâ-vitrî, l’un des morceaux les plus touchants qu’il y ait dans la littérature d’aucun peuple. Le Glossaire sanscrit de M. Bopp, qui contient de nombreux rapprochements lexi-cologiques, est également arrive aujourd’hui à sa troisième édition. U complète cette série de travaux que recommandent l’unité de vues, une grande clarié et l’éloignement pour l’érudition inutile.
Un mémoire de M. Bœhtlingk sur l’accentuation en sanscrit fournit à M. Bopp l’occasion de porter ses recherches sur un point encore inexploré de la philologie comparative. Il rapprocha de l’accent indien le système de 1 accentuation grecque, et montra avec quelle nierveifc leuse fidélité certaines particularités de l’intonation se sont conservées dans la déclinaison et dans la conjugaison de 1 une et 1 autre langue. Il borna d’ailleurs scs observations
jtliçaniiir et eum tmabults (né, Utttnü, gmumeù, liihumkis, ihfnmeû, eei-r
ticis comparantur, - ,
> Une-troisième édition est sous presse,
‘ ' I
au sanscrit et au grec, les analogies taisant défaut ou les renseignements étant trop rares pour les autres idiomes de la famille1. L histoire complète de l’accent tonique dans les langues indo-européennes demeure encore à l’heur qui! est une tâche réservée pour l’avenir.
e
Cependant M. Bopp amassait de nouveaux et amples matériaux pour la seconde édition de sa Grammaire com
parée. Les différentes branches de ia philologie indo-européenne avaient grandi rapidement dans l’intervalle qui sépare les deux éditions, grâce surtout aux progrès de 1 épigraphie grecque et latine et à la publication des textes védiques. Les travaux de M. Ahrens avaient montré combien la science pouvait encore récolter dans le champ des idiomes classiques, en ne se bornant pas aux formes de la langue littéraire, mais en dépouillant les dialectes et en interrogeant les inscriptions, ces fidèles témoins des variations de la langue hellénique. Depuis les premiers livres de M. Ahrens, le grand recueil de M. Bœckh n’avait pas cessé de s’accroître et de fournir à la grammaire comparative un riche butin qui est loin encore d’être épuisé2. Des publications analogues se faisaient pour les
wwporaui a accentuation (ISerlin, 1854). — Les vues de M: Bopp sur I accent ont été soumises à une critique savante par MM. H. Weil
et L. Benlœw, dans leur ouvrage intitulé : Théorie générale de l’accentmlion laltne. Paris, 1855.
1 Les beaux travaux de M. G. Curtius sur la langue grecque nous montrent la méthode comparative s’aidant de tous les secours que lui fournissent l'épigraphie et la connaissance des dialectes. Parmi les ouvrages de ce savant, dont le tact et la réserve seront particulièrement appréciés du public français, if tout citer surtout le suivant ': Principes de l’étvmologie
inscriptions de iltalie; nous avons déjà dit combien les travaux de M. Corssen, qui avaient été précédés des recherches de MM. Mommsen, Aufrecht et Kirchhoff, ont jeté de jour sur la structure de l’ancien latinl. L’histoire de la langue allemande et de ses nombreux dialectes, commencée avec tant de succès par les frères Grimm, avait donné naissance à une quantité de publications, qu’il serait impossible d’énumérer ici. En môme temps, MM. Schleicher et Miklosich soumettaient les dialectes lithuaniens et slaves à une étude rigoureuse et appro
fondie2.
De tous côtés on se partageait, pour en décrire les particularités, le vaste empire embrassé par M. Bopp. Les idiomes asiatiques n’étaient pas oubliés dans cette grande enquête. La langue des Védas, plus archaïque, plus riche en formes grammaticales, plus voisine du grec et du latin que le sanscrit de l’épopée, était mieux connue de jour en jour, et M, Bopp avait la satisfaction de voir réellement grecque (Leipzig, 1858-62). Une seconde édition de eet ouvrage vient de paraître. M. G. Gurdus a également publié une Grammaire grecque à l’usage des classes (7e édition, Prague, 1866), où il fait entrer, dans une juste mesure, les faits constatés par la nouvelle méthode. A cette grammaire est joint un volume d’Éclaircissements (Prague, i863),
1 Mommsen. Études osques (Berlin, 1845-40). — Les Dialectes de XItalie méridionale (Leipzig, i85o).
Aufrecht et Kirchhoff. Les Monuments de la langue ombrienne (Berlin , 1849-51). . .
Corssen. Prononciation, vocalisme et accentuation de la langue latine (Leipzig, 1858-69). —Études critiques sur la théorie des formes en latin (Leipzig, i863).
3 Schleicher. Grammaire lithuanienne ( Prague, i85G). ; ;
Miklosich. Grammaire comparée des langues slaves (Vienne, 1852-56).
conservées dans ces antiques documents <j.es formes qu’il avait autrefois restituées par conjecture, en s’appuyant sur le zend ou sur les langues classiques L L’explication des livres sacrés des Parses, laissée malheureusement interrompue par Eugène Burnouf, avait trouvé dans M. Spiegel un infatigable continuateur, pendant que l’ancien perse, c’est-à-dire le dialecte des inscriptions, s’enrichissait par la découverte inespérée du monument de Bisoutoun.
Une si grande abondance de matériaux devait donner la plus vive activité aux travaux de grammaire comparée. Depuis 185a, un excellent recueil, devenu bientôt trop étroit, servait d’organe à ces études et inaugurait l’ère des recherches de détail2. On y trouve, sur les sujets les
1 La première connaissance de la langue védique est due à Fr. Rosen , qui publia en 1838 le premier livre du Rik. Les quatre Védas sont entièrement édités aujourd’hui. On a publié également les plus anciens livres gram-matteaux des ïndous, et M. Bopp a encore pu mettre à profit, pour la seconde édition de sa Grammaire comparée, les belles et pénétrantes études de M. Adolphe Regnier sur le Prâtiçâkhya du Rig-véda (Études sur la grammaire védique; Paris, 1857-59). 11 a aussi eu entre les mains les premiers volumes du grand Dictionnaire sanscrit, encore inachevé, publié par l’Académie impériale de Saint-Pétersbourg, sous la direction de MM. Bœhtlingk et Roth (1852-66).
2 Nous voulons parler de la Revue de philologie comparée dirigée d’abord par MMi Aufrecht et Kuhn, puis par M. Kuhn seul (Berlin, i852-i865, 14 volumes). Depuis 1856, il se publie, en outre, un recueil dirigé par MM. Kuhn et Scbleicher, qui s’occupe plus spécialement des langues celtiques et slaves. Avant ces deux journaux, M. Hœfer avait fait paraître le Journal pour la science du langage (Berlin, i845-i853). Nous avons déjà cité le journal de M. Benfey, Orient et Occident (Goettingue, 1862-65). Il y faut encore joindre celui de MM. Lazarus et Steinthal, la Revue pour la psychologie des nations et la science du langage, qui cherche à mettre en lumière le côté philosophique de l’étude des langues (Berlin, t86o-65).
plus divers, mais surtout sur la phonétique, des travaux souvent cités par M. Bopp dans le cours de sa deuxième édition, et signés des noms de MM. Pott, Benfey, Ahrens, Kuhn, Max Millier, Aufrecht, A. Weber, G. Gurtius, Cors-sen, Schleicher, Léo Meyer1.
Entouré de ces secours, mais consultant par-dessus tout ses propres observations, M. Bopp commença en 1867 la publication de la seconde édition de sa Grammaire comparée. Elle porte à chaque page k marque du continuel travail d’amendement et de correction que M. Bopp n’a jamais cessé de faire subir à ses idées. Elle contient peu de paragraphes qui 11’aient été remaniés ou augmentés 20 21. En même temps, il y fit entrer la substance de ses plus récents écrits, en sorte qu’on peut regarder cet ouvrage comme le [dernier mot de l’auteur et comme le résumé de ses travaux.
En parcourant la liste des publications de M. Bopp, qui toutes concourent au même but, on ne peut s’empêcher d’admirer la persévérance et l’unité de ses efforts. Il a passé sa vie entière à confirmer et à développer les principes qu’il avait posés dans son premier livre : poursuivant sans relâche les mêmes études, il s’est attaché
pendant cinquante ans à eu étendre la portée, à en multiplier les applications et à en assurer les progrès dans l’avenir. Aussi son nom restera-t-il inséparable d’une science dont il est, en un sens, le plus pariait représentant : sa récompense a été de la voir grandir sous ses yeux. Peu de recherches ont pris un accroissement aussi rapide : créée il y a un demi-siècle, la philologie comparative est enseignée aujourd’hui dans tous les pays de l’Europe; elle a ses chaires, ses livres, ses journaux, ses sociétés spéciales; elle a introduit des idées nouvelles sur l’origine et le développement des idiomes, modifié profondément l’ethnographie et l’histoire, transformé les études mythologiques et éclairé d’un jour inattendu le passé de l’iiu-manité. L’auteur de ce grand mouvement scientifique est un homme modeste jusqu’à la timidité, ne parlant jamais de ses découvertes les plus importantes, mais aimant à citer quelque fait de détail, et laissant voir alors par moments, aux saillies discrètes d’un enjouement candide, la joie intime que lui causent ses travaux.
Il nous reste à dire quelques mots de la présente traduction22* Nous avons scrupuleusement respecté le texte d’un livre qui est devenu classique et dont même les points contestables ont besoin d’être conservés, car ils appartiennent à l’histoire de la science, et une quantité dautres écrits s’v réfèrent. Un examen attentif nous a d’ailleurs
montré que toutes les parties de la Grammaire comparée se tiennent d’une façon étroite : la suite de l’ouvrage révèle l’importance de telle observation dont on ne voit pas, au premier coup dœil, la valeur ou 1 opportunité. Les modifications que je me suis permises sont tout extérieures : elles ont pour objet de rendre le livre d’un usage plus commode et plus facile. Après mûre délibération, je me suis abstenu de donner des notes critiques au bas des pages1. Outre qu’il eût fallu, pour répartir ces notes d’une façon égale sur toutes les parties de la Grammaire comparée, un savoir non moins étendu que celui de l’auteur, il eût été impossible de condenser d’une façon intelligible, dans des remarques nécessairement peu développées, des observations qui,, pour être utiles, ont besoin d’être accompagnées de leurs preuves. Peut-être essayerai-je plus tard, si nul autre n’entreprend cette tâche, de donner un commentaire critique sur quelques parties de la Grammaire comparée de M. Bopp.
Les précieux encouragements qui m’ont soutenu dans mon travail me faisaient un devoir de n’y épargner aucune peine. Mes premiers remerciements sont dus au Comité des souscriptions aux publications littéraires, qui a rendu possible cette édition française, en la proposant au patronage de Son Exc. M. le comte Walewski, ministre
t Pe^ nombre de notules que j’ai ajoutées n’a d’autre objet que de fournir au lecteur quelques éclaircissements relatifs à la composition ou au texte du livre de M. Bopp. J’ai traduit en français le titre des ouvrages en langue étrangère cités par l’auteur, ne voulant pas augmenter la complication dune lecture que les rapprochements d’idiome à idiome rendent déjà assez peu aisée. Un index bibliographique sera joint aux tables alphabétiques qui termineront le dernier volume.
d'Etat. Je suis heureux de nommer ensuite M. Bopp, qui, malgré l'affaiblissement de sa vue, a demandé à relire les épreuves, et ma fourni, avec ses corrections, quelques additions utiles. J’ai trouvé, pour la révision des épreuves, un autre collaborateur dans M. Baudry, bien connu par ses études de linguistique et de mythologie. L’exécution typographique, confiée par M. Hachette à l’Imprimerie impériale, est digne de ce grand établissement. J’ai réservé pour la fin mes remerciernents à M. Adolphe Regnier, qui m’a bien voulu aider de sa haute expérience, et à mon ancien maître, M. Egger \ qui a prêté à ce travail, commencé sur son conseil, l’attention affectueuse et le concours efficace que trouvent auprès de lui toutes les entreprises utiles aux lettres.
r
Epinal, le ier novembre 1865.
Michel Bueal.
1 Le premier enseignement régulier de la grammaire comparée est du, dans notre pays, à M. Egger, qui introduisit la méthode comparative dans les leçons professées par lui à l’École normale supérieure, de 1889 à 1861. Une partie de cet enseignement se trouve résumée dans les Notions élémentaires de grammaire comparée pour servir à Vétude des trois langues classiques. Paris y 1865, 6e édition.
LANGUES INDO EUROPÉENNES.
DE
LA PREMIÈRE ÉDITION.
Je me propose de donner dans cet ouvrage une description de l’organisme des différentes langues qui sont nommées sur le titre, de comparer entre eux les faits de même nature, d’étudier les lois physiques et mécaniques23 qui régissent ces idiomes, et de rechercherTorigine des formes qui expriment les rapports grammaticaux. Il n’y a que le mystère des racines ou, en d’au
tres termes, la cause pour laquelle telle conception primitive est marquée par tel son et non par tel autre, que nous nous abstiendrons de pénétrer ; nous n’examinerons point, par exemple, pourquoi la racine / signifie « aller » et non «s’arrêter», et pourquoi le groupe phonique STHA ou ST A veut dire «s’arrêter» et
non «allerw. A la réserve de ce seul point, nous chercherons à observer le langage en quelque sorte dans son éclosion et dans son développement. Si le but que nous nous proposons est de nature à mettre en défiance certains esprits qui ne veulent pas qu’on explique ce qui, à leur gré, est inexplicable, la méthode que nous suivrons sera peut-être faite pour dissiper leurs préventions. La signification primitive et par conséquent l’origine des formes grammaticales se révèlent, la plupart du temps, d’elles-mêmes, aussitôt qu’on étend le cercle de ses recherches et qu’on rapproche les unes des autres les langues issues de la même famille, qui, malgré une séparation datant de plusieurs milliers d’années, portent encore la marque irrécusable de leur descendance commune.
Cette nouvelle manière d’envisager nos idiomes européens ne 'pouvait manquer de se produire après la découverte du sanscrit24, qui fut, dans l’ordre des études grammaticales, comme la découverte d’un nouveau monde; on reconnut, en effet, que le sanscrit se trouve, par sa structure, dans le rapport le plus intime, avec le grec, le latin, les langues germaniques, etc. et que, grâce à la comparaison de cet idiome, on était enfin sur un terrain solide, non-seulement pour expliquer les relations qui unissent entre eux les deux idiomes appelés classiques, mais encore pour marquer les rapports qu’ils ont avec le germanique , le lithuanien, le slave. Qui se serait douté, il y a un demi-siècle, que de l’extrême Orient il nous viendrait une langue qui partagerait et quelquefois surpasserait toutes les perfections dè forme qu’on était habitué à regarder comme le privilège de ia
langue hellénique, et qui serait partout en mesure de mettre fin à la rivalité des dialectes grecs, en montrant lequel d’entre eux a conservé sur chaque point la forme la plus ancienne et la
plus pure?
Les rapports de la langue ancienne de l’Inde avec ses sœurs . de l’Europe sont en partie si évidents qu’on ne peut manquer de les apercevoir à première vue; mais, d’autre part, il y en a de si secrets, de si profondément engagés dans l’organisme grammatical que, pour les découvrir, il faut considérer chacun des idiomes comparés au sanscrit et le sanscrit lui-même sous des faces nouvelles, et qu’il faut employer toute la rigueur d’une méthode scientifique pour reconnaître et montrer que tant de grammaires diverses n’en formaient qu’une seule dans le principe. Les langues sémitiques sont d’une nature moins fine; si l’on fait abstraction de leur vocabulaire et de leur syntaxe, il ne reste qu’une structure excessivement simple. Elles avaient peu de chose à perdre et conséquemment devaient transmettre à tous les âges à venir ce qui leur avait été attribué au commencement. La trilitérité des racines (§ 107), caractère qui distingue cette famille de langues, suffisait à elle seule pour faire reconnaître les individus qui en faisaient partie. Au con-trairé, le lien qui rattache entre eux les idiomes de la famille indo-européenne, shl n’est pas moins étroit, est, dans la plupart de Ses ramifications, infiniment plus ténu. Les membres de cette race avaient été richement dotés dans la première période de leur jeunesse, et ils tenaient de cette époque, avec la faculté indéfinie de composer et d’agglutiner (§ 108), tous les moyens d’exercer cette faculté. Comme ils avaient beaucoup, ils pouvaient perdre beaucoup, sans cesser pour cela de participer à la
vie grammaticale; à force de pertes, de changements, de suppressions, de transformations et de substitutions, les anciennes ressemblances %e sont presque effacées. C’est un fait que le rap-
, htâ,
port du latin avec le grec, rapport qui est pourtant le plus évident de tous, a été, sinon méconnu entièrement, du moins faussement expliqué jusqu’à nos jours, et que la langue des Romains a été traitée de langue mixte, parce qu’elle a des formes qui ne s’accordent pas bien avec celles du grec, quoi qu’en réalité le latin n’ait jamais été mêlé, sous le rapport grammatical, qu’avec lui-même ou avec des idiomes congénères, et quoique les éléments d’où proviennent les formes qui lui appartiennent en propre ne soient étrangers ni au grec ni au reste de la famille l.
La parenté étroite des langues classiques avec les idiomes germaniques a été presque complètement méconnue avant la connaissance du terme de comparaison que fournit l’idiome indien. Nous ne parlons pas ici de nombreux rapprochements faits sans principe ni critique. Et pourtant il y a plus d’un siècle et demi qu’on s’occupe du gothique, et la grammaire de cette langue, ainsi que ses relations avec les autres idiomes, sont d’une clarté parfaite. Si la grammaire comparée, avec ses procédés systématiques qui la font ressembler à une sorte d’anatomie du langage, avait existé plus tôt, il y a longtemps que les rapports intimes du gothique (et par conséquent de tous les idiomes germaniques) avec le grec et le latin auraient dû être découverts et poursuivis dans toutes les directions, en sorte qu’ils seraient connus et admis aujourd’hui de tous les s&vànts. Or, qu’v avait-il de plus important, et que pouvait-on demander de plus pressant àux philologues adonnés en Allemagne à
1 J’ai touché pour la première fois à ce sujet dans mon Système de conjugaison dé la langue sanscrite, Francfort-sur-le-Mein, 1816. Lors dri remaniement que j’ai donné de cet écrit en anglais, dans les Annales de littérature orientale t Londres ,1890, je ne.pouvais encore profiter de l’excellente Grammaire ajlepjiiîqijfe«4P® n’était pas arrivée à ma connaissance: je Savais pour lés ancienj dialectes geùna-niques que Hiekes et Fulcla. [Le premier volume de la Grànimaire dé Grimm a paru en 1819. -Tr.] ' *
l’étude des idiomes classiques, que d’expliquer les rapports existant entre ces idiomes et leur langue maternelle prise dans sa forme la plus ancienne et la plus parfaite?
( Depuis que le sanscrit est apparu à l’horizon scientifique, il ne peut, lui non plus, être exclu des études grammaticales, du moment qu’on entreprend des recherches quelque peu approfondies sur l’un des membres de cette famille de langues. Aussi les esprits les plus larges et les plus sûrs se sont-ils gardés de le négliger 25. Qu’on ne craigne pas qu’en se répandant sur une trop grande variété de langues, le savoir philologique perde en profondeur ce qu’il aura gagné en étendue ; car la variété cesse du moment qu’on la ramène à l’unité, et les fausses différences s’évanouissent avec le faux jour qui en est la cause. Quant au maniement pratique des langues, dont les philologues font ordinairement le but principal de leurs études, il est nécessaire d’établir une distinction : autre chose est d’apprendre un idiome, autre chose de l’enseigner, c’est-à-dire d’en décrire le jeu et l’organisme. Celui qui apprend une langue pourra se renfermer dans les bornes les plus étroites et limiter sa vue à l’idiome dont il s’occupe ; mais le regard de celui qui enseigne doit embrasser plus d’un ou de deux individus delà race; il doit rassembler autour de lui les témoignages de tous les membres de la famille,
pour introduire de la sorte la vie, Tordre et l'enchaînement organique dans le classement des matériaux de la langue qu’il analyse. Je crois du moins que nous devons tendre vers ce but, si nous voulons répondre à Tune des plus justes exigences de notre siècle, qui, depuis quelques années, nous a fourni les moyens d'y atteindre.
La grammaire zende ne pouvait être restituée que par le moyen (Tune analyse étymologique sévère et régulière, ramenant l'inconnu au connu, et réduisant à un petit nombre Textrême multiplicité des faits. Cette langue remarquable, qui, sur beaucoup de points, remonte plus haut que le sanscrit, le corrige et en fait mieux comprendre la théorie, paraît avoir cessé d’être intelligible pour les sectateurs de Zoroastre. Rask, qui, dans TInde, eut les moyens de s’en convaincre, dit expressément que la connaissance des écrits zoroastriens est perdue et doit être retrouvée de nouveau. Nous croyons aussi pouvoir démontrer que l’auteur du vocabulaire zend-pehlvi qui se trouve dans Anquêtil26 a fréquemment méconnu la valeur grammaticale des mots zends qu’il traduit. On y trouve les méprises les plus singulières, et si la traduction française d’Anquetil est en désaccord avec le texte zend, il faut la plupart du temps s’en prendre aux erreurs de l’interprétation pehlvie. Presque tous les cas obliques sont pris les uns après les autres pour des nominatifs; les nombres eux-mêmes sont parfois méconnus; on trouve, en outre, des formes casuelles que l’auteur de la traduction pefelvie prend , pour des personnes verbales; celles-ci à leur tour sont confondues où traduites par des noms abstraits27 28. Anquêtil ne dit rien* ; que je sache, sur l’âge dudit vocabulaire, tandis qu'il assigne pne date
de quatre siècles à un autre vocabulaire pehivi-persan. Il est donc probable que celui dont nous parlons appartient à une époque assez ancienne; en effet, le besoin d’explication a dû se faire sentir beaucoup plus tôt pour le zend que pour le pehlvi, qui est resté plus longtemps une langue courante chez les Persans. Ce fut donc pour la philologie sanscrite en Europe une tâche assez glorieuse de ramener à la lumière cette langue, sœur des,nôtres, qui était en quelque sorte enfouie dans la terre, et qui, dans l’Inde, en présence du sanscrit, avait cessé d’être comprise ; que si cette tâche n’est pas encore entièrement accomplie, elle le sera sans aucun doute. Ce que Rask, dans son écrit publié en 1826 et traduit en allemand par Von der Hagen a publié d’abord sur cette langue, doit être tenu en haute estime, en tant que premier essai. Ce pénétrant esprit, dont nous déplorons vivement la perte prématurée, a donné à la langue zende, en rectifiant la valeur des lettres, un aspect plus naturel. Il donne les paradigmes au singulier de trois mots de déclinaisons différentes, quoiqu’il soit vrai d’ajouter que ces déclinaisons offrent chez lui des lacunes d’autant plus sensibles quelles portent sur les formes les plus intéressantes, je veux dire sur celles où le zend se sépare du sanscrit. Ces formes viennent à l’appui de la thèse que soutient Rask (peut-être en la poussant trop loin) sur le développement indépendant de la langue zende. Nous ne regardons pas non plus le zend comme un simple dialecte du sanscrit, mais nous croyons qu’il est avec le sanscrit a peu près dans le même rapport que le latin avec le grec, ou le vieux-nor-rois avec le gothique. Pour le reste, je renvoie le lecteur a ma recension des écrits de Rask et de Von Bohlen (Annales de critique scientifique, décembre i83i) ainsi qu’à un autre article publié précédemment^ mars i83i) sur les beaux travaux 26 d’Eugène Burnouf dans ce champ nouvellement ouvert. Mes observations, dans ces deux articles, s’étendent déjà à toutes les parties de la grammaire zende, grâce aux textes originaux publiés par Burnouf, à Paris, et par Olshausen, à Hambourg; il ne me restait plus qu’à les confirmer par de nouvelles preuves, à les compléter, à les rectifier sur certains points, et à les coordonner de telle sorte que le lecteur pût se familiariser plus aisément, à l’aide des langues déjà connues, avec cette langue sœur nouvellement retrouvée. Pour faciliter au lecteur l’accès du zend et du sanscrit, et pour lui épargner l’étude toujours pénible et quelquefois rebutante d’écritures inconnues, j’ai toujours eu soin d’ajouter au mot écrit en caractères étrangers la transcription en caractères romains. Peut-être est-ce encore le meilleur moyen d’introduire peu à peu le lecteur dans la connaissance des écritures originales.
Les langues dont traite cet ouvrage sont étudiées pour elles-mêmes, c’est-à-dire comme objet et non comme moyen de connaissance; on essaye d’en donner la physique ou la physiologie, plutôt qu’on ne se propose d’en enseigner le maniement pratique, Aussi a-t-on pu omettre plus d’une particularité qui sert peu à caractériser l’ensemble. Grâce à ces sacrifices, il m’a été possible de gagner de la place pour étudier en détail les faits plus importants et ceux qui influent plus profondément sur la vie grammaticale. Par une méthode sévère, qui rassemble sous un seul point de vue les observations de même nature et pouvant s’éclairer réciproquement, j’ai réussi, si je ne m’abuse, à réunir dans un espace relativement restreint et à présenter dans leur ensemble les faits principaux d’idiomes aussi riches que nombreux.
J’ai accordé une attention toute particulière aufc langues germaniques : je ne pouvais guère m’en dispenser si , après le grand ouvrage de Grimm, je voulais encore enrichir et rectifier en
quelques endroits la théorie des formes grammaticales, découvrir de nouvelles relations de parenté ou définir plus exactement celles qui étaient déjà connues, et consulter sur chaque point, avec autant d’attention que possible, les autres idiomes de la famille, tant asiatiques qu’européens. En ce qui concerne la grammaire germanique, j’ai pris partout pour point de départ le gothique, que je place sur la même ligne que les langues classiques anciennes et que le lithuanien.
Dans la théorie de la déclinaison, à la fin de chaque cas, j’ai donné un tableau comparatif indiquant les résultats acquis. Tout se résume naturellement, dans ces tableaux, à séparer le plus exactement possible la désinence du thème; cette séparation ne pouvait être faite d’une manière arbitraire : en rejetant, comme cela se fait ordinairement, une partie du thème dans la flexion, on ne rend pas seulement la division inutile, mais on commet ou l’on provoque des erreurs* Là où il n’y a pas de terminaison, il ne faut pas non plus qu’il y en ait l’apparence; nous doîinohs donc, au nominatif, yèça, terra, giba, etc. comme formes dénuées de flexion (§ 137); la division gib-a ferait croire que la est la désinence, tandis que cet a est simplement l’abréviation de l’d du thème, lequel â est mis lui-même pour un ancien â (§ 69) b Dans les langues qui ne se comprennent plus elies- 29
mêmes, il est quelquefois très-difficile de trouver la vraie division et de distinguer les désinences apparentes des désinences réelles. Je n’ai jamais dissimulé ces difficultés au lecteur, mais, au contraire , je me suis attaché partout à les lui signaler.
Berlin, mars i833.
L’AUTEUR.
duisent habituellement. C’est par cette comparaison que je suis arrivé à une théorie de l’apophonie (abîaut) qui s’éloigne très-notablement de celle de Grirrim. En effet, j’explique ce phénomène par des lois mécaniques, au lieu que chez Grimm il a une signification dynamique (§S 6, 48g, 6oü ). On s’expose, ce me semble, dans beaucoup de cas, à obscurcir la question, au lieu de l’éclaircir, en comparant le vocalisme germanique au vocalisme grec et latin, sans tenir compte des renseignements fournis par le sanscrit. En effet, le gothique, dans son système de voyelles, est resté la plupart du temps plus primitif ou du moins plus conséquent que le grec et le latin. Pour ne citer qu’un exemple, le latin rend la seule voyelle indienne a par toutes les voyelles dont il dispose (septimus pour saptamas, quatuor pour catvâr-as, téacap-Il est vrai qu’on peut entrevoir les lois qui président à ces variations.
DE
LA DEUXIÈME ÉDITION.
Aux langues dont il a été traité dans la première édition est venu maintenant se joindre l’arménien : toutefois, ce n est qu au moment où j’étudiai l’ablatif singulier, dont la forme arménienne avait déjà été rapprochée de la forme zen de dans la première édition (p. 1272), que je me décidai à approfondir l’organisme entier de cette langue et à mettre en lumière les rapports, quelquefois très-cachés, et en partie encore inconnus, qui lu-nissent au sanscrit , au zend et aux idiomes congénères de l’Europe. Le point de départ de mes nouvelles recherches sur l’arménien a été la dernière lettre de notre alphabet, à savoir le z, dont le son est marqué dans l’écriture arménienne par la lettre g (= ts") et que je transcris par i (§ i83b s) pour éviter toute confusion aŸec le z français. Déjà le <£ grec (= &) avait été reconnu comme étant une altération du ^y sanscrit (S 19), dont le son équivaut à celui du j allemand. Nous ne parlons pas des cas où le £ est une transposition pour comme dans AOrfvals. J’étais donc naturellement amené à me demander si, parmi les diverses lettres arméniennes qui se prononcent comme une dentale suivie d une sifflante, il n’y en avait pas quelqu’une qui fût, soit partout, soit seulement dans certaines formes, l’ai» tération de la semi-voyelle j; et si, de cette manière, plusieurs
points restés obscurs dans la structure de la langue arménienne ne pouvaient pas recevoir une solution. Or, en examinant cette question, j’ai reconnu que le g z. qui joue un grand rôle dans la grammaire arménienne, est, toutes les fois qu’il fait partie d’une flexion ou qu’il constitue à lui seul la flexion, dérivé d’un J^y sanscrit, c’est-à-dire du son qui est représenté en latin et en allemand par le y, en anglais par le y. Entre autres conséquences résultant de ce fait, j’ai constaté que le futur arménien répond, quant à sa formation, au précatif sanscrit, c’est-à-dire à l’optatif de l’aorist grec, de la même façon que le futur latin des deux dernières conjugaisons est identique, comme on l’a fait observer depuis longtemps1, au potentiel sanscrit, c’est-à-dire au présent de l’optatif grec et du subjonctif germanique. Nous avons donc d’un côté, en latin, des formes comme ferês, feret, qui répondent au grec Çépots, (p/pot, au gothique bairai-s, haïrai, au vieux haut-allemand bërê-s, bëre, au sanscrit bdrê-s, Mrê-t; d’autre part, nous avons en arménien des formes comme ta-ze-s, ta-zê «dabis, dabit», venant de ta-ye-s, ta-yê, qui répondent au sanscrit dê-ya-sf dè-ya-t (venant de dâ-ya-s, dâ-ya-t) et au grec Sofas, $o(ij9 venant de So-jn-s, So-jy (§ i83b 2). Le présent du subjonctif arménien se rapporte au présent de l’optatif grec, c’est-à-dire au potentiel sanscrit, avec le même changement du ^ y sanscrit, ou de 1’* grec en g z; toutefois, je ne peux reconnaître à l’arménien qu’un seul subjonctif simple, à savoir celui du verbe substantif, avec lequel se combinent les verbes attributifs.
Dans la formation des cas, g z, comme désinence du datif-ablatif-génitif pluriel, répond au de la désinence sanscrite byas (§ 215, 2), et, au contraire, le qui est en quelque sorte la moyenne de g z, répond, dans le datif singulier m-£
1 Voyez mon Système de conjugaison de la langue sanscrite, Francfort-sur-lê-Mcin, 1816* p. 98..
«à moi», au y de la désinence sanscritekyam (S si5. 1), En général, dans l’examen du système de déclinaison arménienne me suis surtout attaché, comme je l’avais fait auparavant pour le gothique, le lithuanien et le slave, à bien déterminer les vraies finales des thèmes, surtout dans les mots où le thème finit par une voyelle. Le résultat le plus important de cette recherche a été celui-ci : c’est que Va sanscrit, à la fin des thèmes masculins, a revêtu en arménien une triple forme, en sorte qu’il a donné lieu à trois déclinaisons différentes, savoir les déclinaisons en a, en o et en u (i83b i); la première est presque la déclinaison gothique (mlf-s venant de vuÿas)-, la seconde correspond à la déclinaison grecque, latine et slave*, la troisième rappelle la relation qui existe entre les datifs pluriels, comme wolfu-m en vieux haut-allemand, et le même cas en gothique , comme mlfa-m. L’arménien a, par exemple , des datifs pluriels comme waram-i; le thème de ce mot est, selon moi, warasu « sanglier », et dans le #«- ul qui termine le theme, je reconnais un affaiblissement de Y a final du mot congénère sanscrit varâhâ (S 2 5 5). Si l’on détermine de la sorte le vrai thème des mots arméniens, en y comprenant les thèmes en i ■ {§ i83a A), on donne une hase plus solide et un plus grand in~ térêt aux comparaisons qui ont été faites jusqu’à présent entre l’arménien et le sanscrit ou d’autres langues mdo-europeennes : en effet, les ressemblances ressortent d’une façon plus précise du moment que la lettre finale du thème a été fidèlement conservée ou n’a été que légèrement altérée. Si l’on veut comparer, par exemple, l’arménien tnmui tap «chaleur», dont le thème est
1 11 faut se garder de prendre ie m- « arménien pour une voyelle longue : c est une erreur à laquelle le signe employé pour cette lettre dans l’écriture pourrait (lonner lieu. Cet « est bref, ainsi que l’admet également Petermann (Gramm. p. 39), et il répond, là où il n’est pas un affaiblissement de IV, à un u sanscrit, comme ihmdmtr (norainatif-accusatif-vocatif) =- sanscrit duhitâr (thème), ancien slave
dMUr (thème, $>9,65).
tapo, avec un mot sanscrit, on aimera mieux ie rapprocher du thème tâpa «chaleur» que de la racine lap «brûler», qui a formé ce dernier substantif; au thème sanscrit sàvaka «pullus, catulus» (racine svi «croître», par contraction su), on comparera plutôt le thème arménien ?avaka «enfant», que le nominatif
mutilé savak30 ; à *rff dhi «serpent» (grec ïyj), plutôt le thème arménien olf, éÇi que le nominatif-accusatif âl, qui est avec son thème dans le même rapport qu’en vieux haut-allemand le nominatif-accusatif gnst avec son thème gasti.
En ce qui concerne le caractère général de 1 arménien, on peut dire que l’arménien ancien ou savant appartient aux idiomes les plus parfaitement conservés de notre grande famille. Il est vrai qu’il a perdu la faculté de distinguer les genres et qu’il traite tous les mots comme des masculins (§ i83b 1); il a aussi laissé s’oblitérer le duel, qui est encore en plein usage aujourd’hui dans le slovène et le bohémien : mais la déclinaison des substantifs et des adjectifs se fait encore tout entière d’après l’ancien principe; il a au singulier autant de cas que le latin, sans compterles formes périphrastiques, et au pluriel il ne manque qu’une forme spéciale pour le génitif, qui est remplacé par le datif-ablatif dans la plupart des classes de mots. Dans la conjugaison, l'arménien rivalise encore plus avantageusement avec le latin que dans la flexion nominale : il désigne lés personnes par les désinences primitives; il a notamment conservé partout au présent le m de la première personne ,-qui subsiste encore aujourd’hui dans la langue vulgaire; sous ce rapport, l’arménien ressemble au slovène et au serbe, et, parmi les langues celtiques, à l’irlandais. Au contraire, à la troisième personne du pluriel, il
a perdu, comme le haut-allemand moderne, le signe de la personne ($), qui suit celui de la pluralité («); il fait donc beren rils portent?), qu’on peut comparer au sanscrit Bâranti, au do-rien fâpovTi, au latin ferunt, au gothique bairand, au vieux haut-allemand berant, au moyen haut-allemand bërent, au haut-allemand moderne bàren (dans gebâren). Pour les temps, l’arménien peut soutenir la comparaison avec le latin, car il a, outre les temps périphrastiques, le parfait, le plus-que-parfait, deux prétérits et, comme on l’a dit plus haut, un futur d’origine modale. Les prétérits sont l’imparfait et l’aoriste : à l’imparfait, les verhes attributifs prennent, comme en latin, un verbe auxiliaire qui vient s’annexer au thème ; l’aoriste se rapporte, comme le parfait latin, au prétérit multiforme sanscrit, c’est-à-dire qu’il correspond, quant à la forme, à l’aoriste grec (S io%h 2).
Gomme l’arménien fait partie du rameau iranien de notre famille de langues, ce fut pour moi une observation importante de constater que, comme fossé te, il se réfère, pour plus d’une particularité phonique ou grammaticale, à un état de la langue plus ancien que celui que nous offrent la langue des Achémé-nides et le zend (§ 216). Le premier de ces deux idiomes n’avait pas encore été ramené à la lumière au moment où je commençai la première édition de cet ouvrage : les proclamations de Darius, fils d’Hvstaspe, sont redevenues intelligibles, grâce surtout aux magnifiques travaux de Rawlinson. L’idiome où elles sont conçues a sur le zend cet avantage que des monuments irrécusables en attestent l’existence et en déterminent la patrie et l’ancienneté : personne ne peut douter que cette langue n’ait été réellement parlée à peu près dans la forme où elle est écrite sur ces monuments. Au contraire, pour établir l’authenticité du zend, nous n’avons, pour ainsi parler, que des raisons intrinsèques, c’est-à-dire que nous rencontrons en zend des formes qui ne sauraient avoir été inventées, et qui sont bien celles que récla-
mait théoriquement la grammaire comparée de la lamille entière. Il serait, en effet, difficile de croire qu’une forme d’ablatif qui s’est, pour ainsi dire, éteinte en sanscrit (8 102), ail pu être ravivée en zend par un travail artificiel, de manière à figurer presque à nos yeux l’ablatif osque ou l’ablatif archaïque de la langue latine. Aux impératifs sanscrits en hi ne répondraient pas en zend des formes en ii ou en di, plus anciennes et plus en harmonie avec les formes grecques en S-f. Les formes moyennes en maid'ê ne s’expliqueraient pas davantage dans cette hypothèse, car le iï, comme le prouve le grec f*e0a, est plus ancien que le h
de la terminaison sanscrite en mahê.
Il est remarquable que les langues iraniennes, y compris l’arménien, aient éprouvé un certain nombre d’altérations phoniques qui se rencontrent également dans les langues iettes et slaves (§ 88). Je mentionnerai seulement ici l’accord surprenant du zend asëm ^je» et de l’arménien es avec le lithuanien as, le vieux slave asü, pendant qu’en sanscrit nous avons ahâm (= agam, § 93), en grec et en latin èyé, ego, en gothique ik. Mais il ne faut pas se fonder sur ces rencontres pour supposer que les langues Iettes et slaves tiennent de plus près au rameau iranien qu’au rameau proprement indien : ces ressemblances viennent simplement de la tendance inhérente aux gutturales de toutes les langues à s’affaiblir en sifflantes. Le hasard a pu faire aisément que deux idiomes ou deux groupes d’idiomes se rencontrassent sous ce rapport et fissent subir a
un seul et même mot la même modification. Il en est autrement des altérations phoniques qui sont communes au sanscrit et aux langues iraniennes, telles que le changement d’un k primitif en un s' palatal , changement que présentent également les langues Iettes et slaves dans la plupart des mots susceptibles d’être comparés : j’ai inféré de ce fait, ainsi que d’un certain nombre d’autres altérations grammaticales, qui se présentent simultané-
ment dans les langues indo-iraniennes elles langues letto-slaves, que ces derniers idiomes se sont séparés de la souche asiatique a une époque plus récente que tous les autres membres européens de notre grande famille1. Je ne puis, par conséquent (abstraction faite des mots empruntés), admettre de relation spéciale de parenté entre les langues germaniques, d’une part, et les langues letto-slaves de l’autre; en d’autres termes, je ne puis leur reconnaître que cette identité qui provient d une parenté commune avec les langues sœurs de l’Asie2. J’accorde que, par leur structure, les langues germaniques se rapprochent plus des langues letto-slaves que des langues classiques, et, à plus forte raison, que des langues celtiques : mais cependant, en examinant le gothique, le membre le plus ancien et le plus fidèlement conservé du groupe germanique, je n’y vois rien qui puisse obliger à le mettre avec les langues letto-slaves en une relation de parenté spéciale et, pour ainsi parler, européenne. Ce serait attacher une trop grande importance a cette circonstance, que les datifs pluriels gothiques, comme mnu-m «fdüs», ressemblent plus aux datifs lithuaniens, comme sünù-mus (ancienne forme), et à l’ancien slave süno-mü, qu’aux datifs latins, comme portvr-bus. Mais le passage d’une moyenne à une nasale du même organe est si facile que deux langues ont bien Pu rencontrer fortuitement, sous ce rapport, dans un cas particulier. Cette rencontre est moins surprenante que celle qui fait que le latin et le zend sont arrivés à un même adverbe numéral bis «deux fois» et à une même expression bi (au commencement des composés) pour désigner le nombre deux : il a fallu que des
1 Voyez SS ai*, i&5, *n, sift et *65, et comparez Kuhn dans les Études indiennes de Weber, I, p. 3a4.
2 K’opinion contraire est soutenue par J. Grimm (Histoire de la langue allemande, i848, p. io3o) et'par Schleicher (Sur les formes du slave ecclésiastique, p. to et suiv,). Voyez aussi un article de Schleicher dans le recueil publié par Kuhn et Schleicher (Mémoires de philologie comparée), l, p. 11, as.
deux parts, mais d’une façon indépendante, le d du sanscrit dvis, dvi fût sacrifié, et que, par compensation, le v s’endurcît en b, au lieu que le grec, dont le latin est pourtant bien plus près que du zend, a simplement changé dm, dvi en Sts, St.
Dans la plupart des cas où il y a une ressemblance bien frappante entre les langues germaniques et les langues letto-slaves et où elles paraissent s’écarter du grec et du latin, le sanscrit et le zend viennent s’interposer pour former la transition. Si j’ai raison de considérer l’impératif slave comme étant originairement identique avec le subjonctif germanique et le potentiel sanscrit, il n’y a certes pas de concordance plus frappante que celle qui existe entre les formes slovènes, comme dêlaj-va «nous devons travailler tous deux», et les formes gothiques comme bairai-va,
« que nous portions tous deux », quoique les deux verbes en question n’appartiennent pas, dans les deux langues, à la même classe de conjugaison. La forme gothique répond a la forme sanscrite Mrê-va (même sens), venant de iïarai-va (S 2, note), et à la forme zende baraiva (§ 33). Pour citer aussi
un cas remarquable tiré du système de déclinaison, les génitifs gothiques comme sunau-s (thème sunu) sont, en ce qui concerne la flexion, complètement identiques avec les génitifs lithuaniens, tels que sünaé-s (même sens); mais les génitifs sanscrits comme sûno-s (contraction pour sûnau-s, § 2) forment encore ici la transition entre les deux langues sœurs de l’Europe et nous dispensent d’admettre qu’une parenté toute spéciale les relie entre elles.
Pour la première édition de cet ouvrage je n’avais guère a ma disposition, en ce qui concerne l’ancien-slave, que la grammaire de Dobrowsky, où l’on trouve beaucoup de formes appartenant au russe plutôt qu a l’ancien-sîave. Gomme le % (S 92c) n’a pas de valeur phonétique en russe, Dobrowsky l’omet tout à fait dans les nombreuses terminaisons où il paraît en ancien-
slave : il donne, par exemple, rai comme modèle du nominatif-accusatif singulier d’une classe de mots que déjà, dans la première édition (S 267), j’ai rapprochée des thèmes masculins terminés en sanscrit par et de la première déclinaison masculine (forme forte) de Grimm; cette dernière déclinaison a perdu également au nominatif-accusatif singulier la voyelle finale du thème, et à l’accusatif elle a perdu en outre le signe casuel. (En haut-allemand moderne le signe casuel manque aussi au nominatif.) La forme rab, «servus, servum», si c’était là la vraie prononciation de pdES, serait aussi a comparer à 1 arménien, qui supprime au nominatif-accusatif singulier la finale de tous les thèmes terminés par une voyelle. Dobrowsky supprime également le b ï final partout ou il a disparu en russe dans la prononciation, mais où il est remplacé graphiquement par le t» , lettre aphone en russe, Il donne par conséquent a la troisième personne du singulier du présent la desinence t au lieu du russe imb " t, et il n attribue la terminaison tl ti qu’au petit nombre de verbes qui, à la première personne, ont la désinence mu tnï. Les inexactitudes et les altérations graphiques de ce genre ont eu d’ailleurs peu d influence sur notre analyse comparative; en effet, même dans des formes comme nov (au lieu de novü) ^novus, novum», on ne pouvait méconnaître la parenté avec le grec véos, véov, le latin noms, novu-m, (= sanscrit nâva-s, nâvà-tn), du moment quon avait reconnu novo comme le vrai thème du mot en question, et qu’on avait constaté la nécessité de la suppression des flexions casuelles commençant pat* des consonnes. Les formes comme E€3CT rvehit» (d’après l’orthographe de Dobrowsky) pouvaient être rapprochées des formes sanscrites tout aussi bien que
les formes, en tu tï. Mais tant qu’on disait avec Dobrowsky veset, et à la première personne du pluriel vesem, à l’aoriste vesochy vesochom (au lieu de vesochü, vesochomü), il fallait en-
tendre ia loi mentionnée au § 99 in comme elle est appliquée dans les langues slaves vivantes : à savoir, que les consonnes finales primitives ont dû tomber, et que les consonnes qui se trouvent aujourd’hui à la fin d’un mot ont dû toutes être primitivement suivies d’une voyelle 1. Cette loi ne m’a pas été sans secours pour les idiomes germaniques; j’ai été amené à examiner s’il n’y avait pas une loi générale qui expliquât pourquoi beaucoup de formes gothiques se terminent par une voyelle, tandis que, dans les langues congénères le plus fidèlement conservées, les mêmes mots finissent par une consonne. J’ai recherché, en outre, si les dentales qui se trouvent à la fin de tant de terminaisons germaniques n’étaient pas primitivement suivies d’une voyelle. Ma conjecture s’est vérifiée à cet égard, et j’ai déjà pu consigner dans la première édition (i835, p. 399) la loi de la suppression des dentales finales31 32.
Je donne le nom « d’indo-européenne » à la famille de langues dont le présent livre rassemble en un corps les membres les plus importants; en effet, à l’exception du rameau finnois, ainsi que du basque, qu’on ne peut rattacher à rien, et de l’idiome sémitique laissé par les Arabes dans Me de Malte, toutes les langues de l’Europe appartiennent à cette famille. Je ne puis approuver l’expression ce indo-germanique», ne voyant pas pourquoi l’on prendrait les Germains pour les représentants de tous les peuples de notre continent, quand il s’agit de désigner une famille aussi vaste, et que le nom doit s’appliquer également au passé et au présent de la race. Je préférerais l’expression «indo-classique», parce que le grec et le latin, surtout le premier, ont conservé le type originel de la famille mieux que tout autre idiome européen. C’est pour cela, sans doute, que G. de Hum-boldt évite la dénomination «d’indo-germanique», dont il aurait trouvé l’emploi dans son grand ouvrage sur la langue kawie, surtout dans la préface, qui est consacrée aux langues de tout le globe. II appelle notre souche «la souche sanscrite», et ce terme convient d’autant mieux qu’il n’implique aucune idée de nationalité, mais qu’il relève une qualité à laquelle ont plus ou moins de part tous les membres de la famille de langues la plus parfaite ; aussi ce terme, qui a d’ailleurs l’avantage d’être plus court, pourrait-il être adopté dans la suite de préférence à tous les autres. Quant à présent, pour être plus généralement compris, je me servirai du nom «d’indo-européen», qui a déjà reçu une certaine consécration de l’usage en France et en Angleterre.
Berlin, août 1857.
L’AUTEUR.
rappelle à ce propos la double forme qu'ont prise en gothique les ueulres pronominaux qui en sanscrit sont terminés par un t ; ou bien la dentale finale a été supprimée suivant la loi en question, ou bien on y a ajouté, pour la conserver, un a inorganique (S 93*"),
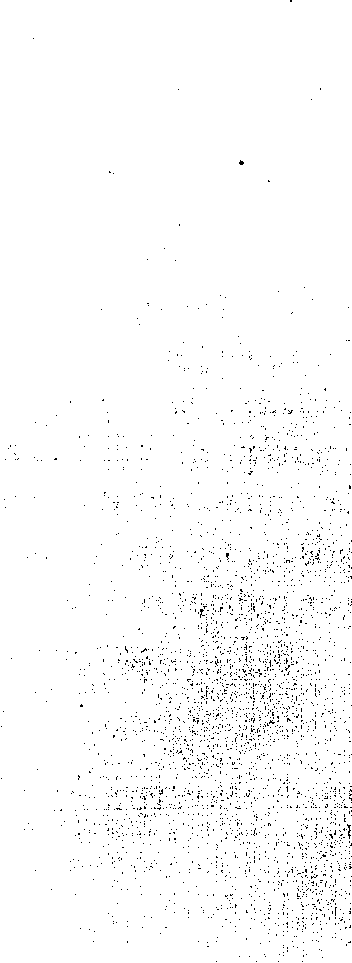
DES
LANGUES INDO-EUROPÉENNES.
SYSTÈME PHONIQUE ET GRAPHIQUE.
ALPHABET SANSCRIT.
S j . Les voyelles simples en sanscrit. — Origine des voyelles r et /1.
Les voyelles simples en sanscrit sont : i° Les trois voyelles primitives, communes à toutes les langues, ^ ^ h ^ u> ^t les longues correspondantes, que je
marque dans la transcription latine d’un accent circonflexe.
a° Les voyelles propres au sanscrit r (.^g) et / (^), aux^-quelles les grammairiens indiens adjoignent également des longues, bien qu’il soit impossible, dans la prononciation, de distinguer la voyelle jongue de la consonne r jointe à un t, et que la voyelle longue ^ l ne se rencontre nulle part dans la langue, mais seulement dans les mots techniques'à fusage des grammairiens, ^//également très^rare, ne se trouve que dans la seüle racine kalp, quand, par la suppréssion de la, elle se contracte en klp, notamment dans le participe passif Mptdr-s fait v, et dans le terme abstrait Mpti-s. Les
/• avoir.énuméré les voyelles sanscrites, passe immédiatement à
l’exaraen de celleH qui dirent le plus d’intérât a cause de leur nature et de leur origine exceptionnelles, à savoir r et l. Mais il reviendra sur les autres voyelles dans les paragraphe^ suivants. Tr.
grammairiens indiens prennent néanmoins klp pour la vraie forme radicale et kalp pour la racine élargie à Taide du gouna ; nous reviendrons sur ce point. Ils font de meme pour les racines où ar alterne avec r, et ils donnent la forme mutilée comme étant la forme primitive, tandis que arest, selon eux, la forme renforcée.
Je regarde, au contraire, ^r, qui a le son d’un r suivi d’un i presque imperceptible à l’oreille1, comme étant toujours le résultat de la suppression d’une voyelle, soit avant, soit après la consonne r. Nous voyons dans la plupart des cas, par la comparaison avec les langues congénères de l’Europe et de l’Asie, que r est une corruption de ar; il correspond en grec h ep, op, ap (§ 3), et en latin à des formes analogues. Comparez, par exemple, (pepTO-s, conservé seulement dans ottyepTos, avec ÏÏrtd-s «porté5); <5ep*:vo-s, conservé dans aSspxTOs, avec drslâ-s pour darktd-s «vu»; erlôp-vü-pit avec str-nâ-mi «j’étends»; jSporés pour pporos, venant de txop?6?i avec mrtd-s « mort » ; âpXTOS avec rksd-s «ours»; ifrrap pour YjTtapT avec yakrt «foie», latin jecur; vtenpdsn, métathèse pour -araTdpat, avec pitf-su (locatif pluriel du thème pitdr); fer-tis avec biBrtd «vous portez»; sterno avec strnô-mi «j’étends»; vermis (venant de çaartfMs), avec hrmi-s «ver»; cord avec hrd «cœur»; mor-tuus avec mr-td-s «mort»; mordeo avec mrd «écraser». Je ne connais pas en latin d’exemple certain de ar tenant la place d’un f ; : peutrêtre ars; thème art,, est-il pour carti-s, et répond-il au sanscrit kf-ti-s «action» (cf. krtrima-s «artificiel»). Avec métathèseet allongement de la, nous avons strâ-tus pour star-tusy qu’onpeutcom-parer au sanscrit sir-tà-s «épars», et au zond starëta starëta, qu’on écrit apssi fra-stërëUi). , ; :;i&î
L’exemple que nous verîons de citer nous amè^ â rémat-
1 A peu près comme dans l’anglais menïly. Le l voyelle est à-la cousoïineî ce. que r est à ( Voyes mon Système comparatif d’accentuation, note 3.) . >
quer que le r voyelle est étranger également au zend. On prouve l’ordinaire à sa place {1{, qu’il ne faut pas, comme l’admet Burnouf », faire dériver du sanscrit r, mais de ar, par l’affaiblissement de l’a en t et l’addition d’un t après le r. Le zend, en effet, ne souffre pas que r soit suivi d’aucune consonne, excepté de s, à moins que devant le r ne se trouve inséré un h; ainsi vfka pour vdrka «loup», se trouve en zend sous les formes vëhrka (quelquefois mhrka) et vërëka. Dans les cas où le r zend est suivi d’un ^ s, l’a s’est conservé, apparemment par le secours que lui a prêté le groupe de trois consonnes qui le suivait; exemple : learsta «labouré», lcarsti«le labourage», parsta «interrogé», formes qu’on peut comparer au sanscrit krstâ, krstl,prsta.
Le r voyelle est également inconnu à l’ancien perse, qui a, par exemple, karta «fait», au lieu du sanscrit krta, barta (parâ-barta) pour WT M. Si, dans les formes comme akunam «il fit», un « prend la place du r sanscrit (védique dkrrnl), je considère cet u comme un affaiblissement de l’« primitif (S 7 ), comme cela se voit dans le sanscrit kur-mh «nous faisons», opposé au singulier karô'mi. Dans l’exemple en question, le r a disparu dans l’ancien perse; pareille chose arrive fréquemment dans le pâli et le prâcrit, qui ne possèdent pas non plus le r voyelle et qui, sous ce rapport, se réfèrent à un état de la langue plus ancien que ne sont le sanscrit classique et le dialecte des Védas. le ne voudrais pas du moins reconnaître avec Burnouf et Las-sen2 dans l’a du pâli km le r du sanscrit krsi «le labourage», ou dans l’« de sunôtu «qu’il écoute», le m r de fpo'to;
je n’hésite pas à expliquer kasi par une forme kdrsi, qui a du exister anciennement en sanscrit, et myêtu par hrnthu, comme la racine éru devait faire régulièrement à la 3» personne de 1 im-
■ Voir, dansle Journal dos Savante, i833, la recension de la première édition de cet.ouvrage, et l'nfna, notesp, 5o, 61,07- Voir aussi mon Vocalisme, p. i57-i93.
s h nâli. O. 82 Sttiv.
pératif. Vu de utu « saison » est pour moi un affaiblissement de l’a de artû, forme qui a dû précéder rti, et l’« de tina «herbe» (sanscrit trnd) est l’affaiblissement de l’u de la forme primitive tarnâ; nous avons en gothique le même mot avec l’affaiblissement de l’a du milieu et de celui de la fin en u : thaurnus, par euphonie pour thumus (S 8a); le sens du mot a légèrement varié dans les langues germaniques, ou il signifie «épine» (en allemand dom). Ce que tina est a tarna, le pra-crit hidaya l’est à hdrdaya, forme qui a dû précéder le sanscrit hriaya, et qui est identique, abstraction faite du genre du mot, au grec xapSla. Quelquefois le prâcrit a la syllabe ft rt, au heu du va _r sanscrit (voyez Vararuci, éd. Cowell, p. 6); exemple . frri jinan pour le sanscrit rwd si de ■
en prâcrit le remplaçant constant ou seulement habituel du sanscrit r, on pourrait admettre que l’t, imperceptible à l’oreille, contenu dans la voyelle r, est devenu plus sonore33. Mais comme il n’en est pas ainsi, et que, au contraire, ri est presque le remplaçant le plus rare du sanscrit r, j’admets que l’t de fl?! rinah n’est pas autre chose qu’un affaiblissement de T « de arnâ-m, qui a dû être la forme primitive de ynd-m. On trouve même en sanscrit des exemples de ar changé en ri, entre autres au passif, dans les racines en ar qui permettent la contraction de cette syllabe en r ; exemple : kriyatê «il est
fait», de la racine kar, kr. La forme primitive ar reste, au contraire, intacte <|uand elle est protégée par deux consonnes, exemple :'smuryâtê de sîtiav, smr «se souvenir». . ?
Si nous passons maintenant à des modes de formation plus ra^s, nous trouverons que le r sanscrit provient d’une corrup-
lion de la syllabe âr à certains cas (nous dirons pius tard lesquels) des noms d’agents en (âr, comme dâtar « celui qui donne », ou des noms marquant la parenté, comme nâptâr «neveu», svâsâr «sœur»; delà dâ(r-Byas, svâsr-Byascorrespondant au latin dator-i-bus, sorôr-i-bus. Au locatif, nous avons des formes comme dâtfsu, en grec au datif Soryp-tn, 11 y a aussi une racine verbale qui change âr en r de la même façon que beaucoup d’autres changent ar en r : je veux parler de la racine mârg, dont la forme affaiblie est mrg; ce verbe fait au pluriel mrg-mds «nous séchons», tandis qu’au singulier il fait mârg-mi, delà même manière tqu’on a au pluriel biBr-mds «nous portons», et au singulier biBâr-mi «je porte». Les grammairiens indiens regardent mrg comme la racine.
On trouve aussi r pour ra, par exemple dans certaines formes du verbe prac, comme prcâti « il interroge », prstâ-s « interrogé ». Cette racine prac, qui est également admise comme la forme primitive par les grammairiens indiens, est de la même famille que la racine gothique frah ( présent fraihna, par euphonie pour fnhna, prétérit frah). La contraction de ra en r est analogue à celle des syllabes ya et va en i et en u, laquelle a lieu assez fréquemment dans la grammaire sanscrite; ces sortes de mutila-* lions se présentent seulement dans les formes grammaticales où, d’après les habitudes générales de la langue* la forme faible est substituée à la forme forte, par exemple dans les participes passifs comme «sacrifié», uktâ-s « parlé », prstd-s « interrogé », par opposition à ydstum, vâktum, prdétim. Comme exemple de r mis pour ra, je mentionne encore l’adjectif prtü-s «large», pour praiû-ù ( racine praî « être étendu»), qui correspond au grec ts'Aa-td-ÿj au lithuanien platu-s, à l’ancien perse frâtu,%dans^îe composé u-frâtu (pour hu-Jrâtu) «Euphrate», proprement «le très-large». Nous n’avons de ce mot que le locatif féminin ufrâtavâ , où le t (un exigé par Yu au nominatif, est changé en t
h cause de Va qui le suit. Le zenà perdu, de pardu pour pariu, contient une transposition, ce qui n’a rien de surprenant, aucune lettre ne changeant aussi aisément de place que r. Ainsi en latin nous avons tertius pour tri-tius (§ 6), en zend tri-tya; au contraire, le sanscrit contracte dans ce seul mot la syllabe ri en r, et donne tr-$y a-s, nombre ordinal formé de tri r trois».
Le r est pour ru au présent et dans les formes analogues au présent dé la racine sru « entendre» (voyez plus haut, p. 2 5); nous avons, par exemple, sr-nô-ti «il entend», sr-no-tu «quil entende»; en outre, dans le composé Brkuti-s ou Brhutî, pour
"N
Brukuti-s, Brukutî, qui sont également usités et où l’w dç la pre mière syllabe tient la place de Vu long de Bru «sourcil», c f ^
§ 2. Diphtbongues sanscrites.
Il y a en sanscrit deux classes de diphtbongues : la première, qui comprend ê et à, provient de la fusion d’un a bref avec un i ou un î conséquent, ou d’un a bref avec un u ou un 4conséquent. Dans cette combinaison, on n’entend ni l’un ni 1 autre des deux éléments réunis, mais un son nouveau qui est le résultat de leur union : les diphtbongues françaises ai, au sont un exemple d’une fusion de ce genre.
L’autre classe, qui comprend TÎ âi (prononcez ai) et ^ au (prononcez âou'j, provient de la combinaison d-.un a long avec un i ou un î conséquent, ou d’un « long avec un u bu un u conséquent. Dans cette combinaison les deux voyelles réunies en diphthongue, et particulièrement la, sont perceptibles à l’oreille, il est certain que dans T* é et ^ ô il y a un a bref, dans Tt et un â long ; car toutes les fois que, pour éviter 1 hiatus, le demiei élément d’une diphthongue se change en la semi-voyelle correspondante, et 6 deviennentay et^pj[^av, tandis que âi et au deviennent Wftj^ây et Si, d.après les
règles de contraction, un o final devient ê en se combinant avec
un i ou un î initial, et s'il devient â en se combinant avec un u ou un û initial, au lieu de devenir ai et âu, cela tient, selon moi, à ce que ïâ long s’abrége avant de se joindre à la voyelle qui se trouve en tête du mot suivant. On ne s’en étonnera pas en voyant que Yâ est supprimé tout à fait quand, dans l’intérieur d’un mot, il se trouve devant une flexion ou un suffixe commençant par une voyelle dissemblable; exemple : dddâ devant us ne devient ni '^t^dadâus, ni ^^t^dadâs, mais dadm «dederunt». Cette opinion , que j’avais déjà exprimée ailleurs34, s’est trouvée confirmée depuis par le zend, où le sanscrit est représenté par au ai, et le ’Wt par p» âo ou >m âu.
Remarque. Je ne crois pas que la diphthongue exprimée en sanscrit par ^ et prononcée êaujourd’hui, ait déjà eu avant la séparation des idiomes une prononciation qui ne laissait entendre nilTî ni 17; il est, au contraire, très-probable qu’on entendait les deux éléments de la diphthongue, et qu’on prononçait aï, lequel aï se distinguait sans doute de la diphthongue ^ âï, en ce que le son a n était pas prononcé d’une façon aussi large dans la première de ces diphthongues que dans la seconde. Il en est de même pour Ùt qui se prononçait aou, tandis que. ïtt sonnait âou. En effet, si, pour ne parler ici que de la diphthongue ^ ê, elle avait déjà été prononcée ê dans la première période de la langue, on ne comprendrait pas comment le son i, qui aurait été en quelque sorte enfoui dans la diphthongue, serait revenu à la vie après la séparation des idiomes, dans des branches isolées de la souche indo-européenne : nous trouvons en grec Té sous la forme de ou, et, ot (vov. Vocalisme, p. 19B suiv.); la même diphthongue se montre en zend comme ai (§ 33) ou comme âi, ou comme ê; en lithuanien comme ai ou ê; en lette comme ai, ê ou ce; en latin comme ae, venant immédiatement de ai, ou comme ê. Si, au contraire, la diphthongue avait encore, avant la séparation des idiomes, sa véritable prononciation, on s’explique aisément que chacun des idiomes dérivés ait pu fondre en è Yaiqu’il tenait de la langue mère, soit qu’il fit de cette fusion une règle constante, soit qu’il ne l’accomplît que partiellement; et, comme rien n’est plus naturel que cette fusion de 17w en ê, beaucoup de langues dérivées ont dû se rencontrer en l’opérant. Ainsi que nous l’avons
dit plus haut, le sanscrit, suivant la prononciation venue jusqu’à nous, change toujours en ê la diphthongue ai suivie d’une consonne, tandis que le grec suit une voie opposée et représente la diphthongue sanscrite par ou,
St OU 01.
L’ancien perse confirme cette opinion : il représente toujours la diphthongue sanscrite ê par ai et 6 par au. Ces deux diphthongues sont figurées dans l’écriture cunéiforme à l’intérieur et à la fin des mots d’une façon particulière, que Rawlinson a reconnue avec beaucoup de pénétration : à côté de la contenu dans la consonne précédente, on place soit un i soit un u, suivant qu’on veut écrire ai ou au. Mais quand Yi ou Yu} ou la diphthongue qui se termine par l’une de ces voyelles, est à la fin d’un mot, on y joint, suivant une règle phonique propre à l’ancien perse, la semi-voyelle correspondante, à savoir y après un i, » après un u; exemple : astiy «il est*, en sanscrit asti; maiy «de moi, à moi h, en sanscrit me ; pâîuv «qu’il protégea, en sanscrit pâtu; bâbirauv «à Babylone». Après h (qui représente le s sanscrit), il y a, au lieu d’un iy, un simple y; exemple : ahy «tu es», en sanscrit âsi. Au commencement des mots où représente Y a bref aussi bien que l’ü long, les diphthongues ai, au ne sont pas distinguées dans l’écriture de âi, au; exemples : f f Y • Y Y - yT a^a ceci ?», en sanscrit étatf et yfÿ . rr*« âiêà «il vint», en sanscrit âièat «il alla.» Comparez le composé ||. Cf y f. yy. . HT * tT * << Vatiy-û™a ils arrivèrent (ils échu
rent)» (en sanscrit praty-âièan), où Y a de la diphthongue ai* est indubitablement long, l’écriture cunéiforme n’ayant pas plus que le sanscrit l’habitude d’exprimer l’a bref quand il vient après une consonne. La diphthongue au ne s’est pas rencontrée jusqu’à ce jour sur lesi inscriptions perses au commencement d’un mot dont la formation fût certaine : mais sûrement elle ne différerait pas du signe qui représente au (fïÿ • ) ’ par exemple, dans
auramasdâ (en zend ahuramasdâ). De la transcription grecque Ùpofxâlrjs (c’est ainsi que les Grecs écrivent le nom du dieu suprême de la religion zoroastrienne), je ne voudrais pas conclure avec Oppert35 que les: anciens Perses, soit dans ce mot, soit en général, prononçaient l’aii comme un d .autrement on pourrait, en suivant la même voie, tirer encore d’autres conséquences de la transcription que nous venons de citer, dire, par exemple, que l’a en ancien perse se prononçait comme un o bref, l’d long comme im >7, et le groupe sd comme ds. „
S 3. Le son a en sanscrit et ses représentants dans les langues congénères.
Parmi les voyelles simples, il y en a deux qui manquent à Pancien alphabet indien : ce sont Ve et l’o grecs. S’ils ont été en usage au temps où le sanscrit étaitmne langue vivante, il faut au moins admettre qu’ils ne sont sortis de l’a bref qu’à une époque où l’écriture était déjà fixée. En effet, un alphabet qui représente les plus légères dégradations du son n’aurait pas manqué d’exprimer la différence entre â, ë et ô si elle avait existé l. Il est important de remarquer à ce propos que, dans le plus ancien dialecte germanique, le gothique, les sons et les lettres e et o brefs manquent. En zend, le sanscrit a est resté la plupart du temps « a, ou s’est changé d’après des lois déterminées en $ ë. Ainsi, devant un m final il y a constamment l ë ; comparez l’accusatif puirë-m « filium », avec pu-trâ-m, et d’autre part le génitif puira-hê avec pu-
trd-sya.
En grec, l’s et l’o sont les représentants les plus ordinaires d’un a primitif; il est représenté plus rarement par l’a. Sur l’altération de Ta bref en i et en u, voyez SS 6 et 7.
En latin, comme en grec, ë est l’altération la plus fréquente de l’a primitif; Vit remplace l’a plus rarement qu’en grec. Je cite quelques exemples d’un ô latin tenant la place d’un a sanscrit :
|
Latin. |
Sanscrit. |
Latin. |
Sanscrit. |
|
0 cto |
aètâû |
SOpOl' - |
svap cr dormirn |
|
novem |
nâmn |
coctum |
pdktum |
|
noms |
ndva-s |
ïàquor |
lap tfparler» |
|
socer |
évâéuras |
soüus |
sdrva-s « chacun » |
|
soeruê |
svaérû's |
sono |
svan ffrésonner» |
|
sororcm |
pont |
pdntan ff chemin» | |
|
1 Cf, Grimm |
Grammaire allemande, I, p. 59/1. | ||
|
Latin. |
Sanscrit. |
Latin. |
Sanscrit. |
|
tonilru |
stan «tonner» |
vomo |
vàm-â-mi |
|
ovi-s |
âvi-s |
voco |
vâc-mi «je parle» |
|
poü-8 |
pâtis «seigneur36» |
proco |
prac «demander» |
|
noct-em |
nâkt-am «de nuit» |
morior |
mar, mr «mourir». |
$ h. Vâ long sanscrit et ses représentants en grec et en latin.
De même que le grec remplace plus souvent Y a bref sanscrit par un e ou un o que par un a bref, de même il substitue plus volontiers à d un v ou un <w qu’un a long. Le dialecte dorien a conservé l’a long en des endroits où le dialecte ordinaire emploie r t) ; mais il ne s’est conservé en regard de Va aucun reste de la primitif. ^enf*T dàiâmi «je place» est devenu
dâdâm «je donne» a fait StSeopu; la terminaison du duel msr tâm est représentée par ttjv et par tgjv, ce dernier à l’impératif seulement; au contraire, il y a partout cov pour le génitif pluriel, dont la désinence sanscrite est dm.
En latin, les remplaçants ordinaires de l’a sanscrit sont ô et a bref; exemples : sôpio, en sanscrit svâpâyâmi «j’endors»; dato-rem, en sanscrit dâtdram; sorôrem, en sanscrit svdsâram; pô~tum, en sanscrit pa-tum «boire;» nô-tum, en sanscritgnâ-tum «connaître ». L’a long s’est conservé, par exemple, dans mater, frâter, en sanscrit mata, tirâ'tâ (thèmes, mâtâr, hrâtar); de plus, dans les accusatifs pluriels féminins, comme novâs, equâs, en sanscrit ndvâs, âsvâs, en analogie avec les formes grecques vêtis, fioverâs, vtKâs, Jamais il n’y a ni » ni co pour les diphthongues indiennes T[ é et ^ 6, formées par la combinaison d’un ^ i et d’un ^ u avec un ’ST a antécédent. Pour la première de ces diphthongues, il y a, en grec, soit et, soit o*, soit eu (^r a étant représenté par a, s ou o); et pour la seconde, soit eu, soit ou, soit.au. Exemples : ê'mi «je vais» =» efytt; ïf^G ÏÏârês «que lu portes» (pépbiz-,
yffîbâratê (moyen) = typerai; Urantê (pluriel) = ^po»Ta<;
jft gô, masculin «bœuf», féminin « vache » — fiov. Sur à — su, voyez § 26. Nous avons un exemple de 0 pour olv dans la racine ^âg «briller» (d’où vient ôgas «éclat»), à laquelle correspond la racine grecque aly dans avyrf, etc. L’otu de mus, au contraire, représente un en sanscrit, comme on le voit par le mot nâu-s «vaisseau». La déclinaison du mot grec montre, d’ailleurs, que Ta est long par lui-même dans ce mot; en effet, le génitif dorien est vâés pour vâFôs = sanscrit nâvâs, et le génitif ionien vy}6$.
Il peut arriver que, par la suppression du dernier élément de la diphtbongue, c’est-à-dire de Ti ou de Yu, un ê ou un 0 sanscrit soit représenté, en grec, par un a, un s ou un 0, Ainsi, T^ïîrKQêkatard-s «un des deux», en grec êndrepos\ dêvâr,
dêvr «beau-frère» (nominatif, déva), en grec Sâsp (venant de SâFép, SatFép); d’autre part, l’o dans @06$, @oi est pour ou (/3ou-<k, jSou-/); Tu aurait dû se changer, et s’est certainement changé, dans le principe, en F, comme cela ressort du latin hovis, bovi et du sanscrit «PTfaguW (locatif), venant de go-i pour gau-i.
S.5. Origine des sons a, œ eL œ en latin.
L’é latin a une double origine. Ou bien il est, comme Yn grec et Yè gothique, l’altération d’un â long, comme par exemple dans qui répond au sanscrit et au vieux haut-allemand
sâmidans siês = etrjs (venant de êatws) qui répond au sanscrit syâs; dans rê-s, rê-bus pour le sanscrit râ-s, râ-Byds. Ou bien il résulte, comme Yê en sanscrit et en vieux haut-allemand, de la contraction d’un a et d’un i (S 2). La langue latine a perdu toutefois la conscience de cette contraction que le sanscrit, le latin et le vieux haut-allemand ont opérée d’une façon indépendante, de sortç qu’d faüt attribuer en partie au hasard la similitude qui existe, par exemple, entre le latin stê-s, $tê~mus, srf-tis et
le sanscrit tistê-s, tîstê-ma, tîstê-ta, et le vieux haut-allemand stê-s, stê-mês, stê-t1. C’est aussi le hasard qui est cause de la rencontre du latin lêvir (pour laivirus de daivirus) avec le sanscrit dêvdra-s venant de daivâra-s. On peut comparer à ce sujet la contraction qui a eu lieu dans le lithuanien dêweris qui est de la même famille. Le thème Sâép en grec se rapporte au thème sanscrit dêvdr ( par affaiblissement dévf, nominatif dêvâ), et a compensé la perte de la seconde voyelle de la diphthongue par rallongement de la première. L’anglo-saxon tacur, tacor a perdu également 1Y de la diphthongue et prouve par son à la vérité de la proposition émise plus haut, que Té sanscrit s’est formé de Y ai après la séparation des idiomes.
Après ê, c’est œ qu’on trouve le plus souvent en latin comme contraction de ai, surtout dans les formes où la langue a encore conscience de la contraction37 38. On peut citer a ce sujet le mot quœro (de quaiso cf. quaistor), dans lequel je crois retrouver la racine sanscrite c'êst ( venant de kaist) « s’efforcer »39. Comparez aussi le gallois cals «contentio, labor».
De même qu’en grec Ya primitif de la diphthongue sanscrite ê**ai s’est altéré fréquemment eno, de même en latin nous avons m (venant de o?.) pour ai : il est vrai que cette altération est très-rare. Elle a lieu dans fœdus de la racine fid qui, comme la racine
grecque correspondante 'suB signifie originairement lier, comme Ernesti l’avait déjà conclu avec raison de 'sreïo’-pta. Pott a rapproché très-justement cette racine de la racine sanscrite band\ En ce qui concerne l’affaiblissement de l’ancien a en i, krtB et fid se comportent comme le thème du présent germanique bind 40\ le prétérit singulier (band) a sauvé au contraire la voyelle radicale primitive, comme cela a lieu, au prétérit, pour tous les autres verbes de la même classe de conjugaison dans les formes monosyllabiques du singulier. De la racine fid (cf. fiides et d’autre partfiido) devait venir avec le gouna (§ ü$)faid, d’oùyœd (dans fœdus) pour foid — ttoiB de 'aéizotBa.
S 6. Pesanteur relative des voyelles. A affaibli en
Si nous examinons la pesanteur des trois voyelles fondamentales , nous trouvons les résultats suivants : l’a est la voyelle la plus grave, IVla plus légère, et l'« tient le milieu entre Ya et IV. Les langues sont plus ou moins sensibles à ces différences de gravité qui sont devenues en partie imperceptibles à notre oreille. La découverte de ce fait auparavant inaperçu m’a conduit à une théorie neuve et, à ce qu’il me semble, très-simple, d’un phénomène grammatical qui joue un grand rôle dans les langues germaniques : je veux parler de ce changement des voyelles connu sous le nom d'apophonie (^ciblant)2. Le sanscrit a été le point de départ de mes observations : il renferme une classe de verbes qui changent d long en î long précisément dans les formes où d’autres classes de; verbes éprouvent d’autres affaiblissements. Il y a, par exemple, un parallélisme parfait entre le changement de yu-nd-mi «je lie» en yu-nî-mds «nous lions» d’une part, et, d’autre
nairement un « au lieu d’un i, conformément au même principe d’affaiblissement; exemples : abjectus, perfectus, mer mû, eæpers, tubicen (qui vient s’opposer à tubicmis} ; ou bien 1’# primitif reste, comme dans contactas, exactus.
part, celui de êm = aimi «je vais » en imàs «nous allons », et celui du grece^f en ïp&v. Nous rechercherons plus tard la cause de ce changement de voyelle qui a lieu dans les verbes, et qui fait que nous avons, dun côté, une voyelle pour le singulier actif, de 1 autre, une autre voyelle pour le duel et le pluriel, ainsi que pour le moyen tout entier dans les verbes sanscrits de la deuxième conjugaison principale et dans les verbes grecs en pt.
Le latin montre également qu’il est sensible à la différence de gravité des voyelles a et i : entre autres preuves, nous pouvons citer le changement d’un a primitif en i, dans les syllabes ouvertes, lorsqu’il y a surcharge par suite de composition ou de redoublement; dans le dernier cas le changement est de rigueur; exemples : ahjicio, perficio, abripio, cecini, tetigi, inimicus, insipidns, contiguus pour abjacio,perfacioy etc. Dans les syllabes fermées1, il y a ordi
Les langues germaniques, pour lesquelles le gothique nous servira surtout de type, ont la même tendance à alléger le poids de la racine en changeant Ÿa en i; elle paraît surtout dans les verbes que Grimm a classés dans ses 10e, 1 ie et 19e conjugaisons, lesquels ont conservé l’a radical au singulier du prétérit, à cause de son monosyllabisme, mais ont affaibli l’a en i au présent et dans les formes qui en dérivent, à cause du plus grand nombre de syllabes* Nous avons, par exemple, at «je mangeai», et ita «je mange», de la même façon qu’en latin nous avons cano et cecini, capio et accipio. On voit par le sanscrit, pour tous les verbes qui se prêtent à cette comparaison, que, dans les classes de conjugaisons gothiques précitées, le prétérit singulier contient la vraie voyelle
1 La syllabe est dit^fermée si la voyelle est suivie de deux consonnes, ou même, à la lin du mot, d’une seule.
radicale; comparez ai «je mangeai» (ou «il mangea»), mi «je m’assis», vas «je restai, je fus», vrak «je poursuivis», ga-vag «je remuai»,frah «j’interrogeai», qvam «je vins», bar «je portai», gu-for «je déchirai, je détruisis», band «je liai», aux racines ad, sad, vas «demeurer», vrag «aller», vah «transporter», prac, gam «aller», bar (par affaiblissement 6V), dar(dârâmi* je fends»), band\ La grammaire historique devra donc cesser de regarder Va des prétérits gothiques dont ncus venons de parler, et des autres formes semblables, comme l’apophonie de 17 du présent, destinée à marquer le passé. Il est vrai qu’au point de vue spécial des idiomes germaniques, cette explication paraissait assez plausible, d’autant plus que la véritable expression du rapport de temps, c’est-à-dire le redoublement, a réellement disparu de ces prétérits, ou bien est devenue méconnaissable, par suite de contraction, dans les formes comme êium «nous mangeâmes», sêlum «nous nous assîmes». Nous reviendrons sur ce point.
Le grec est moins sensible que le sanscrit, le latin et le germanique, à la pesanteur relative des voyelles, et ne présente aucun changement de IVen i qui soit régulier et qui frappe les yeux du premier coup. On peut, toutefois, citer certaines formes où, pour alléger le poids, un t est venu prendre la place d’un a primitif, notamment les syllabes redoublées des verbes comme Stôwpt, ri$ï}fu9 en opposition avec le sanscrit dâdâmi, dâddmi. Dans iisfâmi «je suis debout», etgîgrâmi «je flaire», le sanscrit met également un i au lieu d’un a, pour éviter, à ce que je pense, un surcroît de poids dans une syllabe déjà longue par position ; de même au désidératif, où la racine est chargée par l’adjonction d’une sifflante, exemple : pîp aks« désirer cuire», auquel on peut opposer bùbaks « désirer manger ». 11 y a encore en grec des formes sporadiques où Y t tient la place d’un a primitif : je mentionne l’homérique tfréjype?, dont l’i répond, comme 17 du gothique Juhâr, à 1*« du sanscrit catvâras, et du latin quatuor; Xryvvs dont
la racine, devenue méconnaissable, de même que celle du latin ùgMtm(«lebois» en tant que «combustible») répond au sanscrit dak, à l’irlandais dagh, du verbe c^|(h dâhâmi, daghavm «je brûle » ; ïwkos de txxos pour ixTq$, qui répond au sanscrit ds'va-s, venant de dkva-s «cheval», et au lithuanien aswa «jument».
S 7. A affaibli en u.
Le sanscrit, le latin et le germanique traitent IV comme une voyelle plus légère que IV, car quand il y a lieu (l'affaiblir IV, ils le changent quelquefois en u. Ainsi la racine sanscrite kar (par affaiblissement 1er) donne au singulier du présent karSmi «je fais » , mais au pluriel kurmds «nous faisons», a cause de la terr minaison pesante1 ; de même les désinences personnelles du duel tas, tas se changent en tus, tus au temps qui correspond au parfait grec, évidemment à cause de la surcharge produite par le redoublement, surcharge qui a occasionné aussi l’expulsion d’un n à la 3e personne plurielle du présent des verbes de la 3e classe de conjugaison : biBrati pour biBranti. Il ne manque pas en sanscrit d’autres faits pour montrer que Yu est plus léger que IV Mais nous passons à présent au latin, où les formes comme conculco, insuïsus, pour concalco, insalsus, reposent sur le même principe qui a fait sortir abjicio, immicus, inermts, de abjacio, etc. Les liquides ont une certaine affinité avec IV, mais sûrement la langue aurait préféré conserver IV de calco, salsus, si IV n’avait pas été plus léger que l'a. Les labiales ont également une préférence pour IV et le prennent dans des formes composées où l’on aurait plutôt attendu un i; exemples : occupo, aucupo, nuncupo, cantubermum, au lieu de occipo 41 42, etc. - ^ t
Le germanique affaiblit un a radical en u dans les formes polysyllabiques du prétérit de la 12e conjugaison de Grimm; cette conjugaison ne contient que des racines terminées ou par deux liquides, ou, plus fréquemment, par une liquide suivie d’une muette ou d’une sifflante. La liquide exerce donc encore ici son influence sur l’apparition de Yu; mais cette influence ne resterait certainement pas bornée aux formes polysyllabiques, si Yu n’était pas une voyelle plus légère que Y a. Le rapport de formes comme le vieux haut-allemand bant (oupant) «je liai, il lia» avec bunti «tu lias», buntumês «nous liâmes», etc.1, bunU «je lierais, il lierait», est analogue à celui du latin calco avec conculco, de sabus avec insulsus. Le participe passif (buntanêr «lié ») subit également ^affaiblissement de Y a radical en u; il le montre même dans des racines qui, comme quant «aller» (- gant « aller »), se terminent par une simple liquide2, et qui ne subissent aucun affaiblissement de l’a en u h l’indicatif et au subjonctif du prétérit, parce qu’elles ont, dans les formes où cet affaiblissement pourrait avoir lieu, un redoublement caché par une contraction (quâmi «tu vins», quâmumes «nous vînmes»; gothique qvêmum).
En grec, où l’ancien u est représenté par IWü, ù l’exception de quelques formes du dialecte béotien, qui emploie ou, il n’y a qu’un petit nombre de mots isolés où l’ancien a se soit affaibli en u, et cela sans aucune règle fixe. Comparez vvxr-a, avec le sanscrit ndkt-am «de nuit», le lithuanien naktt-s «nuit», le gothique naht-s (thème nehti); 6-vv%, thème o-vv^, avec le sanscrit
la changent en u; exemple : püpûrs «désirer remplir » (de la racine par, pr), par opposition à éi'ldrê «désirer faire », de kar, kr.
1 J’ài crû, pendant un temps, que Va des formes gothiques, comme hulpum (venant de halpum), était dû à l'influence assimilatrice de l'a de la désinence (Annales berlinoises, février 1827» p. 270). Mais celte explication ne s’accorde pas avec les participes passifs, commehulpans, et les subjonctifs, comme httlpjau; aussi l’ai-je déjà retirée dans mon Vocalisme ( notes 16 et 17).
2 Grimm, 1 tr conjugaison.
naHâ-s, le lithuanien nâga-s; ywrjavec le sanscrit gdni-s « épouse » (racinegan « engendrer, enfanter »), le borussiengYuma-n « femme » (accusatif), le gothique qvên-s (thème qvêni, venant de qvâni); avv avec le sanscrit sam «avec».
Nous retournons au latin pour faire observer que les mutilations éprouvées par les diphthongues m (= ai) et au, quand les verbes où elles paraissent sont surchargés par suite de composition, reposent sur le même principe que le changement de IVf en i et en u (accipio, occupo, SS 6, 7 ). Les diphthongues æ et au renoncent, pour s’alléger, a leur premier élément, mais allongent, par compensation, le second, i et ù étant plus légers que ai et au. Exemples : acquîro, occîdo, collîdo, conclûdo, accûso (de cmm),pour acquaero, etc. Au lieu de Y au de faux, famés, nous avons un â (sujfôco ), que je ne voudrais pas expliquer d’après le principe sanscrit, par une contraction de la diphthongue au, mais plutôt par la suppression du second élément de la diphthongue : cette suppression aurait entraîné, par compensation, l’aUongement de Va, qui se serait changé en 6,. comme dans sôpio — sanscrit svâpâyâmi (§ 4).
S 8. Pesanteur relative des autres voyelles.
Quant au rapport de gravité entre u et i, il n’est pas difficile d’établir que la première de ces voyelles est plus pesante que la seconde. Le sanscrit le prouve en changeant un u radical en i dans les aoristes, comme âundrid-am (racine und) pour aûncl-und-am: la racine redoublée, qui doit paraître dans la deuxième syllabe, sous la forme la plus affaiblie change u en i, et évite la longue en supprimant la nasale. Le latin, pour alléger le poids du mot, transforme toujours en composition Vu radical qui termine le premier membre du composé en i; exemples ifructi-fer, mani-pulus pour fructu-fer, manu-pulus.
1 Grammaire critique de ia langue sanscrite, SS 387, 388.
Il reste à parler du rapport de gravité des voyelles inorganiques (ë, ê, Ô, 6, s, v, o, a) entre elles et avec les voyelles organiques L En ce qui concerne l'e bref, la prononciation de cette voyelle permet de telles dégradations de son, qu’il est impossible d’étendre les conclusions fournies par un idiome à un autre. En latin, un e radical est plus lourd que 1 ’i, comme on le voit par des formes telles que lego, rego, sedeo, par opposition aux composés colligo, erigo, assideo. Au contraire, un e final paraît être, en latin, plus faible qu’un i, puisque cette dernière voyelle se change en e à la fin des mots43 44, notamment aux cas dénués de flexion des thèmes neutres en i; exemple : mite, à côté du masculin et du féminin miti-s, des neutres grecs, comme t'Spt, et des neutres sanscrits, comme sucL En grec, Ps parait être plus léger que Pi, à quelque place du mot qu’il se trouve; c’est pour cela que Pi s’altère en e quand le mot reçoit un accroissement, comme dans les formes «réAe-cas, «r&e-i. Le rapport de formes comme coiyoris, jecoris, à corpus, jecur, montre que IV bref, en latin, est plus léger que l’w.
S 9. L’anousvâra et l’anounâsika. ,
Deux sons nasaux, Yanousvâra et Yanounâsika, et une aspiration finale, nommée visarya, ne sont pas regardés, parles grammairiens indiens, comme des lettres distinctes, mais seulement comme les concomitants d’une voyelle précédente, parce qu’ils n’ont pas toute la force d’une consonne, et qu’ils ne peuvent commencer une syllabe. L’anousvâra (™), c’est-à-dire le son qui vient après, est un son nasal qu’on entend après les voyelles, et qui répond probablement à notre n français à la fin des
mots ou, au milieu des mots, devant des consonnes. Nous le transcrirons h. Sous le rapport étymologique, il remplace toujours, à la fin des mots, un m primitif, lequel doit être nécessairement transformé en anousvâra devant une sifflante initiale, un g h ou les semi-voyelles ^ y, "Ç r, ^v. Exemples : rf
sûnüm «ce fils»; 7} tan vfkam «ce loup», pour iam sûnum, tam vflmm. En prâcrit et en pâli, l’anousvâra s’emploie devant toutes les consonnes initiales au lieu et place d’un m primitif. Le n final s’est également changé en anousvâra dans ces dialectes amollis : exemples : en prâcrit tiaavah pour le sanscrit Bâgavan et fiâgavân, le premier vocatif, le second nominatif du thème Mgavant « seigneur » (proprement « doué de bonheur » ; c’est un terme honorifique); en pâli, 4gunavaii «vertueux» (au vocatif) pour le sanscrit günavan. A l’intérieur des mots,
Panousvâra ne paraît en sanscrit que devant les sifflantes, comme altération d’un n primitif; exemples : hansd « oie », qui est de
même famille que l’allemand gnns, le latin miser (pour hanser) et le grec %iiv ; fvp^jtihsmds « nous écrasons » (singulier,pmds/m), qu’on peut comparer au latin pinsimus; le verbe han-mi «je tue» fait, â la seconde personne, hdh-si, parce qu’un n primitif ne peut pas se trouver devant un s.
L’anounâsika«/w (appelé aussi anomâsîya) ne paraît guère que comme transformation euphonique d’un n devant une sifflante. Dans le dialecte védique, on le trouve aussi devant un r, quand celui-ci provient d’un 5 primitif; nous reviendrons plus tard sur ce-point. Dans la langue des Védas, quandTanounâsika paraît à la fin d’un mot, à la suite d’un â long, il faut admettre que, après le «/ n, il y avait d’abord encore un r. Du groupe tir, auquel on peut comparer le nr français dans,genre f on"peut, je crois, conclure que la prononciation de l’anounâsika était plus faible que celle de l’anousvâra, car le son n peut beaucoup moins sc faire entendre devant un r que devant un s, lequel supporte
devant lai un n prononcé pleinement. La faiblesse de l’anounâ-sika se déduit encore de sa présence devant l, dans les cas où un n final se change en fil devant un l initial, transformation qui n’est, d’ailleurs, pas obligée, et que les grammairiens indiquent seulement comme étant permise. Or, il est presque impossible qu’après un son nasal, deux l, dont l’un serait final et l’autre initial, puissent véritablement se faire entendre.
$ 10. L’anousvâra en lithuanien et en slave.
En lithuanien, il y avait un son nasal qui n’est plus prononcé aujourd’hui, d’après Kurschat, mais qui est encore indiqué dans Técriture par des signes spéciaux ajoutés aux voyelles ; on le rencontre notamment à l’accusatif singulier, où il tient la place du m sanscrit et latin, du v grec, et, ce qu’il est particulièrement important de remarquer, du n borussien. Ce son nasal, que nous marquerons, dans l’écriture, comme l’anousvara sanscrit, par un », a avec lui cette ressemblance que, dans l’intérieur des mots, il tient la place d’un n primitif. De même, par exemple, qu’en sanscrit le n du verbe man «penser» devient h devant le s du futur [maïi-syê'xje penserai»), de même, en lithuanien, le n de laupsinu devient, au futur, laupsimm «je louerai», que Ton prononce aujourd’hui laupsisiu, mais où l’écriture a conservé le signe de l’ancienne nasale. J’écris également h la nasale conservée dans la prononciation de quelques voyelles en ancien slave, sur lesquelles nous reviendrons plus tard. Je me contenterai de rappeler ici l’accord du neutre maco manso, en ancien slave, avec le sanscrit 41 mâhsâ-m «chair »; j’admets toutefois que le passage du son plein de n au son obscurci de l’anousvâra s’est opéré d’une façon indépendante dans les deux idiomes.
'. Su. Le visai’ga.
L’aspiration finale, appelée par les grammairiens indiens iv-
sarga, c’est-à-dire émission, est toujours ia transformation euphonique d’un ou d’un ^ r. Ces deux lettres sont très-sujettes au changement à la fin des mots, et se transforment en visarga(: ) devant une pause, ainsi que devant h, U, p, p. Nous représenterons, dans notre système de transcription, le visarga par un H. En ce qui concerne les altérations auxquelles sont soumis un s ou un r final, le sanscrit occupe, parmi toutes les langues indoeuropéennes, si l’on en excepte le slave, le dernier degré de l’échelle ; car, tandis que, par exemple, dêvâs adieu», agnis a feu», sénés «fils» ne conservent l’intégrité de leur terminaison que devant un t ou un i initial (ad libitum aussi devants), les formes lithuaniennes correspondantes diewas, ugnis, sunus, gardent invariablement leur s dans toutes les positions; le lithuanien est, par conséquent,,à cet égard, mieux conservé que le sanscrit dans la forme la plus ancienne qui soit venue jusqu’à nous. Une circonstance digne de remarque, c’est que même le perse et le zend, ainsi que le pâli et le prâcrit, ne connaissent pas le son du visarga. Dans la première de ces langues, le s final primitif est régulièrement supprimé après a ou â, mais conservé, après les autres voyelles, sous la forme d’un « s, quelle que soit, d’ailleurs, la lettre initiale du mot suivant. De même, en zend, pour le s, par exemple dans pasus
«animal» (latinpecus). Pour un r final, le zend met rë (S 3o), mais conserve partout cette syllabe invariable. Comparez le vocatif zend dâtarè «créateur!» au vocatif sanscrit
datar, qai, devant /?, H, p, p et une pause, devient VTO'da&tô» devant t, i, datasf et ne reste invariable que devant les voyelles, les semi-voyelles, les moyennes et leurs aspirées.
§ 12. Classification des consonnes sanscrites.
Les consonnes proprement dites sont rangées dans l’alphabet sanseriUsuivanl les organes qui servent à les prononcer, et forment
sous ce rapport cinq classes. Une sixième classe se compose des semi-voyelles, et une septième des sifflantes et de g /t. Dans les cinq premières classes les consonnes sont rangées dans Tordre suivant: en premier lieu les consonnes sourdes (S 26), c’est-à-dire la ténue et son aspirée correspondante, puis les consonnes sonores, c’est-à-dire la moyenne avec son aspirée. La dernière consonne de chaque classe est la nasale. Les aspirées, que nous transcrivons U, g, etc. sont prononcées comme les non aspirées correspondantes suivies d’un h parfaitement sensible a l’ouïe : ainsi x^p ne doit pas être prononcé comme un/, mais, suivant Colebrooke, comme p/t-dans le composé anglais haphazard, et comme bh dans le mot abhorr. Quant a 1 origine plus ou moins ancienne des aspirées sanscrites, je regarde les moyennes aspirées comme les premières en date, les ténues aspirées comme les plus récentes. Ces dernières ne se sont développées qu’après la séparation des langues de l’Europe d’avec le sanscrit; mais elles sont antérieures à la séparation du sanscrit et des langues iraniennes. Cette opinion s’appuie surtout sur ce que les aspirées sanscrites sonores sont représentées par des aspirées en grec, et pour la plupart aussi en latin. Mais ces aspirées grecques et latines ont été soumises à une loi de substitution analogue a celle qui, dans les langues germaniques, a changé la plupart des moyennes primitives en ténues; ainsi le grec 3-^(5?, le latin/w-mws, répondent au sanscrit Mmâ-s «fumée», delà même façon que le gothique tunthu-s dent » , répond au sanscrit danta-s, Au contraire j les ténues aspirées sanscrites sont représentées presque constamment dans les langues classiques par des ténues pures; l’aspirée sanscrite t, la plus communément employée parmi les aspirées dures, est notamment toujours remplacée en grec et en latin par t, ^Comparez le grec «rX«tus, latin latus, avec le sanscrit prtû-s et le zend përëtu-s; le latin rota avec le theme sanscrit et zend rata * chariot»; le grec btrréovet l’albanais ciste (féminin)
avec le thème neutre sanscrit dsti; les désinences personnelles du pluriel re, tis avec la terminaison sanscrite etzende ta du présent et du futur. Je regarde comme accidentelle la rencontre de la terminaison grecque 6a dans des formes comme ïa6a, oMa avec le sanscrit ta du prétérit redoublé, en ce sens que le S- grec, à cette place, provient très-probablement d’un t, sous l’influence euphonique du <7 qui précède. En effet, le grec préfère après le o- io 6 au t, sans pourtant éviter entièrement le t; c’est pour cela qu’au moyen et au passif il a changé le t des terminaisons personnelles de l’actif en 6, sous l’influence du <r précédent, qui est l’exposant de l’action réfléchie marquée par le verbe *.
§ 13. Les gutturales.
La première classe des consonnes sanscrites comprend les gutturales, à savoir : \k, \g, \g, La nasale, que nous
transcrivons par un ri, se prononce comme n dans manquer, engager; elle ne paraît à l’intérieur des mots que devant les muettes de sa classe, et elle remplace un m à la fin des mots, quand le mot suivant commence par une gutturale. Quelques composés irréguliers, dont le thème se termine en^r/c, comme W^pràné «situé à l’est», formé de la préposition pra et aii «aller», changent au nominatif-vocatif singulier la nasale palatale en gutturale, après avoir supprimé la consonne finale; mais prâtU nest qu’une altération de prânk (§ 14 ), et il reviendrait à cette forme au nominatif-vocatif si deux consonnes pouvaient subsister à la fin d’un mot. La forme prâïi dérive donc de praiïk et non de prané, par la suppression obligée de la dernière des deux consonnes.
Les aspirées gutturales, Ji ainsi que ^g, sont d’un usage relativement rare. Les mots les plus usités où elles paraissent ‘ Je me suis expliqué ailleurs avec plus de détail sur la jeunesse relative des aspirées dans la plupart des langues de l’Europe, notamment dans les langues celtiques.
(Voyez Système comparatif d’accentuation, notes 16 et 18.)
sont niiM-s «ongle», garmd-s «chaleur», et lagâ-s «léger». Du premier mot il faut rapprocher le lithuanien rnga-s, qui suppose, toutefois, comme le russe nogotj, un mot sanscrit nagas, dont le g serait représenté régulièrement en grec, à cause de la substitution des aspirées (SS 12, 87 1), par le % de 6vux- De garmâ-s «chaleur», l’équivalent en grec est &sp-p.v 1 avec changement de la gutturale en dentale, comme dans t/s «qui?» au lieu du védique ki-s, en latin quis. Le même changement a lieu également dans 'mév’ie, sur lequel nous reviendrons plus taid, et, pour la moyenne, dans Av^vp au lieu de Yvpn'rtip- Avec lagii-s comparez le grec ê\ayvs et le lithuanien lengwa-s «léger» (venant de Imgu-a-s}, dont le theme s est élargi par 1 addition d’un a45 46. La nasale du mot lithuanien se retrouve aussi en sans
crit dans la racine de lagu-s, à savoir lang «sauter».
Nous retrouvons encore le U sanscrit remplacé par un x dans H67Xy = sankd-s «coquillage» (venant de ImhUd-s). Je ne voudrais pas me servir de cet exemple pour prouver l’ancienneté de l’aspiration dure, car le sanscrit a pu aisément, après la séparation des idiomes, changer dans ce mot en U un g dont la prononciation s’était endurcie. Le latin conclut est évidemment un emprunt fait au grec.
Si h. Les palatales.
La deuxième classe de consonnes comprend les palatales, c’est-à-dire les sons tch et dj (les sons italiens c et g devant e et t), avec leurs aspirées respectives et leur nasale. Nous transcrirons la ténue (^) par un c, la moyenne par un g, la nasale (^) par un û. Nous avons donc ^c, Cette classe
est issue, au moins en ce qui concerne la ténue et la moyenne,
de la ciasse des gutturales, et doit être considérée comme en étant un amollissement. On ne rencontre les consonnes de cette classe que devant des voyelles ou des consonnes faibles (semi-voyelles et nasales); devant les consonnes fortes et à la fin des mots les consonnes gutturales reparaissent la plupart du temps. Les thèmes «parole, voix» (latin vâc), et «ma
ladie», font au nominatif vâk, ruk, à l'instrumental et au locatif plurielsvâg-Ms, rug-Bis, vâk-éü, ruk-sü. Dans les langues congénères, au lieu et place des palatales sanscrites, il faut s’attendre à trouver, ou bien des gutturales, ou bien des labiales, les labiales étant souvent sorties par altération des gutturales, comme dans l’éolien <&éovpe$, l’homérique tzrlavpes, le gothique fdvôr «quatre», à côté du latin quatuor et du lithuanien keturi (nominatif pluriel); ou bien encore des dentales, les dentales étant également une altération des gutturales primitives (S i3), mais seulement en grec; exemples : -reWapssdexéo,<rapsç qui lui-rnéme est pour xérFapes, en sanscrit catvaras; •sfévrs de 'nréyx$s éolien utéfiirs, pour le sanscrit pdnca (thème pdncan), venant depdnka. Dans les langues qui ont formé des palatales d’une façon indépendante du sanscrit, on peut s’attendre naturellement à en trouver au même endroit qu’en sanscrit. Comparez, par exemple, l’ancien slave n€M€Tt pecetï « il cuit », avec le sanscrit pdcati. Le slave q c est sorti ici d’un k par l’influence rétroactive de e; le k s’est conservé dans la première personne pekun, et dans la troisième personne du pluriel ikkati* pekuhU, tandis qu’en sanscrit on trouve dans Içs mêmes formes la palatale pdc-d-mi, pdé-a-Mti. . ' . .
La ténue aspirée de cette classe, à savoir est une altération du groupe skP sc : c’est ce qu’on voit par la comparaison des idiomes européens congénères. Comparez, par exemple, la racine cid «fendre», avec le latin acid,-le grec ?xt$ (ffXi&'ap*), et, par la substitution du % au-A, d’ou viennent (pour
49
eTfctàjv), cr^/An ; enfin avec le gothique skaid de skaida «je sépare» (mpourt, § a6). Sur les représentants de en zend, voy.S 37.
§ i5. Les cérébrales ou linguales.
La troisième classe est appelée celle des cérébrales ou linguales47 et comprend une catégorie toute particulière de consonnes qui n’ont rien de primitif, mais qui sont une modification des dentales. Nous les désignons de la façon suivante : ^t, ^(/,
^ $9 w n. En prâcrit cette classe a pris une grande extension et
a remplacé fréquemment les dentales ordinaires. On prononce ces lettres en repliant profondément la langue vers le palais, de manière à produire un son creux qui a l’air de venir de la tète. De là leur dénomination sanscrite mûrianyà «capitalisa. Les muettes de cette classe paraissent très-rarement au commencement des mots, la nasale jamais2. La racine la plus usitée commençant avec une cérébrale est dî «volare».
Une chose digne de remarque, c’est que les dentales se changent en cérébrales après un s; exemple dvês-ti «il hait», dvis-td «vous haïssez». Cette règle vient de l’affinité des sons cérébraux avec le ê (le ch français dans charme).
§ 16. Les dentales.

quatrième classe comprend
les dentales et le n ordinaire
de toutes les langues : g/, ^d, ^/, ^ n. 11 a déjà été
question de l’âge relativement récent du i et du changement par substitution de /en 3 (S 19). Le latin, qui a perdu l’aspirée de cet organe, la remplace quelquefois par l’aspirée labiale ; exemple : fumus, qui répond au sanscrit dumd-s « fumée» et au grec B'VfiSs. Je reconnais dans infra, inferior, infimus des mois de meme famille que le sanscrit aids s en bas», diara-s « inférieur», àiamd-s «le plus bas» L De même dans l’osque méfiai (viaimefiai « in via media ») le/correspond au /de mddyâ; le latin médius a supprimé complètement l’aspiration, ce qui arrive fréquemment dans cette langue, à l’intérieur des mots, même pour les classes de consonnes qui en latin disposent d’une aspirée : comparez par exemple mingo, lingo aux racines sanscrites mih, lik, aux racines grecques Xt%; tibî au sanscrit tuByam; bus
désinence du datif-ablatif pluriel au sanscrit Byas.
Le grec a cette particularité qu’il joint quelquefois au commencement des mots, comme surcroît inorganique, un t, 3 ou A à des muettes initiales d’une autre classe : comparez 'ziléXts, ts6Xi$ à puri (venant de pari) «ville»; 'ssUarato à fif^pié «écraser», en latinpinso; Kido\xai à l’albanais ka-m «j’ai»; yBés à hyas «hier» (latin heri, hes-ternus); y§ov7ros, ySoviréu à l’ancien perse gaub-a-tay «il se nomme», persan (jütSguf-ten « parler » 2.
Quelquefois aussi le son dental qui se montre en grec après la gutturale est la corruption d’une ancienne sifflante, notam- 48
ment dans xrefoco, smctvov, comparé à la racine sanscrite ksan «blesser, tuer»; dans âpjtTos = sanscrit rksâ-s, venant de arkêâ-s, en latin ursus; dans yBapaXés (forme mutilée ^aptaXôs; cf. x«/W, %a(m8ev, %a[mZe) comparé au sanscrit ksamâ «terre».
S 17 \ D affaibli en / ou en r.
On connaît le changement de d en / par le rapport entre Mnpv, SctHpvfJLct et lacrimasOn trouve aussi en sanscrit un d, qui probablement est primitif, à la place où certaines langues de l’Europe ont un l. Exemple : dê'ha-s « corps », gothique7e«& (neutre, thème leika) «chair, corps». Pott rapproche de dah «brûler» le latin lignum, et je crois que le grec Xryvvs se rapporte à la même racine, dont le d primitif s’est conservé dans Soli'gj. Je retrouve le ^d du nom de nombredâsan (venant de dâkan) «dix», dans la lettre l de l’allemand eilf, zwôlf «onze, douze», en gothique ain-lif, tva-lif, et dans le lithuanien Uka de wienolika «onze», dwylika «douze», tryüka «treize», etc. Nous y reviendrons. On trouve aussi r remplaçant le d, notamment dans le latin meridies pour medidies. On peut ajouter ici que dans les langues malayo-polynésiennes l’affaiblissement du d en r ou en l est également très-ordinaire ; ainsi le thème sanscrit dva « deux » est représenté en malais et dans le dialecte de la Nouvelle-Zélande par dûa, en bugis par duva; dans le tahitien au contraire par * ruaf et dans le hawaïen, qui n’a pas de r, par lua. Le tagalien présente les formes redoublées daim et dalava, qui ont conservé le ddans la première syllabe et l’ont affaibli en l dans la deuxième48.
. S 17 \ N dental changé en ra cérébral.
Le n dental sanscrit («ï), quand il se trouve dans une désinence grammaticale, dans un suffixe formatif ou dans la syllabe
1 Comparez mon Mémoire sur la parenté des langues malayo-polynésiennes avec les langues indo-européennes, p. ii, 12.
marquant la classe des verbes, ou bien encore quand il est intercalé pour éviter un hiatus, se change en un n cérébral (w) s il est précédé d’une des lettres cérébrales % r, ^ r, TÇr, ^ s : mais il faut, pour que ce changement ait lieu, que le n soit suivi dune voyelle ou d’une semi-voyelle, et que la lettre cérébrale en question soit dans la partie radicale du mot. Il peut se trouver entre les deux lettres une ou plusieurs labiales, gutturales, ainsi que les semi-voyelles ^y et sans que l’influence de r, etc. sur le n soit interceptée. Voici des exemples : dvésâni « que je haïsse», srnomi «j’entends », srnvànti « ils entendent » ; runadmi «j’arrête », prîndmi «j’aime », pûrnds « rempli », hrsyamana-s «se réjouissant», vâ'n-n-as (génitif) «de l’eau»; pour dvesâni, srnomi, etc.
§ 18. Les labiales.
Nous arrivons aux labiales, à savoir : J^p, tR p, ^ b, ït B, ^Tm. L’aspirée sourde de cette classe i* p est employée rarement; les mots les plus usités où on la rencontre sont pêha-s « écume » (slave n-fcNd pêna, féminin), pald-m «fruit», et les autres formes dérivées de la racine pal «éclater, se fendre, s’ouvrir, porter des fruits». L’aspirée sonore B appartient avec aux aspirées les plus usitées; en grec, elle est remplacée par un (p, en latin au commencement des mots par un f, et, au milieu, comme on la déjà fait obseryer (§ 16), la plupart du temps par un b. Leijr£ de la racine kB «prendre» a perdu en grec 1 aspiration (Aa^aW, ëXotGov), à moins qu’inversement le sanscrit laB ne soit une forme altérée de lab. Quand la nasale ^(m) se trouve en sanscrit à la fin d’un mot, elle se règle sur la lettre initiale du mot suivant, c’est-à-dire qu’elle permute avec la nasale gutturale devant une gutturale, avec la nasale palatale, cérébrale ou dentale devant une palatale, une cérébrale ou une dentale (exemple : tan dântam «hune dentem», pour tam
ddnUrni). Elle se change nécessairement en anousvâra devant les semi-voyelles, les sifflantes et g h; exemple : <T tan sinlidm «huneleonem», pour tamsinhdm, En grec, le fx final s’est partout affaibli en v, par exemple h l’accusatif pour le sanscrit pati-m; au génitif pluriel taoS&v pour le sanscrit pad-dm; à l’imparfait stpepov pour le sanscrit dlîaram; ècpépsiov pour düara-tam «vous portiez tous deux». De même en borussien, par exemple dans deiwa-n «deum» pour le sanscrit dêvd-m. En gothique, on trouve encore le m final, mais seulement dans les syllabes où il était primitivement suivi d’une voyelle ou d’une voyelle suivie elle-même d’une consonne; exemple : ira «je suis» pour le sanscrit dsmi; hairam «nous portons» pour le sanscrit Urâmas; qvam «je vins, il vint «pour le sanscrit gagdma «j’allai, il alla ». Le m, primitivement final, a ou bien disparu en gothique, comme au génitif pluriel où nous avons une forme namn-è, correspondant au sanscrit namn-âm et au latin nomin-um; ou bien il s’est affaibli en un n, auquel, dans la déclinaison pronominale, on adjoint un a à l’accusatif singulier, exemple : Iwa-na «quem » pour le sanscrit ha-m, en borussien ka-n; ou bien enfin, il s’est vocalisé en u (comparez les formes grecques telles que (pépovo-i, venant de Çépovm, pour Çépovn), comme, par exemple, dans iÿar-u «que je mangeasse», lequel, quant & la forme, représente >e potentiel sanscrit ad-yd-m. Le latin, parfaitement d’accord en cela avec le sanscrit, a partout conservé le m final.
S 19, Les semi-voyelles.
Suivent les semi-voyelles, à savoir : 3Ç r, w l, ^ v. Le
y se prononce comme le/allemand ou le y anglais dans le mot year (zend ydrë «année»). Il est assez souvent représenté, en latin, par la lettre / en grec par un £, ce qui a besoin d’être expliqué. De même que leo^tin a pris en anglais le son dj, le sans«rit est devenu A l^Bnairc en prâerit un w// (prononcez dj), quand il se trouve au commencement d’un mot ou à l’intérieur entre deux voyelles. Pareille chose est arrivée en grec : dans cette langue, c’est le Ç (= <$?) qui se rapproche le plus par la prononciation du ^ (= dj) sanscrit. Or, je crois pouvoir affirmer que ce Ç tient partout la place d’un / primitif, comme on le voit clairement, en comparant, par exemple, la racine Çvy au sanscrit yug «unir» et au latin jung1. Dans les verbes en a&y, je reconnais la classe sanscrite des verbes en ayâ-mi, exemple : Sapd^a, en sanscrit dam-dyâ mi «je dompte», et en gothique tam-ja «j’apprivoise». Dans les verbes en Ça, comme (ppdÇa, ayjKa, i'&y, o&w, xpil/a, (3pi%a, xXd£a, xpdlja, je regarde le Ç avec la voyelle qui le suit comme le représentant de la syllabe 'Qfya, qui est la caractéristique de la quatrième classe de conjugaison en sanscrit2; j’admets en même temps que, devant ce Ç, la consonne finale de la racine (A1 ou y) est tombée. On pourrait supposer, il est vrai, que le Ç (= &) de o renferme le S de la racine suivi d’une sifflante; mais il vaut mieux admettre que le S est tombé, parce que cette explication convient également bien à tous les verbes en Ça, et rend compte de formes comme xp/Ça, (2pt%a (pour xpiy-ja, j2ply-ja), aussi bien que des formes yl\a, ëÇa, èÇofJiou. La suppression d’une dentale devant la syllabe Ça3 n’a rien de surprenant, si l’on songe que la même suppression a lieu devant un o- à l’aoriste et au futur, par exemple dans r&>, dont la forme correspondante en sanscrit est cêt-syâ-mi (pour cêcl-syâ-mi, de cid «fendre»).
Il est important de faire observer qu’il y a aussi quelques
1 11 faut excepter toutefois les cas où Ç (= <?s) est une métathèse de tr<3, comme
dans pour kdijvctaSe.
2 Voyez S 109 a 3, et Système comparatif d’accentuation, p. aa5 suiv.
* Le K ne devrait se trouver que dans la première série de temps ( présent et imparfait), qui correspond aux temps spéciaux en sanscrit; mais il s’est introduit abusivement dans d’autres formes où il nj^unt de raison d’être. Pareille chose est arrivée dans la conjugaison prâerile.
racines terminées par une voyelle, lesquelles, dans la première série de temps, peuvent prendre le £ : telles sont /3u-w,
qui peuvent faire jSXtî-?w, Ces formes montrent bien que
1 eK=j est la lettre initiale de la syllabe marquant la classe du verbe, et elles nous empêchent d’admettre que le £ de xp/Jw soit seulement une modification de là consonne finale, A ou 7, de la racine. J’explique également le X> des substantifs comme er^f-Sa, <ptî-?apar le ^y du suffixe sanscrit Tf y a, féminin STT yâ.
La semi-voyelle y, qui, comme nous l’avons dit, représente le sony, s’est ordinairement, en grec, vocalisée en r. Mais il est arrivé aussi que le y, au temps où il existait encore en greb, s’est assimilé à la consonne précédente. Je mentionne seulement ici, comme exemple de ce dernier fait, le mot âXXos, que j’explique par âXjos, et que je rapproche du sanscrit 'ypEQanyd-s49 ; la semi-voyelle y s’est conservée intacte dans le thème gothique alja (§ 9o), tandis quelle s’est assimilée à la consonne précédente dans le prâcrit anna, absolument comme en grec. En latin, le y s’est vocalisé, comme il le fait toujours dans cette langue après une consonne : alius pour aljus. On pourrait rapprocher du même mot sanscrit le latin ille; en effet, ille veut dire «l’autre», par rapport à hic, et la production de deux mots différents quant à la forme, plus ou moins analogues quant au sens, par une seule et même forme primitive, n’a rien de rare dans l’histoire des langues. UUus est de même origine; la voyelle de la forme primitive s’est un peu moins altérée dans ce dernier mot, ainsi que dans ul-tra, ul-terior, ul-timus.
Au commencement des mots, la semi-voyelle j s’est souvent changée en grec en esprit rude. Comparez 6s avec le sanscrit ya-s «qui»; feap, >57raT-os (venant de >77rapT-os) avec le sanscrit ydkrt (venant de yâkart) «foie», et avec le latin jecur; épais pour vppsts, venant de uerjaeîs, avec le thème pluriel sanscrit yusmd; a-&y (de oly-ja), ây-ios avec yag «honorer», yâg-yà-s « qui doit être honoré » ; üpspos avec yam « dompter », racine à laquelle appartient aussi Zvptot*
Nous transcrivons la semi-voyelle ^ par notre v; après une consonne, cette lettre se prononce, dit-on, en sanscrit, comme le w anglais. De même que le y, le grec a perdu la semi-voyelle v, au moins dans la langue ordinaire. Après les consonnes, le v s’est quelquefois changé en u; exemple : <ru, dorien tu, pour le sanscrit tvam «toi»; üttvos pour le sanscrit svâpna-s «rêve» (racine svap «dormir»), vieux norrois svëfn (thème svëjhaj «sommeil»; xvoov pour le sanscrit svan (thème). Mais, en général, le digamma, qui répond au ^ v sanscrit, a entièrement disparu après une consonne, aussi bien qu après l’esprit rude représentant le s sanscrit; exemple : ixvpés, en sanscrit svdsura-s (venant de svâkura-s)«beau-père», vieux haut-allemand swehur (thème swehura). ^etptfv conduit à la racine sanscrite svar, svr «résonner », à laquelle appartient aussi le latin ser-nw; au contraire, creip-, crsipôs, erstptos, Seipfos, déXas, crsXrjvr] (X pour p, § ao) appartiennent à *3^ svar, forme primitive de sur «briller». Le substantif svàr «ciel» (en tant que «brillant»), contient la racine encore intacte; il en est de même du zend hvarë «soleil» qui a pour thème hvar (§ 3o), mais qui se contracte en hûr aux cas obliques.
Quelquefois aussi le v sanscrit s’est changé en <p après un a initial, le tenant la place d’un ancien F (digamma); exemple ;
«sien», en sanscrit sm-s, en latin suu-s. Dans l’intérieur d’un mot, il est arrivé quelquefois que le F, comme le y , s’est
assimilé à la consonne précédente; exemple : 7écrempes, Téjla-ps$, pour le sanscrit catvaras; en prâcrit et en pâli, par une assimilation du même genre, cattârô1. Dans ce mot, la première consonne s’est assimilée la seconde; on peut dire, en général, que les deux idiomes que nous venons de citer assimilent la consonne la plus faible à la plus forte, quelle que soit leur place relative. Citons encore le grec iWos (venant de !Ïxkos, qui lui-même est pour fxFo?) a côté du sanscrit dsva-s (venant de akva-s, S ai*), en latin eqms, et en lithuanien dswa (= sanscrit dsvâ) «jument ».
Entre deux voyelles, le son v a entièrement disparu en grec, à l’exception de quelques formes dialectales50 51; exemples : 'üsXéco pour is'kéFa) (racine «Xü, avec gouna 'srXei*, § 96 a), pour le sanscrit pîdvâmi (racineplu «nager, naviguer, etc.»); en sanscrit dvi-s «brebis»; en lithuanien awi-sf en latin mis.
Comme représentant du digamma, on trouve assez souvent un fi au milieu et surtout au commencement des mots ; cette différence est probablement toute graphique, et ne correspond à aucune diversité de prononciation. S’il en était autrement, on pourrait rappeler que le v sanscrit est devenu, en règle générale , un b en bengali.
Mentionnons, en terminant, un fait qui s’est produit quelquefois: l’endurcissement du v en gutturale; par exemple, dans le latin vic-si (yixi), vic-tum de la racine viv (sanscrit gîv «vivre»). Dans le c de facio,je reconnais le v du causatif sanscrit Mvâyâmi «je fais exister, je produis», de la racine bû «être» (en latin, fu). Au v du sanscrit dêvdra-s, lêvir (S 5 ), répond le c de l’anglo-saxon iacor et le h du vieux haut-allemand zeîhur (thème zei-Lura = dûvara). Au v du latin navi-s et du sanscrit nâv (radical qui se retrouve dans les cas obliques, quand la désinence commence par une voyelle) répond le c anglo-saxon et le ch vieux haut-allemand de nac t, nacho «barque ». Au v du thème gothique qviw{nominatif qviu-s, sanscrit gîva-s «vivant») répond le k du vieux haut-allemand quek, thème queka.
S âo. Permutations des semi-voyelles et des liquides.
Les semi-voyelles et les liquides se confondent souvent entre elles, par suite de leur nature mobile et fluide. La permutation la plus fréquente est celle de r et de Z ; ainsi la racine sanscrite rué (venant de ruk) «briller» a un l dans toutes les langues de l’Europe. Comparez le latin luæ, luceo, le grec Xevx6s9 Xvyyos, le gothique liuhath «lumière», îauhmâni «éclair», le slave AOifMd luca «rayon de lumière », l'irlandais logha «brillant». A la racine rie (vcftknf de rik) «abandonner» appartient le latin linquo, le grec Xe/7r«, sXtnov, le gothique af-lifnan «relinqui», le borus-sienpo-linka «il reste». •
L pour n se trouve dans le grec âXXos, le latin alius, le gothique alja, le gaélique eile et dans d’autres formes analogues, par opposition au sanscrit anyâ-s et au slave uns mû, thème mo, «autre».
L est pour v dans le suffixe latin lent, qui répond au suffixe grec svt pour Fsvt, et au suffixe sanscrit vant (dans les cas forts). Comparez les formes latines, comme opulent-, aux mots sanscrits comme ddna-vant «pourvu de richesse» (de Æna «richesse»). La même permutation de v et de l se remarque dans le gothique slêpa «je dors», le vieux haut-allemand sUfu, qui répondent au sanscrit svâp-i-mi; dans le lithuanien saldû-s «doux», le slave cajasks sladüki% (même sens), qui répondent au sanscritmîdü-s, a Panglais sweet, au vieux haut-allemand mazi(c’est-à-diresivazi).
pour le sanscrit ivâm, tvâ; dans la racine gothique drus «tomber » (driusa, draus ,drusum)pour le sanscrit dvans1 ; dans le vieux haut-allemand bir-u-mês, pir-ur-mês «nous sommes», comparé au sanscrit tidv-â-mas, dont le singulier Mv-â-mi (racine M) s’est contracté, en vieux haut-allemand, en bim, pim; de même dans scrir-u-mês pour scriw-a-mês «nous crions» (sanscrit s'râv-dyâ-mas «nous faisons entendre», zend srâvayêmi «je parle»), dont le w s’est conservé dans la 3e personne du pluriel seriw-m (er-serin-un; Graflf, vi, 566), et, en outre, dans le moyen hautr-allemand, à la ire personne, et au participe passif, schriuwen, geschriuwen (au lieu de schriwci; voyez Grimm, p. 936).
R pour v se trouve, par exemple, dans le latin aras comparé au sanscrit svas (venant de kvas) «demain»; dans cresco, cre-vi, comparé à la racine sanscrite fai (venant de km) «croître», d’où est formé svây-â-mi «je croîs»; dans plôro, comparé au sanscrit plâvdyâmi «je fais couler »( racine pfce; latin ,jlu pour plu, d.pîuit); dans le crétois rpé «toi» (voyez Ahrens, De dial dorica, p. 5i)
Dans le dialecte irlandais du gaélique, arasaim signifie «j’habite »; j’en rapproche le sanscrit â^vasâmi (racine vas, préposition â). On y peut comparer aussi le gothique ras-n «maison » (thème, ras-na, § 86 5), quoique la racine sanscrite vas se trouve aussi, en gothique, sous sa forme primitive vas (par exemple, dans visa «je reste », vas «j’étais »)52 53 54. Cette coexistence de deux formes, 1 une altérée, l’autre pure, venant d’une seule et même racine, est un
fait qui n’est pas sans exemple. Ainsi, en vieux haut-allemand, à côté de la forme slâfu «je dors», il y a une autre forme qui a maintenu intact le son primitif w, à savoir in-swepiu (qui s’écrit insuepiu) «j’endors » ; comme le latin sâpio, cette forme correspond
au causatif sanscrit svâpâyâmi.
En slave, je crois trouver un v initial remplacé par un r dans peKrfr rekuii «je dis» (lithuanien, prd-raka-s «prophète», rehu «j’appélle, je crie»); je suppose, en effet, que ces mots appartiennent à la racine vac (venant de vak) «parler »1. En borussien, nous retrouvons, au contraire, le w dans en-wackêmai « invocamus », formé de la préposition en et de la racine waek. En serbe, vik-n-fi «puf dirft «p.rifir». vic-e-ïïi «ie crie».
On pourrait encore admettre le changement de v primitif en v dans le slave pd3 rus55 56 (ras devant les ténues et x)? comparé au sanscrit ^qvcihis «dehors», attendu que le 3 est le représentant ordinaire du ^ h sanscrit. Mentionnons aussi 1 ancien slave pM3d risa «habit», qui est peut-être dérivé de la racine sanscrite vas «habiller» (en gothique, vasja «j habille»).
Un exemple unique en son genre, d’un l mis pour unj(\y) primitif, est le mot allemand leber, vieux haut-allemand lebara, libéra, etc, s’il faut, en effet, le rapprocher, comme le fait Graff, du sanscrit yâkrt (venant de yakart). L ancienne gutturale se serait alors changée en labiale, comme dans le grec faap (S 19).
Si les langues de l’Europe n’offrent pas d’autre exemple d’un l tenant la place d’un j primitif, cela ne doit pas nous empêcher d’admettre la parenté des mots en question, car, outre le principe déjà établi que les liquides et les semi-voyelles permutent facilement entre elles, nous voyons que l’arménien Ijeard «foie» (£ est le représentant primitif de ê) a opéré le même changement. (Voyez Petermann, Grammaire arménienne, p. a 9.)
L pour m dans le latin jlâ comparé à la racine sanscrite dmâ «souffler» (/pour i d’après § 16), dans balbus comparé au grec fioLuÇat'vw.
M pour v, par exemple dans le latin mare, thème mari, et les autres mots de même famille, parallèlement au sanscrit mri ( neutre j «eau»57; dans le latin clâmo compare au sanscrit sra-vàyâmi «je fais entendre» (racine sru, de krû); dans Spépa comparé au sanscrit drâvâmi«je cours» (racine dru).
V pour m, par exemple dans le slave crüvï, thème crüvi « ver », à côté du sanscrit hfmi-s et du lithuanien kir mini-s.
S 91 \ La sifflante s.
La dernière classe de consonnes comprend les sifflantes et h. Il y a trois sifflantes : \SGi^S.
La première est prononcée comme un s accompagne dune faible aspiration ; elle appartient à la classe des palatales et s unit, comme sifflante dure, aux palatales dures exemple :
sûnûs-rfa «filiusque ». Examiné au point de vue de son origine , Tjr/ est presque partout l’altération d’un ancien k, ce qui explique pourquoi, dans les langues de l’Europe, il est ordinairement représenté par une gutturale. Comparez, par exemple, avec le thème s'van, dans les cas faibles (S 199) sun’ 8rec
JCVÙ)V, le latin cani-s et le gothique hund-s (ce dernier venant du thème élargi hunda); avec la racine dans « mordre », le grec $d-xvco, le latin lacero, le gothique tah-ja «je déchire» et le gallois danhezu «mordre»; avec dâéan «dix» (nominatif-accusatif dasa), le grec le latin decem, le gothique taihun, l’armoricain dek et l’irlandais déagh, deich. Les langues lettes et slaves, qui sont restées unies au sanscrit plus longtemps que les langues classiques /germaniques et celtiques, ont apporté avec elles la palatale s, sinon prononcée complètement comme le sanscrit, du moins parvenue déjà a l’état de sifflante. Ainsi, en lithuanien, le sanscrit ^ s et le zend a* é sont représentés, a 1 ordinaire, par s (qu’on écrit sz), et, en slave, par es. Comparez, par exemple, avec le sanscrit dâsan} le lithuanien desimtis et le slave accati» desantï58 ; avec satâ-rn « cent », le lithuanien simta-s et le slave cto (neutre); avec svan (nominatif sva, génitif sunas^j, le lithuanien suo, génitif sun-s, et le russe sobaka pour sbaka, lequel suppose un svaka sanscrit, qu’on peut rapprocher dumédique atraxa
dans Hérodote. En un petit nombre de mots, où les langues letto-slaves ont conservé la gutturale, tandis que le sanscrit Ta changée en sifflante, la sifflante sanscrite paraît ne s’être développée qu’a-près le départ des langues letto-slaves ; exemples : aktnuo (thème akmen) «pierre», ancien slave mmsi kamü (thème kamen), par opposition au thème sanscrit àsman (nominatif âsrnâ),
Il y a aussi quelques mots en sanscrit où le s (*Q initial est sorti évidemment d’un ancien s (^Q; par exemple dans suskàs «sec», pour lequel nous avons, en zend, huska (thème), et en latin siccus. Si le de ce mot était sorti d’un kf et non d un s ordinaire, nous devrions nous attendre à trouver également s (») en zend et c en latin. Il en est de même pour le mot svdéura-s «beau-père »; on le voit par le s du latin socer, celui du gothique svaihra (thème svaihran), l’esprit rude du grec êxvpos; il est, d’ailleurs, vraisemblable que la première syllabe de ce mot contient le thème réfléchi sva (^); de même, dans ^[sWra-s « belle-mère », latin socrus.
S 21b. La sifflante è.
La seconde sifflante, qui appartient à la classe des cérébrales, se prononce comme le ch français, le sh anglais, l’allemand sch, le slave ui. Elle remplace le ^sdans certains cas déterminés. Ainsi, après un k ou un r il ne peut y avoir un ^s, mais seulement un ’çi. Exemples : vâk-si « tu parles », biBâr-êi « tu portes », pour vdh-si, biBdrsi; dâkêina-s qu’on peut comparer au grec ée&os, au latin deæter, au gothique taihsvâ (thème taihsvôn) «la main droite». Le sanscrit évite également le après les voyelles, excepté a, â; aussi, dans les désinences grammaticales, le s se change-t-il en s après i, î, u,û, r, è, 6 et âu. De là, par exemple, dvisu (locatif) «dans les brebis», sûnü-su «dans les fils», nâu-sü « dans les navires », ê-si « tu vas », srnô~si « tu entends », pour dvi-su, sûnû-su, etc.
Comme lettre initiale s est extrêmement rare 59 ; le mot le plus usité commençant par ê, est sas «six» avec ses dérivés. Je regarde ce mot comme une altération de ksas, en zend ksvas, en sorte que très-probablement le s sanscrit sera sorti d’un s par l’influence du k précédent. A la fin d’un mot, et à l’intérieur devant d’autres consonnes que ijra, la ^ettre * ne
se rencontre pas dans l’usage ordinaire ; les racines et les thèmes qui finissent par un s le changent en Je, g ou en t, à. Le nom de nombre mentionné plus haut fait au nominatif sat; devant les lettres sonores (S a5) sad; à l’instrumental éad-ÏÏîs, au locatif mi~sü.
§ sa. La sifflante s,
La troisième sifflante est le s ordinaire de toutes les langues, lequel, en sanscrit, comme on l’a déjà fait remarquer (§ 11), est très-sujet à changement à la fin des mots et se transforme d’après des lois déterminées en visarga (: Æ), s, s, r et u. Toutefois il est difficile d’admettre qu’un s final se soit changé d’une façon immédiate en u (l’w contenu dans la diphthongue â, voir S a); on sait que le changement en question a lieu quand le s final est précédé d’un a et que le mot suivant commence par un a ou une consonne sonore : il faut supposer que le s se change d’abord en r et le r en u; les liquides se vocalisent aisément en un u, même dans les autres langues, comme on le voit par le français al qui devient au, le gothique am qui devient au, le grec ov qui dévient ov, \
Nous venons de voir que le $ sanscrit se change dans certains cas en r; pareil changement a lieu en grec, en latin et dans
éditioi^po Sakountma, de Chézy, no inel<mi \n\s cou-
plusieurs langues germaniques. En grec, seulement dans certains dialectes, notamment enlaconien : exemples êntye'kaaldp, àaxép, 'sritrop, yovdp, t/p, véxvp, <Çovycovep (/Soes êpydrat) pour êmye-IcLiTlrlSf àcrxésf TfftOos, yovds, t/s, véxvs, Zotiy&ves. (Voir Ahrens, II, 71, suiv.) Le latin change surtout s en r entre deux voyelles ; exemples : eram, ero pour esam, eso; quorum, quarum pour le sanscrit hêsâm (venant de késâm, le s s’étant changé en s à cause de Yê qui précède), kasâm, et pour le gothique fwisê, hvisâ. On trouve souvent aussi en latin un r final à la place d’un s, par exemple au comparatif, et dans les substantifs comme amor, ocfor, dolor; nous y reviendrons. Le haut-allemand présente très-souvent un r pour un s primitif, soit au milieu des mots entre deux voyelles, soit à la fin : je ne mentionnerai ici que la terminaison ro du génitif pluriel de la déclinaison pronominale, au lieu du sanscrit sâm, sam, du gothique sê, sâ; les comparatifs en ro (nominatif.masculin) au lieu du gothique sa, et les nominatifs singuliers masculins en r, comme, par exemple, ir «il» pour le gothique ts.
S a3. L’aspirée h.
J h est une aspirée molle et est compté par les grammairiens indiens parmi les lettres sonores (§ â5). Comme les autres lettres sonores, le h initial détermine le changement de la ténue qui termine ,1e mot précédent en la moyenne correspondante. Dans quelques racines ^ h permute avec dont il paraît être sôrli. Il n’est donc pas possible que la prononciation de cette aspirée ait été, au temps où le sanscrit était parlé, celle d’un h dur, quoique, à ce qu’il semble, on prononcé de cette façon dans le Bengale. Je désigne cette lettre dans ma transcription par k et la regarde comme un x prononcé plus mollement. Sous le rapport étymologique elle répond en général au X en grec, à un h ou à un g en latin (S 16), et à un g* en ger-
manique (S 87 1). Comparez, par exemple, avec kansd-s «oie», le grec yrfv, l’allemand gans; avec himâ-m «neige», hâîmantd-m «hiver», le grec xtév, xs*(m9 fl^nis; avec
vdhâmix.je transporte», le latin veho, le grec e^&>, oyos, la racine gothique vag « mouvoir » (viga, vag, vêgum) ; avec lêhni (racine lih) «je lèche», le grec le latin lingo, le gothique laigô,
ce dernier identique pour la forme au causatif sanscrit lêlidyânu. Dans hrd (de hard) «cœur» le h paraît tenir la place d’une ancienne ténue qui s’est conservée dans le latin cm/-, cordis, le grec xéap, xrjp, xapSta, et que laissent supposer le gothique hairtô (thème kairtan) et l’allemand herz.
Quelquefois le h est le débris d’une lettre aspirée autre que le g, de laquelle il ne reste que l’aspiration : par exemple dans han «tuer» (comparez nidtina-s «mort») pour dhn, en grec 6av, iSoLvov^ dans la désinence de l’impératif hi pour dï (dï ne s’est conservé dans le sanscrit ordinaire qu’après des consonnes); dans grah «prendre», pour lequel on trouve dans le dialecte des Védas grafif en slave grabljuh «je prends», en albanais grabît60 «je pille»; dans la terminaison hyam, en latin hi, de mâhÿam «à moi», mi-hi, qu’on peut comparer a la forme pleine Byam, en latin bi (S 16), de tuByam «à toi»,h’fo.
A la fin des mots et à l’intérieur devant les consonnes fortes, h est soumis en sanscrit aux mêmes changements que les aütres aspirées, et devient, suivant des lois déterminées, ou bien t, d, ou bien h, g.
S 24. Tableau des lettres sanscrites. ,
Nous donnons ici le tableau des lettres sanscrites avec leur transcription.
VOYELLES.
^1 «, ^TT «; T*. V; ^ m, ^ïr* ^£ r> ^/;
Hc, ^é*; ^fto, «fit.
ANOUSVARA, ANOUNASIKA ET VTSARGA.
' n, w n, î li.
CONSONNES.
Gutturales____^ k> U, H g, ^T & ^ »■>'
Palatales.....^ c, ^ c, ^ g, ^ g, ^ n;
Cérébrales. ... ^ f, Z \> ^ 4> £ $> W »;
Dentales...... HT f, ^ t, ^ d, ^ d% ^ 11 ;
Labiales...... T( p} TR ft, ^ h, H ti, îî m;
Semi-voyelles. . Tf y, ^ r/ff '/,’ t>;
Sifflantes et h.. Tij s, ^ è, If s, ^ fc.
Les lettres indiquées dans ce tableau pour les voyelles ne s’emploient que quand elles forment à elles seules une syllabe, ce qui n’arrive guère en sanscrit qu’au commencement des mots, mais ce qui a lieu très-fréquemment en prâcrit, soit au commencement, soit au milieu, soit à la fin. Dans les syllabes qui commencent par une ou plusieurs consonnes et qui finissent par une voyelle, on n’écrit pas l’a bref; cet a est contenu dans chaque consonne, à moins qu’elle ne soit marquée du signe du repos (^), qu’elle ne soit suivie dans la prononciation de quelque autre voyelle, ou qu’elle ne soit unie graphiquement avec une ou plusieurs consonnes. ^ se lit donc ha, et la simple lettre h s’écrit pour 'SïT â, on met simplement T; exemple : hâ.
^ i et sont désignés par f~, ; le premier de ces deux signes
est placé avant la consonne qu’il suit dans la prononciation; exemples : fÏR ki, jft ht Pour ^3 u , ^3ï û, ^ r, ^ r, ^ l, on place au-dessous des consonnes les signes ^ ^ ^ exemple : ^ hu>
r
I) 1
^kû, kr, kr, ^kl. Pour ê et tj; âi Ton place ^ et ^ au-dessus des consonnes ; exemples : % kê, §ï kâi. On écrit ô et en laissant de côté le signe ^r, exemples : kô, wt kâu.
Quand une consonne n’est pas suivie d’une voyelle, au lieu d’en tracer la représentation complète et de la marquer du signe du repos, on se contente d’en écrire là partie essentielle qu’on unit à la consonne suivante; on écrit, par exemple, ?, Z, au lieu de comme dans üPÇEf matsya, au lieu de
Au lieu de v-\> on écrit et pour ^on écrit ^
$ 95. Division des lettres sanscrites en sourdes et sonores,
fortes et faibles.
Les lettres sanscrites se divisent en sourdes et sonores. On appelle sourdes toutes les ténues avec leurs aspirées correspondantes, c’est-à-dire dans le tableau ci-dessus les deux premières lettres des cinq premières lignes; en outre, les trois sifflantes. On appelle sonores les moyennes avec leurs aspirées, le g h, les nasales, les semi-voyelles et toutes les voyelles.
Une autre division, qui nous parait utile, est celle des consonnes en fortes et en faibles; par faibles, nous entendons les nasales et les semi-voyelles; par fortes> toutes les autres consonnes. Les consonnes faibles et les voyelles n’exercent, comme lettres initiales d’une flexion ou d’un suffixe formatif, aucune influence sur la lettre finale de la racine, au lieu que cette lettre finale subit l’influence d’une consonne forte venant après elle.
LE GOÜNA.
§ 96, 1. Du gouna et du vriddhi en sanscrit.
Les voyelles sanscrites sont susceptibles d’une double gradation, dont il est fait un usage fréquent dans la formation des mois et le développement des formes grammaticales; le premier degré de gradation est appelé guna (c’est-à-dire, entre autres sens, vertu), et le second vrddî1 (c’est-à-dire accroissement). Les grammaires sanscrites de mes prédécesseurs ne donnent aucun renseignement sur la nature de ces changements des voyelles : elles se contentent d’en marquer les effets. C’est en rédigeant la critique de la Grammaire allemande de Grirnm2 que j’ai aperçu pour la première fois la vraie nature de ces gradations, le caractère qui les distingue l’une de l’autre, les lois qui exigent ou occasionnent le gouna, ainsi que sa présence en grec et dans les langues germaniques, surtout en gothique.
Il y a gouna quand un a bref, vriddhi quand un « long est inséré devant une voyelle; dans les deux cas, Va se fond avec la voyelle, d’après des lois euphoniques déterminées, et forme avec elle une diphthongue. \ i et ^ î se fondent avec la du gouna pour former un ê, ^ u et ^3î û, pour former un ^ â. Mais ces diphthongues, quand elles sont placées devant les voyelles, se résolvent à leur tour en W^ay et en av.
<*r est pour les grammairiens indiens le gouna et âr le vriddhi de et de mais en réalité, ar est la forme complète et r la forme mutilée des racines qui présentent tour à tour ces deux formes. Il est naturel, en effet, que, dans les cas ou les racines aiment à montrer un renforcement, ce soit la forme complète qui paraisse, et que ce soit la forme mutilée là où les Racines capables de prendre le gouna s’en abstiennent. Le rapport de1 biHdrmi «je porte » a Infirmas «nous portons » repose donc au fond sur le même principe que celui de vêdmi (formé
1 Nous écrivons vriddhi et gouna et non vrddî, guna, comme nous devrions le faire d'après le mode de; transcription que nous avons adopté, parce que ce sont des termes déjà consacrés par l'usage; il en est de même pour le mot sanscrit que nous devrions écrire sanslcrl, le mot zend qu'il faudrait, d’après le même système, écrire $md,ièl quelques autres mots qui sont devenus des termes lectiniques.
2 Àmiales berlinoises, 1897,1». ctsuiv. Vocalisme, p. (i et sniv.
de vaidmi) «je sais» à vidmds «nous savons». Il n’y a qu’une seule différence : tandis que dans le dernier exemple le verbe présente au singulier la forme renforcée, au pluriel la forme pure, dans le premier exemple, le verbe montre au singulier la forme pleine, mais primitive, correspondant au gothique bar et au grec <pep, et au pluriel biUrmds la forme mutilée, ayant supprimé la voyelle du radical et vocalisé le r. C’est encore sur le même principe que repose, entre autres, le rapport de l’irrégulier vdsmi «je veux» avec le pluriel usmds; us'mds a perdu la voyelle radicale de la même façon que bibrmâs, et a de même vocalisé la semi-voyelle. Il sera question plus loin de la loi qui détermine, dans certaines classes de verbes, cette double série de formes : formes susceptibles du gouna ou non; ou bien, ce (jui, selon moi, tient à la même cause, formes pleines et formes mutilées.
S *26, :î. Le gouna en grec.
En grec, dans les racines où des formes frappées du gouna alternent avec les formes pures, la voyelle du gouna est s ou 0; on sait (§ 3) que ces deux voyelles remplacent ordinairement en grec Va sanscrit. E7p< et sont donc entre eux dans le même rapport qu’en sanscrit êmi (de aîmi) «je vais» avec imâs; Xe/nw (de XsUto) est à son aoriste ’éknsov ce que le présent du verbe sanscrit correspondant rêcâmi (de raikâmi) est à driéam. La forme ot apparaît au parfait comme gouna de l’i ; Xéùotna = sanscrit riréca. Le verbe aida conserve partout la voyelle du gouna qui est ici a : répond à la racine sanscrite ind '
«allumer»; l$ctp6$ et iOaiva (d’où vient itxlvw) appartiennent à la même racine; mais la grammaire grecque réduite à ses seules ressources n’aurait pu démontrer leur parenté avec ctïÔw.
1 Ou mieux idle n sert à marquer la classe du verbe et c’est par abus qu’il s’est introduîl. dans d’autres temps qn^ les temps 8péciaux (§ /loq 3). ■
Devant v, dans les verbes susceptibles de^J^una, on trouve seulement e; la gradation de v à eu est donc parafeole à celle qui a lieu en sanscrit de u à o = au : '&sv6o[ioit (de la racine tsvB, sanscrit «savoir») est avec son parfait 'sféirver^ott dans le même rapport que le sanscrit boiê (moyen, formé de baüd'ê) avec Imbutfê'. La relation de (peuycv à ëÇvyov est pareille à celle des présents sanscrits comme bodami aux aoristes comme dbudam. Un gouna oublié en quelque sorte et devenu permanent, consistant dans la placé devant Yv, est renfermé dans avco «je sèche»; en effet, ce verbe, qui a perdu à l’intérieur un er, est parent, selon toute apparence, du sanscrit âsâmi (de aûêâmi) «je brûle» (de la racine us, anciennement us, en latin uro, ustum). Le grec considère comme radicale la diphthongue au dans aû&>, parce que nulle part on ne voit la racine sans la gradation; d’autre part, le latin ne reconnaît plus'le rapport qui existe entre le substantif aurum «i’or» considéré comme «ce qui est brillant», et le verbe uro, parce que le gouna est rare dans cette langue et que le verbe urere a perdu sa signification de «briller »!, quoiqu’elle apparaisse encore dans le mot aurôra, qui a également le gouna et qui correspond, entre autres, quant à là racine, au lithuanien auêra «aurore».
Un exemple isolé de IV frappé du gouna est en latin le mot fœdus (de foidus), qui vient de la racine fid signifiant «lier» (S 5), et auquel font pendant en sanscrit les thèmes neutres comnje tf^jfa$(de taïgas) «éclat» (racine tig).
S a6, 3. Le gouna dans les langues germaniques.
Dans les langues germaniques, le gouna joue un grand rôle, aussi bien dans la conjugaison que dans la déclinaison. Mais, en ce qui concerne le gouna des verbes, il faut renoncer à l’idee
1 Les idées de «briller, éclairer, briller» sont renfermées fréquemment en sanscrit dans une seule et même racine.
généralement adoptée que la vraie voyelle radicale se trouve au présent et que les voyelles qui se distinguent de celle du présent sont dues à l’apophonie. Pour prendre un exemple, il ne faut pas admettre que Yai du gothique bait (and-baù), et Yei du vieux haut-allemand beiz «je mordis, il mordit », proviennent par apophonie du gothique <»(=!,§ 70) et du vieux haut-allemand î du présent beita (and-beita) et bîzu. Je reconnais, au contraire, la-voyelle radicale pure, pour ce verbe comme pour tous ceux que Grimm a classés dans sa huitième conjugaison forte, au pluriel et, pour le gothique, au duel du prétérit indicatif, ainsi que dans tout le subjonctif du prétérit et au participe passif. Dans le cas présent, je regarde comme renfermant la voyelle radicale les formes bit-um, vieux haut-allemand biz-umês «nous mordîmes»; bit-jau, vieux haut^allemand bizr-i «que je mordisse». Le vrai signe distinctif du temps, c’est-^-dire le redoublement, a disparu. Comparez bitum, bizumês avec le sanscrit bibid- i-md «nous fendîmes » ; et, au contraire, bait, beiz «je mordis, il mordit» avec le sanscrit bibê’da (de bib'alda) «je fendis, il fendit».
La 9* conjugaison de Grimm montre la voyelle radicale pure à la meme place que la 8e, seulement c’est un u au lieu d’un i. Par exemple Vu du gothique bug-u-m «nous pliâmes », correspond à l’« sanscrit de bu-Bug-i-mà? et la forme du singulier frappée du gouna baug «je pliai, il plia», s’accorde avec Yâ sanscrit de bu-Bôga. Il n’y a qu’une différence : le gothique baug, ainsi que bait, nous représente un étqt plus ancien de la langue que la forme sanscrite, en ce sens que baug n’a pas opéré la contraction de au en ô, ni bait celle de ai en ê61.
S 96, h. Le gouna dans la déclinaison gothique.
La déclinaison gothique nous fournit des exemples de a employé comme gouna : i° dans les génitifs comme sunau-s «du fils», en sanscrit sûnô'-s; â° dans les datifs comme sunau (sans désinence casuelle), en sanscrit sûndv~ê; 3° dans les vocatifs comme sunau, en sanscrit sunô. De même, pour les thèmes féminins en i, dans les génitifs commega-mundai-s*de la mémoire;?, et dans les datifs comme ga-mundai, comparés aux génitifs et datifs sanscrits, comme matê-s, matdy-ê, venant du thème matl «raison, opinion », de la racine man « penser ».
S 96, 5. Le gouna en lithuanien.
La gradation du gouna se retrouve aussi en lithuanien; mais dans la conjugaison le gouna a ordinairement fait disparaître la voyelle radicale, ou le rapport qui existe entre les formes frappées du gouna et celles qui sont restées pures n’est plus clairement perçu par la langue. Gomme gouna de iï nous trouvons ei ou ai; le premier, par exemple,dans eimi «je vais» = sanscrit êrn (contracté de aimi), grec elfit; mais ei persiste dans le pluriel ei-me «nous allons», contrairement à ce que nous voyons dans le sanscrit i-mâs et le grec ï-fiss* La racine sanscrite nid «savoir» (peut-être cette racine signifiait-elle aussi dans le principe «voir»), d’où vient vê’dmi «je sais », pluriel vid-mds, a bien formé en lithuanien le substantif pa-wizd-is «modèle», qui conserve la voyelle pure; mais le verbe montre partout la forme frappée du gouna weizd (wéizdmi «je vois»); de même aussi le substantil pd-weizdis qui a le même sens que pd-wizdis. On retrouve la diphthongue ai, plus rapprochée de la forme sanscrite que ci, dans uzr-waizdas «surveillant», et dans le causatif waidinô-s «je me fais voir», dont le thème peut être rapproché du gothique vmt «je sais» (pluriel viium). Dans le causatif lithuanien pa-ldaidtmi
«je séduis», ai représente le gouna d'un y radical (l'y lithuanien = î) qui se trouve dans pa-klys-tu (s pour d, § 10a) «je m'égare». Il en est de même de Y ai de atgaiwinù «je récrée» (proprement «je fais vivre»; comparez le sanscrit gîvâmi «je vis»); nous trouvons, au contraire, le y (= î) dans gywa-s «vivant», 0-wénu «je vis» h
Au comme gouna de l'w ne parait que dans le causatif grâu-ju «je démolis» (proprement «je fais tomber»), de grûw-ù62 63 64 «je tombe». En outre, on le trouve dans tous les génitifs et vocatifs singuliers des thèmes en u, d’accord en cela avec les formes sanscrites et gothiques correspondantes; exemples : sûnaà-s «du fils», sûnau «ô fils!» = sanscritsûno-s, siïnô, gothique sumu-s, sunau.
. S 96, 6. Le gouna en ancien slave.
De même qu’en sanscrit nous avons la diphthongue ô (contraction pour au), qui se résout en av devant les voyelles, nous trouvons en ancien slave ce ov, par exemple dans cxinokh sünov-i « au fils », qu’on peut comparer au sanscrit $ûnâv~ê. Au contraire, csrnoy sünu, qui a le même sens, correspond, en ce qui concerne l’absence de flexion casuelle, au gothique sunau. Nous y reviendrons.
De même qu'en sanscrit nous avons la diphthongue ê (contraction de ai), qui se résout en ay devant les voyelles, par exemple, dans le thème Bay-â «peur», venant de la racine Bî, de même nous trouvons en ancien slave oj dans eomth ca boja-ti-san «s’effrayer». Il est difficile de décider si lej du lithuanien bijau «je m’effraye», est sorti d’un i radical, à peu près
comme le y sanscrit (=j) de formes comme bîy-am «timorem », biy-ds k timoris », venant du thème bî; ou bien si IV de bij-aü est un affaiblissement de ïa voyelle a exprimant le gouna, en sorte que ij correspondrait au slave oj et au sanscrit ay. La deuxième opinion me paraît plus vraisemblable, parce que le gouna s’est parfaitement conservé dans bdi-mê' «peur», hai-daù «j’effraye», et baj-ùs «effrayant», sans que toutefois la langue se doute encore que bi soit la véritable racine.
§ 97. De IV gouna dans les langues germaniques.
U est impossible de ne pas reconnaître qu’outre la voyelle a, dont nous avons parlé plus haut, la voyelle ijoue aussi dans les langues germaniques le rôle du gouna : je vois dans cet i un ancien a affaibli/d’après le même principe qui fait qu’un a radical devient souvent un i. De même, par exemple, que l’a de la racine sanscrite band* « lier » ne s’est conservé dans le verbe gothique correspondant qu’aux formes monosyllabiques du prétérit, et s’est affaibli en i au présent qui est nécessairement polysyllabique (binda «je lie», à côté de band «je liai»), de même Ya marquant le gouna dans baug «je pliai», est devenu i au présent biuga65. C’est en vertu d’un principe analogue que Y a du gothique sunau «filio», est remplacé par un i dans le vieux haut-allemand suniu. Déjà dans la déclinaison gothique des thèmes en u, on voit un i tenir lieu au nominatif pluriel de Ya gouna sanscrit : cet i est toutefois devenu un./ à cause de la voyelle suivante. Ainsi s’explique, selon moi, de la façon la plus satisfaisante la relation du gothique sunju de srnju-s « fils » (nominatif pluriel), avec le sanscrit sûudv de dndv-as. Dans les génitifs gothiques comme sunivê (de sunav-i) «filiorum », l'i est également l’expression du gouna, quoique le sanscrit, au génitif pluriel, ne frappe pas du gouna la voyelle finale du thème, mais l’allonge et ajoute un n euphonique entre le thème et la terminaisonjsdmt-ji-ém).
Dans les verbes qui renferment un i radical et dans les thèmes nominaux terminés en i, l’i gouna germanique sc confond avec cette voyelle i pour former un î long, qui, en gothique, est exprime pai ei (S 7(>)' exemples : la racine gothique bit, vieux haut-allemand bk, fait au présent beita, bku «je mords», à côté du prétérit bait, beiz (pluriel bitum, bkumês), et des présents sanscrits comme tvés-â-mi (de tvaié-â-mi) «je brille», de la racine tms; de même nous avons le gothique gastei-s (=gasti-s, formé de gastu-a pour gastm-s) «hôtes», comme analogue des formes sanscrites dvay-us «brebis» (latin.orê-s formé de avais). En ce qui concerne es verbes, il est important d ajouter l’observation suivante : ceux des verbes germaniques dont la vraie voyelle radicale, suivant ma théoiie, est u ou i, ainsi que tous les verbes germaniques à forme forte, à très-peu d’exceptions près, se réfèrent à la classe e a conjugaison saiiscrite qui frappe du gouna, dans les temps spécraux, un « ou un i radical, à moins qu’il ne soit suivi de deux consonnes; par exemple : le gothique bimla «j’offre» (ra-cmebud), répond au sanscrit bôdlimi, «je sais» (contracté de baudam, causatif bùddyâmi «je fais savoir»), tandis que le pré-tént baulh (par euphonie pour baud) répond à bubA'dh, et le pluriel du prétérit bitdum à btihud-i-md.
\ ,
S 28. Du gouna et de la voyelle radicale dans les dérivés germaniques.
Nous allons parler d un fait qui vient à l’appui de la théorie precedente sur le gouna. Parmi les substantifs et les adjectifs qui tiennent à des verbes à voyelle changeante, un certain nombre a pour voyelle du thème celle que précédemment j’ai montrée être la vraie voyelle de la racine, au lieu que le présent des verbes en question renferme une voyelle frappée de IV gouna ou affaiblie de a en u A côté des verbes driusa «je tombe» (prétérit draus, pluriel drusunij,fra-liusa «je perds » {-bus, -ïusum), ur-reisa (=ur-rîsa de ur-ritsa) «je me lève », (ur-rais, ur-rîsum), vrika «je poursuis » (vrak, vrêkum), nous trouvons les substantifs drus « chute », fra-lus-ts «perte », ur-ris-ts « résurrection », vrakja « poursuite », qu’il n’est pas possible de faire dériver du prétérit ; encore faudrait-il supposer que les trois premiers viennent du pluriel, le quatrième du singulier. Nous dirons la même chose des substantifs et des adjectifs frappés de Va gouna ou ayant un a affaibli en u : il n’est pas possible de les faire dériver d’une forme du prétérit tantôt fortifiée tantôt affaiblie ; on ne peut, par exem pie , faire venir bus (thème lausa) d’un singulier bus qui ne se trouve nulle part comme forme simple; staiga «montée» de staig «je montai», all-brun-s-ts «holocauste», de brunnum «nous brûlâmes», ou de brunnjau «que je brûlasse». Il y aurait tout aussi peu de raison à faire dériver en sanscrit Üê'da-s «fente», de
«je fendis, il fendit »; krô'da-s (contracté de kraûia-s) «colère», de cukroda «iratus sum, iratus est», et, d’autre part, (hdd « fente », de bifad-i-md «nous fendîmes» (présent binddmi, pluriel Bindmds), et krudax. colère », de vukrud-Mnd « irati sumus » (présent krô'i-â-mï). En grec nous avons Aofnés, par exemple, qui a le gouna comme : ce n’est pas une raison pour
l’en faire dériver. Pour <j1oÏ%o$ nous n’avons pas une forme analogue du verbe primitif; mais, en ce qui concerne la racine et le gouna, il correspond au gothique staiga (racine stig) que nous venons de citer; la racine sanscrite est stig «ascendere», qui a laissé aussi des rejetons en lithuanien, en slave et en celtique66*
$ i>9- Du vriddhi.
La gradation sanscrite du vriddhi (S ah) donne ^ ai, et devant les voyelles, V^ày, lorsqu’elle affecte i, î, ê (= at); elle produit ^ âu, et devant les voyelles lorsqu’elle affecte
u, û, ô (= au); quand ou plutôt sa forme primitive ar, est marqué du vriddhi, il devient ar; a devient a. Cette gradation n’a lieu que pour les racines qui se terminent par une voyelle, et pour certaines classes de substantifs et d’adjectifs dérivés qui marquent du vriddhi la voyelle de la première syllabe du thème, par exemple : yâuvand-m «jeunesse », de yüvan «jeune » (thème); hâimd-s «d’or», de hêmà-m, contraction pour haimd-m, «or»; râgatâs «d’argent», de ragatd~m «argent».
Les racines susceptibles du vriddhi le prennent entre autres au causatif ; exemples : érâv-dyâ-mi, par euphonie pour srâu-dyâ-mi) «je fais entendre», de sru; nây-dyâ-mi «je fais conduire, de nî. Les langues de l’Europe ont très-peu de part à cette sorte de gradation ; toutefois il est fort probable qu’à srâv-âyâ-mi se rapportent le latin dâmo, venant de clâvo (§20) et le grec xXâco «pleurer» : ce dernier verbe montre particulièrement par son futur xXava-ofiat qu’il est une altération de xXâ-Tco, comme plus haut (§4) nous avons vu dans vdôs, équivalent du sanscrit nâvds, une altération de 1>âF6s. Quant à Tf de la forme *W<w, on peut le rapprocher du y sanscrit dans srâvd-yâmi, en sorte que xXotta se présente comme une forme mutilée pour xXaFjo). '
En lithuanien, comme exemple de vriddhi, il faut citer élo-vuiju (—« w) et je vante» (comparez «Ximis, sanscrit vi-sru-ta-s «célèbre»); en ancien slave, entre autres, siava «gloire», car il faut remarquer que l’a slave, quoique bref, se rapporte ordinairement à un 4 long sanscrit.
ALPHABET ZEND.
S 3o. Les voyelles * a, g ë, m «.
Nous allons nous occuper de l’écriture zende, qui va, comme l’écriture sémitique, de la droite à la gauche. Un progrès notable dans l’intelligence de ce système graphique est dû à Rask, qui a donné à la langue zende un aspect plus naturel et plus conforme au sanscrit ; en suivant la prononciation d’Anquetii, on confondait, surtout en ce qui concerne les voyelles, beaucoup d’éléments hétérogènes. Nous nous conformerons à l’ordre de l’alphabet sanscrit, et nous indiquerons comment chaque lettre de cet alphabet est représentée en zend.
Le a bref sanscrit est doublement représenté : i° par «, qu’Anquetil prononce a ou e, mais qui, ainsi que l’a reconnu Rask, doit toujours être prononcé a; 20 par g, que Rask compare à Yœ bref danois, à la bref allemand dans hànde, ou à Ve français dans après. Je regarde ce g comme la voyelle la plus brève, et le transcris par ë. Cette voyelle est souvent insérée entre deux consonnes qui se suivent immédiatement en sanscrit; exemples : dâdarëéa (prétérit redoublé), pour le sanscrit dadârsa «je vis» ou «il vit», ^3 dadëmahî «nous
donnons », pour la forme védique dadmdsi. On fait suivre
aussi de cet e bref le r final sanscrit; exemples : an-
tarë « en tre », dâtarë « créateur », g)*»»^ hvarë « soleil »,
pour les formes sanscrites correspondantes antàr, datar, svàr «ciel». Il faut encore remarquer que toujours devant un $ m et un | n final, et souvent devant un ^ n médial non suivi de voyelle, le a sanscrit devient g ë. Comparez, par exemple, putrë~w «filium» avec putra-m; jggy^» anh-ën «ils
étaient» avec â'san, >Va»; hënt-ëm «étant» avec
sdnt-am, prœ-sentem, ab-sentem.
80 SYSTÈME PHONIQUE ET GRAPHIQUE.
Va long («) est écrit m.
S 3i. La voyelle ^ ë.
Anquetil ne mentionne pas dans son alphabet une lettre qui diffère peu par la forme du j ë dont nous venons de parler, mais qui dans l’usage s’en distingue nettement : c’est la lettre à laquelle Rask donne la prononciation de Yœ long danois. En pârsi, elle désigne toujours Ye long1, et nous pouvons sûrement lui attribuer la même prononciation en zend. Je la transcris par un ë pour la distinguer de la sorte de $ ë et de # ê. Nous la rencontrons surtout dans la diphthongue ^ ëu (prononcez éou), l’un des sons qui représentent en zend le sanscrit â (contraction pour au), notamment devant un ^ s final; exemple : pasëus — sanscrit pasos, génitif du thème xrçj pasu «ani
mal»; quelquefois on trouve aussi la même diphthongue ëu devant un y d final, à l’ablatif des thèmes en u. Ceci ne nous empêche pas d’admettre que le ^ ë dans cette combinaison représente un e long; nous voyons, en effet, le premier élément de la diphthongue sanscrite ê — ai représenté souvent en zend par une voyelle évidemment longue, à savoir ^ ô. On rencontre encore fréquemment ^ dans les datifs féminins des thèmes en i, où je regarde la terminaison ëê comme une contraction de ayê, en sorte que le ^ contient l’a de ayê avec la semi-voyelle suivante vocalisée en *2.
Une certaine partie du Yaçna est écrite dans un dialecte particulier," qui s’écarte dp zend ordinaire en plusieurs points : on y trouve le ^ tenant la place d’un â sanscrit; on peut comparer ce ^ ë à rrj grec et à Yê latin, la où ce dernier tient la place d’un â primitif (§5). On trouve notamment ce ^ représentant un â devant une nasale finale (n et m) au potentiel du verbe
1 Voyez Spiegel, Grammaire pârsie , p. aa et suiv.
2 Comparez ies formes prAcrites comme cinlémi pour cintâyâmi.
substantif: jyëm, en sanscrit syâm « que je sois» (S 35),
en grec eïtjv (formé de èainv'), en latin stem (pour siêm, dans Plaute); l^j** f'f1Fn «qu’ils soient», en sanscrit syus (venant de syânt). Au contraire, dans qyâd «qu’il soit», qyâmâ «que nous soyons», qyâtâ «que vous soyez», Va primitif du sanscrit syât, syâma, syâta s’est conservé.
On trouve ç dans la déclinaison des thèmes en as (en sanscrit d) devant les désinences casuelles commençant par un b; exemple : manëbîs (instrumental pluriel) pour le sans
crit mdnâBis. On peut expliquer ce fait en admettant que l’« de la diphthongue au (forme primitive de d) s’est allongé en e long pour remplacer Yu qui s’est perdu ’. C’est par le même principe que s’expliqué le ç e qui parait quelquefois à la fin des mots monosyllabiques, comme yÇ_ yë «qui», ^ Ae «qui?», et dans les formes surabondantes des génitif et datif pluriels des pronoms de la ire et de la 9 e personne (ire personne në, 9e personne
vë) : les formes ordinaires sont %/Ç yo (venant de yas) ^ kâ (de kasj, etc. (S 56). Comparez à ces formes en ç le ê qui remplace la désinence ordinaire â au nominatif singulier des thèmes masculins en a, dans le dialecte mâgadha du prâcrit2.
S 3a. Les sons 4 i, ^ *.» > u, ^ ûj, 0, ^ 6, ç*» do.
f bref et i long, ainsi que u bref et u long, sont représentés par des lettres spéciales, 4 i, 4 î, > u, q û. Ànquetil donne toutefois à 4 i la prononciation de Te, et à > celle de Yo, tandis que, d’après Rask, c’est seulement L qui a la prononciation d’un 0 bref. En pârsi, l» 0 précédé d’un « a (L*) représente la diphthongue au (Spiegel, l c. p. 9 5), par exemple, dans =
1 On pourrait supposer aussi que IV de la diphthongue au s’est affaibli en i el que cet i s’est fondu avec IV pour former un ç e.
2 Voyez Lassen, Imtitutiones linguœ prâcriticœ, p. 39et Hœfer, De prâcnta dialecto, p. 199.
»• 6
JUÿ nautar. Le zend 1, de son côté, ne paraît jamais que précédé dun j» a1, et, en perse, c’est-à-dire dans la langue des Achéménides, c’est toujours la diphthongue primitive au qui répond à la voyelle sanscrite ât provenant de la contraction de au (§ 2, remarque). Il ne m’est donc plus possible de sous
crire à l’opinion de Burnouf qui admettait que 1» aussi bien que correspondent, sous le rapport étymologique, à sanscrit; je crois plutôt que le zend a conservé au commencement et à l'intérieur des mots la prononciation primitive de la diphthongue ^ o. C’est seulement à la fin des mots que le zend a opéré la contraction en ^ 6, lequel ^ â toutefois est le plus souvent remplacé par ëu devant un s final, et quelquefois aussi devant un y d final (§ 31); or, cette diphthongue ëu se rapporte comme le grec eu à un temps où Wt à se prononçait encore au. 11 s’ensuit que les mots comme « force» (= sanscrit ôgas, devant
les lettres sonnantes ôgô), r!1 fit» ( = védique dkrnôt),
ipWg « il parle ?? (sanscrit âhravît pour âbrôt, racine brû) doivent se prononcer ausô, kërënaud? mraud. Comparez avec la désinence de kërënaud celle de l’ancien perse alimiam 67 68.
]» o se trouve, au contraire, quelquefois au milieu d’un mot comme transformation euphonique d’un a par l’influence dun v ou dun b précédent, notamment dans >4)*^ vâhu1 «bon, excellent;;, comme substantif neutre « richesse» (en sanscrit msu), et dans ubâyô «amborum», en sanscrit WSTl^ uBdyâs.
Peut-être aussi le de pâuru est-il issu de a par l’influence de la labiale qui précède. Sur Xu placé devant le r, voyez S 1x6. La forme sanscrite correspondante est purü, venant de paré.
La diphthongue produite par le vriddhi, est ordinaire
ment remplacée en zend par p» âo; quelquefois aussi par >ui âu} notamment dans le nominatif gâus « vache » = sanscrit
gâus.
33. Les diplilhongues 6i} ^et sh» ai.
A la diphthongue sanscrite n ê correspond en zend ^ qu’on écrit aussi, surtout a la fin des mots, jy. Nous le transcrivons par ê comme le TÇ sanscrit. Comme équivalent étymologique d’un T[ ê sanscrit, cette diphthongue ne paraît seule en zend qu’à la fin des mots, ou l’on trouve aussi 4^ éi, surtout après un y;
soit nécessairement la brève de )#. Il a pu se faire aussi qu’au moment où l’écriture a été fixee on ait ajoute à la lettre m, pour exprimer le son d, le signe diacritique qui ordinairement indique les longues. En généra], il faut se défier des conclusions qu on pourrait être tenté de tirer du développement de l’écriture pour éclairer la théorie de la prononciation. On voit, par exemple, en sanscrit que l’écriture déva-nagarî exprime la diphthongue Ai par le signe ê deux fois répété (au commencement des syllabes par le signe à la fin par ^). Cette notation provient évidemment de l’époque où ÇT et -■ se prononçaient encore comme ai, de sorte qu’on exprimait dans 1 écriture par ami la diphthongue dans laquelle un â long réuni a un i ne formait qu’un seul son.
Il faut admettre toutèfois qu’outre l’influence de la labiale il y a aussi celle de la voyelle contenue dans la syllabe suivante (u, d); nous voyons, en effet, que vôhu fait au comparatif vahyaé, au superlatif vahista et non vokyaê,vôhista. C’est le même principe qui fait qu un a se change en ê, quand la syllabe suivante contient un i, un f-, un ê ou un y (8 62 J.
A côté de la forme vôhu on a aussi vanhu (§ 568).
exemples : *\>/Ç yôi « lesquels », pour le sanscrit ifyê; maidyéi «dans le milieux, pour le sanscrit mâdyê»
il est de règle de mettre ^ pour le sanscrit ê devant un ^ s ou un f^Jl final; de là, par exemple : barôid pour le sanscrit Bârêt « qu’il porte » ; patôis « domini » pour le sanscrit patês ( à la fin des composés). Comparez avec patôis, en ce qui concerne la longue qui forme le premier élément de la diphthongue, les génitifs de l’ancien perse en msf venant des thèmes en i69 70. Dans le dialecte dont nous parlions plus haut (§ 3i), on trouve aussi, sans y qui précède et sans s ou d final, ôi pour un ê sanscrit; par exemple dans moi, toi, génitif et datif des pronoms de la i,c et de la 2epersonne, en sanscrit mêf tê; dans hôi «ejus, ei » (= étymologiquement sui, sibi), pour la forme (venant de svê), qui manque dans le sanscrit ordinaire, mais se trouve en prâcrit.
Au commencement et à l’intérieur des mots, remplace régulièrement le sanscrit TJ ê. Je renonce toutefois à l’opinion qui fait de la de cexji» une voyelle insérée devant la diphthongue sanscrite IJ ê; j’y vois l’a de la diphthongue primitive ai, de la même façon que dans l’a de (S 3s) je vois la de la diphthongue primitive au. Le groupe étant regardé comme l’équivalent de la diphthongue af2, on voit disparaître les formes barbares comme aêtaêsanm «horum», correspondant au sanscrit
muent au simple rativê. Il faut observer à ce propos que l’adjonction de ca préserve encore dans d’autres cas la terminaison du mot précédent et empêche, par exemple, l’altération de as en ô (S 56b) et la contraction de ayê en ^ ëê (S 31).
Il ne faut pas s étonner de voir la diphthongue ai se conserver intacte au commencement et à l’intérieur des mots, tandis quelle se contracte à la fin des mots en ê; pareille chose a lieu
dans le vieux haut-allemand; en effet, Y ai gothique s’y montre sous la forme ei dans les syllabes radicales, mais dans les syllabes qui suivent la racine, il se contracte en ê, lequel ê s’abrége s’il est final, au moins dans les mots polysyllabiques.
§34. Les gutturales $ k et jy U.
Examinons maintenant les consonnes rendes, et, pour suivre l’ordre sanscrit, commençons par les gutturales. Ce sont : 9 k, b , (j$_g, i.g’* La ténue ^ k paraît seulement devant les
voyelles et la semi-voyelle v; partout ailleurs, par l’influence de la lettre suivante, on trouve une aspirée à la place de la ténue du mot sanscrit correspondant. Nous reviendrons sur ce point.
La seconde lettre de cette classe U) correspond à l’aspirée sanscrite ^ dans les mots Uara «âne?? et haJii
k ami», en sanscrit Uara, saUi. Devant une liquide ou une sifflante, le zend remplace par un kh la ténue sanscrite * k; ce changement a pour cause l’influence aspirante que les liquides et les sifflantes exercent sur la consonne qui précède; exemples : Urus «crier», fôï«régner», uUécm
«bœuf»; en sanscrit Unis, ksi, uksân. Devant les suffixes commençant par un t, le k sanscrit se change, en zend, enU; exemple : ÀiÆft' «aspersion», en sanscrit fàrfw
sikti. De même, en persan, on ne trouve devant la lettre cy t que des aspirées au lieu de la ténue primitive; exemples : pukhien «cuire», de la racine sanscrite pac, venant de pak;
tâf-ten «allumer» de W{tap «brûler»; khuf-ten «dormir » de smp. Nous parlerons plus tard d’un fait analogue dans les langues germaniques.
S 35. La gutturale aspirée yu g'.
Dans la lettre ^, je reconnais avec Anquetil et Rask 71 une aspirée gutturale que je transcris par q, pour la distinguer de l’aspifée <jpU =. sanscrit U. Il n’est pas possible de déterminer
exactement comment on distinguait dans la prononciation les lettres et j*. Mais il est certain que jw^est une aspirée : ^ela ressort déjà de ce fait qu’en persan cette lettre est remplacée par £ ou js*. Si le ^ du groupe js* ne se fait plus sentir dans la prononciation, il ne s’ensuit pas qu’il n’ait pas eu dans le principe une valeur phonétique. Il est de même possible que le zend g^ait été prononcé primitivement Uv; en effet, sous le rapport étymologique, il correspond presque partout au groupe sanscrit dont la représentation régulière
en zend est hv (§ 53). Le rapport de g*^q a hv (abstraction faite du v que le ^ q a perdu) est donc à peu près le même que celui de l’allemand ch à h, sons qui ne se trouvent représentés en gothique que par une seule lettre, à savoir le h; exemple : waàte«nuit», aujourd’hui nacht. Quoi qu’il en soit, la parenté du zend gravée hv montre bien que jjj est une aspirée.
Un mot fréquemment employé, où cette lettre correspond étymologiquement au sanscrit sv, est j»^qa; ce mot est tantôt thème du pronom réfléchi, comme dans le composé ÿa-data « créé par soi-même » 2, tantôt adjectif possessif « suus », auquel
cas il s’écrit aussi km. Voici d’autres exemples de g^q pour le sanscrit sv : qanha «sœur», accusatif qanharëm = sanscrit svâsâ, svàsârani, persan khâher; qafna « sommeil » = sanscrit
svâpna « rêve » (comparez le persan vlr*- «sommeil»).
On trouve encore ^qt comme altération d’un s sanscrit devant un y; mais les exemples appartiennent au dialecte particulier dont nous avons déjà parlé (S 3); tels sont qyëm «que je sois», en sanscrit syâm; spëntaqyâ «sancli»,
qyâ étant la terminaison du génitif répondant au sanscrit sya. Ces formes et d’autres semblables sont importantes à noter, car le y étant du nombre des lettres qui changent en aspirée la muette qui les précède (S £7), la présence de p* _ devant y prouve bien que cette gutturale est une aspirée. On trouve aussi le prenant la place du dans l’écriture : ainsi, pour le mot spëntaqyâ que nous venons de citer, tous les manuscrits ont jy U au lieu de g^q, à l’exception du manuscrit lithographié 2.
La terminaison sya du génitif sanscrit est représentée ordinairement en zend par hê.
S 36. Les gutturales et
À la moyenne gutturale (*jJ et à son aspirée (^) répondent ^ g et ^g. Mais le ^g sanscrit a perdu quelquefois en zend l’aspiration : du moins *$()»Qgarënia « chaleur » correspond au sanscrit vtàgarmâ; d’un autre côtédans v$-
rëiragna «victorieux», représente le sanscrit k la fin des
composés* par exemple, dans satru-gna «hostium occisor». Le zend vërëtragna, ainsi que son synonyme vërëiragan signifient proprement «meurtrier de Vritra». Nous avons ici une preuve 72
de parenté entre la mythologie zende et la mythologie indienne; mais la signification de ce mot s’étant obscurcie en zend et les anciens mythes s’étant perdus, la langue seule reste dépositaire de cette preuve d’afiinité. «Meurtrier de Vritra ?? est l'un des titres d’honneur les plus usités du plus grand d’entre les dieux inférieurs, Indra, lequel a tiré son surnom de la défaite du démon Vritra, de la race des Dânavas.
Nous traiterons plus loin (§ 60 et stiiv.) des nasales.
S 37. Les palatales fu c et v-
Des palatales sanscrites le zend ne possède que la tenue c= et îa moyenne ^g = w. Les aspirées manquent, ce qui ne peut étonner pour^g, lequel est extrêmement rare, même en sanscrit. Pour venant de sk (S i4), le zend a ordinairement »s; du groupe sk, la sifflante s’est donc seule conservée: exemples : !)ërë$ «demander??, pour rt^prac; è^M»t»^gasaiü
«il va??, pour gdcati. Remarquez dans le dernier exemple, de même que dans la racine s^gam «aller??, pour le sanscrit yp^gam, l’altération de la gutturale primitive en g, ce qui ne doit pas surprendre, le sanscrit ^g étant également sorti partout d’un g primitif (§ 11\). Un autre exemple du zend g pour le sanscrit^gest la racine^Aig^gad «parler??, qui correspond a la racine sanscrite ^ gad. Pour le sanscrit ^g, on trouve aussi en zend^ s et «b s, le premier, par exemple, dans la racine san «engendrer??, en sanscrit ^gaw; le second dans >|feb sënu «genou??, pour le sanscrit gânu, et dans la racine snâ «savoir??, pour le sanscrit ^fT gââ. La prononciation, en zend, n’a conservé que la sifflante renfermée dans le g, lequel équivaut a dé ou à dst
Nous retournons à la lettre sanscrite pour remarquer que ce son, qui est sorti de sk, s’est conservé quelquefois en zend dans
sa forme primitive, par exemple, dans l’abstrait skënda,
si Burnouf1, comme il est très-probable, a raison de rapprocher ce mot, que Nériosengh traduit paraît Baiiiga « rupture, ouverture», de la racine «fendre» (S i A). Je lis, par consé
quent, dans les manuscrits et dans le texte lithographié skënda (et non skanda, comme Burnouf), attendu qu’un i primitif se change plus aisément en ë qu’en a73 74. Un autre mot dans lequel on trouve en zend ék, répondant probablement au ^c sanscrit, est yaéka («désir», suivant Anquetil), que Burnouf
(l c. p. 33s) rapporte à la racine sanscrite is «désirer». En ce qui concerne la première syllabe, on peut y voir un gouna retourné (yaéka pour aiska), ou bien Ton peut supposer que la forme sanscrite is, ic (venant de isk, isk) a subi une contraction de y a en i, comme dans istâ, participe parfait passif de yaf> « sacrifier ». Quoi qu’il en soit, je crois qu’il faut regarder la forme secondaire comme la plus ancienne, car elle se place naturellement à côté des formes suivantes : vieux haut-allemand eiscon «demander» (voyezGraff, I,p. Aq3), vieuxnorrois œskja, anglo-saxon æscjân, anglais to ask, lithuanien jêskôju «je cherche », russe iskatj «chercher», et celte (gaélique) aisk «requete»75.
S 38. Dentales. Les lettres p t et ^ t.
La troisième série de consonnes, renfermant les cérébrales ou
A
linguales (S i 5), manque en zend : nous passons donc immédiatement aux dentales. Ce sont p t
(^), ainsi qu’un d particulier au zend (^) dont nous parlerons plus bas. Au sujet de l’aspirée dure de cette classe, nous remarquerons, qu’elle ne peut se trouver après une sifflante, de sorte que le et le ’çj sanscrits sont remplacés, dans cette position, en zend, par le exemple : ?grT siâ «se tenir??, en zend stà; ^ ista, suffixe du superlatif, en zend ista. La lettre étant, suivant notre explication (§ î a), relativement récente, et ^ {n’étant qu’une altération de ^ t, il est naturel de supposer que la sifflante dure a préservé en zend la ténue et l’a empêchée de se changer en aspirée : c’est par une cause du même genre que dans les langues germaniques l’aspirée ne se substitue pas à la ténue quand celle-ci est précédée d’un s, d’un f ou d’un A(cà)1; ainsi le verbe gothique standa «je me tiens?? s»conservé le t, qui se trouve dans la même racine en zend, en grec, en latin et dans d’autres langues de l’Europe, ei le suffixe du superlatif gothique ista correspond exactement à Yista zend et au grec kt1o.
S 89. Les dentales^ d, et ^4.
^ est le d ordinaire (^),et(^ d’après la juste observation de Rask ,,en est l’aspirée (rf). Cette dernière lettre remplace le ^ sanscrit; par exemple, dans maidya «milieu?? (sanscrit
mâdya), et dans la terminaison de l’impératif ê^dî (f*ï) ; toutefois cette terminaison perd son aspiration après un^ s, ce s ne pouvant se joindre qu’à d, jamais à i; exemples : ^*3 dasdi
1
Voyez S 91.
« donne » (ie s est le substitut euphonique d’un d) et j<^***^ dâîdï, même sens. Au commencement des mots le (j^perdson aspiration; exemples : dâ «poser, placer, créer », en sanscrit da, en grec
3.# ; ^ dê « boire », en sanscrit Au contraire, le d sanscrit est fréquemment remplacé en zend par son aspirée, lorsqu il est placé entre deux voyelles ; exemples : pâda «pied», pour
tïT^ pàda; yêidi «si», pour yâdi. Quant a la lettre
- je la regarde avec Anquetil comme une moyenne : c’est en cette qualité que nous la rencontrons en pârsi, où elle tient ordinairement à la fin des mots, surtout après une voyelle, la place de la lettre persane a (Spiegel, p. 28) ; exemple : dad
«il donna» = Sous le rapport étymologique ^correspond le plus souvent au sanscrit ; ce t devient un ^ en zend a la fin des mots et devant les flexions casuelles commençant par unj b, de même qu’en sanscrit «J. £ devient un ^ d devant H B. Comme nous avons donc en sanscrit marüd-byâmf marud-bis, marud-byas du thème marüt, de même en zend nous avons anië-
rëtadbya (pour -tâdbya) du thème amëretat. Nous ren
controns « d tenant la place d’un d primitif dans la racine dbiê « haïr » (en sanscrit dm), d’où dérive tà^^/^»y^dba%éa^ haine » = sanscrit dvêsa. Le mot dJcaisa (nominatif dkaiéo)
fait exception en ce qu’un j» c?initial s’y trouve devant une tenue; il n’a pas d’analogue connu en sanscrit; Anquetil le traduit par «loi, examen, juge», et Burnouf (Yacna, p. 9) par «instruction, précepte», et le rapproche du persan ^jïjS'kes. Peut-etre le d est-il le reste d’une préposition, comme dans le sanscrit ad-Buta « merveilleux, merveille », dont la première syllabe est, selon moi, une corruption de ati^atibûta «ce qui dépasse la realite»). Si cette conjecture est fondée, j’incline a reconnaître dans dkaiéa la préposition sanscrite «</ï«sur, vers». Le changement du £en », à la fin des mots, s’expliquerait par cette hypothèse qu’en zend la dentale moyenne ou une modification de la dentale
moyenne est préférée à la ténue comme lettre finale. Nous voyons quelque chose d’approchant en latin, où la ténue primitive est souvent remplacée, à la fin des mots, par la moyenne, notamment dans les neutres pronominaux, comme, par exemple, id, quod> Ce dernier mot répond au zend kad «quoi?» pour lequel le dialecte védique a ^^kat. Le b de ab correspond à la ténue p, que nous retrouvons dans le sanscrit dpa et le grec ânô.
§ &o. Les labiales g p, è f>_j k
Les labiales comprennent les lettres gp, £ / i b, et la nasale de cette classe ($ m), dont nous parlerons plus loin, g p répond au J^p sanscrit et se change en ^ f quand il se trouve placé devant un ) r, un ^ s ou un { n, La préposition Tfpra (pro, «rpé) devient fra en zend, et les thèmes g* ap «eau», kërëp «corps» font, au nominatif, âfs, kërëfs; au
contraire, a l’accusatif, nous avons £ggj» âpëm, kërëpëm ou
këhrpëm. Comme exemple de l’influence aspirante exercée par le n sur le p, comparez tafau «brûlant» avec le verbe âtâpayêiti«il éclaire», et »\&»^qafna «sommeil» avec le sanscrit svâpna «rêve». Le f du génitif nafëirô, venant du thème naptar (accusatif naptarëm) «neveu» et «nombril»76, doit être expliqué autrement. Je crois que cette forme a été précédée par une autre plus ancienne, nafdrâ, et que l’aspirée / a été amenée par le voisinage de l’aspirée d\ de la même manière que le Ç> dans les formes grecques n;<p0eé?, enï(p9vv; en effet, le zend et le grec ont la même propension à rapprocher les aspirées. Il y a seulement cette différence que, dans nafdrâ, le d n’est pas plus primitif que le f; il est le substitut d’un ancien t (comparez le <fdu zend dugda « fille » = sanscrit duhitâ). Après que la voyelle de liaison ë eut été introduite dans naf-ë-dro, on
a conservé l’aspiration qui avait été produite dans le principe par le voisinage immédiat de la labiale et de la dentale; quelque chose d’analogue est arrivé dans kas-ë-twanm «quis te? ■» pour te' iwahm{$ A7). L’accusatif pluriel féminin hufëdrîs qu’An-quetil regarde comme un singulier et traduit par «heureuse?) (comparez en sanscrit sudadra «très-heureux?? ou «très-excellent??), me semble également une forme où le f était d’abord immédiatement lié au d'; ainsi hufëdrîs viendrait, par l’insertion, d’ailleurs très-fréquente, de g ë3 d’un ancien hufdrîs pour hubairîs. Gomme il n’y a pas parmi les labiales zendes d’aspirée sonore, elle a été remplacée, dans le mot hufdrîs, par la sourde f; au contraire, dans dugdh, nous avons deux aspirées sonores de suite. Toutefois, on trouve aussi, quoiqu’il y ait un g, le groupe Rc£; par exemple, dans puMda «le cinquième??.
Le remplaçant ordinaire du sanscrit est, en zend, lej h.
S 41. Les semi-voyelles. — Épenthèse de IV. .
Nous arrivons aux semi-voyelles, et, pour suivre l’ordre de l’alphabet sanscrit, nous devons commencer par le y; en zend comme en sanscrit, nous représentons par cette lettre le son du j allemand ou italien. Cette semi-voyelle s’écrit, au commencement des mots, pç ou x , au milieu, u, c’est-a-dire par deux 4 (1), de même qu’en vieux haut-allemand le ut? est marqué par deux u.
Par suite de la puissance d’assimilation du y, il arrive que, quand il est précédé d’une consonne simple, un i est adjoint a la voyelle de la syllabe précédente. La même influence euphonique sur la syllabe précédente est exercée par les voyelles 4 i3 ^ î et jq ê final. Les voyelles auxquelles, en vertu de cette loi d’assimilation, vient s’ajouter un i} sont : * a, g ët m a, > u, ^ u, xd at
(S 33), h* au(§ 3a). Il faut remarquer, en outre, que > uf quand un 4 i vient s’y ajouter, s’allonge à l’ordinaire. Exemples : havaiti
«il est» pour bavati; vërëidï «croissance, augmentation» pour vërëii, formé de vardî (§ i); miré «à l’homme» pour narê; da-daiti «il donne» pour dadati, sanscrit dâdâti (§ $9); atapayêiti «il éclaire» pour âtâpayêti (lequel lui-même est pour atapayati (§ Ô2); alibis «par ceux-ci» pour dçjjx)* aibis (sanscrit
êbis); kërënauiti pour kërenauti (védique krnô’ti,
formé de krnauti); stûidï «célèbre» (à 1 impératif) pour
studi (racine stu, sanscrit stu); fàrënûitê ^
* r p « • 1
(moyen) pour kërënuiê, védique krnutê) *$>*> uiti «ainsi», du thème démonstratif u, de même quen sanscrit nous avons itt «ainsi» de i; uuQivç maidya «milieu» pour le sanscrit madya; yâirya «annuel» de yârë (pur euphonie pour yar, § 3o); tûirya «quatrième» pour le sanscrit térya. L’influence régressive de i, î, é et y sur la syllabe précédente est arrêtée par un groupe de deux consonnes jointes ensemble, excepté nt, groupe qui tantôt l’arrête, tantôt ne l’arrête pas; exemples : asti «il est» et non aisti; t»n\^/C~yésnya «venerandus», et non yôisnya. Au contraire, on peut dire bavainti et bavanti « ils sont » pour le sanscrit Bâvanti. Quelques consonnes, notamment les gutturales, J compris h, les palatales, les sifflantes, ainsi que na et v, arrêtent l’influence de IV, même quand ces lettres sont seules. Au contraire, n laisse IV exercer son influence sur un a bref77, mais éon sur un a long; de là, par exemple, aini, ainê au locatif et au datif des thèmes en an, et ainî au nominatif-accusatif-vocatif duel du neutre {cdéniain-î «les deux yeux» de ctwnan); mais ani, à la ire personne du singulier de l’impératif actif, et anê, comme forme correspondante du*moyen. Il n’y a pas non plus de loi constante pour le b; mais d’ordinaire, il arrête l’épenthèse de IV (c’est ainsi qu’on appelle cette répétition de IV dans la syllabe
précédente); ainsi, devant les terminaisons bîs, byô, toutes les voyelles, même Va, repoussent IV1. Il n’y a que la diphthongue
ai, au datif-ablatif pluriel des thèmes en a, qui devienne W» aii par l’influence de IV de la terminaison byô; exemple : bwmW— yaiibyô « quibus », en sanscrit yê'iïyas.
La préposition sanscrite atiî devient aibi en zend; au contraire, dpi reste invariable (jg* api), à cause du p qui arrête Fépenthèse.
g A 2. Influence de y sur la de la syllabe suivante. — F et a changés
en voyelles.
La semi-voyelle y exerce aussi son influence euphonique sur un a ou un â placé après elle et change ces voyelles en jg ê, mais seulement dans le cas où la syllabe suivante contient un i, un î ou un ê; exemple : âvaidayêmi78 79 &j appelle»,
en sanscrit âvêddyâmi; au contraire, au pluriel, nous avons
âvailayâmakî; àyêiè ^je loue»
(moyen); au contraire, à la seconde personne de l’impératif, nous avons âyâsanuha80. Le theme wiasJçya fait, au
génitif singulier, maskyêkê (pour maskyahê), mais, au génitif pluriel, maskyânanm. A la fin des mots, les syllabes sanscrites ya et yâ se sont souvent changées, en zend, en & ê; exemples : X90* ^} terminaison du génitif correspondant au sanscritsya; £)g* aêm «celui-ci», vaêm «nous»81, en sans-
crit ayâm, vayâm; kainê « jeune filles, en sanscrit kanyâ.
D’accord avec Burnouf, j’admets qu’il y a dans ces mots une transposition de lettres : la semi-voyelle y, devenue i, s est placée après Va et a formé avec lui, par le même principe qu’en sanscrit, un ê: hê vient donc de liai, pour hay, qui est lui-même
pour hya1.
Devant un m final, la syllabe sanscrite ya s’est ordinairement contractée en ^ i, et pareillement ? va en 9 u ; c’est-à-dire que Ya étant supprimé, la semi-voyelle s’est changée en la voyelle correspondante allongée (comparez S 64); exemples . tûirîm « quartum », du thème tûirya, et fygjAb «tertmm
partem», de trisva.
§ 43, Y comme voyelle euphonique de liaison.
En sanscrit, y est inséré quelquefois comme liaison euphonique entre deux voyelles (voy. Abrégé de la grammaire sanscrite, § Utf), sans que pourtant ce fait se produise dans tous les cas qui pourraient y donner lieu. En zend, on trouve presque toujours un y inséré entre un u ou un û et un ê final; exemples : frastu-y-ê «je loue»2; mrû-y-ê «je dis», en sanscrit bruv-ê’(par euphonie pour brû-ê); du-y-ê «deux» (duel neutre), en sanscrit dvê, avec le v vocalisé en u; tanu-y-ê «au corps », du fémi-
S 33; c’est pour cela que je ne la transcris point par ai. Ici, en effet, au n’est pas nus pour le sanscrit ç (formé de ai), maisil tient lieu de deux syllabes distinctes en sanscrit. ■ ,
1 On trouve des faits analogues en priait. Ainsi les génitifs sanscrits en ayts (des
thèmes féminins en A) deviennent, en prâcrit, SI? AA, par suite de la suppression de s final; exemples : mêHT? "MM, en sanscrit m-mtrUi, tndMÿd», du thème mMA. Pour dévié = sanscrit dévy-M, il faut donc supposer une forme dêvî-y-âs, et,
pour bahûê = sanscrit vadx-th, une forme bakû-y-â, avec insertion d’un y
euphonique.
2 Fraétuyê ferait en sanscrit prastuv-ê, si ÇïT stu était usité au moyen. (Voyez
Abrégé de la grammaire sanscrite, S 53.) '
ALPHABET ZEND. $ 44-45. nin tanu; au contraire, ratu (masculin) « seigneur » fait au datif raiw-ê.
S 44. La semi-voyelle r.
Il a été dit déjà (S 3o) quun r, à la fin d’un mot, est toujours suivi d’un £ ë. Au milieu des mots, quand on ne joint pas à r un çy h (S 48), on évite ordinairement l’union de r avec les consonnes suivantes, soit en insérant un £ ë comme dans dâdarësa (sanscrit dadârsa «vidi, vidit»), soit en changeant la place de r, comme cela a lieu en sanscrit quand il est suivi de deux consonnes (Voyez Abrégé de la Grammaire sanscrite, S 34 à); exemples : âtrava « prêtres (nominatif),
accusatif âtravanem, du thème âtarvan, lequel
dans les cas faibles ( § î q 9 ) se contracte en ataurun(% 46) .
La langue zende souffre les groupes ry, »1> urv, s’ils sont suivis d’une voyelle, et ars à la fin des mots, ainsi qu au milieu devant p t; exemples : tûirya « le quatrième », J*»»%
urvan k âme », haurva « entier », jatars a feu » ( nominatif), nars « hominis », karsta a labouré»; mais
calrus a quatre fois», et non éaturs, parce que ici
rs n’est pas précédé d’un a.
S 45. Les semi-voyelles v et w.
Il est remarquable que l manque en zend comme r en chinois, tandis qu’on trouve l en persan, même dans des mots qui ne sont pas d’origine sémitique.
Pour le sanscrit le zend a trois lettres : j?, » et y/T Des deux premières, le Lp ne s’emploie qu’au commencement, le » quau 'lhîfiêfP,d^s mots, différence d’ailleurs toute graphique; exemples :
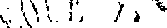
et non dtamm comme le thème véritable, lequel abrégé Va ^iti^hdèiris faibles. En ce qui concerne la contraction de van en un ^comparez
le sansçdt jeune», qui devient y un (pour yu-un) dans les cas les plus faibles.
vaèm ” fi o u s » = vayüïïi, tara «de toi » = tara.
^j/'que je transcris par w, se trouve surtout après un ^ t : jamais on ne rencontre » après cette lettre. Après on trouve l’un et Tautre, mais plus fréquemment le v. Il ne parait pas que soit employé après d’autres consonnes que ^ t et <^<f; mais il est placé fréquemment entre deux % ou entre un i et un y, et jamais on ne rencontre » v dans cette position ; exemples : driwis
« mendiant », daiwis « trompeur w (voyez Brockhaus,
Glossaire, s. v.), ^iwyâ, latin naquis». Je fais dériver ce
dernier mot du thème gj« apf le p étant supprimé1, et la terminaison (en sanscrit Byas) ayant amolli son b en w; quant à l’t, il s’est introduit dans la syllabe radicale en vertu de l’épen-thèse (S k 1). Il reste à mentionner une seule position où nous avons encore trouvé la semi-voyelle y/*w, a savoir devant un 1 r : le son plus mou du w convenait mieux dans cette position que le » v qui est plus dur. Le seul exemple est le féminin suwrâ «épée, poignard», que j’identifie avec le sanscrit
suBrâ, féminin subrâ «brillant»2.
__ Quant à la prononciation du iv, je crois, comme Burnou! paraît l’admettre aussi, quelle se rapproche de celle du w anglais. G’est aussi la prononciation du ^ sanscrit après les consonnes. Toutefois, Rask attribue inversement au g/Ma. prononciation du v anglais, et aux lettres et » celle du w.
$ U6. Épenthèse de Vu.
Quand un v ou un u sont précédés d’un r, un u vient se placer
' \
*
1 Comparez ïfyr uKru «nuage» pour STSiT ab-bra «aquam ferens», êt en zend
â-bërëta ( nominatif) «celui qui porte Veau».
* L’accusatif éuwranm se trouve dans Olshausen, p. i3, avec la variante
éufranm (cf. 8 ho). Nous avons, en outre, plusieurs fois l'instrumental "«W* uwrya, pour lequel il faut lire êwvraya, à moins d’admettre un thème
unn'î analogue au sanscrit sundan venant de sundara.
par épenthèse à côté de la voyelle de la syllabe précédente. Ce fait est analogue à celui dont nous parlions plus haut, en traitant de Tt (§ 4i). Exemples : »»)>»<& haurva «entier», de'harva, sanscrit sârva; cturvant «currens» (thème), nominatif
pluriel aurvantâ, au lieu de arvant, arvantâ (sanscrit ârvant, drvat «cheval»); pauurva «le premier», au lieu de paurva \
tauruna «jeune », sanscrit tdruna, ataurunô « sacer-
dotis », du thème âiarvan (§44), pour lequel on aurait, diaprés la loi phonique en question, âiaurvan82 83, s’il se rencontrait des exemples de cette forme.
$ h7. Aspiration produite en zend par le voisinage de certaines lettres.
Fait identique en allemand.
Les semi-voyelles y, w (non » ») et r, les nasales m, n ()) et les sifflantes, quand elles sont précédées d’une ténue ou bien de la moyenne gutturale, la changent en l’aspirée correspondante : 9 k, par exemple, devient <£> Zé, p t devient é L et P devient *)/, et devient ^g. Aux exemples cités, §§ 34 et 4o, j’ajoute ugra «terrible», sanscrit ugrâ; taUma84 «rapide, fort»; gagmusi, sanscritgagmûsî «celle quia marché» (racine gctifij*, patni «maîtresse», sanscrit pdtnî (grec 'sfÔTvtoi); mëreiyu «mort», sanscrit
mrtyû, venant demartyu. Si bitya «secundus» et trityn «tertius» ont devant le y une ténue au lieu d’une aspirée, cela tient peut-être à ce que le rapprochement du t et du y, dans ces deux mots, n’est pas régulier, car les formes sanscrites correspondantes sont dvitïya et trtiya. II faut, en général, dans l’étude des formes zendes, tenir compte de l’ancien état de la langue : par exemple, dans kasëlwaim «quis te»? en sanscrit has tvârn, ce n’est pas Te qui a été la,cause de la conservation de la sifflante, mais le t qui vient après. Evidemment, on disait d’abord kas-iwaiim, et la voyelle de liaison qui a été insérée est d’origine relativement récente : sans le voisinage du t, kaé serait devenu ko.
On peut remarquer dans le haut-allemand moderne un fait analogue, mais qu’il ne faudrait pourtant pas rapporter à la parenté originaire des deux idiomes. Les mêmes lettres, qui ont en zend le pouvoir de changer en aspirée la muette antécédente, changent en haut-allemand moderne un * antécédent en son aspirée sch (sanscrit slave uj s). A ces sons il faut ajouter /, qui manque en zend. On peut comparer, sous»ce rapport, l’allemand schwîtzen «suer» (ancien haut-allemand swizan, qu’on écrivait suizan1, sanscrit svid), avec les formes zendes comme twânm, accusatif du pronom «toi» (nominatif tûm, génitif tam)\ l’allemand §chm,erz (vieux haut-allemand smerzo), avec taUma pour takma; l’allemand schnur (sanscrit snusa «bru», vieux haut-allemand snura, ancien slave snocha), avec tafnu-s «brûlant» pour tapnvr-s (S Ao), La combinaison sr manque dans les anciens dialectes germaniques, au lieu qu’en sanscrit c’est le groupe phonique ^ si qui Vnanque. Au contraire, TQsl paraît être sorti, dans un certain nombre de racines, de par exemple, dans 'W^Qsrahg, qu’on écrit aussi srank «aller»; il est très-vraisemblable que la dénomination allemande du serpent, schlange
1 Le son w, après une consonne initiale, était représenté dans l’écriture par un u.
(vieuxhaut-allemand slmigo, thème slangon, masculin), se rapporte à cette racine. Je ferai remarquer à ce propos que Vôpa-dêva, pour indiquer le sens de la racine sraük, l’explique par le mot sarpê *, qui est un nom abstrait, formé de la racine d’où sont dérivés en sanscrit et en latin les noms du serpent. Gomme le ’sj/sanscrit est un s aspiré (S Ù9), et qu’il se prononce aujourd’hui dans le Bengale de la même manière que le sck allemand, ainsi qu’on peut le voir par le Lexique de Forster, nous avons, selon toute apparence, pour l’exemple qui vient d’être cité, identité d’origine et identité de prononciation. C’est encore à la même racine srang que se rapportent probablement le vieux haut-allemand slinga et le vieux norrois slanga «fronde», c’est-à-dire «celle qui met en mouvement».
§ 48. H inséré devant un r suivi d’une consonne.
Un fait qui se rattache à la loi que nous avons exposée dans le paragraphe précédent, c’est que le zend insère ordinairement un h devant r, quand celui-ci est suivi d’une consonne autre qu’une sifflante ; exemples : «^^«6 mahrka « mort », de la racine (sanscrit mar, mr), «mourir»; këhrpëm ou
kërëpëm «le corps» (à l’accusatif), nominatif kë-
rëfs; »#ùfavëhrka ou vërëka «loup» (sanscrit vrka, de

§ 69. La sifflante » s.
Nous passons aux sifflantes. A la sifflante palatale, qui se prononce en sanscrit comme un s légèrement aspiré (-^), correspond le », que nous transcrivons s, comme le ^sanscrit. Il n’est guère possible de savoir si la prononciation de ces deux consonnes était exactement la même : Anquetil la rend par un s ordinaire. On
1 Locatif du thème sarpa, qui, comme abstrait, signifie «marche, mouvements, et, comme appellatif, «serpent*.
trouve ie » habituellement dans les mots qui ont ^en sanscrit ; ainsi les mots dasa /dix », sata « cent », pasu «animal», sont à la fois sanscrits et zends ; mais le » s zend est dun emploi plus fréquent en ce qu’il a remplacé le s ordinaire (le ^ s dental sanscrit) devant un certain nombre de consonnes, notamment devant p t, 9 k, | n, soit au commencement, soit au milieu des mots; toutefois dans cette dernière position, seulement après & a, m â et ^ ah. Comparez stârâ «les étoiles» avec stâras
(dans le dialecte védique); dtaumi «je loue» avec
stàilmi; jp»» asti «il est» avec dsti; énâ «purifier» avec ^TT snâ «se baigner».
On pourrait conclure de ces rapprochements que » s se prononçait comme un s ordinaire ; mais le changement de s en s peut aussi résulter d’une disposition à aspirer cette consonne, comme cela a lieu pour le s allemand dans le dialecte souabe et, au commencement des mots, devant un t et un p, presque partout en Allemagne. 11 faut encore observer qu’on trouve aussi » s à la fin des mots après ^ an au nominatif singulier masculin des thèmes en nt.
Sur » s tenant la place du sanscrit, voyez §37.
8 5q. V changé en p après s.
La semi-voyelle » v, précédée d’un » s, se change toujours en $ p; exemples : «Dga» spâ «chien», accusatif igAug» spânëm; vîspa «tout»; «g»» aspa «cheval» (en sanscrit 1-TT X^Jmnam, t*T3T vOva, asva). Il n’y a pas , pour répondre
au zend spënta «saint», de mot sanscrit '3RT hanta ; mais
ce mot a dû exister dans le principe ; il faut y rapporter le lithuanien svomta-s «saint» et l’ancien slave svaiitü (même sens).
S 51. La sifflante ^ s.
La sifflante cérébrale sanscrite a en zend deux représentants,
■*0 de ces lettres a, selon Rask, la pronon
ciation d’un s ordinaire, c’est-à-dire celle de s dental (^en sanscrit), tandis que ggse prononce comme l’aspirée ^ (le ch français dans charme). Le trait qui termine cette lettre dans l’écriture zende semble destiné à marquer l’aspiration. Nous transcrirons cette dernière lettre par s. Dans les manuscrits ces deux signes sont souvent mis l’un pour l’autre, ce qui vient, suivant Rask, de ce que s’emploie en pehlvi pour exprimer le son ch, et que les copistes parses furent longtemps plus lamiiiers avec le pehlvi qu’avec le zend. Ces deux lettres correspondent le plus souvent, sous le rapport étymologique, au sanscrit ; il y a entre elles cette différence que jç se place surtout devant les consonnes fortes ($a5) et à la fin des mots. Il < st vrai que dans cette dernière position ^ répond au sanscrit ^s; mais il faut bien remarquer que ^ se trouve alors après des lettres qui exigeraient en sanscrit, au milieu d’un mot, le changement de en c’est-à-dire après d’autres voyelles que » a, mâ, ou après les consonnes b U oui v; exemples : les nominatifs jçtçuMg pakis « maître », pams kanimal», jàturs «feu», vàUs «discours».
Nous avons, au contraire, »#**>*&& fsuyans et non fsuyahs du thèmeJsuyant. Dans le mot ksvas «.six» nous
trouvons^ il est vrai, un ^3 s final après un m a; mais il ne représente pas un sanscrit ; il est pour le primitif de Comme exemples de ^3 s répondant au ^ sanscrit devant des consonnes fortes, nous pouvons citer le suffixe du superlatif ista ( comparez o-s ), en sanscrit as^a
« huit », en sanscrit ^TE astâ; »$$$*»$ karsta «labouré», en sanscrit ms krétd.
Le mot sayana «lit» semble avoir remplacé le s pala
tal de la racine sanscrite M « être couché, dormir » par un s ordinaire; mais il faut remarquer que ce mot, quand il est écrit ainsi, se trouve être le second membre d’un composé dont le premier
membre finit par un ^ ô, et c’est probablement l’influence euphonique de cette voyelle qui a fait changer le » s en^ «(compares: 2 2h et 55); ce qui prouve, d’ailleurs, que la racine
sanscrite sî a ordinairement un » s en zend, c’est la 3e personne «il est couché, il dort»85 = sanscrit éê’tê, grec xstrat.
Le nom de nombre tisarâ « trois » semble une anomalie, en ce qu’il a un ^ s à la place du de tTftï^tisrâs, car on
verra plus loin (S 53) que le sanscrit devient toujours en zend un & h. Mais cet se trouve ici après un \ i, c’est-à-dire dans une position où ordinairement le sanscrit change s en s.
D’un autre côté, le zend ^sar^ est Pour une ancienne
forme t*8™’ A’a aYant été inséré après coup : autrement,
nous aurions, d’après le § 5 a, ^*>£0^ tiéarô.
S 5q. La sifflante s.
« est pour le sanscrit devant les voyelles et les semi-voyelles jj y et » v. Comparez : aitaisahm et
aitaisva avec X^mT êtMâm «horum» et êtêsu «in his»; Atjjfggjjç maêya «homme» avec ma(nu)syà2. Cependant gjj s9 après un ^ U ou un $ f, est plus rare que s : ori a, par exemple, ksütvü «roi», pour le sanscrit hsutvct
«un homme de la caste guerrière ou royale». Il faut encore observer que le groupe sanscrit g^perd, dans certains mots zends, la gutturale et ne paraît plus que comme s; exemples : Mkêina «dexter» est en zend dasina (lithuanien désine «la main
droite»); âksi «œil» est devenu j^* asi; mais ce dernier mot ne paraît se trouver qu’à la fin de composés possessifs.
S 53. La lettre $p h.
qj» k ne correspond jamais, sous le rapport étymologique, au h sanscrit : il remplace constamment la sifflante dentale ordinaire qui devient toujours 4p h en zend, quand elle est placée devant des voyelles, des semi-voyelles ou m. Une exception unique, à savoir changé en a déjà été mentionnée
(S 35). Quand ^s se trouve devant des consonnes qui ne pourraient se joindre dans la prononciation à un h antécédent (§ A9 ), il devient » s. Comparez :
Zend.
au4P hâ ffhæc, ilia* (nominatif singulier féminin)
uçegMçp hapta « sept*
kakëred rf seinel * a 4P u ahi (ftu es* jj86 87G4pi> ahmâi crhuic*
^ü»4P hvarë «■ soleil*
»»4p kva ffSuus*
Sanscrit.
msâ
^ saptà (accentué ainsi dans les Védas)
^srftr dsi
asmâi ^ wàr
sva. -
Mentionnons encore le mot hisva «langue», en sans
crit! tfrgT gihvà : le son g (dj) a été décomposé en d + s; d a été supprimé, et s changé en A(cf. S 58).
en sanscrit sahâsra; anhra «méchant, cruel»1. Benfey
(Glossaire du Sâma-Véda, p. 88) a rapproché d’une façon plausible ce dernier mot du védique dasrâ «destructeur»; il faut admettre que le d est tombé, comme dans dhan «jour» et dsru «larme», que je rapproche, le premier, de la racine dah «brûler (éclairer)» et du mot allemand tag; le second, de la racine dans' «mordre» (grec âxw), en sorte que dsru serait l’équivalent du grec Saxpv.
S 55. Sê pour hê.
Le thème pronominal sya subit, dans le dialecte védique, 1 influence du mot prééédent et devient, par exemple, ^ sya apres la particule ^ (voyez Grammaire sanscrite, § lot a). Un fait analogue se produit en zend pour certains pronoms : ainsi hê «ejus, ei», qui se rapporte à une forme % sê perdue en sanscrit (cf. % me «mei, mihi» et% tê «tui, tibi»), devient jü-Hî (ou mieux, sans doute, *é) après S1 ”* Par exemple,
dans Olshausen, page 37, tandis que, sur la même page, il y a jüçy «pj&upç yêsica hê. A la page suivante, on trouve encore un fait analogue, si, comme il est probable, 5 sao ( c est ainsi
que je lis avec la variante) correspond au sanscrit asâü «ille, ilia» : *$
nôtd si îm sâo sâo yâ darëga akarsta saitê «non enim hæc tellus, ilia quæ diu inarata jacet».
S 56 \ Nasale n insérée devant un h.
\ '
Quand un h se trouve précédé d’un » a ou d’un â, et suivi d’une voyelle, on place ordinairement un $ n entre la première voyelle et h; cette insertion paraît obligatoire quand la voyelle qui suit h est »a,m â, ^ ê, ^ â, âo; exemple :
Certains manuscrits suppriment h devant r et écrivent hmanra, aura.
usasayarika «lu fus enfanté»; tandis qua l’actif la terminaison personnelle du présent tphi n’amène aucune nasale, comme on le voit par ahi «tu es», jyuubaUsahi «tu donnes», et non M}» anhi, baKsanhi.
S 56 b. As final changé en ô. As en «o.
La terminaison as, qui en sanscrit ne se change en o que de vant les consonnes sonores (§ a5) et devant a, parait toujours en zend, de même qu’en prâcrit et en pâli, sous la forme o. Au contraire, la terminaison as, qui en sanscrit perd complètement le s devant toutes les lettres sonores, ne laisse jamais disparaître entièrement en zend la sifflante finale; je vois, en effet, dans la diphthongue fm âo, qui remplace la terminaison «s, la trace de la vocalisation de s en «'. Il est remarquable que le changement de As en do s’opère même dans les cas où le s est représenté par nh (S 56a) ou par»«'(devant l’enclitique “),.de sorte que la sifflante est doublement marquée par le son o d’abord, par la consonne ensuite. Pour expliquer ceci par quelques exemples, le nominatif mâs «luna», qui est dépourvu de flexion en sanscrit, le s appartenant au radical, prend en zend la forme mdo, l’o remplaçant le ^sanscrit; mais «THS mâs-ca «lunaque» devient »*)»{•»( mâoséa, et tm^masam «lunam» devient mâonhëm, de sorte que la sifflante sanscrite est
à la fois représentée par une voyelle et par une ou même deux consonnes. C’est d’après le même principe que nous avons, par exemple, âonha pour KTfS ôlsa « il fut », et «#«*«“■ àoiihanm
pour 'QRQRQâsén «.earum».
1 Cf. S as. Voyez aussi l'édition latine de la Grammaire sanscrite, § 78, note, où j'ai déjà exprimé l'hypothèse de cette vocalisation, avant de connaître la langue
S 57. La sifflantejj s tenant la place d’un /l* lt
li reste à mentionner deux sifflantes,^ et J*; la première doit être prononcée comme le z français : nous la représentons dans notre système de transcription par un s Le J s zend répond le plus souvent, sous le rapport étymologique, à un ^ h sanscrit Comparez, par exemple :
Zerid.
asëm
t
*»Oçy à/sva
..
vamtli
si.
Sanscrit.
ahâm «moi»
âsta «main»
sahâsra «mille*
*
gihva «langue*
'cj^fJ{vâhati «il transporte* hi «car*
§ 58, £ s pour le sanscrit g ou g.
Quelquefois aussi £ s tient la place du sanscrit, ce qui doit être entendu ainsi : le ^ g, qui équivaut a dj, perd le son d et change le son jen z ( comparez S 5 3 ). Ainsi, par exemple y as «adorer» équivaut à is^yag; n^L^sausa «plaisir» dérive de la racine sanscrite gus «aimer, estimer».
Troisièmement, on trouve le^ s zend à la place du i^g sanscrit; cela tient à ce que les gutturales dégénèrent aisément en ' sifflantes, comme on le voit par le changement du ^ h (=* g) sanscrit en^s. Un exemple de^ s pour if^g est §a0 (
minatif) pour lequel, au féminin, signifie a la fois
. «vache» et «terre» : gâus fait irrégulièrement à Taccusatif gam; à cette forme se rapporte le zend sahm (S 61); d apres le no-
1
Jamais le h sanscrit n’est représenté en zend par o* k.
minatif sâo, on devrait attendre en sanscrit gâs (§ 56 b), qui formerait l’analogue de l’accusatif gâm. Dans le sens de «bœuf, vache », le zend a conservé à ce mot sa gutturale, quoique, d’après Burnouf \ il y ait aussi des cas où l’accusatif ^m^gâuni a le sens de « terre ».
S 5g. La sifflante eb ?■
4k est d’un usage plus rare : il prononce comme 1 ej français; je le transcris s. Il est remarquable que le 4k ? soit sorti quelquefois de la semi-voyelle sanscrite ^ y, absolument comme le j français, dans beaucoup de mots, est sorti de la semi-voyelle latine j. Ainsi <4^4^yûyâm «vous» est devenu en zend yûsëm. Quelquefois aussi *k ? correspond au ^g sanscrit (le j anglais), comme dans qgcb é$tm pour WT«t gurm «genou». Enfin, la lettre 4k ? remplace quelquefois la dentale sanscrite après un i ou un u, .quand elle se trouve, comme lettre finale d’un préfixe, devant une consonne sonore: exemples : ni§-
baraiti «exportât» = dus-ûUtëm «male dictum»; mais
on trouve, au contraire, dus-matëm «male cogitatum».
Le sanscrit, qui manque de sifflantes molles, remplace, d’après . des lois déterminées, le s par un r devant les consonnes molles; il a, par conséquent, mr-liarati au lieu du zend niè-baraiti, le s de nis ne pouvant se trouver devant un B. De même, le préfixe dus, qui correspond au grec <W, se montre toujours devant les lettres sonores(§ a5) sous la forme dur.
Il sera question plus loin de la formation des sifflantes zendes 88
(a» s, s,J s, eJb *), issues d’un t ou d’un son de même famille, cjuand il est suivi d’un autre son dental (S 102 fe).
S 60. Les nasales \ et ^ n.
Nous avons différé jusqu’à présent de parler des nasales zendes, fa connaissance du système phonique entier étant nécessaire pour bien déterminer le caractère de ces consonnes. Le zend diffère du sanscrit en ce qu’il n’a pas pour chaque classe de consonnes de nasale particulière; en ce qui concerne le son n, le zend distingue surtout deux cas, celui ou n est suivi d une consonne forte, et celui où il est suivi dune voyelle. Telle est la différence de \ et de g : le premier se trouve principalement devant les voyelles, les semi-voyelles y et v, et aussi a la fin des mots88; le second ne paraît qu’à l’intérieur des mots devant une consonne forte. On écrit hankarayumi «je célébré», panca «cinq», son^”> mais,
au contraire, M»j tiâ (nominatif) «homme», ^ ne...pas»,
{friiidoj barayën « ils porteraient » (potentiel), anyô «l’autre »,
kërënvô «tu fis». Quant à la prononciation de ces deux •lettres, le ^>, étant toujours joint à une consonne forte, a dû avoir un son moins net et plus sourd que le {, et c est sans doute à cause de cet affaiblissement et de cette indétermination du son que le ^ peut se joindre indifféremment aux consonnes fortes de toutes les classes. Comme ces deux nasales se distinguent suffisamment l’une de l’autre par la place qu'elles occupent dans le mot, nous n’avons j^as besoin de les marquer d’un signe distinct dans notre système de transcription.
§ 61. Le groupe ^ mi. ■
La nasale renfermée dans le groupe £, lequel n’est autre 89
chose, à en juger par sa forme, qu’un » a joint a un | n, a du avoir une prononciation encore plus faible et plus indécise que^w; c’est peut-être l’équivalent, quant au son, de Panousvâra sanscrit. On rencontre cet que nous transcrivons ah, premièrement devant les sifflantes, ^y h, et les aspirées ^ th et ^ f; exemples : Payons « regnans », accusatif
Hsayahtëm; sahhyamana (participe futur passif de la
racine |«£ son «engendrer») «qui nascetur»; marina «pa
role», de la racine man; >\è^\iy8a^fnu wk°uche”> probablement de la racine sanscrite Wf^gap «prier» (§ ùo) avec insertion d’une nasale. On trouve deuxièmement ^ devant « m ou J n final; exemples : pâdanahm «pedum», en sanscrit
sans l’épenthèse de l’j i, unhao, qui est tout aussi Ire-
quent.
II faut encore remarquer que le $ n s’emploie souvent devant > u, mais la syllabe nu est toujours le résultat de la transposition suivante. Le groupe nhva vocalise le v en u et le place devant le h; le n est conservé, quoique en réalité il ne soit destiné qu a se trouver devant le h. Les formes qui donnent surtout lieu a cette transposition sont : i° les impératifs, qui, se terminant en sanscrit en a-sva (aG personne singulier moyen)font en zend «^>44» anuha pour anhva (voyez des exemples au § 7âl)’ 2 ies mots qui, dérivés d’un thème en as, prennent le suffixe vont (vat dans les cas faibles) : ces mots ont en zend, aux cas forts (§199) anuhant (nominatif anuhâo, venant de anuhm), aux cas faibles anuhat Nous v reviendrons.
S 63. La nasale ç m. Le b changé en m en zend; changement contraire
en grec. *
La nasale labiale « m ne diffère pas du m sanscrit; mais il est remarquable quelle prend quelquefois la place du b. Du moins avons-nous la racine \brû «parler», qui fait en zend ,1g mrû; la forme sanscrite àbravît, qui est irrégulière, et qui devrait faire dbrât (pour dbraut), correspond au zend mraud
«il parla». Le grec a devant le p le changement contraire, c’est-à-dire qu’il remplace un p primitif par la moyenne de la même classe; exemples : /3poT<5s, fepaSis pour (iporis (= sanscrit mrtds, de martds), ppaSvï (en sanscrit mriûs «doux, lent»); le superlatif Ppctèu/los répond parfaitement au superlatif sanscrit mrd-
distas.
• ■
S 6A. Influence d’un m final sur la voyelle précédente.
Un « final exerce une double influence sur la voyelle qui précède; il affaiblit (§ So) le » a en 11, et allonge, au con-
traire, les voyelles 4 t et > u; exemples : tepévy paitîm «domi-num », touûm K corpus », accusatifs formés des thèmes
paiti, tanu. Le vocatif asâum « o pur ! » semble
être en contradiction avec cette règle. Mais ici Vu n’est pas primitif; uni est une contraction de la syllabe van du thème asavan, et l’allongement du second a est une compensation pour la suppression du troisième. Quant au changement de n final en m, c’est une singularité unique en son genre, au lieu que le changement contraire, de m final en n, est devenu une loi dans plusieurs langues de la famille indo-européenne.
S 65. Tableau des lettres zendes.
Nous donnons ici un tableau complet des lettres zendes :
Voyelles simples., * a, j g; m à, ^ ë; j i, 4 î; ,u,*â.
Diphtongues... *,* ai (S 33), ai (S 4i et 46), 4 ôi;
jm ai; 0, au (S 3a), >.» au (S 46), « ew; (m do, >m» âti.
Gutturales...... ^k, Æ, çtj,
Palatales....... p cf
Labiales....... ypt èf>_j b-
Semi-voyelles. .. X , pç, jj y (les deux premiers au commencement,
le troisième au milieu d’un mot), ) r (le dernier » seulement après un ^/), Jj, >> y (]e premier au commencement, le deuxième au milieu d’un mot).
Sifflantes et h. .. » s, gjj s, ^ ^ ^ h.
Nasales,....... j n (devantes voyelles, y, v et à la fin des mots), ^ n
(devant les consonnes fortes), ^ an (devant les sifflantes, çp h, & hèf> Ç*ftètjw), j n (entre m a
8
ou fm âo et A), i£» (entre j i ou ^ ê et A), 6 m.
Remarquez encore les groupes ^ pour gy* ah, pour st, pour ^4^ sk et g pour km.
ALPHABET GERMANIQUE.
$ 66, De la voyelle a en gothique.
Nous nous dispensons de traiter en particulier du système des lettres grecques et latines; pour ces deux langues, nous avons déjà, en parlant des lettres sanscrites, touché les points essentiels, et nous y reviendrons encore quand nous établirons les lois générales de la phonologie.
Nous allons nous occuper du système phonique du gothique et du vieux haut-allemand.
Va gothique répond complètement à la sanscrit; les sons de Y s et de l’o grecs, qui sont des altérations de ¥a, manquent en gothique comme en sanscrit. Mais Va ne s’est pas partout conservé pur : très-souvent, dans les syllabes radicales comme dans les terminaisons, il s’est affaibli en i, plus rarement en u; quelquefois aussi il a été supprimé tout à fait dans les syllabes finales.
§67. A changé en i ou supprimé en gothique.
C’est une loi que nous croyons avoir reconnue, que, partout où il y avait un a devant un s final, si le mot est polysyllabique, l’a s’est changé en i, ou bien a été supprimé; exemples : vulfi-s «lupi» (génitif) du thème vulfa, en sanscrit vrka-sya; bair-i-s ktu portes??, en sanscrit Bâra-si; vulj-s klupus??, en sanscrit vfha-s; auhsin-s sbovis ?>, en sanscrit ükêan-as; auhsans «boves» (nominatif-accusatif), en sanscritükêân-as (nominatif pluriel), et ükêan-as (accusatif pluriel).
De même, devant un th final, ie gothique affaiblit volontiers 1 « en i, sans toutefois éviter complètement la terminaison ath. Celle-ci se trouve, par exemple, dans lîuhath «lumière» (nominatif-accusatif neutre), magath «jeune fille» (accusatif féminin), et dans fadverhe aljath «ailleurs»; mais, dans tous les verbes gothiques de la conjugaison forte, à la 3° personne du singulier et à la 2e personne du pluriel, on trouve i-th k la place du sanscrit a-li, fl-ffl; exemples : bair-i-th «fert» et «fertis», sanscrit Bar-a-ti, Mr-a-ia. Va s’est, au contraire, maintenu dans les formes hair-a-m (sanscrit Bar-â-mas) «ferimus», hair-a-nd (sanscrit Bâr-a-nti) «ferunt», bair-a-ts (sanscrit Bar-a-tas, (pépejov); bair-a-sa (§ 86, 5) «fereris», bair-a-da «fertur», bair-a-nda «feruntur», formes qui répondent aux fqrmes moyennes sanscrites Bdr-a-sê, Bâr-a-tê, Bdr-a~nt,ê pour Bâr-a-sai, etc.
S 08. A gothique changé en u ou en o en vieux haut-allemand.
En vieux haut-allemand, Y a gothique s’est conservé, ou bien il est affaibli en u, quelquefois aussi en o. On trouve u tenant la place de Va gothique, par exemple : à la irc personne du singulier du présent des verbes forts (Usu pour le gothique Usa «je iis »), au datif pluriel des thèmes en a (wolfu-m pour le gothique mlfa-tn), à l’accusatif singulier et au nominatif-accusatif pluriel des thèmes en an (lianun ou hanon pour le gothique hanan, lut-wma), et au datif singulier de la déclinaison pronominale (imu pour le gothique imma).
$ 69 , 1. L’a long changé en 6 en gothique.
Pour la long sanscrit, le gothique, auquel la long manque tout à fait, met â ou ê, et, de préférence, le premier, tandis que le grec, au contraire, remplace Yâ bien plus fréquemment par v que par &». Quand il abrège Yâ, ie gothique le fait revenir au son â; ainsi les thèmes féminins en 0 se terminent, au nominatif-
accusatif singulier, par un a bref; exemple : airtha «terra, terrain» (sans flexion casuelle); le génitif singulier et le nominatif pluriel ont, au contraire, mrthô-s, la longue primitive s’étant conservée, grâce à l'appui de la consonne suivante.
En général, Yâ primitif, dans les mots polysyllabiques, s abrégé a la fin des mots en a bref. Quand un mot polysyllabique se termine par ô, cest qu'il avait-encore primitivement une consonne qui est tombée, par exemple dans les génitifs pluriels féminins, comme airth-â «terrarum», où Yâ représente la désinence sanscrite âm et la désinence grecque cov. Dans les formes comme hva-thrâ «d’où?», tha-thrô «d’ici», il est tombé une dentale.
Quand le gothique allonge Ya, il devient ô; exemple : -dog-a (pour ~doga~sf dans le composé jidur-dôg-8 «qui dure quatre jours», du theme daga, nominatif dag-s «jour». La fusion de deux a ou celle d’un ô (= d) avec a, produit ô; par exemple dans * les nominatifs pluriels comme dagôs «jours » de daga-as, hairdâs «troupeaux» de hairdo-as (thème hairdâ, nominatif singulier hmrdtty de même qu’en sanscrit sutâs «les fils» ou «les filles» est pour 8utd-as ou sutâ-as.
En vieux haut-allemand, Yâ gothique est resté à, par exemple au génitif pluriel, ou bien le son s’est divisé en no, m, oa, suivant les différents textes. En moyen haut-allemand, on trouve seulement uo, au lieu que, dans le haut-allemand moderne, ces deux voyelles hreves séparées se sont de nouveau fondues en une longue homogène, Lallemand brûder «frère», par exemple, est, en gothique, brâthdr, en vieux haut-allemand bruoder, brua-
der, en moyen haut-allemand brmder, en sanscrit Brâtar, en latin fréter. :
Dans les terminaisons, on trouve aussi, en vieux haut-allemand, à la place d un â gothique,a et û (ce dernier peut-être seulement devant un w.) Nous y reviendrons.
& 69, a. Ma long changé en ê en gothique.
L’autre voyelle, qui remplace plus rarement en gothique la primitif, est Yê; on peut regarder cette voyelle comme appartenant en propre, entre toutes les langues germaniques, au gothique, de sorte que celui-ci est, sous ce rapport, à l’égard du reste de la famille, ce que l’ionien est à l’égard des autres dialectes grecs. 11 n’y a que le vieux frison qui, dans la plupart des cas, ait également Yê gothique1. Les formes grammaticales les plus importantes où l’on rencontre cet ê sont : i° les formes polysyllabiques du prétérit de la dixième et de la onzième conjugaison (Grimm); exemple: gothique nêmum, vieux frison nêmon «nous prîmes??, en regard du vieux haut-allemand nâmumês; 20 la quatrième et la sixième conjugaison, où le gothique slêpa «je dors??, lêta «je laisse », rêda (ga-rêda «je réfléchis ??, und-rêda « euro, procuro ??), 1e. vieux frison siêpe, lête, rêde90 91, correspondent au vieux haut-allemand slâfu, lâzu, râtu; 3° les génitifs pluriels gothiques des masculins et des neutres, ainsi que des thèmes féminins en i et en u; au contraire, le vieux haut-allemand remplace, à tous les genres, par la désinence d, la désinence âm du sanscrit et la désinence w du grec. Comparez, par exemple, avec le sanscrit üksan-âm «boum??, le gothique auhsn-ê (pour auhsan-ê) et le vieux haut-allemand o/isdw-d. Je mentionne encore, parmi les cas isolés d’un ê gothique et vieux frison remplaçant un â, le mot^dr (thème jêra9 neutre) «année??, en vieux haut-allemand jâr, en zend yârë. Ce dernier, également du neutre, est pour yâr (§ 3o); mais je regarde le r, dans ce mot, comme le reste du suflixe ra, et je fais dériver yârë de la racine sanscrite yâ «aller??, les désignations du temps venant, en généra], de verbes marquant le mouvementl. Il me paraît plus difficile de faire dériver ce mot. avec Lassen et avec Burnouf ( Yaçna, p. 3a8), de la racine sanscrite îr «aller»; encore moins voudrais-je rapporter à cette dernière racine les termes germaniques qui expriment l’année et le grec <üpa, qu’on ne saurait en séparer et qui est formé de la même manière (l’esprit rude pour y, S 19).
$ 70. Le son et dans les langues germaniques.
Pour ^ i et ^ î, le gothique met i et ei. Je regarde ei comme l’expression graphique de 1Y long; en effet, ei correspond, sous le rapport étymologique, à î dans toutes les autres langues germaniques, excepté en haut-allemand moderne, et, de plus, ei représente Yî sanscrit, notamment à la fin des thèmes féminins du participe présent et du comparatif. H y a cette seule différence que, dans ces thèmes, le gothique ajoute encore à Yî un n, de même que Yâ du féminin sanscrit (en gothique, d) est très-souvent suivi d’un n dans les langues germaniques; exemple: gothique viduvôn (nominatif -vô, § 1A 2 ) = sanscrit vidhvâ « veuve » (thème et nominatif). Nous avons de même bairandein (nominatif -dei) pour le sanscrit Garanti ; celle qui porte»; juhisein (nominatif -sei} pour le sanscrit yâvîyasî «junior» (féminin). 11 est digne de remarque aussi qu’Ulfilas, en transportant du grec en gothique des noms de personne ou de pays, remplace très-fréquemment t par ei, et cela sans tenir compte de la quantité. 11 écrit,-par exemple, Teitus pour T/Vos, Teibairius pour T iSéptos, Thaiaufeüus pour 0eàÇiXos, Seidôn pour l&tSâv, rabbei pour paê£/. S’il traduit aussi et pare* (par exemple : ^a^Mpeirris par Sama-
. 1 Entre autres, le gothique aiva, thème aiva, qui vient, comme le gr<jc aiâsv elle latin œvumf de la racine * marquée du gouna. Aiva et ævum sont formes par un suffixe qui répond au sanscrit. (Cf. Graff, 1.1, p. 5o5 et suiv. et Kuhn, Journal, II, p. 9 35.) 'II? ;, .
reliés), cela tient à ce que probablement au iv° siècle si se prononçait déjà i long, comme en grec moderne. Peut-être même Ulfilas a-t-il été conduit par cet si = ï à exprimer le son î par le
groupe ci dans les mots gothiques d’origine.
Quand Yei gothique répond à la diphthonguc sanscrite e~ai, cela tient ou bien à ce que Yi gouna (§27) sest fondu avec un i radical, de manière a former un î long [i + i~i), ou bien diphthongue primitive ai a perdu son premier élément et a allongé le second par compensation. (Comparez en latin, par exemple, acquîro venant de acquairo, S 7). C’est ainsi que j explique, par exemple, le rapport du thème neutre gothique leika (nominatif-accusatif leik) « corps, cadavre, chair»avecle sanscrit ^«(masculin et neutre) « corps » (-§ 17“), et celui de veiksa (nominatif neutre mihs) kbourg» avec le thème masculin singulier vêsa (de vailm)
«maison». (Comparez le latin viens.)
A l’appui de mon opinion que Yei gothique se prononçait t, on peut encore mentionner cette circonstance que et se forme souvent de la contraction de ji. Ainsi le thème hairdja «berger» fait, au nominatif et au génitif singuliers, hairdei-s, paice que ja est précédé d’une syllabe longue, tandis que le thème harja fait, aux mêmes cas, harji-s (pour harja-s, d’après le § 67). Suivant le même principe, sôkja «je cherche » fait, à la 20 personne, sôkei^s (= $ôkî-s)rsokei-tih tandis que nasja «je sauve» fait nasji-s, nas-ji-th. Il est certain que la contraction deji en î est beaucoup plus naturelle qu’en ci prononcé comme une diphthongue; on peut remarquer, à ce propos, quen sanscrit aussi la semi-voyelle ^^y (=y) peut devenir un i long, après avoir rejeté la voyelle avec laquelle elle formait une syllabe; ainsi, au moyen, la syllabe yâ, qui sert à former le potentiel, se contracte enU cause des terminaisons plus pesantes qu’à l’actif; exemple: dvis-î-td «qu’il haïsse», par opposition avec l’actif dvis-ya-t.
Le brisement de l’î long en ei, qui^fi gothique, n’est qu’apparent, est devenu une réalité dans le haut-allemand moderne, de même que le brisement de Yû long en au. Nous avons, par exemple, au génitif des pronoms de la ire et de la 2 e personne, mein,dem, pour l’ancien et moyen haut-allemand, min, dm, et le gothique meina, theina = mina, thîna. Les verbes de la huitième conjugaison (Grimm), comme scheine, greffe, beisse, correspondent au vieux haut-allemand scînu, griffu, bîzu, au moyen haut-allemand schîne, griffe, bîze, au gothique skeina (= skma), greipa, and-beita. La voyelle du gouna, fondue avec \.i radical dans les anciens dialectes, a recouvré, en quelque sorte, une existence propre, de sorte que le moderne scheine répond au vieux et moyen haut-allemand scein, schein «je parus», et aux formes du présent grec frappées du gouna comme Xetir<w.
S 7 i. I final supprimé à la fin des mots polysyllabiques.
Toutes les fois que*, dans la famille des langues germaniques, se trouvait primitivement à la fin d’un mot, si le mot était polysyllabique, Yi a été supprimé; ce fait s’explique par la nature de l’î'j qui, étant la plus légère des voyelles fondamentales, ne pouvait subir d’autre altération qu’une suppression totale. Le gothique était d’autant plus exposé à cette suppression qu il ne connaît pas encore le changement de Yi en e (vieux haut-allemand ë). On a donc, par exemple, en gothique, i-m «je suis», i-s, i~st, s-ind, pour le sanscrit às-mi, â-si, às-ti, s-ânti; uffar «sur» pour le sanscrit upâri; bairis, bairith, bairand, vieux haut-allemand Uns, birit, bërant, pour le sanscrit Bârasi, bârali, Mranti «fers, fert, ferunt». Vi final s’est conservé dans la préposition monosyllabique bi «autour, sur, vers, chez», etc. (vieux haut-allemand, avec allongement de fi, bî, en allemand moderne bei), dans laquelle je reconnais le sanscrit abl «vers», d’ou vient abi-las «par ici». Ua initial de ce mot s’est perdu dans les langues germaniques.
§ 72. De Pi gothique.
Quand un mot polysyllabique, en gothique, se termine par un i, cet i est toujours le reste d’un j suivi d’une voyelle ; la voyelle ayant été supprimée, lej s’est changé en L Ainsi l’accusatif gothique hari «exercitum» (forme dénuée de flexion) est un reste de harja L Le sanscrit aurait karya-m, et le zend harî-m (§ 4a), qui se rapproche davantage de la forme gothique. Le a été également supprimé à l’ordinaire, en gothique, devant uns final, la syllabe finale is est, la plupart du temps, une forme affaiblie
de as ( § 67).
En vieux haut-allemand, et encore plus en moyen et en haut-allemand moderne, l’ancien i gothique s’est altéré en ef& l’exemple de Gnmm, nous marquons cet e de deux points (è) quand, soit en vieux, soit en moyen haut-allemand, il se trouve dans la syllabe accentuée. Remarquons encore que, dans l’ancienne écriture gothique, l’t est marqué de deux points quand il commence une syllabe.
S 78. Influence de Yi sur l’a de la syllabe précédente.
On a vu (§ h 1) quen zend la force d’attraction d’un i, d’un i ou d’un y (*;), introduit un i dans la syllabe précédente : lu sons correspondants ont de même en vieux haut-allemand une puissance d’assimilation qui fait que Va de la syllabe précédente est souvent changé en e, sans qu’il y ait de consonne ayant plus qu’une autre le pouvoir d’arrêter cette influence ; meme plusieurs consonnes réunies ne peuvent s’y opposer. Ainsi ast «branche» fait au pluriel esti; anst «grâce» fait au génitif-datif singulier et au nominatif-accusatif pluriel ensti; fallu «je tombe» fait à la 2e et à la 3° personne fellis, fellù. Au gothique nasja «je sauve»
1 Ce thème correspond, quant à la racine,à Tandon perse Mm «armée», littéralement «ce qui agit», du verbe kardmi «j agis».
correspond le vieux haut-allemand nerju. Toutefois cette loi ne prévaut pas encore partout en vieux haut-allemand; on trouve, par exemple, zahari « lacrymæ », pour zaheri.
S 7&. Développement du même principe en moyen haut-allemand.
En moyen haut-allemand l’influence que nous venons de signaler s’est encore accrue : non-seulement 1 et l’e qui est sorti de Yi, changent, à peu d’exceptions près (voyez Grimm, p. 33?i ), en e tous les a, mais ils agissent encore sur â, u, û, o, ô, no, ou, qu’ils changent respectivement en œ, il, iu, ô, œ, ne, ou. Nous citerons comme exemples geste « hôtes », de gast; jœric «qui dure un an», àejâr; teste «actions», de tât; brüste, de brust «poitrine»; mime, de mûs «souris»; hoche, de koch «cuisinier»; lœne, de lôn «récompense»; stuele, de stuol «chaise»; betSuben «étourdir», de toup (pour toub, § 93a). Au contraire, les e qui sont déjà en vieux haut-allemand l’altération d’un i ou d’un a, n’exercent pas d’influence de ce genre : on dit, par exemple, au génitif singuliergaste-s, parce que, au lieu du gothique gasti-s, l’on a gaste-s en vieux haut-allemand, ce dialecte ayant déjà obscurci en e, au génitif singulier, 1’*’ radical des thèmes masculins en 1.
S 75. Effet du même principe dans le haut-allemand moderne.
Me, sorti, en vieux et eu moyen haut-allemand, de Ya, en vertu du principe précédent, est resté e dans le haut' allemand moderne lorsque le souvenir de la voyelle primitive s’est effacé ou n’est plus senti que vaguement ; exemples : ende «fin», engel «ange», setzen «poser», nelzen «baigner», ncnnen « nommer », brennen «brûler », en gothique andi, cmgilus, satjan, natjan, namnjaïi, brannjan. Mais quand, en présence de la voyelle obscurcie, subsiste encore clairement la voyelle primitive, on emploie â, qui est tantôt bref, tantôt long, suivant qu’il est l’obscurcissement d’un a bref ou d’un a long; on emploi de meme & pour n, 0
pour o, au pour au; exemples : brânde, pfàle, dünste, jlüge, hoche, tùne, baume, de brand «incendie», pfâl «pieu», dunst «vapeur», flug «vol», koch «cuisinier», ton «ton», baum «arbre».
Cette influence d un i ou d’un e sur la voyelle de la syllabe précédente s’appelle périphonie (umlaut).
.^76. De U long* dans les langues germaniques.
L’ancienne écriture gothique ne fait pas de distinction entre \\i bref et Yé long. iNous ne pouvons connaître la longueur de cette voyelle en gothique que par voie d’induction, en prenant pour point de départ le vieux haut-allemand; car les manuscrits de cette langue indiquent en partie la longueur des voyelles, soit par redoublement, soit par l’accent circonflexe. Je ne saurais croire avec Grimm (Grammaire, I, 3°édit. p. 61) que le gothique n ait pas eu d’w long. Je pense, par exemple, qu’au vieux haut-allemand mus «souris» (thème mûsi'j a dû correspondre en gothique un mot que, d’ailleurs, nous n’avons pas conservé, ayant un û long; en effet, la longue se retrouve non-seulement dans le latin mus, mûris, mais encoiv dans le sanscrit mûsâ-s, masculin, musa, muéir, féminin. Les grammairiens indiens admettent meme, a côté de la racine mué «voler» d’où vient le nom de la souris, une racine mûs.
Les autres mots qui ont un û long en vieux haut-allemand ne donnent pas lieu à des comparaisons avec des mots correspondants dans les autres langues indo-européennes, du moins avec des mots ayant également un û long. La longueur de û dans hlût(thème hlûta) «sonore», me paraît inorganique; car ce mot ne peut être qu’un participe passif, et il répond au sanscrit sru-td-s «entendu» (de krutds), en grec kMtos, en latin elüliis. Le gothique hliu-ma (thème -man) «oreille» (c’est-à-dire «ce qui entend»), qui appartient à la même racine, a, au lieu de Va gouna, pris le son plus faible, de 17 gouna (8 27). 11 est clair aussi que Yû de sûfu «je bois» vient de iuf puisque, dans la conjugaison à laquelle appartient ce verbe, le présent exige IV gouna (S 109", i). On peut citer, dans d’autres langues, plusieurs exemples d’un allongement de la voyelle u tenant lieu du gouna; rapprochez, par exemple, le latin dûco (racine duc, comparez dux, dücis) du gothique tiuha et du vieux haut-allemand ziuhu. La racine sanscrite correspondante est duh «traire » (l’idée primitive est sans doute «tirer»), qui ferait au présent doh-â~mi =daüh-â-mi, comme verbe de la première classe (S 109a, 1). Il y a même en sanscrit quelques racines, entre autres guh «couvrir » \ qui allongent l’« radical au lieu de le frapper du gouna : ainsi géi-â-mi «je couvre», qui répond au grec xevÔco. En grec également certains verbes, au lieu de prendre le gouna, allongent la voyelle ; exemple : or6p-vv-(JLt, en sanscrit str-n$-mi ( de star-naû-mi), pluriel str-nü-mâ$f en grec <ttép-vv-pes. On trouve encore le manque de gouna compensé par l’allongement de 1Vt dans le vieux haut-allemand bûan « demeurer », pour le gothique bauan} de la racine sanscrite Bû «être», au causatif bâv-dyâ-mi. Nous y reviendrons.
Si l’on pouvait toujours inférer avec assurance, de l’allongement en sanscrit, l’allongement des mots gothiques correspondants, il faudrait aussi faire de la première syllabe du gothique sunu-s «fils» une longue, car en sanscrit nous avons sunu-s, de92 su ou sû «engendrer». Mais une longue primitive a pu s abréger en gothique depuis l’époque où cette langue s’est séparée du sanscrit; de même aussi que la voyelle peut s’être abrégée, pendant l’espace de quatre siècles qui sépare Ulfilas des plus anciens monuments du vieux haut-allemand, d’autant que, pendant ce laps de temps, beaucoup de voyelles se sont affaiblies.
Sur Vu, devenu au en haut-allemand moderne, voyez § 70. On peut citer comme exemples : haus «maison », raum « espace »,
1 De giwf(8 a3), en grec hv8 venant de yv$.
maus «souris55, sau «truie55, pour le vieux et le moyen haut-allemand, hus, rûm, mûs, su.
S 77. U bref gothique devenu 0 dans les dialectes modernes.
Vu bref gothique, soit primitif, soit dérivé d’un a, est devenu très-souvent 0 dans les dialectes germaniques plus modernes. Ainsi les verbes de la neuvième conjugaison (Grmm) ont bien conservé Vu radical dans les formes polysyllabiques du prétérit, en vieux et en moyen haut-allemand, mais au participe passif ils l’ont changé en 0. Comparez, par exemple, avec les formes gothiques hugum «nous pliâmes55 (sanscrit bubugimd), bugans «plié 55 (sanscrit Uugnd-s), le vieux haut-allemand bugumês, boga-nêr\ et le moyen haut-allemand bugen, bogener. Vu gothique sorti d’un a radical dans les participes passifs de la onzième conjugaison (Grimm) éprouve en vieux et en moyen haut-allemand la même altération en 0 ; exemple : vieux haut-allemand nomanêr «pris55, moyen haut-allemand nommer, au lieu du gothique numan 1.
§ 78. Transformations des diphthongues gothiques ai et au dans les langues germaniques modernes.
Nous avons déjà parlé (8 26, 3) des diphthongues gothiques ni et au, correspondant aux diphthongues sanscrites ê et â, lesquelles sont formées de la contraction de ai et de au. En vieux et en moyëfi haut-allemand, dans les syllabes radicales, Y a de la diphthongue gothique ai s’est affaibli en e et celui de au en 0, ou bien la diphthongue au tout entière s’est contractée en ô devant une dentale, ainsi que devants, k, eh, r etn; exemples : vieux 92 haut-allemand heizu «je nomme», moyen haut-allemand heizv, pour le gothique Imita; vieux haut-allemand «h»/? «je montai», moyen haut-allemand steic (c pour g, S 9 3a) pour le gothique staig (racine stig— sanscrit stig «monter») ; vieux haut-allemand boug «je pliai», moyen haut-allemand bouc, pour le gothique baug> sanscrit buhôga> contracté de bubaüga. Au contraire, nous avons en vieux et en moyen haut-allemand bot «j’offris, il offrit», pour le gothique bauth (pluriel budum) et le sanscrit bubôda, contracté de bubaûda (racine bud « savoir ») ; vieux et moyen haut-allemand kos «je choisis», pour le gothique kaus et le sanscrit gugôsa, contracté de gugausa (racine gus «aimer»); vieux haut-allemand zâh «je tirai», moyen haut-allemand zôch, pour le gothique tauh et le sanscrit dudôfm, contracté de dudaüha (racine ^ duh « traire »). Au gothique ausô « oreille » répond le vieux haut-allemand âra, moyen haut-allemand ore ; au gothique laun «récompense», le vieux et moyen haut-allemand Un. Le haut-allemand moderne a retrouvé en plusieurs endroits la diph-thongue gothique au, qui en vieux et en moyen haut-allemand était devenue ou; exemples : laufen «courir», pour le vieux haut-allemand hloufan, le moyen haut-allemand loufen, le gothique hlaupan. Peut-être ce fait s’explique-t-il de la façon suivante : ou est d’abord devenu û et, d’après le S y6, û s’est changé en au. C’est ainsi que dans la huitième conjugaison (Grimm) il ne reste en haut-allemand moderne de la diphthongue ei que le son i, soit bref, soit long(û?-î), selon la consonne' qui suivait, et sans distinction des formes monosyllabiques ou polysyllabiques; exemples v: grijf, griffrn; rieh, rieben, pour le moyen haut-allemand greif, griffon; reip, riben.
8 79* ha diphthongue gothique ai, quand elle ne fait pas partie du radical, se change en e en vieux haut-allemand.
Dans les terminaisons ou en dehors de la syllabe radicale, IV
gothique sest contracté en ê en vieux haut-allemand, et cet ê lait pendant, au subjonctif et dans la déclinaison pronominale, à Te sanscrit, formé de ai. Comparez, par exemple, bërês « feras», be-rêmês «feramus», berêt «feratis», avec le sanscrit bârês, barêma, ' baréta, et avec le gothique bairais, bairaima, bairaitk, dont les formes sont mieux conservées que les formes correspondantes du sanscrit. £ répond en vieux haut-allemand au gothique ai, comme caractéristique de la troisième conjugaison faible (en sanscrit aya, en prâcrit et en latin ê, § 109% 6); exemple : kab-ê-s «tu .as», habê-ta «j’avais», pour le gothique hab-ai-s, hab-ai-da. Au sanscrit tyê «hi, illi» (pluriel masculin du thème tya), répond le vieux haut-allemand diê ; le gothique tkai est, au contraire, mieux conservé que la forme sanscrite correspondante tê (dorien roi) du thème ta, en gothique tha, en grec t0.
S 80. Ai gothique changé en ê a l’intérieur de la racine en vieux
et en moyen haut-allemand.
Meme à l’intérieur des racines et des mots, on rencontre, en vieux et en moyen haut-allemand, un ê résultant de la contraction de ai, sous l’influence rétroactive de h (cA), r et ta; la contraction a même lieu quand le w s’est vocalisé en 0 (issu de u), ou quand il a été supprimé tout à fait, comme cela arrive en moyen haut-allemand. On a, par exemple, en vieux haut-allemand zêh «j’accusai», pour le gothique ga-taih «je dénonçai» (racine tih, sanscrit dis, formé de dik «montrer», latin die, grec Ssix)m, lêru «j’enseigne», pour le gothique laisja; êmg «éternel» à côté du gothique aivs «temps, éternité»; snêo (thème snêwa, génitif snêwes) «neige», pour le gothique snaivs. En moyen h a ut-allemand zêch, 1ère, ême, snê (génitif snêwes).
S 81. Des voyelles finales en vieux et en moyen haut-allemand.
L’é sorti de ai par contraction (§79) s’abrége en vieux haut-allemand à la fin des mots polysyllabiques1 ; de là, par exemple, à la 1re et à la 3° personne du singulier du subjonctif bëre « feram, ferat»; au contraire, dans bërês «feras», bërêt «feratis», bërên «ferant», Yê est resté long grâce à la consonne suivante. C’est d’après le même principe qu’au subjonctif du prétérit la voyelle modale î s’est abrégée à la fin des mots ; exemple : bunti «que je liasse, qu’il liât», à côté de buntîs, buntîmês, etc. De même en gothique on a déjà bundi à la 3e personne du singulier. En général, les voyelles finales sont le plus exposées à être abrégées; à l’exception des génitifs pluriels en â, il n’y a peut-être pas en vieux haut-allemand une seule voyelle finale longue (nous parlons des mots polysyllabiques) qui n’ait eu d’abord une consonne après elle, et cela dans un temps où la famille germanique existait déjà : tels sont les nominatifs pluriels comme tagâ, gëbô, pour le gothique dagâs, gibôs. En moyen haut-allemand, comme en haut-allemand moderne, toutes les voyelles, dans les terminaisons des mots polysyllabiques, se sont altérées en e; ainsi, par exemple, gëbe «don», tage «jours», gibe «je donne », gîbest2 «tu donnes », habe «j’ai », salbe «j’oins », pour le vieux haut-allemand geba, tagâ, gibu, gibis, habêm, salbom. il y a une exception en moyen haut-allemand : c’est la désinence iu au nominatif singulier féminin et au nominatif-accusatif pluriel
neutre de la déclinaison pronominale, y compris les adjectifs forts, par exemple dans disiu*ilia», bhndiu «cæca».
§ 821. L’i et l’w gothiques changés en ai et en au devant h ou r.
Une particularité dialectale qui n’appartient qu’au gothique, c’est que cette langue ne souffre pas un i ou un u pur devant un h ou un r, mais place toujours un «devant ces voyelles. Il y a, de la sorte, en gothique, outre les diphthongues primitives ai, au, dont nous avons parlé (S 78), deux diphthongues inorganiques qui sont la création propre de cette langue. Grimm les marque de la façon suivante: ai, au, supposant que, dans la prononciation, la voix s’arrête sur l*t ou sur Vu, tandis qu’il écrit ai, au pour les diphthongues primitives, où il regarde l’a comme étant le son essentiel. Mais la vérité est que, même pour les diphthongues primitives, t et « sont les voyelles essentielles ; a est seulement la voyelle de renfort ou le gouna. Si le sanscrit duhitàr «fille» vient de duh «traire», il n’y a qu’une seule différence entre la syllabe radicale du gothique tauk «je tirai» (=dudoha) et celle de dauh~ tar : c’est que l’a de iauh y est de toute antiquité, et que celu de dauhtar, ainsi que celui de tauhum «nous tirâmes»(sanscrit duduk-i-md)9 y a été introduit seulement par le h qui suit 1 u radical. Tel est aussi le rapport du thème gothique auhsan «bœuf» avec le sanscrit ûksan, Gomme exemples de au pour u devant un r, on peut citer daur(thème daura) «porte »,faur « devant » (sanscrit purds). Le rapport é&: daura avec le thème neutre sanscrit dvara s’explique ainsi : après la suppression de l’d, la semi-voyelle précédente est devenue un u (comparez le grec 3-épa) auquel, en vertu de la règle dont nous parlons, on a préposé un a.
Dans la plupart des cas où au est, en gothique, le remplaçant euphonique de u, IV lui-même a été produit (§7) par l’affaiblissement d’un a radical, notamment dans les formes polysyllabiques du prétérit de la douzième conjugaison (Grimm), où ia
diplithongue au est opposée à Yu du vieux haut-allemand et à Y a du singulier, lequel nous présente la racine nue; on a, par exemple, tkaursum «nous séchâmes?? en regard du singulier thars, en sanscrit tatdrsa, de la racine tars, trs «avoir soif??1. Vu de kaur-s «lourd?? pourrait être regardé comme primitif, et, par conséquent, la diphthongue au pourrait être considérée comme organique, et non comme occasionnée par le r, si le premier u du sanscrit guriVs, qui correspond au mot kaur-s, était primitif. Mais le mot guru a éprouvé un affaiblissement de la première voyelle, comme le prouvent le comparatif et le superlatif gdrîyân (nominatif), garnis, le grec (3otpv-s (S 1A) et le latin gravi-s (par métathèse pour garu-is). Va du gothique kaur-s s’est donc changé en u d une façon indépendante du sanscrit, et c est à cause de la lettre r qui suivait quun a a été placé devant Yu. Au contraire, dans gaurs «triste??, thème gaura, s’il est de la même famille que le sanscrit gôrâ-s (pour gaurd-s) «terrible??2, la diphthongue gothique existe de toute antiquité et n’est pas due à la présence de r. A l’appui de cette étymologie, on peut encore invoquer la longue o ( venant de au ), dans le vieux haut-allemand gôr; à un au gothique non organique ne pourrait correspondre, en vieux haut-allemand, qu’un u, ou un o'bref dérivé de Tm.
La règle en question est violée dans le mot uhtvâ « crépuscule du matin?? et dans huhrus «faim??, qui devraient faire auhtvô, hauhrus, à moins que peut-être Yu, dans ces mots, ne soit long.
$ 83Comparaison des formes gothiques ainsi altérées et des formes
sanscrites correspondantes.
Parmi les formes gothiques où i est devenu ai, par l’influence
1 Le sens primitif est évidemment «sécher» (comparez le grec Tèpa-o-twi ). Le gothique thaursja «je sèche», par euphonie pour thursja (et celui-ci pour tharsja), se rapporte, comme le latin torreo (de torseo), à la lorme cansative sanscrite taréâyâmt, 4 Le g sanscrit ne peut donner, en gothique, que g.
d’un /* ou d’un r qui suivait, il y en a qui correspondent à des formes sanscrites ayant un i; telles sont, par exemple, ga-laihum «nous racontâmes», en sanscrit didisimd «nous montrâmes» (racine dis formée de dik}\ aih-trô «je mendie», en sanscrit te, formé de isk (§ 37) «désirer», et probablement maihs-tu-s «fumier», sanscrit mih «mingere». Mais, à l’ordinaire, dans les formes de ce genre, IV gothique est résulté de l’affaiblissement d’un a primitif. Comparez, par exemple:
Sanscrit.
t t
sas
dâscm
dàksim «le côté droit» posés «animal» prac «demander» iSârâmi
dâr-i-tum «fendre, déchirer»
(védique) star
vard-s.
Gothique.
saihs «six» laihun «dix» taihsvo «la main droite 71 faihu «bétail»
fraihna «j’interroge» (prétérit frah) baira «je porte» (prétérit bar)
(lis-taira «je déchire» (prétérit tar)
stairno «étoile»
vair ( thème mira ) « homme »
% 84. Influence analogue exercée en latin par r et h sur la voyelle
qui précède.
On peut comparer à la règle qui veut qu’en gothique * se change en ai devant un r ou un /*, l’influence euphonique qu’un r exerce aussi en latin sur la voyelle qui précède; ainsi, au lieu d’un i, c’est la voyelle plus pesante e qu’on trouve de préférence devant r : peperi et non pépin, comme on devait s’y attendre d’après le S 6, veheris, quoique la voyelle caractéristique de la troisième classe soit i (en sanscrit a, § 109% i); veherem, veh-e-re, par opposition à veh-i-s, vch-i-t, veh-i-tur, veh-i-mus, veh-i-mar. Le r empêche aussi l’affaiblissement de e en %, qu; a lieu ordinairement quand la racine se charge du poids d’un préfixe, exemple : ajfcro, confero et non ajjiro, conjiro, comme on devrait dire, par analogie avec assideo, consideo, eottigo.
H a aussi, en ïatin comme en gothique, le pouvoir de fortifier la voyeüe précédente ; mais les exemples sont beaucoup moins nombreux, h ne se rencontrant pas dans les formes grammaticales proprement dites, c'est-à-dire dans les flexions. Cependant, comme consonne finale des racines veh et Irak, h protège la voyelle précédente contre l’affaiblissement en i dans les formes composées; exemple: attraho, adveho, et «on attriho, adviho.
§ 85. La diphthongue gothique tu changée en haut-allemand moderne
en te, ü et eu.
La diphthongue iu, sortie, en gothique, d’un au primitif, par l’affaiblissement de a en t ($ 37), s’est conservée en vieux et en moyen haut-allemand, mais est devenue, la plupart du temps, ie en haut-allemand moderne, notamment au présent et aux formes qui suivent l’analogie du présent de la neuvième conjugaison (Grimm). Cet ie, il est vrai, est un î, suivant la prononciation qu’on lui donne; mais il a, sans doute, été prononcé d’abord de manière à faire entendre i’e ainsi que l’i1, de sorte que cette dernière voyelle doit être regardée comme une altération de Xu. Mais on trouve aussi. dans la même conjugaison, ü à la place de l’ancien iu, à savoir dans luge, betrüge : ici ü n’est donc pas, comme à l’ordinaire, produit par l’influence régressive de la voyelle de la syllabe suivante (§ 74), mais il est, comme Xv grec et le 21 ü slave, un 'affaiblissement- de u. On peut rapprocher, par exemple, le pluriel miissen, du singulier monosyllabique mues (moyen haut-allemand muezen, en regard de muoz)\ et de même on peut rapprocher dürfen de darf, quoique l’affaiblissement de a en u dût suffire dans les formes polysyllabiques.
On a encore en haut-allemand moderne eu, pour le vieux et le
1 Comparez Vie bavarois (Schmeller, les Dialectes de la Bavière, p. i 5). Sur les differentes origines de Vie allemand, voyez Grimm,i, 3e édit. p. 227.
moyen haut-allemand iu; exemples : heute «hodie», hener «hoc anno», vieux haut-allemand hiutu, hiuru; euch «vous», moyen haut-allemand iuch; fleugt, geusst «volât, fundit» au lieu des formes ordinaires jlicgt, giesst, vieux haut-allemand jliugit, giuzit; neun, neune « novem », vieux haut-allemand nim (thème et nominatif pluriel muni); neu «novus», vieux haut-allemand niwi, niuwi, gothique niuji-s, thème niuja, sanscrit nâvya-s, lithuanien nauja-s; leute «homines», vieux haut-allemand liuti (gothique, racine lud «grandir», sanscrit ruh, venu de rud’, même sens, rodra-s «arbre»); leuchten «briller». vieux haut-allemand liuhtjan (sanscrit, racine rué «briller»; cf. grec Xevxés).
$ 86, î. Les gutturales.
Examinons maintenant les consonnes, en observant l’ordre de la classification sanscrite; commençons donc par les gutturales. En gothique, ce sont h, h, g. Ulfilas, par imitation du grec, se sert aussi de la dernière comme d’une nasale devant les gutturales. Mais, en gothique, comme dans les autres langues germaniques, nous exprimons la nasale gutturale simplement par un n; en effet, comme elle se trouve seulement à l’intérieur des mots devant une gutturale, elle est aisée à reconnaître95. J’écris donc, par exemple, jungs «jeune», drinkan «boire», tungâ «langue», et non juggs, drigkan, tuggô.
Pour le groupe h) (— latin qu), l’écriture gothique primitive a une lettre à part, que je transcris, avec Grimm, par qv, quoique q ne soit, d’ailleurs, pas employé et que v se combine aussi avec g, de sorte que qv (= kv) est évidemment hgv ce que k est à g. Comparez sinqvan «tomber» et singvan «chanter, lire». Le v gothique se combine volontiers aussi avec h : en vieux haut-allemand, ce v est représenté dans l’écriture par u — w. Comparez huer «qui?» avec le gothique hvas, le sanscrit et le lithuanien kas, l’anglo-saxon hva, le vieux norrois hver. Ulfilas a également pour cette combinaison une lettre simple (semblable pour la forme au 6 grec); mais je ne voudrais pas transcrire cette lettre, avec Von der Gabelentz et Lobe (Grammaire, p. 45), par un simple w, attendu que presque partout où elle se rencontre le 7i est le son fondamental et le v un simple complément euphonique. Le gothique hv n’est véritablement d’une ancienneté incontestable que dans le thème hveita « blanc » (nominatif hveit-s, vieux norrois hvit-r, anglo-saxon hvit), pour lequel on a, en sanscrit, svêtâ, venu de Jwaiid; peut-être aussi dans hwaitei, lithuanien kwêciei (pluriel masculin) «froment», ainsi nommé d’après sa couleur blanche.
Le latin a le même penchant que le gothique à ajouter un v euphonique à une gutturale antécédente : voyez, par exemple, quis, à côté du védique kis; quod, à côté du védique kat, du zend kad et du gothique hvata; quatuor, à côté du sanscrit catvàras, venu de katvaras, lithuanien keturi; quinque, à côté du sanscrit pdnca et du lithuanien penM; coquo, à côté du sanscrit pdcâmi et du slave pckuh; loquor, a côté du sanscrit làpâmi; sequor, à côté du sanscrit sâcami (venu de sdkâmi) et du lithuanien seku. Après g on trouve un v dans le latin anguis, en sanscrit ahi-s (védique d/u-s), en grec fytsi dans unguis, en grec 6wS, en sanscrit nakâ-s, en lithuanien naga-s. Quelquefois, en latin, de même quen germanique, la gutturale a disparu et la semi-voyelle est seule restée. Ainsi, dans le moderne wer, pour le gothique hva-s, le vieux Tiaut-alle-mand hwêr (quoique la forme wêr existe déjà); dans le latin ver-mi-s, venu de quermis, le gothique vaarm-s, le vieux haut-allemand ivarm, thème wurmi, pour le sanscrit krimi-s et krmi-s L, 96 le lithuanien kirminis, l’irlandais cruimh, l’albanais krüm, krimb.
En regard de l’allemand warm « chaud » et du gothique varm-jan « chauffer », vient se placer le sanscrit gar-mâ-s « chaleur », pour lequel on attendrait, en gothique, gvarm(a)~s. Mais gv ne se trouve pas au commencement des mots en germanique, non plus qu’en latin. Toutefois, le latin vivo vient d’un ancien gvivo; il doit être rapporté à la racine sanscrite gîv «vivre», à laquelle appartient, entre autres, le thème gothique qviva «vivant», nominatif quius.
Il faut encore remarquer, au sujet de la lettre gothique h, qu’elle tient h la fois la place de h et de ch en allemand moderne, et que, par conséquent, elle n’avait probablement pas la même prononciation dans toutes les positions. Elle représentait, sans doute, le ch devant un t, par exemple dans nahts, haut-allemand moderne nacht «nuit»; aktau, haut-allemand moderne acht « huit » ; mahts, haut-allemand moderne macht « puissance » ; de même, devant un s, par exemple dans vahsja, haut-allemand moderne ich waclm «je grandis» (sanscrit vdksâmi), et à la fin des mots, où le h moderne ne s’entend plus; au contraire, devant des voyelles, le h gothique a eu, sans doute, le son de h initial en allemand moderne.
Le vieux et le moyen haut-allemand mettent, comme le gothique, un simple h devant t et s (naht, aht, wahsu, wahse). A la fin des mots, on voit paraître, en moyen haut-allemand, ch, trairement à une supposition que j’avais émise autrefois, kram « aller » comme la racine de ce mot. On a déjà vu plus haut un verbe signifiant «aller??, servant à former un des noms du serpent (S A7 ). Krimi serait donc un affaiblissement pour krâmi (compare* l’ossète Ualm «ver et serpent?? ; le latin vermis, te gothique vaurm-s et Possète fialm viendraient d’une forme secondaire karmi, le r se prêtant volontiers à la mcta-ihèse, tandis que l’irlandais et l’albanais cruimh, cmm, se rapporteraient à la forme primitive.
entre autres dans les formes monosyllabiques du prétérit de la huitième, neuvième et dixième conjugaison, par exemple dans lêch «je prêtai», zâch «je tirai», sach «je vis» (allemand moderne ich lieh, ich zog, ich sah), dont ie présent est lîhe, ziuhe, sihe; cependant, dans la neuvième conjugaison, et, en général, dans les plus anciens manuscrits, on trouve aussi h ( Grimm, p. A 31, 7 ). Le vieux haut-allemand évite, au contraire, à en juger par le plus grand nombre de documents, de mettre ch (ou hh, qui le remplace) à la fin des mots; dans cette position, il emploie h, même là où l’aspirée est le substitut d’une ancienne ténue germanique, par exemple, dans i’accusatif des pronoms dépourvus de genre, où nous avons mih, dih, sih, pour le gothique mih, thuk, sik, moyen haut-allemand et haut-allemand moderne mich, dich, sich. A l’intérieur des mots, excepté devant t, le vieux haut-allemand a, dans la plupart des manuscrits, ch, ou, à sa place, hh, pour le gothique k, toutes les fois que celui-ci, en vertu de la loi de substitution, s’est changé en aspirée (S 87); exemples: suochu onsmhhu, haut-allemand moderne ich suche «je cherche» (gothique sôkja), prétérit suohta, moyen haut-allemand suoche, suohte (gothique sôkida).
La ténue gutturale, en exceptant la combinaison qu = kw, est exprimée, en vieux et en moyen haut-allemand, par k, ainsi que par c; Grimm marque la différence de ces deux consonnes, en moyen haut-allemand, en n’employant c que comme consonne finale ou devant un t, et en exprimant le redoublement de k par ck. (Grammaire, p. ùâa et suiv.)
La combinaison kw est exprimée, en vieux et en moyen haut-allemand, de même qu’en haut-allemand moderne, par qu; mais, à part le vieux haut-allemand, elle ne s’est conservée qu’en de rares occasions; en effet, le son w a disparu la plupart du temps, au commencement des mots et toujours h la fin, excepté quand le w s’est conservé au commencement, aux dépens de la gutturale, comme dans wemen « pleurer » i, gothique qvainôn, vieux norrois qveina et veina, suédois hvina, anglo-saxon cvanian et vanian2. Laissant de côté le moyen haut-allemand, je ne mentionne ici que les formes où le gothique qv s’est conservé, en haut-allemand moderne, sous la forme qu; ce sont : quick^frais », pour le gothique quiu-s3 (et le verbe erquicken «rafraîchir»); queck « vif » (dans quecksüber « vif-argent » ), et quem (dans bequem « commode»), dont la racine, en gothique, est qvam «aller» (qvîma, qvam, qvêmum); le verbe simple, au contraire, s’écrit komme, kam, kunft {ankunfi), ce dernier pour le gothique qvumths (thème qvum-thi). Je regarde l’o de komme comme une altération de l’te (comparez chumu «je viens », dans Notker4, vieux saxon cumu), et cet u comme la vocalisation du w renfermé dans quimu (qu — kw). La vraie voyelle radicale (qui est i au présent au lieu de Ta primitif) a donc été supprimée, à peu près comme dans les formes sanscrites telles que usmds «nous voulons», venant de msmds (8 â6, i). 11 en est déjà de meme dans le vieux haut-allemand ku ou eu pour qu (=kw), par exemple dans cum «viens» (impératif), pour quim — kwim, kunft, dans Notker chumft, l’aspirée étant substituée à la ténue5. Le latin offre l’exemple de faits
1 Déjà, en vieux haut-allemand, la gutturale a disparu sans laisser de traces (weinôn).
2 Comparez l’exemple, cité plus haut, de wêr pour hwer.
a Thème qviva. Sur le m endurci en gutturale, voyez S 19.
4 Les divers textes cités dans ce paragraphe sont tous conçus en vieux haut-allemand, mais avec des différences d’âge et de dialecte. La traduction d’Isidore (De na-tivitate Domini) appartient probablement au vme siècle. La traduction interlinéaire de la règle de saint Benoît, par Keron, paraît être du même temps. Otfrid, moine de Wissembourg (ix° siècle), a composé un poëme rimé du Christ. C’est également du ixe siècle qu’est la traduction de l’Harmonie évangélique de Tatien. Notker, moine de Saint-Gall (mort en îoaa), traduisit les Psaumes, la Consolation de la philosophie de Boèce, les Catégories d’Aristote, Martianus Capella. La plupart de ces textes sont réunis dans le Thésaurus antiquîtatum teutonicarum de Schiiter; Uim, 1728, in-P, 3 volumes. — Tr.
s Grimm ne s’explique pas bien clairement sur ce fait, ou bien il l’interprète au-
analogues : quatio, par exemple (cest-a-dire qvakto), quand il entre en composition, rejette la voyelle a pour s alléger, et il vocalise le v (concuth); de même, la voyelle radicale du pronom interrogatif est supprimée au génitif et au datif, cujus, cm (pour les formes plus anciennes quojus, quoi). Dans ubi et uler, il n’est rien resté du tout de l’ancien thème interrogatif (sanscrit Ica, gothique kva), excepté le complément euphonique v, changé en voyelle.
Dans les documents écrits en pur vieux haut-allemand, il y a aussi un qu aspiré, qui est le substitut dune ancienne ténue; cette aspirée est écrite quh, ou, ce qui est plus naturel, qhu, ou bien encore chu; exemples : quhidit «il parle», dans la traduction d’Isidore, qhuidit, dans Keron,pour le gothique qvilhith; chumentemu«venienti» dans les hymnes écrits en vieux haut-allemand.
Un fait qui mérite une attention particulière, c’est que qu et chu se rencontrent aussi comme altération de zu = zw (Grimm, P. 196) ; ce changement de la linguale en gutturale rappelle le changement inverse en grec, où nous avons vu (§ iù) t comme altération de k. De même que, par exemple, ris tient la place du védique kis, du latin quis, de même, quoique par un changement inverse, Keron a quelquefois quel « deux » (accusatif neutre), qaîfülon « douter », quîfalt « double », quîro « deux fois », quiski «double», quiohti «frondosa», pour zuîfalôn, etc.
trement. Il dit (pt h h a), en parlant du moyen haut-allemand : «Quelquefois Vu (de «qu = kw) se mêle à la voyelle suivante et produit un 0 bref comme dans kom pour «quant, kone pour qume, komm (infinitif) pour quëmen.» Il ne peut être question d’un mélange de« (c’est-à-dire w) avec la voyelle suivante, quand celle-ci est supprimée. Dans les formes où le gothique qvu répond à un u en vieux haut-allemand, par exemple dans qvumft-a, qui, en vieux haut-allemand, devient chumft, kunft, on peut douter si cet u provient, en effet, d’un t', comme je le crois, et comme cela est évident pour cum « viens « (impératif), ou bien si le v a été supprime et la voyelle , suivante conservée, comme dans le moderne kam.
§ 86, a s. Les dentales.
Les dentales gothiques sont : t, th, d. Pour le th l’alphabet gothique a une lettre à part. En haut-allemand z (= ts) prend la place de l’aspiration du t, c’est-à-dire que l’aspiration est changée en un son sifflant. A côté de ce z, l’ancien th gothique continue toutefois à subsister en vieux haut-allemand L
Il y a deux sortes de z, lesquels ne peuvent rimer ensemble en moyen haut-allemand ; dans l’un, c’est le son t qui l’emporte, dans l’autre, c’est le son s; ce dernier z est écrit par Isidore zf, et son redoublement zjf, au lieu qu’il rend le redoublement du premier par tz. En haut-allemand moderne le second n’a conservé que le son sifflant ; mais l’écriture le distingue encore généralement d’un s proprement dit. Sous le rapport étymologique, les deux sortes de z, en vieux et en moyen haut-allemand, ne font qu’un, et répondent au t gothique.
g 86, 2b. Suppression dans les langues germaniques des dentales
finales primitives.
En comparant les langues germaniques avec les idiomes appartenant primitivement à la même famille, on arrive à établir la lai suivante : le germanique supprime les dentales finales primitives, c’est-à-dire les dentales qui se trouvaient à la fin des mots, au temps où la famille indo-européenne était encore réunie2. Cette loi ne souffre qu’une seule exception : la dentale finale primitive subsiste, quand, pour la protéger, une voyelle est venue
1 Grimm (p. 5a5) regarde le th gui existe en haut-allemand moderne comme un son inorganique qui n’a aucune raison d’exister. «Il n’est aspiré ni dans la prononciation, ni par l’origine ; en réalité, ce n’est pas autre chose qu’une ténue.»
2 Je ne suis arrivé, dans la première édition, à ia connaissance de ce principe qu’eu m’occupant des adverbes gothiques en thrd, tard, et des désinences personnelles (a® partie, i835, p. 3-99). Mais j’avais déjà découvert la loi générale de la suppression des consonnes finales primitives en slave (p. 33q).
se placer à son côté, comme dans les neutres pronominaux, tels que thata = sanscrit tat, zend tad, grec tc5, latin is-tud. Au contraire, thathrô «d’ici», aljaîhrô «d’autre part», et d’autres adverbes du même genre ont perdu le t final ; ils répondent aux ablatifs sanscrits en â-t des thèmes en a (âsvâ-t «equo», de âsva)\ il en est de même de bairai «qu’il porte», qui répond au sanscrit Mrê-t, pour Mrai-t, zend barôi-d, grec (pépot.
Quant aux dentales qui se trouvent à la fin d’un mot dans le germanique tel qu’il est venu jusqu’à nous, elles étaient toutes, dans le principe, suivies d’une voyelle, ou d’une voyelle suivie elle-même d’une consonne. Comparez bairith «il porte» avec le sanscrit Bârati, bairand «ils portent» avec bâranti, vait «je sais» avec vé'da1, gaigrôt «je pleurai» avec cakrdnda. Les thèmes substantifs en a ou en i, qui suppriment cette voyelle ainsi qué la désinence casuelle à l’accusatif singulier, nous fournissent en gothique des exemples de mots avec une dentale finale ; exemple : fait «dominum» (thème fadi, usité seulement à la fin des composés), pour le sanscrit pàti-m.
D’accord en cela avec les langues germaniques, l’ancien perse rejette la dentale finale après a, à et *; le grec la supprime toujours. Exemples : abara «ilporta», grec ëtyeps, pour le sanscrit âBarat, le zend abarad ou barad; ciy (enclit.) pour ck en sanscrit et en zend. Le persan moderne a bien des dentales à la fin des mots, mais seulement, comme en germanique, quand ces dentales n’étaient pas primitivement des finales : c’est ainsi qu’au gothique bairith, bairand, mentionné plus haut, correspondent en persan bcred, berend.
§ 86, 3. Des labiales.
Les labiales sont en gothique p, f, b, avec leur nasale m.
1 Un parfait avec le sens du présent et avec suppression du redoublement. Cf. le grec oïèot.
Le haut-allemand a pour cette classe, comme le sanscrit pour toutes, une double aspiration, Tune sourde (/), l'autre sonore (cf. § â5) qu’on écrit v et qui se rapproche du sanscrit. Dans le haut-allemand moderne nous ne sentons point dans la prononciation de différence entre le / et le v; mais en moyen haut-allemand on reconnaît à deux signes que v est un son plus mou que f : i° à la fin des mots v est changé en f, d’après le même principe qui fait que dans cette position les moyennes sont changées en ténues ; exemple : wolf et non wok9 mais au génitif wokes; 9° au milieu des mots v se change en / devant les consonnes sourdes ; exemples : zweke9 zwelfte; fume, fünfte, funfzic.
Au commencement des mots, f et v paraissent avoir en moyen haut-allemand la même valeur, et ils sont employés indifféremment dans les manuscrits, quoique v le soit plus souvent ( Grimm, p. 399, Aoo). De même en vieux haut-allemand; cependant Notker emploie f comme l’aspirée primitive et v comme l’aspirée molle ou sonore : aussi préfère-t-il cette dernière dans le cas où le mot précédent finit par une de ces lettres qui appellent plutôt une moyenne qu’une ténue (S 93b), par exemple : demo vater «patrem»; mais il mettra desfater «patris» (cf. Grimm, p. 135, i36)L
Beaucoup de documents écrits en vieux haut-allemand s’abstiennent complètement d’employer le v initial (en particulier Kerori, Otfrid, Tatien) et écrivent constamment f.
L’aspiration du p est exprimée aussi quelquefois en vieux haut-allemand par ph : le ph initial ne se trouve guère que dans les mots étrangers, comme phorta, phenning; au milieu des mots et à la fin ph se trouve aussi dans des formes vraiment germaniques, comme werphan, warph, wurpkumês, dans Tatien; limphan dans Otfrid et Tatien, D’après Grimm ph a eu dans beaucoup de cas le
1
Voyez aussi Graff, III, p. 378. .
même son que /. « Mais dans des documents qui emploient à lot*-dinaire f, le ph de certains mots a indubitablement le son du pj) par exemple, quand Otfrid écrit kuphar « cuprum », secphert «creator», il n’est guère possible d’admettre qu’on doive prononcer kufarf sceferi (p. 13 a ). »
En moyen haut-allemand \eph initial des mots étrangers a été changé en pf (Grimm, p. 3 2 6 ). Au milieu et à la fin on trouve pj dans trois cas : i° Après un m, exemples : kampf «pugna », tampj «vapor», krempfen «contrahere ». Dans ce cas,p est un complément euphonique de f, pour faciliter la liaison avec le m. a0 En composition avec la préposition inséparable ent, qui perd son l devant l’aspirée labiale; exemple : enpjînden, plus tard, par euphonie, empfinden, pour ent-fînden. 3° Après les voyelles brèves on place volontiers devant l’aspirée labiale la ténue correspondante ; exemples : kopf, kropftropfe, klopfen, kripfen, kapfen (Grimm, p. 398). «On trouve aussi les mêmes mots écrits par deux/, exemples : kajfen, schujfen. » Dans ce dernier cas, le p s’est assimilé à f qui le suivait ; en effet, quoique f soit l’aspirée de p, on ne le prononce pas comme unp suivi d’une aspiration distincte, ainsi que cela arrive pour le Jff p sanscrit ; mais il s’est produit un son nouveau, simple en quelque sorte, tenant le milieu entre p et h, et capable de redoublement. C’est par un principe analogue qu’en grec on peut joindre le au 0, ce qui ne serait pas possible si le ^ se prononçait ph et le 0 th.
$ 86, h. Des semi-voyelles.
Aux semi-voyelles sanscrites correspondent en gothique j, r, l, v; de même en vieux haut-allemand, La seule différence est que, dans certains manuscrits, en vieux haut-allemand, le son du v indien et gothique est représenté par uu, et en moyen haut-allemand par w; celui du y dans les deux langues par i. Nous mettrons avec Grimm pour toutes les périodes du haut-allemand/ w.
Après une consonne initiale le vieux haut-allemand représente dans la plupart des manuscrits la semi-voyelle w par u; exemple ; ziielîf « douze » (haut-allemand moderne zwôlf), gothique tvalif.
De même qu’en sanscrit et en zend les semi-voyelles y (~j) et v dérivent souvent des voyelles correspondantes i et u, dont elles prennent la place pour éviter l’hiatus, de même aussi en germanique ; exemple : gothique suniv~ê « filiorum », du thème sunu, avec u frappé du gouna (iu, § a 7). Mais plus souvent c’est le cas inverse qui se présente en germanique, c’est-à-dire quej et v se sont vocalisés à la fin des mots et devant des consonnes ( cf. S 7 2 ), et ne sont restés dans leur forme primitive que devant les terminaisons commençant par une voyelle. En effet, si, par exemple, thius « valet» forme au génitif thivis, ce n’est pas le v qui est sorti de Vu du nominatif, c’est au contraire thius qui est un reste de thivas (§ 135), la semi-voyelle s’étant vocalisée après avoir perdu l'a qui la suivait.
§ 86, 5. Les sifflantes.
Outre la sifflante dure s (le sanscrit), le gothique a encore une sifflante molle, qui manque à d’autres idiomes germaniques. Ulfilas la représente par la lettre grecque Z ; mais de ce qu’il se sert de cette même lettre pour les noms propres qui en grec ont un £, ja ne voudrais pas conclure avec Grimm que la sifflante gothique en question se prononçât ds, comme l’ancien Z grec. Je conjecture plutôt que le Z grec avait déjà au ive siècle la prononciation du Z moderne, c’est-à-dire d’un 5 mou : c’est pour cela qu'Ulfdas a pu trouver cette lettre propre à rendre le s mouillé de sa langue. Je le représente dans ma transcription latine par la lettre s qui me sert à exprimer \ej zend (S 67) et le 3 slave (S 9a *). Sous le rapport étymologique, ce s, qui ne paraît jamais au commencement des mots, excepté dans les noms propres étrangers, est une transformation de s dur; au milieu
des mots il ne paraît jamais quentre deux voyelles, ou entre une voyelle ou une liquide et une semi-voyelle, une liquide ou une moyenne, notamment devant y, v, l, n, g, d1. En voici des exemples : thi-sâs, thi-sai, pour le sanscrit td-syâs, td-syâi «hujus, huic??; féminin, tki-sê, thi-sô pour le sanscrit tê-sâm, tâ-sâm, «ho-rum, harum»; bair-aya «tu es porté», pour le sanscrit Ur-a-d ( moyen ) ; juhisans «juniores?? pour le sanscrit yavîyâns~as; tais-jan «docere??; isva97 98 pour le sanscrit yusmd; saislêp «dormivi?? pour le sanscrit susvâpa (§ aib); mimsa (thème neutre) «caro?? pour le sanscrit mânsa (nominatif-accusatif mâhsd-m); fairsna étalon» pour le vieux haut-allemand fërsna; ram, thème rama « maison » (S 90); asgô «cendre?) pour le vieux norrois aska, l’anglo-saxon asca. On trouve rarement s à la fin d’un mot; quand il est employé dans cette position, c’est presque toujours que le mot suivant commence par une voyelle (Grimm, p. 65); ainsi l’on trouve le thème précité mimsa seulement à l’accusatif sous la I forme mims (Lettre aux Corinthiens, I, vin, i3), devant aiv, et le nominatif riqvis, du thème neutre riqvisa «ténèbres?? (sanscrit râgas), se trouve devant ist (Matthieu, vi, a3)99. Mais, entre I autres faits qui prouvent que le gothique préfère à la fin des
! mots la sifflante dure à la sifflante molle, on peut citer celui-ci :
1 le s sanscrit du suffixe du comparatif îyâhs (îyas dans les cas
! faibles) est représenté par un s dur dans les adverbes gothiques
comme mais «plus??, tandis que dans la déclinaison il est représenté par un s faible, par exemple dans-matsa «major??, génitif
maisin-s.
•
j La longueur du rhot paraît avoir influé aussi sur la préférence donnée à s ou à s : dans les formes plus étendues on choisit le
son le plus faible. Ainsi s’explique le changement de s en s devant les particules enclitiques ei et uh, dans les formes comme ikisei «cujus», thamei «quos», vilemih «veux-tu?», par opposition a this «hujus» (sanscrit tâsya), thans «hos», mleis «tu veux». C’est sur le même principe que repose le rapport de la forme saislêp «dormivi, dormivit», qui est chargée d’un redoublement, avec slêpa «dormir», et celui du génitif Mêsêsis avec le nominatif Mâsês.
Il faut enfin rapporter, selon moi, au même ordre de faits le phénomène suivant : le vieux haut-allemand, qui remplace, a plupart du temps, par r la sifflante molle qui lui manque, par exemple, dans les comparatifs et dans la déclinaison pronominale, conserve le s final de certaines racines dans les formes monosyllabiques du prétérit (c’est-à-dire à la ir\et à la 3e personne du singulier), et le change en r dans les formes polysyllabiques; exemple : lus «perdre» (présent liusu) fait au prétérit, à la tpe et à la 3e personne, lès «je perdis, il perdit», mais à la âe luri «tu perdis», lurumês «nous perdîmes».
S 87, 1. Loi de substitution des consonnes dans les idiomes germaniques.
Faits analogues dans les autres langues.
En comparant les racines et les mots germaniques avec les racines et les mots correspondants des langues congénères, on arrive à établir une remarquable loi de substitution des consonnes. On peut exprimer ainsi cette loi, en laissant de côté le haut-allemand, dont le .système des consonnes a éprouvé une seconde révolution (§87,2):
Les anciennes ténues deviennent dans les langues germaniques des aspirées, les aspirées des moyennes, les moyennes des ténues; c’est-à-dire que (si nous prenons le grec comme terme de comparaison) le -sr devient en germanique un /, le <Ç>
t O
an b et le fi un p; le t devient un th, le 3- un d. et le S un t; le h devient un A, le % un g et le y un kl. On peut comparer : 100 101
|
Sanscrit. |
Grec. |
, Latin. |
Gothique. |
|
Pdda-s |
'zsobs |
pes |
fétus |
|
pâncan |
'sréfJHre |
qmnqne |
Mf |
|
pwriià |
tsXêos |
plenus |
fyfls |
|
pitdr |
pater |
fadm* | |
|
upàri . |
Ô7rdp |
super |
ufar |
|
brdtar |
(ppdrfiop |
frater |
brothar |
|
bar |
(pépo) |
fero |
baira |
|
tvarn |
TÙ |
tu |
thu |
|
tam (accusatif) |
TÔV |
is-lum |
thana |
|
Irâya-s |
Tps ts |
très |
threis , |
|
dvâu |
Zbo |
duo |
tvai |
|
dâkèinâ * |
dextra |
taihsvô | |
|
évan pour kvan |
Kvrnv |
sanis • |
hunths |
|
posé pour pakû |
pecus ■ |
faihu | |
|
évdsura pour svdkura |
ênvpôs |
socer |
svaihra |
|
ddéan pour ddkan |
bénoL |
decem |
taihm |
|
aéru pour ddkru |
Sducpv |
lacrima |
tagr |
|
haitsâ pour feansâ |
Xdv |
(ih)anser |
gans |
|
hyas pour gyas |
X&és |
heri |
gistra |
|
lih pour life |
Às/^« |
Hugo |
laigo |
|
gnâ pour gnâ |
yiyvétxH^ |
gnosco |
kan |
|
gâti pour gâti |
yévos |
genus |
kuni |
|
gtinu pour garni |
yàvM |
genu |
kniu. |
|
Nous parlerons |
nluc Inin (Icc |
exceptions à la |
loi de substitu |
tion des consonnes, Nous traiterons aussi de la seconde substitution qui a eu lieu en haut-allemand2.
En ce qui concerne la substitution de l’aspirée à la ténue, l’ossète rappelle, d*une manière remarquable, la loi de substitution germanique, mais seulement au commencement des mots : ainsi le p devient régulièrement/, k devient t devient tP tandis qu au milieu et à la fin des mots l’ancienne ténue s’est la plupart du temps amollie en la moyenne. On peut constater le fait par le tableau suivant, pour lequel nous empruntons les mots ossètes à G. Rosen :
Sanscrit. - Ossèle.
pitàr «père» fid
panda «cinq» fonz
prcami (racineprac) farsin frje demande «
pântâ-s ?<• chemin n fandag
fadar
M
fraihm
Gothique.
( anc. haut-allem. ) pfad. , fad.
pârsvâ-s rf côté » pasû-s (ranimai» ka-s «qui?»
fars
fis «troupeau» Ua
faiku vbétail» hva-s
vieux norrois et de l’islandais (Copenhague 1818), dont Vater a traduit la partie la plus intéressante dans ses Tableaux comparatifs des langues primitives de l’Europe. Toutefois Rask s’est borné à établir les rapports des langues du Nord avec les langues classiques , sans s’occuper de la seconde substitution de consonnes opérée par le haut-allemand, que Jacob Grimm a exposée le premier. Voici l’observation de Rask (Vater, p. 12) :
«Parmi les consonnes muettes, on remarque fréquemment le changement de :
«en/.* i3aTnpjfadir......
t en th i rpeïsthrir; (ego, eg thek; ré, tu, thé.
« en h: xpéctSyhrœ «corps mort»; cornu, hom; cutis, hud.
jS est souvent conservé ; fiXaalàvos, blad; jbruttnr «source d’eau»; bullare,
atbulla.
S en t : Sctfidœ, tamr «apprivoisé».
y en k :yvv^y kona; yévos, kyn ou fein; gêna, kinn; àypos, akr.
0 en b ipt) y os, danois bôg «hêtre» ; fiher, èt/r ;<pépv, fera, eg ber.
&end;&ôpnïdyr. -
X en g: danois gyder «je verse»; , ega; j^rpa, gryta; %oW, gali.»
(îülliique.
(vieux norrois) thunn-r.
Sujjscrit.
kdsmin « dans qui?" kadd « quand?» kàsmât «par qui?» kart y krt « fendre» tami-s «mince» trasyâmi «je tremble» ta,p «brûler»
Ossèle.
Uami «où»
Jcad
Uamei «d’où?»1 Uard «moissonner»2 tœnag
iarsin «je crains» laft. «chaleur»
Les moyennes aspirées sanscrites, au moins les dentales, sont devenues en ossète, de même que dans les langues lettes, slaves et germaniques (exceptéle haut-allemand), des moyennes pures; exemples : dalag «inferior» pour le sanscrit dd'aras3; il faut joindre aussi, je pense, à ce thème les adverbes gothiques daia-thrô «d’en bas», daîa-th «en bas» avec mouvement, dala-tha «en bas» sans mouvement4, ainsi que le substantif dal (thème data) «vallée». Dimin «fumer» se rapporte au sanscrit dïûmâ-s «fumée», slave dümü, lithuanien dûmai, nominatif pluriel du thème dûma} qui se rapproche exactement du sanscrit dûmd. Ardag «demi» répond au sanscrit ardu; müd «miel» à mddu, en grec \iiOv, anglo-saxon medu, medo, slave medü; midæ «inte-rior» à mâdya-s «médius», gothique midja (thème). Pour le ï> sanscrit, l’ossète a « ou f, mais il n*y a que peu d’exemples, tels que arvade5 «frère» pour le sanscrit braîâ (nominatif); arfug
1 On trouve fréquemment en ossète un i final tenant lieu d’un t ou d’un s supprimé. Je regarde, en conséquence, les ablatifs en et (e~i) comme représentant les ablatifsjsanscrits en â-t, des thèmes en a.
a Sur les formes correspondantes dans les langues de l’Europe, voyez Glossaire sanscrit, 18/17, P* ®1,
3 R remplacé par l est un fait aussi ordinaire en ossète que dans les autres langues indo-européennes.
4 Le suffixe tha représente le suffixe sanscrit tas, qui se trouve, par exemple, dans yâtas «d’où, où». Le s final est tombé.
5 Le premier a de arvade sert à la prononciation; le r et le v ont changé de place comme dans arta «trois», venu de ira (sanscrit trâym, nominatif masculin).
«sourcil» pour frug, en sanscrit Erûrs, grec b-(ppü-st Peut-être, dans le mot ossète, l’aspirée a-t-elle été produite par l’influence de r, comme dans jirt « fds » pour le sanscrit putrâ-s.
L’ossète a conservé l’aspirée moyenne de la classe des gutturales ; exemples : gar « chaud » ( sanscrit garmâ « chaleur » ), garni-Uanin «chauffer» (dans ce dernier mot la racine sanscrite est conservée d’une façon plus complète); gos «oreille» (Sanscrit çfôéâyâmi «j’annonce», primitivement «je fais entendre»), zend et ancien perse gausâ «oreille»; niijg «nuage», en sanscrit mêgà-s.
En ce qui concerne la substitution de la ténue a l’ancienne moyenne, l’arménien moderne ressemble au germanique : en effet, la deuxième, la troisième et la quatrième lettre de l’alphabet arménien, lesquelles correspondent aux lettres grecques /S, y, A, ont pris la prononciation de p, k, t (voyez Petermann, Grammaire arménienne, p. âA). Toutefois, j’ai suivi, dans ma transcription des mots arméniens, l’ancienne prononciation, qui se rapproche davantage du sanscrit.
Il y a aussi en grec des exemples de substitution de consonnes : une moyenne primitive se change quelquefois en ténue. Mais cela n’arrive, comme l’a démontré Agathon Benary, que pour certaines formes terminées par une aspirée; cette aspirée finale, molle à l’origine, a été remplacée par l’aspirée dure, qui est la seule aspirée que possède le grec, et alors, pour établir une sorte d’équilibre, la moyenne initiale s’est changée en ténue1. Remarquez le rapport de «ri# avec la racine sanscrite band’ « lier » (§ 5), de ntvO avec bud* «savoir», de «raB avec bâti «tourmenter», de Tsnyy-s avec bâhü-s «bras», de 'tiuyÿ-s avec bahü-s «beaucoup», de xvO avec gui « couvrir », de Tpiy, «cheveu» (considéré comme
1 A. Benary, Phonologie romaiue, p. 196 et suiv. li est question au meme endroit île faits analogues en latin. Voyez aussi mon Système comparatii d’accentuation, note 19.'
«ce qui croît»)1 avec drh «croître» (venant de drah ou darii). Le latin, auquel manque l’aspirée du t, aputo etpatior en regard des racines grecques zsfvÔ, ma0, et fid, avec recul de l’aspiration, pour le grec tauQ.
S 87, ss. Deuxième substitution des consonnes en haut-allemand.
En haut-allemand il y a eu, après la première substitution des consonnes commune à toutes les langues germaniques, une seconde substitution qui lui est propre et qui a suivi absolument la même voie que la première, descendant également de la ténue à l’aspirée, de celle-ci à la moyenne, et remontant de la moyenne à la ténue. Cette seconde substitution, que Grimm a fait remarquer le premier, s’est exercée de la façon la plus complète sur les dentales, parmi lesquelles, comme on l’a déjà dit, îe z = ts remplit le rôle de l’aspirée. Comparez, par exemple :
Sanscrit.
Gothique.
Vieux haut-allemand.
dânta-s «dent» dammjâmi «je dompte « pada-s «pied» àdmi trje mange» tvarn crtoifl tamrni « j’étends» Bratar «frère» d'â «placer-, coucher, faire»
(tari> drs «oser» rud'irâ-m4 «sang»
zand zamom fmz izu, izzu du
tuom «je fais»
ga-dars3 «j’ose » ge-tar, a102 pers. ge-tars-l
'(vieux-sax.) rod «rouge» tôt. f
Si l’on excepte les documents qui représentent ce que Grimm appelle le pur vieux haut-allemand, les gutturales et les labiales se sont peu ressenties au commencement des mots de la seconde substitution des consonnes. Les lettres allemandes kf h, g, f b se sont maintenues dans des mots comme kinn « menton », gothique kimurs; kann «je peux, il peut», gothique kan; hund «chien», gothique hunds; herz «cœur», gothique hairtô; gast « hôte », gothique gasts; gebe «je donne», gothique giba; fange «je prends», gothique faha; vieh (=fieh) «bétail», gothique faihu; bruder «frère», gothique brôthar; binde «je lie», gothique binda; biege «je courbe», gothique biuga. Au contraire, à la fin des racines, un assez grand nombre de gutturales et de labiales ont subi la seconde substitution. Comparez, par exemple, breche «je casse », fehe «j’implore », frage «je demande», hange «je pends», lecke «je lèche», schlâfe «je dors», laufe «je cours», b-leibe «je reste», avec les formes gothiques brika, jlêka, fraihna, haha, laigâ, slêpa, hlaupa, af-lifnan «être de reste». Un exemple d’un p initial substitué à un b gothique ou germanique (= B en sanscrit, <p en grec, f en latin) est l’allemand pracht (primitivement «éclat»), lequel se rattache par sa racine au gothique bairht-s «clair, évident », à Fanglo-saxon beorht, à Fanglais brightf ainsi qu’au sanscrit firâg «briller», au grec (Çkèyv, au latin fa-gro , fulgeo.
Comme dans la seconde substitution des consonnes, en haut-allemand, c’est une particularité assez remarquable de voir Fas-pirée du t remplacée par £=ts (voyez Grimm, I, p. 592), je ne dois pas manquer de mentionner ici que j’ai rencontré le même fait dans une langue qui, il est vrai, est assez éloignée du haut-allemand, mais que je range dans la famille indo-européenne, je prochez, entré autres, le grec êpvQpés, le lithuanien rmu\à «couleur rouge» , rnu-dôna-ft «rouge».
veux dire le madécassel. Cet idiome affectionne, comme les langues germaniques, la substitution du h au h, duf on p; mais, au lieu du t aspiré, il emploie ts (le z allemand); de là, par exemple, futsi «blanc» (comparez le sanscrit pûtd «pur») en regard du malais pûtih et du javanais puti Le ts dans ce mot se trouve, à l’égard du t des deux autres langues, dans le même rapport où est le z du vieux haut-allemand fuoz «pied», à l’égard du t renfermé dans le gothique fétus; le f du même mot répond à un p sanscrit, comme le f du gothique et du haut-allemand fétus f fuoz y comparés au sanscrit jÆcï-$, au grec &rovs, au latin pas. De même, entre autres, le mot madécasse hulits «peau», comparé au malais kûht, présente un double changement dans le sens de la loi de substitution des consonnes en haut-allemand, à peu près comme l’allemand herz substitue le z au t gothique ( hairtô), et le h au c latin et au x grec (cor, xrfp, xctpSia)2. De même encorefehi «lien » est pour le sanscrit pasa-s «oorde» (venant de jtAas, de la racine p«s'«lier»); mi-feha «lier». Toutefois, le changement de t en ts'A n’est pas aussi général en madécasse que celui du h en h et du p en f et l’on conserve souvent le t primitif; par exemple, dans fitu «sept» à côté du tagalienpùo4; dans hita «voir» à côté du nouveau-zélandais kitea, du tagalien quita (= hita), formes qui correspondent parfaitement à la racine sanscrite kit (cïkêtmi «je vois»).
A cause de l’identité primitive du c sanscrit et du kf on peut
*
1 Voyea mon mémoire Sur la parenté des langues malayo-polynésiennes avec les idiomes indo-européens, p. i33 et suiv. note i3.
2 Le h sanscrit de hrd (pour hard) paraît n’être issu du k qu'après la séparation des idiomes : c’est ce qu’attestent les langues classiques aussi bien que les langues germaniques.
3 Ou en tS (Je tch français).
* Je crois reconnaître dans ce mot le sanscrit soptâ, la syllabe initiale étant tombée et 1’* ayant été inséré pour faciliter la prononciation, comme, par exemple, dans le tahitien toru trtrois^, pour le sanscrit trâyas (Ouvrage cité, p. ia et suiv.).
ALPHABET GERMANIQUE. S 88. 153
aussi rapprocher du dernier mot la racine sanscrite cit ou cint « penser», d’où vient cêtas «esprit»1.
§ 88. Delà substitution des consonnes dans les languesletto-slaves.
En ce qui concerne la substitution des consonnes, les langues Jettes et slaves ne s’accordent que sur un seul point avec les langues germaniques, c’est qu’elles changent les moyennes aspirées sanscrites en moyennes pures. Comparez, par exemple :
|
Sanscrit. |
Lithuanien. |
|
bu «être» |
bû-ti (infinitif) |
|
Bratdr «frère» |
brôli-s |
|
uBâé «tousdeux» |
abù |
|
luByâmi «je désire» |
lûbju |
|
haiisâ-s «oie» |
zasi-s |
|
lagùrS «léger» |
lengwa-s |
|
dars-i~tum «oser» |
drys-ti |
|
nuidu «miel» » vidavâ «veuve» |
medu-s |
|
Ancien slave. |
Gothique. |
|
bü-ii | |
|
bratrü |
brôthar |
|
oba |
bai (pluriel) |
|
ljubü «amour» |
-lubô «amour» 105 |
|
( russe) gasj |
(anglais) goose |
|
lïgükü106 |
leiht-s |
|
drüs-a-ti • |
ga-dars «j’ose » |
|
medü |
(angl.-sax.) mëdo |
|
vïdova |
vîduvô. |
«je peux») =sans-u t suivant, pour le e d’un % prononcé
Dans les langues Jettes et slaves, les gutturales molles primitives, aspirées ou non (y compris le h sanscrit, qui équivaut à un X prononcé mollement), sont devenues très-souvent des sifflantes molles, à savoir z (= 1 ej français) en lithuanien, et en slave 3 s ou ?k s, par exemple, dans le lithuanien zasis «oie», cité plus haut. D’autres exemples du même genre sont ; zâdas « discours » ; zôdis «mot» (sanscrit gad «parler»); zinaà «je sais», slave 3Mdrrn sna-ti «savoir», racine sanscrite gnâ (venant de gnâ); ziêma «hiver», slave 3H<\\d sima, sanscrit himd-m « neige »; ivezu «je transporte», slave K€3<ft vernit, sanscritvdhâmi; laizau «je lèche», slave ob-lis-a-ti (infinitif), sanscrit lé'h-mi, causatif lêhdyâmi, gothique laigo; mézu «mingo», sanscrit mê’hâmi (racine mih).
Le ïk s slave est d’origine plus récente que le 3 s, et postérieur, comme il semble, à la séparation des langues slaves d’avec les langues lettes; celles-ci, dans les formes similaires, le représentent ordinairement par g. Comparez, par exemple, sivuh «je vis» (sanscrit giv-â-mi, venant de gîv) avec le borus-sien gîw-a-si «tu vis» (sanscrit gîv-a-si) et le lithuanien gywa-s (y—î) «vivant», gywênu «je vis» 107; ?K€Nd sena «femme» avec le borussien^wwd!-w(accusatif), le zmàgëna,gëna, le sanscritgâni-s, gânî; ?KpSH0K2 êrünovü*. meule »avec le lithuanien girna, le gothique qvairrm-s, le sanscrit gar (gf)-> venant de gar «écraser».
Le^ÿ s et le «b * zends doivent, comme le 3 s et le ?k s slaves, leur origine à l’une des gutturales molles, y compris h (S 93), ou à un g dérivé d’un g. En conséquence, les mêmes sifflantes peuvent se rencontrer, par hasard, dans le même mot en letto-slave et en zend. Comparez, par exemple, le zend sima «hiver» (= sanscrit kimâ «neige») avec le lithuanien iiênui, le slave 3HMd sima; sbayêmi «j’invoque» (sanscrit hvâyâmi
«j’appelle») avec 3KdTH sva-ti «appeler»; M»jtb «savoir» avec
Unau «je sais», 3NdTM, sna-ti, « savoir »; vasâmi «je transporte» avec we£à, E€3tf> vernir, maisâmi «mingo» avec
myzé; ^ sî1 «vivre» (sanscrit gîv) avec la racine slave ?kmk siv; asëm «moi» (sanscrit ahdm) avec d3S asü, lithuanien as108 109.
S 89. Exceptions à la loi de substitution en gothique, soit à l'intérieur,
soit à la fin des mots.
On trouve assez souvent, en gothique, à l'intérieur des mots, plus fréquemment encore à la fin, des cas où la loi de substitution des consonnes est violée, soit que la substitution n’ait pas eu lieu, soit qu’elle ait été irrégulière. Au lieu du th? qu’on devrait attendre d’après le S 87, on trouve un à, par exemple, dans fadar, «père», «quatre». Pour le premier de ces mots, le
vieux haut-allemand afatar, de manière qu’en raison de la seconde substitution des consonnes, le £ primitif du sanscritpitâ (thème pitâr), du grec «rom/p et du latin pater est revenu. On rencontre b au lieu def, par exemple dans sibun «sept» (anglo-saxon seo-fon) et laiba «reste» (substantif), tandis que le verbe af-lif-nan « être de reste » a le /110. Le g n’a pas éprouvé de substitution dans biuga «je courbe» (sanscrit Bug «courber»). Le d est resté de même dans skaida «je sépare» et dans skadus «ombre», le pre-
SYSTÈME PHONIQUE ET GRAPHIQUE.
mier venant de la racine sanscrite cïd pour skid (§ 1 A) et le second de cad pour skad «couvrir». Le p est resté dans siêpa «je dors», en sanscrit smp-i-mi(§ 20).
S 90. Exceptions à la loi de substitution au commencement des mots.
On trouve aussi, au commencement des mots, des moyennes qui n ont pas subi la loi de substitution. Comparez.
Sanscrit,
band' «lier» hxtd'vt savoir» gard\ grdndésirer» gâu-s trterre» gral) tr prendre» duhitâr (thème) «fille» dvara-m «porte» dalâ-m «partie» 2
Gothique.
band «je liai»
budum «nous offrîmes»
grêdus tffaim» '
gavi «contrée» (thème gauja)
grîp «prendre»
dauhtar
daur (thème daura) dail-s.
Par suite d’une substitution irrégulière, on trouve g pour le k sanscrit dans grêla «je pleure », prétérit gaigrât= sanscrit krân-dâmif cakrânda. Une ténue, qui n’a pas subi de substitution, se voit dans têka «je touche», en latin tango, mais le mot sanscrit correspondant fait défaut.
§ 91, 1. Exceptions à la loi de substitution. La ténue conservée
après s, h (ch) et/.
Par une loi sans exception en gothique et généralement obser-
1 C’est-à-dire «désir de nourriture». Je rapporté les mots hungrja «j’ai faim» et huhrus «faim» à la racine sanscrite hâiiks «désirer». A gard\ grd\ d’où vient gidhit-s «avide», il faut comparer vraisemblablement le gothique gairnja «je désire», l’anglais greedyy le celtique (irlandais) gradh «amour, charité», graidheag,«femme aimée». ( Voyez Glossaire sanscrit, 1867, p. 107.)
2 ha racine dal signifie «se briser», éclater», et le causatif (dâlâyâmi) signifie «partager». En slave, y\1>AHTH délite veut dire «partager». (Cf. Glossaire sanscrit , p. i65.)
vée dans les autres dialectes germaniques111, les ténues échappent à la loi de substitution quand elles sont précédées d’un s ou des aspirées h (ch) ouf. Ces lettres préservent la ténue de toute altération , contrairement â ce qui arrive en grec, où Yon trouve souvent <70 au lieu de <r7 (S 12 ) et toujours £0, ÇÔ au lieu de ^r, <pt. Comparez, par exemple, en ce qui concerne la persistance de la ténue dans les conditions indiquées, le gothique skaida «je sépare» avec scindo, cndSvcyn, en sanscrit cïnâdmi (§ i A ) ; fisk-s (thèmefiska) avec pisci-s; speiva (racine spiv, prétérit spaiv) avec spuo; staimâ «étoile» avec le sanscrit star (védique); steiga «je monte» (racine stig) avec le sanscrit $tign&mi (même sens), le grec <77stawda «je me tiens » avec le latin sto, le grec Mvpt, le zend histâmi112 113; is-t «il est» avec le sanscrit ds-ti; naht-s «nuit» avec le sanscrit nâktr-am «de nuit «(adverbe); dauhlar «fille» avec duhitdr (thème); ahtau «huit» avec âstâu (védique astâü), grec
OXTfié.
S 91, 9. Formes différentes prises en vertu de l'exception précédente par le suffixe ti dans les langues germaniques.
Par suite de la loi phonique que nous venons d’exposer, le suffixe sanscrit H, qui forme surtout des substantifs abstraits féminins, conserve la ténue dans tous les dialectes germaniques, lorsqu’il est précédé d’une des lettres énoncées plus haut; mais, en gothique, le même suffixe, précédé d’une voyelle, fait une autre infraction à la loi de substitution, et, au lieu dé changer la ténue en aspirée, la change en moyenne. Nous avons donc, d’une part, des mots comme fra-lus-ti (verlmt)114 « perte » ; mah-ti (macht) « puis-
sance » (racine mag « pouvoir », sanscrit mardi « croître ») ;'ga-skaf-ii « création » (racine skctp), et d’autre part dê-di (that^ «action»; sê-di (saat) «semence» (tous les deux usités seulement à la iin d’un composé); sta~di (masculin) «place» (racine sta = racine sanscrite sia «se tenir»); fa~di (masculin) «maître» (sanscrit pâ-ti pour pa-ti, racinepâ « dominer » ). Après les liquides, ce suffixe prend tantôt la forme thi (conformément à la loi de substitution)., tantôt la forme Æ. Nous avons, par exemple, les thèmes féminins ga-rbaur-thi (gebuvt) «naissance», ga-Jaur-âi «assemblée », ga-kun-thi « estime », ga-mm-di « mémoire » \ ga-qmm-thi «réunion». On ne trouve point, comme il était d’ailleurs naturel de s’y attendre, de forme enm-di; mais, en somme, la loi en question s’accorde d’une façon remarquable avec un fait analogue en persan, où le l primitif des désinences et des suffixes grammaticaux s’est seulement maintenu après les sifflantes dures et les aspirées (s f, cA), et s’est changé en d après les voyelles et les liquides. Ainsi l’on a bôs-ten «lier», das-ten «avoir», taj-ten « allumer », puch-ten « cuire » ; mais on a, d’un autre côté, da~den « donner », bev-den « porter », âm-d&fi « venir », man-dsti « rester ».
Par suite de la seconde substitution, le haut-allemand a ramené à la ténue primitive la moyenne du gothique di, tandis qu apres st h (cA ),/, la ténue de la première période est restée; exemples: sâti (saat) «semence», tâ-ii (that) «action», bur-ti, gi-bur~ti (ge-burt) « naissance » ,fer-ti (fahrt) «traversée». Ces mots se trouvent avoir une ressemblance apparente avec les thèmes qui n ont pas subi la substitution, comme an-s-ti « grâce », mah~ti «puissance », hlouf~ti «course». Mais le haut-allemand ne manque pas non plus de formes ayant comme le gothique di après une liquide; par exemple: scul-di (scAw/d) «dette» (racine scal «devoir»). 111
§ 91, 3. Le gothique change la moyenne en aspirée à la tin des mots
et devant un s final.
A la fin des mots et devant un s final, le gothique remplace souvent la moyenne par l’aspirée. Conséquemment le nominatif du thème/âdf est fath-s, et l’on aurait tort d’expliquer ce th comme étant substitué au t du thème sanscrit pâti. Les participes passifs sanscrits en ta, dont le t, en gothique, s’amollit en d, lorsqu’il est placé, comme cela a lieu d’ordinaire, après une voyelle, se terminent régulièrement, au nominatif singulier masculin en ths (pour da-s) et à l’accusatif en tk; exemple : sôkith-s «quæsitus», accusatif sôMth. Mais je regarde sôMda comme étant le thème véritable, ce que prouvent, entre autres, les formes du pluriel sôkidai, sôkida-m, sèkida-ns, ainsi que le thème féminin sôkid.o, nominatif sôMda,
Par suite de cette tendance à remplacer les moyennes finales par des aspirées, quand elles sont précédées d’une voyelle, on a, dans les formes dénuées de flexion de la première et de la troisième personne du singulier au prétérit des verbes forts, des formes comme bautk, de la racine bud « offrir » ; gaf, de gab « donner » (présent giba). Toutefois g ne se change pas en h, mais reste invariable; par exemple, staig «je montai», et non staik.
$91, h. Le th final de la conjugaison gothique. — Les aspirées douces
des langues germaniques.
Il en est de même du th des désinences personnelles, que je n’explique pas comme provenant d’une ancienne ténue, mais comme résultant de la tendance du gothique à remplacer les moyennes finales par des aspirées. Je ne regarde pas, par conséquent, le th de bairith comme provenant par substitution du t du sanscrit Mr-a-ti et du latin fert, mais je pense que la terminaison personnelle ti (de même que le suffixe ti après une voyelle) est
devenue, en germanique, di, et que ce di s’est changé, en gothique, en th, IV s’étant oblitéré. Le même rapport qui existe entre fath «dominum», du thème fadi, et le sanscrit patitn? existe aussi entre bair-i-îh (pour bair-a-th) et Bâr-a-ti. Comme une preuve de ce fait, nous citerons le passif bair-a-cla pour bair-a-dai, comparé au moyen sanscrit Bâr-a-tê (venant de hâr-a-tai) et au grec <pép-s-Tau; ici la moyenne est restée, étant protégée par la voyelle suivante. Cette moyenne est également restée, à la fin des mots, en vieux saxon, où les moyennes finales ne sont jamais remplacées par des aspirées ( bir-i-d au lieu du gothique bair-t-tlij, tandis quen anglo-saxon la moyenne aspirée s’est substituée à la moyenne (ôèr-e-dA). En vertu de la seconde substitution de consonnes qui lui est propre (§87» 2), Ie haut-allemand a substitue la ténue au th gothique de la troisième personne du singulier, et est revenu de la sorte, par ce détour, à la forme primitive; ainsi nous avons bir-i-t à côté du vieux saxon bir-i-d, du gothique bairi-th, du sanscrit odr-a-ti.
A la troisième personne du pluriel, le gothique a un d au lieu du t primitif, a cause de n qui précède ; en vertu de la loi de substitution (§ 87, 2 ), le vieux et le moyen haut-allemand rétablissent le t, de sorte que le vieux haut-allemand bërant, le moyen haut-allemand bërent s’accordent mieux, sous ce rapport, avec le sanscrit Bâranti, le grec (pépov t* , le latin fer unit qu avec le gothique
bairand et le vieux norrois bërand.
A la a * personne du pluriel, il faut considérer la terminaison
sanscrite ta comme une altération de ta (§ 12), en grec ts, en lithuanien te, en slave T€; en gothique, ta devrait faire da à cause de la voyelle qui précède; mais, la voyelle finale étant tombée, d se change en th (S q 1, 3 ). Au contraire, le vieux saxon conserve la moyenne et a, par exemple, ber-a-d pour le gothique bairi-th (au sujet de IV, voyez § 67) et le sanscrit bar-a-ta. Langlo-saxon et le vieux norrois aspirent la moyenne; en conséquence,
ils ont bër-a-dh, qui se rapproche beaucoup de la forme sanscrite Bdr-a-dbê «vous portez ». Néanmoins les moyennes aspirées germaniques n’ont rien de commun avec les mêmes lettres en sanscrit; en effet, les moyennes aspirées germaniques se sont formées des moyennes non aspirées correspondantes de la même façon, bien que beaucoup plus tard, que les aspirées dures sont sorties des ténues. En sanscrit, au contraire, les aspirées molles sont plus anciennes que les aspirées dures : au moins «Test plus ancien que i (§ 12).
Il y a aussi quelques documents conçus en vieux haut-allemand qui présentent des moyennes aspirées, à savoir dh et gh,; mais l’origine de ces deux lettres est fort différente. Le dh provient partout de l’amollissement dune aspirée dure (th), par exemple dans dku « toi », dhrî « trois », widhar « contre », werdhan «devenir», wardh «je devins, il devint», pour le gothique thu, threis, vithra, vairthan, varth. Au contraire, le gh est la moyenne altérée par l’influence de la voyelle molle qui suit («, i, ë, e, ê, et). Exemples : gheisi « esprit », ghibu «je donne », ghibis « tu donnes », ghëban « donner », daghe « au jour » (datif). L egh disparaît quand cette influence cesse; ainsi gah «je donnai», dagâ «jours», au nominatif-accusatif pluriel115.
ALPHABET SLAVE.
S 92. Système des voyelles et des consonnes.
Nous passons maintenant à l’examen du système phonique et graphique de l’ancien slave, en le rapprochant, à l’occasion, du lithuanien, du lette et du borussien. Nous nous proposerons surtout de montrer les rapports qui unissent les sons de l’ancien slave avec ceux des autres langues plus anciennes, dont iis sont
ou les équivalents fidèles ou les représentants plus ou altérés.
moins
§92“. a, e, o, A, a, uj e, 0, ah, un.
L ancien a sanscrit a eu le même sort en slave qu’en grec, c’est-à-dire qu’il est le plus souvent représenté par e ou par 0 (e, 0), qui sont toujours brefs, plus rarement par a (d). Gomme en grçc, c et 0 alternent entre eux à l’intérieur des racines, et de meme que nous avons, par exemple, X6yoç et Xéycü, nous avons en ancien slave &035 vosü «voiture» et vernit et je transporte». De même encore qu’il y a en grec, à côté du thème Xoyo, le vocatif Xôye, on a en ancien slave le vocatif rabe «esclave», venant du thème rabo, rabü « servus ». L’o est considéré comme plus pesant que Ye, mais Ya comme Tétant plus que To; aussi a remplace-t-il le plus souvent Yâ long sanscrit. Les thèmes féminins en ^TT â sont notamment représentés en ancien slave par des formes en a, comme vidavâ «veuve», qui fait en ancien slave vïdova.
Au vocatif, ces formes affaiblissent Y a en 0 (vïdovo), de la même manière que nous venons de voir 0 affaibli en e. A s’affaiblit encore en 0 comme lettre finale d’un premier membre d’un composé; exemple : vodo-nosü « cruche d’eau» (mot à mot «porteur d’eau»), au lieu de voda-nosü, absolument comme en grec nous avons Movo-o-Tpatyrfs, Movaro-tytAijs et autres composés analogues, où Ta ou Y y du féminin a été changé en 0. Si a est donc en ancien slave une voyelle brève, il n’en est pas moins la plupart du temps la longue de Yo sous le rapport étymologique. L’ancien slave est, à cet égard, le contraire du gothique, où Ya est, comme on Ta vu, la brève de Td, et où pour abréger Yâ on le change en a, de la même manière qu’en ancien slave on change a en 0.
Le lithuanien manque, comme le gothique, de To bref, car son 0 est toujours long et correspond, sous le rapport étymologique, a Yâ long des langues de même famille. Je le désigne, là
où il n’est pas pourvu de Faccent, par ô, et j’écris, par exemple, mot#kfemme» (primitivement «mère»), pluriel moters (§ 4a 6), en sanscrit mâtâ, mâtdr-as; de rankà « main » vient le génitif rankô-s, comme en gothique nous avons, par exemple, gibô-s, venant de giba. Dans les deux langues, la voyelle finale est restée longue devant la consonne exprimant le génitif, tandis qu’au nominatif, la voyelle, étant seule, s’est abrégée, mais en conservant le son primitif a. Va long paraît surtout devoir son origine, en lithuanien, à l’accent; en effet, F a bref s’allonge quand il reçoit le ton (excepté devant une liquide suivie d’une autre consonne)1. De là, par exemple, nâga-s «ongle», pluriel nagaî, pour le sanscrit naUd-s, naUas; sâpna-s « rêve », pluriel saprnl, en sanscrit svdpna-s, svdpnâs.
Quelquefois aussi ¥â long sanscrit ou ¥& long primitif est représenté en lithuanien par & = no (en une syllabe); exemples : dümi «je donne», pour le sanscrit dddâmi; akmù «pierre», génitif akmen-s, pour le sanscrit démâ, dsman-as (§ ata); sesü «sœur », génitif se$er-s, pour le sanscrit svasâ, svdsur. Comparez avec le lithuanien u = m2 le vieux haut-allemand uo pour le
1 Voyez Kurschat, Mémoires pour servir à l’étude du lithuanien, II, p. si î. Il y a aussi en lithuanien des longues qui paraissent être la compensation d’une désinence grammaticale mutilée. Ainsi les thèmes masculins en a allongent cette voyelle devant la désinence du datif pluriel ms, pour mus; exemple : pênâ-ms au lieu de l’ancien pâna-mus. A l’instrumental et au datif du duel, pénü-m est une mutilation d epôna-ma, comme on le voit par le slave. Si la longue primitive s’était maintenue en lithua
nien devant la désinence, nous devrions avoir pâno-m ou pdnô-ma, en analogie avec les fonnes sanscrites comme âévâ-b'yâm.— Deux verbes seulement ont un «long qui paraît inexplicable : bâlà «je blanchis» et sàlû «je gèle» (Kurschat, II, p. i55 et suiv.). Ce sont peut-être des formes mutilées pour baliu, èaltu, c’est-à-dire des dénominatifs formés des adjectifs boitais «blanc», éalta-s «froid».
2 C’est là-la prononciation première ou plus ancienne de u ( Kurschat, l. c. pp. g, 34); celle d’aujourd’hui est presque comme o. Schleicher lui attribue (Lituanica,
p. 5) le son de 0 suivi du son a. En tous cas, la notation ü fa dation uo, et il faut rappeler à ce propos qu’on trouve auss
t su
®ér une pronon-
dans Certains dialectes
KaiiCn. un u l ui
gothique o et le sanscrit â, par exemple, dans bruoder, pour le gothique brâthar et le sanscrit Ifratar.
Au sujet de Ve long (e), venant d’un â primitif, voyez § 99u.
Nous retournons à l’ancien slave pour remarquer qu’il conserve Y a bref sanscrit, tpiand il est suivi d’une nasale; je regarde, en effet, comme un a la voyelle renfermée dans a1, ce que donne déjà à supposer la forme de cette lettre, qui vient évidemment de l’À gréé; aussi la lisait-on d’abord ja, c’est-à-dire comme est prononcé à l’ordinaire le russe a, qui correspond le plus souvent à l’ancien slave a dans les mots d’origine commune. Comparez, par exemple, maco mahso « viande » (sanscrit mânsâ-m) avec le russe mhco mjàso, et mma imah «nom» (sanscrit naman, thème) avec le russe hmh inija. Si en ancien slave a se trouve fréquemment aussi représenter l’e des langues slaves vivantes, et s’il remplace également un e dans des mots empruntés, par exemple, dans cenTAEpt septanbrï «septembre», ïiatmkocth («vsvvnma^d), il est possible que ce changement de prononciation ait été produit par l’influence rétroactive de la nasale, comme dans le français septembre, Pentecôte> où l’e a pris le son a.
Je rends par un, et devant les labiales par uth, la lettre Jh qu’on lisait d’abord u; exemples : a^th duntt «souffler» (comparez AovfHATH (même sens) et le sanscrit dtt-nô-mi «je meus»); roAAEL golumbï «colombe». Toutefois, il ne manque pas non plus de raisons pour regarder l’élément vocal de a comme un o116 117. Sous le rapport étymologique, cette lettre se rattache le plus souvent'à un a primitif suivi d’une nasale; comparez, par exemple, nd/rkpunü «chemin», en russe nyim»putj,avec le sanscrit pântan (thème fort); /KHKd\ swuh «je vis», en russe sKHBy sivu, avec le sanscrit gîvâmi; îehe^tl êimhtï «ils vivent», en russe viciiByrai, sivut\ avec le sanscrit gîvanti; klaoeæ. vïdovuh « viduam », en russe vdovu, avec le sanscrit vidavâm. Dans e^a* bunduh «je serai?? (infinitif esith bü-ti, lithuanien bû-ti), en russe budu, <ft est pour û, comme le montre le sanscrit Bû.
S 93 b. M, K if ï.
et^î figurent tous deux en ancien slave sous la forme h i, sans qu’il reste trace de la différence de quantité; du moins, je ne vois pas qu’on ait reconnu en ancien slave la présence d’un i long ni celle de quelque autre voyelle longue L Comparez sivuh «je vis?? avec le sanscrit gïvâmi, et, d’autre part, kha'&th vidêti «voir?? avec la racine sanscrite lid «savoir??; ce dernier verbe, dans sa forme frappée du gouna vêd (vêd-mi «je sais??), correspond à l’ancien slave K-foWE vêmï «je sais?? (pour vêdmï), infinitif vês-ti, de sorte que vid et vêd sont devenus sur le terrain slave deux racines différentes. Ut bref s’est aussi altéré fréquemment en slave en e bref(e), de même qu’en grec et en vieux haut-allemand (§ 72 ); notamment les thèmes en i ont à plusieurs cas, ainsi qu’au commencement de certains composés, € e pour m t; de là, par exemple : rocTCXS goste-chü «dans les hôtes??, du thème pocth gostî, n/ftTeEOffiAE punte-vosdï «ôStjyés?? pour punti-voédï.
h aussi tient assez souvent à l’intérieur des mots la place d’un i bref en sanscrit, et il a eu sans doute la prononciation d’un i très-bref (voyez Miklosich, Phonologie comparée, p. 71). Je le rends par ï2. Voici des exemples de l’emploi de cette voyelle :
1 Voyez Miklosich, l. c. p, i63. En siovène, l’accent occasionne rallongement de voyelles primitivement brèves; le même fait a lieu en lithuanien (S 9a “) et en haut-allemand mjderne.
2 La lettre L, qui correspond à L, en russe, est définie par Greisch comme étant la moitié d’un t, et Reiff, le traducteur de l’ouvrage de Gretsch, compare le son b au?c sons mouillés français dans les mots travail, cigogne (p. fi7). En siovène, là ou cette lettre s’est conservée, elle est représentée par/. Mais cela n’a lieu, comme
KbAOKd vîdova «veuvej), en russe vdom, pour le sanscrit viclavà; klcl vïsï «chacun» (en russe secb vesj, féminin vsja, neutre vse), pour le sanscrit vls'va (thème), le lithuanien wisa-s «entier?;; rem jestï «il est??, cATb suhtï «ils sont??, pour le sanscrit asti, nanti.
S 9* c. si ü, s ü.
et^î û sont devenus tous deux en ancien slave, dans les formes les mieux conservées, si1 ; c’est ainsi que nous avons, par exemple : esi bü (infinitif esith büti, lithuanien buti), qui correspond à la racine sanscrite Bû «être??; <wsiuib müsï «souris?? à côté de mûsâ-s; amz sünü «fils?? à côté de sûnû-s; asims dümü «fumée?? à côté de cFûmâ-s; MCTSipHit cetürije «quatre?? à côté de éa-tür (thème faible). Les exemples où si ü est pour ^ u sont cependant plus rares que ceux où si ü correspond à ^5 û; en effet, Vu il semble, qu’à ta fin des mots, après un n ou un I, quoique môme dans celte position le b de l’ancien slave ne se soit pas toujours conservé comme un j. Comparez, par exemple, ogénj «feu» avec OrNb ognï; kanj,«cheval» avec KONb konï; prijattdj «ami» avec FipHlz!T€Ab prijateîï; mais, d’un autre côté, dan «jour» avec AbNb dtnï (en sanscrit, le thème masculin et neutre dîna a le même sens). Je regarde IV* du slovène dan comme une voyelle insérée à cause de la suppression de la voyelle finale ; il en est de même de l’e de ves «chacun», féminin vsa, neutre vse, à côté de'l’ancien slave EbCb vM, EbCId vïsja, EbC6 vïse. Si la prononciation du b final n’était pas entièrement semblable à celle qu’il avait à l’intérieur des mots, il faudrait lui donner, dans le premier cas, celle du j allemand, et, dans le second, celle de IV brel. Ce qui parait certain, c’est que le b ne formait pas une syllabe avec la consonne précédente, et que, par exemple, EbCb vM «chacun», du thème vïsjô (8 9a k), n’était pas un dissyllabe, niais un monosyllabe : on aurait pu transcrire visj ou vïsj, s’il ne valait pas mieux adopter une seule et même transcription pour une seule et même lettre de l’écriture primitive. Pour le russe, je transcris b par j.
1 Nous transcrivons cette lettre double par ü. Sa prononciation est en russe, d’après Reiff(t. II, p. 666 de la traduction de l’ouvrage de Gretsch), celle du français ou» prononcé très-rapidement et en une seule syllabe ; d’après Heym, à peu près celle de l’w allemand suivi d’un t très-bref. Toutefois, celte prononciation change suivant les lettres qui accompagnent la voyelle, et elle est, après d’autres consonnes »{iie les labiales, celle d’un * sourd on étouffe (ReifF, I. c.).
bref est en certains cas devenu o, en slave comme en vieux haut-allemand (§ 77) ; de là-, par exemple, cno?Cd snocha«belle-mère », pour le sanscrit snuêâ'. Mais bien plus souvent, ïu bref sanscrit est remplacé en ancien slave par s, c’est-à-dire par la voyelle fondamentale de si. Cette lettre, qui n’a plus de valeur phonétique en russe, a encore dû être prononcée en ancien slave comme un u bien distinct1 ; je le transcris par ü, pour le distinguer de ovf u. Voici des exemples où ce % correspond, à l’intérieur des mots, a un u sanscrit : asuith düêti « fille», en russe docj, pour le sanscrit duhitâ, le lithuanien dukte; esauth bûdêti «veiller», en lithuanien bundu «je veille», budrus «vigilant», en sanscrit bud' «savoir», au moyen «s’éveiller»; cxndTM süp-a-ii «dormir», sanscrit suptâ-s «endormi» (de svaptà-s), su-supimâ «nous dormîmes»; p2A*fcTH ca rüdêti sait «rubescere», sanscrit rudïm-m «sang» («ce qui est rouge»), lithuanien raudà «couleur rouge»; Atrxift lïgukü «léger», sanscrit lagé-s. Le 2 de asm düva «deux», pour le sanscrit dvâu, sert à faciliter la prononciation; on a fait précéder dans ce mot la semi-voyelle k v de la voyelle brève correspondante, de même qu’en sanscrit, dans les thèmes monosyllabiques en û, nous avons des formes comme buv-âs «terræ» (génitif) du thème bu, en opposition avec les formes comme vadv-as ( « feminæ » ) de vadu. 2 remplace 1’$ long sanscrit dans Ep2KE brüvï « sourcil » = sar icrit ürû-s.
A étant sujet, dans toutes les langues indo-européennes, à être affaibli en u, 011 ne sera pas étonné de trouver aussi en ancien slave 2 employé fréquemment pour un a ou un â sanscrit; exemples : KpSKt krüvï (féminin) «sang», russe krovj, dans lequel je crois reconnaître le sanscrit krdvya-m « viande », dont la semi-voyelle s’est changée dans le lithuanien krauja-s en u; C2 su «avec», lithuanien su, grec crùv, pour le sanscrit sam; la termi-
1
Voyez Miklosich, l, c. ]>, 71.
naison jg du génitif pluriel de la déclinaison pronominale, pour le sanscrit sam, le latin rum, leborussien son (S 92 e), et la désinence du datif pluriel ms mü, pour le sanscrit Byas, le latin bus, le lithuanien mus.
S 9ad. Si ü pour a.
De même que s ü, on rencontre dans certains cas si ü, à la place d’un a ou d’un â primitif, si ü est pour Va sanscrit à la iro personne du pluriel, où msi mü répond au sanscrit mas et au latin mus; exemple : K€3eMSi ves-e-mü, en sanscrit vdh-â-mas, en latin veh-i-mu$. Au nominatif et à l’accusatif pluriels des thèmes féminins en d a, je regarde le si ü final comme une altération de ce d6a ou de Va sanscrit et latin, de sorte que, à vrai dire, il n*y a pas de désinence dans des formes comme KtAOFSi vïdom, puisque la terminaison primitive, à savoir s (en sanscrit vitfavâ-s, en latin, à l’accusatif, viduâ-s), a dû tomber d’après la loi que nous exposerons ci-dessous (S 99 m). Quand nous examinerons plus loin la déclinaison, nous rencontrerons encore d’autres formes en si ü, pour lesquelles nous constaterons que l’w n’est pas la désinence, mais une altération de la voyelle finale du thème.
§ 99 \ U c.
A la diphthongue sanscrite ê, venue de ai, correspond ordinairement, en ancien slave, un n êl. Comparez, par exemple, K'èml vêmï «je sais » avec le sanscrit vê'dmi; niuid pêna « écume n avec pâm-s (même\sens); czt>T% svêtü «lumière» avec évita
1 C’est ainsi que nous transcrivons la lettre 'C, réservant la transcription je pour
cette dernière iettre se distingue du 'b en ce que le son c qu’elle contient se rapporte à un a bref sanscrit, et que le j a souvent une valeur étymologique; exemple : M0pl€ morje «mer» (par euphonie pour morjo, avec 0 = sanscrit a, voyez S 357), dont le j est sorti d’un i primitif et répond à IV du thème latin mari. Au nominatif pluriel, par exemple, dans rOCTM€ («hôtes»), que je divise ainsi gostij-e, ij est le développement euphonique de IV du thème.
(thème) «blanc», primitivement «brillant». Les formes grammaticales les plus importantes, où n est pour le sanscrit T£é, sont: le locatif singulier des thèmes en o — sanscrit a (§ 93 “), exemple : HOK’fc novê «in novo», pour le sanscrit nâvê; le nominatif-accusatif-vocatif duel des thèmes féminins en a a et neutres en 0=sanscrita, exemples : blaobu vïdovê «deux veuvesv^vidavê; MAC'b rnansê (du thème neutre mahso «viande ») — sanscrit mânsé'; le duel et le pluriel de Pimpératif, dans lequel je reconnais le potentiel sanscrit, exemple : îKHK'tTCèiv-ê-te «vivez », pour le sanscrit gîb-ê-ta «que vous viviez».
Le^ qu’on entend dans la prononciation habituelle du n, est une sorte de prosthèse très-familière aux voyelles slavesJ, et qui est même représentée graphiquement dans certains mots, comme K<m jesmï «je suis» = sanscrit dsmi, rartu jamï «je mange» = ddmi. Quant au son ê, je le regarde comme résultant d’une contraction de a et de i, contraction qui s’est faite en slave, comme en latin et en vieux haut-allemand (§§ 5, 79), d’une façon indépendante du sanscrit. En effet, les langues lettes, qui sont les proches parentes du slave, ont souvent ai ou ei à la place du 'h slave; en borussien, par exemple, nous trouvons au nominatif pluriel masculin de la déclinaison pronominale stai « ceux- ci », pour le sanscrit tê, l’ancien slave th ti; cette derniere forme ainsi que l’impératif singulier n’ont conservé que le dernier élément de la diphthongue ai, tandis que le borussien a conservé ai ou ei; exemples : nwimsivi «vis » (à l’impératif )=gîvê-s «que tu vivesaü contraire, nous avons en borussien dais «donne» (latin dès) ; daiti « donnez » ; tiwaw « prends » ( gothique nimais « que tu prennes»); idaiti ou ideiti «mangez»118 119. Ei pour le sanscrit ê se
rencontre aussi dans le borussien deiwa-s « dieu », pour le sanscrit dêvâ-s, primitivement «brillant» (racine div «briller»), sens auquel se rapporte le slave A’fcKd dêva tt vierge » ( considérée comme «brillante»)1. Le lithuanien, pour un ê sanscrit ou pour sa forme primitive ai, met, comme on Ta dit (S 26, 5), ei ou ai, ainsi que la forme contractée ë2, cette dernière, par exemple, dans dêweris, pour le sanscrit dêva-rà-s, en latin lêvir.
De meme que Té latin ne provient pas toujours de la contraction d’une diphthongue (§5), mais tient souvent, ainsi que !’>/ grec, la place d’un â primitif, de même aussi le slave 'fe et le lithuanien ë. Ils sont pour â, par exemple, dans a^th dê-k «faire», lithuanien dê'-mi «je place», dont la racine, comme le grec &tj (Tiûrifjii, 3*ï/ow), se rapporte à la racine sanscrite dâ « placer », vi-dd « faire » ; M'bpa mêra « mesure », lithuanien mërà (migra,), de la racine sanscrite ma «mesurer»; E'fcTps vê-trü «vent»3, lithuanien wiïjas, de 3fT vâ «souffler», gothique vô (vaivô «je soufflai, il souffla»); dans le suffixe A'fc dé, à côté de la forme habituelle Ad da = sanscrit dâ, des adverbes de temps d’origine pronominale, notamment dans KSrA't kügdé «quand?», pour la forme ordinaire kügda (Miklosich, Phonologie comparée, p. i4), lithuanien kadà, sanscrit kadd. Au contraire, le suffixe locatif aé (de K5A€ küde «où?», MNtAe inïde «ailleurs») répond au suffixe zend da, sanscrit ha (formé de da); exemple : en zend i-dh, en sanscrit i-hà «ici».
- S 93f. o\f u, K) jn.
Au sanscrit ô, venant de au, correspond le slave o\f u, lequel,
1 Voyez Miklosich, Radiées, p. 37.
2 On l’écrit e ou ie, sans que l’t soit prononcé ( voyez Kurschat, Mémoires, II, p. 6 et suiv.), ou é.
1 Le suffixe correspond au sanscrit ira (grec rpo, latin Irft), et est de la mémo famille que târ, tr, dans vâ-liïr, nominatif t?d-fd'«air, vent».
comme iécriture l’indique, a dû se prononcer d’abord ou, quoique, dans les langues vivantes, il soit remplacé par un u bref (en russe y). Devant les voyelles, on a oc au lieu de oy, comme en sanscrite pour âzz au (§ 26, 6); ainsi iiaoEthplovuii «je navigue, je nage», pour le sanscritplâvàmi120 (racine plu), à côté de l’infinitif nrtoifTw pluti, qui est identique au sanscrit plô'-tum, venant de plauium, abstraction faite de la différence des suffixes. A caobæ dovuh «j’entends» répondrait en sanscrit srdvâmi, si sru «entendre», infinitif srô-tum (slave caovttm), appartenait à la première classe de conjugaison. Avec le causatif sanscrit bôddyitum «faire savoir, éveiller» s’accorde l’ancien slave bovamth bud-i-ti «eveiller», tandis que EXA'fcTH büdêti «veiller» se rencontre, quant à la voyelle s ü, avec Yu sanscrit de la racine bucL Dans le causatif royemtm gubiti « détruire », oy est la forme frappée du gouna de si ü (S 92 c) dans tSibn^tm gübnunti «se perdre». Au génitif duel, la terminaison slave oy u s’accorde avec le sanscrit âs (=aus), le s étant nécessairement supprimé (§ 92 m); exemple : asboio düvoj-u (to^joy) «duorum», pour le sanscrit dvdy-âs. Comparez encore oycTd usta (pluriel neutre) «bouche», mttna «lèvre», avec le sanscrit ds\a «lèvre»; turü « taureau » avec le latin taurus, le grec Tavpos, le sanscrit stûra-s -, le gothique stiur-s (thème stiura); tous junü «jeune», junakü «jeune homme», junostï «jeunesse», avec le lithuanien jauni-katis «jeune homme», jaunyst&«jeunesse», jaun-ménu «la nouvelle lune», sanscrityévan (thème) «jeune»; coyxs suchü «sec» avec le lithuanien sdusa-s, grec cravo-apos, sanscrit suskds. Il ressort de quelques-uns de ces exemples que le slave oy se trouve dans certaines formes où le sanscrit emploie u, et plus souvent û, et le lithuanien au; on peut donc comparer le changement de Vu primitif en o\f (primitivement ou) avec celui qu’a subi le vieux haut-allemand û, qui est devenu régulièrement en haut-allemand moderne au; exemple : haus pour le vieux haut-allemand Ms(§ 76). On peut donc rapprocher la forme wmzjmü, lithuanien jaun (dans jaun-menû), avec la forme contractée yûn des cas faibles (§ 109) en sanscrit.
On trouve encore Tancien slave o\f pour le sanscrit ou k> (=y0\f)pour^^ entre autres dans aov[h^th dunuhti « souffler », qu’il faut rapprocher de la racine sanscrite «mouvoir»
{iû-nfl-mi «je meus»), et dans K>Xd jucha «jus» (en lithuanien juka «sorte de soupe»), comparés au sanscrit yûêâ-s, masculin, yûsd-m, neutre J, et au latin jus, juris pourjusis (8 32).
Pour o\f joint à un j antécédent, l’alphabet cyriliien a 10, quoique cette combinaison doive proprement représenter la syllabe y#. Mais ce groupe ne se rencontre pas en slave, pour des raisons que nous donnerons plus bas (§ 92k).
*
S 928. Tableau des consonnes dans l’ancien slave. — La gutturale X-
Les consonnes sont, abstraction faite de la nasale renfermée dans a et dans a :
Gutturales...... k, x (ch), r.
Palatale. ...... m (c).
Dentales. ...... t, a> IJ — &)•
Labiales....... n, K (b).
Liquides....... A, Ail, N, p.
Semi-voyelles. • 7, K (©).
Sifflantes....... c («), m (4), 3 (#), îk (4).
H est essentiel de remarquer, en ce qui concerne la lettre x,
1 Sur X tenant la place du s ou s sanscrit, voyez S 92 s.
que cette aspirée est relativement récente, et quelle ne s’est développée dans les langues slaves qu’après leur séparation d’avec les langues lettes : elle est sortie d’une ancienne sifflantex. Ce fait m’a expliqué un grand nombre de formes de la grammaire slave, qui auparavant étaient pour moi des énigmes, notamment la parenté de la terminaison x* chu, mentionnée plus haut (§ 99e)? avec les désinences sanscrites sam et su, et celle des prétérits en 7CS avec les aoristes sanscrits et grecs en sam (sam) et <ra, tandis qu’auparavant on voulait y voir une forme congénère des parfaits grecs en xa2. Le lithuanien met un k au lieu de la sifflante primitive dans la forme juka, citée plus haut (S 99 f), et dans les impératifs en ki, 2e personne pluriel ki-te; je reconnais dans ces dernières formes le précatif sanscrit, c’est-à-dire l’aoriste du potentiel (en grec optatif), d’après la formation usitée au moyen; je regarde donc le k renfermé dans dû-ki-te adonnez» comme identique avec le x slave de AdXS dachü a je donnai», AdXOMS dachomü a nous donnâmes », et avec le s sanscrit de dâ-sî-dvâm « que vous donniez ». Nous y reviendrons.
S 99 \ La palatale M c. Le lithuanien d£.
En ce qui concerne l’origine de la lettre slave m é, je renvoie au S 14, où j’ai donné des exemples de la rencontre fortuite de cette 121
palatale avec la palatale c en sanscrit et enzend. Le lithuanien c121 a une autre origine : à l’intérieur des mots il est sorti d’un t, par l’influence rétroactive d’unt suivi lui-même d’une autre voyelle2; exemple : deganéiôs (génitif singulier) à côté du nominatif deganti «brûlante» (en sanscrit dâhantîy
La moyenne palatale (w g) manque en slave, mais non en lithuanien, où dz tient dans la prononciation la place du sanscrit dj ; on aurait donc raison de le transcrire par g. Au commencement des mots, cette lettre est très-rare dans les termes véritablement lithuaniens; au milieu, elle provient d’un d, qui se change en dz dans les mêmes circonstances qui font changer un t en é; exemples : zôdziô «verbi», zôdziui « verbo » (datif), zôdiei «verba», à côté du nominatif singulier iôdis. Le thème est proprement zôdia, qu’il faudrait toutefois prononcer, d’après la règle indiquée, iôdzta ou wdîie,(% 92k).
$ g 2 â. La dentale 9 z.
9 z se prononce ts comme le z allemand; mais il est, sous le rapport étymologique, comme m c, une altération de k, et il remplace k dans certaines circonstances, sous l’influence rétroactive de h î et de •*> ê (Dobrowsky, p. ûi). Exemples : neijn pezi « cuis » (impératif), n£9'bT€pezête «cuisez» (impératif), de la racine 7tsk (sanscrit pac venant depak), présent pekun, 2e personne pec-e-si (sanscrit pâc-a-si), Lu'nitifpes-ti.
~ % 92k. Lèj slave, ra ja, l&jan, t€ je, io ju, tfhjvn.
L’alphabet cyrilïien n’a pas de lettre à part pour le j : en eflet, cette lettre, dont la forme est a peu près celle de l’f grec, se joint par un trait d union avec la voyelle simple ou la voyelle nasalisée 122
suivante, de manière à former corps avec elle. De là proviennent différentes combinaisons qui comptent comme lettres à part : m ]a, i&jan, k je, to ju (8 99c) vh jun. La combinaison d’un^' avec un 0 bref ne se trouve pas en ancien slave, attendu qu’un j, en vertu de sa puissance d’assimilation, change To suivant en c * ; exemple : KpdKMS krajemü (datif pluriel) pour krajomü, du thème krajo «bord»; la voyelle finale de ce thème est supprimée au nominatif et à l’accusatif singuliers, et la semi-voyelle devient de sorte que nous avons Kp<w krai «margo, marginem», pour krajü. Comparez à cet égard les nominatif et accusatif lithuaniens des thèmes masculins en ia, comme jaunikis «fiancé», jamikïn, pour jaunikia-s, jaunikia-h ( jaunikiô ), et les mêmes
formes en gothique comme hmrdei-s (= hairdî-s, § 70), hairdi, du thème hairdja. Quelquefois il n’est resté en ancien slave que le c de K, le y ayant été supprimé : par exemple, au nominatif-accusatif des thèmes neutres en jo, comme mopc «mer», pour Mopie, du thème morjo. Après les sifflantes, y compris m c et g z qui, d’après ia prononciation, se terminent par une sifflante, le/ est généralement supprimé ; exemples : Aoyiiid dusa «âme» (lithuanien dusià) pour drnja, venant de duchja; m^?k€A\l muhsemï ( instrumental ) pour munsjemî, venant de munêjomï, du thème munêjo « homme » (comparez le sanscrit manusyà « homme »), nominatif-accusatif munit2.
Il y a, en lithuanien un fait analogue à ce changement, qui se produit en slave, de l’o en c, quand il est précédé dunj : les thèmes masculins en ia (nominatif en is) changent à plusieurs cas leur a en e, sous l’influence de IV qui précède, notamment au datif duel et au nominatif-vocatif, au datif et à l’instrumental pluriels; de sorte que dans cette classe de mots la forme ia est presque aussi 123
rare que jo en slave123. Comparez jaunikim, jaumkiei, jamikiems, jaunikieis, du thème jaunikia, avec les formes correspondantes pônam, pônai, ponants, panais, du thème pôna, nominatifpowas «seigneur».
J’explique aussi par l’influence de Yi la différence de la troisième et de la deuxième déclinaison (voyez Mielcke ou Ruhig). Le nominatif devrait être en ia, et le génitif singulier et le nominatif pluriel Qu iô-s, au lieu qu’on a e, &s,\t étant tombé apres avoir changé l’a suivant en c, et l’o en ^(= ë) ; nous avons vu plus haut le même fait pour les formes slaves en e au lieu de K. Je crois de même que Ye des féminins lithuaniens comme zwake «lumière», giesme «chant» (Mielcke, p. 33), vient de ia ou ja, et leur ê'(ë) de iô ou fl ; ce qui tend à le faire croire, c’est le génitif du duel et du pluriel, où IV ou le j se sont maintenus à cause de Yû qui suivait ; exemples : zwakiû, giesmjû124 125.
Les palatales 6, dé (= Wg) empêchent le changement de k, iô en e, ê'; exemples : winivia « vigntf», génitif winicios, datif winicki; pradzk «commencement» (pra-dêmi «je commence»), pradziôs, pradziai, et non wMice, pradze, etc. Il faut donc attribuer aussi 1 exception swecias à l’influence du c.
Je fais encore remarquer ici que l’é de la cinquième déclinaison latine, que je regarde comme primitivement identique avec la première, peut s’expliquer également par l’influence euphonique de IV qui presque toujours le précède. Mais la loi est moins absolue en latin qu’en lithuanien, car, à côté de la plupart des
mots en iê-s, se trouvent les mêmes mots en ia; exemples : effigiu,
pauperia, canitia, planitia, a cote de ejfigiê-s, pauperiê-s, amitiés, phnitiê-s.
Enzend on trouve des nominatifs féminins singuliers en yê pour ya (forme abrégée de yâ), dont Yê doit être expliqué sans aucun doute par 1 influence du y : cela ne s’écarte pas beaucoup de la réglé établie plus haut (S A a), qu’il faut, pour changer en ê un a ou un â, outre le y qui précède, un i, î ou ê dans la syllabe suivante. Voici des exemples de nominatifs zends en yê ;
brâturyê « cousine », de brâtar ou brâtarë{% fxk) « frère », XjJiLÿp tûiryê kune parente au quatrième degré». Dans kainê « jeune fille»126, le son qui a produit Yê est tombé, comme dans les formes lithuaniennes zwakQf ^icsine; au contraire, dans
nyâkê «grandmère», et K>l&eipêrmê «plena » (ce dernier mot se trouve souvent construit avec sâo « terre » ), l’é est sorti,
sans cause particulière déterminante, d’un af venant lui-même d un a; les masculins correspondants sont : nyâkâ « grand-père ». përënô « plenus », des thèmes nyâka ( d’origine obscure ) et përëna2. Mais Yê féminin ne s’étend pas en zend au delà du nominatif singulier, et nous avons de kainê l’accusatif kanyanm = sanscrit hi-
nyam. Je ne connais pas de cas obliques de brâturyê, nyâkê, përënê.
En ce qui concerne la représentation du son j en ancien slave, il faut ajouter que dans les cas où lej se réunit en une syllabe avec la voyelle qui précède, il est représenté dans les manuscrits les plus récents et dans les livres imprimés par à, et simplement par h dans les manuscrits plus anciens. La propension que le slave semble avoir pour la combinaison ij se retrouve dans l’an-
9 MVA“V «wiiuw », ^iiiiuc plus» IJdltl (ül C)2 j,
nous avions en slave djeva «vierge», de T^oT^dît? «briller».
........de laracine par- (pf), u’ou vient piparmi «je remplis». Le
tend përëna suppose en sanscrit une forme parna.
rien perse, où les terminaisons sanscrites en i reçoivent régulièrement le complément de la semi-voyelle y (le/ allemand), de même qu’un u final est complété par la semi-voyelle correspondante v. L’ancien slave préfère aussi aux diphthongues ai, ci, ci, oi, in, ui, les groupes aj, ej, êj, oj, iij, uj, dont le j est représenté également dans les manuscrits plus récents et dans l’impression par M (dH, CM, 'ÈH, SIM, OVfÜ).
Mais la où m ne forme pas de diphthongue avec la voyelle précédente, il doit être prononcé jt, suivant Miklosich \ de sorte que, par exemple, pdü «paradis» se prononcera raj; mais le pluriel pdM sera prononcé raji. Mais je ne transcris jamais m que par un G en me contentant de faire observer ici que cet i forme à lui seul une syllabe apres les voyelles : en effet, l’ancien slave ne connaît pas de diphthongue ayant i comme deuxième élément ; il le remplace par la semi-voyelle correspondante, comme dans a\om moj « meus» à coté du dissyllabe mom moi2 «mei».
$ 9a \ Les sifuantes.
Des sifflantes enumerees plus haut [h q2g), la première, c $, correspond, sous le rapport étymologique, aussi bien à la dentale qua la palatale s (1^) sortie du k, Au contraire, et cela est important a faire observer, le lithuanien distingue ces deux 126
lettres et présente d’une façon régulière s pour le «.? sanscrit., et s126 pour le Comparez sous ce rapport : ^
|
Sanscrit. |
Lithuanien. |
Slave. |
|
sa |
sü | |
|
svâpna-s «rêve» |
sapna-s |
süpanije ff sommeil a |
|
svadu-s « doux « |
saidks (S ao) |
siadü-kü |
|
svâsâ ff sœur « |
sessû |
sestra |
|
sata-m «cent» |
simta-s |
süto |
|
(Usa rrdixfl |
désimti-s |
desantt |
|
sa fia cr branche» |
sakà |
russe suk |
|
svit ccêtre blanc»129 |
swêciu tfj’éclaire» |
svêtü ff lumière »/l |
|
àsvâ ce jument» |
âswa | |
|
asm tr larme » |
asara | |
|
aêtdns «huit» (thème) |
aêtûni |
osmï. |
|
Le lithuanien ne |
manque pas non plus |
de formes où le s pur |
remplace le * sanscrit. Nous en avons un exemple dans wisa-s «chaque», pour le sanscrit visva-s.
( Le Ul slave a la prononciation du s sanscrit; mais il s’est formé d’une façon indépendante; il est sorti comme celui-ci et comme le sch allemand, quand ce dernier remplace le s du vieux et du moyen haut-allemand (S i7), d’un s pur. Ainsi, par exemple.
mu si, désinence de la 2e personne du singulier du présent, répond à la désinence sanscrite si, et, à la différence du sanscrit, la terminaison lithuanienne ne varie pas, quelle que soit la lettre qui précède (comparez § 21b) ; de là, par exemple, ?khb£üih îtivesi (sanscrit gîv-a-si'j et tu vis», mamlum imasi et tu as», malgré Y a du dernier exemple, lequel ne permet pas en sanscrit le changement de s en s. Le s pur s’est, au contraire, conservé dans kch jesi ee tu es » = sanscrit dt-si pour âssi; B'kcn vêsi ee tu sais » = sanscrit vêï-si, venant de vê’d-si; racn jasi «tu manges» = sanscrit dt-si, pour àdrsi; Ad-CH dasi eetu donnes» = sanscrit dâdâ-si. Ce qui me paraît déterminer en slave la conservation de la sifflante dentale primitive, dans les désinences personnelles, c’est la longueur du mot : les thèmes verbaux monosyllabiques ont seuls conservé l'ancien s, tandis que les thèmes polysyllabiques l’ont affaibli en s; de là l’opposition entre imasi d’une part, et jasi, dasi de l’autre132. On peut regarder 111 s, partout où il tient la place du c s, comme un affaiblissement de cette lettre : il n’y a pas d’autre raison à donner de ce fait que la loi commune de toutes les langues, qui sont sujettes à s’user et à se détruire. C’est ainsi que la racine sanscrite siv « coudre » est devenue en ancien slave siv, d’où vient sivuii «je cous», tandis que la forme lithuanienne suwu a conservé la dentale sanscrite. iuo\fH Sut « gauche », thème sujo, a également un s au lieu du s qui se trouve dans le thème sanscrit savyd. Au contraire, le s slave se rencontre fortuitement avec le é sanscrit dans msilul müêï «souris», thème müsjo, en sanscrit mûsd^s, de la racine mûs «voler», laquelle a changé son s en s d’après une loi euphonique particulière au sanscrit (§ 2ib). C’est probablement aussi au hasard qu’il faut
attribuer la rencontre d’un s initial dans sestï «six» et dans le lithuanien sesini avec le s initial du sanscrit sas (§ ai1).
En ce qui concerne les sifflantes molles 3 s et m s, en lithuanien z, z, je les transcris, comme les lettres zendes correspondantes^, §§ 57, 69) par s, L Sous le rapport étymologique, ces sons proviennent presque toujours de l’altération d’anciennes gutturales, et ils se rencontrent quelquefois avec les palatales sanscrites et zendes, parce que celles-ci sont également d’origine gutturale (§88). En lithuanien z a la prononciation du 3 slave, et z celle de ai, quoique z soit moins fréquent en lithuanien que 3 en slave, et qu’on trouve ordinairement, là où la gutturale n’est pas restée, un z à la place de 3 (§ 88 ). Un exemple de z pour le slave 3 sf est zwâna-s «cloche», et le verbe zwâniju^]e sonne la cloche », à côté du slave 3K0H3 svonü « sonnette », 3KUV&TW svtnêti « sonner ». Miklosich (Radiées, p. 31) rapproche de ces expressions la racine sanscrit dvan; mais je les crois plutôt de la même famille que la racine sanscrite svan «résonner», en latin son (§ 3); en effet, quoique le slave 3 $ soit ordinairement l’altération d’une gutturale molle, il n’y a rien de surprenant à ce qu’une sifflante dure se soit changée, dans certains cas, en sifflante molle. Aussi approuvons-nous Miklosich, quand il rapproche 3£H3Ad svêsda «étoile» de la racine sanscrite s'vid «briller» (ou plutôt svind), ap'&TH srêti «mûrir», de ^ïT srâ «cuire» (d’où irrégulièrement srld-s «cuit»), 3£iGdTM sübati «agitare», de ksuB (causatif kêâ-Bâyâmi «j’ébranle »), avec perte de la gutturale qui est cause en sanscrit du changement de 5 en é. Peu importe que dans les deux premières formes le 3 s slave corresponde en sanscrit à un * palatal, lequel est sorti de la gutturale k : en effet, le slave remplace par c le ^ é aussi bien que le ^ s, et le changement du k sanscrit en sa eu lieu antérieurement à la naissance des langues slaves et lettes (§ ai0); il n’est donc question ici que du changement d’un s duron s mou. Une transformation du même
genre se rencontre dans ie mot p»3d risa «habit» (sanscrit ms «habiller», latin vestis) et dans les mots de même famille, si j’ai raison d’admettre que le v s’est altéré en r (§ 20).
H faut encore mentionner ici une autre loi particulière au slave : quand un a est suivi d’un j, ou d’un h ï venu d’un y et d’une voyelle, on insère un ?k s devant ce a ; dans les mêmes conditions on insère un lu s devant le t. Exemples : mmAh jasdï « mange, qu’il mange », pour le sanscrit adyâs « edas », adyât «edat»; Ad^Ai* dasdi «donne, qu’il donne», pour le sanscrit da-dyâs « des », dadyât « det » ; B'fcffiAt vêsdt « sache, qu’il sache », pour le sanscrit vidyâ’s «scias», vidydt «sciât»; koîkai» vosdï «conducteur», du thème voêdjo^ racine ved, vod, «conduire»). Le y tombe lui-même dans le cas où la voyelle qu’il précédait est conservée ; exemples : rocno?KAd gosposda «domina», pour gospodja; pOmA<ft rosdun «gigno», imparfait pOrftAdd/C rosdaachü, pour rokljuh, rosdjaachü; <vw>uitæi munstun «j’obscurcis», pour muhstjuh, par opposition à iuîkah jasdï, etc. On aurait eu iïipkak jasdje (= sanscrit adyâs, adyât) si l’d long sanscrit des formes comme adyâs s’était affaibli en 0 (S 92k), ou xâKxrn jasdja, si le Wï â s’était simplement abrégé. Mais la voyelle du caractère modal yâ a été complètement supprimée dans le petit nombre de verbes slaves (il n’y en a que trois) qui se rapportent à la seconde conjugaison principale ; quant à la semi-voyelle, elle s’est vocalisée en h i devant les consonnes (exemple : lûi&AWTtjasd-l-te « mangez » = sanscrit ad-yâ-ta)9 et à la fin des mots elle est devenue i. ï (m^At jasdï — sanscrit ad-yâ-s « edas », ad-yâ-t « edat »).
D’accord avec Miklosich \ je regarde les groupes ?ka §d et lut êt comme provenant de la métathèse de ds, ts (de même que le dorien e?8 pour £ - &), sans voir toutefois, comme le fait le même savant, dans la sifflante une transformation de la lettre /.
1
Phonologie comparée, p, 186 sa.
Les mots cités plus haut jasêt, dasdi, vêsdï, où le t. ï est, comme on l’a montré, un reste d’une syllabe commençant parj, parlent, suivant moi, contre cette hypothèse ; il en est de même de formes comme eo?kal vosdï « conducteur », du thème vosdjo. Si l’on prenait le s, par exemple, dans dasdi, pour une transformation de j, le y sanscrit et Yt grec ( dans StSo-t'n-s, ) serait double
ment représenté, une fois par l ï et une autre fois par ê. Si, au contraire, on explique dasdi par dadsï, et celui-ci par une modification euphonique de dadï, on se trouve d’accord avec la loi mentionnée plus haut (§ 92h) qui veut quen lithuanien on dise zôdziô pour zôdiô, et qui a fait sortir dz ( — slave a?k ds j dun d suivi d’un i accompagné d’une autre voyelle, et c = tui , d un t placé dans les mêmes conditions. Nous mettons donc dans les formes citées plus haut, comme muhêtun «j’obscurcis », le st slave (résultant de la métathèse de té ou m = fs) à coté du c lithuanien de formes comme deganctô (venant de degantiô), et nous comparons, par exemple, wezenciô (= wezentsiô) «vehentis», au génitif slave correspondant vesahsta (pour vesaniüTja, lequel est lui-meme pour vesaiitsja). Nous reviendrons plus tard sur le complément ja, en slave jo, qu’a reçu en lithuanien et en slave le suffixe sanscrit nt aux cas obliques.
Je rappelle encore ici qu’en ossète la 3e personne du pluriel du présent a changé en c = ts le t primitif de la désinence, par l’influence de Yi qui précédait ce t ; exemple : canné « ils vivent »133. Le cas est d’autant plus remarquable, qu’en sanscrit le participe présent a, par son suffixe nt, une analogie apparente avec la 3e personne du pluriel nti, et que de cette dernière forme on peut toujours induire celle du participe présent : ainsi, par exemple, de l’irrégulier usdnti «ils veulent» (racine vas, § a6, x ), on peut inférer le thème du participe usant (dans les cas forts).
.S 99 Loi ie suppression des consonnes finales dans les langues slaves
et germaniques.
La loi déjà mentionnée plus haut (S 86, 2b), d'après laquelle toutes les consonnes finales primitives sont supprimées, à l’exception de la nasale faible renfermée dans a et ^ (S 92“), a exercé, sur la grammaire des langues slaves, une influence considérable, mais destructive L Par suite de cette loi, on ne trouve, dans les langues slaves vivantes, d’autres consonnes à la fin des mots que celles qui, primitivement, étaient encore suivies dune voyelle, comme le slovène delam «je travaille», 2epersonnedelaé, venant de delami, delasi; au contraire, à l’impératif, nous avons delaj aux trois personnes du singulier, parce que, dans le potentiel sanscrit correspondant, le mot est terminé par les désinences personnelles m, s, J134 135. Même dans l’ancien slave, beaucoup de
terminaisons n’ont trouvé d’explication et n’ont pu être comparées aux formes équivalentes des autres langues que par la découverte de cette loi. Des formes comme nebes-e «cœli», nebes-ü «cœlorum», sünov-e «filii» (pluriel), peuvent maintenant être rapprochées des formes sanscrites, comme nâBas-as, ndBas-âm, sûnâv-as, et des formes grecques comme i>^(pe(<7)-os, ve<p^(cr)-aw, /Bérpvss, au même droit que nous avons rapproché plus haut (86, ab) le gothique bairai et le grec <pépot du sanscrit Bdrêt et du zend barôid. Dans la déclinaison des thèmes féminins en a a, on trouve si ü au génitif singulier aussi bien qu’au nominatif et à l’accusatif pluriel; il correspond, dans les deux premiers cas, au lithuanien ô-s (pour a-s), et, dans le dernier, au lithuanien as. Comparez pÆK2i runkü (%8tp6s,xs*pss) avec le lithuanien rankô-s, qui a le même sens, et vidovü «viduæ» (nominatif pluriel) avec le nominatif pluriel sanscrit vidtwâs. À l’instrumental pluriel, il y a, en slave, des formes en si ii, venant de thèmes en o (sanscrit et lithuanien a), et des formes en mi venant d’autres classes de mots. Cette différence se retrouve en sanscrit, où les thèmes en a font leur instrumental pluriel en dis, de même qu’en lithuanien il est terminé en ais, au lieu que toutes les autres classes do mots forment le même cas en Bis, en lithuanien mis, pour bis. Le slave SA2K2i vlukii répond donc au lithuanien wilkais qxemple, les formes gothiques bair-i-th et bair-a-m se rapportent à U7fH bar-a-ti et tidr-â-mas (S 18). On aurait pu regarder le 2,- même en lui donnant, avec Miklosich, la prononciation m, comme un complément euphonique des consonnes finales, de même que l’a gothique des ûeutres, comme thata (en sanscrit tat) et des accusatifs singuliers masculins, comme tka-na (en sanscrit ta-m, en grecro-r), ou de même que l’a italien des formes comme amano, venant de amant. Dans ces formes, l’addition d’une voyelle euphonique était nécessaire pour préserver la consonne, qui, sans cela ^ serait tombée aussi. C’est pour la même raison que nous avons le gothique bairaina «ferant»; le vieux haut-allemand, en supprimant plus tard cet a inorganique, est retourne à une forme plus rapprochée du type primitif. Nous avons, en vieux haut-allemand, bërm, en regard du gothique bairaina.
(du thème wilka = sanscrit vfka, venant de varka «loup») et au sanscrit vfkâis; au contraire, le slave ruhka-mi répond au lithuanien rankô-mis et le slave vïdova-mi au sanscrit vidhvâ-îîis. Mais si, pour le sanscrit sûnu-ëis et le lithuanien sunu-mis, on trouve, en ancien slave, au lieu de sünü-mi ou sünü-mi la forme sünü, cela vient de ce que les thèmes en o (venant de a) et les thèmes en u se sont mêlés dans la déclinaison slave. Nous y reviendrons.
Le lithuanien se distingue des autres langues slaves, en ce qui concerne la loi des consonnes finales, par certaines formes grammaticales où le s final est resté; il a, par exemple, sunau-s pour le sanscrit sûnô-s (de sûnaû-s) «filii» (génitif); aswôs «equæ» (nominatif pluriel), venant de aswâs =* sanscrit âévâs (nominatif et accusatif pluriel); mais, dans les désinences personnelles, le h final est complètement perdu, contrairement à ce qui est arrivé dans la déclinaison, qui a conservé le s partout où elle Ta pu (excepté au génitif duel, où il est également perdu en zend). Nous avons donc sek-a-wa « nous suivons tous deux » au lieu du sanscrit sàc-â-vas; sek-a-ta « vous suivez tous deux» au lieu du sanscrit sac-a-'tas; sek-a-me « nous suivons» au lieu du sanscrit mc-à-mas. On aurait pu trouver le t final, entre autres, à la 3e personne de l’impératif, qui remplace le potentiel sanscrit; mais il a été supprimé : este «qu’il soit (te este «afin qu’il soit») au lieu de
Ut^sijât (pour asyât), en vieux latin siet, en grec gfrj; dédie (te düdie) «qu’il donne», au lieu de dadydt, en slave dasdï
(S 991), en grec SMtj. Pareille chose est arrivée dans les langues germaniques, qui, dètoutes les consonnes finales primitives, n’ont guère conservé que le s (pour lequel on trouve aussi, en gothique, *) et le r dans des mots comme le gothique brôthar «frère » = sanscrit Brâtar (thème et vocatif). Le vieux haut-allemand a déjà perdu le s final à beaucoup de désinences grammaticales qui l’ont encore en gothique. Comparez, par exemple :
im
<*t»nr> 1
Vieux haut-allemand.
Golhique.
vulf S ff lupus 57 vulfos wlupin (pluriel)
wolf wolfâ gëbô
isos rrejus» (féminin) anslais ergratiæ» (génitif) ansteis (nominatif pluriel)
■ A
tra ensti ensti.
Hormis s et r, on ne trouve d’autres consonnes finales, dans les langues germaniques, que celles qui, à une période plus ancienne, étaient suivies d’une voyelle simple ou d’une voyelle accompagnée d’une consonne (SS 18 et 86, 2b). Mais par suite de cette mutilation, on trouve, à la fin des mots, des dentales, des gutturales, des labiales, ainsi que les liquides l, m, n, r; exemples : baug «je courbai, il courba », pour le sanscrit buUôga; saislêp «je dormis, il dormit», pour le sanscrit susvâpa; vulf «lupum» pour le sanscrit vrkam, le lithuanien wilkah; stal «je volai, il vola», avec suppression de l’a final; mêl « temps »( thème mêla); auhsan «bovem», pour le sanscrit ükêân-am (védique uksàn-am); bindan «lier», pour le sanscrit bândana-m «faction de lier». La désinence un de la 8e personne du pluriel du prétérit est à remarquer : le n était suivi, dans le principe, d’un d, et, plus anciennement encore, de la syllabe di (comparez le dorien TBTvÇavrt); il y a, par conséquent, le même rapport entre saislêpun «ils dormirent» et saislêpund, venant de saislêpundi, qu’entre l’allemand moderne schlâfen (sie schlâfen «ils dorment») et le gothique slêpand = sanscrit svdpanti.
MODIFICATIONS EUPHONIQUES AU COMMENCEMENT ET A LA FIN DES MOTS.
$ 98“. Lois euphoniques relatives aux lettres linales en sanscrit. Comparaison avec les langues germaniques.
'■Nous retournons au sanscrit pour indiquer celles des lois phoniques les plus importantes qui n’ont pas encore été mentionnées,
En parlant de chaque lettre en particulier, nous avons dit de beaucoup d’entre elles qu’elles ne peuvent se trouver à la fin d’un mot, ni devant une consonne forte dans le milieu d’un mot ; nous avons ajouté par quelle lettre elles étaient remplacées dans cette position. II faut observer, en outre, que les mots sanscrits ne peuvent être terminés que par les ténues, et que les moyennes ne peuvent se trouver à la fin d’un mot que si le mot suivant commence^par une lettre sonore (8 25); dans ce dernier cas, si le mot précédent est terminé par une moyenne, on la conserve, et, s’il est terminé par une ténue ou une aspirée, elle se change en moyenne. Nous choisissons comme exemples harit «vert» (comp. viridis), vêda-vid «qui connaît les Védas», dana-lâB «qui acquiert des richesses». Ces mots n’ont pas de signe du nominatif (S 9^)» on a donc, par exemple, dsti harit, âsti vêda-vit, asti dana-lap; au contraire, haridasti, vêda-vid asti, dana-htb asti; ou encore harid Bavati, etc.
Le moyen haut-allemand a quelque chose d’analogue : il conserve, il est vrai, les aspirées à la fin des mots, en changeant seulement la lettre sonore v en lettre sourde f (8 86,3 ), mais il est d’accord avec le sanscrit en ce qu’il remplace régulièrement, a la fin des mots, les moyennes par des ténues indépendamment de la substitution exposée au § 87 ; ainsi nous avons , à côté des génitifs toges, eide8f wibes, les nominatifs et accusatifs singuliers tac, eît, wîp, lesquels ont perdu la désinence et la voyelle finale du thème (S 116 ). De même encore dans les verbes : ainsi les racines trag, lad;gmb forment ,■ a la ire et à la 3e personne du singulier du prétérit (laquelle est dépourvue de flexion) truoc, luot, gruop; au pluriel truogen, luoden, gruoben. Là, au contraire, ou la ténue ou l’aspirée (excepté le v) appartiennent à la racine, il n’y a pas de changement dans la déclinaison et la conjugaison; exemples :
1 J’ai attiré l’attention sur nn fait semblable, en albanais, dans ma Dissertation sur cette langue, p. 5a.
mort «parole », génitif wortes et non mordes, de même qu’en sanscrit dddat « celui qui donne », fait au génitif dâdatas et non dd-dadas; mais on aura vit «celui qui sait», génitif vidas, du thème vîd. En vieux haut-allemand, les manuscrits ne sont pas d’accord; celui d’Isidore se conforme à la loi dont nous parlons, en ce sens qu’il change un d final en t, un g final en c; exemples : mort, mordes; dac, dages.
Le gothique n’exclut de la fin des mots que la moyenne labiale, mais il la remplace par l’aspirée et non par la ténue ; exemples : gaf * je donnai», à côté de gêbum, et les accusatifs hlaij lauf, thiuf, à côté des nominatifs hlaibs, laubs, thiubs, génitif hlai-bis, etc. Les moyennes gutturale et dentale (g,d) sont souffertes h la fin des mots en gothique, quoique, dans certains cas, on rencontre également, pour les lettres de cette classe, une préférence en faveur de l’aspirée. Comparez bautk «j’offris » avec budum «nous offrîmes», de la racine biid; adi «j’ai» avec cdgum «nous avons ».
Il peut sembler surprenant que l’influence de la lettre initiale d’un mot sur la lettre finale du mot précédent soit plus grande, en sanscrit, que l’influence de la lettre initiale de la désinence grammaticale, ou du suffixe dérivatif, sur la lettre finale du thème; en effet, les désinences et les suffixes commençant par une voyelle, une semi-voyelle ou une nasale, n’amènent aucun changement dans la consonne qui précède. On dit, par exemple, yud-ds « du combat », yud-yâ-tê « on combat », hant-as « viridis » (génitif), pdt-a-ti « il tombe », tandis qu’il faut dire ^ yûd asti où Tp^dsh y ut, harid asti, etc. Je crois que
Bœhtlingk136 â indiqu é la vraie cause de ce fait : c’est qu’il y a une union plus intime entre les deux parties d’un mot qu’entre la lettre finale et. la lettre initiale de deux mots consécutifs. Dans
1 Bulletin historique de l'Académie, de Saint-Pétersbmirff, l. VIII, n° n .
le premier cas, 1 union est aussi grande que s’il s’agissait des lettres composant la racine d’un mot; il n’y a pas moins d’afïi-nité entre le i de yuiï et la syllabe as, qui marque le génitif (yud-ds qu’il faudrait diviser phoniquement ainsi : yu-das), ou entre yuiï et la syllabe y a, indiquant le passif dans yudydtê (= yu-dyâtê), ou encore entre la racine sak «pouvoir» et la syllabe nu, marquant la classe verbale dans éaknumds (s'a-knumds) «nous pouvons », qu’il n’y en a, par exemple, entre le d et la de ddna-m «richesse», ouïe iïet le y de la racine dyâi «penser», ou le k et le na de la racine knai «blesser». En d’autres termes, la lettre finale de la racine ou du thème se rattache à la syllabe suivante et en devient partie intégrante. Au contraire, les consonnes finales appartiennent entièrement au mot qu elles terminent; mais elles se conforment, pour des raisons euphoniques, à la lettre initiale du mot suivant, en ce sens que la ténue finale, devant une lettre sonore, devient elle-même une sonore. C’est la même opinion, au fond, qu’exprime G. de Hum-boidt \ quand il dit que la lettre initiale d’un mot est toujours accompagnée d’une légère aspiration, et ne peut donc pas se joindre à la consonne finale du mot précédent d’une façon aussi étroite que la consonne se joint à la voyelle suivante à l’intérieur des mots.
Mais, d’un autre côté, si les groupes de consonnes qui paraissent à l’intérieur des mots ne se rencontrent pas ou ne sont pas possibles au commencement, si, par exemple, nou^ n’avons pas à côté de formes comme baddd «lié», hbiïâ «acquis» (par euphonie pour hand-ta, lub-td}, des mots ou des racines commençant par di ou bd', cela nous obligera à ne pas prendre trop à la lettre le principe qui dit que, à l’intérieur du mot, la consonne finale de la racine doit être jointe à la syllabe suivante. 136
Une racine commençant par bd serait à la vérité possible, puisque nous trouvons en grec des mots commençant par «7, (BS; mais ce qui est impossible, c’est de faire entendre deux muettes de la même classe (par exemple dd) au commencement d’une syllabe, que ce soit au commencement ou au milieu d’un mot. Je crois donc qu’il faut attribuer dans la prononciation de badda le d à la première syllabe et le dà la seconde, bad-d'a, et il paraît également plus naturel, ou du moins plus facile, de dire lab-dâ que la-biïâ.
La manière particulière dont sont prononcées les aspirées sanscrites (§12) est cause qu’une aspirée ne peut pas plus se trouver à la fin d’un mot sanscrit quelle ne peut se trouver, a l’intérieur d’un mot, devant une muette; en effet, la voix ne saurait s’arrêter sur bk ou dk prononcés à la façon indienne. Mais on voit que si, en réalité, le sanscrit unissait les consonnes finales aux lettres initiales du mot, ainsi que le prétendent les grammairiens indiens, il n’y aurait aucune raison pour éviter des rencontres comme yüd'asti apugna est». G’est donc la langue elle-même qui, par les modifications quelle impose aux lettres finales, nous invite à séparer les mots. Si le signe appelé virâma « repos» (^) ne parait pas approprié à séparer, dans l’écriture dêvanâgarî, un mot terminé par une consonne du mot suivant, on pourra en inventer un autre ou renoncer à l’écriture dêvanâgarî dans nos impressions. Pour ma part, je n’hésite pas à écrire ^ pour qu’on ne prononce pas yu-da-sti. Dans cer
tains cas pourtant, il est nécessaire de réunir les deux mots dans la prononciation; on ne peut pas prononcer, par exemple, dêvy asti «dea est» et vadb asti «femina est», sans réunir à la voyelle du mot suivant le y et le v, sortis, suivant les lois phoniques, d’un î et d’un u; mais cela ne doit pas nous empêcher de séparer les mots dans l’écriture, comme on ne peut se dispenser de les séparer dans l’esprit.
S 93La loi notkérienne. Changement d’une moyenne initiale en ténue.
On voit aussi, mais seulement dans Notker, que les lettres finales et initiales du vieux haut-allemand se combinent quelquefois d une façon opposée à la loi sanscrite que nous venons de mentionner*, c'est J. Grimm qui en fait le premier la remarque (I, i38, i58,18 i).Notkerpréfère, au commencement des mots, la ténue à la moyenne, et ne conserve cette dernière que si elle est précédée d une voyelle ou d une liquide f ; il la remplace par la ténue au commencement d'une phrase, ainsi qu’après les muettes (y compris h, ch, comme aspirée de /s) et si h devient doncp, g devient k, et d devient t; exemples : ihpin «je suis », mais th ne bin «je ne suis pas»; helphentpein «ivoire», mais mmiubeine «mes jambes»; abkot «idole», mais tninan got «mon dieu» (accusatif lehre mih kan «apprends-moi à marcher », mais wirgiengen «nous allâmes», laz in gan «laisse-le aller»; ih tahta «je pensai», orges tahton sic « ils pensèrent à mal », mais so Mita ih « ainsi pensai-je », Mais si le mot commence par une ténue provenant de la seconde substitution de consonnes (§ 87, 2), cette ténue reste invariable, même après les voyelles et les semi-voyelles, sans subir l’influence de la lettre finale du mot précédent2. Il n’y a guère, au reste, que les dentales qui permettent de constater ce fait, car pour les gutturales et les labiales, la moyenne gothique a géné-. râlement subsisté dans la plupart des documents, conçus en vieux haut-allemand, ainsi qu’en moyen haut-allemand et en haut-allemand moderne3. le renvoie aux exemples cités dans Graff
1 Le changement en question a lieu aussi hien dans les mots ciui ont conservé lu moyenne gothique ou primitive que dans ceux qui ont remplacé (S 87, 9 ) une ancienne aspirée par la moyenne.
2 Je m’écarte en ceci de l’opinion de Grimm et de celle que j’ai moi-même exprimée dans ma première édition (p. 90).
3 Voyez § 87, s. Même la racine d’où dérive l’allemand pracht doit être regardée comme ayant encore un b dans Notker; il en est de même de la forme notkérienne
pour constater cette persistance de la ténue, particulièrement du C Je citerai seulement ici : der tag chumet, in dien tagen, uber sie tages, aile taga, in tage, be tage, fore tage, fine tage te tage, an demo jungestin tage, jartaga, wcchetag, frontag, hungartag; do liez ik sie tuon, so tuondo, daz soit du tuon, ze tuonne, daz sie mir tuon, getan habet; mennischm tat, getat «action», ubiltat «méfait», ubiltatig «malfaiteur», wolatate «bienfaits», meintate «méfaits», missetat; fom demo mderen teile, geteilo «particeps», zenteilig «qui a dix parties»; getoufet «baptisé».
Il est très-rare que Notker ait un d pour le t qui remplace, en vertu de la seconde loi de substitution (S 87, a), le d gothique : le mot undat «méfait» est un exemple de ce changement; mais je regarde plutôt ce d comme un reste de l’ancienne moyenne gothique. De même on trouve quelquefois dag; mais ce qui rend cette forme suspecte, c’est que tag se trouve très-fréquemment après une voyelle ou une liquide; ainsi, à côté de allen dag (Psaumes, 55, 2), se trouve allen tag. Au contraire, il y a, parmi les mots qui, dans Notker, comme en moyen haut-allemand et en haut-allemand moderne, commencent par un d (pour le th gothique), un certain nombre de mots qui ne subissent que rarement le changement en t Ainsi le pronom de la 2e personne; exemples : daz soit du tuon « tu dois faire cela » ( Psaumes 10, b. 2 ) ; daz du (19,5); nés ist du (27, 1); gechertost du (A3. 19) ; so gibo ih dir (2, 8). Au commencement d’une phrase : du bist(3, A); du truhten ( A, 7); dugebute [7, 8). L’article aussi conserve volontiers son d : der man ist salig, der (ps, 1, 1); daz rinnenta wazzer;
correspondant à l'allemand pein et au verbe qui en dérive. La labiale de ces mots ne se trouve comme ténue, dans Notker, qu’au commencement d’une phrase et après d’autres consonnes que les liquides. Je n’attache pas grande valeur aux mots étrangers; il esb cependant digne de remarque que paradys et porta conservent leur p invariable après des voyelles et des liquides (fone paradyse, ps. 35, 13 ; 108, 15; diu porta, 113, 1 ; dim porta ,1/17,3).
t.
t3
ien weg dero rehton (1, 3 ). Abstraction faite de ces anomalies et de quelques leçons suspectes, je crois pouvoir réduire maintenant la loi notkérienne aux limites suivantes : i° les moyennes initiales se changent au commencement dune phrase, et après les consonnes autres que les liquides, en la ténue correspondante, mais elles restent invariables après les voyelles et les liquides; 20 les ténues et les aspirées initiales restent invariables dans toutes les positions. La seconde de ces deux règles pourrait même être supprimée, car elle va de soi, du moment qu’aucune loi ne prescrit le changement des ténues et des aspirées initiales.
89/1. Modifications euphoniques à la fin d’un mot terminé par deux consonnes, en sanscrit et en haut-ailemand.
Dans l’état où nous est parvenu le sanscrit, il ne. souffre pas deux consonnes à la fin d’un mot137, mais il rejette la dernière. Cet amollissement, qui n’a eu lieu qu’après la séparation des idiomes, car on ne retrouve cette loi ni en zend, ni dans les langues sœurs de l’Europe, a influé, en bien des points, d’une manière fâcheuse sur la grammaire; beaucoup de vieilles formes, que la théorie nous permet de reconstruire, ont été mutilées. On pourrait rapprocher de cette loi un fait analogue en haut-allemand : les racines terminées par une double liquide (//, mm, nn, rr ) ont rejeté la dernière dans les formes dépourvues de flexion et devant les consonnes des flexions. Il en est de même de deux h et de deux t; la dernière lettre tombe à la fin des mots ; exemples : stihhu «pungo», ar-prittu «stringo» font, à la ircet à la 3e personne du prétérit stah, arprat. En moyen haut-allemand, on rejette également dans la déclinaison la dernière lettre de ck et de ff, quand ils se trouvent à la fin d’un mot; exemples : boc, génitif bockes; grif, génitif griffes; dans te, c’est le t qui disparaît; exemple : schaz, schatzes,
1 Excepté dans les formes qui ont un r comme pénultième. (V. Grain, sansc. S 57.)
S 96. S euphonique inséré en sanscrit entre une nasale et une dentale,
cérébrale ou palatale. Faits analogues en haut-allemand et en latin.
Entre un ^ n final et une consonne sourde de la classe des dentales, des cérébrales ou des palatales \ on insère, en sanscrit, une sifflante de même classe que la muette qui suit, et le n est changé, par l'influence de cette sifflante, en anousvâra ou anounâsika («, n); exemples : dBamhstdtra ou alhvanstdtra «ils étaient là », pour dbavau tâtra; asminscdranê ou asminscdranê « à ce pied », pour asmin caranê. Ce fait a un analogue en haut-allemand : dans certains cas, on insère un s entre un n radical et le t d'une désinence ou d’un suffixe. De la racine ann «favoriser» vient, par exemple, en haut-allemand, an-s-t « tu favorises », on-s-ta ou onda «je favorisai », an-s-t « faveur » ; de brann vient brun-s-t « chaleur»; de ckan dérive chun-s-t «connaissance, science»; les mots modernes gunst, brunst et kunst ont conservé ce s euphonique. Le gothique ne suit peut-être cette analogie que dans an-s-ts et allbrun-s-ts « holocaustum ». En latin manstutor « qui manu tuetur » et mm-s-tmm (de moneo) ont un s euphonique de même sorte.
$ 96, Insertion de lettres euphoniques en sanscrit, en grec, en latin
et dans les langues germaniques.
Le « euphonique s’ajoute encore, en sanscrit, à certaines prépositions préfixes, à cause de la tendance qu’ont ces mots à s’unir avec la racine de la façon la plus intime et la plus commode. C’est ainsi que les prépositions sam, dva,pdri, prdti, prennent un * euphonique devant certains mots commençant par un k. Ce fait s’accorde d’nne manière remarquable avec le changement de ab 137
et de ob en abs et en obs devant c,q et p137 ; la préposition ab peut même se changer en abs à l’état isolé, devant les lettres que nous venons de nommer. Il faut aussi rapporter à cette règle le cosmit-tere pour committere, cité par Festus (voyez Schneider, p. 4j5), à moins qu’il n’y ait, dans ce composé, un verbe primitif, smitto, pour mitto. En grec, a se combine volontiers avec t, 3- et /a, et paraît, devant ces lettres, comme liaison euphonique, surtout après des voyelles brèves, dans des cas qui n’ont pas besoin ici d’une mention spéciale. Dans les composés comme craKecrTrdXos, je regarde le s, contrairement à l’opinion généralement adoptée, comme faisant partie du premier membre (§128).
■ Il reste à parler de l’insertion d’une labiale euphonique, destinée à faciliter la liaison de la nasale labiale avec un son dental. Ce fait est commun au vieux latin et aux langues germaniques : le latin insère unp entre un m et le t ou le ^suivant; le gothique et le vieux haut-allemand mettent un f entre m et t; exemples : sumpsi, prompsi, dempsi; sumptus, promptus, demptus; en gothique ‘ anÂanvM-f-ts « acceptation », vieux haut-allemand chuM-j-t v arrivée ».
En grec, on a encore l’insertion d’un fi euphonique après un
fx, et d’un ê après un v, pour faciliter la combinaison de /a, v avec
p (fis&yjfiGpta, (iéfx&\sTai, âvSpés; voyez Buttmann, Grammaire
grecque détaillée, S 19, note 2 ). Le persan moderne insère un d
euphonique entre la voyelle d’une préposition préfixe et celle du
mot suivant, be-d-ô « à lui ».
*
S 97. Modifications euphoniques à la tin des mots en grec et en sanscrit.
A la fin des mots, le grec nous offre peu de faits a signaler, a l’exception de quelques particularités de dialecte, comme p pour 138
0- (S 29). Le changement du v en y ou en ju, dans l’article (voir les anciennes inscriptions) et dans ow, êv et 'tsctXiv, quand ils sont employés comme préfixes, s’accorde avec les modifications que subit, en sanscrit, le TjTm final de tous les mots (S 18). Au reste, le v final est ordinairement venu, en grec, d’un p, et correspond à la lettre m (qui, en grec, ne peut se trouver à la fin des mots) dans les formes correspondantes du sanscrit, duzend et du latin. Souvent aussi le v est sorti d’un o- final; ainsi, au pluriel, (àsv (dorien pas), et, au duel, tqv correspondent aux désinences personnelles sanscrites mas, tas, tas. J’ai trouvé la confirmation de cette explication, que j’ai déjà donnée ailleurs, dans le prâcrit, qui a pareillement obscurci le s de termi
naison de l’instrumental pluriel, et en a fait km (voyez pour l’anousvâra § 9 ).
A l’égard des voyelles, il faut encore remarquer qu’en sanscrit, mais non en zend, on évite l’hiatus à la rencontre de deux mots, soit en combinant ensemble les deux voyelles, soit en changeant la première en la semi-voyelle correspondante. On dit, par exemple, dstîdâm «est hoc» et ^^y^Sf^dsty aydm «est
hic». Pour plus de clarté, et pour éviter l’agglomération autrement très-fréquente de deux ou de plusieurs mots en un seul, j’écris, dans mes dernières éditions, indiquant par l’a
postrophe que la voyelle qui manque au commencement de dam, est renfermée dans la voyelle finale du mot précédent. On écrirait peut-être encore mieux pour indiquer, dès le
premier mot, que sa voyelle finale est formée par contraction, et qu’elle renferme la voyelle initiale du mot suivant139.
MODIFICATIONS EUPHONIQUES À L’INTERIEUR DES MOTS, PRODUITES PAR LA RENCONTRE DU THÈME ET DE LA FLEXION.
S 98. Modifications euphoniques en sanscrit.
Considérons à présenties changements à l’intérieur des mots, c’est-à-diré ceux qui affectent les lettres finales des racines et des thèmes nominaux devant les terminaisons grammaticales; c’est le sanscrit qui montre, sous ce rapport, le plus de vie, de force et de conscience de la valeur des éléments quii met en œuvre; il sent encore assez la signification de chaque partie radicale pour ne point la sacrifier complètement et pour la préserver de modifications qui la rendraient méconnaissable, et il se borne à quelques changements légers, commandés par l’euphonie, et à certaines élisions de voyelles. C’est pourtant le sanscrit qui aurait pu donner lieu, plus que toute autre langue, a des modifications graves, car les consonnes finales de la racine ou du thème s’y trouvent souvent en contact avec d’autres consonnes qui les excluent. Les voyelles et les consonnes faibles (§ a5) des désinences grammaticales et des suffixes n’exercent aucune influence sur les consonnes précédentes; les consonnes fortes, si elles sont sourdes (S 35), veulent devant elles une ténue, et, si elles sont sonores, une moyenne; exemples : t et l ne souffrent devant eux que k, mais non U, g>g‘, que t, mais non L d, d, etc. Au contraire, ine souffle devant lui que g, mais non k, U, g; que b, mais non p, p, 6f. Les lettres finales des racines et des thèmes nominaux ont à se régler d’après cette loi, et l’occasion s’en présente souvent, car il y a beaucoup plus de verbes en sanscrit que dans les autres langues, qui ajoutent les désinences personnelles immédiatement à la racine, et il y a beaucoup de terminaisons casuelles commençant par des consonnes Byâm,
*ïp^byas, sw). Pour citer des exemples, la racine ad kmanger» forme bien âdmi «je mange», mais non âd-sT, dd-ti, ad-iâ; il faut dîna, àt-ti, at-tâ; au contraire, à l’impératif, nous avons ^rfli ad-dï «mange». Le thème V^pad «pied» fait, au locatif pluriel, T|T^pat-sü, et non pad-su; au contraire, makdt « grand » fait, à l’instrumental, mahâd-ëis et non mahdt-Uis.
§ 99*. Modifications euphoniques en grec.
Le grec et le latin, tels qu’ils sont arrivés jusqu’à nous, ont éludé tout a fait cette collision de consonnes, ou bien ils laissent voir quils ne sentent plus la valeur de la dernière consonne du radical; en effet, ils la suppriment tout à fait ou ils la modifient trop profondément, c’est-à-dire qu’ils substituent à une consonne d une classe celle d’une autre. Dans les langues en question, il y a moins souvent qu’en sanscrit occasion à ces rencontres de consonnes, car, a 1 exception de ès et de 1$ en grec, de es, de fer et de vel en latin *, et de ed dans l’ancienne langue latine, il n y a pas de racine terminée par une consonne qui ne prenne les désinences personnelles, ou, du moins, certaines d’entre elles, avec le secours d une voyelle de liaison. Le parfait passif grec fait une exception, et exige des changements euphoniques qui se font, en partie, dans la limite des lois naturelles observées en sanscrit, et en partie dépassent cette limite. Les gutturales et les labiales montrent le plus de consistance et observent, devant cr et r, la loi sanscrite mentionnée plus haut 98); ainsi l’on a x.~cr ^ et x-t, que la racine soit terminée par «, y ou y, et l’on a w-o*(=^), «r-T, que la racine soit terminée par /3 ou <p\en effet, les lettres sourdes a* et t ne souffrent devant elles ni moyenne, ni aspirée; exemples: 'téiptn-erai, Térptvr-Tai, de t pt€; réritéiuK-iou, de rvjç. Le grec s éloigné au contraire du sanscrit en ce que le p.
hfT-W, èa-[dv, èu-xé, iè-ficv, îa-xe, est, es-tis, fer-t, jer^is, vul-t, vul-lis.
i
ne laisse pas la consonne précédente invariable, mais qu il s assimile les labiales, et quil change en moyenne la ténue et l’aspirée gutturales. Au lieu de T&üp-juo», T^rpip-pai, «r^wXey-fM», vy-fxat, il faudrait, d’après le principe sanscrit (§98) têtutt-[âoli , Terpiê-fjwif, tffÊTrXex-fJtat, t^tvyj-fxcu* Les sons de la lamdle du t n’ont pas la même consistance que les gutturales; ils se changent en cr devant t et (x et ils sont supprimés devant a- (méneia-TOtt) zsénei-o'ou, TsiitCKT-gou au heu de 'GféivstT-tcu ^ <Gfé'jTBtT-(Tcu,
rséicei0-(âou ou TséTrsiS-fÂou'j. Dans la déclinaison, il n y a que le & du nominatif et celui de la désinence <rt du datif pluriel qui peuvent donner lieu à une accumulation de consonnes; or, nous re
trouvons ici les mêmes principes que dans le verbe et dans la formation des mots. Kh èt g deviennent k, comme en sanscrit (£= «-s), et b et joh deviennent]? (^ = -nr-s). Les sons de la famille du t tombent, contrairement à ce qui a lieu en sanscrit, et conformément au génie de la langue grecque, déjà amollie sous ce rapport : on dit urou-s pour ts6t-s, zyo-cr/pour tsot-vI.
§100. Modifications euphoniques en latin.
En latin, il y a surtout lieu à changement phonique devant le s du parfait et devant le t du supin et des participes; la gutturale sonore se change, devant s et t, en c; la labiale sonore, en p, ce qui est conforme à la loi sanscrite mentionnée plus haut (§98); exemples : rec-si (reæi), rectum} de reg; scrip-si, scrip-tum, de scrib. Il est également conforme au sanscrit, que h, comme aspirée, ne puisse se combiner avec une consonne forte (S 26). Quoique le J h sanscrit soit une aspirée sonore, c’est-à-dire molle (§ 23), et que le h latin soit, au contraire, une consonne sourde ou dure, les deux langues s’accordent néanmoins en ce qu’elles changent leur hf à, devants, en la ténue gutturale. Nous avons, par exemple, en latin, vec-sit (vexit) pour veh-sit, de même qu’en sanscrit on a dvâksît, de wih k transporter », et, en grec,
Ae/x-o-w (Ae/êw), de la racine A*^; cette dernière forme est analogue au sanscrit lêk-éyâmi cdingam??, de UL Devant t et i, le h sanscrit obéit à des lois spéciales, que nous ne pouvons exposer ici en détail; nous mentionnerons seulement que, par exemple, dah k brûler » lait, à fin fi ni (if, ddg-dum (pour ddh-tum), le t du suffixe se réglant sur la lettre finale de la racine et en empruntant 1 aspiration; au contraire,les formes latines, commevec-tum, trac-tum, restent fidèles au principe sur lequel reposent les parfaits vec-si, trac-si.
Quand, en latin, une racine se termine par deux consonnes, la derniere tombe devant le s du parfait (mul-si, de mule et mulg; spar-si, de sparg^ \ ce fait s’accorde avec la loi sanscrite, qui veut que de deux consonnes finales d’un thème nominal, la dernière tombe devant les désinences casuelles commençant par une consonne.
D devrait se changer en t devant s : elaud devrait, par conséquent, donner une forme de parfait claût-sit, qui répondrait aux formations sanscrites, comme d-tâut-sît « il poussa e, de tud. Mais le df est supprimé tout à fait ( comparez Tssi-ŒG)}, et cette
suppression amène;, par compensation, rallongement de la voyelle radicale, si elle est brève; exemple : di-uî-si; ou bien, ce qui est plus rare, le d s’assimile au s suivant, comme, par exemple, dans ees-si, de ced. Dans les racines terminées en t, qui sont moins nombreuses, c’est l’assimilation qui a lieu habituellement; exemple:CQn-'CUs-si, dé eut ; mais on a mî-si, et non mis-si, pour mit-siy de mit ou mitt.
Oh a aussi des exemples de b> m et r assimilés par le s dans jus-si, pvesi~$i, ge$-si1.
La racine ger n’a pas d'analogue bien certain en sanscrit ni dans les autres lang
ues
congénères, de sorte qu'on pourrait aussi regarder le s comme étant primitivement la lettre finale dé la racine, comme cela est certain pour uvo, its-si, us-tum (sanscrit uê ttbmler»), S’il était'permis (le regarder le g latin comme représentant ici, au
S i o î. Modifications euphoniques produites en latin par les suffixes
commençant par un t.
Parmi les suffixes formatifs, ceux qui commencent par un l méritent une attention particulière, à cause du conflit que produit le t en se rencontrant avec la consonne antécédente; prenons pour exemple le suffixe du supin. D après la loi primitive, observée par le sanscrit, un t radical devrait rester invariable devant tum, et d devrait se changer en t, comme fait, par exemple, Bêi-tum «fendre», de Bid. D’après les lois phoniques du grec, qui dénotent une dégénérescence de la langue, un d ou un t radical devrait se changer, devant t, en s. On trouve des restes de ce second état de la langue dans comes-tus ,comes-tura, claus-trum (comparez es-t, es-tis), de edo, claudo; mais, au lieu de comes-tum, comes-tor, on a comêsum, comêsor. On pourrait demander si, dans^ comêsum, le s appartient à la racine ou au suffixe, si c’est le d de ed ou le t de tum qui s’est changé en s. Là forme comes-tus semblerait prouver que le s est radical; mais il est difficile d’admettre que la langue ait passé immédiatement de estus à êsus; il est plutôt vraisemblable qu’il y eut un intermédiaire essus, analogue aux formes ces-sum, jis-sum, quas-sum, etc. le t de tum, tus, etc. s’étant assimilé au s précédent. De essum est sorti êsum, par suppression de l’un des deux s, probablement du premier,
commencement du mot, le h sanscrit, ainsi que cela arrive fréquemment au milieu des mots, je rapprocherais volontiers gero de la racine sanscrite har, hr «prendre», à laquelle se rapporte probablement le grec «main» («celle qui prend»). Mais -si la moyenne latine est primitive, il faut rapprocher gero, comme l’a fait Benfey (Lexique des racines grecques, II, p. i4o), du sanscrit grafy, védique grati «prendre», en y joignant aussi grâ-tm, dont le sens propre serait alors analogue à celui de aœceptus. Si le r de gero est primitif, son changement en s devant « et devant t repose sur le même principe qui fait qu’en sanscrit un r final devient s devant un t, t ou a initial (devant s le r peut aussi se changer en H); exemple : th'â'tas târdya « frère, sauve ! » Bridas sâèa « frère, suis !» car, quand de deux consonnes Tune est supprimée, c’est ordinairement la première qui tombe (eipi de no-m' de utoSW).
Une fois que, par des formes comme êsum, câ-sum, divî-sum, fis-sum, quas-sum, la langue se fut habituée à mettre un s dans les suffixes qui devraient commencer par un t, le s put s’introduire facilement dans des formes où il ne doit pas sa présence à l’assimilation. Cs (#) est un groupe fréquemment employé; nous avons ficsum, necsum, etc. pour Jîc-tum, nec-tum. Les liquides, a 1 exception de m, se prêtent particulièrement à cette introduction de s, et, parmi les liquides, surtout r; exemples : ter-sum, mer-sum, cur-sum, par-sum, versum. D’un autre côté, l’on a partum, tor-tum. S-t pour r-t se trouve dans gestum, si ger est la forme primitive de la racine (S îoo, note); tos-tum est pour tors-tum, et torreo par assimilation pour torseo L R reste invariable devant /dansfer-tus,fer-tilts, comme dans le sanscrit Mr-tum «porter», tandis qu’à la fin des mots r doit se changer en s devant un t initial (Eratas târâya, § 100, note).
L se trouve devant un s dans les formes latines fal-sum, pul-smn, vul-sum, mais devant t dans cul-tum. A la fin des mots cependant, le latin a évité le groupe h, parce que les deux consonnes se seraient trouvées réunies en une seule syllabe; aussi les thèmes en l ont-ils perdu le signe du nominatif s; exemples : sol pour sais, en grec ctX-s ; sol pour sol-s; consul pour consuls. C’est pour la même raison, sans doute, que volo ne fait pas, à la 9e personne, cul-s, mais vi-s, tandis qu’il fait vul-t, vul-tis.
N sa trouve devant t dans can-tum, ten-tum,, et devant s dans man-sum. Les autres formes en n-sum, excepté cen-sum, ont supprimé un d radical, comme ton-sum, pensum. 140
S 109, Modifications euphoniques produites dans les langues germaniques, en zend et en sanscrit par les suffixes commençant par un t.
Dans les langues germaniques, il n’y a que le t qui occasionne le changement euphonique d’une consonne radicale antécédente, par exemple à la 9e personne du singulier du prétérit fort; toutefois , en vieux haut-allemand, le t ne s’est conservé, à cette place, que dans un petit nombre de verbes qui unissent à la forme du prétérit le sens du présent* Les prétérits faibles, dérivés de ces verbes, présentent les mêmes changements euphoniques devant le i du verbe auxiliaire affixé. Nous trouvons que, dans ces formes, le germanique suit la même loi que le grec : il change la dentale ( t,th f d, et, de plus, en vieux et en moyen haut-allemand, z) en s devant un t. Ainsi,.en gothique, nous avons and-haihais~t « confessus es », pour and-haikait-t; qvas t « dixisti jj, pour qvath-t; ana-baus-t « præ-cepisti w, pour ana-baud-t. En vieux et en moyen haut-allemand, weis-t «tu sais jj est pour weiz-t. Le gothique forme de la racine vit, au prétérit faible, vissa «je sus jj, au lieu de vis~ta, venant de vit-ta; il ressemble en cela au latin qui a quassim pour quas~tum, de quat-tum (§ 101). Le vieux haut-allemand a également wis-sa; mais, à côté de cette forme, il en a d’autres, comme muosa, au lieu de muossa, venant de muoz, qui rappellent les formations latines câsum, claursum. 11 n’en est pas de même, en vieux haut-allemand, pour les verbes de la première conjugaison faible, qui, ayant la syllabe radicale longue (dans la plupart; la syllabe radicale est terminée par deux consonnes), ajoutent immédiatement le t du verbe auxiliaire à la racine. La dentale ne se change pas alors en s140, mais t, z et même d restent invariables; c’est seulement quand la dentale est précédée d’une autre consonne, 141
que t, «/sont supprimés, z, au contraire, est maintenu; exemples • «duxi», gi.neiz.ta «afflixi», ar_êd_ta
«volVi„ /m/t-to «hixi», pour feit-to; hul-ta «placavi», pour huld~ta. De deux consonnes redoublées on ne conserve que l’une et de ch ou cch on ne garde que le h; les autres groupes de consonnes restent intacts; exemples : ran-ta «cueurri», pour rann-ta; wanh-ta « vacillavi », pour wanch-ta; dah-ta « texi », pour dacch-ta.
Le moyen haut-allemand suit, en général, les mêmes principes; seulement le t radical, quand il est seul, tombe devant le verbe auxiliaire, de sorte qu’on a, par exemple, hi-te à côté du vieux haut-a lemand icit-ta; au contraire, dans les racines en Id et en rd, le dpeut être maintenu, et le t du verbe auxiliaire être supprimé ; exemple : dulde « toleravi » ( à moins qu’il ne faille diviser et expliquer le d par l’amollissement du « auxiliaire).
Le changement du g en c (comparez S 98), qui n’est, d’ail-eurs, pas général, n’a rien que de naturel; exemple : anc-te «arc-
am, pour ang-te; mais, contrairement à cette loi, le b reste invariable.
, î)eVa"t ,es ®uffixes formatifs commençant par un t\ il est de réglé, en gothique comme en haut-allemand, que les ténues et les moyennes gutturales et labiales se changent en leurs aspirées, quoique la ténue soit bien à sa place devant un «. Ainsi nous avons, en gothique, vah-tcâ rgarde», de vak; sauh-t(i)s «mala-ie», de suh; mah-l(i)s « puissance », de rnag; ga-shaf-t(As « création », deéap;fragif-t{i)s «fiançailles», degib, affaibli degab; vieux haut-allemand suhl, maht, giskaft « créature », gift « don » 2 Les dentales remplacent l’aspirée th par la sifflante (s), comme cela a lieu, en gothique, devant le t du prétérit, attendu que la
' A l’exception du participe passif à forme faible, en haut-allemand, lequel en
«fz:i^rbinai8on *1 ~,a radne’Buit ^ *>
* Sur des faits analogues en zend et en persan, voyez S 34.
combinaison de th avec t est impossible. Toutefois nous avons peu d’exemples de ce dernier changement: entre autres, l’allemand moderne mast, qui est de la même famille que le gothique mats «nourriture» et matjan «manger». En gothique, le s de blôstreis « adorateur » vient du t de blâtan « adorer » ; beist « levain » vient probablement de la racine bit «mordre» (S 27, et Grimm, II, p. 208).
Le zend s’accorde sous ce rapport avec le germanique, mais plus encore avec le grec, car il change les dentales en jjj s ou » $, non-seulement devant p t, mais encore devant g m ; exemples : irista «mort», de la racine iA» irit; basta «lié»,
de « guy band'y la nasale étant supprimée (comme dans le persan besteh, de bend}; aisma «bois», pour le sanscrit
'fVQidmâ. Le choix de la sifflante (» « ou « devant t) dépend de la voyelle qui précède, c’est-à-dire que » é se met apres le son a et «g s après les autres voyelles (comparez § 5i); ainsi l’on aura basta à côté de irista. Devant le d> qui ne com
porte pas une sifflante dure, on met par euphonie la sifflante douce^ s après le son a et fta ê apres les autres voyelles ; exemples : 4$*3 dasdi «donne», pour dad-di (qui suppose en sanscrit une forme ïçflr dad-dï), t'usta «il crût» (aoriste moyen),
pour ruita (§ 51). On peut rappeler a ce propos que le zend remplace aussi quelquefois à la fin des mots la dentale par une sifflante, de même qu’en grec on a, par exemple, $6s pour venant de $68t, -crpéffpour 'srpoT, venant de -crpoTÛ Le même rapport qui existe entre ®p<5? et tsrpor/- existe entre le zend asx
1 Les leçons des manuscrits varient entre as et gg* ai. Spiegel, dans son explication du dix-neuvième fargard du Vendidad, donne la préférence à la seconde forme, parce qu’elle se trouve dans les meilleurs manuscrits. Je regarde comme la meilleure la forme ai- ai qui, à ce qu’il semble, ne se rencontre nulle part, et cela à cause de l’a précédant la sifflante. Quant à l’a qui se rencontre quelquefois après la sifflante, je le regarde comme une voyelle euphonique, analogue à l’a qui est inséré quelquefois entre la préposition préfixe ui «sur» et le verbe, par exemple, dans vs-
«très» (si c’est avec raison que je reconnais dans ce mot la préposition sanscrite dti «sur», laquelle signifie, en composition avec des substantifs et des adjectifs, «beaucoup, démesurément, très»), et la forme plus fidèlement conservée aiti(pour ati, S 61). De même qu’on a, par exemple, en sanscrit atiyahs « ayant beaucoup de gloire» ou «ayant une gloire démesurée», atrsundara «très-beau, démesurément beau», de même en zend on a as-qarënâo «très-brillant», as-qarëtëimiibyê «très-dévorants» (superlatif, datif pluriel), as-augas «très-fort», mot que Neriosengh
traduit par mahâbala « très-fort »,
Le changement de t en » s a été reconnu dans la préposition
a»> us «sur, en haut », laquelle correspond au sanscrit ut.
Dans l’ancien perse les dentales et les sifflantes finales sont supprimées après a et â; mais après les autres voyelles s reste comme représentant du sanscrit, et se change en s, exemple : aüénaus k il fit », pour le sanscrit akrnot (védique); il est hors de doute que aUünaus était en même temps en ancien perse la 2e personne, et répondait, par conséquent, au védique âkrnôs ; de même, dans la déclinaison, i répond à la fois à la désinence du nominatif et du génitif (küru-s ttCyrus», Uurau-s ^Cyri» — sanscrit kuru-s, kurô-s), et à celle de l’ablatif qui en zend est çd (venant de t, S 89), bâbifu-s «de Babylone» (ablatif)l.
Le sanscrit, qui supporte un t final après toutes les voyelles, a pourtant quelquefois un s au lieu d’un t; exemple : adâs « celui-là» (nominatif-accusatif neutre), qui est sans aucun doute une 1 A* aJAt. car c’est cette dernière forme qui correspon-arhistata «levez-vous». La préposition as ou ai n’a rien de commun avec le substantif
féminin aéâ «pureté» (nominatif aéa). ^
1 Dans l'inscription de Behistun, II, 65. La leçon vraie est probablement bob»-rau-é; au lieu de ^ (r*), qui ne s’emploie que devant w, il faudrait lire (r), lettre qui peut renfermer en elle un a, comme cela a été remarqué ailleurs (Bulletin de l’Académie de Berlin, mars 1848, p. 144 ).
tirait aux formes neutres analogues tat «celui-ci, celui-là», anyât «autre ». A la 3e personne du pluriel du prétérit redoublé, us est très-probablement pour anti; exemple : tutupus pour tutu-panti (dorien TSTvtyctvTt), et au potentiel pour ânt ou mit; exemples : vidyûs « qu’ils sachent», pour vidyânt, bârê-yus pour barê-y-ant, en zend barayën, en grec (pépotsv. C’est aussi par le penchant à affaiblir un t final en s que j’explique l’identité de l’ablatif et du génitif singuliers dans le plus grand nombre des classes de mots. On peut, par exemple, inférer d’ablatifs zends en ~ôi-d et au-d (^1»*), venant des thèmes en i et en u, des formes sanscrites comme agnê-t «igné», sûno-t « filio » ; au lieu de ces formes nous avons agnê-s, sûno-s, comme au génitif : c’est ce dernier cas qui a déterminé, en quelque sorte, par son exemple, le changement du t en s à l’ablatif, changement qui n’a pas eu lieu pour les classes de mots qui onts^a au génitif, ou qui ont un génitif de formation à part, comme mâma « de moi », tam « de toi ». Dans ces mots, on retrouve l’ancien t à l’ablatif ; exemples : âs'vâ-t «equo», génitif dsva-sya ; ma-t, tva-t, génitif marna, tâva : l’imitation du génitif par l’ablatif, au moyen du simple changement d’un t final en s} était ici impossible. Si, au contraire, l’ablatif était réellement représenté dans la plupart des classes de mots en sanscrit par le génitif, il serait inexplicable que les thèmes en a et le thème démonstratif amû (génitif amü-sya, § Qib, ablatif amû-smâ-t), sans parler des pronoms de la iro et de la 3° personne, eussent un génitif distinct de l’ablatif, et que ces formes ne fussent pas également confondues au duel et au pluriel.
On voit encore l’étroite affinité de t et de s par le changement contraire, qui a lieu en sanscrit, de s en t. 11 a lieu, quand un s radical se rencontre avec le s du futur auxiliaire et de l’aoriste ; exemples : vat-syami «habitabo», dvât-sam « habitavi », de la racine vas. On observe encore ce changement dans le suffixe vâns ( forme forte ), et dans les racines srahs et dvaiis « tomber »,
quand elles se trouvent, avec le sens d’un participe présent, a la fin d’un composé : le s de vâhs, srahs, dbans se change en dentale au nominatif-accusatif-vocatif singulier neutre et devant les désinences casuelles commençant par un ë ou un s.
g io3. Modifications euphoniques produites dans les langues slaves par les suffixes commençant par un L
Les langues lettes et slaves se comportent à l’égard des dentales comme les langues classiques, le germanique et le zend : elles se rapprochent surtout du grec, en ce qu’elles changent en s la dentale finale de la racine, quand elle se trouve placée devant un t, et en ce quelles la suppriment devant un s; nous avons, par exemple, en ancien slave, de jamï «je mange » (pour jadmï, sanscrit ddmi), la 3e personne jas-tï, pour le sanscrit dt-ti, venant de ad-ti, et en lithuanien de ed~mi «je mange» (en parlant des animaux), la 3e personne ës-t (comparez le vieux latin es-t) : de même en ancien slave das-tl «il donne», et en lithuanien dus-ti (même sens), pour dad-ti, düd-ti, sanscrit dàdâ-ti, dorien StSaru. Au sanscrit vêï~ti «il sait», pour vêd-li, répond l’ancien slave küctl vês-tï, venant de vêd-tï. Ce sont surtout les infinitifs en U qui donnent occasion en lithuanien et en slave au changement des dentales en s : ainsi, en lithuanien, de la racine sanscrite wed « conduire », et, en ancien slave, de la racine B€A, qui est identique à la précédente par le son comme par le sens, on a l’infinitif westi, bêctm. Pour la suppression de la dentale devant un s, cest le futur qui fournit des exemples en lithuanien : de la racine ed « manger » se forme le futur ë-siul, en sanscrit atsydmi, venant de ad-sydmi, qui donnerait en grec ë-vv (comme i[*eü(A)-0w, 'srei/(3')-o*«) ; de skut « gratter », vient le futur sku-sm, pour skut-siu. En ancien slave, la
1 La irfc personne du singulier du futur doit avoir un et cet t est encore distinctement entendu aujourd'hui : c’est ce que nous apprend Schleicher (Lettres sur les résultats d’un voyage scientifique en Lithuanie, p. h ).
désinence personnelle si, qui s’ajoute immédiatement à plusieurs racines en d, déjà mentionnées, et au thème redoublé du présent dad, fournit également des exemples de la suppression du d; exemple : mcttja-si'«tu manges », pour jad-si, sanscrit dl-si. lien est de meme pour certains aoristes qui, au lieu du x mentionné plus haut (S 99®), ont conservé le c primitif; exemple mczja-sü «je mangeai», pour jcid-sû, forme comparable à l’aoriste grec êty&MTa pour ëÿevS-o-oL (la dentale reste, au contraire, à l’aoriste sanscrit dtâut-sam «je poussai», de la racine tuâ). En général, le slave ne permet pas la combinaison d’une muette avec un s : on a, par exemple, po-gre-saii «ils enterrèrent» (racine greâ), pour po-greb-san ou po-grep-san. Au contraire, le lithuanien combine les labiales et les gutturales avec s et tf sans pourtant changer b et g en leur ténue, comme on pourrait s’y attendre; exemples : dirbstu, degsiu (futur), dirbti, degti (infinitif), de dirbau «je travaille », degù «je brûle» (intransitif). Remarquons encore que l’ancien slave permet devant st le maintien de la labiale précédente, mais qu’il change alors b en p; exemple : norpcncTH po-grep-s-ti «enterrer». Le s est ici une insertion euphonique à peu près analogue à celle qu’on rencontre dans les thèmes gothiques comme an-s-ti «grâce» (racine an, § 95). Pour po-grep~s-ti on trouve cependant aussi po-gre-s-ti, et sans s euphonique, po-gre-ti (voyez Miklosich, Radices, p. 19). La première de ces deux formes a coriservé le complément euphonique et perdu la consonne radicale, comme les formes latines os~tendo pour ob-$~tendof a-s-porto pour ab-s-porto.
\
S toi \ Déplacement de l’aspiration en grec et en sanscrit.
Quand l’aspiration d’une moyenne doit être supprimée en sanscrit (S 98), il se produit, dans certaines conditions et suivant des lois à part, un mouvement de recul qui reporte l’aspiration -sur la consonne initiale de la racine, pourvu que cette consonne
soit une moyenne, ou bien l’aspiration avance sur la consonne initiale du suffixe suivant. On dit, par exemple, Bôt-syâmi «je saurai», pour bôd-sydmi; vêda-bût «qui sait le véda», pour Ma-bûd; bud-d’â «sachant», pour bud'-tâ; d'ôk-syami «je trairai», pour dôh-syâmi; dug-dâ «mulctus», pour duh-tâ. En grec il subsiste une application remarquable de la première de ces deux lois142 : dans certaines racines commençant par un t et finissant par une aspirée, l’aspiration, quand elle doit être supprimée devant un O-, un t ou un ju (car elle ne pourrait subsister devant ces lettres), est rejetée sur la lettre initiale, et le t est changé en 3-; exemples : rpétyot, B-pén-crco (S-p^w), Spe^r-Tj/p, S-pép-fxa; tatyrj, a-a'TT-TW, êrdQvv, TébapL-fiai ; ïpuCpos, 3-pu7r-T&>, èrpvÿtjv, 3-piîjtJt-jua ; Tpé%co, Speijofiai ; 3-p/f, tpt%6s; Tap^'s, S-davcov, C’est d’après le même principe que prend l’esprit rude, quand ^ doit être remplacé par la ténue (êxrés, é'ëw, é?r?)2.
Le latin a aussi quelques mots où l’aspiration a reculé : entre autresfido ( S 5 ) et les mots de même famille, qui correspondent à la racine grecque %nÔ, et qui ont remplacé la dentale aspirée, que le latin n’a pas, par l’aspiration de la consonne initiale. Quant au rapport du grec rseidco avec la racine sanscrite band «lier», le changement du b sanscrit en <sr repose sur une loi assez generale
qu’Agathon Benury a fait connaître le premier {Phonologie romaine, p. 195 ss.). Voici en quoi elle consiste : l’aspirée finale, en devenant dure de molle qu’elle était dans le principe, entraîne, pour les besoins, en quelque sorte, de la symétrie, le changement de la moyenne initiale en ténue : «16 est pour Iridli, en sanscrit haut- Il en est de même pour *a0 comparé à W« savoir», «a0 comparé à hM «tourmenter», ®âXus com“ paré à hâkû-s «bras», tsayie comparé à bahé-s « beaucoup»1, kvB comparé à gui s couvrir », Tpi* (« cheveu », considéré comme, «ce qui pousse»), comparé à drh (de drah ou darh) «grandir». Baflu's fait exception à la règle, si, comme je le suppose avec Benfey, il doit être expliqué par yMs143 144 145 et rapporté à la racine sanscrite gâh, venant de #«ré«submcrgi», racine qui a peut-être
fnmvia ln cnncPPlt
- a . \ P _ J , .T
LES
ACCENTS SANSCRITS.
g 10L’oudfttta et le svarita dans les mots isolés.
Pour marquer la syllabe qui reçoit le ton, le sanscrit a deux accents, dont l’un s’appelle udâtta, c’est-à-dire « élevé », et l’autre
evarka, c’est-à-dire «sonore » (de saura «ton, accent »). L’oudâtta
répond à l’accent aigu grec, et dans notre transcription en caractères latins nous emploierons ce signe pour le représenter146. I peut se trouver sur réimporte quelle syllabe, quelle que soit lu
longueur du mot : il est, par exemple, sur la première dans « «nous désirons savoir» (moyen), sur la deuxième dans tctn&mi «j’étends», et sur la dernière dans babandtmâ «nous liâmes ». Le svarita est d’un usage beaucoup plus rare : par lui-même, c’est-à-dire quand il se trouve sur un mot isolé, en dehors d’une phrase, il ne se met qu’après les semi-voyelles y et v, au cas où celles-ci sont précédées d’une consonne ; néanmoins, même dans cette position, c’est l’accent aigu qui se rencontre le plus souvent, par exemple, dans les futurs comme dâsydti« il donnera », dans les passifs comme tudydtê «il est poussé», dans les intensifs comme bêBidydtê «il fend», dans les dénominatifs comme namasyâti « il honore » (de ndmas «honneur»), dans les potentiels comme adyam « que je mange », dans les impératifs moyens comme yunkêvd x unis ». Voici des exemples du svarita, que je représente, comme le fait Benfey, par l’accent grave : mmmyà-s «homme», manusyê-Byas «aux hommes», Bâr-yâ « épouse », vâkyà-m «discours», nadyàs «fleuves», svàr «ciel», kvà «ou?», vadbàs «femmes». Probablement y et v avaient, dans les formes marquées du svarita, une prononciation qui tenait plus de la voyelle que de la consonne, sans pourtant former une syllabe distinctel. G’est seulement dans les Védas que l’on compte quelquefois, à cause du mètre, la semi-voyelle pour une syllabe, sans que l’accent aigu soit cependant changé en svarita : ainsi, dans le Rig (I, h 6), tmm «tu» doit être prononcé comme un dissyllabe, probablement avec le ton sur l’« (tu-dm), Mais là où, à cause du mètre, une syllabe marquée du svarita se divise en deux, par
1 Comparez BôhUingk {Un premier essai sur l’accent en sanscrit, Saint-Pétersbourg, i8&3, p. 4). Je ne m’éloigne de l’auteur, dans l’explication présente, qu’en ce que je réunis en une seule syllabe IV et Pu contenus dans le y et le v, et la voyelle suivante. Je ne conteste d’ailleurs pas que des mois comme kanyâ' «fille», que je lis kaniâ (dissyllabe), ont été trissyllabiques dans un étal plus ancien de la langue (je dirais volontiers avant la formation du svarita), et qu’ils ont eu l’accent aigu sur Pi, comme dans le grec ao^/a.
exemple, quand dâtijàm = clûtîam (dissyllabe), doit être prononcé en trois syllabes, le svarita qui n’a plus de raison d’être disparaît et est remplacé par l’aigu, dûti-am 147. Si l’on considère i et u (pour y, v) comme formant une dipbthongue avec la voyelle suivante (et il n’est pas nécessaire que la syllabe pour cela devienne longue), on peut comparer ua, par exemple, dans sùar «ciel» (qu’on écrit svàr), avec la dipbthongue ua en vieux haut-allemand, par exemple dans fuaz «pied» (monosyllabe, à côté defuoz), et ia, par exemple, dans nadias (dissyllabe, on écrit nadyàs) avec la diphthongue ia du vieux haut-allemand, par exemple, dans hialt «je tins»2. ,
L’accentuation des formes grecques comme repose
également sur ce fait, que l’e est prononcé si rapidement, que les deux voyelles ne font, par rapport à l’accent, qu’une seule syllabe (voyez Buttmann, § 11, 8, note 6 ).
Comme le svarita s’étend toujours sur deux voyelles à la fois (§ i o4c), il doit être prononcé plus faiblement que l’oudâtta ou l’aigu, dont le poids tombe sur un seul point : en effet, quoique réunies par la prononciation en une seule syllabe, les deux voyelles qui reçoivent le svarita ne forment pas une unité phonique comme les diphthongues eu, et, ot, au, eu en grec, ou ai, au, eu en français ou en allemand ; mais elles restent distinctes comme ua, ia dans les formes précitées du vieux haut-allemand. Il peut sembler surprenant qu’en sanscrit des thèmes oxytons, commenadî' kfleuve», vaffl «femme», prennent, quand c’est la syllabe "finale qui est accentuée, l’accent le plus faible (le svarita) dans les cas forts (S i a 9 ), et l’accent le plus fort (l’aigu) dans les cas faibles ; exemples : nadyàs (nadias) «fleuves », nadyâu (nadiïiu)
r deux fleuves », vadvàs (vadms) « femmes », vadvau (vadkau) « deux femmes», et d'autre part,nadyâs «du fleuve», datif nadyai, etc. vadvàs «de la femme », datif vadvâî. La raison ne peut etre, selon moi, que celle-ci : c’est que dans les cas forts le thème a des formes plus pleines que dans les cas faibles (comparez Üàrantas, (pépovTes, avec Mratas, (pépovros) ; or, nadî'et vadk nous montrent des formes plus pleines dans les cas forts, en ce sens qu’ils ne laissent pas s’effacer entièrement, devant les désinences commençant par des voyelles, le caractère de voyelle de leur lettre finale. En effet, nadws, nadiâu, vadùas, vaduâu, quoique dissyllabes, obligent la voix à s’arrêter plus longtemps sur le thème que des formes comme nadyâs, vaMs, où y et v sont décidément devenus
des consonnes.
S îoAc. Emploi du svarita dans le corps de la phrase.
Dans l’enchaînement du discours le svarita prend la place de
l’aigu : _ ,
i° Nécessairement, quand après un o ou un é final marque
de l’accent [6, <f), un a initial sans accent est élidé; exemples : ko ’si «qui es-tu?», pour ko asi, kds asi; tê ’mntu «que ceux-ci te protègent», pour tê1 amntu. Probablement ce principe daccentuation appartient lui-même à un temps où Va était encore entendu après U et ¥ê, sans cependant former une syllabe entière1. C’est le lieu de remarquer que, dans les Védas, Ta initial est souvent conservé après un â final; exemple, Rig-Véda, 1, 84, 16 : kô ûdyâ.
a" D’une façon facultative, quand une voyelle finale accentuée se contracte avec une voyelle initiale non accentuée : néanmoins, dans ce cas, l’accent aigu domine de beaucoup dans le Rig-Véda, et le svarita est borné, ce semble, à la rencontre d’un i accentm
1 On peut rapprocher les diphthongucs m, m en vieux haut-allemand, qiioi.jtte la première partie de ces diphthongucs soit brève par elle-même.
final avec un i initial non accentué; exemple, I, a a, 20, où divl «clans le ciel » est réuni avec le mot im qui n’a pas d’accent, divim1.
$ 104d. Cas particuliers.
Quand une voyelle finale accentuée se change en la semi-voyelle correspondante devant un mot commençant par une voyelle, l’accent se transporte, sous la forme du svarita, sur la voyelle initiale, au cas où celle-ci n’est pas accentuée; exemples : priivy àsi «tu es la terre» (pour prtwiasij; urv àntdriksam «la vaste atmosphère » (pour urü antâriksam). Mais si la voyelle initiale du second mot est accentuée, comme elle ne peut recevoir l’accent du mot précédent, il se perd; exemples : nady dira «le fleuve ici», pour nad$ dira; svâdv âtra «dulce ibi», pour svâdü dira. Quand des diphthongues accentuées se résolvent en ay, ây9 av, âv, Va ou Yâ gardent naturellement l’accent qui revenait à la diphthongue ; exemples : tav ayâtam « venez tous deux », pour tâé ayâtam (Rig-Véda, I, 2, 5). La même chose a lieu devant les désinences grammaticales ; exemples : sûndv-as « filii », du thème sûnü, avec le gouna, c’est-à-dire avec un a inséré devant IV agnay~as «ignés», de agni, avec le gouna; nav-as «naves», de nâü.' Quand des thèmes oxytons en i, î, u, û changent leur voyelle finale en la semi-voyelle correspondante (y, v) devant des désinences casuelles commençant par une voyelle, l’accent tombe sur la désinence, ordinairement sous la forme de l’aigu, et, dans certains'cas que la grammaire enseigne (comparez § ioàb), sous la forme du svarita.
1 Le Satapata-Brâhmana du Yagur*Véda emploie, sauf de rares exceptions, le svarita dans tous les cas où une voyelle finale oxytonée se combine avec une voyelle initiale non accentuée (voyez Weber, Vâjasaneyi-Sanhitâ, II, prœfatio, p. g et suiv.). Quand une voyelle finale marquée du svarita se combine avec une voyelle initiale sans accent, le Big-Fèda conserve également le svarita; exemple, I, 35,7: hvfila-nîm, formé de kvà «où ?» et idâmm xmaintenant».
S 10A V Des signes employés pour marquer les accenls.
Le signe du svarita sert aussi, dans récriture indienne, à marquer la syllabe qui suit immédiatement la syllabe accentuée, et qui se prononce plus fortement que celles qui se trouvent plus éloignées du ton148. Au contraire, la syllabe qui précède la syllabe accentuée se prononce moins fortement que les autres syllabes, et s’appelle à cause de cela chez les grammairiens anu-dâttatara, c’est-à-dire « moins accentué» (comparatif de anudâtta «non accentué»), ou sannatatara «plus abaissé». Cette syllabe est marquée par un trait horizontal en dessous de l’écriture. Quant à la syllabe accentuée elle-même, elle ne reçoit aucun signe particulier, et on la reconnaît seulement par le moyen des syllabes qui précèdent ou qui suivent.
Remarque 1. — Le svarita comparé à l’accent circonflexe grec. — Les accents en lithuanien.
L’explication que nous avons donnée plus haut du svarita peut s’appliquer aussi aux combinaisons comme divîva pour divi iva (S io4c); quoique les deux i ne forment qu’une syllabe, on les prononçait probablement de manière à faire entendre deux i, l’un accentué, l’autre sans accent, de même que, suivant les grammairiens grecs, le circonflexe réunit en lui un accent aigu et un accent grave, ce qui veut dire, sans doute, qu’il comprend une partie accentuée et une autre sans accent. En effet, l’accent grave représente en grec la négation ou l’absence de l’accent aigu, comme l’anoudâtta en sanscrit (§ ioàc), excepté quand il se trouve sur une syllabe finale, où il représente l’accent aigu adouci. II faut donc que le grec 'moh&v (en sanscritpadam) ait été prononcé tboSôov, de manière à faire entendre deux o en une syllabe, ou à faire suivre un o long d’un o très-bref qui ne forme pas de syllabe. De toute façon, ce redoublement de son empêche l’accent de se produire dans toute sa force, et l’aigu qui est contenu dans 'croSctw (—Tsohéov ou •zsohdjov) et dans le sanscrit divïva (= dm iva) ne peut être aussi marqué que l’accent de padam crpedum ». Les formes comme divïva, qu’en grec on écrirait StFfFa, se prêtent le mieux à une comparaison du svarita sanscrit avec le circonflexe grec, parce que l’accent tombe ici sur une voyelle longue résultant d’une contraction, comme dans le grec TtfAoi, Tipxwfxsv, wouw, tsoiw[xsvt La seule différence est que la longue* en sanscrit résulte de la combinaison de deux mots, et qu’en sanscrit le svarita ne résulte jamais d’une contraction à l’intérieur du mot, à moins qu’on ne veuille rapporter à cette analogie les formes comme nadyàs fffleuves», vadvàs rrfemmes» = nacVias, vad'uas (v v»)l; mais ces dernières formes diffèrent essentiellement des syllabes grecques marquées du circonflexe, en ce que les deux voyelles réunies par le svarita ne font qu’une syllabe brève. En général, dans toute la grammaire et tout le vocabulaire des deux langues, on ne trouve pas un seul cas où le svarita sanscrit soit à la même place que le circonflexe grec; il faut nous contenter de placer en regard des formes grecques, comme 'aroSwr, veâtv ( dorien vâêov), ÇevxTotai, ZevxTafoi, borrjpes, vôtss, des formes équivalentes par le sens et analogues par la formation, qui ont l’accent sur la même syllabe que le grec, mais l’aigu là où le grec a le circonflexe. Tels sont padam> nâvüm, yuktêsu (de yuktai-su), yuktâ'su\ dâtaras, ndvas. Il résulte de là que les deux langues n’ont produit le circonflexe (si nous appelons le svarita de ce nom, comme le fait Bôhtlingk) qu’après leur séparation et indépendamment l’une de l’autre; il provient dans les deux idiomes d’une altération des formes. C’est, par exemple, une altératioft en sanscrit qui fait que certaines classes de mots forment une partie de leurs cas d’un thème plein et une partie du thème affaibli : comparez le nominatif pluriel Bârantas = (pépovTes au génitif singulier bâratas == Çépovros. Or, c’est la même altération qui fait que des thèmes comme nadi cr fleuve » (féminin) et vadil ce femme» traitent 149 150 autrement leur î et leur u final dans les cas forts (§ 129) que dans les cas faibles; quoique cette différence de forme ne soit pas sensible dans l’écriture, il n’en est pas moins vraisemblable, comme on l’a dit plus haut, quà 1 accusatif pluriel on prononçait nadlas, vaduas, et au nominatif na-dyâ's, vadvas. D’un autre côté, c’est une altération, dont le sanscrit resta exempt, qui fait qu’en grec les voyelles longues reçoivent un autre accent, selon quelles sont suivies d’une syllabe finale brève ou longue : comparez, par exemple, le grec Zorrfpes au génitif Sor^pwr, et au sanscrit dâtaras.
Dans les langues lettes, il y a aussi, outre l’aigu, qui devrait suffire à tous les idiomes, un accent qui a une grande ressemblance avec le circonflexe grec; seulement, dans les voyelles qui en sont marquées, c’est la partie non accentuée qui est la première et la partie accentuée la seconde. Je veux parler du ton aiguisé, qui joue un rôle beaucoup plus grand en lithuanien que le svarita en sanscrit et le circonflexe en grec ; il s’est d’ailleurs produit d’une façon indépendante et n’a pas de parenté originaire avec ces deux accents. Kurschat, à qui nous devons une connaissance plus exacte du système d’accentuation lithuanien, décrit ainsi le ton aiguisé1 : «Les voyelles ffaiguisées ont ceci de particulier, qu’en les prononçant, le ton, après avoir frété d’abord assez bas, s’élève tout à coup, de manière que l’on croit entendre deux voyelles, dont l’une est sans accent et l’autre accentuée.« Plusieurs mots de forme et de quantité identiques se distinguent dans la prononciation par l’accent, qui peut être frappé ou aiguisé ; exemples : paj&dmti2 tr laisser aller à cheval », pajédînti n noircir»; sovditi «■ juger », soiiditi crsaler»; dovman «l’espritn (accusatif), doitmah «la fumée» 3 (même cas); isdrîfks « il arrachera», isd?'rjks rren chemise»; primmsm rrje rappellerai» (sanscrit man tr penser», latin memini), priminsiu «je commencerai». Kurschat désigne le ton aiguisé sur les voyelles longues, où on le rencontre de préférence, par \ excepté sur Ve ouvert long, auquel il donne le même signe renversé, exemple : géras. Sur les voyelles brèves, il emploie indifféremment l’accent grave pour le ton frappé et le ton aiguisé; mais
J H, >39.
a Pour marquer simultanément la quantité et l’accentuation, nous employons les caractères grecs pour les syllabes accentuées, quoique cela ne soit pas nécessaire à la rigueur pour le son 0, qui est toujours long en lithuanien.
3 Ces deux derniers mots sont identiques sous le rapport étymologique, tous les deux étant de la môme famille que le sanscrit ditum-s «fumée» et lo mol grec ,9-üpds.
comme ce dernier ne se trouve sur tes voyelles brèves que si elles sont suivies dune liquide, on reconnaît le ton aiguisé à un signe particulier dont Kurschat marque la liquide : m, n, r sont surmontés d’un trait horizontal et l est barré; exemples : mirti « mourir », girditi «■ abreuver»; le premier de ces mots a le ton aiguisé, le second le ton frappé sur Xi bref. Je préférerais que le ton frappé fut toujours représenté par l’aigu, auquel il correspond en effet, et que le ton aiguisé sur les voyelles brèves fut marqué par l’accent grave; j’écrirais donc girditi, mirti, le premier ayant le ton frappé, le Second le ton aiguisé. Pour indiquer que la voyelle est longue, il faudrait inventer quelque autre signe que l’aigu, qui sert déjà à représenter l’accent.
Remarqüe 2. — Principe de l’accentuation en sanscrit et en grec.
Le principe qui régit l’accentuation sanscrite est, d’après moi, celui-ci ; plus l’accent se trouve reculé, plus il a de relief et de force; ainsi l’accent placé sur la première syllabe est le plus expressif de tous. Je crois que le même principe s’applique au grec : seulement, par suite d’un amollissement qui n’a eu lieu qu’après la séparation des idiomes, le ton ne peut pas être reculé en grec au delà de l’antépénultième, et si la dernière syllabe est longue, êlle attire l’accent sur la pénultième. Par exemple, à la 8e personne du duel de l’impératif présent, nous avons (pepérav au lieu de (pêpSTwv, qui correspondrait au sanscrit bartitâm (trque tous deux portent?)), et au comparatif nous avons rjblwv pour rjhttov, qui répondrait au sanscrit svadtyân «plus doux» (du thème positif saMi — grec ^86). Au superlatif, au contraire, r}hi<r1os correspond parfaitement au sanscrit svadiètas, parce qu’ici il n’y a pas lieu pour le grec de s’écarter de l’ancienne accentuation. En reculant l’accent au comparatif et au superlatif, les deux langues ont l’intention de représenter le renforcement de l’idée par le renforcement du ton. Nous avons une preuve bien frappante de l’importance attachée par le sanscrit et le grec au reculement de l’accent, dans la règle qui veut que les mots monosyllabiques aient l’accent sur la syllabe radicale dans les cas forts (S 129), qui sont regardés comme les plus marquants, tandis que les cas faibles laissent tomber l’accent sur la désinence; comparez, par exemple, le génitif sanscrit et grec padâs, 'æohàs, et l’accusatif pddam et -sréSa. Nous rencontrerons dans le cours de cet ouvrage d’autres preuves de la même loi, qui est absolue en sanscrit, mais qui, eu grec est renfermée dans certaines limites. *
S io5. Des racines verbales et des racines pronominales.
Il y a en sanscrit et dans les langues de la même famille deux classes de racines : la première classe, qui est de beaucoup la plus nombreuse, a produit des verbes et des noms (substantifs et adjectifs); car les noms ne dérivent pas des verbes, ils se trouvent sur une même ligne avec eux et ont même provenance. Nous appellerons toutefois cette classe déracinés, pour la distinguer de la classe dont nous allons parler tout à l’heure, et à cause de l’usage qui a consacré ce mot, racines verbales; le verbe se trouve d’ailleurs, sous le rapport de la forme, lié à ces racines d’une façon plus intime que le substantif, puisqu’il suffit d’ajouter les désinences personnelles à la racine, pour former le présent de beaucoup de verbes. De la seconde classe de racines dérivent des pronoms, toutes les prépositions primitives, des conjonctions et des particules; nous les nommons racines pronominales;, parce qu’elles marquent toutes une idée pronominale, laquelle est contenue, d’une façon plus ou moins cachée, dans les prépositions, les conjonctions et les particules. Les pronoms simples ne sauraient être ramenés à quelque chose de plus général, soit sous le rapport de l’idée, soit sous le rapport de la forme : le thème
de leur déclinaison est en même temps leur racine. Néanmoins les grammairiens indiens font venir tous les mots, y compris les pronoms, de racines verbales, quoique la plupart des thèmes pronominaux s’opposent, même sous le rapport de la forme, à une pareille dérivation; en effet, le plus grand nombre de ces thèmes se terminent par un a, il y en a même un qui consiste simplement en un a; or, parmi les racines verbales il ny en a pas une seule finissant en âf quoique Yâ long et les autres voyelles, excepté ^ âu, se rencontrent comme lettres finales des racines verbales. Il y a quelquefois identité fortuite entre une racine verbale et une racine pronominale; par exemple, entre ^ i «aller» et i «celui-ci».
S 106. Monosyllabisme des racines.
Les racines verbales ainsi que les racines pronominales sont monosyllabiques. Les formes polysyllabiques données par les grammairiens comme étant des racines contiennent ou bien un redoublement, comme gâgar, gâgr « veiller » , ou bien une préposition faisant corps avec la racine, comme ava-iîr «mépriser », ou bien encore elles sont dérivées d’un nom, comme kumar «jouer», que j e fais venir de kumârâ « enfant ».
Hormis la règle du monosyllabisme, les racines verbales ne sont soumises à aucune autre condition restrictive; elles peuvent contenir un nombre très-variable de lettrés. C’est grâce à cette liberté de réunir et , d’accumuler les lettres que la langue est parvenue à exprimer toutes les idées fondamentales par des racines monosyllabiques. Les voyelles et les consonnes simples ne lui suffirent pas : elle créa des racines où plusieurs consonnes sont rassemblées en un tout indivisible , comme si elles ne formaient qu’un son unique. Dans siâ «se tenir», le s et le t ont été réunis de toute antiquité , Comme le prouvent toutes les langues
indo-européennes; dans skand «monter» (latin scand-o), la double combinaison de deux consonnes au commencement et à la fin de la racine est un fait dont l’antiquité est prouvée* par l’accord du sanscrit et du latin. D’un autre côté, une simple voyelle suffisait pour exprimer une idée verbale : c’est ce qu’atteste la racine i signifiant «aller», qui se retrouve dans presque tous les idiomes de la famille indo-européenne.
S 107. Comparaison des racines indo-européennes et des racines
sémitiques.
La nature et le caractère particulier des racines verbales sanscrites se dessinent encore mieux par la comparaison avec les racines des langues sémitiques. Celles-ci exigent, si loin que nous puissions les poursuivre dans l’antiquité, trois consonnes; j’ai montré ailleurs1 que ces consonnes représentent par elles-mêmes, sans le secours des voyelles, l’idée fondamentale, et quelles forment à l’ordinaire deux syllabes; elles peuvent bien, dans certains cas, être englobées en une seule syllabe, mais alors la réunion de la consonne du milieu avec la première ou la dernière est purement accidentelle et passagère. Nous voyons, par exemple, que l’hébreu kâtûl «tué» se contracte au féminin en ktûl, à cause du complément âh(ktûlâh), tandis que kôtèl « tuant », devant le même complément, resserre ses consonnes de la façon opposée et fait kâtlâh. On ne peut donc considérer comme étant la racine, ni ktûl ni hôtl; on pourra tout aussi peu chercher la racine dans ktôl, qui est l’infinitif à l’état construit; en effet, ktôl n’est pas autre chose que la forme absolue kâtâl abrégée, par suite de la célérité de la prononciation, qui a hâte d’arriver au mot régi par l’infinitif, mot faisant en quelque sorte corps avec lui. Dans l’impératif ktôl, l’abréviation ne tient pas, comme dans
• ■ . •
Mémoires de l’Académie de Berlin (classe historique), 182/1, p. - t a(î et sniv.
le cas précédent, à une cause extérieure et mécanique151 : elle vient plutôt d’une cause dynamique, à savoir la rapidité qui caractérise ordinairement le commandement. Dans les langues sémitiques, contrairement à ce qui se passe dans les langues indo-européennes, les voyelles n’appartiennent pas à la racine; elles servent au mouvement grammatical, à l’expression des idées secondaires et au mécanisme de la structure du mot : c’est par es voyelles qu’on distingue, par exemple, en arabe, katala «il tua » (hkutüa «il fut tué», et, en hébreu, kâtêl «tuant» de kâtûl «tué». Une racine sémitique ne peut se prononcer : car du moment qu’on y veut introduire des voyelles, on est obligé de se décider pour une certaine forme grammaticale, et l’on cesse d’avoir devant soi l’idée marquée par une racine placée au-dessus de toute grammaire. Au contraire, dans la famille indo-européenne, si l’on consulte les idiomes les plus anciens et les mieux conservés, on voit que la racine est comme un noyau fermé et presque invariable, qui s’entoure de syllabes étrangères dont nous avons à rechercher l’origine, et dont le rôle est d exprimer les idées secondaires, que la racine ne saurait marquer par elle-même. La voyelle, accompagnée d’une ou de plusieurs consonnes, et quelquefois sans le secours d’aucune consonne, est destinée à exprimer l’idée fondamentale; elle peut tout au plus être allongée ou être élevée d’un ou de deux degrés par le gouna ou par le vriddhi, et encore n’est-ce pas pour marquer des rapports grammaticaux, qui ont besoin d’être indiqués plus clairement, que la voyelle est ainsi modifiée. Les changements en question sont dus, ainsi que je crois pouvoir le démontrer, uniquement à des lois mécaniques; il en est de même pour le changement de voyelle qu’on observe dans les langues germaniques, ou un a primitif est tantôt ou en u (SS 6 et 7).
conservé, tantôt changé en i
•S to8. Classification générale des langues. — Examen d’une opinion
de Fr. de Schlegel.
Les racines sémitiques ont, comme on vient de le dire, la laculté de marquer les rapports grammaticaux par des modifications internes, et elles ont fait de cette faculté l’usage le plus large; au contraire, les racines indo-européennes, aussitôt qu’elles ont à indiquer une relation grammaticale, doivent recourir à un complément externe : il paraîtra d’autant plus étonnant que Fr. de Schlegel152 place ces deux familles de langues dans le rapport inverse. 11 établit deux grandes catégories de langues, à savoir celles qui expriment les modifications secondaires du sens par le changement interne du son radical, par la flexion, et celles qui marquent ces modifications par l’addition d’un mot qui signifie déjà par lui-même la pluralité, le passé, le futur, etc. Or il place le sanscrit et les langues congénères dans la première catégorie et les idiomes sémitiques dans la seconde. «Il est vrai, kdit-il (p. à8), qu’il peut y avoir une apparence de flexion, r lorsque les particules ajoutées finissent par se fondre si bien avec «le mot principal, qu’elles deviennent méconnaissables; mais «si,- comme il arrive en arabe et dans les autres idiomes de «la même famille, ce sont des particules déjà significatives par «ellesHmêmes qui expriment les rapports les plus simples et les «plus essentiels, tels que la personne dans les verbes, et si le «penchant à employer des particules de ce genre est inhérent «au génie même de la langue, il sera permis d’admettre que le « même principe a été appliqué en des endroits où il n’est plus «possible aujourd’hui de distinguer aussi clairement l’adjonction
«de particules étrangères; du moins, il sera sûrement permis «d'admettre que, dans son ensemble, la langue appartient à «cette catégorie, quoique dans le détail elle ait déjà pris en «partie un caractère différent et plus relevé, grâce à des mélanges et à d’habiles perfectionnements. »
Nous devons commencer par rappeler qu’en sanscrit et dans les idiomes de cette famille, les désinences personnelles des verbes montrent pour le moins une aussi grande ressemblance avec les pronoms isolés qu’en arabe. Et comment une langue quelconque, exprimant les rapports pronominaux des verbes par des syllabes placées au commencement ou à la fin de la racine, irait-elle négliger précisément les syllabes qui, isolées, expriment les idées pronominales correspondantes?
Par flexion, Fr. de Scblegel entend le changement interne du son radical, ou (p. 35) la modification interne de la racine qu’il oppose (p. A8) à l’adjonction externe d’une syllabe. Mais quand en grec de ou de <5o se forittent St'Sco-fii, Sw-crco, So-Oti&âjABBct, qu’est-ce que les formes f«, &&, On^ofxeOct, sinon des compléments externes qui viennent s’ajouter à une racine invariable ou changeant seulement la quantité de la voyelle? Si l’on entend donc par flexion une modification interne de la racine , le sanscrit, le grec, etc. n’auront guère d’autre flexion que le rédoublement, qui est formé à l’aide des ressources de la racine même. Ou bien, dira-t-on que dans So-OwTÔfiBB*, O^crofxedût est une modification interné de la racine <5b ?
Fr. de Schlegel continue (p. 5o ) : « Dans la langue indienne, «ou dans la langue grecque, chèque racine est véritablement «ce que dit son nom, une racine, un germe vivant; car ies «idées de rapport étant marquées par un changement interne, «la racine peut se déployer librement, prendre des développe-«ments indéfinis, et, en effet, elle est quelquefois d’une ri-«chesse admirable. Mais tout ce qui sort de cette façon de la
«simple racine conserve la marque de la parenté, fait corps «avec elle, de manière que les deux parties se portent et se «soutiennent réciproquement.» le ne trouve pas que cette déduction soit fondée, car si .la racine a la faculté d’exprimer les idées de rapport par des changements internes, comment en peut-on conclure pour cette même racine (qui reste invariable à rintérieur) la faculté de se développer indéfiniment à l’aide de syllabes étrangères s’ajoutant du dehors? Quelle marque de parenté y a-t-il entre pu, et les racines auxquelles
se joignent ces compléments significatifs? Reconnaissons donc dans les flexions des langues indo-européennes, non pas des modifications intérieures de la racine, mais des éléments ayant une valeur par eux-mêmes et dont c’est le devoir d’une grammaire scientifique de rechercher l’origine. Mais quand même il serait impossible de reconnaître avec certitude l’origine d’une seule de ces flexions, il n’en serait pas moins certain pour cela que l’adjonction de syllabes extérieures est le véritable principe de la grammaire indo-européënne; il suffit, en effet, d’un coup d’œil pour voir que les flexions n’appartiennent pas à la racine, mais qu’elles sont venues du dehors. A. G. de Schlegel, qui admet dans ses traits essentiels cette même classification des langues153, donne à entendre que les flexions ne sont pas des mo-
1.
clifications de la racine, mais des compléments étrangers, dont le caractère propre serait de n’avoir pas de signification par eux-mêmes. Mais on en peut dire autant pour les flexions ou syllabes complémentaires des langues sémitiques, qui ne se rencontrent pas plus quen sanscrit, a l’état isolé, sous la forme qu’elles ont comme flexions. On dit, par exemple, en arabe antum, et non pas tum «vous»; et en sanscrit, c’est ma, ta, et non pas îm, tî qui sont les thèmes déclinables de la iro et de la 9° personne; at-TI «il mange» est dans le même rapport avec TA-m «lui» (à l’accusatif) que le gothique IT-a «je mange » avec la forme monos vil abiaue AT «je mangeai». La cause de l’affaiblissement de Va radical en i est probablement la même dans les deux cas : c’est à savoir que le mot où nous rencontrons Yi est plus long que le mot où nous avons a (comparez § 6).
Si la division des langues proposée par Fr. de Schlegel repose sur des caractères inexacts, l’idée d’une classification rappelant les règnes de la nature n’en est pas moins pleine de sens. Mais nous établirons plutôt, comme fait A. G. de Schlegel (endroit cité), trois classes, et nous les distinguerons de la sorte : i° idiomes sans racines véritables, sans faculté de composition, par conséquent, sans organisme, sans grammaire. A cette classe appartient le chinois, où tout, en apparence, n’est encore que racine1, et où les catégories grammaticales et les
«dérivatives, on forme des mots dérivés de diverses espèces, et des dérivés des déri-«vés. On compose des mots.de plusieurs racines pour exprimer les idées complexes. «Ensuite on décline les substantifs, les adjectifs et les pronoms, par genres, par «nombres et par cas; on conjugue les verbes par voix, par modes, par temps, par «nombres et par personnes, en employant de même des désinences et quelquefois « des augmenta, qui séparément ne signifient rien* Celte méthode procure l’avantage «d’énoncer en-un. seul mot l’idée principale, souvent déjà très-modifiée et très-« complexe, avec tout son coftége d’idées accessoires et de relations variables.»
1 Je dis en apparence, car, de racines véritableson ne peut en reconnaître au chinois: en effet, une racine suppose toujours une famille de mots dont elle est le
rapports secondaires ne peuvent cire reconnus que par la position des mots dans la phrase f.
centre et l’origine; on n’arrive à la saisir qu’après avoir dépouillé les mots qui la contiennent de tous les éléments exprimant des idées secondaires, et après avoir fait, abstraction des changements qui ont pu survenir dans la racine elle-même par suite des lois phoniques. Les composés dont parlent les grammaires chinoises ne sont pas dos composés véritables, mais seulement des mots juxtaposés, dont le dernier ne sert souvent qu’à mieux déterminer la signification du premier; par exemple, dans taô-lü (Endlicher, Éléments de la grammaire chinoise. p. 170}, il y a deux mots juxtaposés, qui ont tous les deux, entre autres significations, celle de « chemin», et qui réunis ne peuvent signifier autre chose que chemin. Les expressions citées par Endlicher (p. 171 et suiv.) ne sont pas plus des composés que ne Je sont en français les termes comme homme d’affaires, homme de lettres. Pour qu’il y ait composé, il faut que les deux mots soient réellement combinés et n’aient qu’un seul et même accent. Ces expressions chinoises n’ont qu’une unité logique, c’est-à-dire qu’il faut oublier la signification particulière de chacun des mots simples pour ne penser qu’au sens de l’ensemble, sens souvent assez arbitraire ; par exemple, la réunion des mois shûi («eau») et sheù («main») signifie «pilote» (shûi skeù), et celle des mots («soleil »} et tsè («fils») désigne te «jour», qui est considéré comme le
produit du soleil (gï tsè). — Les mots chinois ont l’apparence de racines, parce qu’ils sont tous monosyllabiques; mais les racines des langues indo-européennes comportent une plus grande variété de formes que les mots chinois. Ceux-ci commencent tous par une consonne et se terminent (à l’exception du chinois du sud), soit par une voyelle, diphthongue ou triphthongue, soit par une nasale (», ng) précédée d’une voyelle. L seul fait exception et se trouve à la fin des mots après eu, dans eul «et», eül «deux» et eùl «oreille». Pour montrer dans quelles étroites conditions est renfermée la structure des mots chinois, je cite les noms de nombre de 1 à 10, ainsi que les termes employés pour 100 et 1000. Je me sers du système de transcription d’Endlicher : ’£ i , eül 2, san 3, ssé h, ’w 5, lu 6, tàï 7, pâ 8, kieù 9, shï io, pë 100, téta» 1000. On voit qu’ici chaque nom de nombre est une création à part, et qu’il n’est pas possible d’expliquer un nom de nombre plus élevé par la . combinaison d’autres noms de nombre moins élevés. Ce qui, dans les langues indoeuropéennes, se rapproche le plus de la structure des mots chinois, ce sont les racines pronominales ou thèmes pronominaux, lesquels, comme on l’a fait observer plus haut "(S io5) , se terminent tous par une voyelle. A ce point de vue, on pourrait comparer, par exemple,pâ^lü, shï aux thèmes ka, ku, ki. On en pourrait rapprocher aussi quelques thèmes substantifs sanscrits, qui, d’après leur forme, sont des racines nues, aucun suffixe formatif n’étant joint à la racine à laquelle ils appartiennent; exemples : -fia «éclat», £» «peur», hrî «pudeur».
1 La langue chinoise a été parfaitement caractérisée par G. de Humboldt dans sa
9° Les langues à racines monosyllabiques, capables de les combiner entre elles, et arrivant presque uniquement par ce moyen à avoir un organisme, une grammaire. Le principe essentiel de la création des mots, dans cette classe de langues, me paraît être la combinaison des racines verbales avec les racines pronominales, les unes représentant en quelque sorte lame, les autres le corps du mot (comparez § to5). A cette classe appartiennent les langues indo-européennes, ainsi que tous les idiomes qui ne sont pas compris dans la première ou dans la troisième classe, et dont les formes se sont assez bien conservées pour pouvoir être ramenées à leurs éléments les plus simples.
3° Les langues à racines verbales dissyllabiques, avec trois consonnes nécessaires, exprimant le sens fondamental. Cette classe comprend seulement les idiomes sémitiques et crée ses formes grammaticales, non pas seulement par composition, comme la seconde, mais aussi par là simple modification interne des racines. Nous accordons d’ailleurs volontiers le premier rang à la famille indo-européenne, mais nous trouvons les raisons de cette prééminence, non pas dans l’usage de flexions consistant en syllabes dépourvues de sens par elles-mêmes, mais dans le nombre et la variété de ces compléments grammaticaux, lesquels sont significatifs et en rapport de parenté avec des mots employés à l’état isolé ; nous trouvons encore des raisons de supériorité dans le choix habile et l’usage ingénieux de ces compléments^ qui permettent de marquer les relations les plus diverses de la façon la plus exacte et la plus vive; nous expliquons enfin cette supériorité par l’étroite union qui assemble la racine et la flexion en un tout harmonieux, comparable à un corps organisé.
Lettre à M. Abel Bémusat, sur la nature des formes grammaticales en généi'al, et sur le génie de la. langue chinoise en particulier (en français)^-
.S 109'. Division des racines sanscrites en dix classes, d’après des caractères qui se retrouvent dans les autres langues indo-européennes. •
Les grammairiens indiens divisent les racines en dix classes, d’après des particularités qui se rapportent seulement aux temps que nous avons appelés temps spéciaux154, et au participe présent; ces particularités se retrouvent toutes en zend, et nous en donnerons des exemples au paragraphe suivant. Mais nous allons d’abord caractériser les classes sanscrites, et en rapprocher ce qui y correspond dans les langues européennes.
§ 109 i. Première et sixième classe.
La première et la sixième classe ajoutent « à la racine, et nous nous réservons de nous expliquer, en traitant du verbe, sur l’origine de ce complément et d’autres du même genre. La première classe comprend environ mille racines, presque la moitié çte la somme totale des racines; la sixième en contient à peu près cent cinquante; la différence entre ces deux classes est que la première élève d’un degré la voyelle radicale par le gouna (S 26) et la marque de l’accent, tandis que la sixième laisse la voyelle radicale invariable et fait tomber le ton sur la syllabe marquant la classe; exemples : bod'ati «il sait», de bud 1, mais tudâti «il frappe », de tud 6. Gomme « n’a pas de gouna, il n’y a pour cette voyelle de différence entre la première et la sixième classe que dans l’accentuation : ainsi magg-d-ti «sub-
mergitur» sera de la sixième. Mais, en général, les verbes ayant un a radical sont de la première1.
Quelques verbes de la sixième classe insèrent une nasale, qui naturellement devra appartenir au même organe que la consonne finale de la racine : exemples : lump-â-ti, de lup «fendre, briser»; vind-â-ti, de vid «trouver».
En grec, le complément a est représenté par s (par o devant les nasales, § 3) : Asfa-o-pev155 156t (psuy-o-fisv, de ÀIII, <DYF (IXittov, êtywyov}, appartiennent à la première classe, parce qu’ils ont le gouna (§ 96); au contraire, yXfy-o-fÂOu sera de la sixième157. En latin, nous reconnaissons dans la troisième conjugaison, dont je ferais la première, les verbes correspondant à la première et à la .sixième classe sanscrite; la longue de dîco, fido, déco tient la place du gouna de la première classe, et le complément i est un affaiblissement de l’ancien a (S 6); sous le rapport des voyelles, leg-i-mus est au grec \éy-o-(Aev ce que le génitif ped-is est à tsoS-os, qui lui-même est pour le sanscrit pad-âs. Dans leg-u-nt, venant de leg-a-nti, l’ancien a.est devenu un u par l’influence de la liquide (comparez § 7).
De même que dans la sixième classe sanscrite, certains verbes en latin insèrent la nasale : rump-i-t, par exemple, répond à la forme lump-d-ti, citée plus haut. On peut comparer à vind-â-ti, en ce qui concerne la nasale, les formes latinesjind-i-t, seind-i-t, tund-i-t.
Dans les langues germaniques, tous les verbes forts, à l'exception de ceux qui seront mentionnés plus bas (§§ ioqa, 2 et 5) et du verbe substantif, sont dans le ^apport le plus frappant avec les verbes sanscrits de la première classe l. Le ^ a, qui se joint à la racine, est. en gothique 158 159, resté invariable devant certaines désinences personnelles, et s’est changé, devant d’autres, en i (comparezS67), comme en latin; exemple: hait-a «j’appelle», hait-i-s, hait-i-th ; 20 personne duel hait-a-ts; pluriel : hait-a-m, 1iait-i-thf hait-a-nd.
■ Les voyelles radicales i et u prennent le gouna comme en sanscrit, avec cette seule différence que l’a du gouna s’est affaibli en « (§ 27), lequel, en se combinant avec un i radical, forme un i long (qu on écrit et, § 70); exemples : kema (= Mnavenant de kiïna) «je germe 5?, du verbe kin; biuga «je plie 5), du verbe lmgf en sanscrit Bug, d’où vient Bugnâ «plié»160. La voyelle radi-
cale sanscrite a se présente, en gothique, sous une triple forme. Ou bien a est resté invariable dans les temps spéciaux, par exemple dansfar-i-th «il voyage», pour le sanscrit câr-a-ti (S i4); ou bien l’ancien a s’est affaibli, dans les temps spéciaux, en i; exemple : qvim-i~th «il vient», à côté de qvam «je vins, il vint» (en sanscrit, racine gam «aller», § 6 ); ou bien, en troisième lieu, l’ancien a a complètement disparu, et IV, qui en est sorti par affaiblissement, compte pour la vraie voyelle radicale; on traite alors cet i de la même façon qu’un i organique, qui aurait déjà subsisté en sanscrit, c’est-à-dire qu’on le frappe de IV gouna dans
néanmoins je ne doute pas que Grimai n'ait eu raison d'écrire ga-lüka dans la deuxième édition de sa Grammaire (p. 8âs), attendu que tous les verbes forts, ayant un u radical , frappent au présent cette voyelle du gouna, et qu'il est beaucoup plus naturel d'admettre qu’ici le gouna a été remplacé par un allongement de la voyelle que de supposer qu’il a disparu sans compensation aucune. Mais si le gothique, ce qui a été contesté plus haut (S 76), avait été absolument dépourvu de Vu long, cette circonstance aurait certainement contribué à conserver la forme liuka, parce qu’ators il eût été impossible de compenser la suppression de IV par l'allongement de la voyelle radicale. v
L’w de truda «je foule» est, comme te montrent les dialectes congénères, pour un i; je le regarde comme un affaiblissement de Va radical, lequel, au lieu de se changer en t, s’est changé, par exception dans ce verbe, en la voyelle u, moins légère que IV, et, par conséquent, plus proche de la voyelle a (S 7 ) ; truda est donc, aux formes comme giba, ce qu’en latin concuho est aux composés comme contingo, avec cette différence quici le voisinage de Z u contribué à faire préférer l’w à IV*. 11 ne me paraît pas douteux que le prétérit de truda, qu’on ne trouve nulle part, a dû être trath, plurieltrêdum, ainsi que l’admet Grimai (I, p. 84a), quoique Grimm ait lui-même changé d’opinion au sujet de ce pluriel (Histoire de la langue allemande), çt qu’il préfère actuellemetft trodum à trêdum. Ce qui rend la dernière forme plus vraisemblable, ce sont les formes du vieux haut-allemand drâti (subjonctif) et fur-trâti (a* personne du singulier de l’indicatif). S'il y avait eu un prétérit pluriel gothique trodum, on aurait eu probablement, au singulier, trôth, en analogie avec/tir, fôrum, présent far a; alors le présent truda appartiendrait à la septième conjugaison de Grimm,et il serait, en ce qui concerne la voyelle radicale, dans le même rapport’ avec les autres formes spéciales de cette classe, que le sont les formes comme bun-dum «nous liâmes» avec les formes monosyllabiques du singulier, comme band (douzième conjugaison). .
les temps spéciaux, et de Va gouna au prétérit singulier, et on le conserve pur au prétérit pluriel. C’est ici que vient se ranger le verbe km « germer », mentionné plus haut : présent keina, prétérit singulier kamj pluriel kin-um. La racine sanscrite correspondante est gan «engendrer, naître» (§ 87, 1). Même rapport entre greipa, graip, gripum, de grip «saisir» et W^graB (forme védique) «prendre» 161. Au contraire, bit «mordre»'2 (beita, bail, bitum) a déjà, en sanscrit, un i. Comparez f*rgr iïid «fendre».
§ 109“, 9* Quatrième classe.
La quatrième classe sanscrite ajoute aux racines la syllabe ya et se rencontre en cela avec les temps spéciaux du passif; les verbes appartenant à cette classe sont, d’ailleurs, en grande partie, des intransitifs, comme, par exemple, nâd-ya-ti «il périt», hfsya-ti «il se réjouit», fd-ya-ti «il croît», küp-ya-ti «il se fâche», trm-ya-ti «il tremble». La voyelle radicale reste, en général, invariable, et reçoit le ton162, comme on le voit par les exemples précédents, au lieu que le passif laisse tomber le ton sur la syllabe ya. Comparez, par exemple, nah-yd-tê «il est lié» avec le moyen nâiti-ya-tê (actif nah-ya-ti) «il lie». Cette classe comprend environ cent trente racines.
Je rapporte à cette classe les verbes gothiques en ja, qui, comme par exemple vahs-ja «je croîs», ùid-ja» je prie», rejettent ce complément au prétérit ( vâhs «je crûs», bath «je priai », pluriel bêdum). Ils n’ont, dans les temps spéciaux, qu’une res^-
1 .Lé j». gothique tient ici exceptionnellement la place d’un è, qui est le substitut ordinaire du b sanscrit (S 88). Comparez le lithuanien grë'bju «je prends», ancien slave gràhljùn «je pille».
3 Le verbe bit ne se rencontre qu’avec la préposition and et dans le sens de «injurier», mais il répond an vieux haut-allemand biz «mordre» (en allemand moderne semblance fortuite avec la première conjugaison faible de Grimm (nas~ja «je sauve»), dont le ja a une autre origine, et est, comme on le montrera plus tard, un reste de aja (en sanscrit aya, § 109", 6 ). La racine sanscrite vaks, qui répond au gothique vahs, appartient à la première classe (mks-a-ti «crescit»), mais la racine zende correspondante, qui se montre d’ordinaire sous la forme contractée ulis\ appartient à la quatrième; c’est ainsi que nous avons, dans un endroit cité par Burnouf ( Yaçna, notes, p. 17), us-uüsyanti ^ ils croissent », forme qu’on peut comparer au gothique vahs-ja-nd. Je ferai encore observer que, si les verbes gothiques com mevahsja contenaient un mélange de la conjugaison forte et de la conjugaison faible, il faudrait attendre une forme bad-ja et non bid-ja, de même que nous avons sat-ja s je place» («je fais asseoir»), de la racine sat (sita, sat, sêturn), nasja «je sauve», de nas ((ganisa «je guéris», prétérit ga-nas). Dans les racines terminées en 0 (= â} S 69, 1), l’d s’abrége en a dans les temps spéciaux, et le j, devenu voyelle, se réunit avec Va pour former une diphthongue ; exemple : vaia «je souffle », pour va-ja, lequel est lui-même pour vô-ja, de la racine vâ (prétérit vaivâ), en sanscrit vâ (parfait va-vâü), dont la 3e pers. du présent ferait, d’après la quatrième classe, vd-ya-ti. Ainsi que vaia, je rapporte à cette classe les deux autres verbes de la cinquième conjugaison de Grimm, à savoir îaia «maledico» et saia «je sème», des racines lô, sâ. La forme saijüh (Marc, IV, ik) «il sème» est mise par euphonie pour satith, / étant évité après ai, tandis que, devant uafl,un ne rencontre jamais aij pour ai (saiadn, satan, saiands, satans; voyez Grimm, I, p. 845).
Le sanscrit présente également, dans cette classe de verbes, 161
des abréviations de â en a, si l’on y rapporte avec Bœhllingk (Ghrestomathie sanscrite, p. 279) des formes comme dd-ya-ti«il boit 57. Ce qui vient à Fappui de celte manière de voir, c’est que toutes les racines terminées, selon les grammairiens indiens, en ê, âi, ô, suivent l’analogie des racines en â dans les temps généraux 161 ; ainsi d’â-stjdmi «je boirai?) ne vient pas de de, mais de dit. (Comparez le grec B-rjaôai.) Il y a donc lieu de supposer qu’il n’y a pas de racines terminées par une diphthongue, mais qu’à l’exception de gyô (en réalité gyu), toutes les racines auxquelles les grammairiens attribuent une diphthongue comme lettre finale appartiennent à la quatrième classe de conjugaison. En ce qui concerne la forme qu’elles prennent dans les temps spéciaux, ces racines se divisent en trois classes : i° verbes qui laissent la final de la racine invariable devant la syllabe caractéristique ya; exemple : gd-ya-ti «il chante», de gâ2; 20 verbes qui, comme d'd-ya-ti, que nous venons de mentionner, abrègent l’a. Les grammairiens indiens divisent ainsi : idy-a-ti, et rapportent le verbe, ainsi que les autres semblables, à la première classe; 3° verbes qui, devant la syllabe caractéristique ya, suppriment la voyelle radicale â, de sorte que le ton est nécessairement rejeté sur cette syllabe. Il n’y a que quatre verbes de cette espèce, parmi lesquels d-yd-ti « abscindit »;dont la racine dâ se montre clairement dans dâ-td-s « coupé » et dà-tra-m «faucille». En ce qui touche la suppression de la voyelle radicale, dans les temps spéciaux, comparez la perte de la dans dâ «donner» et M «placer», au po- 163 tentiel dad-yd-m, dad-yd-m, pour dadâ-yam, dadâ-ydm, en grec StSoi'yv, TtOeiwv.
Nous retournons aux langues germaniques pour faire remarquer qu’en vieux haut-allemand 1 ej, qui est le caractère de la classe, s’assimile souvent â la consonne radicale précédente; exemples : kef-fu «je lève», pour hef-ju, à côté du gothique haf-ja, prétérit hôf; pittu «je prie», pour pit-ju, gothique bid-ja. Ceci nous'conduit aux verbes grecs comme fidXXco, 'üfdXXc*.>, aX-Xopou (venant de fidX-jc»), 'GfdX-ja, etc. § 19), que je rapporte également à la quatrième classe sanscrite, le redoublement des consonnes se bornant aux temps spéciaux. Dans les formes comme 'tapdero-ci), (ppieraoj, Xlcaop.au se cache une double altération de consonnes, à savoir le changement d’une gutturale ou d’une dentale en sifflante, et, d’autre part, en vertu d’une assimilation régressive, le changement du j, qui se trouvait autrefois, en grec, en <7; ainsi 'stpd<r-o,cû vient de utpdy-jw, (fipi'cr-crw de Çpix-jea, Xfo-aro-pou de Xh-jo-pctt. J’explique de la même manière les comparatifs à double o*, comme yXvar&wv pour yXôxjwv (yXux/aw); xpsio-trwv pour xpskjoâv, C’est par l’analyse de ces formes de comparatifs que je suis arrivé, dans la première édition à découvrir le rapport des verbes grecs en ova (attique t7«) et XXûj avec les verbes sanscrits de la quatrième classe. Néanmoins, tous les verbes grecs en ovrcy ne se rapportent pas à la quatrième classe sanscrite; une partie de ces verbes viennent d’ailleurs, quoique également avec l’assimilation régressive d’un y primitif (sapscrit Nous y reviendrons plus tard.
On a déjà fait observer *plus haut que le y -sanscrit de la quatrième classe paraît aussi dans les verbes grecs correspondants sous la forme du exemples : jBXde fâ-joj,
(3Xv-jco; (3po%t“Z<u de (Boty-jw, <jy$-jco (§ 19). 164
Dans les verbes dont la racine se termine par une liquide, il arrive quelquefois que la semi-voyelle, après s’être changée en f, passe dans la syllabe précédente; de même donc qu’on a les comparatifs djustvm, pour âfxevtcov, yeptav, ve“
nant de dfiévjav, x.épjœv, de même on a %aipw, venant de Xap-jw. pour le sanscrit hrs-yâ-mi du primitif hnrs-yâ-mi164 ; imtv-$-Tcu, venant de pav-je-Tott, pour le sanscrit î ïn-ya-tê (racine JP^man «penser»)*.
Aux formes gothiques, mentionnées plus haut, comme vota «je souffle» (de va-ja^j, saia «je sème» (de sa-ja), répondent en partie les verbes grecs en a/», notamment Safa «je partage», de Sd-ja, lequel est resté plus fidèle à la forme primitive que le sanscrit â-yâ-rm «abscindo», en çe qu’il a conservé la voyelle radicale: il est sous ce rapport à la forme sanscrite ce que StSoinv, ttOetrjv sont au sanscrit dadyam, dadydm. Ut de Sctt(û a fini par faire partie intégrante de la racine dans certaines formations nominales comme S&is, éd/n;, SouTpés, ainsi que dans le verbe &cUpVfu ; un fait pareil a lieu en sanscrit, où nous trouvons à-côté dés verbes và-ya-ti «il tisse», dd-ya-ti «il boit», les thèmes substantifs vê-man (venant de vai-man) «métier à tisser» et dê-nû «vache nourricière», formes qui ne doivent pas nous induire à admettre avec les grammairiens indiens vê et de comme étant des racines véritables. On pourrait cependant regarder aussi vê-man, iïê-nü comme des altérations de vd-man, dû-né, attendu qu’on trouve encore ailleurs des exemples d’un â affaibli en ê — ai, par exemple, au Vocatif des thèmes féminins en a y comme sutê « fille », de sutâ', et au duel du moyen, comme dbâdêtâm «tous deux savaient», venant de abôd-a-âtâm.
En ce qui concerne <W<w«jebrûle, j’allume», j’ai émis, dans mon Glossaire, la conjecture qu’il répond au causatif dâh-âyâ-mi
1 L’a de toutes les syllabes caractéristiques est allongé en sanscrit devant m et f, si ces consonnes sont suivies d’une voyelle, ce qui a toujours lieu pour le v.
« je fais brûler, j allume»; cependant, je ne conteste pas que, squs le rapport de la forme, peut répondre aussi a Eintran-sitif ddh-yâ-mi «ardeo» : dans ce cas, la suppression de 1**, dans les formes comme êSaôuijv, Sdkrat, Séance, sera parfaitement régulière. Parmi les verbes en ew, ainsi que le fait remarquer G. Curtius \ ceux dont la syllabe caractéristique ne sort pas des temps spéciaux peuvent, être rapprochés des verbes sanscrits de la quatrième classe; Te sera alors une altération de Et, venant de y (S 656), et œBéw, par exemple, sera pour &Bjc»>. Mais pour le plus grand nombre de ces verbes en e«y, je regarde Es comme une corruption de l’a sanscrit (S 109% 6). Dans yotyiéco, venant de ydpjœ,, je crois reconnaître un verbe dénominatif, quoique les temps généraux dérivent immédiatement de yafi : nous aurons de la sorte un verbe grec à rapprocher du mot sanscrit gam (venant de gam) qu’on ne rencontre que dans le composé gam-patî «épouse et époux»; il faut rappeler à ce •sujet que les thèmes dénominatifs sanscrits en ya peuvent entièrement supprimer cette syllabe aux temps généraux, et qu’en grec les dénominatifs à deux lettres semblables, comme dyyél-A<w, 'sroiHtXkaj, xopvo-crck) (formés par assimilation de àyyéX-jù>, 'ZffotxtX-joj, xopvB-jco), se débarrassent dans les temps généraux de la seconde lettre et font, par exemple, âyyeXâ, tfyyeXov, ■croiXiAw, xsx6pvB(ioLt.
Le latin présente des restes de la quatrième conjugaison sanscrite dans les formes en io de la troisième conjugaison, comme cupio, capio, sapio. Le premier de ces verbes répond au sanscrit küp-yâ-rni «îrascor», les1 deux autres au vieux haut-allemand hef-fu (gothique haf-ja «je lève»), sef-fu {m-sejju «intelligo»), En lithuanien, il faut rapporter ici les verbes commegnÿbiu «je pince», prétéritgnÿbau, futurgmjbsiu; grudiu
1 Voyez G. Curtius, La formation des temps et des modes, en grec et en latin, p. <)A et suiv.
«je foule» (par euphonie pour grudiu, S 9a 165), prétérit grü-dau, futur grû-siu (8 io3). Les verbes de même sorte, en ancien slave, ont tous une voyelle à la fin de la racine, de façon qu’on doit peut-être admettre que le j a été inséré par euphonie pour éviter l’hiatus; exemples : muh pijuh «je bois», nmcmu pi-jesi «tu bois» (comparez Miklosich, Théorie des formes, p. A 9). Il faut dire, toutefois, qu’en sanscrit la racine pî «boire » (forme affaiblie de pa) appartient en effet à la quatrième classe, de sorte que, si l’on divise ainsi les formes slaves: pi-je-si, pi-je-tï, etc. elles concorderont parfaitement avec le sanscrit pï-ya-sê, pî-ya-tê (abstraction faite des désinences du moyen).
§ 109% 3. Deuxième, troisième et septième classe.
Les deuxième, troisième et septième classes ajoutent les désinences personnelles immédiatement à la racine; mais, dans les langues de l’Europe, ces classes se sont en grande partie fondues avec la première, dont la conjugaison est plus facile; exemples : edri-mus, et non cd-mus (nous avons es-t, es-tis, comme restes de l’ancienne formation); gothique it-a-m; vieux haut-allemand èz-a-mêsyet non ëz-mês, à côté du sanscrit ad-mds. La deuxième classe, h laquelle appartient ad, laisse la racine sans complément caractéristique, en marquant du gouna les voyelles qui en sont susceptibles, quand la désinence est légère166; exemple : êmi, à côté de imds, de i «aller», comme en grec nous avons sïpt à côté de t[iev. Cette classe ne comprend pas plus d’environ soixante et dix racines, les unes finissant par une consonne, les autres par une voyelle. Le grec n?a guère de cette classe et de la troisième que des racines terminées par des voyelles, comme/, Ça, /3a,
<*7a, S"»7, La liaison immédiate des consonnes avec les consonnes
des désinences a paru trop incommode ; il n’est resté dans la seconde classe que la racine es1 cri étant des groupes faciles à prononcer), laquelle est restée également de la même classe en latin, en lithuanien, en slave et en germanique : nous avons donc asti, è</l/, lithuanien esti, gothique et vieux haut-allemand ist, slave KCTt jestï. En slave, il y a encore de la même classe les racines jad « manger » et vêd «savoir», qui à toutes les personnes du présent s’adjoignent les désinences d’une façon immédiate; ainsi le lithuanien fait êd-mi, 3e personne ês-t; pluriel êd-me — sanscrit ad-mâs, ês-te — cit-ld. Au sujet de quelques autres verbes lithuaniens qui suivent plus ou moins le principe de la deuxième classe sanscrite, je renvoie a Mielcke, p. i35. En latin, il y a encore les racines i, da, stâ, fâ {fâ-tur), jlâ, qua (in-quàm)167 168 169, qui appartiennent à la deuxième classe sanscrite. Fer et veî (ml) ont conservé quelques formes de leur ancienne conjugaison. En vieux haut-allemand il y a encore quelques autres racines qui appartiennent à cette classe : 10 gâ «aller»,
tuo-n, tuo-s, tuo-t, tuo-nt1 ; en vieux saxon dô-m, do-s, dô-d; pluriel dâ-d «vous faites». La racine sanscrite correspondante da «poser», qui, avec la préposition vi (vida), prend le sens de «faire»170 171, appartient à la troisième classe.
La troisième classe comprend à peu près vingt racines, et elle se distingue de la deuxième par une syllabe réduplicative ; elle s’est conservée, avec ce redoublement, en grec, en latin, en lithuanien et en slave, mais surtout en grec. Comparez StSwpt avec le sanscrit dâdâmi «je donne», le lithuanien dîtdu ou dûmi (venant de dûdmi), le slave da-mï, venant de dad-mï; la 3e personne sanscrite dâdâti avec le dorien le lithuanien duda
ou dûs-ti, dîis-t, venant de dûd-ti (§ io3), le slave das-tî, venant de dad-ÎL Au sanscrit dâdïïmi «je pose», 3e personne dâiïâû, répondent le grec T/flïjfu, t(Birti., le lithuanien dedu (ou demiy venant de dedmi), deda ou des-t (verlant de ded-t). En latin, IV de sistls, sisû-t, etc. est un affaiblissement de 1*4 radical de s ta; de même, IV de bibis, bibi-t est un affaiblissement de Yâ sanscrit de la racine pâf représentée parpd (§ !\) dans po-tum, po-tor, pô-tio, pâ-culum, en grec dans 'usé-
lïWKd, «ra/rn, et tro dans 'sténopou, ênéôrjv, nsorês, etc. 172 173 174 175 176 177 178 179 180. A bibo correspond le védique pibâmi, qui a conservé Tancienne ténue dans la syllabe réduplicative, et qui n'a substitué la moyenne que dans le thème; dans la langue sanscrite ordinaire, le b s’est encore amolli en v1. Toutefois, les grammairiens indiens regardent pib (ou piv) comme un thème secondaire, et font de Va, par exemple dans pîbati, la caractéristique de la première classe : ils divisent donc pîb-a-ti, au Heu de piba-ti. Ce qui les autorise jusqu'à un certain point à mettre pîbati, ainsi que plusieurs autres verbes, dans la première classe, c’est que la voyelle radicale de ce verbe et celle de quelques autres, dont nous parlerons plus tard (S 5o8), suivent dans la conjugaison l’analogie de l’a adjonctif de la première classe, et que le poids des désinences n’amène aucun déplacement dans le ton, contrairement aux règles de l’accentuation pour les verbes de la troisième classe. Dans la syllabe réduplicative pibâmi, nous avons un i qui prend la place de la voyelle radicale, absolument comme dans iiScopt; il en est de même dans le dialecte védique pour gîgâmi «je vais» = fifêrjpt, qui est usité à côté de gd-gâmi, de même encore pour sisahti «sequitur» pour sdsaftit. Mais ce sont là des rencontres fortuites, causées par des altérations qui n’ont eu lieu qu’après la séparation des idiomes, et desquelles on peut rapprocher aussi le latin bibo, sisto et gigno. Ce dernier verbe et le grec ylyvo-pat s’éloignent du principe de la troisième classe sanscrite (a laquelle appartient aussi gâganmï), en ce que la racine reçoit encore l’adjonction d’une voyelle caractéristique,, à moins qu’il ne faille admettre que la racine gen, yen des deux langues classiques ait transposé la voyelle radicale, dans les temps spéciaux, du milieu à la fin : yi'yvo-pcti serait alors pour yiyov-pou, yiyve-rou pour yiyev-iat181 182, et le la-
‘srltofÂOL, 'nriâvts, et, entre autres, l’* (pour à) de SW-cthw, téOvti-xa, là de ts$vaa-i, l’e de veOve-eSs; de même encore j3ë-&üj-xa pour ^e€aX-xa, etc. Je rappelle enfin les thèmes mentionnés pour un autre but par G. Curtius (De nominumgratcorum formations, p. 17), <$uko(/lpé-T (racine <r7op, sanscrit
lin gignis pour gigm-s ou gigen-s (sanscrit gdgah-si), gignimm pour gigin-mus ou gigen-mus (sanscrit gagan-mâs), à peu près comme nous avons en grec sSpotxov pour ëSotpxov, 'sfcttpctŒt pour vrardp-Œt (thème sanscrit pitdr, affaibli en pitf\ Le verbe (racine sanscrite pat «tomber, voler») s’expliquerait de même par une transposition. Il n’est pas douteux à mes yeux que 156> de isê'KlaxcK. et 1 rj de ■sre7r7ï/<kJ£, 'GfSTrlrivïa ne sont pas autre chose que la voyelle radicale transposée et allongée. De même 1 ’<y de
star, str), aSprl-r (racine sanscrit dam), àxfxrf-T (racine xafz, sanscrit sam, venant de &am), iBvTfirj-T, ainsi que /SpoTé, venant de poprâ (racine sanscrite mar, mr « mourir»). Le sanscrit présente une transposition avec allongement de la voyelle dans la forme mnâ «songer, exprimer, vanter» (comparez pti-vtf&xù), pvrjpa, etc.) : c’est cette forme que les grammairiens indiens donnent pour la racine, en faisant observer que, dans les temps spéciaux, elle est remplacée par man; mais c’est évidemment le contraire qui a eu lieu : man est la racine et a été changé en mnâ dans les temps généraux.
Il n’en est pas moins certain que les verbes redoublés suppriment volontiers la voyelle radicale, dans les formes qui comportent un affaiblissement du thème; c’est ce qu’on voit en sanscrit, par exemple dansgagmés «ils allèrent», qu’on peut opposer au singulier gagàma, de gam.
Nous avons encore à ranger dans la troisième classe sanscrite un verbe latin, dont les temps spéciaux 183 cachent un redoublement assez difficile h reconnaître, quoique je ne doute pas que Pott n'ait raison, quand il considère le r de sero comme une altération d’un s (comparez § 29), et quand il regarde le tout comme une forme redoublée 1. En ce qui concerne la syllabe réduplicative, c’est évidemment le r qui est cause qu’au lieu de renfermer un i, comme bibo, sisto et gigno, elle a un c (§ 84). Mais si sero est une forme redoublée, IV de $eri-s, seti-t n’est pas la syllabe caractéristique de la troisième conjugaison, mais l’affaiblissement de l’a radical renfermé dans sa-tum : seri-s, seri-t sera donc pour seras, sera-t, comme bibi-s, bibi-t, sistis, sisti-t, pour bibas, etc.
La septième classe sanscrite, qui ne contient que vingt-cinq racines terminées par une consonne, insère la syllabe na dans la racine devant les désinences légères, une simple nasale du même organe que la consonne finale devant les désinences pesantes. La syllabe na reçoit le ton; exemples : yunagmi - «j’unis»; Binddmi «je fends»; einddmi (même sens), de yug, Bid, cid. Le latin, par l’adjonction d’une voyelle, a confondu les verbes de cette classe avec ceux de la sixième qui prennent une nasale (S 109 a, 1); un assez grand nombre de verbes lithuaniens ayant une nasale dans les temps spéciaux se rapporte également à cette classe. Nous avons, par conséquent, en latin : jung-i-t, find-i-t, scind-i-t, jimg-i-mus, jînd-i-mus, scind-i-mus, à côté du sanscrit ymâkti, Bînâtti, cinâtti, yung-mds. Bind-mds, cind-mds. En lithuanien, limp-à «je colle» (intransitif), pluriel hmp-a-me, est à son prétérit lipau, Mp-ô-me, ce qu’est en sanscrit limp-â-mi «j’enduis», pluriel limp-â-mas, à l’aoriste dlip-a-m, dlip-â-ma 2.
et de la quatrième conjugaison , ce temps n’étant pas autre chose, comme on le verra plus tard (S 692 et suiv.), qu’un subjonctif présent.
1 Recherches étymologiques, tre éd. I, p. 216.
2 Parmi les autres verbes lithuaniens de la môme espèce, rassemblés par Schîe i-
En grec, les verbes comme Xap^dvco, \i[mdvoô, (j.av9dvco réunissent deux caractéristiques : par la première, Xifinaveo se rencontre avec le latin linquo et le sanscrit r indemi \ pluriel riücmds, qui lui sont étymologiquement identiques. En gothique, le verbe standa «je me tiens» a pris une nasale qui ne se trouve que dans les temps spéciaux (prétérit stâth, pluriel stôthum pour stâ-dum; vieux saxon standu, stâd, stoclun^ de sorte qu’on est autorisé a placer ce verbe, qui d’ailleurs est seul de son espèce, à côté des formes à nasale de la troisième conjugaison latine et de la sixième classe sanscrite. Le d de là racine gothique stad n’est cependant pas primitif : c’est un complément qui a fini par faire corps avec la racine, comme le t de mat a mesurer» {mita, mat, mêtum'), quon peut rapprocher du sanscrit nui «mesurer», et le s de la racine lus «lâcher», qui est parent du sanscrit lû «couper», en grec Av, Av.
§ 109a, U. Cinquième et huitième classe.
1 ■
La cinquième classe, d’environ trente racines, a pour caractéristique la syllabe nu, dont IV reçoit le gouna et le ton devant les désinences légères. Les désinences pesantes entraînent la suppression du gouna et attirent sur elles l’accent. En grec, les formes comme aJép-vv-fAt, a16p-vv-{ts$, répondent aux formes sanscrites 2 «j’étends», pluriel str-nu-mâs. Dans alop-
l’e ne peut être qu’une voyelle auxiliaire destinée à aider la prononciation; quant au double v, il s’explique par l habitude qu’a le grec de redoubler les liquides après une
cher (Lituamca, p. 51 et suiv.), il n’y en a pas qui soit étymologiquement identique à un verbe sanscrit de formation analogue. •
1 Bacine né (de rik) «séparer». Sur n pour n, voyez $ i 7 b. a Venant de star-nô-mi; au sujet de n pour n, voyez S 17 b. J’explique l’«. du latin struo par la transposition et l’affaiblissement de l’a primitif de la racine star; de même en gothique slmu-ja, venant de staur-ja, en grec alpdj-wv-fxi.
voyelle : c’est ce que nous voyons constamment dans les verbes de cette classe, tels que 'zivwfxt, X>dvvvya, Çc/wwfJii, p&vvvfÂt, aipwvw{jLi, %pwvvvy,tL Au contraire, dans èvvvyt, le premier v vient d’une assimilation (ë<T-vv-yu, racine sanscrite vas «vêtir»). — Dans neeT-d-pm-tAt et a-jcsS-d-wv-yi, la est voyelle de liaison.
La huitième classe sanscrite, qui ne contient que dix racines, ne se distingue de la cinquième .que par un seul point : au lieu de nu, elle ajoute simplement « à la racine. Comparez, par exemple, tan-ô-mi «j’étends», pluriel tan-u-mds, avec le verbe mentionné plus haut str-no-mi, str-nu-mds. Ainsi que ttm, toutes les autres racines de cette classe, h l’exception de kar, kr «faire», se terminent par une nasale (n ou n), de sorte qu’on a toute raison d’admettre que la nasale de la caractéristique a été omise à cause de la nasale terminant la racine. Cette explication est d’autant plus vraisemblable que la seule racine de cette classe qui ne finisse pas par une nasale est de la cinquième classe dans le dialecte védique ainsi qu’en ancien perse; nous avons dans les Védas kr-nô-mi «je fais», zend kërë-
naumi, ancien perse aUunavam «je fis», à côté des formes du sanscrit classique kar-ô-mi, dkar-av-am. Avec la forme tan-o-mi, moyen tan-v-ê'(forme mutilée pour tan-u-mê'), s’accorde le grec -raVu-juou, et avec la 3e personne tan-u-tê\ le grec tdv-v-Tott. Il faut encore rapporter ici âv-v-yu et ydv-v-you; au contraire, 6X-Xvyi est évidemment pour 6\-vu-ut, par assimilation régressive, à peu près comme en prâcrit nous avons anm «autre» pour le sanscrit anya (§ 19). s
S 109*, 5, Neuvième classe. — Des impératifs sanscrits en ana.
La neuvième classe met nâ devant les désinences légères, et nî
1 En sanscrit, on redouble un n final après une voyelle brève, quand le mot suivant commence par une voyelle; exemples : iïsann âtra «ils étaient là », ftsann âdâé ■«ils étaient au commencement».
qui fait gân (pour gâ-m), gâ-s, gâ-t, gammés, gê-t (pour gâ-t), gâ-nt (voyez Graff, IV, 65), à comparer au sanscrit gdgâsi, etc. (dans les Védas, on trouve aussi gigâmi, etc.); on voit que le verbe germanique a perdu le redoublement, de sorte qu’il a passé, comme, par exemple, le latin do, de la troisième classe dans la deuxième; 9° stâ «se tenir», d’où viennent stâ-n, stâ-st (dans Notker, pour std-s), stâ-t; stâ-mês (ar-stâ-mês «sur-gimus»), stê-t («vous vous tenez», pour stâ-t), $tâ-nt (voyez Graff, VI, p. 588 et suiv.); 3° trn «faire» (on trouve aussi to, venant de tâ, compare^ S 69, 1 ; en vieux saxon dé), qui fait
(S 6) devant les désinences pesantes. L’accentuation est la même que dans la cinquièmè classe ; exemples : yu-nâ-mi « je lie » ; mrd-nâ-mi (de mard; comparez mordeo) «j’écrase » ; pluriel yu-nî-mds, mrd-nî-màs. En grec, nous avons, comme représentants de cette classe, les verbes en (de i>â-f«) qui, devant les désinences pesantes, changent la voyelle primitive à en sa brève; exemple:
, plurielSdfA-và-fXëv. On trouve aussi, en sanscrit, dans l’ancienne langue épique, au lieu de l’affaiblissement de na en n?, l'abréviation de nâ en nâ; exemples : mai-na-dvdm (ae personne pluriel moyen), de niant «ébranler»; prâty-agrh~na-ta {n, d’après § i 7*), de prati-grah «prendre, embrasser». (Voyez Grammaire sanscrite abrégée, § 3h5.) Cette dernière forme répond comme 3e personne de l’imparfait moyen aux formes grecques comme êSdp-va-TO. On supprime, à l’intérieur de la racine, une nasale précédant une muette finale: c’est ainsi que nous avons mai-na-dvdm au lieu de mant-ria-dmm; de même bad-nâ-mi «je lie»; grat-nd-nti(même sens),de band, grant. Du dernier verbe, Kuhn (Journal, IV, 320)rapproche, entre autres, le grecxXwflw, en se rapportant a la loi mentionnée § toU a. Je ne doute pas de cette parenté, car je regarde le verbe srant (venant de krant), qui a le même sens, et qui fait, au présent, srat-nâ-mi, comme primitivement identique avec grant184*, l’explication de xXwOw par la racine srant (sfcrant')-ou par la racine grant revient donc au même. On pourrait plutôt avoir des doutes sur le S- grec remplaçant un t sanscrit, car 184$f^t répond d’ordinaire, en grec, a un r (S 13), et le 3- fait attendre, en sanscrit, un £. On pourrait donc supposer que, dans les racines sanscrites dont il est question, l’aspirée sourde est le substitut d’une aspirée sonore, comme on l’a conjecturé plus haut (§ i3) pour naUa-s «ongle»,
comparé au lithuanien naga-s et au russe nogotj. Je rappelle encore ici la racine lÿQgwii, qui coexiste, en sanscrit, à côté de gui (guh) «couvrir»; or, c’est cette dernière racine, et non la première, qui répond au grec kvQ (S 1 oha). Au sujet de la racine ^«jjrani, il faut encore remarquer quelle est représentée, en latin, par la syllabe crê, de credo - sanscrit srad-daiâmi «je crois» (littéralement: «je mets croyance»), car je ne doute pas que Weber n ait Raison de faire dériver le substantif renfermé dans ce composé sanscrit de la racine 'ZF^srdnt ou irai « lier » ; je rappelle encore, à ce propos, que le grec tff/<r7fs vient également d’une racine dont le sens primitif est «lier» l.
Des formes comme ^dfx-vri-fit, ^dfÂ-va-fiev, $ctfÂ-voi-Ts sont nées, par 1 affaiblissement en o ou en e de la voyelle de la syllabe caractéristique, les formes comme SdH-vo-fisv^ Aûéjt-vg-rs; la 110 personne du singulier Sdn-vco (de ^cùt-vo-pt) est à SdH-vo-fisv ce que \sfo-co (venant de Xsi'ir-o-pt} est à Xe/7r-o-jtJter. 11 faut rapporter ici les formes latines comme ster-no, ster-m-s, $ter-ni-t, ster-m-mus, comparées au sanscrit str-nâ-mi, str-na-si, str-nd-ti. str-m-mas; mais IV bref latin n’a ici rien de commun avec le son sanscrit i; il n est que 1 affaiblissement d’un a primitif, comme on le voit par veh-i-s, veh-i-t = sanscrit vàh-a-si, vah-a-ti. Il en est de même pour le seul verbe gothique qui appartienne à cette classe : fraih-na «je demande », fraik-ni-s, jr(iih-ni~th (de JraiJi-na-&; fraih-m-th, dapres § 67), prétérit frak. En lithuanien, nous comprenons dans cette classe de conjugaison les verbes comme gaù-mi «j obtiens-^ , duel gou-na-wa, pluriel gau-na-me;
Voyez S 5, et, sur le composé érad-dtulami > S 63a. A ne considérer ce composé qu en lui-même, on ne peut pas reconnaître si le thème nominal qui en forme le premier membre se termine par un f, un f, un d ou un d\ car, dans tous les cas, la dentale ne pouvait paraître que sous la forme du d (S 93a). Mais comme il n’y a pas de racineêrat, érad, érad'ou «Vont, etc. il ne nous reste que frant ou érat «lier», pour
expliquer le mot qui, dans ce composé, veut dire «croyance» et qui, hors de là, a disparu de T usage.
prétérit gaw-au, futur gaw-siu, etc. L’ancien slave, au présent, a affaibli la voyelle de la syllabe caractéristique en u devant le h de la iropersonne du singulier et de la 3e personne du pluriel; partout ailleurs, il l’affaiblit en s; exemple: dvig-nu-n «je
remue», 2° personnedvig-ne-si, 3e personne dvig-ne-tï; duel dvig-ne-vê (eu), dvig-me-ta, dvig-ne-ta; pluriel dvig ne-me, dvig-ne-te, dvig-nu-ntt Mais le slave s’éloigne des autres membres de la famille indo-européenne en ce qu’il ne borne pas la syllabe caractéristique aux temps spéciaux, mais qu’il l’insère également dans les formes qui devraient provenir uniquement de la racine. Il ajoute à la caractéristique un n devant les consonnes et a la fin des mots, un v devant les voyelles185; on a, par exemple, à l’aoriste : dvig-nun-chü; a0 et ,3° personne dvig-nuh; pluriel dvig-nun-ch-o-mü, dvig-mm'-s-te, dvig-nuh-sah. Mais (ce qu’il est important de remarquer), quand la racine se termine par une consonne, l’aoriste, les participes passés actifs et les participes présents et passés passifs peuvent renoncer à la syilabe caractéristique , et se ranger de la sorte au principe du sanscrit et des autres langues congénères. (Voyez Miklosich, Théorie des formes, p. 54 et suiv.) Si, comme le suppose Miklosich, nous devons reconnaître dans le présent dvignun une mutilation de dmgnvuh ou dvignomh, et si, par conséquent, dvig-ne-si, dvig-ne-tï, sont pour dvig-nve-si, dvig-nve-tï ou dvig-nove-si, dvig-nove-tï, il faudra rapporter cette classe de verbes à la cinquième classe sanscrite; on pourra Comparer l’a de la syllabe dérivative avec l’a qui, en zend, vient quelquefois se joindre à la caractéristique nu: c’est ainsi que nous avons, par exemple, en zend, kërë-nvô « tu185 fis » (pour kërë-nva-s), venant de kërë-nau-s, et de
même, en grec, il y a une forme inorganique, Setxvvù), h côté
de Seixwtii. Mais je doute qu’il y ait jamais eu, en slave, des formes comme dvig-nvuh, dvig-nvesi, ou comme dvig-
novu-n; dvig-nôve-éi, etc. Les participes passifs comme dvignov-e-nü ne me paraissent pas à eux seuls un argument suffisant pour changer l’explication de toute la classe de conjugaison dont il est question, et pour cesser d’admettre que -ne-mü, -m-te, -nu-ntï, -ne-ta, correspondent au grec vo-(xev, -vs-ts,
-vo-vjt, -ife-TGv, dans les formes comme Sdht-yo-fnv^ etc. et au lithuanien na-me, -na-te, -na-wa, -na-ta dans gau-na-me, etc. (S ^96). Mais si le participe passé passif, par exemple dvig-nov~e-nü, ne pouvait être considéré comme appartenant a lui seul à une classe de conjugaison qui n’est pas représentée autrement en slave ni en lithuanien, nous regarderions alors le v de cette forme comme un complément ou une insertion euphonique. De toute façon, nous persistons à ramener à la neuvième classe sanscrite la classe de conjugaison slave dont il est question ici; et nous faisons encore observer que, en zend aussi, la caractéristique nâ est quelquefois abrégée et traitée comme l’a de la première et de la sixième classe; exemples : «pxH&P» stërënaita «qu’il étende » (moyen), stërënayën «qu’ils étendent » (actif), formes analogues à baraita (pipom»), barayen (<pépotsv), et rappelant particulièrement les formes grecques comme $dx~ VOtTO, Sdxvotev,
Les racines de la neuvième classe sanscrite terminées par üne consonne ont, à la 2e personne du singulier de 1 impératif actif, la désinenceâna,\au lieu de la forme niki qu’on devrait attendre; exemple : kliéânà «tourmente!», tandis que nous avons yu-wî-hl (venant de yu-nî-dî) «unis!» Si l’on admet un rapport entre cette syllabe âm et la caractéristique primitive de la neuvième classe, c’est-à-dire la syllabe nâ de kUs~na~mi «je tourmente », il faut considérer ân comme une transposition pour na1,
1 Comparez Lassen, Bibliothèque indienne, III, p. 90.
de meme que, par exemple, drakêydmi «je verrai » est une transposition pour darkéyami (en grec sSpoutov pour ëfapxov), ou de meme que, en sens inverse, B-vv-tôs est pour Sav-rês (en sanscrit ha-td-s «tué», pour han-tas, venant de dhn-td-s). À la syllabe transposée ân serait encore venue s’adjoindre la caractéristique a de la première et de la sixième classe, comme en grec, par exemple, de §dp.-vn-ftt, 'mép-vtj-fju, sont sorties les formes vd-œ, xsep-vd-cû, et de àetx-vv-fjLt la forme Ssut~v6-oj. Peut-être, à une époque plus ancienne de la langue, les impératifs comme klisand n’étaient pas isolés, mais accompagnés de formes du présent, comme klisâ-nâ-mi, klisâ-na-sî, disparues depuis. C’est a des formes de ce genre qu’on pourrait rapporter les formes grecques comme atî?di>w, j3\a<r1dv6>, et celles qui insèrent une nasale, c’est-à-dire qui réunissent les caractéristiques de deux classes, comme hpurdpco, (jtav8dv(v. Les impératifs grecs comme aûÇ-ape, Xdfx^ave, correspondraient parfaitement aux impératifs sanscrits comme klisând. Mais si cette ressemblance n’était qu’apparente, il faudrait diviser les formes grecques ainsi : ay^-a-ve, XaVê-a-ve, et regarder la voyelle précédant le v comme une voyelle de liaison, analogue à la voyelle de a1op-é-vw~ixi, 'sfST-d-vw-fjLi (i 09*, à). Ce qui est certain, c’est que les verbes en avw tiennent par quelque côté à la neuvième classe sanscrite.,
$ î 00a, 6* Dixième classe.
La dixième classe ajoute dya à la racine et est identique avec la forme causative ; ce qui a déterminé les grammairiens indiens à admettre une dixième classe, c’est uniquement la circonstance qu’il y a beaucoup de verbes qui ont la forme causative, sans avoir le sens d’un causatif (par exemple Mm-dya-ti «il aime»). Cette classe se distingue, d’ailleurs, des autres en ce que la carae-téristique s’étend à la plupart des temps généraux et même à la formation des mots, avec suppression toutefois de l’« final de
aya. Plusieurs verbes, que les grammairiens indiens rapportent à cette classe, sont, suivant moi, des dénominatifs; ainsi Jeumâr-dya-ti vil joue» vient de kiimârâ v enfant» (S 106); éabd-âya-ti vil résonne», de éabdd «son, bruit». On verra plus tard que beaucoup de verbes dénominatifs, reconnus comme tels, ont la forme de cette classe. .
Les voyelles susceptibles de prendre le gouna le prennent quand elles sont suivies d’une seule consonne, et, si elles sont finales, elles prennent le vriddhi ; un a non initial et suivi d’une seule consonne est ordinairement allongé; exemples; éâr-dya-ti vil vole », de cur; yâv-aya-ti vil repousse», de yu; grâs-aya-ti vil avale», de gras. Dans les membres européens de notre famille de langues, je rapporte à cette classe de conjugaison : i° les trois conjugaisons des verbes germaniques faibles; â° les première, deuxième et quatrième conjugaisons latines; 3fl les verbes grecs enatfiô (= ajw, § 19), a«; o«(de ajù)> etc.); 4° une grande partie des verbes lithuaniens et slaves; nc^s y reviendrons.
Dans la première conjugaison faible de Grimm, le aya sanscrit a perdu sa voyelle initiale; par là cette conjugaison a contracté, comme nous l’avons déjà remarqué (S 109", 9), une ressemblance extérieure avec la quatrième classe sanscrite; je m’y suis laissé tromper autrefois, et j’ai cru pouvoir rapprocher tamja vj’apprivoise » du sanscrit dâm-yâ-mi vje dompte» (racine dam, quatrième classe)1. Mais tam-ja correspond en réalité au causatif sanscrit dam-dyâ-mi (même sens); tam-ja lui-même est le causatif de Ja racine gothique tam, d’où vient ga-timith vil convient» (en allemand moderne geziemt); c’est de la même façon que lag-ja vje pose» appartient à la racine lag vêtre posé» (Uga, lag, îêgum), dont il est le causatif (en allemand moderne legen et liegen).
1
Annales de critique scientifique, février 1897, p. a83. Vocalisme, p. 5o.
En latin, les verbes de la quatrième conjugaison ont éprouvé une mutilation analogue à celle des verbes gothiques de la première conjugaison faible; nous avons ~iof -m-nt, ~w-nsf par exemple, dans aud-io, mid-iu-nt, aüd-ie-ns, de meme qu’en gothique on a tam-ja, tam-ja-nd, tam-ja-nds, à côté des formes sanscrites dam-ayâ-mi, dam-âya-nti, dam-âya^n. Au futur (qui est originairement un subjonctif), nous avons le même accord
entre aud-iê~s, aud-iê-mus, aud-iê-tis, venant de aud-iai-s, etc.
• *
(S 5), et le gothique tam-jai-s, tam-jai-ma, tam-jai-th, en sanscrit dam-dyê-s, dam-âyê-ma, dam-âyê-ta. La où deux i se seraient rencontrés, il y a eu contraction en î, lequel s’abrége, comme toutes les autres voyelles longues, devant une consonne finale, excepté devant s. Nous avons donc aud-î-s, aud-i-t, aud-î-mus, audA~t\s, aud-î-re, attd-î-rem, pour aud-ii-s, etc. Le gothique est arrivé, par une autre cause, à une contraction analogue (comparez § 135); dans les formes comme sôk~ei~s stu cherches» (= sôk-î-s pour sôk-ji-s, venant de sôk-ja-$, S 67). Mais on peut encore expliquer d’une autre façon Yî long de la quatrième conjugaison latine : le premier a de aya, affaibli en i, a pu se contracter avec la semi-voyelle suivante de manière à former un 1 long, lequel s’abrége devant une voyelle ou un t final. En tout cas, la caractéristique de la-quatrième conjugaison latine est unie, d’une façon ou d’une autre, avec celle de la dixième classe sanscrite.
Dans la troisième conjugaison faible de Grimm, je regarde la caractéristique ai (vieux haut-allemand è) comme produite par la suppression du dernier a de aya , après quoi la semi-voyelle, vocalisée en i, a dû former une diphthongue avec Va précédent; nous avons, par conséquent, à la 9e personne du présent des trois nombres, hab-ai~s, hab-ai-ts, hab-ai-tlu Devant les nasales, qu’elles existent encore dans les formes actuelles ou qu’elles aient disparu, IV de la diphthongue a été supprimé;
exemple : baba «j’ai», pluriel ftab-a-m, 3e personne ltab-a~nd, qu’on peut comparer aux formes mieux conservées du vieux haut-allemand hab-ê-m, hab-ê-mês, hab-ê-nt (ou kapêm, etc.). À cet ai gothique et à cet ê vieux haut-allemand répond Yê latin de la deuxième conjugaison ; exemple : hab-ê-s, qui est complètement identique, par le sens comme par la forme, au vieux haut-allemand hab-ê-s. Il n’est pas nécessaire de rappeler que Yê latin s?ahrége en vertu des lois phoniques, par exemple, dans hab-e-t; en gothique, au contraire, et en vieux haut-allemand, la longue persiste dans hab-ai-th et hab-ê-t A la ire personne du singulier, 17f de habeo représente Y a final de la caractéristique sanscrite aya, lequel est allongé à la ire personne [côr-âyâ-miy
Un fait digne de remarque, c’est que le prâcrit, d’accord en cela avec la deuxième conjugaison latine et la troisième conjugaison faible germanique, a rejeté le dernier a de la caractéristique sanscrite aya, et contracté la partie qui restait en ê : de là les formes éint-ê-mi «je pense», cint-ê-si, cint-ê-di, cint-ê-mha186, cint-ê-da, cint-ê-nti, répondant au sanscrit cmt-dyâ-mî, -dya-si, -dya-ti, -dyâ-mas, âya-ia, -dya-nti. Le prâcrit s’accorde, comme on le voit, parfaitement avec le vieux haut-allemand hab-ê-m, hab-ê-s, hab-ê-t, hab-ê-mês, hab-ê-t, hab-ê-nt, ainsi qu’avec les formes latines analogues.
Dans la deuxième conjugaison faible de Grimm et dans la première conjugaison latine, la caractéristique sanscrite aya a perdu sa semi-voyelle, et les deux voyelles brèves se sont con-^ tractées'en une longue^, à savoir à en latin (à la iro personne du singulier â est remplacé par o) et â en gothique (S 69, 1); exemple : laig-ô «je lèche», laig-â-s, ïaig-ô-th, laig-â-m, laig-6-tli, hig-ô-nd, en regard du causalif sanscrit lêh-âyâ-mi{lêh pour laih), lêh-dya-si, lêh-dya-ti, lêh-ayâ-mas, lêh-dya-ia, lêh-dya-nti,
1 Cette Tonne contient le verbe substantif, mha étant une transposition pour hma qui représente le sanscrit smas.
de la racine lih «lécher»; le verbe faible gothique a le gouna, comme le causatif sanscrit, quoiqu’il soit retourné à la signification primitive du verbe. Comparez à ces formes les formes latines comme am-â-s, am-â-mus. am-â-tis9 probablement pour cam-â-s, etc. = le sanscrit Mm-dya-si «tu aimes» L Le prâcrit peut également rejeter la semi-voyelle de la caractéristique aya, mais il n’opère pas dans ce cas la contraction, et il a, par exemple, ganaadi «il compte» pour le sanscritgandyati.
En grec a?o, a?e, venant de ajo, otje (S 19), est le plus fidèle représentant de la caractéristique aya. Comparez avec
le sanscrit dam-dya-ta «vous domptez». En lithuanien et en slave, le type des thèmes verbaux en aya s’est le mieux conservé dans les verbes qui ont à la tre personne du singulier ôju, dhï» ajuh, formes qui correspondent au sanscrit dyâmi et au grec a£w2. De même que le gothique îaigâ «je lèche» se rapporte au causatif sanscrit lêh-dyâ-mi, de même le lithuanien raudoju «je gémis» et le slave pXiAdfft rüdajuh (même sens) se rapportent au sanscrit rôd-dyâ-mi «je fais pleurer», de la racine rud (vieux
1 Voyez Glossaire sanscrit, 18Ô7, p. f>5.
2 Dans les formations lithuaniennes de cette espèce, le premier a de la caractéristique sanscrite s’est donc allongé, car l’o lithuanien répond, ainsi que l’a slave (% 93 *), à un â sanscrit. Je rappelle donc ici provisoirement les verbes dénominatifs sanscrits en cîyâ, dont l’d n’est toutefois qu’un allongement de l’a final du thème nominal. Aux verbes lithuaniens dont nous parlons, répondent encore, même en ce qui concerne l’accentuation, les formes védiques comme grb-âyâ-ti cril prend», qui se distinguent, en outre, des verbes ordinaires de la 1 oe classe en ce que la racine n’a pas de gouna ni de vriddhi, mais éprouve, au contraire, un affaiblissement (gi'tiâyâti pour grabtyâti, comparez Benfey, Grammaire développée, S 8o3, III, et Kuhn, Journal, II, p. 3qô etsuiv.). Je ne doute pas que ces verbes n’aient été aussi dans le principe dés dénominalifs ; grb'âyâti suppose un adjectif gréa, de même que nous trouvons à côté de êubayâté «il brille» un adjectif éub'â «brillant», et à côté de priyâÿâti «il aime» un adjectif priyâ «aimant» ou «aimé». De ce dernier mot vient, entre autres, le gothique fria-tkva (féminin) «amour» (thème -thvô), ainsi ([uefrij-ô «j’aime», s0 personne frij-ô-s, lequel,en tant que dénominatif, s’accorde avec les formes comme finb:-û «je pêche» (du thème fitka). 186
haut-allemand ruz, d’où vient riuzu «je pleure », prétérit rom, pluriel ruzumê?). Je mets ici les présents des trois langues pour qu’on les puisse comparer entre eux :
Singulier.
|
Sanscrit. |
Ancien slave. |
Lithuanien. |
|
rôd-àyâ-mi |
nid-aju-ii |
raud-qju |
|
rôd-àya-si |
rüd-aje-si |
raud-oji |
|
râd-âya-tî |
rüd-aje-lï Duel. |
raud~oja |
|
rôd-uyâ-vas |
rüd-aje-vê |
raud-o)a-wa |
|
rôd-aya-tas |
rüd-aje-ta |
raud-oja-ta |
|
râd-âya-las |
rüd-aje-ta Pluriel. |
raud-oja |
|
rod-àyâ-mas |
rüd~aje-mü |
rauâ-oja~me |
|
rod-àya-ia |
rüd-a)e~îe |
raud-oja-te |
|
rèd-âya-nü |
rüd-aju-ditï |
raud-oja. |
S 109b, 1. De la structure des racines indo-européennes. — Racines
terminées par une voyelle.
Pour montrer quelle variété il peut y avoir dans la structure des racines, nous allons en citer un certain nombre, en les disposant d’après les lettres finales. Nous ne choisirons que des exemples qui appartiennent à la fois au sanscrit et aux langues congénères, sans pourtant poursuivre chaque racine à travers toutes les formes qu’elle peut prendre en zend et dans les autres idiomes: Quelques forqies celtiques entreront aussi dans le cercle de nos comparaisons.
Il n’y a en sanscrit, comme on l’a déjà fait remarquer (S to5), aucune racine en a; au contraire, les racines en à sont assez nombreuses, et il faut y joindre encore, comme finissant en âf celles qui, d’après les grammairiens indiens, se termineraient en ê, âi et 0 (.§ 109% 2). En voici des exemples :
*TTgâ 3 « aller »1 ; vieux haut-allemand^n « je vais ?? (§ î o 9a 3) ; lette gaju (même sens); grec fin (fiiGytu),,
VT dà 3 «placer, mettre?), vi-da « faire ??; zend dcî (§39), dadahm «je créai??; vieux saxon do-m «je fais?? (S 109% 3); grec B-tj (tiOrjfxt = dddâ-mi); lithuanien dê~mi, dedu «je mets??; slave MiTM dê-ti «faire??, dê-ja-ti «faire, mettre??, dê-lo «œuvre??; irlandais deanaim «je fais ??, dan « œuvre ??187 188 189 190.
gÂâ «savoir??; grec yvw (yi>«-&); latin gna-rus, nosco, nô-vi, venant de gnosco, gnô-vi; zend snâ; slave 3Nd ma, infinitif sna-ti «connaître?? (S 88); vieux haut-allemand knâ, ir-knâ-ta «il reconnut??, bi-knâ-t, thème bi-Jmâ-ti «aveu?? (comparez le grec yvev-ai-s) ; irlandais gnia «connaissance??, gnic (mêmé sens),gno «ingénieux??.
*TT vâ «souffler??; gothique î?d191; slave siiraTH vê-ja-ti «souffler??, vê~trü «vent??.
stâ « se tenir » (§ 16 ) ; zend mp» stâ, histaiti « il se tient » ; latin stâ; vieux haut-allemand «fil (8 109% 3); grec <r1 >7; slave stüf sta-ti «se tenir»j stu-nu-n «je me tiens»; lithuanien sto, st(i, stôwju «je me tiens», stô-na-s «état», sta-tù-s «rétif».
Racines en i, î :
^ i 9 «aller»; zend i, upâiti «il approche» (préfixe upa); grec i; slave i, infinitif i-ti; latin î; lithuanien ei, eimi «je vais», infinitif ei-ti. En gothique, le prétérit irrégulier i-ddja «j allai», pluriel i-ddjêdum, parait se rapporter a la même racine, i-ddja étant pour i-da, i-ddjêdum pour i-dêdum. Mais 1 impératif composé hir-i «viens ici», duel hir-ja-ts, pluriel hir-ji-th1, appartient plutôt à la racine sanscrite yâ qu’à ^ i.
svi 1 «croître». Le latin crê, dans crê-vi, crê-tum (§20), nous représente probablement la même racine frappée du gouna (§5); on trouve, au contraire, l’allongement de la voyelle au lieu du gouna dans crî-nis « cheveu » ( « ce qui croit » )2. Le grec kÙcû (comparez Benfey, Lexique des racines grecques, II, 16Ô et suiv.) et le latin cu-mulus se rapportent à la forme contractée su, à laquelle appartient très-probablement aussi le gothique hau-hs
«haut» (suffixe ha~sanscrit ka).
1 «rire»; slave smê, infinitifsmê-ja-ti, dans lequel
le * ê répond à Yê de la forme sanscrite frappée du gouna %
sanscrite lagg «avoir honte », comme le suppose Graff, elle a pris en germanique la signification causative et a passé du sens de «faire honte» a celui de «railler» et enfin à celui de «rire».
Là où un s ou une dentale "sont venus s’ajouter aux racines germaniques, ils ont fini par faire corps avec la racine : notamment s dans lus «perdré» (gothique lima, laits, lusum)} t dans mat «mesurer» (mita, mat, mêtum) pour le sanscrit lu, mâ; et %, dans le vieux haut-allemand fluz «couler» {fiiuzu,jlôz, jluzumês) = sanscrit plu.
1 Sur hi-r, venant du thème démonstratif hi, voyez S 896.
* Comparez le grec tpi£ qui se rapporte au sanscrit drh «croître» (S io4“). Comparez aussi le sanscrit rd-man «poil» pour rô'h-man, venant de rit h «croître», et êirô-ruha «cheveu» («ce qui croit sur la tête»).
DES RACINES. S 109b, 1. 261
é • ‘ v
smê, d’où vient smây-a-ti «il rit»; irlandais smigeadh192 «le sourire», anglais suite ; f^rf% vi-smi «s’étonner»; latin mî-rus (commepitr-rus, de «purifier»), d’où vient mî-râ-ri.
prî «réjouir, aimer»; zend frî-nâ-mi (â-frî-nâr-mi «je bénis»); gothique frijô «j’aime» (§ 109% 6) faihu-fri-ks «aimant l’argent, ÇtXctpyvpos » ; slave npuizmi pri-ja-ti « avoir soin», pri-ja-telï « ami » en tant que «celui qui aime» (voyez Miklosich, Radiées, p. 67); grec ÇtX, transposé pour <pXt\ peut-être le latinpius deprius = fsm^priy-d-s «aimant, aimé».
’ïfV éî a «être couché, dormir», avec un gouna irrégulier sêîê «il est couché, il dort»; zend saitê; grec xsÏTotr, latin
quiê (quiê-vi, quiê-tum}- gothique hei-va (thème) «maison» (dans le composé héiva-frauja «maître de la maison»), hai-ms, thème hai-ma «village, hameau»; slave po-koi «repos», po-ci-ti «reposer» (Miklosich, Radiées, p, 36); lithuanien pa-kaju-s «repos».
Racines en u, û:
sgdru 1 «courir», drâv-â-mi «je cours»; grec APEMO, etyot.-fiov, SéSpopa, venant de SpeFa, etc.2.
éru 5 (venant de tcru) «entendre»; grec xXu; latin clu; gothique kliu-ma, thème hliu-man «oreille», avec affaiblissement du gouna (§ 27); vieux haut-allemand hlû-t, thème hlûr-ta «haut» (en parlant du son), Idû-ti «son»; irlandais cluas «oreille». Au causatif srâv-âyâ-mi «je fais entendre», en zend srâv-ayê-mi «je parle, je dis», appartiennent, entre autres, le
latin clâmo, venant de clâvo, le lithuanien slôwiju vante», le slave slav-i-ti «vanter».
«je loue, je
% plu « nager, couler » ; latin plufjlu (plu-it, jlur-it) ; grec txXv, -srÀ&>, de TxXéFc*) = sanscrit plàv-â-mi; ©■Xeu-<70-|«oei ; -orAu-iw, (pXvco, j3Xv'w; slave nuoifTH pluti «naviguer»; lithuanien plûd, plus-tu (deplud-tu} «je nage», prétérit plûd-au; vieux norrois jlut; vieux haut-allemandfluz «couler». En zend, où il riy a pas de / (§ k5'), cette racine s’est changée en fru, et a été reconnue d’abord sous cette forme par Spiegel, mais seulement au causa tif1, en composition avec la préposition fra193 194 195.
^^9 « purifier », pu-na-mi avec abréviation de i’û (voyez Abrégé de la Grammaire sanscrite, § 3A5a); latin pu-rus, pu-tare.
\lû 9 «fendre, couper»; grec Xv, Xv; latin so-ho, so-lû-tum — 'Ô^saû-lû; gothique lus, fra-liusa «je perds» (prétérit pluriel -lus-u-m). Au causatif (lâv-dyâ-mi) appartient vraisemblablement le lithuanien lau-ju «je cesse», prétérit Mw-jau, futur Mu-siu; le slave pSBUTH rüv-a-ti «arracher», et avec l’addition d’une sifflante po\füJMTM rus-i-ti «renverser» (Miklosich, Radices, p. 76).
«être, devenir»; zend bav-ai-ti «ilest» (§ h 1); lithuanien bû, bû-ti «être»; slave bsi bü, bü*-ti; latin fu; grec Çfv9 <pt/; gothique bau-a «je demeure» =5 Bdr-â-mi «je suis», 3epersonne bau-i-th — Bdv-a-ti3; vieux haut-allemand bi-m (ou pim)
«je suis», venant de ba-m, pour le sanscrit bav-â-mi, à peu près comme en latin malo, de mavolo, pour magis volo; bir-u-mês «nous sommes», de bivumês, comme par exemple scnr-n-mès, de scriv-u-mês = sanscrit srâv-âyâ-mas (S 20).
to9*\ 2. Racines terminées par une consonne.
Nous ne donnerons qu’un petit nombre d’exemples, en mettant ensemble les racines qui contiennent la même voyelle, et en les disposant d’après l’ordre suivant : a, i, u. Nous ne regardons pas comme radicales les voyelles ^ r et f (§ 1 ). Il est rare de rencontrer une voyelle radicale longue devant une consonne finale j et les racines où ce cas se présente pourraient bien pour la plupart n’être pas primitives.
. Les racines les plus nombreuses sont celles où la consonne finale est précédée d’un a \ -
ad 2 «manger»; gothique at (ita, at, êtum); slave tax jaâ (§ 92e); grec latin ed; lithuanien ed (êdmi = sanscrit âdmi); irlandais ithim «je mange».
an 2 « souffler »1 ; gothique us -an-an « expirer, mourir » ;. vieux haut-allemand un-s-t, thème un-s-ti « tempête »; grec âv-s~ pto?2; latin an-i-mus, an-i-ma. _
as 2 «être»; zend »» as (as'-ti «il est); borussien ers3; lithuanien es; slave kc jes; grec és; latin es; gothique is (ts~t — sanscrit dà-ù).
tient, au contraire, à la forme causative sanscrite. Le gothique vos «j'étaisïi , présent. visa «je reste», appartient à une racine sanscrite qui signifie «demeurer».
1 Cette racine et quelques autres de la a* classe insèrent, dans les temps spéciaux, un t, comme voyelle de liaison, entre la racine et les terminaisons commençant par une consonne; exemple : dn-i-mi «je souffle».
a Les verbes qui marquent le mouvement servent souvent aussi à exprimer l’action, par exemple, cor «aller» et «faire, accomplir». Aussi peut-on rapprocher, comme le fait Pott, de cette racine le grec dv-u-pi (S 109 ", h ).
3 As-mai «je suis». (Voyez mon mémoire Sur la langue des Borussiens, p. 9.)
sac i, moyen (dans les Védas il est aussi de la troisième classe et actif, avec i pour a dans la syllabe réduplicative),
« suivre»; lithuanien sek; latin sec; greç èn. Au causatif sâc-âyâ-mi je crois pouvoir rapporter le gothique sâhja «je cherche»1, la ténue primitive n ayant pas subi de substitution, comme cela est aussi arrivé pour slêpa «je dors» (§ 89)*
band 9 «lier»; zend band 10 (même sens) ; gothique band (binda, band;, bmidum)\ slave EA3 vans, infinitif vans-a-ti; grec <üsiQ\ latin fid {% ioha), ,
krand 6 «pleurer»; gothique grêt (même sens)2; irlandais grith « cri ».
Voici des exemples d’un â sanscrit devant une consonne finale :
hrâg «briller»; grec (pXsy; latin jtam-ma (venant par assimilation de jlag-ma), jlag-ro, qui vient d’un adjectif perdu jlag-rus, comme, par exemple, pu-rus 3 du sanscrit pu «purifier»; fulgeo, par transposition de flugeo; gothique bairh-tei «lumière»3; anglais bright.
râg 1 «briller, régner» (râgan «roi»); zendjji*) ras 10 (§ 58); latin rego; gothique rag-inô (verbe dénominatif) «je règne», sans substitution de consonne (S 89); reilc-s, thème l'eîka rîka) «prince»; irlandais ruigheanas «éclat».
Racines ayant ^ i, î, devant une consonne finale :
stig 5 «monter»; gothique stig (steiga, staig, stigum);
grec <fU% (^<t7i^ov); lithuanien staigiô-s «je me hâte»; slave
' •
\
' 1
1 Le même changement de sens s'observe dans le sanscrit anv-ié «chercher», qui d’après l'élymoiogie devrait signifier «suivre».
9 Grêta, gaigrôt. La suppression de la nasale a été compensée par l’allongement de la voyelle (^~d,$69,2), comme dans têka «je touche r>,jlêka «je me plains», qui répondent aux verbes latins tango, plango. '
s H, à cause du t suivant (S 91, 9); le verbe fort, aujourd’hui perdu, a dû faire au présent bmrga. .
ctl 3 d stïsa «sentier»; russe stignu et stigu «j’atteins»; irlandais staighre «pas, degré».
f|nr^dis 6, venant de dik «montrer»; zend dis io; grec Setx, avec gouna; latin die; gothique ga-tih «annoncer, publier » (ga-teiha, -taih, -taihum).
%Qîks î (moyen) «voir» me paraît une altération de aks, d’où viennent aksa9 âksi « œil» (le premier à la fin des composes) ; grec on, venant de ôx; latin oc-u-lus; le gothique sahv «voir» (saihva, sahv, sêhvum; sur le v qui a été ajouté, voyez § 86, î ) contient peut-être une préposition qui s’est incorporée à la racine (comparez le sanscrit sam-îks «voir»), de manière que la vraie racine serait ahv, qui lui-même est pour akv (S 87, 1).
1 «vivre»; borussien gîw-a-si «tu vis » = gïv~
a-si; lithuaniengywa-s «vivant» (y = «) ; gothique qviu-s, tbeme qviva (même sens); latin vîvo, de guîvo (S 86, 1); grec fttos, de y/os, pour y/Fos196. Le zend a ordinairement supprimé, dans cette racine, la voyelle ou le v; exemples : gva «vivant», nominatif gvâ, hu-gî-ti-s «ayant une bonne vie», pluriel hugîtayâ. On trouve aussi^ § pour g dans cette racine, notamment dans saya-dwëm «vivez» (moyen) et dans l’adjectif savana «vivant», ce dernier dérivé de su (venant de ate), avec gouna et ana comme suffixe (S 88); la racine est complètement conservée dans l’adjectif gfaya «donnant la vie» (probablement d’un substantif perdu gîva & vie»). Le mot «vie» nous donne la
gutturale primitive, d’accord en cela avec les formes borussiennes et lithuaniennes qui appartiennent à la même racine.
Racines contenant u} û devant une consonne finale :
gus 1 «aimer»; gothique kus «choisir» (Musa, kaus, kusum)m, irlandais gus «désir»; zend sausa «plaisir»;
latin gus-tus; grec yevu.
rud a «pleurer»; vieux haut-allemand ruz (riuzu, ràz, ruzumês); causatif râddyâmi (S 109®, 6).
W ruh, venant de rud' 1 «grandir»1; zend rw(/f(ae personne du présent moyen ) raud-a-hê); gothique lud (liuda,
lauthf ktdum); vieux celtique rhodora, nom d’une plante (dans Pline ) ; irlandais rud « bois », roid « race », ruaidlmeach « cheveu ». En latin, on peut probablement rapporter à la même racine le substantif rudis «bâton» (en tant que «branche qui a poussé», comparez le vieux haut-allemand ruota «verge», le vieux saxon ruoda} l’anglo-saxon rod)t ainsi que l’adjectif rudis (en quelque sorte «ce qui a poussé en liberté»). Peut-être aussi est-ce à l’idée de la croissance qu’est emprunté le nom de rûs, rûr-is> et le r est-il l’affaiblissement d’un ancien d (S 17 °). Au causatif sanscrit rôh-dyâ-mi se rapporte le slave rod-i~ti «engendrer», dont Yo représente toutefois la voyelle radicale pure u (S 92 e). Mais c’est de la racine primitive que vient probablement na-rodü «peuple». Le lithuanien liudinu «j’engendre» est, du moins quant à la signification, un causatif, et s’accorde, en ce qui concerne l’affaiblissement de la voyelle marquée du gouna, avec le gothique liuda «je croîs». Le mot rudû «automne», thème rud-en, appartient vraisemblablement aussi à la racine en question et signifie, comme il me semble, primitivement «celui qui nourrit» ou «augmente»197 198.
1 et 10 «orner». Comparez avec Bûê-dyâ-mi 10 l’irlandais -beosaighim «j’orne, j’embellis», en tenant compte de cette circonstance que les verbes irlandais en aighi-m se rapportent, en général, pour leur dérivation au sanscrit aya. Mais
beos pourrait aussi appartenir à la racine sanscrite Bas «briller» (forme élargie de Bâ), d’autant que l’adjectif beasach signifie «éclat». Le verbe sanscrit Bûs lui-même pourrait être considéré comme une altération de Bâs, Yû étant pris pour un affaiblissement de l’a ; nous trouvons souvent, en effet, à côté d’une racine ayant un a bref une racine semblable ayant un u bref; exemples : mad «se réjouir» et mud, haml «lier» et bund 10 ( d’après Vôpadêva ).
Comme exemple d’une racine sanscrite ayant une diphthongue à l’intérieur, je mentionnerai seulement 1 «honorer,
servir», grec <rs£ (créÉ-e-Tat = sév-a-tê'j, dont 1 s représente l« contenu dans Tjé (contracté de ai).
Remarque. — Racines des 70, 8° et 6* classes en zend.
Parmi les racines citées dans le paragraphe précédent, il n’y a pas d’exemple de la f classe en zend : il n’y a pas de verbe de cette classe qui appartienne en commun au zend et au sanscrit. Mais le zend possède un verbe de la f classe dont nous retrouvons la racine en sanscrit dans une classe différente. Burnouf (lapna, p. &71 et suiv.) rapporte cis-ti, qu’Anquetil traduit partout par «science», à la racine cil (S 109), qu’il rapproche avec raison du sanscrit cit tr apercevoir, connaître, penser». Le verbe zend correspondant fait à la 3e et à la t” personne du singulier du présent cinasti, cïnakmi (a» $ à cause de 1 a
précédent), et à la ire personne du pluriel actif et moyen cismahi, cïsmaidc199. Dans les deux dernières formes, le n qui, d’après le principe sanscrit, devrait rester devant les désinences pesantes (S 129), a été supprimé et remplacé par rallongement de la voyelle précédente, à peu près comme dans ■ les formes grecques fiéXas, <V7as, Tvÿàs, pour péXavs, etc.
Pour la 8e classe en zend, laquelle n’est pas non plus représentée dans le paragraphe précédent, nous trouvons un exemple dans la forme ainauiti* (paiti ainauiti «il censure») : non-seulement la voyelle de la racine 200 201
( in ), mais encore la syllabe caractéristique reçoit le gouna, comme cela arrive en sanscrit pour le verbe kar-o-ti «il fait», qui frappe du gouna ta caractéristique en même temps qu’il emploie la forme forte, ou, suivant la théorie des grammairiens indiens, la forme marquée du gouna (§ 26, 1). Dans le dialecte védique, nous avons in-o-ti qui répond à la forme zende, mais sans gouna de la voyelle radicale.
Au sujet de la 6e classe, il faut encore observer qu’elle est représentée en zend dans ses deux variétés, à savoir avec ou sans nasale ; exemples : përëê-a-kt frtu demandes»’, vind-ë-nti trils trouvent», pour le sanscrit prc-â-si, vind-â-nti (S 109 1 ).
*
S 110, Les suffixes sont-ils significatifs par eux-mêmes?
Des racines monosyllabiques se forment les noms, tant substantifs qu’adjectifs, par l’adjonction de syllabes que nous nous garderons bien de déclarer dénuées de 'gnification, avant de les avoir examinées. Nous ne supposons pas, en effet, que les suffixes aient une origine mystérieuse que la raison humaine doive renoncer à pénétrer. 11 paraît plus simple de croire que ces syllabes sont «ou ont commencé par être significatives, et que l’organisme du langage n’a uni entre eux que des éléments de même nature, c’est-à-dire des éléments ayant un sens par eux-mêmes. Pourquoi la langue n’exprimerait-elle pas les notions accessoires par des mots accessoires, ajoutés à la racine? Toute idée prend un corps dans le langage : les noms sont faits pour désigner les personnes ou les choses auxquelles convient l’idée abstraite que la racine indique; rien n’est donc plus naturel que de s’attendre à trouver, dans les syllabes formatives, des pronoms servant à désigner ceux qui possèdent la qualité, font l’action ou se trouvent dans la situation marquée abstraitement par la racine. 11 y a, en effet, comme nous le 199 montrerons dans le chapitre sur la formation des mots199, une identité parfaite entre les éléments formatifs les plus importants et certains thèmes pronominaux qui se déclinent encore à l'état isolé. Mais s’il est devenu impossible d’expliquer à l’aide des mots restés indépendants plusieurs éléments formatifs, cela n’a rien qui doive nous étonner, car ces adjonctions datent de l’époque la plus, reculée de la langue, et celle-ci a perdu le souvenir de la provenance des mots qu’elle avait employés pour cet usage. C’est pour la même raison que les modifications, du ‘suffixe soudé à la racine n’ont pas toujours marché du même pas que celles du mot resté à l’état indépendant; tantôt c’est l’un, tantôt c’est l’autre qui a éprouvé de plus fortes altérations. Il y a toutefois des cas où l’on peut admirer la merveilleuse fidélité avec laquelle les syllabes grammaticales ajoutées aux racines se sont maintenues invariables pendant des milliers d’années; on la peut constater par le parfait accord qui existe entre les divers idiomes de la famille indo-européenne, quoiqu’ils se soient perdus de vue depuis un temps immémorial et que chacun ait été abandonné depuis à ses propres destinées.
§ ni. Des mots-racines.
Il y a aussi des mots qui sont purement et simplement des mots-racines, c’est-à-dire que le thème présente la racine nue, saps suffixe dérivatif ni personnel; dans la déclinaison, les syllabes représentant les rapports casuels viennent alors s’ajouter à la racine. Excepté à la fin des composés, les mots de cette sorte sont rares en sanscrit : ce sont tous des abstraits féminins, comme aft Bî «peur», «combat», mud «joie». En
grec et en latin la racine pure est également la forme de mot la plus rare; cependant, quand elle se rencontre, elle n’appar-
1 Voyez aussi mon mémoire De l'influence des pronoms sur la formation des mois (Berlin, t83a). .
tient pas exclusivement à un substantif abstrait; exemples ; <ploy (<p\6tt-$), Ô7T (671-5), vt(p (nW), leg (lec-s), pac (pac-s), duc (duc-s), pel-lic (pel-lec-s). En germanique, même en gothique, il n y a plus de vrais mots-racines, quoiqu’on puisse croire, à cause de la mutilation des thèmes au singulier, qu’il y en a beaucoup : car ce sont précisément les dialectes les plus jeunes qui, à cause de la dégradation toujours croissante des thèmes, ont l’ait d’employer comme noms le plus de racines nues (comparez S 116). '
GENRE et nombre.
S 112. Du thème.
Les grammairiens indiens posent, pour chaque mot décli-nuble, une forme fondamentale, appelée aussi thème, où le mot se trouve dépouillé de toute désinence casuelle : c’est également cette forme fondamentale que donnent les dictionnaires sanscrits. Nous suivons cet exemple, et partout où nous citons des noms sanscrits on zends, nous les présentons sous leur forme fondamentale, à moins que nous n’avertissions expressément du contraire ou q.ue nous ne fassions suivre la terminaison, en la séparant du thème par un trait (-). Les grammairiens indiens ne sont d’ailleurs pas arrivés à la connaissance de la forme fondamentale par la voie d’un examen scientifique, par une sorte d anatomie ou de chimie du langage : ils y furent amenés d’une façon empirique par l’usage même de leur idiome. En effet, la forme fondamentale est exigée au commencement des composés1 : or, l’art de former des composés n’est pas moins nécessaire en sanscrit que l’art de conjuguer ou de décliner. La forme fondamentale pouvant exprimer, au commencement d’un composé, chacune des relations marquées par les cas, ou, en d’autres
1 Sauf, bien entendu, les changements euphoniques que peut amener la reu-contre des lettres initiales où finales avec les lettres d’un autre mot.
ablatif, etc. il est permis de la regarder en quelque sorte comme un cas génêral} plus usité que n’importe quel autre, à cause de l’emploi fréquent des composés.
termes, pouvant tenir lieu d’un accusatif, d’un génitif, d’un
Toutefois, la langue sanscrite ne reste pas toujours fidèle au principe quelle suit d’ordinaire dans la composition des mots ; par une contradiction bizarre, et comme faite exprès pour embarrasser les grammairiens, les pronoms de la ire et de la ae personne, quand ils forment le premier membre d’un composé, sont uns à l’ablatif pluriel, et ceux de la 3e personne au nomi-natif7accusatif singulier neutre. Les grammairiens indiens ont donné dans le piège que la langue leur tendait dans cette circonstance : ils ont pris, par exemple, les formes asmdt ou asmâd «par nous», yusmdt ou yusmdd «par vous» comme thème et comme point de départ de la déclinaison, quoique en réalité, dans ces deux formes pronominales, il n’y ait que a et yu qui appartiennent (encore n’est-ce qu’au pluriel) au thème. Il va sans dire que, malgré cette erreur, les grammairiens indiens savent décliner les pronoms et qu’ils ne sont pas en peine de règles à ce sujet.
Le pronom interrogatif, quand il se trouve employé en composition, paraît sous la forme neutre f^p-r kim; mais ceux mêmes qui regardent cette forme comme étant le thème ne peuvent méconnaître que, dans sa déclinaison, le pronom en question suit l’analogie des thèmes en a. Pânini se tire de cette difficulté par la règle laconique suivante (VÏI, n, to3) :
^iî mmaK kaKy c’est-à-dire à kim on substitue ka1. Si l’on voulait
appliquer cette méthode singulière au latin et prendre le neutre quul pour thème, il faudrait, pour expliquer, par exemple, le datif cm, faire une règle de ce genre, qui serait la traduction
1 Kîmm ( devenu ici himuh, en vertu des lois phoniques ) est lin génitif qui n'existe pas dans la langue, et qui est forgé d’après feint, considéré comme thème.
de celle de Pânini : quidis eus ou quidi eus, c’est-à-dire qmd substitue le radical eu, qui fait au datif cm, comme fructus fait Jructui. Dans un autre endroit (VI, ni, 90), Pânini forme de ■idam «ceci» (considéré également comme thème) et de kim « quoi ? » un composé copulatif, et par les mots idmïkimorîskî, le grammairien enseigne que les prétendus thèmes en question substituent à eux-mêmes les formes î et kî.
S 11.3. Des genres.
Le sanscrit et celles d’entre les langues de même famille qui se sont maintenues à cet égard sur la même ligne distinguent encore, outre les deux sexes naturels, un neutre que les grammairiens indiens appellent klîva, c’est-à-dire eunuque. Ce troisième genre paraît appartenir en propre à la famille indo-européenne, c’est-à-dire aux langues les plus parfaites. Il est destiné à exprimer la nature inanimée. Mais, en réalité, la langue ne se conforme pas toujours à ces distinctions : suivant des exceptions qui lui sont propres, elle anime ce qui est inanimé et retire la personnalité à ce qui est vivant.
Le féminin affecte en sanscrit, dans le thème comme dans les désinences casuelles, des formes plus pleines, et toutes les fois que le féminin se distingue des autres genres, il a des voyelles longues et sonores. Le neutre, au contraire, recherche la plus grande brièveté; il n’a pas, pour se distinguer du masculin, des thèmes d’une forme particulière : il en diffère seulement par la déclinaison aux cas les plus marquants, au nominatif, à l’accusatif, qui est l’antithèse complète du nominatif, ainsi qu’au vocatif, quand celui-ci a la même forme que le nominatif.
§ 114. Des nombres.
Le nombre n’est pas exprimé en sanscrit et dans les autres
|8
langues indo-européennes par des afîixes spéciaux, indiquant le singulier, le duel ou le pluriel, mais par une modification de la llexion casuelle, de sorte que le même suffixe qui indique le cas désigne en même temps le nombre; ainsi Byam, Byâm et 8yas sont des syllabes de même famille qui servent à marquer, entre autres rapports, le datif : la première de ces flexions est employée au singulier (dans la déclinaison du pronom de la 9e personne seulement), la deuxième au duel, la troisième au

Le duel, comme le neutre, finit par se perdre à la longue, a mesure que la vivacité de la conception s’émousse, ou bien l’emploi en devient de plus en plus rare : il est remplacé par le pluriel qui s’applique, d’une façon générale, à tout ce qui est multiple. Le duel s’emploie de la façon la plus complète en sanscrit, pour le nom comme pour le verbe, et on le rencontre partout où l’idée l’exige. Dans le zend, qui sur tant d’autres points se rapproche extrêmement du sanscrit, on trouve rarement le duel dans le verbet beaucoup plus souvent dans le nom; le pâli n’en a conservé que ce qu’en a gardé le latin, c’est-à-dire deux formes, dans les mots qui veulent dire deux et tous les deux; en prâcrit, il manque tout à fait. Des langues germaniques, il n’y a que la plus ancienne, le gothique, qui possède le duel, et encore dans le verbe seulement ‘. Parmi les langues sémitiques (pour les mentionner ici en passant), l’hébreu a, au contraire, gardé le duel dans le nom et l’a perdu dans le verbe ; l’arabe .qui, sous beaucoup d’autres rapports encore, est plus complet què l’hébreu, a le duel dans la déclinaison et dans la conjugaison; le syriaque, enfin, n’a gardé du duel, même dans le nom, que des traces à peine sensibles2.
1 Sur le duel inorganique des pronoms des deux premières personnes, voyez S 169.
- Sur i'essence, la raison d7être et les diverses nuances du duel, et sur sa prè-
S 115. Des cas.
Les désinences casuelles expriment les rapports réciproques des noms entre eux : on peut comparer ces rapports à ceux des personnes entre elles, caries noms sont les personnes du monde de la parole. Dans le principe, les cas n exprimèrent que des relations dans l'espace ; mais on les fit servir ensuite à marquer aussi les relations de temps et de cause. Les désinences casuelles furent originairement des pronoms, du moins le plus grand nombre, comme nous le montrerons dans la suite. Et ou aurait-on pu mieux prendre les exposants de ces rapports que parmi les mots qui, en même temps qu’ils marquent1 la personne, expriment une idée secondaire de proximité ou d’éloignement, de présence ou d’absence ? De même que dans le verbe les désinences personnelles, c’est-à-dire les suffixes pronominaux, sont remplacées ou, pour ainsi dire, commentées par des pronoms isolés dont on fait précéder le verbe, lorsque le sens de ces terminaisons a cessé avec le temps d’être perçu par l’esprit et que la trace de leur origine s’est effacée, de même on remplace, on soutient ou l’on explique les désinences casuelles, quand elles ne présentent plus d’idée nette à l’intelligence, d’une part, par des prépositions pour marquer la relation dans 1 espace, et, de 1 autre, par l’article pour marquer la relation personnelle.
THÈMES FINISSANT PAR UNE VOYELLE.
, S 116. De la lettre finale du thème. — Thèmes en a.
■ Avant de nous occuper de la formation des cas, il parait a propos d’examiner les différentes lettres qui peuvent se trouver
sence dans les diverses familles de langues, nous possédons une précieuse dissertation de G, de Humboldt (Mémoires de Y Académie de Berlin, 1807 ).
à la fin des thèmes : c’est à ces lettres que viennent s unir les désinences casuelles, et il convient de montrer les rapports qui existent à cet égard entre les langues indo-européennes202.
Les trois voyelles primitives (a, i, u) peuvent se trouver en sanscrit à la fin d’un thème nominal, soit brèves, soit longues {a, i, u; â, î, û). Va bref est toujours masculin ou neutre; il n’est jamais féminin. En zend et en lithuanien, il est représenté également par un a, il en est de meme dans les idiomes germaniques ; mais Va ne s’est conserve que rarement dans cetté dernière famille de langues, même en gothique2, et il a elé remplacé dans les dialectes plus jeunes par un u ou un e. En grec, 1*« primitif est représenté par l’o de la a6 déclinaison (par exemple, dans Aéyo-s, A&îpo-v). Nous trouvons également cet o en latin à une époque plus ancienne : à l’époque classique, l’o latin se change en u, quoiqu’il ne disparaisse pas de tous
les cas3.
§ 117. Thèmes en i et en w.
A Vi bref, qu’on trouve pour les trois genres, correspond la même voyelle dans les autres langues. Dans les idiomes germaniques, il faut chercher cet i dans la Ae déclinaison forte de Grimm ; mais il n’y a pas été moins maltraité par le temps que Va de la ire déclinaison. En latin, i alterne avec e, comme dans
1 Si la désinence venait simplement se ranger-après le thème, sans le modifier en rien, il n’y aurait qu’une seule et même déclinaison pour tous les substantifs (sauf, bien entendu, ia différence des. genres), et il ne serait pas nécessaire d’examiner les lettres qui peuvent se trouver à la fin des thèmes. Mais entre ia dernière lettre du thème et la première lettre de la désinence, il se produit des combinaisons diverses,, suivant que la lettre finale est une voyelle ou une consonne, suivant que les lettres qui se trouvent mises en contact s’attirent ou s’excluent, etc. On comprend donc qu’avant d’étudier la formation des cas il faille examiner les diverses rencontres qui pourront se produire et qui seront la cause de la multiplicité des déclinaisons. Tr.
2 Voyez la ir® déclinaison forte de Grimm. v
3 II sera traité à part de la formation des cas en ancien slave.
facile pour facili, mare pour mari, en sanscrit 4lfV v$ri «eau». En grec, l’i s’affaiblit ordinairement en e devant les voyelles.
L’a bref se trouve comme l’t aux trois genres en sanscrit; de même y en grec et u en gothique. Dans cette dernière langue, l’a se distingue de l’a et de Yi, en ce qu’il s’est conservé aussi bien devant le - « du nominatif qu’à l’accusatif dépourvu de flexion. En latin, nous avons Yu de la h6 déclinaison, et en lithuanien également l’a de la h* déclinaison des substantifs*, qui ne contient que des masculins; exemple : sünù-s « fils » = sanscrit sûné-s. Parmi les thèmes adjectifs en u, nous avons, ? par exemple, le lithuanien saldu «doux», nominatif masculin saldù-s, neutre saldii, qui correspond au sanscrit svâdii-s, neutre svâdü, en grec tî-s, Nous parlerons plus tard du féminin lithuanien saldï répondant au sanscrit svâdvi.
§ 118. Thèmes eu â.
Les voyelles longues (d, î, u) appartiennent principalement en sanscrit au féminin (S n3); on ne les trouve jamais pour le neutre, très-rarement pour le masculin. En zend, l’a long final s’est .régulièrement abrégé dans les mots polysyllabiques; il en est de même en gothique, où Yâ des thèmes sanscrits féminins s’est changé en ô (§ 69 ); cet d, au nominatif et à l’accusatif ( sans flexion) du singulier s est abrégé en a, à l’exception des deux formes monosyllabiques sô «la, celle-ci» — sanscrit sâ,
zend hâ; hvâ «laquelle??? = sanscrit et zend kâ. Le latin a également abrégé l’ancien â du féminin au nominatif et au vocatif, qui sont sans flexion; de même le lithuanien (S 92a), et souvent aussi le grec, surtout après les sifflantes (cr et les consonnes doubles renfermant une sifflante), quoiqu’on trouve aussi après celles-ci y tenant la place d’un â. Au contraire, les muettes, 202 qui sont les consonnes douées de la plus grande force, ont, en général, protégé la longue primitive, qui est v dans la langue ordinaire, « dans le dialecte dorien. Nous ne pouvons entrer ici dans le détail des lois qui ont présidé dans les différents cas au choix entre à, S ou tj en remplacement de \ a sanscrit. En ce qui concerne les masculins latins en a et grecs en â-s, w-$, je renvoie aux paragraphes qui traitent de la formation des mots (SS 910, 91/1). Il a déjà été question de Yê latin de la 5e déclinaison, laquelle est originairement identique avec la première, ainsi que des formes analogues en zend et en lithuanien (S 92k).
§ 119. Thèmes féminins en l — Formes correspondantes en grec
et en latin.
L’i long en sanscrit sert ordinairement de complément caractéristique pour la formation des thèmes féminins : nous avons, par exemple, de mahât9 le thème féminin mahatî a magna ». Il en est de même en zend. En grec et en latin, cet 1 du féminin a cessé d’être déclinable : il a disparu ou a été allongé dun complément inorganique chargé de porter les désinences casuelles. Ce complément est en grec a ou S, en latin c. Le grec d<5eîa correspond au sanscrit svâdv-t, de svâdu « dulcis », et -tpia, -rptS, dans bpyria'lpta, Ajxr'JpA, Xïî«t7p/£-o?, répondent au tn sanscrit qui se trouve dans ganitrï «celle qui enfante». Pour ce dernier mot, le latin a genitn-c~s9 genitrï-c-is.
D’autre part, dans le grec yevheipa et dans les formations analogues, l’ancien i du féminin recule d’une syllabe. Nous avons, d’après le même principe, les adjectifs féminins fxéXaiva* rdXatva, tépeiva, et les substantifs dérivés comme t&touwï, Aa-xaiva. Dans B-epanatvct, Xéatva, le thème du primitif a perdu un t, comme au nominatif masculin. Pour 3-datva, hfaouvot, il faut admettre ou bien que le primitif terminé en v ou vt s’est perdu, ou bien, ce que je crois plutôt, que ce sont des forma-lions d’une autre sorte, correspondant aux féminins sanscrits comme mdrâni k la femme d’Indra » (§ 8 3 7).
Dans les formes en sacra, venant de thèmes masculins et neutres en sut (pour Fsut, sanscrit vant), j’explique le second a-comme venant d’un ancien/ que le a précédent s’est assimilé; le / lui-même provient du caractère féminin t. Ainsi SoXà-scracL est pour SoXô-eajtx, qui lui-même est pour SoXâ-erjoi, de même que plus haut (§ 109% 2) nous avons eu xpefatrav, venant de xpehjojv, XfWojtM», venant de XiTjofiou, Le u du thème primitif en sut a donc été supprimé, comme dans les féminins sanscrits correspondants, tels que dana-vatî, de d'dna-vant « riche », aux cas faibles (§ 129) ddna-vat. Mais il y a aussi des formations en ero-a, où, selon moi, le second <7 provient également d’un/ assimilé, mais avec cette différence que la syllabe j& représente le suffixe sanscrit ^fT yâ (féminin de ^ y a); par exemple : fxé-Xta-arct « abeille », pour fxéXtT-ja, du thème ^X*t, comme nous avons en sanscrit le féminin div-yâ «céleste», venant de div «ciel». Baa/X<(r-aa et (pvXdxta-oa sont sortis très-vraisemblablement de /3a<TtXt$, ÇvXaxiS, et, par conséquent, sont pour j6ot<rt-XtS-ja, ÇvXdxtS-ja. De même que plus haut, dans Xv«r-Tp/-^, la syllabe tS de (puXax~{$ représente le caractère féminin sanscrit %îl, lequels’abrége toujours devant Ta, qui lui est adjoint, et presque toujours devant <£203 204.
L’a grec, dans les thèmes participiaux en ut, représente à lui seul le caractère féminin; mais je le regarde comme étant pour ta : la vraie expression du féminin a donc été supprimée,
et le Complément inorganique a est seul resté, après que Vt, par son influence, eut changé le t précédent en a. Exemples : {pépQvcr-a, laflâa-a, venant de (pepovT-tat, la-lavr-ia, en regard des formes féminines sanscrites Mrant-î et celle qui porte», lislmit-4 «celle qui se tient». Dans SspaunovT-tèl, forme unique en son genre, le vrai caractère féminin s’est conservé avec le complément habituel S et avec abréviation de la longue primitive.
§ 190, i. Thèmes féminins gothiques en em.
Le gothique a conservé, au féminin du participe présent et du comparatif, la longue du caractère féminin sanscrit : mais à et (= L S 70) il a joint, comme le grec et le latin, un complément inorganique, à savoir n, lequel est supprimé au nominatif singulier (S i4a). Nous avons donc bairand-ein, juhis-ein, au nominatif hairand-ci, juhis-ei, en regard des féminins sanscrits Mrant-î «celle qui porte», ydvîyas-î «celle qui est plus jeune». À côté des thèmes substantifs sanscrits en î, comme dêvï «déesse» (de dêvd «dieu»), kumârî «jeune fille» (de ku-mârâ «jeune garçon»), on peut placer en gothique les féminins aithein «mère», gaiiein «:chèvre», qui toutefois n’ont pas de masculin, car si aithein peut être considéré comme étant de la même famille que attan «père» (nominatif atta), il est d’ailleurs impossible d’y voir un dérivé régulier de ce dernier mol. 205
pour nadl-âs. A cette sorte de féminins gothiques n appartiennent toutefois que trois thèmes, à savoir : frijênd-jn (nominatif/n-jâud-i) k amie », du thème masculin frijônâ (nommatif/rj/oW-s) k l’ami a, considéré comme «celui qui aime», thiu-jo «servante», de tlmia(nominatif thiu-s) «valet» ', et rnau-jo" «fille», de magu (nominatif magu-s) «garçon». Dans tous les autres mots de la a* déclinaison féminine forte, la syllabe jô se rapporte à un ^7 yâ sanscrit. Au nominatif-vocatif-accusatif dépourvu de flexion, le gothique supprime la voyelle finale, dans le cas où le j est précédé d’une syllabe longue (y compris la longue par position), ou de plus d’une syllabe. Ainsi des thèmes mentionnés plus haut fnjôndr-jô, thiu-jê, maurjâ, viennent les formes frijônd-i, thiv-i, mav-i, qui, par suite de cette mutilation, se sont de nouveau rapprochées des types sanscrits comme
kumârï.
Sial. Thèmes féminins lithuaniens en t.
En lithuanien, le caractère féminin sanscrit % s est conservé, sans prendre de complément, au nominatif-vocatif de tous les participes actifs : il s’est seulement abrégé. Comparez les féminins degant-i «brûlante», degus-i «ayant brûlé» et degsent-% «devant brûler» avec les formes sanscrites correspondantes dahant-i, dêhüs-t, d'ateijdnt-î. Mais à tous les autres cas, ces participes lithuaniens ont reçu un complément analogue à celui des thèmes gothiques mentionnés plus haut, fnjmdjô, tkujà, maujô, et a celui des féminins grecs comme bpxv'olpta, ^dXtpta. : ils ont
. En ce qui concerne la suppression de l’a du thème primitif masculm, comparez les thèmes humM, cités plus haut, ainsi que la loi qui reut que, en généra , les voyelles finales des thèmes sanscrits tombent devant les voyelles et la semi-voyelle U ». 11 n’v a d’exception que pour « et les diphthongucs & («) et du.
Ponrimuru-fVi, à peu près comme le comparatif latin major, pour tmgwr. l.e sanscrit croître'» est la racine commune delà forme gothique et de la forme
Mi lift.
par là changé de déclinaison. Ainsi les génitifs deganmô-s\ degu-siô-s, degsenciô-s se rencontrent avec les génitifs gothiques comme frijândjâ-s et les génitifs grecs comme àp^tf pfa-s, ou, sans aller si loin, avec le génitif wyniciô-s, qui vient de la forme, mentionnée plus haut (§ 92 k), wynièia (nominatif) «vignoble.. Au sujet des cas ou, dans les participes que nous avons cités, on a a au heu de ia, par exemple, au datif degancei, etc. (pour deganciai) , il faut se reporter à la 3e déclinaison de Mielcke, dont Ve est dû à l'influence d’un * qui est tombé; exemples : giesme «chant», datifgiesmci, tandis que dans wyniéiai, deganciai, dégustai la palatale ou la sifflante ont arrêté cette influence (comparez § 9â k)- Ob pourrait conclure de là que le complément inorganique reçu par les participes féminins aux cas obliques a appartenu également au nominatif dans le principe, et que, par exemple, le nominatif lithuanien deganti, qui dans cette forme ressemble extrêmement au sanscrit ddhantî, a été d’abord degancia? d apres 1 analogie de wynicta; on appuierait cette opinion de la circonstance suivante, à savoir que tous les thèmes adjectifs qui sont terminés au masculin en ia (nominatif is pour tas, § i3à) ont au nominatif féminin i ou e (venant de m); exemple : didi ou dide «magna», en regard du thème masculin didta, nominatif didts. Mais une objection à cette explication est que, dans tous les participes actifs, le nominatif-vocatif masculin est resté, comme 011 le montrera ci-après, plus fidèle au type primitif que tous les autres cas, et n’a rien ajouté à la forme première du theme; oh peut objecter, en outre, que les adjectifs masculins et neutres en u prennent également un «au nominatif féminin; par exemple : saldl «douce», féminin de saldü-s (masculin) et solda (neutre); enfin, qu’il y a encore, comme on le verra plus tard, bien d’autres classes de mots en lithua- 206
nien, dont le nominatif singulier n’a rien de commun avec le thème des cas obliques, lequel a reçu un accroissement inorganique.
S i9â. Thèmes sanscrits en u. — Thèmes finissant par une diphthongue,— Le thème dyo rrciel*.
Vu long est assez rare en sanscrit à la fin des thèmes, el il appartient ordinairement au féminin. Les mots' les plus usités sont vadu « femme », bu « terre», svasrû «belle-mère » (socrus), Ihrû «sourcil». A ce dernier répond le grec ô<pptfe, qui a également un v long; mais, en grec, la déclinaison de l’y long ne s’écarte pas de celle de Yv bref* tandis que, dans la déclinaison sanscrite, Yû long se distingue de Vu bref féminin de la même manière que Yî long de fi bref.
Il n’v a qu’un petit nombre de thèmes monosyllabiques qui se terminent en sanscrit par une diphthongue; aucun ne finit par TJ ê9 un seul par ^ âi9 à savoir ^rai (masculin) «richesse», qui forme de râ les cas dont la désinence commence par une consonne : c’est à ce thème râ que se rapporte le latin rê (§ 5). Les thèmes en ô sont rares également. Les plus usités sont dyâ « ciel » et gô.
Le premier est féminin; il est sorti du mot-racine div, qui est formé lui-même de div «briller»; le v est devenu voyelle, après quoi l’i a dû se changer en semi-voyelle. Les cas forts (§ 129) des thèmes en ô se forment d’un thème élargi en on a donc au nominatif singulier dyau-s, pluriel dyav-as. A l’accusatif, la forme âv-am, qu’on devrait attendre, s’est contractée en â~m; exemple : gâm, pour gav-am206. A dyâu-s répond le grec Zetfe, mais avec amincissement de la première partie de la diphthongue. Le Z répond au ^y sjinscrjt et le $ est sup-
1 L’accusatif de dyâ n’est pas dans l’usage ordinaire, mais il $e triouve dans îc dialecte védique. I
primé (S 19), tandis que la forme éolique Abus a conservé la muette et supprimé la semi-voyelle. Avec Zsvs, venant de /sus, s’accorde, en ce qui concerne la perte de la moyenne initiale, le latin Jov-is, Jov-i, etc. cette dernière forme représente le datif sanscrit dyâv-ê, qui est formé comme gâv-ê. Le nominatif vieilli Jovi~s a éprouvé un élargissement du thème analogue à celui de nâvi-s, comparé au sanscrit nâu-s et au grec vav-s. Dans Jupiter9 proprement «père» ou «maître du ciel»207, Jû représente le thème sanscrit dyô, venant de dyau, la suppression de la première partie de la diphthongue ayant été compensée par rallongement de la deuxième partie, comme, par exemple, dans conclûdo, pour condaudo (§ 7). Pour retourner au grec, les cas obliques de Zeés viennent tous du thème sanscrit div « ciel » : At6s, de AtF6$ = sanscrit div-ds; AtFi (S 19), Ad — locatif div-i. 11 faut encore mentionner une désignation latine du ciel qui ne s’est conservée qu à l’ablatif, sub dîvo 9 et qui suppose un nominatif dîvu-m ou divu-s. Elle se rapporte au thème sanscrit dêvâ (venant de daivà) «brillant, dieu», et a remplacé le gouna sanscrit par Rallongement de la voyelle radicale.
S 123. Le thème go « vache» et « terre».
Le second des thèmes précités en ô signifie ordinairement comme masculin «taureau» et comme féminin «vache». En zend, nous le trouvons sous la forme 1qui devient gav devant les terminaisons commençant par une voyelle; en grec, nous avons /3ov, qui, devant les voyelles, a dû être primitivement j60F, et, en latin, nous trouvons, en effet, bov. Le nominatif bâ-s compense la suppression de la deuxième partie 208 209
de la diphthongue par rallongement de la première (comparez §7). En ce qui concerne le changement de la moyenne gutturale en labiale, le grec {3ous et le latin bô~s sont avec le sanscrit gâu-sdans le même rapport que, par exemple, fifënpt avec le sanscritgâgâmi (ou aussi, dans les Védas, gîgâmi). Mais il est à remarquer que l’ancienne gutturale qui se trouvait dans le nom de la vache n’a pas entièrement disparu du grec; je crois du moins pouvoir affirmer que la "première syllabe de ydXa désigne «la vache », de sorte que le mot entier marque proprement le «lait de la vache». La dernière partie du composé s’accorde littéralement avec le thème latin lact : c’est, sans doute, à cause de la forme très-mutilée du nominatif qu’on n’a pas reconnu en yctXaxr un mot composé. Dans yXax.TO<pdyo$, et autres mots du même genre, le nom de la vache n’est représenté que par le y L 207
Gomme féminin, le sanscrit gô a, entre autres significations, celle de «terre», qui rappelle le grec y ata; mais y ata ne doit pas être rapproché directement du sanscrit gô : il suppose un adjectif dérivé gâvya, féminin gâvyâ, qui existe en sanscrit avec le sens de «bovinus», mais qui a pu signifier aussi «terre-nus». Tata doit donc être considéré comme étant pour yaTta ou yaFja. Au sanscrit gâvya, et particulièrement au neutre gàvyam, se rapportent aussi le thème gothique gauja, nominatif-accusatif gavi «pays, contrée» (la moyenne a été conservée, § 90), et l’allemand moderne gau, que Pôderlein a déjà comparé à y axa. Pour le nom de la vache, les langues germaniques ont observé la loi de substitution qui veut qu’une moyenne soit remplacée par la ténue, de sorte que kuh s’est distingué de gau, non pas seulement par le genre, mais encore par la forme. Quant au mot kuh, je le rapproche également du dérivé sanscrit gâvya, avec suppression de la voyelle finale et vocalisation de la seini voyelle \y- Le thème, qui est en même temps le nominatif dénué de désinence, est dans Notker chuoe (venant de chuot) : Yuo représente un ô gothique, et celui-ci un â sanscrit (§ 60, j), de manière que dans le sanscrit gâvya, ou plutôt dans le féminin gâvyâ, le v a été supprimé et la voyelle précédente allongée par compensation. Un autre document vieux haut-allemand a chuai (ua pour le gothique ô = «) à l’accusatif pluriel, lequel est d’ailleurs identique au nominatif. Les formes chua, chuo au nominatif singulier tiennent à ce que ce cas, ainsi que l’accusatif, a déjà perdu en gothique la voyelle finale des thèmes en L
En ce qui concerne l’origine du thème sanscrit gô, nous voyons dans le livre des Unâdi qu’on le fait dériver de la racine gam «aller», laquelle aurait de la sorte remplacé la syllabe am par ô; il faudrait donc admettre que le m s’est vocalisé en u, comme nous voyons souvent en grec v devenir v (rvnlovo-t, tMovctol), et comme, en gothique, la syllabe jau, par exemple, dans êtjau «que je mangeasse», répond à la syllabe yâm dans adyam (§ 67 5). Je préfère toutefois faire venir gô de la racine *ngâ, qui veut dire également «aller». Dans le dialecte védique il y a d’ailleurs un autre nom de la terre, gmâ, qui vient de gam. En zend, nous trouvons un mot sëm «terre», qu’on ne rencontre qu’aux cas obliques, et qu’on pourrait également expliquer par la racine gam *, à moins que le m ne provienne d’un v qui se soit endurci, de sorte que le datif sëmê et le locatif sëmi correspondraient au sanscrit gâv-ê, gâvi; dans cette dernière hypothèse, les cas obliques, que nous venons de citer, seraient dans une relation étroite avec le nominatif sâo «terra», et l’accusatif sahm «terrain» = sanscrit gâus, gâm.
Quoique le nom de la terre et celui du bœuf soient empruntés à l’idée de mouvement, je ne les regarde pas comme étant d’origine identique. Je crois que dans gô «terre», il y a une idée de passivité, c’est-à-dire qu’il faut la considérer comme «celle qui est foulée». La route a reçu en sanscrit un nom analogue, vârt-man (de vart, vrt «aller »). C’est aussi par une racine sanscrite exprimant le mouvement que peut s’expliquer le gothique airtha (allemand moderne erde «terre»), qui vient de ar, r «aller»2 : air-tha viendrait donc de ir-tka (§82), forme affaiblie pour ar-tka, participe passif. La loi de substitution aurait été régulièrement suivie dans ce mot, au lieu qu’à l’ordinaire la ténue de ce participe devient un d en gothique3.
' S 126. Lè thème nâu «vaisseau».
Je ne connais en sanscrit que deux mots terminés en âu :
1 J «pourg, S 58.
3 Nous avons rapproché ailleurs de celte racine le gothique air-us «messager».
3 Voyez 891,3. Comme or, r signifie aussi «élever» (voyez le Lexique de Peters-bourg), le latin al-tus peut être considéré comme un participe passif de cette même racine, avec l pour r (S ao).
*ft nâu (féminin) «vaisseau» et glâu (masculin) «lune». Quoique le premier de ces mots se retrouve dans un grand nombre de langues, il n’est pas facile de lui assigner une étymologie certaine. Je crois que nâu est une forme mutilée pour mâu, qui lui-même vient probablement de ^ snu «couler»; nous avons, en effet, encore une autre désignation du vaisseau, plav-ars, qui vient de la racine plu, à laquelle se rapportent le latin jluo et l’allemand Jliessen. En tout cas, nâu a perdu une sifflante initiale, de même que le verbe grec vév (de véFu) «nager», futur vsvcropaii, qui répond évidemment au sanscrit ^ snu, a perdu le s du commencement. Le verbe sanscrit appartient à la 2e classe, et reçoit le vriddki au lieu du gouna, toutes les fois que les désinences légères (§ 48o et suiv.) viennent se joindre immédiatement à la racine; nous sommes donc préparés d’avance, en quelque sorte, par la forme snau-nu «je coule», à trouver dans nâu «vaisseau» la diphthongue résultant du vriddbi. On a déjà fait remarquer (§4) que l’a de la diphthongue de vavs est long par lui-même. Le latin nav-l-s, pour nâu-i-$, témoigne également de la longueur primitive de la. Le composé navfragus et ses dérivés ne prennent pas le complément inorganique i : de même nauta, qu’on n’a pas besoin de prendre pour la contraction de nâvita.
En gothique, nous rencontrons également une racine snu, qui est unique en son genre1, et qui répond exactement a snu; seulement elle a pris le sens général de «aller, partir, prévenir»; l’adverbe sniu-mundô «à la bâte» en dérive. Mais en se renfermant dans la langue gothique, on pourrait tout aussi bien prendre snav pour la racine, et cette forme correspondrait exactement à la forme que snu prend en sanscrit, quand il a le gouna et qu’il se trouve devant une voyelle, par exemple dans
le nom abstrait snav-a-s, qui marque «l’action de couler, de dégoutter». Du gothique snav dérive, en effet, le prétérit pluriel snêvum (Epître aux Philippiens, ni, 16 ; ga-snêv-um), qui ne se trouve que dans ce seul passage. Quant à la forme snivmi (Marc, vi, 36 : dur-at-snivun «ils abordèrent»), qui ne se rencontre également quune fois, on ne peut la rapporter a une racine snav; mais on peut la faire venir de snu par le même changement de Vu en w9 qu’on remarque au génitif pluriel des thèmes en u; exemple : simiv-ê «filiorum», de sunu; c’est-à-dire qu’il faut admettre que Vu a reçu le gouna le plus faible (S 27) et que la diphthongue iu s’est changée en iv, à cause de la voyelle suivante. Les formes snu-un ou snv~unt auxquelles on aurait pu s’attendre, paraissent avoir été évitées, la première à cause de Thiajtus et de la cacophonie produite par deux u qui se suivent, la seconde pour éviter de faire précéder le v d’une consonne, combinaison que le gothique n’aime pas, à moins que la consonne ne soit une gutturale (§86, 1). C’est pour la même raison, sans doute, que le gothique évite aussi au génitif pluriel des formes comme sunu-ê ou sunv-ê, et les remplace par suniv-ê, contrairement aux génitifs pluriels comme pasvahm (du thème paéu «animal») en zend, comme fructu-um en latin, comme fiorpà-œv en grec. Le fait qui a lieu en gothique a un analogue en sanscrit : au prétérit redoublé sanscrit, que représente le prétérit germanique, un u ou un û9 placé à la fin d’une racine, ne peut pas se changer en un simple v; les voyelles en question, quand elles ne sont pas frappées du gouna, se changent en uv devant une désinence commençant par une voyelle; exemples : nunuv-üs «ils louèrent», de nu; susnuv-üs «ils coulèrent», de snu9 formes qu’on peut comparer au gothique sniv-un.
1.
‘9
THÈMES FINISSANT PAU UNE CONSONNE.
•S iri5. Thèmes terminés par une gutturale, une palatale
ou une dentale.
Nous passons aux thèmes finissant par une consonne. Les consonnes qui en sanscrit paraissent le plus souvent à la fin de lu forme fondamentale sont n, t, s etr1; toutes les autres consonnes ne paraissent qu’à la fin des mots-racines (S ni), qui sont rares,* et de quelques thèmes d'origine incertaine. Nous commencerons par les consonnes qui se trouvent seulement à la fin des mots-racines.
4
Aucune gutturale ne se trouve en sanscrit à la fin d'un thème véritablement usité; en grec et en latin cela arrive, au contraire, fréquemment; c se rencontre en latin à la fin des thèmes comme des racines, g seulement à la fin des racines; exemples : duc, vorac, edac; leg, conjug. En grec, x, ^ et y paraissent seulement à la fin des racines ou de mots d’origine inconnue, comme (pptx, xopax, 6w% (sanscrit naUâ), ^Aoy.
Parmi les palatales, c et g paraissent le plus fréquemment en sanscrit; exemples : vâé (féminin) «discours, voix» (latin vôc, grec Ô7r); rué (féminin) «éclat» (latin Mc); râg (masculin) «roi» (seulement à la fin des composés); rug (féminin) «maladie». En zend, nous avons : juauL? vâé (féminin) «discours»; drug (féminin), nom d'un démon, probablement de la
racine sanscrite druA'* haïr».
• .
Les cérébrales ('S t, etc.) ne sont pas usitées à la fin des thèmes; les dentales, au contraire, le sont fréquemment, avec cette différence que d, ^ d'ne se rencontrent qu’à la fin des mots-racines, c’est-à-dire rarement, vy t peut-être seulement
1 Les thèmes terminés, suivant les grammairiens indiens, en r (sïî), doivent etre considérés comme des thèmes en ?• (S i J.
dans pat, thème secondaire de patin «chemin», tandis que t et sont très-souvent employés. Voici des exemples de mots-racines terminés en d et en i: ad «mangeant», à la fin des composés; yud' (féminin) «combat»; ksuiï(féminin) «faim». Plusieurs des suffixes les plus usités sont terminés en t, par exemple le participe présent en ant, forme faible at, grec vt et latin nt. Outre le t, le grec a aussi S et B- à la fin des thèmes; toutefois xépvB me paraît être un composé, ayant pour second membre la racine avec suppression de la voyelle, ce qui donne à ce mot le sens de « ce qui est posé sur la tête ». Sur l’origine relativement récente du S dans les thèmes féminins en i§, il a déjà été donné des explications (S 119); on peut comparer notamment les noms patronymiques en t§ avec les noms patronymiques terminés en î en sanscrit; exemple : îbft Bâimt «la fille de Bhîma». Le des noms patronymiques féminins en ot$ est probablement aussi un complément ajouté à une époque plus récente : comme les noms en tS, les noms en aS dérivent immédiatement de la forme fondamentale d’où est sorti également le masculin; ils ne se trouvent donc pas avec celui-ci dans un rapport de filiation.
En latin, le d du thème pecud est un complément de date récente, comme on le voit par le sanscrit et le zenà pasu, et par le gothique faiku.
En gothique, les formes fondamentales terminées par une dentale se bornent à peu près au participe présent, où l’ancien t a été changé en d; ce d toutefois ne reste seul que là où la forme est employée substantivement; autrement, il prend le complément an à tous les cas, excepté au nominatif, ce qui fait rentrer ces formes dans une déclinaison d’un usage plus général. Les dialectes germaniques plus jeunes ne laissent jamais l’ancienne dentale finale sans ajouter au thème un complément étranger.
En lithuanien, le suffixe participial ant fait au nominatif ans,
pour ants, ce qui nous reporte à une époque de la langue représentée par le latin et le zend, mais antérieure au sanscrit, tel qu’il est venu jusqu’à nous. Toutefois, aux autres cas, le lithuanien ne sait pas non plus décliner les consonnes, c’est-à-dire les joindre immédiatement aux désinences casuelles. Il fait passer les consonnes dans une déclinaison à voyelle1, à l’aide d’une addition de date récente : au suffixe participial mit, il ajoute la syllabe %a, par l’influence de laquelle le t subit un changement euphonique en c.
La nasale de la classe des dentales, c’est-à-dire le n ordinaire, est une des consonnes qui figurent le plus fréquemment à la fin des thèmes. Elle termine en germanique tous les mots de la déclinaison faible; ces mots, comme les noms sanscrits, et comme les masculins et les féminins en latin, rejettent' au nominatif le n du thème, et finissent, par conséquent, par une voyelle. Le même fait a lieu au nominatif en lithuanien, mais dans les cas obliques les thèmes en n s’adjoignent soit la syllabe ta, soit simplement un i.
. ‘ t
S 126. Thèmes terminés par une labiale. — I ajouté en latin et en gothique à un thème finissant par une consonne.
Les labiales, y compris la nasale (m) de cette classe, se trouvent très-rarement en sanscrit à la fin des formes fondamentales; on ne les rencontre guère qu’à la fin des racines nueâ employées comme dernier membre d’un composé; encore, cela arrive-t-il peu fréquemment. Au nombre des mots employés séparément, nous trouvons cependant up (féminin) «eau», et kaküB (féminin) «région du ciel», où la labiale est très-probablement radicale; tous deux sont d’origine incertaine. ap, dans les
y
1 Pour abréger, nous disons déclinaison à voyelle, déclinaison à consonne, au lieu de déclinaison des thèmes finissant par une voyelle, des thèmes finissant par une consonne. — Tr.
cas forts (§ 129) âp, n’est usité qu’au pluriel, mais le mot zend correspondant Test également au singulier (nominatif âfs9 S A7, accusatif âpëm, ablatif apad).
De même en grec et en latin, les thèmes en p, b, Ç> sont ou bien évidemment des mots-racines, ou bien des mots d’origine inconnue; il y a aussi en latin des thèmes où la labiale n’est finale qu’en apparence, un i ayant été supprimé au nominatif; exemple :plebs, pour plebi-s, génitif pluriel plebi-um. Comparez à ces formes, en faisant abstraction du genre, les nominatifs gothiques comme hlaib-s «pain», laubs «feuillage», génitif filai-bis, laubis, du thème iilaibi, laubL
Sans la comparaison des langues congénères, on peut difficilement distinguer en latin les thèmes véritablement et primitivement terminés par une consonne de ceux qui ne sont ainsi terminés qu’en apparence; car il est certain que la déclinaison en i a réagi sur la déclinaison des mots finissant par une consonne, et a introduit un i en divers endroits, où il est impossible qu’il y en eût un dans le principe. Au datif-ablatif pluriel, on peut expliquer IV de formes telles que amantibus? vô-eibus, comme voyelle de liaison servant à faciliter l’adjonction des désinences casuelles; mais il est plus exact, selon moi, de dire que les thèmes vôc, amant, etc. ne pouvant se combiner avec bus y ont, dans la langue latine, telle qu’elle est venue jusqu’à nous, élargi leur thème en va ci, amanti, de manière quil faudrait diviser ainsi : voci-bus, amanti-bus. Ce qui prouve que cette explication est plus conforme à la vérité, c’est que devant la terminaison uni du génitif pluriel, et devant la terminaison a du neutre, nous voyons souvent aussi uni, sans qu’on puisse dire que, dans amanti-um9 amanti-a, IV soit nécessaire pour faciliter l’adjonction des désinences. Au contraire, les thèmes juvenis, cani-s font au génitif pluriel juven-um, can-um, formes qui rappellent les anciens thèmes en n; nous avons, en effet.
en sanscrit svan «chien» (forme abrégée suri) et yûvan «jeune» (forme abrégée yûn), en grec xvmv (forme abrégée xvv), qui ont un n à la fin du thème, On montrera plus tard que les nominatifs pluriels, comme pedê-s, você-s, amantê-s, dérivent de thèmes en i. Le germanique ressemble au latin, en ce qu’il a ajouté un i, pour faciliter la déclinaison, à plusieurs noms de nombre dont le thème se terminait primitivement par une consonne; c’est ainsi qu’en gothique le datif jidvôn-m suppose un thème fidvôri (sanscrit x|c[^ catâr, aux cas forts calvdr). Les thèmes ^(^saptan «sept», navan «neuf», dâéan
«dix» deviennent en vieux haut-allemand, par l’adjonction d’un i, sibuni, muni, zëhani, formes qui sont en même temps le nominatif et l’accusatif masculins, ces cas ayant perdu en vieux haut-allemand le suffixe casuel. Les nominatifs gothiques correspondants seraient, s’ils étaient conservés : sibunei-s, niunei-sy taikunei-s.
§ 127. Thèmes terminés par r et /.
Parmi les semi-voyelles (ÿ, r, l9 v), et ne se trouvent jamais à la fin d’un thème, seulement à la fin du thème div, mentionné précédemment, qui, dans plusieurs cas, se contracte en dyô et en dyu; ^ r, au contraire, est très-fréquent, surtout à cause des suffixes tar et târ210, qui se retrouvent également dans les autres langues. En latin, on a souvent, en outre, un r tenant lar place d’un s ^primitif, par exemple, dans le suffixe comparatif iôr (sanscrit îyas, forme forte îyâhs). En grec,
dX est le seul thème en X; il appartient à la racine sanscrite
ml «se mouvoir», d’où vient sal-i-ld (neutre) «eau». Le thème latin*correspondant est sol; le thème sol, au contraire, se rapporte au thème sanscrit svàr (indéclinable) «ciel». Ce mot svàr ne vient certainement pas de la racine svar, svr «résonner»1, mais de la racine sur 6 «briller», qui se trouve sur les listes de racines dressées parles grammairiens indiens, et que je regarde comme une contraction de svar; le zend qarenas «éclat» (génitif qarënanho,$$ 35 et 56a), auquel correspondrait en sanscrit un mot svarnas, génitif svarnasas, dérive de cette racine. Mais comme le groupe sanscrit sv est représenté aussi en zend par hv9 on ne sera pas surpris que svàr «ciel» (en tant que «brillant») ait donné en zend hvar (par euphonie hvarë, d’après le S 3o) «soleil»; cette dernière forme, à la différence du mot sanscrit, est restée déclinable. Au génitif, et probablement aussi au* autres cas très-faibles (§ i3o), hvar se contracte en hûr; exemple: liûr-o, venant de hûr-as (§ 56 b), lequel répond au latin sâl-is. Nous trouvons une contraction analogue dans les thèmes sanscrits sura et surya «soleil» : le premier vient immédiatement de la racine svar « briller », le dernier probablement de svàr «ciel». En grec, $Xto$ (X pour p) serait avec une forme svârya (nominatif $vârya-s), qu’on peut supposer en sanscrit, dans le même rapport que nSv-e est avec svâdü-s. Il n’y a aucun doute que rjXto ne soit de la même famille que ëXv (qui répondrait à une -forme sanscrite smrâ); mais il est très-douteux qu’il en dérive, car il n’y aurait aucune raison pour allonger la voyelle initiale. Le rapport de sXtf avec la forme supposée svarâ est le même que celui de êxvpés avec le sanscrit svâsura-s (pour svasuras). L’e de a-éXas211 212 et de osXtfvtj tient de même la place d’une ancienne syllabe Fa; creX répond donc au sanscrit svar. On pourrait encore
poursuivre la même racine ramifications.
en grec et en latin dans d’autres
§ 128. Thèmes terminés par un s.
Des sifflantes sanscrites, les deux premières ^ i) ne
paraissent qu’a la fin des mots-racines, et, par conséquent, rarement; au contraire, termine quelques suffixes formatifs très-usités, parmi lesquels qui forme surtout des neutres;
exemple : têgas «éclat, force», de tïï^T tig «aiguiser». Le
grec semble manquer de thèmes en s : mais cela vient de ce que cette sifflante est ordinairement supprimée quand elle est . entre deux voyelles, surtout dans la dernière syllabe; cest pour cela que les neutres comme fiévos, yévos font au génitif (xévsos, yévsos, au lieu de pévecros, yivsvos l. Quant au s du nominatif, il doit appartenir au thème et non à la désinence casuelle, puisqu’il n’y a pas de désinence s pour les neutres au nominatif. Dans la langue de l’ancienne épopée, le <7 s est conservé au datif pluriel,parce qu’il ne s’y trouvait pas entre deux voyelles; exemples : ?evyea,-<Tt, épeer-o1/; de même dans les composes comme <jctxés-7ra\os, TsXes-(pépos, pour lesquels on supposait a tort l’adjonction d’un s à la voyelle du thème. Dans y ripas, yv-pa-os, pour yripctcr-os, le thème, une fois le a rétabli, correspond au sanscrit garas « vieillesse », quoique la forme
indienne soit du féminin et non du neutre. En latin, dans celte classe de mots, le s primitif s’est changé entre deux voyelles en r; mais dans les cas dénués de flexion, il est, en général, resté invariable; exemples : gémis, gener-is = grec yévos, yévs{cr)-os\
1 Vo (= a en sanscrit) du nominatif ne diffère pas, quant à l'origine, de Te des cas obliques, lesquels feraient supposer un thème peves, yeve$, Toute la différence vient de ce que les cas obliques, pour alléger le thème qui est accru par l’adjonction des désinences, ont substitué à l’o la voyelle moins pesante e. C’est pour la même raison que, dans la meme classe de mets, le latin affaiblit tti en c,* exemple ; opus, oper- is.
opusf oper-is = sanscrit (védique) dpas «action, œuvre», dpas-as 213.
Il y a dans ia langue védique un thème féminin en s d’une forme assez rare : c’est usés « aurore », de la racine us («briller », ordinairement «brûler»); ce mot peut allonger Va a tous les cas forts; exemples : uêâsam, nominatif-accusatif duel uêasâ (védique a pour au), pluriel usas-as. A l’accusatif uêâsam répond
en zend ; au nominatif usas, le zend
usâo.
Aux thèmes neutres en as correspondent les thèmes zends comme marné «esprit», micas «discours». Le masculin sanscrit qui signifie à la fois «lune» et «mois»,
de la racine mas «mesurer», donne en zend au nominatif^ mao «lune», à l’accusatif mâonhêm = sanscrit masam
(S 56 ). En lithuanien, nous avons le thème menés, qui, comme en sanscrit, signifie en meme temps «lune» et «mois» (voyez §167). ‘
CAS FORTS ET CAS FAIBLES.
S 129, Les cas en sanscrit. — Division en cas forts et en cas faibles.
Le sanscrit et le zend ont huit cas, à savoir, avec ceux du latin, 1 instrumental et le locatif. Ces deux cas se trouvent aussi en lithuanien; mais cette dernière langue n’a pas le véritable ablatif, celui qui répond à la question unde.
Comme avec certains thèmes et avec certains suffixes formatifs la forme fondamentale ne reste f|s la même en sanscrit à tous les cas, nous diviserons pour cettè langue la déclinaison en cas forts et en cas faibles. Les cas forts sont le nominatif et le vocatif des trois nombres, l’accusatif du singulier et du duel; au
1 Sur d’autres formes que prend le suffixe sanscrit m en latin, voyez S 98*2. a La forme mas est à la fois le thème et le nominatif.
contraire, l’accusatif pluriel et tous les autres cas des trois nombres appartiennent aux cas faibles. Cette division ne s’applique toutefois qu’au masculin et au féminin; pour le neutre, il n’y a de cas forts que le nominatif, l’accusatif et le vocatif pluriels, tous les autres cas des trois nombres sont faibles. Là où le thème affecte une double ou une triple forme, on observe d’une façon constante que les cas désignés comme forts ont la forme la plus pleine du thème, celle que la comparaison avecjes autres idiomes nous fait reconnaître ordinairement comme étant la forme primitive; les autres cas ont une forme affaiblie du thème. Au commencement des composés, le thème dénué de flexion paraît sous la forme affaiblie : c’est pour cela que les grammairiens indiens ont considéré la forme faible comme étant la vraie forme fondamentale ( § i 1 a ).
Nous prendrons pour exemple le participe présent, qui ferme ses cas forts avec le suffixe ant, mais qui rejette le n aux cas faibles et au commencement des composés; cette lettre reste, au contraire, à tous les cas dans les langues congénères de l’Europe, et la plupart du temps aussi en zend. D’après ce que nous venons de dire, les grammairiens indiens regardent et non ant comme le suffixe de ce participe L La racine ^ Bar,
Br, ire classe, « porter», aura donc, au participe, Bârant pou* thème fort, thème primitif (comparez ÇépovT, ferent), et Bàrat pour thème faible. La déclinaison du masculin est la suivante :
Cas forts. Cas faiblvs.
Bàran .......
liârautam .......
....... I) ara là
....... Hâratê
Singulier : Nominatif-vocatif........
Accusatif............ •
Instrumental............
Datif . ;.............. 213
Cas forts. Cas faibles.
Ablatif....................... Piratas
Génitif..............*........ baratas
Locatif........................ barati
Duel : Nominatif-accusatif-vocatif. . barantau • • -.....
Instrumental-datif-abîatif......... baradbyam
Génitif-locatif........... *...... bâratos
Pluriel : Nominatif-vocatif........ lîarantas ........
Accusatif.............. ....... baratas
Instrumental................... baradbis
Datif-ablatif......... Uradbyas
Génitif...................... * bdratâm
Locatif....................... bàratsu.
§ i3o. Triple division des cas sanserits en cas forts, faibles ■ et très-faibles.
Quand, dans la déclinaison d’un mot ou d’un suffixe, paraissent alternativement trois formes fondamentales, la forme la plus faible appartient à ceux des cas faibles dont les désinences commencent par une voyelle, la forme intermédiaire aux cas qui ont une désinence commençant par une consonne. D apres cette règle, nous pouvons diviser les cas en cas forts, en cas faibles ou intermédiaires, et en cas très-faibles. Prenons pour exemple le participe actif du prétérit redouble (parfait grec). U forme les cas forts du masculin et du neutre avec le suffixe vâns, les cas très-faibles avec us (pour us, § 21 L) et les cas intermédiaires avec vat (pour vas}. La racine rud « pleurer» aura, par exemple, au nominatif et à 1 accusatif du singulier masculin et du pluriel neutre, les formes rurudvan 213, rurudvan-sam, rurudvdmi (S 786), au génitif masculin-neutre des trois nombres rurudûêas, rurudûsâs, rurudusam, et au locatif masculin-neutre du pluriel rurudvdt-su. Le nominatif-accusatif singulier
' A ver suppression île s, d’après If* S 9/1.
neutre est rurudvdt, le vocatif rürudvat. Le vocatif singulier masculin n’a pas toujours la forme complète du thème fort; il affectionne les voyelles brèves; exemple : rurudmn (au nominatif, rurudmn). Sur l’accentuation du vocatif, voyez § 20
S i3i. Les cas forts et les cas faibles en zend.
Le zend suit, en général, le principe sanscrit qui vient d’être exposé, non-seulement dans la déclinaison des suffixes formatifs, mais aussi dans celle de certains mots dont le thème prend exceptionnellement en sanscrit plusieurs formes : toutéfois, à la différence du sanscrit, le zend a ordinairement conservé, au participe présent, la nasale dans les cas faibles. On a, par exemple, le thème fiuyant*, qui fait au datiffsuyantê,
au génitif fsuyantê , à l’accusatif pluriel fsuyantê; sau
çant «brillant», qui fait à l’ablatif sauéantâd et au génitif pluriel saucëntahm. Mais les formes faibles, au participe présent, ne manquent pas non plus : on a, par exemple, le thème bërësant «grand, haut» (littéralement «grandissant» = sanscrit vrhdnt, védique brhant), qui fait au datif bërësaitê et au génitif bëresatê, tandis que l’accusatif est bërësantëm. Le suffixe vaut supprime le n dans les cas faibles dont la désinence commence par une voyelle, en d’autres termes, dans les cas très-faibles; on a donc au génitif qarënamhatê (pour qarënankvatê, S 62) «splen-dentis», mais à l’accusatif qarënanuhantëm. Le suffixe van se contracte dans les cas très-faibles en un; si ce suffixe est précédé d’iîn a, Vu de ten\se combine avec lui pour former la diph-thongue 1»* au (S 3a); exemple : asavan «pur, doué de pureté», datif nominatif-accusatif-vocatif duel neutre
aiauni9; au contraire, nous avons au nominatif-accusatif-voca- 214 215
lîf masculin pl«ml mmmm$4 et duel smmm. An reste. eo trouve
aussi es rend. dans le? cas très-faibles àu thème . la
dipbllioagoe plu? pleine >m èm an lien de L* #*: nous aTeas.
par exemple, au datif et sa gésitîf les fermée? à eèié de •BÔmmè: au génitif pluriel mâmtâkM a coté de
À la contraction de mmiwm es /êmœm on màéw ressemble en sanscrit celle de théine mÆgémm | surnom d’Indra ). qui. dans les cas. très»faililef. supprime-1* de la syllabe m. change le r en s et le combine avec. Fa précédent : le génitif est denc ■»*-gêÊHB$9 le datif ms^gâi-èj. tandis que l'accasaSif a 1s forme forte De |w» tjeune* défive. dans les cas très-faible?. la forme |«« f génitif fim-és: Facensatif est jiwmi. i: 1» long provient de la contraction de la syllabe m on m en ss. lequel s’cst combiné arec. F» précédent en une seule voyelle longue.
Du thème contracté y£n dérive te thème' féminin y#»*. la caractéristique du féminin i avant été ajoutée au radical : eu latin, nous avons le thème^èsl-r2 Ijèsrir * jàmtei* !. qui sest élargi par fadjonciion don f, et. qui est dans le même rappel avec le thème sanscrit que les noms dagents comme «fetri-e, gvw*fri-c avec les formes .sanscrites êâlr-t scelle qui donne *. gurit&r-* 3celle qui enfante* fi i ipi. Eh général", la caractéristique du féminin f se joint en .sanscrit- à la ferme affaiblie du théine, lorsque celui-ci est susceptible dus affaiblissement au masculin et au neutre: exemple : riêri * chienne ?. du thème des cas très-faibles du masrnlin (génitif ém-m; rend le rappelle encore en passant Falhanais ijp-s ^chienne* i de * chien *1,
3 Qm tos* qe'es smà TwmBSËH plami affflrtiBBI mx ras feefe. même pr h Èamœr, teæfei qa’es sKsæxi^iï iF«!t an ca^Jiwt gar ÏMtmA a$s. t A * C^Jméhr#! mm jàme *|sâ «& h «a. I*ës : asairraaSEiî. ks ra»
dans le duquel je reconnais un représentant de Yi, caractéristique du féminin en sanscritL
S 13a - t - Les cas forts et les cas faibles en grec. — De l’accent dans la déclinaison des thèmes monosyllabiques, en grec et en sanscrit.
Le mot sanscrit précité ban «chien» est du nombre des mots dont le thème passe par une triple forme : mais ban lui-même est le thème des cas intermédiaires (S i3o); il fait, par conséquent, évd-Byas216 217 «canibus». Les cas forts dérivent, a 1 exception du vocatif ban, de bân, accusatif svân-am (zcnd span-ëm,
§ 5o). C’est à ce thème fort que se rapporte le grec xdûw, dont les cas obliques se réfèrent tous au thème des cas tres-faibles en sanscrit; le génitif jcwgs, par exemple, répond bien au sanscrit sûn-as (de kün-as), mais l’accusatif xôva ne répond pas à bànam. Il y a toutefois des mots grecs qui rappellent de plus près la division sanscrite en cas forts et en cas faibles; on voit notamment dans les thèmes nrctTep, fitjrsp, S-uyaTep, que Y s se perd seulement aux cas qui correspondent aux cas faibles en sanscrit, tandis que dans les autres il se maintient ou s allonge. Comparez, à ce point de vue, «ram/p, 'sraTep, <æraT^p-a, 'zsa.Tép-e, 'ssarép-es avec le sanscrit pitd, pîtar (vocatif),pitâr-am, pitâr-âu,pitâr-as, et, au contraire, le génitif et le datif taraTp-és, tEfarp-/ avec les affaiblissements de forme que le sanscrit fait subir aux mots irréguliers au génitif et au locatif (ce dernier cas répond au datif grec); exemples ; sun-as, sun-i, pour svan-as, bdn-4. Nous ne pouvons prendre ici comme terme de comparaison les mots sanscrits exprimant la parenté, parce que leur
génitif, qui est complètement, irrégulier, a perdu toute désinence casuelle, et que leur locatif n’a pas subi la mutilation qu’éprouvent, en général, à ce cas, les mots qui affaiblissent leur thème; nous avons, en effet, pitân, et non pitrî, comme pourrait le laire attendre le grec ^rarpl. À la différence du sanscrit, le grec ne permet pas l’affaiblissement du thème au duel et au pluriel.
On peut admettre avec certitude qu’au temps où notre race n’avait encore qu’une seule et même langue, la division en cas lorts et en cas faibles commençait seulement à se dessiner et n’avait pas encore toute l’étendue qu’elle a prise depuis en sanscrit; pour citer un exemple, elle ne s’appliquait pas encore aux participes présents, car aucune des langues européennes ne la reproduit au participe, et le zend lui-même n’v prend part qu’à un faible degré. La division en cas forts et en cas faibles a dû s’introduire d’abord par l’accentuation, car ce ne peut être un hasard qu’à cet égard le sanscrit et le grec se correspondent d’une manière si parfaite. En effet, les deux langues accentuent les mots dont le thème est monosyllabique (nous ne parlons pas de quelques exceptions isolées), tantôt sur la désinence, tantôt sur la syllabe radicale; or, ce sont précisément les cas que nous avons appelés, à cause de leur forme, les cas forts, qui prouvent également leur force, en ce qui concerne l’accentuation, en maintenant le ton sur la syllabe radicale, tandis que les cas faibles ne peuvent le retenir et le laissent tomber sur la .désinence. C’est ainsi que nous avons, par exemple, le génitif uâcâs «sermonis» par opposition au nominatif pluriel de même forme vâcas. L’accusatif pluriel qui, en ce qui touche l’accentuation, appartient aux cas forts, fait également vâéas; il n’est guère permis de douter que ce cas n’ait été dans le principe un cas fort, même dans sa forme, comme le sont 1 accusatif singulier et ! accusatif duel.
Pour donner une vue d’ensemble, je place ici la déclinaison complète de vâc (féminin) «discours» en regard de la déclinaison du grec èw, qui, bien qu’assez altéré (ôw pour Fox), a la même origine :
CAS FORTS.
cas faibles.
Sanscrit. Grec. Sanscrit. Grec.
Singulier : Nominatif-vocatif...... vâlc Ôtt-s ............
Accusatif............. vac-am Ôtt-et ............
Instrumental..................
Datif.........................
Ablatif......................
Génitif......................
Locatif; datif grec...... ..........vâc-i
Duel : Nominatif-accusatif-vocatif vdc-âu Ôir-e ..............
Instrumental-ablatif..............vâg-tiyam .......
Datif.........................vâg-Byam oitotv
A * *r
vac-a
A * A.*
vac-c vâc-ds vâc-as
v. locatif Ô7T-é?
OTï—t
Pluriel
|
Génitif-locatif...... |
^ A J A* vac-os | ||
|
IVnminafif—vn^îltiT * . |
Af f . . - vac-*as |
ÔtT-SS | |
|
Aronsatif......... |
Ôts-ols | ||
|
Instrumental....... |
vàg-bts | ||
|
Datif-ablatif....... |
vâg-Byâs | ||
|
Génitif........... |
^ A r a? _ vac-am |
Locatif; datif grec
vâk-su
07T-&V Ô7T-(T l
$ i3a, a. Variations de l’accent dans la déclinaison,des thèmes monosyllabiques, en grec et en sanscrit.
\ '
Dans un petit nombre de mots sanscrits monosyllabiques, l’accusatif pluriel se montre à nous comme un cas faible, non-seulement en ce qui concerne la forme, mais encore en ce qui touche l’accentuation, c’est-à-dire qu’il laisse tomber le ton sur la désinence. Parmi ces mots, il faut citer râi * richesse», nié (de nik) «nuit», pad «pied», dont l’accusatif pluriel èst rây~ds, nis-âs218 219, padràs (en grec, au contraire, isôSols). D’un autre côté, il y a aussi en sanscrit quelques mots monosyllabiques qui ont absolument maintenu l’accent sur la syllabe radicale : par exemple, svan « chien», gâ « taureau, vache», dont les équivalents grecs ont suivi l’analogie des autres monosyllabes, de sorte que nous avons, par exemple, xvvés, xvvl, fio(F)i% xvvâv, fio(f)£w, xvvl, fioval, répondant aux formes sanscrites sun-ns, sun-i, gâv-i, sün-âm, gdv-âm, svd-su, go-su. Il n’est pas douteux que ces formes sanscrites, qui se rapportent à une période où la division en cas forts et en cas faibles n’avait pas encore eu lieu, sont plus près de l’ancien état de la langue, en ce qui concerne l’accentuation, que les formes grecques. Il y a parité entre le sanscrit et le grec, pour les thèmes pronominaux monosyllabiques, plus résistants que les thèmes nominaux; exemples : tésu «in his», féminin tâ’su (non têsû, tâsû); en grec, dans la langue épique, rotât, ratai. Le mot sanscrit exprimant le nombre «deux», qui est, à vrai dire, un pronom, garde également l’accent sur la syllabe radicale ; exemple : dvâByâm; mais il en est autrement en grec, ou nous avons Svotv1, Le nombre sanscrit «trois» suit, au contraire, la division en cas forts et en cas faibles : nous avons tri-sû «in tribus», trî-n-am, «trium» (forme védique), avec l’accent sur la dernière, comme en grec rpt-ai, %pt-âv, tandis qu’au nominatif-accusatif neutre, qui est un cas fort, l’accent est sur la syllabe radicale : rpla (en sanscrit trî-n-i).
§ 13a, 3. Les cas forts et les cas faibles, sous le rapport de l’accentuation, en lithuanien.
L’accentuation donne lieu aussi en lithuanien à la division en cas forts et en cas faibles ; tous les substantifs dissyllabiques qui ont l’accent sur la dernière le ramènent sur la syllabe initiale à l’accusatif et au datif singuliers et au nominatif-vocatif pluriel, c’est-à-dire, si l’on en excepte le datif, à des cas que le sanscrit et le grec considèrent comme les cas forts220 221. On a , par exemple :
Nominatif singulier. Accusatif sing. Datif sing, Nom.-voc. sing.
sfinu-s «fils» sûnu-h sûnu-i sunü-s
mergà «enfant* (féminin) merga-n mêrga-i mergô-s
akmiï «pierre» akmeni-n âkmeniu-i ahnen-s
dükte «fille» diikteri-n dhkterei dùkter-s \
a
Pour les adjectifs en u, ayant l’accent sur la dernière, il n’y a pas de changement dans l’accentuation au datif.
On peut comparer ce recul de l’accent à celui qui a lieu en sanscrit au vocatif des trois nombres, et en grec à quelques vocatifs du singulier, ainsi qu’au recul que les deux langues font subir à l’accent dans les superlatifs en iéta-s, iff7o-s, et dans les comparatifs correspondants.
S 13a, 4. Les cas forts et les cas faibles en gothique.
Le gothique reproduit, dans certaines formes de sa déclinaison, la division sanscrite en cas forts et cas faibles : i° 11 supprime l’a des thèmes en ar aux cas faibles du singulier, et ne le conserve qu’aux cas forts, c’est-à-dire au nominatif-accusatif-vocatif; a0 dans les thèmes en an, il maintient ¥a dans les cas que nous venons de nommer, tandis qu’au génitif et au datif il l’affaiblit en *. En sanscrit, l'« des thèmes en an est complètement supprimé aux cas très-faibles, s’il est précédé d’une seule consonne. Comparez le gothique brâthar «frère», comme nomi-nalif-accusatif-vocatif, avec le sanscrit Brâtâ (S i44), Brâtaram, Brâtar, et, au contraire, le datif brâthr (sans désinence casuelle) avec *s(f^ Bratr-ê, Le génitif gothique brôthr-s s’accorde avec le zend brâtr-â (S 191) et les formes comme taravp-és. Du thème gothique ahan, nous avons le nominatif aka, l’accusatif akan, le vocatif aha, qui répondent aux formes sanscrites comme râgâ «roi», râgân-am, ragan, et, au contraire, le génitif ahin-s, le datif ahin, qui, en ce qui concerne l’affaiblissement du thème, répondent aux formes sanscrites râfpi-as,râgà-ê, lesquelles ont supprimé la voyelle de la dernière syllabe du thème. 222
deux voyelles, insère entre elles un n euphonique; on ne rencontre guère cet emploi d’un n euphonique qu’en sanscrit et dans les dialectes les plus proches (pâli, prâcrit). Il n’a pas dû, dans la période primitive de notre famille de langues, avoir été d’un usage aussi général qu’il l’est devenu en sanscrit; autrement on en trouverait des traces dans les langues européennes congénères, qui s’en abstiennent presque entièrement. Le zend même en offre peu de vestiges. Nous regardons donc l’emploi de ce n euphonique comme une particularité du dialecte qui, après la séparation des langues, a prévalu dans l’Inde et s’est éleyé au rang de langue littéraire. Il faut ajouter encore que fflKome védique ne se sert pas de ce n dans une mesure aussi large que le 'sanscrit ordinaire. C’est au neutre qu’il paraît le plus souvent; il est moins usité au masculin et plus rarement encore au féminin. Le féminin en borne l’usage au génitif pluriel, où on le trouve aussi en zend, quoique d’une manière moins constante. Il est remarquable que précisément à ce cas les anciennes langues germaniques, à 1 exception du gothique et du vieux norrois, insèrent aussi un n euphonique entre la voyelle du thème et celle de la désinence casuelle; mais cette insertion n’a lieu que dans une seule déclinaison, celle qui est représentée en sanscrit et en zend par les thèmes féminins en â.
Outre l’emploi de la lettre euphonique n, il faut encore mentionner le fait qu’en sanscrit et en zend la voyelle du thème prend le gouna à certains cas; le gothique, le lithuanien et l’ancien slave présentelft des faits analogues (S 26, 4, 5, 6).
SINGULIER.
nominatif.
S 134. La lettre s, suffixe du nominatif en sanscrit. — Origine
de ce suffixe.
Les thèmes masculins et féminins terminés par une voyelle ont, sauf certaines restrictions, s pour suffixe du nominatif dans les langues indo-européennes. En zend, ce s, précédé d’un se change en lequel, en se contractant avec l’a, donne ô (S 2); la même chose a lieu en sanscrit, mais seulement devant les lettres sonores (S a5)x. On en verra des.exemples au § 148. Ce signe casuel tire son origine, selon moi, du thème pronominal TJsa «il, celui-ci, celui-là» (féminin ^TTsa); nous voyons, en effet, que, dans la langue ordinaire, ce pronom ne sort pas du nominatif masculin et féminin: au nominatif neutre et aux cas obliques du masculin et du féminin, il est remplacé par H taf féminin HT tâ.
S 135- La lettres, suffixe du nominatif en gothique. — Suppression, affaiblissement ou contraction de la voyelle finale du thème.
Le gothique supprime a et i devant le suffixe casuel $, excepté à la fin des thèmes monosyllabiques, où cette suppression est impossible. On dit hva-s «qui», i-s «il», mais vulf-s «loup», gast-s «hôte, étranger », pour vulfa-s, gasti-s (comparez hosti-s). Dans les thèmes des substantifs masculins en ja? la voyelle finale est conservée, n*is affaiblie en i (S 67); exemple : harji-s «armée». Mais si, ce (® arrive le plus souvent, la syllabe finale
1 Par exemple : ïPT mâma r filins mei», ÇTfTH H3T suté-s tâva «filius
tui»($a2). “ est précédée d’une longue ou de plus d’une syllabe, ji est contracté en ei (= î, § 70); exemples : andeis «fin», raginei-s «conseil», pour andji~s9 ragmjis. Cette contraction s’étend au génitif, qui a également un s pour signe casuel.
Aux nominatifs gothiques enji-s correspondent les nominatifs lithuaniens comme Atpirktôji-s «Sauveur», dont IVprovient également d’un ancien a223 ; je tire cette conclusion des cas obliques, qui s’accordent, en général, avec ceux des thèmes en a. Mais quand en lithuanien la syllabe finale ja est précédée d’une consonne (ce qui a lieu ordinairement), le y devient î, et IV suivant, qui provient de Va, est supprimé; exemple : lobi-s «richesse», pour lobji-s, venant de lobja-s.
Les thèmes adjectifs gothiques en ja ont au nominatif singulier masculin quatre formes différentes, pour lesquelles sûtis, krains, niujis, viltheis peuvent servir de modèles2. La forme la plus complète est jis, qui tient lieu de ja-s (S 67); ji-s est employé quand la syllabe ja du thème a devant elle une voyelle ou une consonne simple précédée d’une voyelle brève : niu-ji-s «nouveau», sak-jis «querelleur». Le nominatif masculin du thème midja serait donc, s’il s’en trouvait des exemples, midjis (= sanscrit mddyas, latin médius).
Si la syllabe ja des thèmes adjectifs gothiques est précédée d’une syllabe longue terminée par une consonne, ja se contracte au nominatif masculin en comme pour les thèmes substantifs, ou bien il se contracte en t, ou, ce qui est le plus fréquent, il est supprimé tout à fait. Nous citerons, comme exemples du premier cas, althei-s «vieux »9viUhei-s «sauvage»; du second cas, sûtis « doux », airlmis « saint » ; du troisième cas, hrains « pur »,
i.
gamain-s « commun », gafaur-s « à jeun », brûk-s « utile », bleith-s «rebon», andanêm-s «agréable». On peut ajouter à ces derniers mots aîja-kun-s « âWoysvtfs», au lieu duquel on aurait pu attendre aljakunji-s,Yu étant indubitablement bref; mais le suffise paraît avoir été supprimé au nominatif pour ne pas trop charger ce mot composé, ou simplement parce que la syllabe est précédée de plus d’une syllabe. Les cas obliques montrent partout clairement que c’est bien la syllabe ja qui termine le thème.
Remarque 1. — Nominatif des thèmes en m, ri, en gothique. — Comparaison avec le latin.
Les thèmes gothiques en ra et en ri suppriment, au cas où le r est précédé d’une voyelle, le signe casuel s; mais ils le conservent quand r est précédé d’une consonne. Exemples : vair « homme », stiur «veau, jeune taureau», anthar « l’autre», hvatkar «qui des deux?», des thèmes vaira, sliura, etc. frumabaur «premier-né», de frumabauri; maisakr-s «champ», fingr-s «doigt», baitr-s «ramer»,fagr-s «beau», de akra, etc. Aux formes qui suppriment le signe casuel ainsi que la voyelle finale du thème, répondent les formes latines comme vir, puer, socer, levir, aller, pulcer; aux thèmes gothiques en ri répondent en latin les formes comme celer, celeber, puter. Mais quand r est précédé en latin d’un a, d’un u ou dun o, ainsi que d’un ê ou d’un î, la terminaison est conservée ; exemples : vêrus, sevê-rus, sêrus, mîrus, virus, -parus (oviparus), cârus, nurus, pûrus, -vorus (camivorus). L’e bref n’a lui-même pas laissé périr partout la terminaison us (mërus, Jerus).
Il y a aussi en gothique des thèmes en sa et en si qui, pour éviter la rencontre de deux s à la fin du mot, ont laissé tomber le signe casuel ; exem -
y ■
pies : laus «privé, vide», du thème lausa; drus «chute» 224 225. Dans us-stass «résurrection», du thème féminin us-stassi226, il y aurait, sans la suppression du signe casuel, jusqu’à trois s.
Remarque % — Nominatif des thèmes en va, en gothique.
Les thèmes gothiques en va changent en u la semi-voyelle quand elle est précédée d’une voyelle brève; ce changement a lieu non-seulement devant le signe casuel du nominatif, mais encore à la fin du mot, a 1 accusatif et au vocatif dénués de flexion des substantifs; exemples: thiu-s «valet», du thème thiva, accusatif thiu ; qviu-s « vivant» (lithuanien gywa-s, sanscrit gîvâ-s), de qviva. Le thème neutre kniva «genou» fait de même au nominatif-accusatif kniu. Mais si le a est précédé d’une voyelle longue (la seule qu’on rencontre dans cette position est ni), le v reste invariable; exemples . saiv-s «mer», snaiv-s rrneige», aiv-s «temps». En vieux haut-allemand ce v gothique s’est vocalisé ; très-probablement il est d abord devenu u, et, pai suite de l’altération indiquée au S 77, cet u s’est changé en 0; exemples : sêo «mer», snêo «neige», génitif sêwe-s, sncwe-s, qu’on peut comparer au gothique saiv-s, saivi-s, snaiv-s, snaivi-s. De même dëo «valet», génitil dëwe-s, en gothique thiu-s s thiwi-s.
Remarque 3. — Nominatifs zends en as.
En zend, devant la particule enclitique c'a, les thèmes en a, au lieu de changer ai (— sanscrit as) en 0, comme c’est la règle (8 56 b), conservent la sifflante du nominatif. Nous avons bien, par exemple, vëhrko «loup», pour le sanscrit vrka-s, le lithuanien wilka-s, le gothique vuîf-s; mais on aura vëhrkaécti «lupusque» = sanscrit vrkasca. Le thème
interrogatif ka «qui?» a aussi conservé la sifflante quand il est en combinaison avec nà «homme» (nominatif du thème nar) et avec le pronom enclitique de la a0 personne du singulier : kasna «quis homo?», kaste «quis tibi?». Entre kaé et l’accusatif iwahm 011 insère en pareil cas une voyelle euphonique, soit £ é, soit ^ ë; les manuscrits les plus anciens1 ont £ ë, qui est préférable, attendu que ^ comme voyelle longue ne convient pas bien au rôle de voyelle de liaison (SS 3o et 31). Mais il est sur que même £ ë ne s’est introduit dans kaéëtwahm «quis te?» qu’à une époque relativement récente, car la conservation de » $ peut s’expliquer seulement par la combinaison immédiate avec la dentale. R faut observer à ce propos que l’enclitique c'a a pour effet de préserver la sifflante, non-seulement au nominatif, mais à toutes les autres terminaisons qui en sanscrit finissent par as, et quelle empêche, en outre, d’autres altérations, telles qu’abréviation dune voyelle primitivement longue ou contraction de la désinence ayê en hî* ëê.
1
Voyez Burnouf, Yaçna, notes, p. 135.
S i36. Le signe du nominatif conservé en haut-allemand
et en vieux norrois.
Le haut-allemand a conservé jusqu’à nos jours 1 ancien signe du nominatif sous la forme v; mais déjà en vieux haut-allemand on ne trouve plus ce v que dans les pronoms et dans les adjectifs forts qui, comme on le verra plus loin (S 987 et suiv.), contiennent un pronom. Comparez avec le gothique i-s «il» et le latin i-s le vieux haut-allemand i-r.
Dans les substantifs, le signe du nominatif s est conservé sous la forme r, mais seulement au masculin, en vieux norrois. C’est la seule langue germanique qu’on puisse comparer sous ce rapport au gothique; exemples : hva-r ou ka-r «qui?», en gothique hva-s; ûlj-v «loup»1, en gothique vuîfs, venant de vulfa-s; son-r «fils»* en gothique sunu-s, en sanscrit et en lithuanien sdwtL-s, sünù-s. Les féminins ont, au contraire, perdu en vieux norrois le signe casuel; exemples : hônd «main», en gothique handu-s; dâdh «action», du thème dadhi (nominatif-accusatif pluriel dâdhi-r), en gothique dêd-s, de dêdi-s.
S 137. Nominatif des thèmes féminins en sanscrit et en zend. —
De la désinence ês dans la 5e et dans la 3e déclinaison latine.
Les thèmes féminins sanscrits en « et, à très-peu d’exceptions près, les thèmes polysyllabiques en î, ainsi que strî «femme», ont perdu l’ancien signe du nominatif, comme cela est arrivé pour les formes correspondantes des langues congénères (excepté en latin pour les thèmes en é). En sanscrit, ces féminins paraissent sous la forme nue du theme ; dans les autres langues, ils affaiblissent, en outre, la voyelle finale. Sur l’abréviation de la, voyez § .118. En zend, * î s’abrége aussi, même dans le
1 11 y a aussi varg-r qui veut dire «loup», et qui se rapproche beaucoup du sanscrit vârka-8, forme primitive de vvka-s.
monosyllabe Jp» strî «femme»; nous avons, par exemple, stri-éa «feminaque», quoique, à l’ordinaire, l’enclitique «ufu ca protège la voyelle longue qui précède.
En ce qui concerne le s de la 5e déclinaison latine, laquelle, comme je l’ai montré plus haut (S 92k), est au fond identique avec la première, je ne puis plus reconnaître227 dans cette lettre un reste des premiers temps, qui aurait survécu en latin, tandis qu’il aurait disparu du sanscrit, du zend, de l’ancien perse, du grec, du lithuanien et du germanique. Je regarde la lettre en question comme ayant été restituée après coup à cette classe de mots, qui avait très-probablement perdu son signe casuel dès avant la séparation des idiomes. On peut comparer ce qui est arrivé à cet égard pour le génitif allemand herzen-s, qui a recouvré sa désinence s, tandis qu’en vieux haut-allemand tous les thèmes en n ont perdu leur s au génitif dans les trois genres, et qu’il faut, pour le retrouver, remonter jusqu’au gothique. Ce qui a pu amener le latin à restituer le s de la 5e déclinaison, c’est l’analogie des nominatifs de la 3e déclinaison terminés en ê-s (comme cœdê-s).
Pour ces derniers mots il se présente une difficulté : car si l’on regarde comme étant le thème primitif la forme cœdi, on aurait dû avoir au nominatif cœdis; en effet, en sanscrit, en zend, en grec et en lithuanien, tous les thèmes terminés par ifont au nominatif i*sf à moins qu’ils ne soient du neutre. Mais parmi les substantifs latins en ê-s, génitif i-s, il y en a deux auxquels correspondent en sansçrit des thèmes en as, à savoir nubês et sedês; le premier est évidemment parent du thème sanscrit nâlias «air, ciel», du slave nebes (nominatif-accusatif nebo, génitif
nebes-e) et du grec véÇ>es, génitif vd<ps(er)-o$ (§ 128). En sanscrit et en slave, ce mot est, comme en grec, du neutre; mais s il était du masculin ou du féminin, il ferait au nominatif nabas en sanscrit et vefyris en grec. C’est ainsi que nous avons en sanscrit du thème féminin usas « aurore » le nominatif usas, de tavas «fort5) le nominatif masculin tavas (védique), de dürmanas «malveillant» (minas, neutre, «esprit») le nominatif masculin et féminin dûrmanâs, neutre (peut-être inusité) dürmanas; c’est ainsi encore qu’en grec les thèmes neutres en es ont un nominatif masculin et féminin en vs, quand ils sont à la fin dun composé; exemple : Sucrptevffs, neutre Svcrptevés, qu’on peut comparer au sanscrit dûrmanâs, -nas, que nous venons de citer. Il est important de remarquer à ce propos que le latin décliné d’après le modèle cwdês, nubês les composés grecs analogues a Svarfxevtfs, lorsqu’ils entrent en latin comme noms propres; nous avons, par exemple, au nominatif Socratês, qui répond à 2<y-xpetrtjs, mais les cas obliques dérivent d’un thème en i, ce qui donne Socrati-s, et non, comme on aurait dû s’y attendre d’après la forme complète du thème, Socrateris (comme généras = y&e(cr)-os).
Le second mot latin en ê-s, i-s, qui répond à un thème neutre
terminé en sanscrit en as et en grec en es, est sedês : la forme sanscrite est sâdas « siège », génitif sàdas-as, la forme grecque sSos, génitif £$e(o-)-os. On peut donc comparer sedês avec le dernier membre du composé evpvéSrts. Ui qui paraît aux cas obliques, par exemple, Aans nubi-s, cœdi-s, sedi-s, etc. peut s expliquer comme un affaiblissement de l’a primitif du thème; quant à l’e de oper-dsygeher-is, il a été produit par l’influence de r, qui, comme on a vu (S 8A)* se fait précéder plus volontiers dun e que d’an i. Si le s primitif était resté, nous aurions eu probablement opis-is, genis-is, au lieu de oper-is, gener-is.
* > 1
___ ____ ____ mu c ncl CO Ht
111 Cil vo vjui o von ^
Nous mentionnerons ici un féminin lati
316 formation des cas.
servé sans mutilation aux cas obliques : Cerê-s, Cerer-is; l’étymologie de ce mot est obscure, si l’on se borne à consulter à cet égard le latin. Si Pott a raison (Recherches étymologiques,
1, 197, II, 224 et suiv.) de rapporter le nom de cette déesse, inventrice de l’agriculture, à une racine qui signifie en sanscrit «labourer», et dont nous avons fait dériver plus haut (§ 1) le zend kars-ti (en sanscrit krs-ti «le labourage»), la signification étymologique de Cerê-s serait «celle qui laboure», de même que la signification du sanscrit usas «aurore» est «celle qui brille». Le thème de Cerê-s serait donc Cerer (primitivement Ceres). Quant à la racine dont ce nom est formé, elle aurait perdu la sifflante qui suivait le r, à peu près comme en grec nous avons Xap {%odpa) en regard de la racine sanscrite bars, hrs «se
réjouir»228. .
De ce qu’il y a dans la 3' déclinaison latine des noms qui
ont leur nominatif terminé à Sa fois en es et en is, par exemple, canês et eanis, on n’est pas autorisé à conclure que les deux terminaisons dérivent d’une source unique; car l’analogie de mots tels que codés, nubês, sedês, et, pour citer un masculin, verrês, qui aux cas obliques ne se distinguent pas des thèmes en i, a pu faire que quelques thèmes en i aient pris ê-s au nominatif au lieu de i-s. 11 faut donc examiner dans chaque cas particulier si c’est la forme en t-s ou la forme en ê-s qui est la forme organique. Le mot canis n’aurait pas dû adopter, outre la forme en is, le nominatif en ês, car l’t est dans ce mot, comme dans juvenis, simplement ajouté à un thème primitif en n
Il a pu se faire aussi quelquefois que la désinence es de la
5e déclinaison ait réagi à son tour sur la troisième, et y ait introduit des nominatifs en is qui tiennent la place de formes
en a (venant d’un a). Ainsi le suffixe de fa-mê-s1 ne me paraît pas différent, quant à son origine, du suffixe ma dans Jlam-ma, fâ-ma, etc. et du suffixe firj dans yvé-yw, dhy-pd, etc. Famê-licus se rapporte clairement à un thème primitif famé.
Sur les nominatifs zends en yç ê et sur les nominatifs lithuaniens en e (venant de id) voyez § 92 k.
S 138. Conservation du signe s après un thème finissant
par une consonne.
Les thèmes masculins et féminins terminés par une consonne perdent en sanscrit le signe du nominatif s, conformément au S 9A; et quand deux consonnes terminent le thème, Tune de celles-ci est également supprimée, en vertu de la même règle; exemples : billrat, pour blb'rat-s «ferens»; ’tuddn, pour tudânt-s «tundens»; vâk (de vâc, féminin), pour vâk-s « discours». Le zend, le grec et le latin ont conservé le signe du nominatif après une consonne, plus conformes en cela à la langue primitive que le sanscrit; exemples : en zend Ail âf~s (pour âp-$, § ûo) «eau», kërëfs «corps» (pour kërëp-s),
druU-s (du thème drug) «un démon», ^aiq»a*» âtar-s «feu». Quand la consonne finale du thème ne s’unit pas facilement au signe du nominatif, le latin et le grec renoncent plutôt à une partie du thème qu’au signe casuel; exemples : yapis, pour virtûs, pour virtûts. Il y a un accord remarquable entre le zend, d’une part, et le latin, l’éolien et le lithuanien, de l’autre, en ce que nt combiné avec $ donne ns, ns ; ainsi amans, riSévs, lithuanien degaiis «brûlant » répondent au zend fsuyaiié«engraissant» (la terre).
Comme le n lithuanien ne se fait plus sentir dans la pronon- 229
dation (S 10), je rappelle encore les formes mieux conservées des participes borussiens comme sîdans «assis». Les formes gothiques comme bairand-s «portant» et certains substantifs analogues comme frijônd-s «ami» (littéralement «celui qui aime»), fijand-s «ennemi» (littéralement «celui qui hait»), dépassent, par leur état de conservation, toutes les formes analogues des autres idiomes, en ce qu’elles ont conservé aussi la consonne finale du thème. Au sujet du zend, il convient encore de faire observer que les thèmes terminés par le suffixe vont (forme faible vat) forment leur nominatif d’une double manière : ou bien ils suivent l’analogie du participe présent et des formations latines en tens (comme par exemple opulens, nominatif de opulent-), ou bien ils suppriment les lettres nt et, par compensation, allongent l’a précédent, comme cela arrive en grec pour icrlâ-s, venant de iafldvt, Xverâ-s, de Xoerarr, A la première formation se rapportent twâvaiis « tuî similis » et cvans (pour ci-vans, § kio) «combien» (interrogatif); à la seconde formation appartiennent tous les autres nominatifs connus des thèmes en vaut ou en manl; mais il faut remarquer que, d’après les lois phoniques du zend, â-s doit devenir do, de sorte que l’analogie avec les formes grecques en as, pour avr-s, est assez peu apparente. Nous avons, par exemple, pi»»» avâo «tel» du thème avant, venant lui-même du thème primitif a « celui-ci » ; vîmnhâo (pour -hvâo), nom propre, en sanscrit vivasvân, du thème vivasvant.
Mentionnons encore un mot qui, contrairement aux règles ordinaires du sanscrit, et d’accord en cela avec les formes latines et grecques telles que x^Pts> virtûs, conserve au nominatif le signe casuel et rejette, la consonne finale du thème : c’est avayâg (dans le dialecte védique «portion du sacrifice»), dont le nominatif est avayâ-s (au lieu de avayâk).
S i3g, î. Nominatif des thèmes en », en sanscrit
et en zend.
Les thèmes masculins sanscrits en n rejettent la nasale finale au nominatif, et allongent la voyelle brève qui précède. Les thèmes neutres en n suppriment la nasale au nominatif, a 1 accusatif et, facultativement, au vocatif; exemple : danî' «riche», de danin. Les suffixes an,man, van, ainsi que svan «chien» et plusieurs autres mots en an, d’origine incertaine, allongent 1 a à tous les cas forts, excepté au vocatif singulier; exemple : raga « roi », accusatif râgân-am. Le zend suit généralement le même principe, avec cette seule différence qu’il abrège ordinairement, comme on l’a déjà fait observer, un â long a la fin des mots polysyllabiques; on aura, par exemple, spa «chien», mais asava ( du thème asavan) « pur ». Au contraire, le mot-racine gan « tuant » (=le sanscrit han), dans le composé vërëira-gan «victorieux» (littéralement «tuant Vërëtra» = le sanscrit vrtra-han), fait au nominatif vërëiragâo, pour vërëiragâ-s (en sanscrit
vrtrahâ). Les formes fortes des cas obliques conservent, en zend, 1 a bref de la racine \ comme vrtrahan en sanscrit; je considère donc Vâ long, renfermé au nominatif dans la diphthongue ao (pour â-s), comme une compensation pour la suppression de n, ainsi que cela est arrivé dans les formes grecques fiéXâ-s, raXâ-s pour fié\otv-s, TdfXav-s. Il y a aussi, en sanscrit, trois thèmes en n qui conservent au nominatif le signe casuel et suppriment n; les deux plus usités sont pântâ-s « chemin » et manta-s « batte a beurre»230 231, accusatif pântân-am, mdntân-am. Comme les cas forts de ces mots ont tous un â long, celui du nominatif ne peut pas être regardé comme une compensation pour la suppression de n,
ainsi que nous l’avons supposé pour Yâ des formes correspondantes en grec et en zend; il est vraisemblable toutefois que, lors même qu’il n’y aurait pas da long aux cas obliques forts de pâniâ-s, mdniâ-s, il y en aurait un au nominatif.
S 189, a- Nominatif des thèmes en n, en latin.
Le n du thème et le signe casuel s sont supprimés tous .deux, en latin, après un ô (= sanscrit «), mais non après une autre voyelle. Nous avons notamment les nominatifs edô, bibô, erro, sermô (racine svar, svr «résonner»), qui sont formés par un suffixe on, mân, auquel répond, en sanscrit, le suffixe des cas forts ân, mân, dans les mots comme rdgâ «roi», accusatif rdgânam, âtmd « âme », accusatif âtmdn-am. Les thèmes féminins, comme actiôn, sont probablement une forme élargie d’anciens thèmes en ti, auxquels répondraient, en sanscrit, les substantifs abstraits en ti. En effet, il y a, en sanscrit, très-peu de thèmes en n qui soient du féminin, et il n’y a pas, dans cette langue, de suffixe tyân ou tyan qui puisse être rapproché du tiân latin.
Ui des cas obliques, dans les thèmes comme homin, arundin, ïiirundin, origin, imagin, et dans les mots abstraits en tudin, est un affaiblissement de Yô; homin-is est, par exemple, une altération de homônis, et, en effet, dans une période plus ancienne de la langue, on trouve Yô dans les cas obliques (kemônem, ho-monem), comme il est resté au nominatif. Mais, dans les thèmes qui ne se terminent ni ne se terminaient primitivement en ôn, il n’y a jamais suppression simultanée de n et du signe casuel, ou bien c’est le signe casuel qui est conservé, comme dans san-gui-8, sanguin-em (rapprochez le sanscrit pàniâ-s, pan-
lân-am), ou bien c’est n, comme dans pecten,pmen (masculin), -cm (tubi-cen, fidi-cm, os-cm), lien, forme à côté de laquelle nous trouvons aussi liênis. Ce dernier mot pourrait nous servir h expliquer les trois autres, et nous autoriser à supposer que les
nominatifs masculins en en sont des restes de formes en ni-s, comme plus haut nous avons vu de thèmes en ri se former des nominatifs en er (celer pour celeri-s, S i35). Les nominatifs en m-5 des mots que nous avons cités plus haut auraient perdu, plus tard, cet i, qui n’était qu’un complément inorganique, tandis qu’il serait resté dans juveni-s et cani-s (en sanscrit, au nominatif, yüvâ, svâ, à l’accusatif yüvân-am, svân-am). Le suffixe en de pect~en, comme le suffixe on de ëdôn, bibôn, etc. représente le suffixe sanscrit an, et le suffixe men, dans jla-mcn, représente le suffixe sanscrit l.
Le neutre latin s’éloigne * au contraire, du neutre sanscrit, zend et germanique, en ce qu’il ne rejette nulle part le n du thème; nous avons, par exemple, nômen, en opposition avec le nominatif-accusatif sanscrit nàma% zend nâma3 et gothique namô.
Si la suppression de n au neutre se bornait aux deux langues de l’Asie, j’admettrais sans hésitation quelle n’a eu lieu qu’après la séparation des idiomes. Mais, comme les langues germaniques ont part à cette suppression, il est plus vraisemblable que le latin, après avoir d’abord rejeté, au nominatif et h l’accusatif, la nasale des thèmes neutres en n, l’a plus tard réintégrée (compariez §i A3).
$ iko. Nominatif des thèmes en n, en gothique et en lithuanien.
Les dialectes les plus anciens des langues germaniques, et, en particulier, le gothique, sont dans le rapport le plus étroit 232 233 234
avec le sanscrit et le zend, en ce qu’ils rejettent le u tinal du thème au nominatif de tous les genres, ainsi quà l’accusatif des thèmes neutres. En gothique, cette règle ne souffre aucune exception. Nous avons, par exemple, le thème gothique masculin ahman « esprit», qui fait au nominatif ahma, à l’accusatif ahman (sans désinence casuelle), de même qu’en sanscrit âtmân «âme» fait au nominatif âtma, à l’accusatif âtman-am*.
Le lithuanien supprime également, dans les thèmes en n (lesquels sont tous du masculin), cette nasale au nominatif; la voyelle qui précède (ordinairement cest un e) est alors changée en û. Je reconnais dans cet û Vâ long sanscrit (S o9a), tandis que l’e des autres cas représente l’a sanscrit des cas faibles. Mais si l’on admet que tous les cas de cette classe de mots ont eu primitivement, en sanscrit, un â long, il faut quen lithuanien il se soit d’abord abrégé en a et ensuite affaibli en e. Comparez le nominatif aktnü «pierre » avec le sanscrit asma (venant ue a/cma) et le génitif akmèn-s avec âéman-as. Je regarde le nominatif su « chien » comme un reste de swu = sanscrit svâ, à peu près comme sapna-s «rêve» est pour le sanscrit svâpna-s. L’w de sun-& «du chien » ( gériitiS ) et de tous les autres cas correspond, au contraire, comme lu de kw-6$, etc. à la contraction des cas très-faibles en sanscrit.
§ iUi. Nominatif des thèmes neutres en an, en gothique.
En gothique, les thèmes neutres en an, après avoir rejeté le n, changent Va précédent en â, c’est-à-dire qu’ils l’allongent. Ce changement a lieu au nominatif, ainsi qu’aux deux cas qui lui sont semblables, l’accusatif et le vocatif. On voit par là que le neutre gothique suit l’analogie des cas forts, au lieu qu’en sans-
Le suffixe formatif du mot gothique est originairement identique à ceîui du moi
sanscrit (S 799).
crit le neutre, excepté au pluriel \ n’a que des cas faibles. En gothique, au nominatif-accusatif pluriel neutre, les thèmes en an allongent également l’a en ô; exemples : hairtôn-a « les cœurs », ausôn-a «les oreilles», augôn-a «les yeux », gajukôn-a «les compagnons», des thèmes haîrtan, ausan, augan, gajukan; c’est ainsi quon a, en sanscrit, naman-i «les noms», de nâman; vârtvnâni «les routes», de vârtman. Mais, en gothique, on n’allonge ainsi la voyelle, et même on ne la conserve que quand la syllabe qui précède est longue par nature ou par position, ou quand il y a plusieurs syllabes qui précèdent: si la voyelle n’est précédée que dune seule syllabe, et si cette syllabe est brève, comme dans les thèmes naman «nom», vatan «eau», non-seulement on n’ai-longe pas l’a devant le n, mais on le supprime tout à fait, comme cela arrive, en sanscrit, dans les cas très-faibles; exemple : namna «les noms » (pour namôn-a2), de même qu’en sanscrit nous avons nâmn-as « nominis », pour nâman-as.
On peut expliquer, par certains faits analogues, le pouvoir qu’a, en gothique, une syllabe longue de conserver Yê de la syllabe suivante; cest ainsi quen latin la long de la racine sanscrite siâ «être debout» est conservé presque partout, grâce à la double consonne qui précède (stâ-mus, stâ-tis, stâ-tum, etc.), tandis que l’d de dâ «donner» s’est abrégé dans les formes latines correspondantes. C est ainsi encore qu’en sanscrit la désinence de l’impératif hi ne s’est conservée dans les verbes de la 5° classe qu’en un seul cas : celui où Yu de la syllabe caractéristique est précédé de deux consonnes; en d’autres termes, quand le h de la syllabe nu a une consonne devant lui ; exemple : sak-
Voyez S 129. G est pourquoi on a eu plus haut (S i3o) vurudvShs-i, en analogie avec le masculin rurudviïm-as; on & de même catvar-i (réaaapa), en opposition avec l’accusatif masculin faible catür-as (jéaaaptts).
* Le thème vata» n’est employé nulle part au nominatif-accusatif-vocatif pluriel; maie du datif on peut conclure qu’il devait faire vatn-a.
nu-hx, de êak «pouvoir», auquel on peut opposer ci-nü (et non éi-mt-hî), de ci «assembler».
Si Ton voulait, en remontant, conclure du gothique au sanscrit, on pourrait tirer des formes comme hairtô, pluriel hairtôn-a, celte conséquence que non-seulement le nominatif-accusatif-vocatif du neutre pluriel, mais encore les mêmes cas du neutre singulier et du neutre duel (lequel a disparu en gothique), suivaient le principe des cas forts; on aurait donc eu primitivement, à côté du pluriel ndmân-x «les noms», le singulier namâ et non nâmâ, et le duel namân-î et non namn-î.
§ 1 Aâ. Adjonction, en gothique, d’un n final au nominatif
des thèmes féminins.
Dans la déclinaison féminine je ne puis reconnaître, en germanique, de thème primitif terminé par?*; je regarde cette lettre, aussi bien dans les substantifs que dans les adjectifs féminins, comme un complément inorganique. En gothique, les thèmes substantifs féminins terminés par n ont, devant cette consonne, soit un ô (« ^rr â, § 69), soit ci (= t, $ 70): ce sont la de vraies voyelles finales du féminin, auxquelles un n n’a pu venir se joindre qu’à une époque plus récente; ainsi viduvân (nominatif viduvô) s’éloigne par cette lettre n du thème correspondant en sanscrit, en latin, et en slave : vidavâ, vidua, blaobiI vUova (ces formes sont, en même temps, le thème et le nominatif singulier); de même svaihron «belle-mère» (nominatif ~rô) s éloigne par son n du grec éxvpâ. En sanscrit, on aurait dû avoir, dapres 1 analogie de svdsxira «beau-père» un féminin évd~ surâ; mais la forme usitée est svasrû (latin socru), qui vient, à ce que je crois, d’une métathèse Quant aux thèmes féminins 235
gothiques en ein, iis ont déjà été comparés en partie avec des thèmes sanscrits en$(§ 120,1). Dans les thèmes abstraits, comme mikilein « grandeur», managein « foule », hauhein «hauteur», qui dérivent des thèmes adjectifs mikila, managa, hauha, je regarde à présent ci comme une contraction du suffixe secondaire yâ (féminin); nous y reviendrons (S 896). De toute manière, le n n’est, dans cette classe de mots, qu’un complément inorganique. Dans les adjectifs de la déclinaison faible (Grimm), les thèmes féminins en on ou jôn ne dérivent pas, comme on pourrait le croire, des thèmes masculins et neutres correspondants en an, jan, mais ils viennent, selon moi, des thèmes féminins correspondants (thèmes forts) en â,jô, avec adjonction d’un n. Je reconnais, par exemple,dans les thèmes gothiques féminins qvivôn «viva», niujân «nova», midjôn «media» (nominatif qvivo, ninjô, midjô), ainsi que dans les thèmes forts (féminins) correspondants, les thèmes sanscrits ayant même signification gtvâ', navyâ, mddyâ. Semblablement le substantif féminin daura-vardôn «portière» est dérivé de daura-vardâ (nominatif -da), dont le thème s’est élargi, et il est avec celui-ci dans le même rapport que le thème mentionné plus haut, viduvôn, avec le sanscrit vidava. Rappelons encore qu’Ulfilas élargit aussi, par l’adjonction d’un », le thème du grec éxxXrio-ia, et tire d’aikklêsjon le génitif âikldês-jôn-s, tandis qu’on aurait plutôt attendu un nominatif aMlêsja, génitif aikklêsjô-8.
S 143, 1. Rétablissement de n au nominatif des mots grecs et de certains mots germaniques.
Quand'deux ou trois membres d’une grande famille de langues ont éprouvé, sur un seul et même point, une même perte, on
voyelle au féminin; ainsi |anw (masculin-neutre) «mince» a le thème du féminin semblable, ou bien il but, avec P« long, tann.
peut l’attribuer au hasard, et à cette raison générale que tous les sons, dans toutes les langues, surtout à la fin des mots, sont exposés à s’oblitérer; mais, sur le point qui nous occupe, cest-à-dire sur la suppression de n a la lin du theme au nominatif, l’accord a lieu entre un trop grand nombre d’idiomes pour que nous puissions l’attribuer au hasard. Ce n devait déjà être supprimé au nominatif, avant le temps où les langues qui composent la famille indo-européenne commencèrent a se sépaier.
11 n’en est que plus surprenant de voir le grec s écarter, à cet égard, des langues congénères, et se contenter de supprimer, dans ses thèmes en v, soit le signe du nominatif, soit le v, selon la nature de la voyelle qui précède, mais presque jamais l’un et l’autre à la fois. La question est de savoir si nous sommes ici en présence d’un fait contemporain du premier âge de la langue, ou bien si, après avoir éprouvé la même perte que le sanscrit, le zend, etc, les thèmes en v sont rentrés en possession de leur consonne finale, grâce à l’analogie des autres mots terminés pai une consonne et par une réaction des cas obliques sur le nominatif; dans cette dernière hypothèse, nous serons conduits à admettre d’anciennes formes de nominatif, comme sv$cu(â&> eiîSatpo, T6pn, tfye. Je me range à la seconde supposition,^et je citerai, à ce sujet, l’exemple de certains dialectes germaniques qui, dans beaucoup de mots, ont restitué au nominatif, suivant l’analogie des cas obliques, le n que le gothique supprime constamment. Déjà, en vieux haut-allemand, les thèmes féminins en mi (gothique ein, S 70) font au nominatif in, tandis que le gothique a la forme mutilée ei; exemple : guotlihhin « gloire». En haut-allemand moderne, il est à remarquer que beaucoup de thèmes masculins, primitivement terminés en. », sont, par une erreur de l’usage, traités au singulier comme s’ils avaient été terminés primitivement en m, c’est-à-dire comme s ils appartenaient à la irc déclinaison forte de (irimin. On a, par cotisé-
quent,le n au nominatif, et le génitif recouvre le signe s, qui, il est vrai, se trouve, en gothique, après les thèmes en n, mais qui avait déjà été retranché en haut-allemand il y a plus de dix siècles. On dit, par exemple, brunnen, brunmn-s «fons, fonds», au lieu du vieux haut-allemand bfunno, brunnin, et du gothique brunna, brunnin-s. Dans quelques mots on voit, au nominatif, à côté de la forme qui a repris le n, comme hackm k joue », samen « semence », l’ancienne forme sans n : bâche, same; mais, même dans ces mots, le génitif a pris le s de la déclinaison forte.
Parmi les neutres, le mot herz «cœur» mérite d’être mentionné, Le thème du mot est, en vieux haut-allemand, bërzan, en moyen haut-allemand hërzen; les nominatifs sont hërza, hërze; l’allemand moderne supprime à la fois le n et Ye du thème her-zen, comme il fait aussi pour beaucoup de thèmes masculins en n, tels que bar, au lieu de bave. Gomme nous ne sommes pas ici en présence d’un mot qui passe dans la déclinaison forte, mais que ce mot subit, au contraire, un nouvel affaiblissement du nominatif faible, la forme du génitif herzens, au lieu d’une forme dénuée de flexion herzen, est d’autant plus surprenante.
S i43, a. Suppression d’un v en grec, à la fin des thèmes
féminins en cov.
C’est seulement dans les thèmes féminins en ov ou en cov que le grec supprime le v au nominatif : encore la suppression n’a-t-elle pas toujours lieu. Mais là où l’on trouve concurremment &> et cov, co est ordinairement la forme employée chez les écrivains les plus anciens. Ainsi Topyco, Moppico236, WvQco, à côté de Topycov.
Mopfxcov, Uvdôjv. La déclinaison de ce dernier mot, telle que nous la trouvons dans Pindare, est presque de tout point conforme au principe sanscrit; il y a seulement cette différence que le sanscrit fait peu d’usage des thèmes féminins en n et préfère, dans l’état de la langue qui est connu de nous, même dans le dialecte védique, ajouter la marque du féminin î aux thèmes masculins et neutres en n. On ne trouve guère de thèmes féminins en n qu’à la fin des composés, et même dans cette position ils sont très-raresl. Nous comparerons donc la déclinaison du thèmeUvOcSv, telle qu’elle est dans Pindare2, avec celle du mas-
|
colin sanscrit âtmdn : | ||
|
Nominatif........... |
WvOùS |
âtma |
|
Accusatif............ |
Ilo^wr-a |
âtman-am |
|
Datif; en sanscrit locatif. |
llvd&v-t |
âtmân-i |
|
Génitif.............. |
II v8ûv-os |
âtmân-as. |
En ce qui concerne les dérivés ÏÏé&os, HvÔâos, et les composés comme UvOoxXrjs? ïlv6o$Ô)po$, nous rappellerons qu’en sanscrit on supprime régulièrement0un n final, ainsi que la voyelle qui précède, devant les suffixes dérivatifs commençant par une voyelle ou par un ^y; exemple : râgya-m «royaume», de râgrn «roi»; en outre, qu’un n final est toujours supprimé au commencement d’un composé. A propos de la suppression des v dans cette classe de mots et de la contraction qui s’opère
pour «douleur» (védanâ, du causa tif de la racine w'd«savoir») signifie étymologiquement «celle qui fait souvenir». Moppd) comme «épouvantail» serait donc primitivement «ce qui ramène à la raison». Le suffixe répond au suffixe sanscritman, forme forte mân, qui est représenté en grec par les formes pov, pwv, pev et pïv (S 797 etsuiv.).
1 De ~han «tuant», on trouve dans le Yajour-Véda (V, sB) -hanam comme accusatif féminin, forme identique à l’accusatif masculin. a Voyez Ahrens, dans le Journal de Kuhn, Iü, p. to5.
ensuite, Buttmann237 rappelle avec raison le fait analogue qui se. passe dans la déclinaison des comparatifs en o)v. .
On peut être surpris, après ce que nous venons de dire, de voir les mots féminins dont le nominatif est en former leur vocatif en o7, surtout si Ton voit dans cette forme de vocatif l’analogue du vocatif sanscrit en ê = ai} appartenant aux thèmes on â, comme sûtê «ô fille!», de sutâ (S ao5). Aussi sont-ce principalement ces vocatifs, ainsi que les nominatifs en co, assez fréquents sur les inscriptions, comme Àpreprçî, Aiovucr&), <ï>*~ Xvtç>, qui paraissent avoir conduit Ahrens a admettre des thèmes en oi pour tous les mots ayant au nominatif238 239. Mais ces vocatifs peuvent s’expliquer autrement : on peut regarder Yt de Fopyoi, âriSoï, comme tenant la place du v\ c’est par
un changement analogue que nous avons tmets, au lieu de ttOévs, XTévs; en éolien fisXais, taAais, au lieu de fiiXavs, raXavs; et en ionien pte/s, au lieu de (jlïjv240 241 242 243 244 245 246 247 248. Topydt, venant de Fopyév, serait donc, avec le nominatif Topyoj9 dans le même rapport que le vocatif sanscrit ragan avec le nominatif râgâ.
A côté des noms qui, comme Fopy&î, ysXiSoS, sont
évidemment d’anciens thèmes en v, il y a un grand nombre d’autres mots féminins en o>, tels que des noms mythologiques et des noms abstraits comme-ureiOeS, jusXXcé, (peM, pour lesquels
il est difficile de dire s’ils ont laissé disparaître un ancien v sans qu’il ait laissé de trace \ ou s’ils n’en ont jamais eu. Quant au principe qui a présidé à leur formation, il est certain que ces noms sont de la même sorte que les thèmes féminins sanscrits en â : on peut, par exemple, rapprocher fxeXAw,
(peiSco, aussi bien que Çopà, <p0opa, xaP“»
et les thèmes abstraits gothiques comme vrakâ «poursuite?;, bido
« prière » (nominatif vraka, bida, S 921)’ ^es a^s^ra^s sanscrits comme ksipa «l’action de jeter», bida, eidavA action de fendre».
Il est même vraisemblable que plusieurs noms mythologiques et quelques autres noms propres, surtout ceux qui ont simplement ajouté un w a la racine, ne sont que des abstractions personnifiées; exemples : KXfijflw,proprement «l’action de filer»2, KAsig; «l’action de publier», Nwe&> = vim «la victoire» (comparez Victoria «la déesse de la victoire»). KaAA*a-7<y et kpi</lé sont évidemment des superlatifs et rappellent par leur &>, tenant la place d’un â sanscrit (par exemple, dans svâdistâ «dulcissima»), les thèmes de superlatifs féminins en gothique, par exemple, batistâ «la meilleure », jubistô «la plus jeune». Mais si, comme j’en doute à peine, les noms grecs dont il s’agit ont, à une époque plus ancienne, ajouté un v à leur thème, ils ressemblent, à cet égard, aux noms gothiques que nous citions plus haut (S îAâ), tels que viduvo «veuve», du theme viduvôn, et les féminins de la déclinaison faible des adjectifs, comme blindo «cæca», du thème blindôn; batistâ «la meilleure», de batiston, génitif hatistôn-s. Les thèmes grecs comme Àjot&lcov, àetvcnv seraient alors aux thèmes masculins correspondants âpialo, Seivé ce que batiston, blindôn (d = d, § 6 9) son^ aux ^iemes masculins. 237
forts batista, blinda. On peut surtout appuyer cette opinion sur les nominatifs en & quon trouve sur les vieilles inscriptions, si Ton regarde cet ^ comme la vocalisation d’un v, et si l’on admet que le rapport entre hpTspoj (venant de Àprepofo) et le vocatif Aprefiot est le même qu’en sanscrit le rapport entre le thème fort âtmêin « âme» (nominatif âtma) et le vocatif, qui est en même temps le thème faible, atmrni.
Il en est de même pour les autres cas singuliers des mots qui se déclinent sur ils s’expliquent le plus naturellement par la suppression d’une consonne, qui n’a pu être ici que v, tandis que dans la déclinaison de rpttfptis il faut admettre la suppression d’un o*(Sia8),ce qui d’ailleurs ne fait pas de différence entre les deux déclinaisons, hormis au nominatif (S 1A6). Au pluriel, les féminins en é sont, en général, passés dans la ae déclinaison ; mais les exemples en sont rares (voyez Ahrens, Journal de Kuhn, III, p. 9b). Il reste aussi des formes qui se rapportent au type de déclinaison primitif et qui font supposer la suppression d’un ancien v : ainsi le pluriel KX&Oâss répondrait, sauf la différence du genre, après la restitution du v, au pluriel sanscrit âtmanas.
$ ihà. Suppression de r au nominatif des thèmes sanscrits et zends en ar.
— Fait analogue en lithuanien.
Les thèmes en ar, âr1 rejettent en sanscrit le r au nominatif et allongent, comme les thèmes eh n, la voyelle précédente : de pitdr « père », Brâtar « frère », mâtdr « mère », duhitdr « fille », viennent les nominatifs pitâ, Brâtâ, mâtà, duhitâ. De svdsâr « sœur », ndptâr « petit-fils », dâtâr «donateur» (S. 810) viennent svasâ, ndptâ, dâtd. L’allongement de Va des thèmes en ar sert, à ce que je crois, à compenser la suppression de r.
1 Y compris les thèmes que les grammairiens indiens regardent comme terminés en r (SS t et 197).
Le zend suit l’analogie du sanscrit et rejette r au nominatif; mais si ce r est précédé d’un a long, il 1 abrège, suivant la iegle qui veut que la soit toujours abrégé à la fin des mots polysyllabiques1; exemples : brâta «frère», data «donateur,
créateur»; accusatifbrâtar-ëm, dàtâr-ëm.
11 y a aussi en lithuanien quelques thèmes en r qui suppriment cette lettre au nominatif; ces thèmes sont tous du le-minin et, dans la plupart des cas obliques, ils se sont élargis par l’addition d’uni. Ainsi môte «femme», dukté «fille» répondent à TTTïïT mâta, duhita, et le pluriel moter-s, dük-
ter-s à KTtUQmâtdr-as, fff?IKQduhitâr-as. Au génitif singulier je regarde la forme môtèr-s, duhtèr-s comme la plus ancienne et la mieux conservée, et môteriës, dukterlës comme la forme altérée, appartenant aux thèmes en i. Au génitif pluriel, le thème n’a pas reçu cet % inorganique : on a nwtcr-ü, duktev-üf et non môteri-ü, duktevi-ü. Outre les mots précités, il faut encoie ranger dans cette classe le thème seser « sœur » ; il répond au sanscrit svâsâr, nominatif svâsâ; mais il s’éloigne au nominatif de môtê et dukte, en ce que l’c se change en û, d’apres 1 analogie des thèmes en en. Le nominatif est donc seau.
S î h 5. Suppression du signe du nominatif après les thèmes en r, en germanique, en celtique, en grec et en latin.
Les langues germaniques s’accordent avec le grec et le latin, en ce que, contrairement à ce qui se passe en sanscrit et en zend, elles conservent au nominatif le r final des thèmes2; a «ram/p, p/-n?p, &vyd7r}p, frnter, soror répondent en gothique j'adar, brâthar, svistar, dauhtar, en vieux haut-allemand fatar,
> Partout ailleurs qu’au nominatif singulier, le zend conserve, aux mêmes cas
/nia canccpil _ X* n Iniltf DOH1S 4 BIGOÏllS COtDlTIG dtitfàl *■
l|UV «V UUÏ1UVT A» f » VT ■ V. —0 —0 T
2 IL n’y a d’ailleurs dans les langues germaniques qu’un petit nombre de thèmes terminés par r : ce sont des mots exprimant une relation de parenté.
hruodar, suëstar, tohtar; La question est de savoir si ce r est au nominatif un reste de la langue primitive, ou si, après avoir été anciennement supprimé, il a été restitué au nominatif d’après 1 analogie des cas obliques. Je pense que c’est la première hypothèse qui est la vraie; j’explique l’accord du lithuanien et de l’ancien slave1 avec le sanscrit et le zend, par cette circonstance que les langues lettes et slaves se sont séparées de leurs sœurs de lAsie plus tard que les langues classiques, germaniques et celtiques, ainsi que nous l’avons reconnu d’après des raisons tirées du système phonique. Je ferai observer à ce sujet qu’en celtique, notamment en gadhélique, on supprime bien au nominatif singulier le n final 2, mais jamais le r final du thème. En voici des exemples en irlandais : athair « père » (pour pathair), brathair «frère», matkair «mère», piuthair3 «sœur», dear «fille», gen-
1 Nous reparlerons plus loin de l’ancien slave, où l’on a, par exemple, le nominatif mati «mère* à côté du génitif mater s.
2 On a, par exemple, en irlandais comharsa «voisine», génitif comharsain-e, du thèmecomharsan; naoidhe «enfant*, génitif naoidhin, de nanidheàn; guala (féminin) «épaule», génitifgualann, nominatif pluriel gaailne; eu «chien de chasse» (de cun, sanscrit ^wn,comme thème très-faible), génitif eon ou cuin, nominatif pluriel con ou cuin on cona. *
3 Pour spiuthair, avec endurcissement du v &n p, comme dans speur « ciel », qui répond au sanscrit «««r (voyez Pictet, De Vajjimté des langues celtiques avec le sanscrit (en français),tp. 7ô). Le sanscrit, le zend, le latin et le lithuanien ont évidemment perdu un (dans le terme qu’ils emploient pour désigner «la sœur»; ce l s’est conservé en germanique, en slave (ancien slave sestra) et dans une partie des langues celtiques. Si l’on rétablit cette lettre en sanscrit,,on obtient svastâr comme thème des cas forts. D’accord avec Pott (Recherches étymologiques, II, p, 55 ô, Ve édit.), je reconnais dans la dernière partie de ce nom un mot de la même famille que ski «femme» littéralement «celle qui enfante», de la racine su, s tri étant par conséquent pour su-tn), et dans la première syllabe, je reconnais le possessif sva «suus» (marquant l’appartenance, comme dans svagana «parent»), Svdsâr est donc pour svastâr, venant de sva-sâkîr. L’t du féminin manque, mais il faut observer qu’il manque aussi dansmâtâr «mère», duhikir «fille», et, comme le rappelle Pott, dans le latin uxor et auctor «celle qui commence une chose».
Le nom de la fille duhiiâr, de la racine duh «traire», est expliqué par
leoir (gemini «j’engendre») — sanscrit ganitâ, latin gemtor, grec ysveryp. On ne sera pas étonné, après ce qui a été dit § i35, de voir que le signe casuel manque au nominatif de cette classe de mots, en gothique et en latin; on pourrait attendre en grec des formes comme 'sra'n/?, jtnrn/s, au lieu de usaiép-s, fiyrep~s, c’est-à-dire le signe casuel maintenu préférablement a la consonne finale du thème et la perte de celle-ci compensée par l’allongement de la voyelle précédente. Les termes d’agents en tï}~s comme <5o-tw-s, y$v-s-sont probablement identiques, quant a leur origine, avec ceux qui sont terminés en Typ, et, en effet, on les voit souvent se remplacer (So-Hp, ysv-s-Ty'p); ces noms en tj?-? ont conservé le signe du nominatif de préférence à la consonne finale du thème; mais entraînés en quelque sorte par l’exemple du nominatif, ils ont renoncé au p dans les cas obliques et sont passés complètement dans la 1 déclinaison; on a donc Sût ou, etc. au lieu de S6t ypos, Sôzypi ou
de spos, <$oT£p( L Ces deux dernieres formes, en ce qui con-
Lassen (Anthologie sanscrite, s. v.) comme celle quœ mulgendi officium habuit m vetusta familiœ institution. Duhitâr peut certainement signifier «celle qui trait» ; et le nom donné à ia fille peut être emprunté à cette circonstance de la vie de pasteurs que menaient les ancêtres de la race. Mais il me paraît plus vraisemblable de regarder duhitâr comme le «nourrisson femelle»; ce terme a pu être détourné de son sens primitif pour désigner la fille déjà adulte, à une époque où l’étymologie du mot avait cessé d’être sentie ou d’être prise en considération. Il est encore possible* et c’est l’hypothèse qui me semble la plus probable, que la racine duh ait ici un sens causatif et signifie «allaiter», de sorte que duhitâr désignerait «la femme» en général, et, par conséquent, aussi «la jeune fille». La racine de «boire» (dâ, 8 109 ,2) dans de-nü «vache laitière» a également le sens causatif; il en est de même de la racine correspondante en grec , Q-tj dans le dérive Ô-üAus «femelle». En zend, le mot jj dainà, qui est de même origine que S-î)Xws, désigne «la femelle des animaux».
1 Un fait analogue a lieu en lette et en borussien, où non-seulement le nominatif, mais encore les cas obliques, perdent 1er .* nous avons, par exemple, en borussien, mûti «mère», accusatif mutin, comme en grec S6m~s, accusatif Aétrj-t». En lette, mâte (mahte) «mère» fait au génitif mâtes, au datif mâte, à l’accusatif mâti, au lieu qu’en iiihiianien nous avons motèrs, méterei, mâterm.
cerne la voyelle brève devant le p, concorderaient avec les formes comme axTop-os, éxrop-t, dont le suffixe rop se rapporte comme T>?pau sanscrit târ, forme faible ir, tr. Rappelons encore, comme un exemple unique en son genre, puip-^v-s, éolien (xdp-rvp, dont le suffixe est évidemment de même origine que typ et Top. Uv est donc l’affaiblissement d’un a primitif (§ 7). Pott fait dériver ce mot, et avec raison, à ce que je crois, de la racine sanscrite smar, smr «se souvenir?? (comparez S iA3, 2, note), de sorte que le' témoin serait proprement «celui qui fait souvenir?? ou «qui se souvient?? (memor).
En général, même pour les mots qui n’appartiennent pas aux classes dont nous parlons, toutes les fois qu’un thème finit par un p, le grec conserve cette lettre et sacrifie le signe du nominatif. On peut comparer à cet égard 3-i/jp, xr/p, xe*p aux 110îrji-natifs sanscrits comme dvâr (féminin) «porte??, gîr (féminin) «voix??1, dur (féminin) «timon??, qui ont dû, suivant une loi phonique constante en sanscrit, abandonner le signe casuel (S 9A). Le seul exemple dans toute la famille indo-européenne qui nous montre r final du thème a côté du signe s du nominatif est le mot zend âtars «feu??; on ne peut, .en effet, compter comme exemples les mots latins tels que pars, ars, iners, con-cors, attendu que leur thème ne se termine pas simplement en r, mais en rt, rd, et que la langue a craint en quelque sorte de sacrifier l’expression du rapport casuel en même temps qu’une portion du thème. *Gette circonstance a aussi préservé le signe casuel à la fin du mot pul(t)-s, malgré l’aversion du latin pour le groupe is à la fin d’un mot (S 101).
$ 1A6. Thèmes en s, en sanscyit et en grec.
Les thèmes masculins et féminins en as allongent Va en
1 Ait lieu de git; de môme dur au lieu de dur ; voyez § 73R de l’Abrégé de la Grammaire sanscrite.
sanscrit au nominatif singulier. Ce sont, en général, abstraction faite du dialecte védique, des composés dont le dernier membre est un substantif neutre en as, comme, par exemple, dür-manas «qui a un mauvais esprit » (de dus, devant les lettres sonores dur, et mânas « esprit »), dont le nominatif masculin et féminin est dürmanâs, lë neutre dûrmanas. Le grec présente ici avec le sanscrit un accord remarquable : nous avons, en effet, en grec, Svcrpsvtfs (ô, rj) qui fait au neutre rb Il y a toutefois
cette différence que le ^ s de dürmanâs appartient indubitablement au thème, et que le caractère du nominatif manque (§ 9 A); au contraire, en grec, le s de <$tto-pevrfs a l’apparence d’une flexion, parce que le génitif et les autres cas ne sont pas «Wpe-vécr-os, etc. comme en sanscrit dürmanas-as, mais «W/aer/os* etc. • Mais si l’on tient compte de ce qui a été dit § î 28, à savoir que le s de fiévos appartient au thème et que fxévsos est pour fxévsu-05, on pourra aussi admettre que le s de Sv<jys.svtfs et de tous les adjectifs de même sorte appartient au thème, et que Svcrfievéos est pour SverfÀevéaos. Ou bien donc le s du nominatif appartient au thème, et l’accord avec dürmanâs est complet, ou le s du thème est tombé devant le ? signe casuel, d’après le même principe qui fait qu’une dentale finale est supprimée devant le signe du nominatif, parce quelle ne peut exister à côté de lui (IpfiLï-s, 'zxaï-s). Cette. dernière hypothèse me paraît la
plus vraisemblable, parce que le grec, s’écartant en cela du sanscrit, cherche à conserver autant que possible dans les masculins et les féminins la sifflante du nominatif. Au neutre, au contraire, lequel n’a pas droit à cette sifflante, le s de $u<r(ievés fait tout aussi .certainement partie du thème que celui de (xévos (S 128). Npus pouvons 'donc, en nous bornant aux mots grecs, regarder l’allongement de la voyelle, au nominatif masculin et féminin <Wjueio/-s, comme une compensation pour la suppression de la consonne finale du thème, ainsi que ceta a lieu pour
NOMINATIF SINGULIER, § 146. pAa-s, t«Aâ-s, de pteXav, TfltXair, de même lai de alScS-s, dus, des thèmes aiSôs, v6$.
g *
Ge dernier mot a évidemment perdu un cr qui se trouvait entre la racine et le suffixe (comparez wôs, venant de w<r6s> en latin mrus, en sanscrit musa)-, il correspond, en éffet, au thème védique usas « aurore »1, qui est également du féminin ; la forme éolienne aüws a conservé Vu de la forme sanscrite, mais en la frappant du gouna, comme cela a eu lieu aussi pour aurora et le lithuanien ausra (védique usra «aube»). A la contraction védique de l’accusatif singulier usasam en usa'm et de l’accusatif pluriel usdsas en usas on peut comparer les formes éoliennes comme Sva-fiévnjv, pour Svcrftevéa^SvapevéGafv) 9 sanscrit dürmanasam (Ahrens, De dialectts, I, p. ii3). On peut encore rapprocher à cet égard de la seconde partie d sûpwéÇriv le latin nubem, si l’explication que j’ai donnée plus haut (§ 187)
de cette classe de mots est fondée.
Il y a un certain accord entre la déclinaison de aiSés et rjas et celle de îfp&fs; mais le thème de ce dernier mot se termine en j>, et non pas en s; nous avons conservé ce v dans le dialecte syracusain (ifpctwa?, vipoSv&Ttrt, voyez Ahrens, Ibid. II, p. 2Ai). Il faut donc rapprocher tfpw-s, comme âXœ-s, rav-s, *ru(pw-s, quant à la formation du nominatif, de ra'Aâ-s, (xéXü-s (§i39,i); il y a cette différence seulement que dans les premières de ces formes la voyelle de la syllabe finale du thème est longue par elle-même, tandis que dans toéXs-s, fxéXâ-s elle devient longue, pour compenser la suppression du v.
1 Voyez SS ia8 et 26, a. Comme 3^ viâ$ signifie originairement « la brillante», ïe mot grec tfîôs se prête aussi au sens de «jour» ( voyez Ahrens, De grœcœ linguœ dialectts, I, p. 36, et dans le Journal de Kuhn, III, p. iis). Une preuve que le thème du mpt a un s, et que le génitif vous est pour voaos = sanscrit mâsas, c’est le composé èaapàpos (comparez S 198). On ne saurait expliquer ce a comme tenant la place d’un t, ainsi que cela a lieu dans ptoapopos : la parente indubitable de >î«&s avec ttêâs s’y oppose.
g ! 4y, i. Thèmes en s, en latin. — Changement «le 5 en r.
Comme le latin, d’accord sur ce point avec le grec, conserve au nominatif masculin et féminin le signe casuel de préférence à la consonne finale du thème, il est très-vraisemblable que c’est aussi le s du nominatif qui a été conservé dans mas, Jlos, ros (sanscrit râsa-s «suc?’, grec <$p<5<70 s), môs, arhos, mus, tel-lûs, Venus, lepus, Cerês (§ 1^7), cims (§ 9^^)’ autres formes semblables; la consonne finale du theme a dû disparaître, dans cette hypothèse, au nominatif, mais elle reparaît aux cas obliques sous la forme d’un r (lequel tient la plupart du temps, sinon toujours, la place d’un ancien 5). Au contraire, dans les neutres comme ôs (sanscrit âsyà-m «bouche??), pecus, fœdus, genus~yé-vos, yév£(<r)-o$, gravius (sanscrit gârîyas, thème des cas faibles et nominatif-accusatif neutre), majus (sanscrit mdhîyas), le s appartient au thème, car le neutre n’a pas de s pour signe casuel (S 15a); c’est ce s du thème qui se change en r aux cas obliques. Il ne faut donc pas, si l’on admet la distinction que nous venons de faire entre les thèmes masculins et féminins, d’une part, et les neutres, de l’autre, dire que le latin mûs et le grec (jlv$ (génitif fiv-és, venant de fxva-ès) sont complètement identiques avec le vieux haut-allemand mûs (thème mûsi, S 76); en effet, le s du mot germanique appartient indubitablement au thème. Au contraire, dans les composés latins mus-cipula, mus-carda, ef dans le dérivé mus-culus, comme dans jhs-culus, mas-culus, le s du thème s’est conservé grâce au c qui suivait.
Dans un grand nombre de thèmes latins, terminés par un r tenant lieu d’un s primitif, la puissance de l’analogie a eu pour effet d’introduire r au nominatif, quoiqu’il n y eût pas pour ce cas la même raison que pour les cas obliques de changer s en r, puisqu’il ne s’y trouve pas entre deux voyelles. Il est arrivé
alors que ces thèmes ont perdu le signe du nominatif comme les thèmes véritablement terminés en r (pater, datôr, S iù5). A cette classe appartiennent notamment les abstraits comme pudor, amor (S 93a), lesquels toutefois n’ont pas entièrement perdu leur nominatif pourvu du signe casuel, car à côté de labor existe aussi labâ-s, qu’on peut rapprocher, à la différence du genre près, du grec aliés; de même, à côté de clamor, la forme archaïque chmô-s.
Parmi les mots cités plus haut, il y en a un où le r des cas obliques peut sembler organique et non sorti d’un s; c’est mâ-$, mér-is, que je faisais autrefois dériver de la racine smar, smr kse souvenir». Mais, comme ce serait le seul mot ayant un r primitif avec s comme signe du nominatif, je préfère maintenant regarder le r comme tenant la place d’un s, et je fais venir mô-s de la racine mâ « mesurer », qui a donné aussi, en abrégeant la voyelle, mô-dm. Mo~s, en tant que signifiant «loi, règle», est l’équivalent, quant au sens, de l’ancien perse fra-mânâ, qui signifie, d’après Rawlinson, «loi», principalement «loi divine» (en sanscrit pm-mâm-m «autorisé»). Le persan fermân «ordre» (fermâjem «je commande») est de la même famille; la racine mâ en composition avec la préposition fra a sans doute eu aussi en ancien perse le sens de «commander», comme cela ressort du nom d’agent framâtôr «commandant, souverain». Parmi les adjectifs latins, le s final de vêtus pourrait, au moins au neutre, faire douter s’il fait partie du thème (veter-is, venant de vetisis, e à cause de r), ou si le signe casuel du masculin et du féminin s’est étendu par abus au neutre. Ce qui est certain, c’est, que vêtus est identique, quant à son origine, avec h.os, Féros, Fhe(a)-o$, et signifiait, par conséquent, dans le principe «année» On pourrait donc rapprocher vêtus
■ i * ’ 249
au masculin et au féminin des formes grecques comme rptenf-s, et au neutre des formes comme Tpterés.
C’est ici le lieu de rappeler que le latin a aussi dans sa conjugaison une forme avec s final, où l’on peut douter si ce s appartient au thème ou à la flexion : c’est la forme es « tu es », de la racine es, que nous voyons dans es-t, es-tis, er-am, er-r (venant de es-am, es-o). Le fait en question nest pas sans analogie avec ce que nous avons vu pour Cerê-s (au lieu de Ceres-s), génitif Cerer-is, avec cette différence que dans Cerê-s le dernier e a été allongé pour compenser la suppression de la consonne. On peut admettre que le s de es «tu es» appartient a la désinence personnelle et non à la racine., d’autant plus que le latin a l’habitude de marquer partout par une désinence la seconde personne du singulier, excepté à l’impératif, il en est de même pour le gothique i-s «tu es??, où le s appartient a la désinence personnelle, et non, comme le s de la 3° personne (*$-t), à la racine; en effet, le gothique ne laisse jamais disparaître la désinence personnelle s au présent (nous ne parlons pas des prétérits ayant la signification du présent). 11 faut donc expliquer is comme venant de ts-s, mais avec suppression du premier s et non pas du second, de même que, dans le sanscrit dsi «tu es » (pour ds-si, dorien êcr-ari ), c’est le premier, et non le seconds, qui a été supprimé.
S 1/17, 2. Suppression d’un s au nominatif dans le thème ‘
lithuanien mènes,
Nous passons au lithuanien pour faire remarquer que le thème mènes «lune»-et «mois»249 supprime le s au nominatif singulier et élargit la voyelle précédente en ü; on a donc mênii,
pond-au sanscrit vatsaras «année», les deux premiers à vatsâ-8 (même sens). Voyez mon mémoire Sur l'albanais, p. 9 et suiv= etp. 83, n. 56.
*J Mènes = sanscrit mâs, qui a probablement fait d’abord en lithuanien mëns,
en analogie avec les formes comme akmü «pierre» (venant de akmèn, S i4o), et sesü «sœur» (venant de sesèr7 § iA4). Dans les cas obliques, le thème mènes s’élargit ordinairement par l addition d’un complément monosyllabique ia, ou simplement d’un i. Ainsi, l’on a au génitif mênesiô et à l’instrumental singulier ménesi-mi.
S i48. Nominatif des thèmes neutres. — Tableau comparatif
du nominatif.
Le nominatif des thèmes neutres est identique avec l’accusatif dans toute la famille indo-européenne (S 162 et suiv.) L
Avant de présenter une vue générale de la formation du nominatif, il convient de faire connaître les thèmes qui nous serviront d’exemples. Nous avons choisi des thèmes qui diffèrent entre eux, les uns par le genre, les autres par la lettre finale. Autant qu’il sera possible? nous conserverons les mêmes exemples pour les autres cas.
Thèmes sanscrits et zends :
Sanscrit.
àsva (masculin) «cheval»;
ko (masculin) «qui?»;
(ÇPif dana (neutre) «don» ;
ta (neutre) «ceci» ;
^RfT âévâ (féminin) «jument » ; M (féminin) «qui?»;
, * Zend.
aspa (masculin) «cheval» (§ 5o);
«9 ha (masculin) «qui?»; jtpMO) dâta (neutre) «datum»; ta (neutre) «ceci»; **»>>£*$)» kisvâ (fém.) «langue»; kâ (fém) «qui?»;
et, par l’insertion d'un e, mènes. Comparez le latin mensi-s, le grec pifr, pour (génitif pour p»i>o-ds).
1 L’auteur attend, pour traiter des thèmes neutres, gu il soit arrive a 1 accusatif, parce qu’il admet que le signe du neutre est originairement identique avec celui de l'accusatif (S t 5a). — Tr.
Sanscrit.
ïrfTr pâti (maso.) ffmaître, mari»;
prîti (fém.) « amour, joie» ;
^Ttt vari (neutre) «eau»;
Bâvantî (féminin) «celle qui est»;
33 $ûm (masculin) « fils » ;
13 faim (féminin) nos maxillaire» ; *3 mâdu (neutre) «miel, vin»;
vadu (féminin) «femme»;
«t go (masculin, féminin) ff taureau, vache»; nâu (féminin) «vaisseau»;
^7^vâc (féminin) «discours»;
Mrant (masc.), forme faible Bârat (S 129) «portant, soutenant», de 3TJÇ bar, H Br ( ire classe) ;
(masculin) «pierre»1 ; •1 naman «nom»; wnç Bratar (masculin) «frère»; 3tî*nç duhitdr (féminin) «fille»; ^IcfHÇ dâtar (masculin) «donateur»
(S 127);
c|t| ^ vâcas (neutre ) « discours ». 250 251 252 253
Zend.
jpjMg paiti (masc.) «maître»
(S 4i)ï
âfrîti (féminin) «bénédiction » ;
%
J)* ai [9 vairi ( neutre ) « eau » ; ^^»j^iiiAi»Aij bavaintî (fém.) «celle qui est » ;
>DA>gl paéu (masculin) «animal apprivoisé»;
>|iiço tanu ( féminin) « corps » ; ><S*6 mad'u (neutre) «vin»;
gau (masc. fém.) «taureau, vache» (S 128);
vâc ( fém. ) ff discours » ; bavant ou ba-
rënt, forme faible baral (masc.) «portant»;
asman ( masc. ) « ciel » ; nâman (neutre) «nom» ; brâtqir (masc.) «frère»; dugdar (fém.) «fille»; dâtar (masculin) «donateur, créateur»; vacas (neut.) «parole»*.
3/13
Les exemples grecs et latins n’ont pas besoin d’être mentionnés ici. En lithuanien et en gothique, nous choisissons les thèmes suivants :
Thèmes lithuaniens et gothiques.
Lithuanien.
pona (masculin) maître» ; ka (masculin) «qui?» ; géra (neutre) rrbon»;
ta (neutre) «ceci » ; aêwa (féminin) rrjument» ;
genti (masculin) rrparent»;
awi (féminin) «mouton» (sanscrit avij latin ovis, grec 6is); sünu (masculin) «fils»;
• * • «*•••••«•••••■•*# * * * * « plaiu(neutre) <rlarge» (sanscritprié, grec otAocté);
Gothique.
mlfa (masculin) rrïoup»; hva (masculin) crqui?» ; daura (neutre) cr porte» (sanscrit dvara, neutre); ïha (neutre) trie, ceci»; gîbo (féminin) trdon» (§ 69); hvo (féminin) «■ laquelle?» ; gasti (masculin) » étranger»; i (masculin et neutre) rriiic, hoc»; amti ( féminin ) «■ faveur » ;
sum (masculin) frfils » ; kandu (féminin) ffmain»; fathu (neutre) » fortune»;
pourtant devoir conserver au thème la forme en as, attendu qu’un thème vaco n’aurait jamais pu donner aux cas obliques des formes comme vacanha, vacanho. Je fais observer à ce propos qu’en sanscrit on ne trouverait pas non plus de thème vâcas, si l’on voulait, dans tes tables qu’on dresse des thèmes, se conformer aux lois phoniques; en effet, un ^ s final ne reste invariable que devant un t, t initiai; devant une pause il se change en visarga (î h). Mais puisque nous négligeons les lois phoniques en citant les thèmes sanscrits, nous pouvons en faire autant pour le zend. Brockhaus, dans son Glossaire du Vendidad-Sadé, termine par çyi nh les thèmes qui en sanscrit finissent par as; mais cette forme me paraît employée à tort, car le s sanscrit ne se change en nh qu’entre deux voyelles, et non pas à la fin des mots. Encore dans certains cas trouve-t-on simplement un h, comme quand la seconde voyelle est un i, par exemple, vacahi et non vacanhi (S 56a). La forme qui rend le mieux corripte de ces diverses modifications est vacas, dont le » $ est d’ailleurs le représentant régulier du s sanscrit; on trouve, en effet, les formes comme vacas non-seulement devant la particule en. mais encore devant les enclitiques t4 et iwd (§ i 35, remarque 3). .
Lithuanien. Gothique.
dugant1 (masculin) « grandissant»; fijand (masculin) rr ennemi * ; akmen (masculin) rr pierre»; ahman (masculin) r esprit a;
.......................... naman (neutre) «nom»;
.......................... brothar ( mascul in ) w frère » ;
duktèr (féminin) r fille ». dauhtar (féminin) rr fille».
Nous faisons suivre le tableau comparatif du nominatif254 255 :
|
Sanscrit. |
Zend. |
Grec. |
Latin. |
Lithuanien. |
Gothique. |
|
masculin, àsvas |
aspo256 |
ÏTÏ7TO-S |
equus |
pona-s |
vulf’s257 |
|
masculin, ka-s |
kâ |
. ÎCOrS |
hvür-8 | ||
|
neutre.. . ddna-m |
dâtê-m |
hâpo-v |
donu-rn |
géra |
daur* |
|
neutre.. . ta-t |
ta-d |
rà |
is-tu-d |
ta-i |
tha-ta |
|
féminin.. dsvâ |
hisva * |
Xfipà, |
equa |
âswa |
giba |
|
féminin.. kâ |
kâ | ||||
|
masculin, pâtis |
paiti-s |
tsôcfi-s |
hosti-s |
gentls |
ga&t’-s |
|
masculin ....... |
i-s |
i-s | |||
|
féminin.. prî'ti-s |
âfrîtis |
'ESÔpTlS |
turris |
anst’-s | |
|
neutre... van |
vain |
mare | |||
|
neutre....... |
. i-d |
i-ta | |||
|
féminin Umtninti |
hfmmnti |
n? |
. V. 8 îaî. | ||
|
féminin.. sûnûs |
pasu-s |
véxvs |
pecu-s |
sûnk-s . |
sunu-s |
|
féminin. . hdnu-s m |
tanu-s |
yêvv-s |
socru-s |
• • « a ■ * * |
handu-s |
|
. Sanscrit. neutre... mâdu féminin.. vad'iï-s , |
Zend, madu |
Grec. (iéfiv |
Latin, jvécu |
Lithuanien. platù |
Gothique. faihu |
|
mas.-fém. gâu-s1 |
gau-s2 |
fiov-s |
bâ-s | ||
|
féminin., nâu-s |
. VOLVS | ||||
|
féminin.. vâk |
véJc-s |
Ôtt-s | |||
|
masculin. tiâran |
baraii-s |
0épcov |
fer en-s |
âugân-s |
fjand-s |
|
masculin, dsmâ |
aéma |
batfKûv |
sermo |
akmiï |
ahma |
|
neutre... nama |
nârria |
TâXav |
nomen. |
namô | |
|
masculin, bratâ |
brâta |
'Gfarrfp |
fréter |
brôthar | |
|
féminin., duhita |
dugdu |
Q-vyàvïjp |
mater |
dukte |
dauhtar |
|
masculin, data |
dâta |
hoTtjp |
dater | ||
|
neutre,. . vécus |
vaco3 |
énos |
genus |
ACCUSATIF.
S i4<). Du signe de I accusatif. —r- L’accusatif dans les langues
germaniques.
. *
Le caractère de 1 accusatif est m en sanscrit, en zend et en latin; en grec et en borussien, il est v, n (§ 18). En lithuanien, nous avons une nasale qui est représentée dans récriture par des signes ajoutés aux voyelles, mais qui, dans'la prononciation actuelle, n’est plus sensible pour l’ouïe (§ 10); ainsi dêwa-n « deum» qui se prononce dewa. Le borussien a la forme deiwa-n, en regard du sanscrit dêvà-m.
En gothique, la terminaison de l’accusatif a disparu dans les substantifs sans laisser de trace; mais, dans les pronoms de la 3e personne, y compris l’article, ainsi que dans les adjectifs forts, c’est-à-dire combinés avec un pronom ( § 987 et suiv.), la terminaison de 1 accusatif s est conservée, en gothique et en haut-
1 Voyez S i aa.
2 Voyez S 1 a3.
3 Avec èa ; vacasca, S i35, remarque 3.
allemand ancien et moderne, mais seulement dans les masculins; le féminin a perdu, même dans ces classes de mots, le signe casuel. Le m primitif s’est changé en », auquel est venu se joindre, pour le protéger en quelque sorte (S 18), un a; on a donc le gothique tha-na ën regard du sanscrit ta-m, du borussien sia-n sto-n, du lithuanien ta-n (prononcez ta), du grec ià-v, du latin is-tu-m; au contraire, le féminin est, en gothique, thé, qu’on peut comparer au sanscrit tâ-m, au dorien ?â-v, au borussien stan, sto-n, au lithuanien ta-n (prononcez ta), au latin is-ta-m. Le haut-allemand a perdu la voyelle complémentaire que le gothique avait ajoutée à la désinence de l’accusatif; mais on ne peut guère douter qu’il ne l’ait eue dans le principe, autrement la nasale finale aurait très-vraisemblablement été supprimée, comme elle l’est au génitif pluriel et à la iro personne du singulier du subjonctif présent (SS 18 et 92“). Comparez le vieux haut-allemand i-n « eum » avec le gothique i-na et le vieux latin i-m. Le haut-allemand l’emporte suri le gothique en ce qu’il n’a pas laissé périr entièrement le signe de l’accusatif dans les substantifs; il s’est conservé, en vieux et en moyen haut-allemand, dans les noms propres masculins; exemples: vieux haut-allemand hluodowiga-n, hartmuota-n, petrusa-n; moyen haut-allemand sîvride-n, parzifâle-n, jôhannese-n. Même, en haut-allemand moderne, on permet des accusatifs comme Wilhelme-n, Lud-wige-n, quoiqu’ils aient vieilli (voyez Grimm, Grammaire allemande, I, pp. 767, 770, 773). Outre les noms propres, le
■h.
vieux haut-allemand* a conservé le signe casuel n dans les substantifs kot k dieu », truhtin « seigneur », fater « père » et man «homme»; on a, par conséquent, kota-n, truhtina-n, truhtine-n, faterar-n258, manm-n. Il faut remarquer que, à l’exception du dernier, ce sont tous des termes qui doivent être prononcés avec un sentiment de respect, ce qui nous aide à comprendre pourquoi ils ont conservé plus longtemps l’ancienne forme. Au sujet de manna-n, observons que le gothique possède à la fois un thème rnana et un thème élargi maman, qui sert, en même temps, d’accusatif; on pourrait identifier le vieux haut-allemand maman avec ce dernier mot, en sorte que le n final appartiendrait au thème. Quoi qu’il en soit, je ne voudrais pas dire, avec Grimm, que les accusatifs en n des noms propres et des termes qui signaient «dieu», «maître» et «père» appartiennent à la déclinaison des adjectifs, car primitivement les substantifs germaniques avaient une nasale à l’accusatif masculin et féminin (les thèmes en a également au neutre), absolument comme les pronoms et les adjectifs; il n’est donc pas étonnant que les noms propres et certains mots privilégiés aient conservé l’ancienne forme héréditaire.
Il est encore à remarquer qu’en zend les thèmes en ya et en va contractent ces syllabes en î et en û devant le m de l’accusatif (S /ia). Le gothique fait à peu près de même pour les thèmes substantifs en ja, va: des thèmes harja «armée», hairdja «berger», thiva «valet», il forme les accusatifs hari, haircli, thiu (S i35, remarque 2); au contraire, quand la désinence casuelle na est conservée, l’a final du thème subsiste ; exemples : midja-na «medium » (adjectif), qviva-na «vivum », de même qu’en sanscrit mâdJya-m, gîva-m.
S i5o. Accusatif des thèmes terminés par une consonne.
Les thèmes terminés par une consonne placent, en sanscrit, en zend et en latin, devant le signe casuel m, une voyelle de liaison, à savoir a en sanscrit, ë en zend et en latin; exemples ; imïtar-a-m, zend brâtar-ë-m, latin fratr-e-m. Le grec a laissé tomber, après l’a, qui a été ajouté comme voyelle de liaison, le vrai caractère de l’accusatif; comparez, par exemple, (pépovr-a au sanscrit Mrant-a-m, au zend barant-ë-m, au latin ferent-e-m,
S i5i. Accusatif des thèmes monosyllabiques en sanscrit, —
De la désinence latine em.
Les mots monosyllabiques en î, û et au prennent, en sanscrit, am au lieu de m pour désinence de l’accusatif, comme les thèmes terminés par une consonne; de cette façon ils deviennent polysyllabiques. Ainsi M «peur» et nâu «vaisseau» ne font pas ïïî-m, nâur-m, comme on pourrait s’y attendre d’après le grec vav-v, mais Biy-am, nâv-am. Un fait analogue a lieu pour les thèmes grecs en eu, qui, au lieu de eu-r, font e-a, venant de eF-a; exemple : fia<riA^(F)-a au lieu de fiaat'ksv-v.
Mais il ne faudrait pas, comme on l’a fait, regarder en latin em comme la vraie et unique terminaison primitive de l’accusatif, et voir dans lupu-m, hora-mffructu-m, die-m, une contraction pour lupo-em, hora-em, fructu-em, die-em. La nasale suffisait pour marquer l’accusatif, et on la faisait précéder d’une voyelle par nécessité seulement; c’est ce qui ressort de l’histoire de toute la famille indo-européenne, et ce qui pourrait se démontrer même sans le secours du sanscrit et du zend, à l’aide du grec, du lithuanien, du borussien et du gothique. Le em de la 3e déclinaison latine a une double origine : ou bien Ye appartient au thème et tient, comme cela arrive très-souvent', la place d’un i; alors la syllabe e-m, par exemple dans igne-m (sanscrit agni-m), correspond à i-m en sanscrit, î-m en zend, i-t» en grec, i-n en borussien (asti-n «rem»), i-h en lithuanien , i-m (dans ina «lui») en gothique. Ce n’est que par exception que certains mots conservent Yi du thème259 ; exemples : siti-m, tussi-m, Tiberi-m, Albi-m, Hispali-m. Au contraire, l’e qui est a l’accusatif des thèmes ter-
1 Parmi les mots qui sont vraiment d’origine latine, il n’^ a que des féminins qui conservent f*; on a vu- plus haut (SS 119, i-3i) que le féminin affectionne IV.
minés par une consonne correspond à Va sanscrit ; exemple : ped-em ss sanscrit pddr-am, grec î6S-a(v). De même, pour les formes uniques en leur genre: gru-em, su-em (de grû, su), qui concordent parfaitement avec les accusatifs sanscrits comme Büv~am (par euphonie pour Bu-am}, de Bû, nominatif Bûrê « terra ». Le rapport est le même entre le génitif gru-is, su-is, et les génitifs sanscrits comme Buv-ds, C est évidemment parce que les thèmes grû, su sont monosyllabiques, qu’ils ne suivent pas la AG déclinaison *; c’est pour la même raison qu’en sanscrit Bû, Bî, ne se déclinent pas comme vaM, nadi'.
S iÔ2. Accusatif neutre en sanscrit, en grec et en latin. — Nominatif
semblable à l’accusatif.
v *
Les thèmes neutres en a, en sanscrit et en zend, et leurs
congénères en grec, en latin et en Borussien, prennent, comme le masculin et le féminin, une nasale pour signe de l’accusatif; cette terminaison, qui. paraît avoir quelque chose de moins personnel, de moins vivant que le s du nominatif, convenait bien pour le neutre, qui ne s’est pas contenté de l’adopter pour l’accusatif, mais qui l’a introduite en outre dans son nominatif; exemple : sanscrit sâyana-m, zend sayanë-m a couche»; de même, en latin et en grec, donu-m, Sâpo-v, en borussien kawyda-n « quoi ? », billito-n « dictum » 2.
Les thèmes substantifs et adjectifs neutres non terminés par a en sanscrit et en zend, ainsi que leurs congénères dans les autres langues, sauf quelques exceptions en latin, que nous verrons plus loin, restent sans signe casuel au nominatif et à l’accusatif, et présentent à ces deux cas le thème nu. Un i final se 259 change, en latin, en e; nous avons, par exemple, mare au lieu de mari, qui répond au sanscrit vâri «eau». Le grec conserve Yi, ainsique le sanscrit, le zend et le borussien; exemple : fôpt-s, t$pr, de même, en sanscrit, süci-s, suci «pur»; en borussien arwi-s, arwi «vrai». Voici des exemples de thèmes neutres en u qui, en même temps, tiennent lieu de nominatif et daccusatif: en sanscrit mâdu «miel, vin», dsru «larme», svadu «doux»; en zend, vôhu «richesse» (sanscrit msm); en grec, fxéÔv, Sdnpv, en latin, pecû, genû; en gothique, failm «fortune» (primitivement «bétail»), hardu «dur»; en lithuanien, saldu «doux»; en borussien, pecku «bétail». C’est à tort que Vu est long en latin; ce sont probablement les cas obliques, ou \u est long a cause de Ja suppression des flexions casuelles, qui ont amene, par imitation, l’allongement de Yu final du nominatif-accusatif-vocatif. La règle qui veut quün u final soit toujours long en latin trouve généralement son explication dans les faits : ainsi, à l’ablatif, Yu qui, primitivement, était bref, a été allongé à cause de la suppression du d, qui était le signe casuel ; c’est la même raison qui fait que Yô de la 2 e déclinaison devient long a 1 ablatif. Au reste, le datif pluriel ü-bus montre encore clairement que Yu de la à0 déclinaison était primitivement bref.
On a déjà montré (S 128) que le ? des mots grecs comme yévos, fiévos, etjyevés, appartient au thème; il en est de même pour le s des neutres comme gémis, corpus, gravius. Ce s est la forme plus ancienne de r, que nous trouvons aux cas obliques comme gener-w, corpor-is, graviâr-is (§127). *
Je regarde également comme appartenant au thème le s des mots comme rervtyôs, répas. Ce s tient, selon moi, la place d’un ancien t; en effet, ou bien le grec rejette un t final (fxéXi, nrpàytxa), ou bien il le change en s; exemple : tspôs, venant de zsporl, sanscrit prdti259. '
1 La même opinion est exprimée par Hartnng dans son estimable ouvrage Sur les
C’est par une sorte d’aberration de la langue qu’en latin la plupart des thèmes adjectifs terminés par une consonne conservent au neutre le s du masculin et du féminin, comme s’il appartenait au thème; exemples : capac-s, felic-s, soler(i)-&, aman(t)-s. En général, le sentiment du genre est fort émoussé en latin pour les thèmes terminés par une consonne ; nous voyons, en effet, que dans ces thèmes le féminin ne se distingue pas du masculin, contrairement au principe suivi par le sanscrit, le zend, le grec et le gothique.
S i53. Nominatif-accusatif des thèmes neutres, en gothique
et en lithuanien.
Le signe casuel m manque aux substantifs gothiques, aussi bien au neutre qu’au masculin; les thèmes neutres en a sont
cas, p. i5s et suiv. Nous ne pouvons toutefois approuver l’auteur, quand il explique également le p du mot yitctp comme venant d’un t. La forme sanscrite est 9WL yâkrt (venant de yâkart) «foie» (également du neutre); le latin a conservé le son guttural dans^ecur, et le grec a changé le k en comme dans beaucoup d’autres mots. Jecur et «p doivent tous les deux leur r à la forme primitive; quant au r de HitaT-os (pour jjnapr-os), nous le retrouvons aussi dans yâkrt, génitif yâkrt-as, pour yâkart-as.— 11 y a en sanscrit une forme secondaire, yâlcan, qui a donné une deuxième série de cas faibles, tels que le génitif yâkn-as à côté de yàkrt-as. — On peut rapprocher de yâkrt le mot sakrt «fumier», génitif sakrt-as ou êakn-as, dont la racine parait avoir été éak, venant d,e kak (comparez le latin caco, le grec naxxdto,\e lithuanien éikù, l’irlandais cac, cacach, cachaim, seachraith). — De ce que nous venons de dire pour $ïrap, il ne s’ensuit pas que tous les mots analogues, comme Çpéctp, (ppéotr-os, eî&tp, eïèaT-os (voyez Kuhn, Journal, IF, p. iA3) aient eu dans le principe un p et un t à la fin du thème. Il est possible que (Ppéap soit pour Çpéas, qui iui-méme viendrait de <ppé«t, comme xépae de xêpar (§ aa). Pour uyeïpotp nous trouvons, en effet, une forme 'taeTptxs (ainsi que mipas). Dans certains cas, c’est te a qui a pu être la forme la plus ancienne, de sorte que les formes ap,«T-os seraient originairement identiques avec os, s(ct)-o?, et en sanscrit as, as-as (§ ia8). Ainsi «Séotp, Sétnos viendrait de Ssas, 8ea<?os, qui a formé aussi êéos, Séovs (Sés(a)-os). — Il ne faut pas confondre avec ces mots le féminin êdyctp, èdpapzos, qui est unique en son genre, et qui appartient évidemment à un thème «Sapapr; à l’égard de la suppression du t final, comparez le latin cor dont le thème est çord— sanscrit hrd, venant de hard.
donc dénués de flexion au nominatif et à l’accusatif, absolument comme les thèmes terminés par i, par u ou une consonne dans les langues congénères. On a, par exemple, le gothique daur(a) «porte » en regard du sanscrit dvara-m (même sens). Il n’y a pas en gothique de thèmes neutres en i, excepté le thème numéral thri (§ 3io) et le thème pronominal i (§ 36a). Mais les substantifs en ja prennent l’apparence de thèmes en i, par la suppression de 19a au nominatif et à l’accusatif singuliers (comparez S 135); exemple : reikja «empire» (sanscrit râgya, également du neutre), nominatif et accusatif reiki (en sanscrit rdgya-m). L’absence de thèmes neutres en i dans les langues germaniques n’a rien qui doive nous étonner; en sanscrit, en zend et en grec, les thèmes neutres terminés par cette voyelle sont également assez rares.
En lithuanien, le neutre a tout à fait disparu pour les substantifs; il n’a laissé de trace que parmi les pronoms et parmi les adjectifs, quand ces derniers se rapportent à des pronoms. Les thèmes adjectifs en u sont alors dépourvus, en lithuanien comme dans les langues congénères, de signe casuel au nominatif-accusatif singulier : ainsi darku «laid» est le nominatif-accusatif neutre de l’adjectif, qui fait au nominatif masculin darkù-s, à l’accusatif masculin darku-h. Mais il en est de même en lithuanien pour les thèmes adjectifs en a, de sorte que nous avons, par exemple, géra «bonum» comme nominatif-accusatif de l’adjectif, qui fait au nominatif masculin géras et à l’accusatif masculin géra-n.
§ i5k. Les thèmes neutres en i et en u avaient-ils primitivement un m au nominatif et à l’accusatif ?
On peut se demander si le m qui sert de signe au nominatif et à l’accusatif neutres1 était borné dans le principe aux thèmes
1 En sanscrit et en zend, le m est exclu du vocatif.
# en a, ou s’il ne s’ajoutait pas aussi aux thèmes en i et en u> de sorte qu’on aurait eu primitivement, au lieu de vâri, une forme vari-m, au lieu de màdu, une forme mâdu-m. Je suis loin de croire que des formes pareilles n’aient pu exister dans le principe: car pourquoi les thèmes en a auraient-ils seuls eu le privilège de distinguer le nominatif et l’accusatif neutres par un signe marquant la relation ou la personnalité? Je suppose que les thèmes en a ont plus fidèlement maintenu leur terminaison que les autres, parce que, étant de beaucoup les plus nombreux, ils devaient plus aisément résister à l’action du temps; c’est pour une cause analogue que le verbe substantif a conservé des formes plus archaïques que les autres verbes, et que, par exemple, dans les langues germaniques il est le seul verbe qui ait retenu la nasale à la ire personne : bi-n, vieux haut-allemand hi-m, sanscrit Mvâ~mL Nous avons encore en sanscrit un exemple unique de m ajouté comme signe du nominatif à un thème en i : c’est la déclinaison pronominale, toujours plus archaïque que celle des noms, qui nous fournit cet exemple. Nous voulons parler de la forme interrogative ki-m «quoi?» du thème M. Le même thème a, sans doute, produit aussi en sanscrit un neutre ki-t, qui s’est conservé dans le latin qui-d, et que je reconnais aussi dans l’enclitique sanscrite cit, forme amollie pour ki-t. La déclinaison pronominale n’a pas d’autre thème neutre en * ou en u, car amü aille» substitue adâs «illud» et i «hic» se combine avec dam (idâm «hoc»). Elle ne fournit pas non plus d’éclaircissement sur le nominatif et l’accusatif neutres des thèmes finissant par une consonne, tous les thèmes pronominaux étant terminés par une voyëile (ordinairement par a).
S 155. Le signe du neutre dans la déclinaison pronominale.
Les thèmes pronominaux en a prennent en sanscrit t} en zend y d comme flexion du nominatif et de l’accusatif neutres. Le
i.
23
gothique, de même qu’à l’accusatif masculin il prend na au lieu de m ou n, prend au neutre ta au lieu de t; il transporte cette particularité de la déclinaison pronominale, ainsi que plusieurs autres, dans la déclinaison des thèmes adjectifs en a, et les autres dialectes germaniques font sur ce point comme le gothique. Nous avons, par exemple, le neutre gothique blinda-ta k cæcum », midja-ta «medium»1. Le haut-allemand a dans sa période ancienne % au lieu du t gothique (§87), dans sa période moderne Le thème pronominal^ (pins tard e) suit en germanique, comme en latin,l’analogie des anciens pronoms en a260 261. Le grec a sacrifié toutes les dentales finales (S 86, 9); la différence entre la déclinaison pronominale et la déclinaison ordinaire des thèmes en 0 consiste donc simplement ici dans l’absence de la flexion; mais c’est cette différence, ainsi que le témoignage des langues congénères, qui nous montre que, par exemple, tô a dû être primitivement tôt ou to^, car s’il y avait eu toi>, il serait resté invariable comme l’accusatif masculin. Peut-être avons-nous un reste d’une flexion neutre dans le premier t de Mt, de sorte qu’il faudrait partager le mot ainsi : 6r-h; le double t serait alors parfaitement motivé. Il ne serait pas plus nécessaire de l’expliquer par des raisons métriques qu’il n’est besoin d’invoquer cès raisons pour le double g de formes comme bpsG-Gt (S198)262.
S i56. Origine des désinences t et m du neutre.
L’origine du signe casuel t pour le neutre est, à ce que nous croyons, le thème pronominal <T ta «il, celui-ci» (grec to, gothique tha, etc.). Il y a, en effet, à l’égard du thème, la
même opposition entre ia-t «hoc» et les formes masculine et féminine m, sa, scî «hic, hæc», qu’entre le t, signe casuel du neutre, et le s, signe casuel du nominatif des noms masculins et féminins (§ i34). Je ne doute pas que le m de 1 accusatif, que les neutres mettent aussi au nominatif, ne soit également d’origine pronominale. Il est remarquable que les thèmes pronominaux composés i-mâ «hic, hoc» et a-mû «ille, illud» (féminin imâ, «md) ne s’emploient pas plus que ta, ta, au nominatif masculin et féminin; au thème amü, le s’anscrit substitue au nominatif masculin-féminin la forme asau, ou nous retrouvons un s. 11 y a entre ce s et le m de amû-ni «ilium», amu-sya «illius» (et, en général, de tous les cas obliques), le même rapport que nous trouvons dans les désinences casuelles entre le s du nominatif masculin-féminin et le m, signe casuel de l’accusatif et du nominatif-accusatif neutre. En zend, nous avons la même opposition : si y-ugj imad «hoc» est la forme du neutre, celle du masculin n’est pas imo «hic», mais aêm (répondant à WQffl ayant, § à 2 ) et ^ îm (répondant à %^^tyâm) «hæc». En grec, on peut rapprocher le thème pronominal fit, qui ne s’emploie qu’à l’accusatif, et qui, à l’égard de la voyelle, est dans le même rapport avec ma (du theme compose ^ i~ma) que ki-m «quoi?» avec ^^ka-s «qui?». En gothique, la désinence neutre ta répond, suivant les lois de substitution (§ 86), au d latin (id, istud):; or, ce d me parait un affaiblissement d’un ancien t, comme, par exemple, le b de ab est sorti du p de dpa, chr6, et le d de l’ancien ablatif latin (S 181) du t
sanscrit.
§ 167. Le neutre pronominal tai en lithuanien. — Tableau comparatif
de l’accusatif.
Au neutre sanscrit ta~t, zend ta-d, gothique tha-ta, grec to , correspond en lithuanien la forme tai «hoc». Je crois reconnaître clans ce son i une ancienne dentale qui s’est fondue avec Va, de la même'façon qu’en ossète la voyelle i tient lieu d’un t ou d’un s (S 87, 1). Il y a aussi en lithuanien des formes où F/ tient la place dun ancien s; ainsi à la 3 e personne du singulier de l’aoriste, ai répond au sanscrit as. Exemple : sukal s tu tournas », qui nous représente un aoriste sanscrit comme âbutfas tu connus ». Nous reviendrons plus tard sur ce point : rappelons seulement ici que dans une langue qui n’appartient pas à la famille indo-européenne, en tibétain, on écrit, par exemple, las et Fon prononce lai263.
Le borussien a laissé disparaître complètement la dentale des neutres pronominaux; exemples : sta tthoc», ka «quid?»; ce dernier mot répond au védique SfRT kat, au zend g*} kad.
Nous faisons suivre le tableau comparatif de l’accusatif. Les exemples cités sont les mêmes qu’au § 1A8.
|
Sanscrit. |
Zend. |
Grec. |
Latin. |
Lithuanien. |
Gothique |
|
masculin. âéva-m |
aépë-m |
ÏTTJTO-V |
equu-m |
pona-ii |
Vüif |
|
masculin, ka-m |
kë-m |
ka-h |
hva-na | ||
|
neutre.. . dana-m |
dâtë-m |
S &po-v |
donu-m |
géra |
daur’ |
|
neutre.. . la-t |
ta-d |
TÔ |
is-tu-d |
ta-i |
tha-ta |
|
féminin.. as'vâ-m |
Msva-iim » |
X^pà-V |
equa-m |
dsvca-h |
giha |
|
féminin.. ka-m |
ka-nm |
hvô% | |||
|
masculin, pâli-m masculin........ |
paitî-m |
<zs6<ti-v |
hoste-m i-m tuwi—m |
genü-n |
gasf i-na anst’ |
|
féminin.. prili-m |
âfrîtî-m |
'srépr t-v |
âwi-h |
1 Bœhtlingk, Mémoire sur la grammaire russe, dans le Bulletin hist. philol. de l’Académie de Saint-Pétersbourg, t. VIII.
s On devrait avoir hvô~na, ou, avec abréviation du thème, hva-na, ce qui est la forme du masculin. Au sujet de la perte de la désinence casuelle, il faut remarquer qu’en général les féminins conservent moins bien les anciennes flexions (comparez § i36). Ainsi le sanscrit a déjà, au nominatif, kâ, au lieu de kâ-s (S 137); le gothique , poussant plus loin cette suppression des désinences féminines, retranche la terminaison de l’accusatif.
|
Sanscrit. |
Zciul. |
Grec. |
Latin. |
Lithuanien. Gothique. |
|
neutre... vàri |
vairi |
mare | ||
|
neutre.......... |
i-d |
.......i-ta | ||
|
féminin.. bâvantî-m |
bavaintî-m | |||
|
masculin, sûnû-m |
pasu-m |
vénv-v |
pccu-m |
sum-n mm |
|
féminin.. hdnu-m |
tanû~m |
yévv-v |
socru-m |
« > . ■ 1 » 0 hcttidti |
|
neutre.. . màdu |
madu |
pédv |
pecû |
platu faihu |
|
féminin.. vadû-m |
, | |||
|
mas.-fém. gà-jgÀ>;-f féminin.. îict&-am |
ga-nm |
jSoS-v VOLV-V |
bov-em | |
|
féminin.. var'-nm. |
vôc-em | |||
|
masculin, bârant-am barënt-ëm Çépovr-a |
ferent-em | |||
|
masculin, dsmân-am |
asman-ëm |
haip.ov-oL |
sermân-em | |
|
neutre... ndma |
nâma |
râXav |
nômen | |
|
masculin. bratar-am |
brâtar-ëm |
Tsavép-a, |
frâtr-em |
.......brothar |
|
féminin.. duhitdr-am |
dugdhr-ëm Q-uyarép-ct mâtr-em | |||
|
masculin, dâtar-am |
J A. A ü datar-em |
hôTtfp-et |
dator-em |
1 t ■ • 1 • 1 » « » 1 « « * |
|
neutre... vàcas |
M 2 vaco |
bvos |
genus | |
INSTRUMENTAL.
$ i58. L’instrumental en zend et en sanscrit.
L’instrumental est marqué en sanscrit par â; cette flexion est, comme je le crois, un allongement du thème pronominal a, et elle est identique avec la préposition â s vers, jusqu’à», sortie du même pronom. En zend, au lieu de â nous avons ordinairement un â bref pour désinence de l’instrumental^, même dans les mots dont le thème se termine par a, de sorte qu’il n’y a pas de différence entre l’instrumental et la forme fondamentale ; exemples : sama « avec volonté »,
asauèü «sans volonté», skyautna «aetione», ami 263
FORMATION DES CAS.
*
«par lui??, paiti-bërëta «allevalo??. Ce n’est que dans
les thèmes monosyllabiques en « a qu'on trouve à l’instrumental un «long; exemple : qâ «proprio??, venant du thème
ja (sanscrit ^fsva, § 35). En sanscrit, quand le thème est terminé par une voyelle brève, on insère devant Yâ de l’instrumental un n euphonique263; si le thème est terminé par a, cette voyelle est changée à l'instrumentai, comme à plusieurs autres cas, en TJ ê, et Yâ de la désinence casuelle est alors abrégé, probablement à cause de cette surcharge du radical; exemples : dsvê-n-a, agni-n-â, vâri-n-â (§\ 17 L), sûnü-n-â, mâdu-n-â, de diva, agnif etc. Les Védas nous présentent encore des restes de formations sans le secours d’un n euphonique, comme, par exemple, mahitvâ, pour mahitva-â, de mahitvâ «grandeur??; ma-hitvanâ, de makitvanâ (même sens); vrêatva, de vrsatvd «pluie??; svdpnay-â (formé de svapnê-â, § 143, 9), de svdpna «sommeil??; uru-y-â, pour urà-n-â, de uru «grand??, avec ^y euphonique (S 43); prabâhav-â? deprabâhn, venant de bâhû «bras??, avec la préposition prci; mâdb-â, de mddu (neutre) «miel??. On trouve encore dans la langue ordinaire les analogues des formes comme svâpnayâ : ainsi mdyâ «par moi??, tvàyâ «par toi??, des thèmes ma et tva, dont Y a se change dans ce cas, comme au locatif, en ê. Pâti (masculin) «maître?? et sdUi (masculin) «ami?? sont encore deux exemples de mots de la langue ordinaire formant leur instrumental sans le secours de n : ils font pâty-â, saMy-â 2. Les féminins ne prennent jamais le n euphonique; mais d se change en ê, comme devant plusieurs autres désinences commençant par une voyelle, en d’autres termes, Yâ s’abrége et se combine avec un t (3 i43, 9); exemple : dsvay-â (pour divê + â}. Le zend suit à cet égard l’analogie du sanscrit. 264
S 159. De quelques formes d’instrumental en gothique.
Gomme i a sanscrit est représenté en gothique par ê aussi bien que par o (S 69, â), les fornies thê, hvê, du thème démonstratif tha et dit thème interrogatif fwa, correspondent .parfaitement aux instrumentaux zends et védiques, tels que m^qâ, du thème et ^|T tvâ «par toi». Il faut ajouter à ces
formes gothiques, que Grimm avait déjà reconnues comme des instrumentaux, la forme svê, venant de sva, qui répond exactement au zerid Le sens de svê est «comme» (<w$), et la
formeso, qui, en haut-allemand, est dérivée de sva ou svê, signifie à la fois « comme » et « ainsi ». Or les relations casuelles exprimées par «comme» et «ainsi» sont de vrais instrumentaux2. La forme anglo-saxonne pour svê est svâ, et se rapproche encore plus du zend Le gothique sva «ainsi» est simplement
une forme abrégée de svê, puisque Va est la brève de Yê aussi bien que de lo; mais par cette abréviation sva est devenu identique avec la forme fondamentale, de la même façon que, par exemple, 1 instrumental zénd .»{* ana ne peut pas être distingué de son thème (8 i58).
S i6o. L’instrumental en vieux haut-allemand.
Au gothique thê-et hvê répondent, abstraction faite du thème, les formes du vieux haut-allemand diu, hwiu3. 11 s’est conservé
1 La forme zende et la forme germanique se correspondent même pour l’étymologie; voyez S 35. Les conjectures.de Grimm sur les formes «va et svê (III, p. /i3) me paraissent peu fondées; il est impossible d’expliquer ces mots sans le secours du sanscrit et du zend. Nous y reviendrons en parlant des pronoms.
2 «Gomment» équivaut à «par quel moyen», et «ainsi» signifie «par ce moyen». Au lieu de sô on trouve aussi suo = swô. La forme usitée en haut-allemand moderne est sô.
3 Peut-être fout-il prononcer dju, hmju (S 86, U). Le-thème du premier répond au sanscrit r^T tya (§ 355), qui ferait à l'instrumenta! c37 tya d’après le principe védique et zend. Sur le thème de hwiu (hum ), voyez S 388.
360
fit
I?
ftl
formation des cas.
aussi d’un thème démonstratif lu la forme d’instrumental Ai» , dans le composé hiutu, pour hiu-tagu 265 «à ce jour, aujourd’hui w, en haut-allemand moderne heute, quoique, daprès la signification, nous ayons plutôt ici un locatif. Le gothique emploie le datif, himma-daga (S 3 96). ^
Cette désinence u s’est conservée aussi avec des thèmes substantifs et adjectifs masculins et neutres en a et en i;les exemples, il est vrai, sont peu nombreux; ordinairement les mots ains. terminés sont précédés de la préposition mit «avec»; exemples: mit eidu «cum jurejurando», mit wortu «cum verbo», mit euatu « cum bono », mit kasfr-u « cum hospite », des thèmes eida, worta, ouata, kasti. Il faut observer à ce propos que très-fréquemment en sanscrit l’instrumental, soit construit avec la préposition safa «avec», soit, plus souvent, employé seul, sert à marquer le
rapport d’association.
Il y a une différence entre les formes comme kast-u (pour kasti-u ou teü'-u2) et les formes comme wortu; c’est que, dans les premières, l’u appartient uniquement à la désinence, et représente la sanscrit de USTT pàly-â (venant de pdli-â), et 1« zend de patay-a. On supprime en vieux haut-allemand
Yi final du thème, de la même manière qu’on peut le supprimer au génitif pluriel, où nous trouvons à la fois kestt-o, keste-o et kest-o. La forme hiu (de hiu-tu « aujourd’hui ») est digne d’attention : c’est, je crois, le monosyllabisme du thenie hi qui est cause, en partie, que la voyelle finale du thème s est conservée devant la désinence de l’instrumental.
Au contraire, l’a des formes comme eidu, wortu, swertu (mit swertu «avec l’épée», du thème swerta) est, selon moi, produit par la fusion de l’a final du thème avec l’a de la désinence ca-
suelle; c’est-à-dire que le ^TT â (venant de a + â) des formes védiques comme îrff^T mcihitva, pour mahitva-â, s’est d’abord abrégé comme en zend et ensuite affaibli en u266.
S 161. L’instrumental en lithuanien.
Le lithuanien, à l’instrumental de ses thèmes masculins en a, s’accorde avec le vieux haut-allemand, en ce qu’il a également un u au lieu de l’d qu’aurait dû produire la réunion de 1 a du thème et de 1 de la désinence; exemple : dëwu, qu’on peut comparer au védique dêva* et au zend daim. Les thèmes
féminins en a (primitivement â, S 118) ne font point de différence en lithuanien entre la voyelle du nominatif et celle de l’instrumental; mais on peut admettre que Va du theme a absorbé celui de la désinence casuelle, et que, par exemple, merga «servante» (nominatif) a fait d’abord à l’instrumental merga-a. On trouve aussi dans la langue védique des formes analogues pour les thèmes féminins en â; exemple : darâ, de dârâ-â, au lieu de la forme ordinaire ddray-â (voyez Benfey, Glossaire du Sâma-Véda, s. v.). Dans toutes les autres classes de mots, le lithuanien a mi pour désinence de l’instrumental singulier3;
cette terminaison est évidemment en rapport avec la désinence mis (= sanscrit bis, zend bis ou bîs) du même cas au pluriel (S 216). On peut comparer awi-ml «par le mouton», sünu-mi «par le fils» avec les cas correspondants du pluriel awi-mls, sünu-mls, et avec les formes correspondantes du sanscrit dvi-bis «par les moutons», sûnü-bis «par les fils».
S 162. De quelques formes particulières de finstrumental en zend.
Nous revenons au zend, pour faire remarquer que la terminaison a de l’instrumental peut devenir ^ ô par l’influence euphonique d’un v qui précède, lequel lui-même est sorti d’un u L C’est ainsi que nous avons plusieurs fois bâsvô avec la
signification de l’instrumental267 268. (Va est, au contraire, conservé dans ce même mot dans la forme bâsv-a «brachio», avec la variante èdsam269.) Les thèmes féminins en i suppriment la désinence casuelle et présentent le thème nu, par exemple, frasrûiti, que Nériosengh traduit par l’instrumental svdrêna «avec le son»270. Le dialecte védique permet des suppressions analogues à l’instrumental des thèmes féminins en », mais la voyelle finale, du thème est allongée par compensation ; exemples : matï, dîtï, sustutîde matl, etc. Un fait analogue a lieu dans le
363
sanscrit classique, au duel des thèmes masculins et féminins en i et en u (S a i o). ■
S 163. Tableau comparatif de l’instrumental.
Voici le tableau comparatif de l'instrumental pour les thèmes cités au § j à8 et pour quelques autres :
|
■ Lithuanien, pônh. |
hauL-allcmand. eidu wortu |
|
■Lt | |
|
aswa | |
|
genti-mi |
hast*-u |
|
awi-ml | |
|
***•*«••« süm-ml |
• 1 > ^ * t V f * |
|
Sanscrit. |
Zend. | |
|
masculin. . |
âivê-n-a1 |
aspa |
|
neutre.... |
mahitvd • |
data |
|
féminin. .. |
àévay-â |
hisvay-a |
|
féminin.... |
d'tirâ2 | |
|
masculin.. . |
pâty-â |
patay-a |
|
féminin.... |
pii’ty-â |
âjrîti3 |
|
féminin.. .. |
bâvanty-â |
baminty-a |
|
masculin... |
sûm-n-â |
pasv-a |
|
féminin.... |
hânv-â |
tanv~a |
|
féminin.., . |
vadv-a | |
|
roasc.-fém.. |
gdv-â |
gav-a |
|
féminin... . |
nâv-a | |
|
féminin.. .. ê |
^ A * A? vac-a |
vac-a |
|
masculin... |
bârat-â |
barëntra |
|
masculin... |
âsman-â |
(ïéman-a |
|
neutre.... |
namn-â |
nâman-a |
|
masculin. . |
bratr-a |
brâtr-a |
|
féminin.... |
duhùr-d • |
dugder-a |
|
masculin . . |
dâtr-a |
dâtr-a |
|
neutre.... |
vàcas-â |
vacanh-a * |
|
1 Je ne connais |
point, dans le dialecte védiqi | |
l’instrumental a, au lieu de ê-n-a, à moins qu’on ne veuille compter parmi les thèmes masculins tvâ «par toi», dont le nominatif pluriel yuSme (védique) et l’accusatif yuémdn appartiennent au masculin par la forme, Je regarde comme d’anciens instrumentaux neutres les mots suivants que le sanscrit classique considère comme des adverbes : dakéinâ' «au sud» (proprement «à droite»), uttariï «au nord», ainsi que le védique savyiï «à gauche». Comparez à ces mots les instrumentaux d’adjectifs en vieux haut-allemand, comme cuatu (mit cuatu «cum bono»).
2 Voyez Si6i. .
3 Comparez le védique mat?.
DATIF.
S 16U. Le datif en sanscrit et en zend.
La marque du datif en sanscrit et en zend est ê (pour les féminins ê ou âiy Cette désinence doit probablement son origine au pronom démonstratif ê, qui fait au nominatif ayâm (de ê + am) «celui-ci»; mais ce pronom ê ne paraît être lui-même que le thème a élargi, comme le prouvent la plupart des cas de ce pronom (a-swiaC a-smât, a-smîn, etc.). On doit remarquer à ce sujet que, dans la déclinaison sanscrite ordinaire, les thèmes en a changent de même à beaucoup de cas cette voyelle en ê, c’est-à-dire qu’ils l’élargissent en y mêlant un i.
Parmi les thèmes féminins, il y en a qui font toujours leur datif en âi, au lieu de ê : ce sont les thèmes simples1 en 'QCt â (par exemple, Bâ « éclat», suta «fille»), et les thèmes polysyllabiques en î et en û. Au contraire, le datif est tantôt ê, tantôt âi pour les thèmes monosyllabiques en î et en û271 272, et pour les thèmes féminins en i et en u, qui sont tous polysyllabiques. Un â final devant la terminaison âi s’élargit en ây; exemple : tîsvây-âi, de àévâ. Les thèmes en i et en u reçoivent toujours au masculin, mais au féminin seulement devant ê et non devant la désinence plus pleine et plus pesante âi, la gradation du gouna ; les thèmes neutres terminés par une voyelle insèrent un n euphonique (qui devient n dans les cas indiqués au S 17 b); exemples : agnây-ê, sûnâv-ê, de agni (masculin) «feu», sûnû (masculin) «Fils»; prïtay-ê ou pn'ty-âi, denâv-ê ou dênv-âî, de pfïti (féminin) «joie», iïênü (féminin) «vache laitière»; vâri-n-ê, mâdu-n-ê, de v$ri (neutre) «eau», mâdu (neutre) «miel, vin».
En zend, les thèmes féminins en â et en % ont, comme en sanscrit, ai pour désinence; mais on abrège souvent la voyelle de l’avant-dernière syllabe, si le thème est polysyllabique : ainsi l’on ne dit pas hisvây-âi, mais hisvay-âi (sanscrit gih-
vay-âi), au datif du thème hisvâ «langue». Les thèmes en t, joints à la particule «p ca, ont conservé le plus fidèlement la forme sanscrite; ils font «fux)»»*’ ay-ai-ca (§ 33); exemple:
karstayaîca «et pour la culture », de harsti (féminin). En l’absence de ca on ne trouve guère que la-forme ^ ëê (S 31 ) ; exemple : qarëtëê « pour le manger », de
qarëti (féminin) «le manger». Les thèmes en » u peuvent prendre le gouna, comme, par exemple, vanhav-ê, de
vanhu «pur», ou bien ils forment le datif sans gouna, comme ratw-ê, de valu «grand, maître». La forme sans gouna est la plus fréquemment employée. On trouve aussi un a y euphonique inséré entre le thème et la désinence (§ /i3); exemple : tanu-y-ê, de tanu (féminin) «corps».
S i65. Datif des thèmes en a, en sanscrit et en zend.
Les thèmes sanscrits en a font suivre la désinence casuelle ê (= a+i) d’un autre a, ce qui donne aya, et, avec Va du thème, âya; exemple : dsvâya «equo». Le zend aspâi peut être
regardé comme appartenant à cette forme, avec suppression de l’rt final, cè qui a ramené la semi-voyelle y à son état premier de voyelle. Mais je préfère admettre que le zend n’a jamais ajouté un « à Yê du datif, et que le fait en question n’a eu lieu pour le sanscrit qu’après la séparation des deux idiomes. En effet, a + ê donne régulièrement la diphthongue âi que nous avons en zend. Nous avons d’ailleurs un exemple de formation
analogue en sanscrit : le pronom annexe sma, qui se combine avec les pronoms de la 3e personne, fait au datif smâi (sma-ê) : ainsi kâsmâi «à qui?» correspond au zend kahmâi.
S 166. Le pronom annexe sma. — Sa présence en gothique1.
Le pronom annexe sma, dont il vient d’être question, qui s’introduit entre le thème et la désinence au singulier des pronoms de-la 3e personne et au pluriel des pronoms de la iro et de la 2e, fait paraître, si l’on n’a soin de le séparer, la déclinaison pronominale plus irrégulière quelle ne l’est en effet. Comme cette particule se retrouve dans les langues européennes, où plus d’une énigme de la déclinaison s’explique par sa présence, nous profitons de la première occasion où nous la rencontrons pour la poursuivre autant que possible à travers ses diverses transformations.
En zend, sma s’est changé régulièrement en hma(§ 53); il en a été de même en prâcrit et en pâli, où, au pluriel des deux premières personnes le s de sma est devenu j| h (S 23), et où, de plus, la syllabe hma s’est changée en mita par la métathèse des deux consonnes: exemples : '3^ amhê «nous» (a^es), pâli amhâkam, zend ahmâkëm « tipâv ». La forme prâ-
crite et pâlie mha nous achemine vers le gothique nsa, dans u-nsa-ra Krjfiôjv», u-nsi-s2 «nobis, nos». Le gothique l’emporte en fidélité sur le pâli et le prâcrit, en ce qu’il a conservé la sifflante ; mais il a changé m en n pour l’unir plus facilement à s. Nous ne pouvons donc plus, comme nous l’avons admis autre-
1 Ce paragraphe et les suivants (166-175) forment une parenthèse qui n’appartient pas directement à l’étude du datif. Mais comme le pronom annexe sma, qui joue un rôle essentiel dans la déclinaison pronominale, s’est introduit aussi dans la déclinaison des noms et des adjectifs (SS 173,280), l’auteur n’a pas voulu attendre qu’il fût arrivé aux pronoms, pour nous donner ses observations les plus importantes sur ce sujet. — Tr.
2 Avec changement de Va en i, d’après le S 67.
fois avec GrimmJ, regarder ns de ms «nos» comme la désinence ordinaire de l’accusatif, telle que nous la trouvons, par exemple, dans vulfa-ns, gasti-ns, sunu-ns, ni supposer que de là cette terminaison, devenue en quelque sorte la propriété du thème, serait entrée dans quelques autres cas et se serait combinée avec de nouvelles désinences casuelles. Une autre objection contre cette explication peut être tirée du pronom de la 2e personne, qui fait isvis (z-sw-s) à l’accusatif : or, les pronoms des deux premières personnes ont la même déclinaison. Uns «nobis, nos» est donc pour unsi-s (venant de unsa-s), et ce dernier mot a s pour suffixe casuel et le composé u-nsa (affaibli en u-nsi) pour thème273 274.
S 167. Formes diverses du pronom annexe sma en gothique. —
Nsa et sva.
De même qu’en zend le possessif sanscrit ^ sva change d’aspect suivant la place qu’il occupe 275, de même je crois pouvoir démontrer la présence en gothique du pronom annexe sma sous six formes différentes, à savoir : nsa, sva, nlca, nqva, mma et s. Il vient d’être question de la première; la seconde, c’est-à-dire sva, et par affaiblissement svi, se trouve dans le pronom de la 2e personne à la même place où celui de la iro a ma (nsi). Aussi, à la différence de ce qui se passe en sanscrit (y compris le pâli elle prâcrit), en zend, en grec et en lithuanien, où les deux pronoms ont au pluriel une déclinaison parfaitement parallèle, le pronom annexe se trouvant renfermé sous sa forme primitive ou sous une forme modifiée de même façon, dans le pronom de la ire et dans celui de la 2 personne, au contraire, en gothique, il y a eu scission, causée par la double forme qu’a adoptée la syllabe sma, a savoir nsa pour la 1 et sva pour la 2e personne. Cette dernière forme sva s’explique par l’amollissement de s en s (§ 86, 5) et par le changement, qui n’a rien d’insolite, de m en v276.
S 168. Le pronom annexe sma dans les autres langues germaniques.
Dans les dialectes germaniques plus modernes que le gothique, la particule sma, enclavée dans le pronom de la 2e personne , est devenue encore plus méconnaissable par la suppression de la sifflante. Le vieux haut-allemand i-wa-r est au gothique i-sva-ra à peu près ce que le génitif homérique toto est au sanscrit tâsya. Si, sans tenir compte du gothique, on comparait le vieux haut-allemand i-wa-r, i-u, i-wi-h avec le sanscrit yu-sma-kam, yu-smâ-Byam, yu-sma-n, et avec le lithuanien ju-su, ju-mus, jùrs, on ne douterait pas un instant que le w ou Vu n’appartînt au thème, et l’on partagerait à tort ces mots de cette façon : iw-ar, iw-ih, iu. Aussi ai-je été d abord de cet avis : c’est une nouvelle étude de la question, ainsi que la comparaison du zend, du prâcrit' et du pâli, qui me permettent aujourd’hui d’affirmer que la particule sva subsiste en haut-allemand et s est maintenue en partie jusque dans l’allemand moderne ( e-ue-r, de i-sva-ra). Au contraire, l’w du thème jet (^J yu) sest déjà effacé
en gothique et dans la plus ancienne forme du haut-allemand, aux cas obliques du pluriel et du duel1; le gothique i-sva-ra, vieux haut-allemand i-wa-r, etc. est pour ju-sva-ra, ju-wa-r. Le vieux saxon et l’anglo-saxon ont, du reste, mieux conservé le thème que le gothique, et gardent à tous les cas obliques Vu, devenu o en anglo-saxon; exemples : iu-we-r, ëo-ve-r svestri??, etc. Si, parmi les formes dont il vient d’être question, on ne prenait que les deux extrêmes, à savoir le sanscrit yusmâkam et l’allemand moderne euer, on aurait l’air de soutenir un paradoxe, en affirmant leur parenté, surtout si l’on ajoutait que Vu de euer n’a rien de commun avec Vu de yu dans yusmÆam, mais qu’il provient de la lettre m dans la syllabe sma.
§ 169. Autres formes du pronom annexe ma en gothique. —
Nka, nqva.
La différence que le gothique fait entre le duel et le pluriel, aux cas obliques des deux premières personnes, n’a rien de primitif. En effet, le duel et le pluriel ne se distinguent dans le principe que par les désinences; or, elles sont les mêmes, en gothique, pour les pronoms dont il est question. La différence qui existe entre les deux nombres a l’air de résider dans le thème : on a unka-ra ttswiV», mais unsa-ra k rjpâv » ; inqva-ra zcr<pâïv», mais isva-ra Mais une analyse plus exacte et
la comparaison des autres langues indo-européennes démontrent que le thème ne change pas et que les différences proviennent de ce que le pronom annexe sma affecte deux formes, dont le duel a adopté l’une et le pluriel l’autre277 278.
Le pronom de la 2e personne a en gothique qv (« Jw) au Heu de h, pendant que les autres dialectes ont la même lettre dans les deux personnes : vieux haut-allemand u-ncha-r, i-ncha-r; vieux saxon u-nhe-r, i-nke-r; anglo-saxon u-nce-r, i-nce-r. Entre le duel et le pluriel des deux premières personnes il n’y a donc pas de différence organique et primitive, mais leur diversité provient des altérations diverses subies par une seule et même forme ancienne. Ces deux pronoms n’ont pas plüs conservé l’ancien duel que les autres, ni que les substantifs. Quant au v du gothique i-nqva (= i-nkva pour ju-nhva), il tient au penchant qu’a le gothique (§ 86, i) à faire suivre une gutturale d’un v euphonique; le pronom annexe s’en est toutefois abstenu dans la ire personne, et c’est là-dessus que repose toute la différence entre nqva, de i-nqva, et nka, de u-nka.
§ 170. Autre forme du pronom annexe sma en gothique : mma.
La cinquième forme sous laquelle on rencontre sma dans la déclinaison gothique est mma; par exemple, au datif singulier thamma «à lui, à celui-ci », lequel est pour tha-sma. En borussien, le s s’est conservé; on a, par exemple, ka-smu «a qui?», qu’on peut comparer au sanscrit kd-smâi et au gothique hva-mmal.
S 171. Restes du pronom annexe sma en ombrien.
L’ombrien a également conservé au datif de la déclinaison
gothiques du duel unkara, inqvara et la forme prâcrite mha; dans ies deux langues * il y a métathèse et changement de s en gutturale. Un autre exemple, unique en son genre, du même changement en sanscrit, est la 1" personne du singulier moyen du verbe substantif, | hé, pour sé, qui lui-même est pour as-me (3e personne s-té, pour m-té).
1 C’est sous cette forme que j’ai d’a bord reconnu la présence de la particule sma en gothique. Voyez le recueil anglais des Annales de littérature orientale (i8«o, p. 16).
pronominale le groupe sm de notre pronom annexe, particulièrement dans e-smei ou e-sme «à celui-ci» et dans pu-sme «à qui» (relatif et interrogatif)A. Ce dernier mot, qui a un p au lieu d un ancien k, répond au sanscrit kâ-smâi, au borussien kasmu, et au gothique hva-mma. Quant à e-smei, nous ne savons si IV du thème représente un « sanscrit (comme, par exemple, IV de es-t «il est = ds-ti) ou s’il tient lieu d’un * L Dans le premier cas, e-smei, e-sme représenterait le sanscrit a-smâi «à celui-ci» (S 366); dans la seconde hypothèse, il faudrait supposer une forme i-smâi (par euphonie pour i-smâi), perdue en sanscrit, mais à laquelle se rapportent le datif gothique i-mma, le vieux haut-allemand i-mw et l’allemand moderne ihm (S 862).
H sera question plus tard des traces que le pronom annexe sma a laissées en latin et en grec.
S 179. Autre forme du pronom annexe stnct en gothique : s,
La sixième forme gothique du pronom annexe sanscrit sma se réduit à la lettre s; elle figure entre autres dans les datifs mi-s «mihi», thu-s «tibi», si-s «sibi» : on voit que le pronom annexe sma, qui, en sanscrit, ne se combine au singulier qu’avec le pronom de la 3e personne, pénètre en gothique dans les deux premières personnes; la même chose est arrivée en zend et en prâcrit. En zend nous avons le locatif de la 2e personne iwa-hni-î «dans toi» (venant de twa-smî), au lieu du sanscrit tvdy-iyet on peut induire pour la ire personne le locatif ma-hm-t Le prâcrit a tu-ma-sm-i «en toi», et avec assimilation, tu-ma-mm-i; on trouve aussi tu-mê (de tu-ma) et tai (de tvaï = sanscrit tvay-i). Pour la ire personne, on a ma-ma-smW ou ma-ma-mm-î, à côté de tria-ê (venant probablement de ma-mê = ma-ma-ï) et de mai. Plusieurs de ces formes contiennent le pronom
Voyez Aufrecht el Kirchhoff, Monuments de la langue ombrienne, nn. *33 137. ~
annexe deux fois : du moins je ne doute pas que, par exemple, tu-rm-smi, tu-ma-mmî, ma-ma-smi, ma-ma-mmi ne soient des formes mutilées pour tu-sma-smi, etc. Le même redoublement a lieu dans les formes gothiques comme u-nsi-s «nobis», i-svi-s «vobis», et les formes analogues du duel, car le dernier s répond évidemment à celui des formes du singulier mi-s, thu-s, et n’a de la désinence casuelle que l’apparence. Il en est de même, selon moi, pour le s de vei-s k nous n et de ju-s «. vous », qui, à son origine, ne marquait pas la relation casuelle, mais était un reste du pronom annexe sma. Dans le dialecte védique il s’est, en effet, conservé de ce pronom un nominatif pluriel smê (smê d’après le S 21) dans a-smêf « nous », yu-smê\\ous». En zend la syllabe mê est tombée et la voyelle u s’est allongée, ce qui a donné yûs279, forme extrêmement curieuse, qui semble faite exprès pour nous montrer l’origine de la forme correspondante en germanique et en lithuanien; le zend yûs répond, en effet, lettre pour lettre au lithuanien jus, et si, d’autre part, Vu du gothique ju-s est bref, il répond en cela au védique yu-êmê'et au thème des cas obliques dans le sanscrit classique. L’allongement de Vu dans le zend yûs n’est probablement qu’une compensation pour la mutilation du pronom annexe.
S 178. Le pronom annexe sma dans la déclinaison des substantifs
et des adjectifs.
En lithuanien, le pronom annexe sma a aussi pénétré dans la déclinaison des adjectifs; le s initial est alors supprimé, comme dans les formes prâcrites précitées, telles que tuma-mmi, et dans les datifs en vieux haut-allemand comme i-mu «à lui». Nous trouvons, par exemple, la syllabe en question dans les datifs lithuaniens comme gerâ-mui (forme mutilée gerâ-m) «bono» et
dans les locatifs comme gera-mè (forme mutilée gera-m). Une fois admis dans la déclinaison des adjectifs, le m du pronom annexe s est encore introduit en lette dans les substantifs masculins ; ils prennent tous ce m, qui a l’air dès lors d’être l’expression du datif; exemples : wêja-m (qu’on écrit wehja-m) «vento», letu-m (îeetu-m) «piuviæ», en regard des datifs féminins comme akkai «puteo» (nominatif akka}, uppei ^rivov (nominatif uppe, venant de uppia, comparez^ 9a11), sirdî1 «cordi» (à la fois thème et datif, nominatif sirds pour sirdi-s, comme en gothique ansts pour ansti-s).
Le pâli et le prâcrit emploient également le pronom annexe dans la déclinaison des substantifs et des adjectifs (à l’exclusion du féminin); dans la première de ces deux langues, on le trouve a 1 ablatif et au locatif280 281 toutes les fois que le thème finit par une voyelle ou qu*il rejette une consonne finale.
$ ljU. Le pronom annexe sma, au féminin, en sanscrit et en zend.
Au féminin, le pronom annexe sanscrit sma devrait faire smâ ou sm% (comparez S 119) : la déclinaison pronominale, en sanscrit, n’offre pas trace d’une forme smâ; quant à smî, il expliquerait très-bien les datifs comme tâ-sy-âi, les génitifs et ablatifs comme tâ-sy-âs et les locatifs comme tâ-sy-âm, qui seraient des formes mutilées pour -smy-âi, -smy-âs, -smy-âm. Qu a une époque plus ancienne il y ait eu en effet des formes comme ta-smy-râi, etc. c’est ce que nous pouvons conclure du zend, où l’on rencontre encore hmî (venant de smî), au locatif et à l’instrumental féminins de certains pronoms, par exemple dans yahmya (à diviser ainsi : ya-hmy-a). Au locatif, le zend remplace
régulièrement la désinence sanscrite àm par a : ya-hmy-a suppose donc une forme sanscrite J^ya-smy-âm, au lieu de la forme existante A l’instrumental, le sanscrit ne nous
présente rien que nous puissions comparer au zend ya-hmy-a, attendu qu’à ce cas les pronoms sanscrits suivent la déclinaison ordinaire, c’est-à-dire s’abstiennent de prendre le pronom annexe, et font, par exemple, yê-n-a (masculin-neutre), ydy-â (féminin) et non ya-smè-n-a, ya-s(mÿy-â. Au zend a-hmy-a «par celle-ci» (instrumental); correspond, dans le dialecte védique, la forme simple ay-â, d?àprès l’analogie de l’instrumental des substantifs en d, par exemple dsvay-â\ au masculin et au neutre, l’instrumental du pronom védique est ê-n-a ou ê-n-â, tandis que dans le sanscrit classique le thème a et son féminin â ont perdu tout à fait leur instrumental. Au locatif féminin nous avons en sanscrit a*sya-m (venant de a-smyà^m) en regard de la forme zende a-hmy-a. Aux datif, génitif et ablatif, le zend n’a pas non plus conservé dans son intégrité le pronom annexe; non-seulement il a perdu le m, comme le sanscrit, mais il a laissé tomber le caractère du féminin i, ou plutôt son remplaçant euphonique y; exemple : ^^31» anhâo (S 56a) «hujus» (féminin), au lieu de a-hmy-âo. Au lieu de anhâo — sanscrit a-sy-âs on trouve aussi ainhâo, où le y, qui autrefois se trouvait dans le mot, a en quelque sorte laissé son reflet dans la syllabe précédente (§ Ai).
Nous trouvons en zend, comme datif féminin d’un autre thème démonstratif, avanhâi, au lieu de ava-hmy-âi, et comme
ablatif avanhâd, au lieu de ava-hmy-âd. 282
font subir au pronom annexe sma dans la déclinaison féminine : le gothique ne conserve de la syllabe smt, qui, comme nous l’avons vu, serait la forme complète du féminin, que la lettre initiale, qu’il donne sous la forme s (z d’après § 86, 5). Nous avons, par exemple, le datif thi-s-ai, le génitif thi-s-ôs, en regard du sanscrit tâ-sy-âi, td-sy-âs. Nous reviendrons plus tard sur thi-s-ôs; quant à thi-s-ai et aux formes analogues de la déclinaison pronominale en gothique, nous voyons dans la diph-thongue finale ai le représentant de la désinence ai, qui caractérise les datifs féminins en sanscrit et en zend.
Il est difficile de décider si, en gothique, au datif des thèmes féminins en ô (=«, § 69), il faut attribuer à la désinence la diphthongue ai tout entière, ou simplement Yi, qui serait un reste de la désinence ai; en d’autres termes, si, par exemple, dans gibai «dono», il faut diviser gib-ai ou giba-i. Dans le dernier cas giba-i répondrait aux formes latines comme equæ = equa-i et lithuaniennes comme aswai (âswa-i). On pourrait supposer aussi que la voyelle finale du thème, au temps ou elle ne s’était pas encore altérée d « en ô, s’était fondue avec le son a de la désinence ai; c’est ainsi qu’en sanscrit âi est également le résultat de la fusion â + ê ou de la fusion â + dt.
Dans les langues germaniques, même en gothique, les thèmes masculins et neutres, ainsi que les thèmes féminins en i,u,n et r, ont entièrement perdu la terminaison du datif. Gela est évident pour les thèmes finissant par une consonne ou par u : on peut comparer brôthr, dauhtr avec les datifs sanscrits correspondants firatr-ê, duhitr-ê'; namin avec nàmn-ê et le latin nômin-î; sunau «filio» et les formes féminines analogues, par exemple kinnau ttgenæ», avec le sanscrit sûnâv-ê, hânav-ê. De même que Yau de sunau, kinnau, est simplement le gouna de l’a du thème, de même Yai de anstai ne peut être que le 01^ay (venant de ê=m) des datifs féminins sanscrits comme prtïày-ê. Au contraire, dans
les datifs comme gasta, du thème gasti, c est ii du theme qui est tombé, et l'a introduit par le gouna est seul resté; gctsta est donc pour gastai, de même que, dans les formes passives comme bairada, au lieu de bairadai (en grec (pépereu, en sanscrit, au moyen, Mrutê pour Bâratai), le dernier élément de la diph-thongue ai a disparu. Lde formes comme vulfa slupo», daura «portæ» (ire déclinaison forte de Grimm), appartient au thème et se distingue par là de celui des formes comme gasta; mais il faut que même après Va de vulfa, daura, il y ait eu dans le principe un i comme signe du datif. Il a disparu de ces mots, comme il s’est effacé dans thamma = cTO tdsmâi et dans les formes analogues, et comme il est tombé dans le borussien kasmu = sanscrit kâsmâi. Au féminin, certains datifs pronominaux borus-siens ont, au contraire, conservé une forme beaucoup plus complète, à savoir, si-ei, et, après une voyelle brève, ssi-eil, quon peut rapprocher du sanscrit -sy-âi et du gothique -s-ai; exemples : stei-m-ei ou ste-ssi-eL en sanscrit td-sy-âî, en gothique thi-s-ai.
S 176. Le datif lithuanien.
Les substantifs, en lithuanien, ont i ou ei comme désinence du datif: ei ne s’emploie toutefois qu’avec les thèmes féminins eni2; on peut, par conséquent, rapprocher cette désinence de l’ei borussien, que nous venons de rencontrer dans la déclinaison pronominale féminine (stei-si-ei). Il y aurait donc identité, en ce qui concerne la désinence comme en ce qui regarde le theme, entre dwi-ei (dissyllabe) «ovi» et le sanscrit avy-ai, par euphonie pour âvi-âi, de avi (féminin) k brebis»; nous avons, en outre, en sanscrit, une forme commune au masculin et au féminin âvay-ê : le gothique représenterait cette forme par ami au féminin et
1
2
Voyez mon mémoire Sur la langue des Borussiens, p. 10.
Les thèmes masculins en i forment le datif d’un thème élargi en ia
.-.U /ittt t'i 1 n
gmmti, dissyllabe, comme pâma (voyez Kurschat, 11, p. 367).
ava au masculin (S 34o), si le thème en question, qui a donné le dérivé avistr «étable de brebis » (thème avistra) s’était conservé en gothique et appartenait aux deux genres.
La désinence %, qui n’a gardé delà diphthongue sanscrite ê=ai que la partie finale, ne se rencontre pas en lithuanien au datif des thèmes terminés par une consonne : ces thèmes s’élargissent au datif, comme à la plupart des cas, en prenant comme complément la syllabe i ou ial. Quand le thème est terminé par une voyelle, i se fond avec celle-ci de manière à former une diphthongue, et Va masculin s’affaiblit alors en u; exemple : wilkui «lupo», du thème wllka, comme nous avons sünui de sünà. L'a féminin, qui primitivement était long, reste invariable; exemple : âswai «equæ». Avec les formes comme wilkui s’accordent d’une façon remarquable lés datifs osques comme Maniui, Âbellanûï, Nûvlanûi, qui appartiennent à la même déclinaison, c’est-à-dire aux thèmes masculins et neutres terminés par a en sanscrit
r
(voyez Mommsen, Etudes osques, p. 82). Des rencontres de ce genre sont fortuites; mais on se les explique aisément, car des idiomes réunis par une parenté primitive et qui vont se corrompant doivent souvent éprouver les mêmes altérations.
§ 177. Le datif grec est un ancien locatif. — Le datif latin.
Les datifs grecs répondent, au singulier comme au pluriel, aux locatifs sanscrits et zends (SS 196, a5o et suivants). Quant à l’f long du datif latin, je le regarde maintenant, d’accord avec Agathon Benary, comme le représentant du signe du datif sanscrit ê (venant de at). La seconde partie de la diphthongue primitive s’est allongée pour compenser la suppression de la première partie ; c’est le même fait qui s’est produit dans les nominatifs pluriels comme istî, ülî, lupî (S 928). On ne sau-
1
Sur le datif des thèmes terminés par une consonne en ancien slave, voyez S 367 .
rait voir un locatif dans le datif latin : en ellet, le signe casuel du locatif est IV bref; or, en latin, un i bref, partout où il se trouvait primitivement a la fin d’un mot, a été ou bien supprimé comme en gothique1, ou bien changé en ë (8 8) : il n’y a aucun exemple certain d’un i bref changé en î. 11 faut aussi remarquer qu’au pluriel le datif-ablatif latin se rapporte au cas correspondant en sanscrit et en zend, et non pas, comme le datif grec, au locatif (S a A4); en outre, il faut considérer que mi-hi, ti-bi, si-bî appartiennent évidemment par leur origine au datif (S 915 ), dont nous trouvons encore la désinence, mais avec le sens du locatif, dans t-bî, u-bî, aii-bî, ali-cu-bî, utru-bL On doit encore tenir compte, pour décider la question en litige, de losque et de l’ombrien, qui ont à côté du datif un véritable locatif; on trouve même en ombrien è = sanscrit ê comme désinence du datif pour les thèmes terminés par une consonne283 284. Exemples : nomn-ê, pour le sanscrit nâmn-ê, le zend nâmam-ê, le latin nomin-î; patr~ê, pour le sanscrit pitr-e (venant de patr-ê).
Le datif latin étant originairement un vrai datif, nous ne devrons pas rapprocher ped-i du grec qui équivaut au locatif
populoi Romanoi, que nous pouvons mettre sur la même ligne que les datifs osques comme Maniûi et lithuaniens comme ponui « au maître ». Dans la déclinaison pronominale, le signe casuel s’est conservé au détriment de la voyelle finale du thème : on a ist'-î au lieu de istoi ou istô, et au féminin ist’-î au lieu de istai ou istœ. Les datifs archaïques comme familial et les formes osques comme toutai « populo ?? répondent aux datifs lithuaniens comme âswai aequæ«. L ombrien contracte ai en ê, comme le sanscrit plus tard £o/ê). Dans les thèmes latins en if IV final du thème se fond avec Yî de la désinence casuelle : hostî est pour hosti-î.
sanscrit pad-i, mais nous le comparerons avec le datif sanscrit pad^é’ (venant de pad-ai); de même ferent-î ne devra pas être rapproché du grec (pépovr-t, ni du locatif zend barënt-i(en sanscrit Bârat-i), mais du datif zend harëntrè, barëntai-ca (Wj. $ 33) «ferentique», et du datif sanscrit Mrat-ê. Dans la ke déclinaison, fructu-i répond, abstraction faite du nombre des syllabes et de la quantité de it, aux datifs lithuaniens comme sunui (dissyllabe), en sanscrit sunav-e. La déclinaison en Ô a perdu dans le latin, classique le signe du datif, et pour le remplacer elle allonge 1g> du therne : mais la vieille langue nous offre des formes comme
§ 178. Tableau comparatif du datif.
Nous donnons ici le tableau comparatif du datif, à l’exclusion des thèmes neutres terminés par une voyelle :
Zend,
aépâi
ka-hmâi
hismy-âi
Latin.
equo cu-i1 equa-i
Sanscrit.
dsvâya
kà-smâi
r / A A*
asvay-m
Lithuanien.
Gothique,
vulfa hva-mma gibai287
Zend, Latin. Lithuanien. Gothique.
Sanscrit.
pâtay-ê1
a*. Ah
pn tay-e
bavanty-âi
tâ-sy-âi
sûnâv-ê
hânav-ê288 •
vadv-âi
gâv-ê
A A*
nav-e
A r a*
vac-e
Mrat-ê
âsman-ê
namn-ê
Bratr-ê
duhitr-e . •
dâtr-c'
vâcas-ê
patë-ê ?289 290 hostî ........291 292 gasta #
âfrîtë-è293 294 295 turrî uwi-ei anstai
bavainty-âi ...........................
aùa-nh~âi0 .................. tki-s-ai
■ •
pasv-ê pecu-î sânu-i1 sunau
tanu-y-ê socru-î ......... Jcinnau
**•*••*** t # • • I < I « 1 • **»*•»*»
gâv-ê bov4 ..................
.. A* A AA
vac-e voc-i ..............
barënt-ê ferent-î ......... fijand
asmain-ê sermôn-î ......... ahmin
nâmain-ê nômin-î ......... namin
brâtr-ê frâtr-î ....... . brothr
dufrdër-ê296 .................. dauhtr
dâtr-ê datêr-î ..............
vacank-ê gener-î ........... . . .
ABLATIF.
§ 179. L’ablatif en sanscrit.
Le signe de l’ablatif en sanscrit est t; si l’on admet avec nous l’influence des pronoms sur la formation des cas, on ne
peut pas hésiter sur la provenance de cette lettre : elle nous représente le thème démonstratif ta, qui, comme nous l’avons vu, sert également de signe casuel au nominatif-accusatif neutre, et qui, ainsi que nous le verrons plus tard, remplit aussi dans le verbe les fonctions d’une désinence personnelle. Cette marque de l’ablatif ne s’est du reste conservée en sanscrit qu’avec les thèmes en a, qui allongent Y a devant le t. Les grammairiens indiens, induits en erreur par cet allongement de Va, ont regardé WVê^ât comme la désinence de l’ablatif; il faudrait alors admettre que dans dsvât Va du thème se fond avec l’a de la terminaison297.
S 180. L’ablatif en zend.
C’est Eugène Burnouf2 qui a reconnu le premier en zend le signe de l’ablatif dans une classe de mots qui l’a perdu en sanscrit, à savoir dans les mots en > u, sur lesquels nous reviendrons plus bas. Ce fait seul nous montre que le caractère de l’ablatif est t et non pas ât. Quant aux thèmes en a, ils allongent aussi en zend la voyelle brève, de sorte que vëhrkâ-d cdupo»
correspond à (§ 39). Les thèmes en 4 i ont à l’abla
tif ôi-d, ce qui nous doit faire supposer d’anciens ablatifs sanscrits comme patê-t, prîtê-t (S 33), qui, en ce qui concerne le gouna de la voyelle finale, s’accordent bien avec les génitifs en ê-$. L’Avesta ne nous fournit du reste qu’un petit nombre d’exemples d’ablatifs en «A ôi-d; j’ai constaté d’abord cette forme dans le mot àfrîtâid «benedictione»; peut-être
avons-nous un exemple masculin dans mgôid saratustrôid «institutione saratustrica rfl.
Les thèmes en > w ont à 1 ablatif au-d, ^ m-d, v-ad et HL*?* av~a<h exemples : anhau-d «mundo», de ^^u
anhu; y !>*]*(» tanau-d, ou fgu»|A>{» tanv-ad, ou £u»AijA»f» tanav-ad «corpore», de >Ja»ç» tcmu. L’ablatif en ^ ëud se trouve attesté par la forme mainyëu-d, de mainyu «esprit».
Les thèmes finissant par une consonne, ne pouvant pas joindre le y d immédiatement au thème, prennent ad pour désinence ; exemples : ap-ad « aquâ », yjâtr-ad « igné »,
casman-ad « oculo », fpAijugyjftul nâonhan-ad « naso », yg drug-ad «dæmone», yAi»^ vîs-ad «loco» (comparez viens ? S 21). Le au â étant souvent confondu avec le a» a, on trouve aussi quelquefois la leçon fautive y au âd au lieu de $*» ad; ainsi (^uy^Aqului» saucant-âd, au lieu de ^a^»^ai(u1*a>a» saucant-ad «lucente».
Les thèmes féminins en au â et en 4 î ont, au contraire, comme terminaison régulière de l’ablatif âd298 299; exemples: lpAujju|A» ^ dahmay-âd «præclarâ», de au^jij dakmâ; urvaray-âd « arbore », de au)a»>1> urvarâ; barëiry-âd
« génitrice », de barëtrî300.
On voit que le zend ne manque pas de formes pour exprimer l’ablatif dans toutes les déclinaisons; malgré cela, et quoique la relation de l’ablatif soit représentée, en effet, la plupart du
temps par l’ablatif, on trouve souvent aussi en son lieu et place le génitif, et même des adjectifs au génitif se rapportant à des substantifs à l’ablatif. Nous avons, par exemple :
|haca avanhâd1 vîsad y ad mâsdayasnôis « ex hac terra quidem masdayasnica».
S 181. L’ablatif dans l’ancienne langue latine et en osque.
On peut rapprocher du zend, en ce qui concerne le signe de l’ablatif, la vieille langue latine; sur la Colonne rostrale et dans le sénatus-consuite des Bacchanales tous les ablatifs se terminent par d301 302, de sorte qu’on peut s’étonner qu’on ait pendant si longtemps méconnu le vrai rôle de cette lettre, et qu’on se soit contenté du mot vide de d paragogique. Les thèmes finissant par une consonne prennent ed ou id comme suffixe de l’ablatif, de même qu’à l’accusatif ils prennent em, au lieu d’avoir simplement m. Les formes comme dictator-ed, covention-id s’accordent
donc avec les formes zendes comme saucant-ad âtr-ad «lucente
. • *
igné», tandis que namle-d303 prœda-d, in alto-d mari-d ont simplement une dentale pour signe de l’ablatif, comme en zend ragâi-d «instilutione», tanau-d «corpore», et en sanscrit dsvâ-t « equo ». ■ .
L’osque a également le signe de l’ablatif d à toutes les déclinaisons; dans les monuments de cette langue qui nous ont été conservés, il n’y a pas une seule exception à cette règle, tant pour les substantifs que pour les adjectifs; exemples : touta-d
« populo », eitiuva-d «pecuniâ », suva-d « sua », preivatü-d « pri-vato », dolu-d mallu-d « dolo malo », slaagi-d « fine », prœsent-id « præsente », convention-id « conventione », lig~ud « lege ».
§ 182. Restes de l'ancien ablatif dans le latin classique.
Dans le latin classique, il semble qu’il se soit conservé une sorte d’ablatif pétrifié sous la forme du pronom annexe met, qui répondrait à l’ablatif sanscrit mat «de moi», et qui, de la irc personne, se serait étendu à la deuxième et à la troisième. Du reste, il est possible aussi que met ait perdu un s initial et soit pour smet} de sorte qu’il appartiendrait au pronom annexe sma, dont nous avons parlé plus haut (§ 165 et suiv.); (s)met répondrait donc à l’ablatif smât} avec lequel il serait dans la même relation que memor (pour smesmor) avec smar, smr «se souvenir». L’union de cette syllabe avec les pronoms des trois personnes serait alors toute naturelle, puisque sma, comme on l’a montré, se combine aussi en sanscrit avec toutes les personnes, quoique par lui-même il soit de la troisième.
La conjonction latine sed n’est pas autre chose originairement que l’ablatif du pronom réfléchi ; on trouve sed employé encore comme pronom dans le sénatus-consulte des Bacchanales. 11 y est régi par inter, ce qui peut s’expliquer par une double hypothèse : ou bien inter pouvait se construire avec l’ablatif, ou bien, dans l’ancienne langue latine, l’accusatif et l’ablatif avaient même forme dans les pronoms personnels. Cette dernière supposition semble confirmée par l’usage que fait Plaute de ted et de med à l’accusatif.
§ i83a, 1. Les adverbes grecs en ûjs, formés de l’ablatif.
En sanscrit, l’ablatif exprime l’éloignement d’un lieu : il répond à la question unde, C’est là la vraie signification primitive de ce cas, signification à laquelle le latin est encore resté fidèle
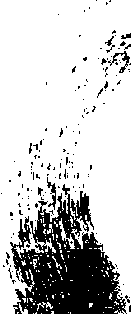
pour ses noms de ville. De Ridée d'éloignement on passe aisément à l'idée de cause, le motif pour lequel une action se fait étant considéré comme le lieu d’où elle vient; l’ablatif, en sanscrit, répond donc aussi à la question quare, et de cette façon il arrive dans l'usage à se rapprocher de l’instrumentai : ainsi têha (§ i58) et wra tâsmât peuvent signifier tous les deux «à cause de cela». Employé adverbialement, l'ablatif prend encore un sens plus général et désigne dans certains mots des relations ordinairement étrangères à ce cas. En grec, les adverbes en cas peuvent être considérés comme des formes de même famille que l’ablatif sanscrit : le w-s des thèmes en o est avec le â-i sanscrit des thèmes en a dans le même rapport que SlSùy-tn avec dâdâ-ti. Il y a donc identité, pour le thème comme pour la désinence, entre 6pet le sanscrit samâ-t «simili». A la fin des mots, en grec, il fallait que la dentale fût changée en s ou bien qu'elle fût supprimée tout à fait304; nous avons déjà vu (§ i5q) des thèmes neutres en t changer, aux cas dénués de flexion, leur t final en er, pour ne pas le laisser disparaître. Nous expliquons donc les adverbes tels que oju&ü-?, oütgj-s, comme venant de opê-T, oiit&ht, &>-t, ou bien de ofiâ-iï, etc. C’est la seule voie par laquelle on puisse rendre compte de ces formations grecques, et il n’est pas vraisemblable de supposer que le grec ait créé une forme qui lui soit propre pour exprimer cette relation adverbiale, quand nous ne rencontrons d’ailleurs aucune dçsirience casuelle qui soit particulière à cette langue. La relation exprimée par ces adverbes est 1er même que marquent en latin les formes d’ablatif comme hoc modo, quo modo, raro, perpetuo. ’
Pour les thèmes finissant par une consonne on devrait avoir comme désinence adverbiale os, venant de ot, d’après l’analogie des ablatifs zends comme
alors ces ablatifs adverbiaux se confondraient avec le génitif. Cette raison, ainsi que la supériorité numérique des adverbes venant de thèmes en o; expliquent les formes comme creo(pp6p-co$; à l’égard de la désinence, on peut rapprocher ces formes des ablatifs féminins zends comme barëtry-âd. Nous rap
pellerons encore, en ce qui concerne l’irrégularité de la syllabe longue dans cette terminaison adverbiale, le génitif attiqùe «s, au lieu de os.
On peut considérer aussi comme des ablatifs ayant perdu leur dentale les adverbes pronominaux doriens tout#, «ôtos tvjvco d’autant qu’ils ont en effet la signification de 1 ablatif et qu’ils tiennent la place des adverbes en 3-sv = sanscrit tas, latin tus (S Ù21); -©#, par exemple, qui est pour -nr^r, équivaut, quant au sens, à uréOev = sanscrit kütas «d’où?». Dans tyjvgjÔsv, tyvâÔs, il y aurait, par conséquent, deux fois l’expression de l’ablatif, comme quand, en sanscrit, on joint aux ablatifs mat «de moi», tvat «de toi», le suffixe tas, qui par lui seul peut suppléer le signe de l’ablatif [mat-tas, tvut-tas).
S i83\ 2. Les adverbes gothiques en ô, formés de l’ablatil.
Comme le gothique a supprimé, en vertu d’une loi générale (§86, 2b), toutes les dentales qui primitivement se trouvaient à la fin des mots,via désinence sanscrite â-t ne pouvait être représentée plus exactement que par 6 (§ 69, 1). Jë regarde donc comme des ablatifs les adverbes dérivés de pronoms ou de prépositions, tels que thathrô «d’ici», hvathro «d’où?», aîjathrô «dailleurs», dakthrâ «d’en bas». On voit, en effet, qu’ils expriment
1 Ahrens, Degrœcw linguœ dialectis, II, p. 37^1.
l’idée d’éloignement, qui est l’idée essentielle marquée par l’abla» tif. Tous ces adverbes sont formés d’un thème terminé en thra : ce suffixe est évidemment le même que le suffixe ihara, dont nous parlerons plus tard (S 292), qui a perdu une voyelle devant le r, comme cela est arrivé en latin dans les formes comme utriusf utrî, eæ-trâ (à côté de exterâ), con-trâ. Hva-thrâ se rapporte donc a Iwatkar (thème hvathara) a qui des deux?» (avec suppression de l’idée de dualité) : thàthrô se rattacherait de môme à une forme hypothétique sanscrite ta-tara « celui-ci des deux » ; alja-thrô à anyatarâ « l’un des deux » : daïathrâ « d’en bas » (com
parez dal, thème dala «vallée») à adora «celui qui est en bas», dont le comparatif serait adaratara; mais adara lui-même contient déjà le suffixe du comparatif, si, comme je le crois, dam est pour tara. Les autres adverbes gothiques formés de la même manière sont : ailathrô « de tous côtés », jainthrâ « de là, de ce lieu-là », fairrathrô «de loin», iupathrô «d’en haut», utathro «du dehors».
Il y a encore beaucoup d’adverbes gothiques en à qu’on peut regarder comme des ablatifs, quoiqu’ils aient perdu la signification de l’ablatif, ainsi qu’il arrive en latin pour quantité d’adverbes (raro, perpetuo, contînuo, etc.). Tels sont : sinteinô «toujours» (du thème adjectif sinteina, «continuus, sempiter-nus»), galeiko «similiter» (thème galeika «similis»), sniumundâ «avec empressement», spranto «subito», andaugjô «palam» (comparez le sanscrit sâkêdt «à la vue de», formé de sa «avec» et akêa «œil» à l’ablatif). Les adverbes que nous venons de citer viennent de thèmes adjectifs en a, ja, les uns perdus, les autres subsistant encore en gothique. On pourrait, il est vrai, être tenté de rapporter ces adverbes à l’accusatif neutre d’adjectifs faibles dont le thème serait terminé en an (voyez Grimm, II!, p. iot ) ; mais ces adjectifs datent,d’une époque postérieure à celle où ont été créés les adverbes comme sprantô, sniumundâ, andaugjô, formes congénères des adverbes tels que subitâ en latin, amovSal&s- en grec, sâksât en sanscrit.
Il y a, en gothique, un certain nombre d’expressions adverbiales qui sont, à la vérité, des accusatifs : tel est thata andaneithô «au contraire», littéralement «le contraire», traduction ou imitation du grec Toùvctvtlov (Deuxième aux Corinthiens, II, 7 Ici andaneithô est évidemment le nominatif-accusatif neutre du thème andanmthan. Mais je ne voudrais en tirer aucune conclusion pour les vrais adverbes terminés en ô et non précédés de l’article. J’en dirai autant de thridjô, qui est suivi, dans les deux passages où nous le rencontrons (Deuxième aux Corinthiens, XII, 14; XIII, 1), du démonstratif thata: thridjô thata «pour la troisième fois», littéralement «ce troisième», à l’imitation du grec tphov et Tpfoov tout0. Ici thridjô est le neutre du nom de nombre ordinal, avec la suppression obligée, au nominatif-accusatif, de la lettre finale n du thème (S tko) et avec l’allongement de l’rt en d.
§ i83fl, 3. L’ablatif en ancien perse. — Adverbes slaves formés
de l’ablatif.
L’ancien perse, qui supprime régulièrement la dentale ou la sifflante finale quand elle est précédée d’un a ou d’un à, ne peut opposer ,aux ablatifs sanscrits en d-£ et aux ablatifs zends en â-d que des formes en â; dans cet idiome ce cas est donc devenu extérieurement semblable à l’instrumental. Cela ne doit pas nous empêcher de regarder comme de véritables ablatifs les mots yc. ^T • Kyï • * H • K*"• HT kabujriyâ «Cambyse » (Ins
cription de Béhistoun, 1, ko )^pârsâ «Persiâ» (Inscription de Nakshi-Roustem, 18) et autres formations analogues en â} que nous trouvons régies par la préposition hacâ «a, ex»1. Mais, le
1 .Te me sépare sur ce point de Benfey, qui regarde les formes en question comme des instrumentaux et fait gouverner à la préposition haéâ^instrumentai aussi bien
plus souvent, l’ablatif est exprimé en ancien perse par le suffixe ta, de même qu’en prâcrit il est marqué par dô; 1 un et 1 autre
sont pour le suffixe sanscrit tas.
On vient de voir que les ablatifs gothiques en o — a, comme hvathrâ «d’où?», ont éprouvé la même mutilation que les ablatifs perses : il y a seulement cette différence, qu’en gothique la suppression de la consonne finale a lieu en vertu dune loi plus generale qu’en perse (S 86, ab). Nous remarquerons à ce propos qu’on trouve aussi en ancien slave des restes de 1 ablatif, naturellement avec suppression du t final (S 92 “), en quoi ils ressemblent à l’ablatif en ancien perse et en gothique. C’est dans la déclinaison pronominale qu’on trouve ces restes d’ablatif, qui sont considérés comme des adverbes: deux ont change la signification de l’ablatif contre celle du locatif; le troisième signifie : quâ? Il y a eu un changement de sens analogue pour les ablatifs latins quâ, eâ, Mo, qui, en tant quadverbes de lieu, marquent le mouvement vers un endroit. Pareille chose est encore arrivée en sanscrit pour le suffixe tas, qui, quoique destine a marque 1 l’éloignement d’un lieu, c’est-à-dire la relation de 1 ablatif, se rencontre dans des formes pronominales avec le sens du locatit et même de l’accusatif1. On ne peut donc s’étonner ,si nous regardons comme d’anciens ablatifs les formes de l’ancien slave tamo «illîc », jamo «ubi » (relatif) et kamo «quô?». Elles contiennent le pronom annexe dont il a été question plus haut (S 167 et suivants), avec suppression de s, comme en lithuanien et en haut-allemand. Or, le datif tomov tomu «huic» répond au sanscrit tasmài, au borussien ste-smu, au lithuanien ta-m, au
que l’ablatif. (Comparez ce que j’ai dit sur ce sujet dans le Bulletin mensuel de l’Académie de Berlin, i848, p. 133.)
1 Par exemple, dans un passage du Mahàh'ârata (la Plainte du Brahmane, I, ao, p, 53) : Yatah kéêman tatô ganium (yatali, par euphonie pour yatm, tato pour tu tas) «là où (est) le bonheur, là (il faut) allers.
gothique tha-mma-, le locatif toml tarai «in hoc» répond au sanscrit U-smin, au zend ta-hmi1; tanw «illîc» ne peut donc être rapporté qu’à l’ablatif Usinât, car, en dehors du datif, du locatif et de l’ablatif, il n’y a pas addition du pronom annexe. II faut admettre que la long du sanscrit -smâ-l s’est abrégé, et que l’a bref est devenu o, comme il est de règle a la fin des thèmes en ancien slave (§§ 9 a0 et a 5 7 ). Le premier a bref du sanscrit U-smâ-t s’est, au contraire, conservé dans la forme ta-mo; il s est affaibli en 0 et en ï dans to-mu et to-mï, ce qui n’empêche pas de reconnaître dans ces trois formes un même thème, à savoir ta = le sanscrit et le lithuanien ta, le gothique tha et le grec to. De même que tamo a conservé son a médial, de même un» jamo s où» (relatif) = sanscrit yâ-smâ-t «a quo, ex quo, quare», a résisté à l’influence euphonique de la semi-voyelle -.jamo présente encore ceci de remarquable qu’il a conservé la signification relative du thème sanscrit Hya, lequel, partout ailleurs, a pris, dans les langues lettes et slaves, le sens de «il»; exemples : lithuanien ja-m, ancien slave ,KA\oy je-mu * à lui»; locatiflithuanienjja-me, slave, h-Mkjm**.— Kamo «où?» (avec mouvement), en slovène ko-mo, répond au sanscrit kâ-mâ-t, et n admet pas de composition comme les autres pronoms interrogatifs slaves (§ 388).
S i83‘, A. L’ablatif en arménien. — Tableau comparatif de l’ablatif.
11 a déjà été question de l’ablatif ossète, qui est terminé en et, pour e-t \
1 Cette forme ne'se trouve pas dans les textes zends, mais théoriquement elle ne
fait pas de doute (S a01).
2 A côté du mot jamo nous trouvons un pronom amo qui a le même sens. U est difficile de décider si jamo vient de amo par la prosthèse ordinaire du j, ou si, au contraire, le j à b jamo a été supprimé dans «mo. Dans le premier cas, *mo aPPar' tiendrait au thème démonstratif sanscrit a, et le tout nous représenterait 1 abiatu
«art Ï n|
* Voir S 87,1* C’est ici le lieu de remarquer que üamei ne signifie pas seuleme
Nous passons donc à l’arménien, dont l’ablatif est particube-renient digne d’attention. Dans son traité Sur les origines ariennes de l’arménien1, Fr. Windischmann appelle encore
l’ablatif une forme énigmatique.
Nous croyons qu’il faut partir de cette observation, que 1 arménien, qui appartient au rameau iranien de notre famille de langues, a supprimé, comme plusieurs autres idiomes dont nous avons déjà parlé, la dentale qui se trouvait primitivement être finale. Ainsi il fait, à la 3* personne du présent, ber-è* «il porte», qu’on peut mettre en regard de la i" ber-e-m et de la 2e ber-e-s : à la 3e personne, la caractéristique b e, qui tient la place de l’a sanscrit et zend, s’est allongée en b tt pour compenser la suppression de la dentale. D’après le même principe, je regarde In* é des ablatifs tels que himan-ê (thème himan «base») comme un reste de et: je rapproche himan-ê des ablatifs zends tels que caman-ad et des anciens ablatifs latins tels que covention-id, dictator-ed3. Dans la déclinaison des thèmes
«d’où?», mais encore «de qui?» et «par qui?». En général, dans le dialecte deciH par G. Bosen, et qui appartientà l’ossète du Sud, l’ablatif et l'instrumental se confondent. Mais ce qui prouve que la désinence ri se réfère à 1’ablat.f sanscrit et zend et non pas à l’instrumental, c’est le pronom annexe : en effet kamm (ka-me-i) répon au sanscrit kâ-mâ-t, au zend ka-hmd-d; «-tari (u-me-,) «de lui, par lui» répond au sanscrit a-smdrt, au zend a-hmâ-d «par celui-ci». Si c’était l’instrumental, au lieu de
Ua-mei, il devrait y avoir lèei = zend kâ, sanscrit kê'-n-a.
^ Dans les Mémoires de l’Académie de Bavière, i" classe, a0 section, t. IV, p. 38.
* Gomme les désinences modela .«etdelaa* personne ont perdu U ^des désinences sanscrites mi, si, il n’est pas nécessaire de tenir compte de il de ttî ** a la 3e personne : nous expliquons donc ber-é par une forme ancienne ber-e-t.
» Petermann (Grammaire arménienne, p. 108 etsuiv.) regarde comme la, terminaison primitive de l’ablatif singulier, et il fait venir cette forme en de la1 prepo-sillon failni «in, «nm, per, propter, sub» (ouvrage cité, p. *55). 11 reconnaît fe to-minaison ri. dans les pronoms des deux premières personnes (ablaüf .«en, f«) les pronoms démonstratifs, dont il regarde la sjllabe finale né comme unemelalhtso pourrit («mené, aimnmé). En supposant que né fût en effet une transposition pour én, j’expliquerais IV de ri» comme étant un reste dé l’ancien ablatif et, et dans « je
en a \ k é répond au sanscrit d-t, au zend à 1 ancien
perse et au pâli â. Par exemple stanê2, du thème arménien stana «pays», répond au sanscritstanâ-t, au zenà stânâ-d, au pâli tânâ; en effet le £ ê arménien représente, la plupart du temps, le â sanscrit. Dans la déclinaison pronominale, qui, comme Ta montré Windischmann, a gardé le pronom annexe sma (S 167 et suiv.), mais eu supprimant le s de sma, nous trouvons des ablatifs en mê correspondant aux ablatifs en smâ-t du sanscrit, en hmâ-d du zend et en smâ ou hmâ du pâli. En effet, la comparaison des ablatifs pronominaux en mê avec les datifs en m
reconnaîtrais une enclitique pronominale, comparable au c du latin hû-c ou au nam de quimam, etc. ou bien encore au eh des accusatifs allemands mi-ch, di-ch, si-ek (gothique m-U, thu-h, si-h, S 3a6). Mais il n’en est pas ainsi, selon moi, et je regarde ne comme la forme primitive et ine-n, qê-n comme étant pour mc-né, qe-ne. Cette syllabe né est une particule qui est venue se joindre à l’ablatif de ces pronoms : ce qui le prouve, c’est que nous la retrouvons à l’ablatif pluriel noi-a-nè
«de ceux-ci?)) jointe à la désinence ordinaire .y £ (voyez SS 215 et 872, 3). Je ne vois pas de raison pour admettre que dans une période plus ancienne de la langue les autres pronoms, ainsi que tous les substantifs et adjectifs, aient eu celle enclitique ne ou n. Mais en admettant même que cela ait eu lieu, et que ne ou n soit en effet le reste d’une ancienne préposition, il n’en résulte pas moins que l’ablatif régi par celte préposition a dû avoir primitivement une désinence casuelle, dans laquelle on pourrait reconnaître la mutilation de la terminaison t de l’ablatif sanscrit. Je rappelle l’ablatif du pronom de la tre personne, en ancien perse, ma «de moi», qui correspond au sanscrit mat, avec suppression régulière du t final. ^
» L’instrumental est, parmi les cas du singulier, celui où l’on reconnaît le mieux quelle est la vraie voyelle finale du thème. Le t> de l’instrumental, qui devient b après une consonne, correspond, ainsi que l’a reconnu avec pénétration Fr. Windischmann (ouvrage cité, p. ad et suiv.), au b sanscrit de quelques désinences casuelles de même famille (S ai5 et suiv.). On peut noter à ce propos une rencontre carieuse, bien que fortuite, de l’arménien avec les langues lettes et slaves, qui ont également à l’instrumental singulier une désinence rappelant de près celle de l instrumental pluriel. En lithuanien, par exemple, mi au singulier, «us (— sanscn
bis) au pluriel. .
a Je laisse do côté à dessein la préposition, qui parait sous la forme . devant les
consonnes, sous la forme fi (venant de j) devant les voyelles . dans le dernier cas se joint dans l’écriture avec 1p mot régi.
prouve bien que mê tient la place du sanscrit -smcî-t, et m celle de smai : rapprochez, par exemple, or-mè (avec la préposition : ti-or-mê) ^quo» (relatif) de oru-m «cui». On voit qu’au datif la déclinaison pronominale a éprouvé exactement la même mutilation en arménien qu’en lithuanien et en haut-allemand moderne. On peut comparer le m de oru-m «cui» (d’après la prononciation d’aujourd’hui, worum) avec le m des formes lithuaniennes comme Im-m «à qui?» (pour le borussien ka-smu, le sanscrit kâ-smâi) et le m du haut-allemand moderne, par exemple dans we-m, de-m.
En arménien, comme en pâli et en prâcrit, et comme en lette, le pronom annexe a pénétré de la déclinaison pronominale dans la déclinaison des substantifs; les seuls toutefois qui l’admettent sont les thèmes en o (4a déclinaison), lequel o devient ne. u devant le m en question; exemple : mardu-m ^homini» à côté de mardoi (prononcez mardô). Le pronom annexe se trouve aussi à l’ablatif des mots de cette classe (Petermann, p. 109), mais la voyelle finale du thème e^t supprimée {ag-mè, au datif agu-m). Il n’y a d’ailleurs aucune raison pour faire dériver l’ablatif du datif, puisqu’on sait, par la comparaison avec les autres idiomes, que le pronom annexe appartient également à ces deux cas.
Dans les thèmes en i \ je regarde la désinence de l’ablatif ê, 305
par exemple dans upuit; srtê «du cœur», comme le gouna de l’i du thème ; je rapproche ces ablatifs arméniens des génitifs-ablatifs sanscrits en é-s (§ 102) et des ablatifs zends en iç4? * '
parez srtê avec les ablatifs sanscrits comme agnê-s « igné », venant de agnê-t, du thème agnî. Voici quelques exemples où le k ê arménien correspond à la diphthongue sanscrite a, venant de ai: #£ gês-q «cheveu», en sanscrit kêsa; mèg «brouillard », en sanscrit mêgd « nuage » ; têg «lance », de la racine
sanscrite tig «aiguiser» (venant de tig}, avec le gouna têg; de la le substantifIfs^têgas «pointe, éclat» 305. En ce qui concerne la double origine de l’d arménien, qui répond a la fois a la et à 1 e
en sanscrit, on peut comparer Yê latin (§5)-
Pour la formation de l’ablatif, on peut consulter le tableau
comparatif suivant :
Sanscrit.
dsvâ-t2 Jcâ-smâ-t ui'vâray-âs3
*r. A _
pri tes
Zend.
aspâ-d
ka-hmârd
âfritôi-d
Latin.
alto-d
Osque.
Arménien.
preîvatùrd stanê
or-me
prœdttrd navaîe-d(
toutdrd
slami-d
srtê
Irumental singulier, l’arménien srti-v (venant de srdi-b) du lithuanien èirdi-nn (ve nant de Sirdi-bi, S 161).
1 Voyez Bôtticher dans le Journal de la Société orientale allemande, IV, p. 363.
2 II est entendu que la comparaison se borne a la desinence; il serait impossible, dans les tableaux comparatifs de ce genre, de n’admettre que des mots ayant même thème.
3 Voyez S îoa. Le zend urvarâ signifie «arbre», le sanscrit ui'vârâ «champ cultivé».
4 On pourrait aussi attendre navali-d, par analogie avec tnari-d. Si, dans un temps où les consonnes finales n’avaient pas encore pour effet d’abréger la voyelle précédente, cet e était long, on pourrait le regarder comme le gouna de l’t et comme le représentant régulier de Yê sanscrit (S 5). LV de navalê-d serait alors le même ê qui s’est conservé au pluriel navales (S a3o). Au sujet de mari-d, on pourrait faire observer qu’en sanscrit les thèmes neutres en i et en u ont moins de propension pour le gouna que les masculins et les féminins : ainsi, au vocatif, nous avons à côté de vïïrê, mddïï, les formes vfâ'i, inâdtL.
magistratu-d
prœsent~ed prœsent-id ........
coventîon-ici2........hîman-ê
dictatôr-ed ........dster-ê.
Sanscrit.
Zend.
Latin. Osque.
395
Arménien.
(hirtry-as
sûno-s
iancb-Sj tanv-ds
• r fi
vis-as
Hocat-as (védique) vàrtman~as
barëtry-âd anhau-d, mainyëu-d tanau-d, tanv-ad vîs-ad saucant-ad
Comparez encore à dévâ-t les formes grecques comme ôp.co-$ (= sanscrit sama-t) et les formes ossètes comme arsei (= sanscrit. rksâ-t, venant de ârksâ-t) ; à kd-smâ-t l’ossète ïïa-mei, le slave ka-mo.
g i83b, î. De la déclinaison arménienne en général309.
L’ablatif a été pour nous la première occasion de comparer, d’une façon détaillée, l’arménien aux autres langues indo-européennes; nous examinerons à ce propos les faits les plus saillants de la déclinaison arménienne.
Parmi les thèmes terminés par une consonne, la plupart
finissent en arménien, comme dans les langues germaniques, par n ou par r. Les premiers sont très-nombreux et suppriment, comme en général tous les thèmes finissant par une consonne, le signe casuel au génitif et au datif; exemples : akan «oculi, oculo», dster «filiæ» (génitif et datif). Au nominatif, le thème est mutilé; exemples : akn «oculus», dustr «filia»1. Il ne faut donc pas, quand on étudie la déclinaison arménienne, partir, comme on le fait d ordinaire, du nominatif singulier, ni admettre qu’une portion des cas obliques des mots en n et en r insèrent une voyelle entre cette lettre et la consonne précédente, ou que le thème s’élargit à l’intérieur (Windischmann, ouvr. c. p. 26). Au contraire, le nominatif abrège le thème et opère des contractions souvent fort dures. Pendant que les thèmes terminés par une voyelle suppriment la voyelle finale au nominatif, les thèmes tegninés par une consonne rejettent la voyelle qui ia précède. If est certain que akn «oculus» n’appartient pas au thème sanscrit âkêi, mais au thème secondaire aksan, d’où dérivent les cas très-faibles de ce mot irrégulier (voyez mon Abrégé de grammaire sanscrite, § 169); aksan rejette dans ces cas le dernier a, comme le fait le thème arménien au nominatif-accusatif-vocatif. On peut donc, en ce qui concerne la mutilation du thème, rapprocher uil(u akn des datif et génitif sanscrits aksn-ê, aksn-as; inversement, le datif et génitif arménien akan 2 répondra, en sanscrit, au thème complet aksan. La même comparaison pourrait se faire pour les thèmes en r : ainsi dster
• « '
1 U en est de même ata vocatif et à l’accusatif, avec cette différence seulement que ce dernier, dans la déclinaison des noms déterminés, prend le préfixe n s. La mutilation dont il est question peut être rapprochée de celle qu’éprouvent en gothique les formes comme brôtkar, dauhtar, qui font au génitif et au datif brôthr-s, brôthr, dauhtr-s, dauhtr.
2 Au nominatif pluriel u#£fii_ïïg akunq l’a s’est affaibli en «, comme cela arrive très-fréqtaemment, à peu près comme nous avons, en vieux haut-allemand, le datif pluriel tagu-m en regard du gothique daga-m.
(dalif et génitif) répond au sanscrit duhitâr, au grec BvyotTsp, au gothique dauhtar, tandis que le nominatif dustr correspond au sanscrit dukitr, au grec 3-uyarp, au gothique dauhtr des cas faibles.
Le mot himan-ê (ablatif), cité plus haut, est formé d’un suffixe qu’on retrouve en sanscrit sous la forme mant et qui joue aussi un grand rôle dans la déclinaison faible des langues germaniques (8,799). Peut-être himan «base»,
nominatif hîmn, est-il identique au sanscrit sîman «frontière» (racine si «lier»), avec le changement ordinaire aux langues iraniennes de s en h. Je crois retrouver dans at-a-man «dent», nominatif apimn, la racine sanscrite ad «manger», qui est commune à toute la famille indo-européenne. Le verbe arménien dérivé de la même racine a affaibli l’ancien son a en u (nL.uthJ* utem «je mange»), au lieu que dans le mot ataman «dent» Va s’est conservé; de plus, une voyelle euphonique a été insérée dans ce dernier mot entre la racine (et le suffixe, comme, par exemple, dans le vieux haut-allemand wahs-a~mon (nominatif ivahs-a-mo) «fruit», littéralement «ce qui croît», qui ferait, en gothique, vahs-man, nominatif vahs-ma^§ 1 &o). Au nombre des mots arméniens en n, je mentionne encore le thème san «chien» (= sanscrit smw), dont le nominatif sim se rapporte à la forme contractée des cas très-faibles (sun, grec xuv).
Parmi les thèmes arméniens en n (ces thèmes, dans le Thésaurus Unguœ Armemcœ de Schrôder, comprennent les trois premières déclinaisons), il ne manque pas non plus de formes rejetant la nasale au nominatif, suivant un principe que nous avons reconnu être fort ancien (§ 189 et suiv.). Mais comme en même temps on supprime la voyelle de la syllabe finale, de la même manière que si n était conservé, on arrive à des formes comparables aux mots bar, ochs, mensch, nachbar du haut-aile-mand moderne, lesquels viennent des thèmes bâren, ochsen1 (sanscrit iiksan, nominatif ükéâ), menschen, nachbarn. Voici des exemples de mots de cette sorte en arménien : q-euin^um galust k arrivée », ufut^ni-itin pahust « protection », ubmLbq. snund « éducation»; génitif : galustean, pahustean, snundean (voyez la 2e déclinaison de Schrôder).
Outre les thèmes en n et en r (/* r ou r), il n’y a d’autres thèmes terminés par une consonne que ceux qui finissent en g (Ae déclinaison de Schrôder). Mais, comme cette lettre est de la famille de /2, et comme les liquides r et l sont presque identiques (S 2o), on peut admettre aussi une parenté primitive entre g et r, et on peut s’attendre à voir le 8 remplacer un ancien r. C’est ce qui arrive, en effet, pour le mot trqjzuMjg egbair «frère», dans lequel je reconnais, comme Diefenbach3,
1 Le thème arménien esan, nominatif esn (sanscrit ùhêan, nominatif ükéd) a perdu la gutturale, comme cela est arrivé pour le zend aêi « œil r>, en sanscrit âksi, En ce qui concerne l'affaiblissement de l’a en i dans la syllabe finale du thème, le génitif-datif esin s’accorde très-bien avec le vieux haut-allemand oksîn (mêmes cas) et avec le gothique auhsin-s, auhsin. De même que le thème gothique auhsan et toutes les formations analogues, te mot arménien congénère et tous les autres mois de la 3* déclinaison de Schrôder ont tantôt a, tantôt i dans la syllabe finale. On a, par exemple, à l’instrumental esatnb (pour esan-h) et au pluriel h-qufhg esanz comme datif-ablatif-génitif (§ ai5), tandis que le nominatif est e&in-q. En général, dans cette déclinaison l’a prédomine; la voyelle affaiblie * ne paraît au pluriel qu’au nominatif (qui est porté, comme le nominatif singulier, à affaiblir le thème) et dans les cas qui se forment du nominatif; au singulier, on ne rencontre i’* qu’au génitif-datif, tandis que l’ablatif, comme le nominatif, supprime tout à fait la voyelle (em-ê), d’ac-cord-en cela avec les formes sanscrites telles que niïmn-as.
3 Dans l’alphabet arménien le g occupe, en effet, la place du A grec. Les lettres particulières à l’arménien ont été, il est vrai, intercalées parmi les lettres communes au grec et à l’arménien; mais tj_g prend véritablement la place du A et se range après le h (4), dont il est séparé par deux lettres qui manquent à l’alphabet grec, le
h et le A que nous transcrirons par Ç. La place du K grec est occupée par le s, ce qui prouve qu’à l’époque où l’alphabet arménien a été arrangé, le K avait la valeur d’un s doux. ,
3 Annales dé critique scientifique, 1803, p. hh7.
le mot brait', avec la métathèse de la liquide, si ordinaire en arménien, et la prosthèse d’une voyelle euphonique. La désignation arménienne de « frère» ressemble, sous ce double rapport, au mot correspondant en ossète, arrnde (S 87, 1). Dans ni-qui ugt « chameau », forme très-aîtérée du sanscrit éstra, l’ancien r a également été déplacé; en effet, je reconnais dans le q_g, non pas le s sanscrit, mais le r transformé. Parmi les thèmes de la 4e déclinaison de Schrôder, qui se terminent tous en ji_ g, mais qui, au nominatif et dans les cas de forme identique, suppriment Ve dont ce ^ g est précédé, nous trouvons, entre autres, le thème tuumbq^ asteg « étoile », nominatif astg, qui, étant admise l’identité de g et de r, rappelle aussitôt le védique stâr, str, le zend stâr (stârë, § 3o) et le grec dcrltfp. 11 y a même entre le mot arménien et le mot grec ce rapport particulier, qu’ils ont pris tous les deux au commencement une voyelle euphonique, sans laquelle le nominatif arménien (stg) serait impossible à prononcer. Cette prosthèse pourrait faire passer le mot arménien pour un terme emprunté à la langue hellénique, si nous ne savions que le procédé en question est tout aussi familier à l’arménien et à l’ossète qu’au grec ; nous venons d’en avoir un exemple dans e-gbair310.
Parmi les thèmes arméniens en bq^ eg, il y a plusieurs composés en !{binbtj^ keteg, nominatif ketg; exemple : qarketg « amas de pierres». Ce keteg rappelle le sanscrit ksêîra «lieu, place», dont la syllabe finale a pu aisément se transposer en tar, qui a dû donner en arménien teg, b e étant le représentant le plus ordinaire d’un a sanscrit. .
Outre la lettre b e, on trouve très-fréquemment n 0 et hl. u
comme tenant lieu de Ia sanscrit; aussi les mots sanscrits en a, qui ont fourni au grec et au latin la ae déclinaison et au gothique la ire (forte), se sont-ils divisés en arménien en trois déclinaisons1 : la irc comprend les thèmes en u» a, la 2e les thèmes en n o, la 3° les thèmes en hl. u; l’instrumental pour ces trois classes de mots est a-v, o-v et u (ce dernier sans désinence casuelle)311 312. On a déjà donné plus haut (8 i83“, h) un exemple de la déclinaison en a, à savoir starn, nominatif stan (— sanscrit siana-m «place»), instrumental $tana-v; mardo khomme» est un exemple de la déclinaison en o; il fait au nominatif mardf au génitif mardoi, à l’instrumental marda-v. Le sens étymologique de mardo est «mortel»; par sa forme, mardo se rapporte au thème sanscrit mrid, ou plutôt marta «mort»; comparez le grec j6por<$, pour ptpoT<$, qui est lui-même pour fiopj6. L’o du thème arménien est donc identique avec la voyelle finale du mot grec congénère. A la même racine qui a donné mard, je rapporterai marmin «corps» , en tant que «mortel, périssable»313 (thème marmno ou marmni)\ dans la seconde syllabe, je reconnais le représentant du suffixe sanscrit mâna, zend mana ou mna, grec ptévo, latin mnô (al-u-mno, Vert-u-mnô). Au thème grec répond, quant à la racine et au suffixe,
l’arménien inni-pn turo «don», nominatif turf de la racine sanscrite dâf dont Yâ s’est probablement d’abord abrégé en arménien et ensuite affaibli en hl. u. Dans le thème dio (pour divo), nominatif Æ «idole, faux dieu», génitif dioi (prononcez dtê), je reconnais le sanscrit dêvd avec mutilation de la diphtbongüe ai (devenue par contraction ê) en t, uigéwf9- ar&i, thème arlatOf se rattache au sanscrit ragatà-m «argent», avec méta-thèse de va en ar, comme dans le latin argentum et le grec âpyvpos, qui appartiennent à la même racine sanscrite râg « briller » (venant de râg). .Dans le suffixe uno, nominatif un, de formes comme q-kuinui# getun «sciens, conscius», je reconnais le suffixe ana, grec avo (§ 93o). Comme exemples de thèmes ayant nu u (10e déclinaison de Schroder), au lieu de la sanscrit, nous pouvons citer kênu «troupe», nuqtnnu ugtu «chameau», t^mjnu kowu «vache», nominatif kên, ugt, kow. Le premier de ces mots répond au sanscrit sêhâ (féminin) «armée»1; mais comme l’arménien, qui ne distingue pas les genres, n’a, en réalité, que des masculins314 315, il faut supposer un thème masculin sêha coexistant à côté de sêhâ. Nous en dirons autant pour le thème arménien kowu «vache», nominatif tini/^kow, qui, par sa forme, est un masculin et se rattache au thème sanscrit gava «veau», lequel ne paraît qu’en composition316. On peut encore expliquer le thème arménien kowu d’une autre façon : on peut le faire dériver du sanscrit gd (venant de gau), en supposant que l’arménien, ne pouvant décliner la diphthongue 6 (ou plutôt au), lui a adjoint un a, qui s’est affaibli en u; de là le thème kowu, et, par apocope, le nominatif kow317. Le thème sanscrit nâu «vaisseau» s’est élargi de la même façon en 'bwunu navu, d’où vient le nominatif nav; le thème latin navi est formé d’une manière analogue, par l’adjonction d’un t.
S i83\ a. Alphabet arménien. — Du 3 z arménien.
Comme l’arménien reviendra encore souvent dans la suite de cet ouvrage, nous donnerons ici, comme nous l’avons fait plus haut pour les autres idiomes, l’alphabet avec la transcription adoptée pour chaque lettre.
1. a ;
а. p b 1 ;
3. * £ ;
A. n- d;
5. tr e318 319 320 321 322 323 324;
б. i_s (s doux);
7. k ê;
8. n ë;
9. P h
10. s (le7 français, le îfi slave);
11. t *j
iâ. t^l;
i3. p» iï;
15. k;
16. 4 h;
17. A | (ds):
18. nff (venant de l ou de r, S 183 !\ 1 );
19. **(<«);
20. *r m ;
21. j S (A doux initial), i1 ;
22. ^ n;
23.
26. n o2;
jusqu’à un certain point, identiques, car elles représentent toutes les deux la moyenne palatale (sT^ g) dans les mots dont la forme correspondante existe en sanscrit (sur ^ — dé, voyez S là). Toutefois 5 Ç représente plus souvent le sT^ que ne le fait On peut comparer ¥huîubi^ Qnancl «engendrera avec la racine sanscrite gan (même sens); Zpr «vieux» avec garant (thème faible garai.) «vieux», grec yépovt; tuph-utfi ar{at «argent» avec ragatà; tpuhiA gan£ «trésor» avec gangâ «lieu où l’on mettes trésors». Mais de même que les palatales sanscrites sont sorLies d’anciennes gutturales, de même il est arrivé fréquemment qu’une ancienne gutturale , notamment (t (= j£ prononcé mollement, S a3), s’est changée en arménien en 5- £ ou en J £; exemples : oA ôt «serpent» = sanscrit ahi-s (védique âhÀ~s, grec AfuJb iiun «neige», en sanscrit himâ-m (racine /m); {i «cheval», en sanscrit hàyâ-s (racine hi) ; AUrCu Zern «main» (thème 1er an, génitif-datif lerin) répond, quant à la racine, au sanscrit fyârana-m «.main», en tant que «celle qui prend», et, quant au suffixe, à an (S 92à). Nous avons un exemple de h sanscrit changé en $* £ dans Æ5- mei «grand» (thème mêla, instrumental mc^a-v) — védique mâha-s.
1 Le j initial, qui se prononce aujourd’hui comme un h, est l’altération du son !£^y ; ainsi Hasel «sacrifier» répond à la racine sanscrite yag (même
sens). De même pour les noms propres ff’akobus, H’udas, H’ossp, etc. A l’intérieur des mots, et à la fin de quelques mots monosyllabiques, j précédé de tu a et de n 0 forme avec ces voyelles les diphthongues ai et ni, a 0 se prononçant u quand il se trouve darts cette combinaison (voyez Petermann, p. B1); exempl es : uyi_ail «alius» ~ sanscrit ünyâ-s; /nju luis «lux» = sanscrit rue, nominatif ruh, A la fin des mots, excepté dans quelques monosyllabes, le j i de ces diphthongues n’est plus prononcé : je le conserve toutefois dans la transcription. On peut comparer cet t muet avec l’iota souscrit en grec. La voyelle précédente devient alors longue; exemple : Jiup^oj tnardoi=mardq>,
8 Cette voyelle se prononce aujourd’hui avec un n prosthétique (no); avec j elle forme la diphthongue ui, qui anciennement se prononçait peut-être oi. On a déjà fait
i
a5. i_ o (/s);
26. n f;
a7- tê (*)«
28. «- r (rdur):
30. £w;
31. "* t;
3s. r (r mou);
33. g % (te);
3k. *- v devant les voyelles, u devant les consonnes et à la fin des mots1 ;
35. $ p; t
36. # q (souvent pour le sv sanscrit, comme ^q en
zend,S 35); ^
38. £ /.
On voit que l'alphabet arménien contient un grand nombre de lettres marquant un son dental suivi d’une sifflante, à peu près comme le Ç grec (= <$er), le j anglais (= di), ou le z allemand (= t$). La question se présente donc naturellement, si une ou plusieurs de ces lettres ne proviennent pas, comme on Fa montré plus haut pour le £ grec (S 19), du son Or, pour î e g z~t$, qui joue un si grand rôle dans la déclinaison des noms et des pronoms et dans la conjugaison des verbes, j’ai pu constater que, partout ou il sert à la flexion, il s explique par le ^y sanscrit , et que les formes en question répondent à des formes sanscrites ayant la lettre \ y. Il sera bientôt question (SS 2i5, 2ÔÔ) des désinences casuelles qui contiennent un
observer (§ 183 b, i) que le a simple répond étymologiquement à Ta sanscrit, comme 6 ptnpév en grec et O en slave. Schroder attribue dans toute position à la voyelle « la prononciation uë ou zto.
1 Précédée de a 0, la lettre i_ exprime la voyelle brève u; exemple : dustr «fille» (thème dwter), pour le sanscrit dtihitâ(thème duhitâr), slave dûéti,
génitif diiéter-e.
3 z; mais il me paraît à propos de jeter par avance un coup d’œil sur la conjugaison, parce quelle répand du jour sur la déclinaison des noms et des pronoms, de même qu’elle en reçoit à son tour des éclaircissements.
Nous commencerons par le subjonctif présent. Nous avons pour le verbe substantif ligbiTizem, qui correspond au potentiel sanscrit syâm; ce dernier est pour asyâm, comme s-mas ttnous sommes» est pour amas, dorien êcr^tés, lithuanien es-me. L’arménien a conservé, comme le grec, la voyelle radicale, en affaiblissant, ainsi qu’il arrive très-souvent, Va en i, comme, par exemple, en grec dans l’impératif La sifflante a complètement disparu en arménien du verbe substantif, à moins qu’elle ne se trouve, comme je le crois, sous la forme dun r a la 3e personne du singulier de l’imparfait : £p êr (erat) = védique as, zend âi, dorien fjs (§ 53a). Le r de la 2 e personne êir (= sanscrit asfo) est, au contraire, pour le s de la flexion. Le £ ê initial de toutes les personnes de l’imparfait doit probablement, comme IVgrec, son origine à l’augment. Si nous prenons donc le g z du subjonctif pour le représentant du j, et si, comme en sanscrit, nous exprimons ce son par la lettre y, nous aurons une correspondance frappante entre les formes arméniennes iyem, iyes, iyê et le grec sîriv, efas, etij (venant de èatrjv, etc. pour sojyv), ainsi qu’avec le sanscrit (ajsyâm, {ajsyâs, (atysyât. Les verbes attributifs se combinent, comme je crois, au subjonctif présent avec le verbe substantif; on a, par conséquent, sir-izem amem», venant de sir-iyem, à peu près comme le vieux latin juc—sim, qui est, au moins sous le rapport de la forme, la combinaison de la racine avec le subjonctif de sum. Dans la 2e conjugaison arménienne, Yi d eizm, en se combinant avec Y a qui précède, forme la diph-thongue ai; exemple : MuquygtnT agaizem ^molam», venant de agd-iyemt Après le hl. u de la 3e conjugaison, 1*. du verbe auxiliaire tombe ; ainsi de log-itr-m «sino» vient le subjonctif fih*
qn^n^iTioguium, ioguzus, ioguzu, formé de loguyum, -yus, -yu. Dans les désinences, nous trouvons ici un u, au lieu de Ye des deux premières conjugaisons; ce changement s’explique par l’influence assimilatrice exercée par Yu de la syllabe précédente, qui lui-même tient la place d’un ancien âl.
Je regarde le futur arménien comme étant originairement un subjonctif aoriste, de même que le futur latin de la 3e et de la 4e conjugaison est, comme on l’a montré depuis longtemps, un subjonctif présent (S 692). Rappelons-nous à ce sujet que, dans le dialecte védique, il n’y a pas de différence pour la signification entre les modes de l’aoriste et ceux du présent, et que dans le sanscrit classique ce qu’on appelle le précatif n’est pas autre chose que le potentiel ou l’optatif de l’aoriste : comparez M-yâ~t «qu’il soit» avec âBû-t «il était». Mais si le futur arménien est identique avec le précatif sanscrit, ou avec l’optatif aoriste grec, il renfermera sans doute l’équivalent de l’expression modale ^TT yâ, en grec tn (venant de jy ), quq nous avons, par exemple, dans Ao-fVy, Ao-tV-s, <$Wî? (pour So-jy-v, etc.). C’est cet équivalent que je trouve, en effet, dans la syllabe gk ze ou zu, venant l’une et l’autre de za, et étant, comme on l’a montré plus haut, pour ye et yu; je retrouve encore le même équivalent dans le simple g z de la iro personne du singulier; exemple : tnw-g ta-z «dabo» , ta-ze-s «dabis», ta-zê «dabit», ta-zu~q (pour ta-zu-mq) «dabimus», ta-ze-n «dabunt». A la 2e personne du pluriel, où l’ancien â de la syllabe yà s’est affaibli en i, le g z devient, par l’influence de cet i, un f^g (= c&); exemple:
‘ En supposant que l’hypothèse émise ne soit pas fondée, et que le verbe substantif ne soit pas contenu dans le subjonctif présent de la 3e conjugaison, il faudrait rapprocher les formés comme tog-u-zum des potentiels sanscrits de la 8° classe (S 109“, û), tels que tan-u-ya-m «extendam», -yiï-s, -yiï-t; mais, même en expliquant ainsi ces formes, il faudrait encore voir dans Vu de la troisième syllabe un effet de l’influence assimilatrice de l’w de la deuxième.
,T,LUÊilP ^aêli « dabitis ». Nous arrivons de la sorte au même point que le prâcrit, où le sanscrit devient très-ordinairement c’est-à-dire qu’il passe de la prononciation du j italien ou allemand à celle du j anglais. Si nous remplaçons donc 3 * A é Par son primitif j, qu’en sanscrit exprime le y, le futur arménien répondra, comme nous l’avons dit, à l’optatif aoriste en grec et au précatif en sanscrit; mais il sera plus semblable au premier qu’au second, en ce que le précatif sanscrit, à la plupart des personnes, joint à la racine principale le verbe substantif, comme cela arrive en grec dans Sofacmv. L’accord le plus complet a lieu à la 2 e personne du singulier des trois langues. On peut comparer :
Sanscrit. Grec. Arménien.
|
dê-ya-sam1 |
Zo-irj-v |
ta-y |
|
dê-ya-s |
§o-/ï;-s |
ta-yes |
|
dê-ÿd-t |
ho-(r? |
ta-yê |
|
dê-ya-sma |
80-fy-pev |
ta-yu-q |
|
dê-yU-sta |
ho-ly-ts |
ta-yi-q |
|
dê-yd-sus* |
S o-fs-v |
ta-ye-n. |
A l’aoriste de l’indicatif, le verbe arménien en question a affaibli l’a radical en u, affaiblissement fréquent dans cette langue; à la 3e personne du singulier, l’a est supprimé tout à fait. On a donc : e-tu? e-tu-r (venant de e-ta-s), e^t, en regard des formes sanscrites â-dâ-m, d-dâ-s, d-dâ-t, et grecques ë-Soj~v9 i-Sûû-s, s-Sco. A la 3e personne du pluriel, si l’on fait abstraction de l’altération des voyelles, il y a accord entre l’arménien e-lu-n et le dorien e-éb-i>, au lieu qu’en sanscrit la forme primitive a-da-wt s’est affaiblie en â-du-s.
Les aoristes de l’indicatif, qui se terminent à la irc personne
' Pour dâ-yâ'-sam> §70 5.
1 Venant de dê-yâ-sant.
du singulier en zi, doivent être rapportés à la 10e classe sanscrite, à laquelle se rattache aussi, dans les langues germaniques, la conjugaison faible. J explique donc g z, par exemple, dans lit «implevi» par le ^ y sanscrit, par exemple, dans pâr-âyâmi «impleo»1. Cette classe de verbes n’a pas d’aoriste en sanscrit; elle le remplace par des formes redoublées, comme dcûcuram «je volai où il n’y a pas trace du caractère aya, ay325 326, et qui n’ont de commun avec le présent côr-âyâ-mi et l’imparfait dcôr-aya-m que la racine, et non la formation. Mais l’arménien qui, à l’imparfait, ajoute le verbe substantif au thème du verbe principal, se sert, pour l’aoriste de cette classe, de la forme de l’imparfait sanscrit327. Toutefois, de ce que les aoristes des verbes réguliers de la ire et de la 2e conjugaison arménienne se rattachent par leurs formes en bgfi ezi, tugft ait, à la syllabe finale ay de la 10e classe sanscrite, il ne suit pas nécessairement que les temps spéciaux de ces verbes appartiennent aussi à la 10e classe sanscrite; il se pourrait, en effet, que les temps spéciaux appartinssent à la conjugaison forte et les temps généraux à la conjugaison faible (s’il est permis d’appliquer à l’arménien la terminologie de Grimm), à peu près comme en latin sero (venant de seso, § 109“, 3) et strepo appartiennent à la conjugaison forte, mais sê-vi, strep-ui, à la conjugaison faible, à cause du verbe auxiliaire qui est venu se joindre au thème, et comme, en sens inverse, spondeo appartient à la conjugaison faible et spopondi à la conjugaison forte. Il se pourrait encore
A 09
qu’en arménien sir-e~m «j’aime» et ag-a-m «je mouds» (les deux verbes pris pour modèles de conjugaison par Petermann) eussent éprouvé une abréviation ou une mutilation dans la voyelle caractéristique, de sorte que sir-e-m fût pour sir-ê-m, et ag-a-m pour ag-ai-m; ê-m serait alors une contraction pour ayâ-mi, comme le prâcrit ê-mi et le vieux haut-allemand ê~m (3° conjugaison faible de Grimm, § 109a, 6); il en serait de même pour ai renfermé dans la forme supposée ag-al-m.
Au futur, ou plutôt au subjonctif, qui tient lieu de futur (c’est le potentiel sanscrit), on ajoute l’exposant du mode au thème de l’aoriste indicatif. Nous avons vu que le thème de l’aoriste se termine par g z; de son côté, l’exposant modal commence, ainsi qu’on vient de le dire, par g z = le sanscrit ^ y. A la ire personne du singulier, qui n’a pas de signe pour marquer la personne, on intercale un i euphonique (^ufiplrgpg sirez-i-z. wqutgftg agazr-i-z}. Mais, aux autres personnes, on fait suivre le second g z immédiatement, et alors le premier se change en s (Petermann, p. so7 et suiv,) : sires-ze-s «amabis», agas-ie-s «moles», pour sirez-ze-s, agaz-ze-s. Au sujet de ce changement, on peut rappeler un fait analogue qui a lieu en ancien et moyen haut-allemand, à savoir le changement en s des dentales (y compris le z — l’arménien g z) devant d’autres dentales (§102 et suiv.); exemple : weis-t «tu sais», au lieu de weiz-t.
Ramené au système phonique sanscrit, agaszes> ou la forme plus ancienne agazzes, donnerait agay-yâ-s (nous faisons abstraction de la valeur étymologique du g arménien, qui, en sanscrit, serait un r ou un /). Mais, en sanscrit, le précatif, qui n’est pas autre chose que le potentiel de l’aoriste, rejette la syllabe ay, qui sert de caractéristique dans les temps généraux aux verbes de la 1 oe classe et aux verbes causatifs ; on a, par conséquent, éôr-ya-s «que tu voles», vêd-yâ-s «que tu fasses savoir», au lieu de éômy-yâ-s, vêday-yâ-s. Ce sont ces deux dernières formes que je regarde comme les formes organiques et primitives; je ferai remarquer à ce propos un autre fait du même genre qui jette du jour sur celui que nous étudions. En sanscrit, cette même syllabe caractéristique mj est encore supprimée devant le suffixe du gérondif y a (â-vêd-^ya, pour â-vêd-ay-ya); mais ici elle ne disparaît pas entièrement, car on la conserve, si la syllabe radicale a un a bref. Comparez vi-gan-ay-ya aux formes comme ni-pât-ya (de ni-pât-ay « faire tomber»), où rallongement de Va radical annonce suffisamment le causatif, même après la suppression de la syllabe ay. C’est ainsi que dans bâd~ya~s «que tu fasses savoir» (au lieu de bôcf-ay-yâs}, le causatif est suffisamment marqué par le gouna, qui distingue cette forme de bu$-yâ-s «que tu saches». Je fais encore observer que le sanscrit, pour empêcher la rencontre de deux ^y, qu’il évite autant que possible, supprime aussi la caractéristique causale 'ipj ay devant la caractéristique du passif ya; exemple : mâr-yâ~tê «il est tué» (littéralement «il est fait mourir»), au lieu de màray-ya-tê.
L’arménien gï, comme venant de ^y (j), a aussi des analogues en zend. Ainsi la racine mar, mr «mourir» change au causatif le ^y sanscrit en p é, qui dans la prononciation équivaut à ts; elle fait donc mërëc, et, avec insertion d’une nasale, mërënc «tuer», c’est-à-dire «faire mourir» (= sanscrit mâray). A ce verbe se rattachent l’impératif moyen mërëncanuha «tue» (= sanscrit mârâyasva, S 721) et Ie nom d’agent mërëMtâr328 «meurtrier», ainsi que le désidératif moyen mimarëUsanuha (2e personne de l’impératif moyen), mimarëUsâitê (3e personne du subjonctif). Il y a encore, selon toute vraisemblance, une autre forme zende, où nous voyons la semi-voyelle sanscrite ^ y se changer en p c~ts, et ensuite, à cause de la sifflante qui suit, en h U : c’est la forme Usmad (sur Us, voyez § 5a ),
’ Avec changement de c en c^ K, à cause du t suivant.
au lieu du sanscrit yuêmât (pronom pluriel de la 2e personne). 11 est difficile de croire que 1 e^y de la syllabe initiale yu, que le zend a laissée intacte* dans les formes comme yûsmad, yûsmâkëm, soit devenu une gutturale sans transition; je pense que yu est devenu d’abord eu ou eu, et ensuite, après la suppression de la voyelle, U; en effet, une fois la voyelle supprimée, la combinaison es ou c's devenait aussi insupportable en zénd que le seraient en sanscrit és ou es, qui doivent se changer en ^Jc§, par exemple dans vâkê-ü, de vâc «parole»2.
Je ne mentionnerai plus qu’un mot arménien, unique en son genre, où un ^y sanscrit s’est changé en£_g = ds, comme nous avons vu ci-dessus que cela est arrivé pour la 20 personne plurielle du futur : c’est « milieu », qui répond évidemment
au sanscrit mddya. Mais le g arménien ne doit pas être considéré comme représentant à la fois les deux lettres sanscrites d'et y : il faut supposer que le est tombé et que, par compensation, la voyelle précédente a été allongée (ê=â). Le est donc une altération du ^ y sanscrit, et s’explique de la même façon que le Ç grec dans <pu-?a, qui sont pour
<TXtS-ja, Quy-ja (§19).
GÉNITIF.
S 184. Désinence du génitif.
A aucun cas les divers membres de la famille indo-européenne ne s’accordent d’une façon aussi complète qu’au génitif singulier. Il n’y a d’exception que pour le latin : dans les deux premières déclinaisons et dans la cinquième, ainsi que dans les pronoms des deux premières personnes, le latin a perdu la désinence pri- 328
mitive et Ta remplacée par celle de l’ancien locatif. Les désinences sanscrites pour le génitif sont s, as, sya et as. Les deux premières sont communes aux trois genres: cependant as, dans le sanscrit classique, est principalement réservé aux thèmes terminés par une consonne328. As est, par conséquent, à s, ce qua l’accusatif am est à m, ou ce qua l’ablatif zend ad est à d.
S i85. Gouna d’un i ou d’un u devant le signe du génitif. — Le génitif
en haut-allemand.
Devant le signe du génitif les voyelles i et u reçoivent le gouna; le zend et, dans une mesure plus restreinte, le lithuanien et le gothique prennent part à cette gradation du son. Tous les thèmes en u prennent en lithuanien et en gothique un a devant la voyelle finale; le lithuanien sünaü-s et le gothique sunau-s répondent donc au sanscrit sûno-s «fîlii» (venant de sûnau-s). Pour les thèmes en i, le gouna se borne en gothique aux féminins : ainsi anstai-s s gratiæ » répond à pritê-s.
Au sujet du génitif des thèmes lithuaniens en i, voyez S 190. Le haut-allemand a, dès la période la plus ancienne, abandonné pour tous les féminins le signe du génitif ; avec les thèmes terminés par une consonne (SS 135,137), il renonce aussi au signe du génitif pour les autres genres.
S 186. Génitif grec en os. — Génitif latin en is (archaïque us).
En sanscrit, les thèmes terminés par une consonne ne prennent, pour ainsi dire, que par nécessité au génitif la forme as, au lieu de s (§ 94); en grec, cette désinence, sous la forme os, est adoptée non-seulement par les thèmes qui finissent par une 329
consonne, mais encore par ceux qui se terminent par pai u, et par les diphthongues ayant v pour seconde voyelle. On ne dit pas au génitif 'üsocfsi-s^ vsxev-s, comme on pourrait s y attendre d’après le § i85, mais 'usèert-os r véxv-os. Le latin, au contraire, se rapproche davantage de la formation sanscrite, gothique et lithuanienne, mais il ne prend pas le gouna : nous avons de la sorte le génitif hosti-s qui répond au génitif gothique gasti-s. Dans les thèmes en u (fr déclinaison), l’allongement de Vu remplace peut-être le gouna, ou, ce qui est plus vraisemblable, cette classe dé mots suit le même principe que les mots grecs dont nous venons de parler, et la voyelle qui est tombée devant s a été remplacée par l’allongement de Vu. Le Sénatus-consulte des Bacchanales nous donne le génitif $enatu-o$, qui rappelle le génitif grec. La terminaison is des thèmes finissant par une consonne s’explique d’ailleurs mieux par le sanscrit as que par le grec os, l’ancien a sanscrit s’étant affaibli en i dans beaucoup de formes latines, ainsi que cela est souvent arrivé aussi en gothique (SS 66, 67). Mais on trouve également en vieux latin us comme représentant de la désinence du génitif as; exemple : nôminus, pour nâminis = sanscrit nâmn-as (Sénatus-consulte des Bacchanales). D’autres inscriptions donnent les génitifs Venerus, Cas-tm'us, Cererus, exerckuus (Hartung, Des cas, p. 161).
S 187. Génitif des thèmes en i et en u. en zend et dans le dialecte
védique.
Au sujet de la forme senatu-os que nous venons de citer, il est important de faire observer que le zend, au lieu d’ajouter simplement un s au génitif des thèmes enw, comme dans mainyëurs (venant de mainyu), peut aussi former le génitif en ajoutant un V ^ (pour as), comme s’il s’agissait dun thème finissant par une consonne; exemple : dmkv-â ou -5^3
W»«y danhav-fi, au lieu de danhëu-s «loci» (de >«>3»<, danhu).
Dans le dialecte védique, les thèmes en i et en u peuvent prendre au génitif la forme as, avec suppression du gouna : ainsi
ary-ds, pasv-ds (de ari « ennemi », pasu « animai » ) répondent aux génitifs grecs comme 'zsqœi-os, véxv-os. De as, par 1 affaiblissement de Ya en u, est sortie la désinence us, qui est usitée en sanscrit classique pour les thèmes pâti «seigneur, époux», et sdHi «ami», au génitifpdty-us, sdUy-us. A la fin des composés, le premier - de ces noms a toutefois la forme reguliere patê-s. La terminaison us est usitée aussi pour une classe rare d adjectifs en tî (ou nî) et ïïî (voyez Abrégé de la Grammaire sanscrite,
S 162). On peut comparer avec ces génitifs en us les anciens génitifs latins comme nomin-us dont nous parlions plus haut; mais pour ces formes latines, ainsi que pour les génitifs étrusques comme Avntliial-us, Tanchfil-us où la désinence us se joint aux thèmes terminés par une consonne, nous croyons que 1 u est sorti directement de Y a primitif, sans qu il soit nécessaire de supposer une relation particulière entre ces formes et les génitifs comme pdty-us, sâïïy-us.
S 188. Génitif des thèmes en a, en sanscrit et en zend. — Génitif
arménien.
Les thèmes en a et les pronoms de la 33 personne, parmi lesquels il n’y en a d’ailleurs qu’un seul, and, qui finisse par une autre voyelle que a, ont en sanscrit, au génitif masculin et neutre, la terminaison plus pleine sya; exemples : vfha-sya «lupi», tâ-sya «Jiujus», amé-sya «illius» (S 2ib). En zend, cette terminaison paraît d’ordinaire sous la forme he (§ ùa); exemples : vëhrkahê «lupi»,
tûiryê -hê « quarti », au lieu de tûirya-hê. La désinence sya est encore représentée en zend par deux autres formes, hya 330 et *»»w^ qyâ (S 35). Elles appartiennent toutes les deux à ce dialecte plus ancien dont nous avons déjà parlé (S 3i), dans lequel, comme en ancien perse et comme dans certaines formes du dialecte védique, Va bref sanscrit s’est allongé à la fin du mot. La forme dialectale zende hyâ est identique à la forme hyâ employée en ancien perse l, par exemple, dans martiya-hyâ «hominis». Comme exemple d’un génitif zend en hyâ, nous citerons asa-hyâ «puri»; d’un génitif en qyâ, spëntaqyâ «sancti». On trouve aussi la désinence hyâ combinée avec le thème iwa du pronom de la 9° personne : iwa-hyâ «tui», forme à laquelle devrait répondre en sanscrit un génitif tva-sya. Ce génitif a dû exister en effet, ainsi qu’un génitif ma-sya pour la ire personne : ce qui nous autorise à le croire, ce n’est pas seulement la forme zende que nous venons de mentionner, mais ce sont encore les formes borussiennes twai-se atui», mcii-sei «mei», où la désinence se, sei (après les voyelles brèves sset) représente évidemment la désinence sanscrite sya.
Il est difficile de dire si en arménien la désinence r, au génitif des pronoms, par exemple dans no-r-a «illius»331 332, a quelque rapport avec la désinence sanscrite sya. Gomme s, dans les langues iraniennes, devient ordinairement h, ou disparaît tout à fait devant les voyelles et les semi-voyelles, nous pouvons être tentés de voir dans r le représentant du y de sya, hyâ; on sait, en effet, qu’en arménien y devient souvent l333, et que l et r peuvent être regardés comme presque identiques. Mais nous trou-
vons aussi r au génitif pluriel des deux premières personnes, où il est impossible de rattacher cette liquide à un ^ y sanscrit. J’aime donc mieux considérer ces génitifs arméniens, tanf singuliers que pluriels, comme des possessifs, en me référant à un fait analogue en hindoustani (§ 3ùo, note); quant à la désinence sya, j’en retrouve le ^ans J c^es génitifs arméniens en et dans le p i de la 6e déclinaison de Schrôder, la
quelle supprime Ta du thème devant la désinence casuelle. On aura alors un génitif stan-i répondant au sanscrit siana-sya et au zend stâna-hyâ1. Dans tltupq.nj mardo-i « ho minis » (Peter-mann, ùe déclinaison), je crois que le j répond au y du sanscrit mrtâ-sya (venant de marta-sya), quoique le j ne soit plus prononcé aujourd’hui et ne soit représenté que par l’allongement de la voyelle précédente (S i83\ 2); de même aussi le j du pronom relatif nfuy oro-i (prononcez orâ) «cujus» répond au y de yà-sya334 335 336. Comparez encore avec le génitif sanscrit ctnyâ-sya et le génitif grec âXkoto le génitif arménien uyiq/ ailo-i, du thème ailo «autre», qui est évidemment de la même famille (§ 189). Après ni- u (altération d’un ancien a), le signe du génitif arménien a disparu même dans l’écriture, ce qui prouve que le j dans cette position est tombé de très-bonne heure : on peut comparer nt-quim- ugtu « cameli » avec le sanscrit üstra-sya (S i83\ 1). C’est ainsi que nous avons également un instrumental dénué de flexion ugtu ou, en conservant la primitif, ugta-v. Le génitif de <hunT sam «heure» est samu, l’instrumental éamu ou sama-v337. Avec les thèmes en [i i, il est impossible de distinguer si la voyelle (par exemple, dans srti «ccrdis, cordi», § i83% A) appartient au thème ou à la désinence.
Les génitifs en uy ne sont guère employés, ce semble, que pour les noms propres étrangers, dont le thème est élargi de la meme façon qu’en vieux haut-allemand, où, par exemple,petrus a pour accusatif petrusa-n (S i A9 et Grimm, I, p. 767).
Il reste encore à résoudre une question : les datifs arméniens qui ont la même flexion que le génitif sont-ils originairement identiques avec ce cas? La réponse doit être négative, car en supposant que le génitif à lui seul exprimât en arménien, comme il le fait en prâcrit, les relations marquées par les deux cas, il y aurait vraisemblablement identité du génitif et du datif dans toutes les classes de mots, et au pluriel comme au singulier : le génitif aiîoi, par exemple, signifierait à la fois «de l’autre» et «à l’autre». Or, nous voyons que dans la déclinaison pronominale (excepté pour les deux premières personnes) le datif est terminé en m ou en ma; nous avons notamment ailu-m, qui répond au datif sanscrit anyd-smâi, au lieu que dans la déclinaison des substantifs Ti devenu muet, par exemple dans mardoi «homini», répondra 1 ï des datifs zends comme aspâi. Pour la prononciation, mardoi (lisez mardô) nous rappelle les datifs latins comme lupo (venant de iupoi). Les datifs arméniens qui (comme stâni = le zend étânâi) ont supprimé devant la désinence la voyelle finale du thème rappellent les datifs latins de la déclinaison pronominale, comme üiî., ipsî, venant de illoi,

§ 189. Les génitifs grecs en 0-10. — La désinence pronominale ius, en latin. — Le génitif en osque et en ombrien.
Le grec a conservé, ainsi que nous Lavons déjà montré ailleurs des restes de la désinence du génitif sya. Comme
il était naturel de s’y attendre, c’est dans la déclinaison des thèmes en 0, qui correspondent aux thèmes en ^ a, que nous rencontrons les traces de cette ancienne terminaison. Nous voulons parler de la désinence épique 10, par exemple dans roto. Comme le <7 doit être supprimé en grec quand il se trouve entre deux voyelles à l’extrême limite du mot, je ne doute pas que 10 ne soit une forme mutilée pour aïo. Dans toïo = «T^r td-sya (d’après la prononciation du Bengale tôsyo) le premier 0 appartient au thème, et il n’y a que to qui marque la flexion casuelle. Quant à la suppression du a- dans toîo, la grammaire grecque nous fournit encore un autre oto où personne ne peut douter qu’il n’y ait eu anciennement un <7 : en effet, $t$oïo est pour $t$Qi<TQy comme êXéyov est pour êXsys&o; cela est prouvé par êSfàoero et par tout l’organisme de la conjugaison, puisque le <7 est la marque ordinaire de la deuxième personne. C’est par une suppression analogue du <7 que nous avons toïo au lieu de zo-crto (en sanscrit td-sya). Dans la langue ordinaire, outre le a-, l’i qui suit est tombé également, et l’o qui restait s’est contracté
cher (t. II, p. A87), regarde le j du génitif arménien comme représentant le s de la désinence sanscrite sya. Il soutient que les lois phoniques de la langue arménienne s’opposent' à la disparition d’une sifflante. Je rappellerai seulement ici lés noms de nombre evin « sept » pour le sanscrit sâptan, ut «huit» pour le sanscrit àétan et le datif pronominal ailu-m «à l’autre» pour le sanscrit anyâ-smâu Si la lettre s de sya s’était conservée en arménien, elle aurait sans doute pris la forme d’un h et non celle d’un j, car cette dernière lettre, qui a pu dégénérer en aspirée au commencement des mots, n’en est pas moins, même dans cette position, le représentant d’un j primitif (8 183 b, S).
1 Du pronom démonstratif et de l’origine des cas, dans les Mémoires de l’Académie de Berlin, 1826, p. 100.
avec l’o du thème, de sorte que nous avons tov pour to-o. La forme homérique ao (Bopéao, A/vs/ao) est de la même origine : elle est pour ot-io qui lui-même est pour a-ato.
Le latin, à ce qu’il semble, a transposé la syllabe sya en jus, avec changement de Va en u, changement ordinaire en latin devant un s final, comme nous le voyons par les formes equu-s, ovi-bus, ed-i-mus, qu’on peut comparer aux formes sanscrites équivalentes dsva-s, avi-Byas, ad-mâs1. On peut encore expliquer autrement la terminaison latine jus, en y voyant une forme mutilée pour sjus, qui se rapporterait à la terminaison féminine syâs, usitée en sanscrit au génitif des pronoms. Le latin cu-jtis répondrait alors au sanscrit kd-syâs, au gothique hvi-sôs (§ 17 5 ), et aurait passé, par abus, du féminin dans les deux autres genres : ce fait serait encore moins surprenant que ce que nous voyons en vieux saxon, où le signe de la 9e personne du pluriel du présent sert aussi pour la ire et pour la 3®personne. Quoi qu’il en soit, il est certain qu’il y a confusion des genres au génitif de la déclinaison pronominale latine : car si, par exemple, cu-jus (archaïque quoius) répond au masculin-neutre sanscrit kd-sya, cette forme ne peut convenir pour le féminin, car la désinence sya et ses analogues en zend, en ancien perse, en borussien et en ancien slave ( § 2 6 9 ), ne sont employées que pour le masculin et le neutre. Il nous reste donc le choix de rapporter cujus à kd-sya, ou au féminin kd-syâs, en admettant dans ce dernier cas la suppression de s devant j, et le changement de Yâ long en u, changement
qui a pu s’opérer par l’intermédiaire d’un a bref, comme cela a
*
1 Une circonstance a pu produire ou aider ici la métathèse : c’est le sentiment confus que le génitif doit avoir pour marque caractéristique un s final. Les métathèses son t d’ailleurs fréquentes dans notre famille de langues, surtout pour les semi-voyelles el les liquides : en ce qui concerne le latin, je me contente de citer ici tei'tius de (retins pour tnt; ter de ire, en sanscrit tris, en grec 7pis ; creo de cero, en sanscrit kar, kv ttfairey>; nrgentîWî» de rapcfitutii, en sanscrit ro^ütàm (183I>, 1)5 ptihno de pltimo, en grec Tavsipwv. ,
37.
dû avoir lieu pour la désinence 'du génitif mm, qui est pour l«
w
sanscrit ^ïTVf^sâm.
Corssen propose une autre explication *, d’après laquelle la
terminaison sja serait représentée en latin par j'u, et le s final
serait une nouvelle désinence du génitif qui serait venue se
surajouter à l’ancienne. Nous avons dans les formes éoliennes et
doriennes comme époûs, èpéos, épevs (au lieu de époio) un
exemple-d’une double désinence au génitif. Cette explication,
qu’on peut admettre pour le masculin et le neutre, nexclurait
pas l’hypothèse que la désinence féminine -jus répond au sanscrit
suas (pour smy-âs)2.
Si l’on admet, comme le font Aufrecht et Kirchhoff , que .dans la terminaison osque eis (au génitif de la 2” déclinaison , l’e est un affaiblissement de lu ou de l’o du thème, et que la désinence casuelle est marquée seulement par is, on pourra voir aussi dans cetds une métathèse : Abellands, par exemple, serait pour Abellane-si, et de même ehc-ls uhujus» pour efse-st4. En effet, la seconde déclinaison, à laquelle appartiennent la plupart des pronoms 4 doit avoir au génitif masculin et neutre une désinence finissant par une voyelle et commençant par un s : or, si l’on explique is comme provenant par métathèse de si, l’analogie avec le sanscrit sera parfaite, car, après la chute de IV,, Syn devait devenir si*. Au génitif des thèmes osques en i, je
> Nouvelles Annale» de philologie et de pédagogie, i853, p. a37-
» C’est aussi à cette désinence féminine «yd. qu’il faut rapporter en.ancien slave la syllabejan de TON* lo>»«liujus»,(féminin) ; le masculin-neutre fait to-go (S a7>)• 5 Monuments de la langue ombrienne, p. 118.
‘ Le thème pronominal sanscrit « «celui-ci», qui n’est usité quau nommatil,
ferf II y a une autre explication qui rendrait compte également des génitifs en et» de la a' déclinaison osque. On y peut veir des formesmu.ilées pour ri-« .comme en mes-sapien nous avons ei-hi. LVde ri-, proviendrait par épenthèse de 1. final qui »est
ensuite perdu.
regarde et, par exemple dans Herentatei-s, comme le gouna de 1’/ du thème, de sorte que la désinence casuelle est représentée par s, comme en sanscrit, et que Yeî répond à Té du sanscrit agné-s (pour agnai-s) ttdu feu»1. Les thèmes terminés par une consonne s’élargissent par l’addition d’un i qui est frappé du gouna, exactement comme les thèmes latins de même sorte au nominatif pluriel (S 226). Nous n’avons donc nulle part^ au génitif osque, de désinence organique en is, qu’on puisse rapprocher de 1W sanscrit dans pad-ds, de l’os grec dans 1toS-6$9 de lïs latin dans ped-is ou de Yus de l’ancienne langue latine dans nomin-us, Vener-us. Nous sommes, par conséquent, d’autant plus autorisés à regarder comme une métathèse de si la désinence osque is, qui, dans la 2° déclinaison et dans celle des pronoms, correspond au sya sanscrit, au se borussien et au grec 10 (o-(o).
Les anciens dialectes italiques n’ont pas, comme le latin, effacé au génitif pronominal la distinction des genres. Du moins l’ombrien a un génitif féminin era-r «illius» (venant de era-s), qui nous induit à croire que i’osque, dont nous n’avons pas conservé de génitif pronominal féminin, a dû opposer à la forme masculine eise-is mentionnée plus haut une forme féminine eisa-s. D’après cette analogie, l’ancien latin aurait dû avoir des génitifs féminins pronominaux comme quâ-s, hâ-s, cas, illà-s, ipsâs, istâs. Le pronom ombrien que nous venons de citer fait au génitif masculin erêr (venant de ereis)338 339.
S 190. Génitif des thèmes en a, en lithuanien et en horussien.
En lithuanien, les thèmes masculins en a ont le génitif terminé en ô; exemples : dêwô «dei»; ko «cujus??. Cet ô n’est pas autre chose que la voyelle finale du thème qui a été allongée (S psa) pour compenser la suppression de la désinence casuelle; cette désinence est, au contraire, restée en horussien, où nous avons au génitif deiwa-s = le lithuanien dêwô et le sanscrit dêvd-sya. Le lette a, comme le slave, conservé au génitif la voyelle a du thème, mais il a également perdu le signe casuel; exemple: deewa (dêwa). Une autre explication de cette forme est donnée par Schleicher1 : il 'regarde 10 lithuanien comme une contraction pour aja, venant de asja. Les deux a brefs se seraient donc combinés, après la chute du j, pour former la longue correspondante. Si je partageais cette opinion, je rappellerais un fait analogue qui a lieu en gothique, où les formes laig-ô-s, laig-ô-th sont pour le sanscrit lêh-âya-si, lêh-mja-ti2. Cet exemple viendrait appuyer i’ explication de Schleicher; mais je ne puis admettre son principe, qu’un s final ne saurait être supprimé en lithuanien. Je rappellerai deux exemples qui prouvent le contraire : les désinences du présent (ire et 20 personne du duel) wa et ta sont pour les formes sanscrites vas et tas, et pour les formes gothiques os (venant de a-vas) et ts (venant de tas). En outre, au génitif
sanscrit ttdd-s «celui-là», avec changement de d en r, comme dans le latin mendies (S 17’). \
1 Mémoires de philologie comparée de Kuhn et Schleicher, I, pp. 115, 119.
2 Voyez S109 % 6. Dans l’ô du lithuanien jéSk-ô-me « nous cherchons» (c’est l’exemple donné par Schleicher, recueil cité, p. 119 ), je reconnais seulement le premier a du caractère sanscrit aya. C’est ce que prouvent le prétérit jëêlcâjau, pluriel jêékàjôme, ainsi que les formes du présent rmdéju~sanscrit rôd-âyâ-mi (S 109 % 6}- L’allongement de 1 « en ô est inorganique. En général, le lhnuanien prodigue un peu l’ô long : ainsi, au duel et au pluriel de l’aoriste, il a aussi un Ô long pour représenter le dernier a de aya : jèsk-ojo-wa, jëék-ojô-ta, jëék-ojô-me, jêék-âjô-te.
duel, s final tombe, comme il tombe aussi en zend, où nous avons 1? à au lieu du sanscrit os (S aa5 ). Quoi qu’il en soit, pour expliquer la forme lithuanienne dâvô, il faut tenir grand compte des génitifs borussiens comme deiwa-s. Or, il se pourrait que les génitifs borussiens en as provinssent de asja = sanscrit asya, par la suppression de la syllabe 'Qfya : dans cette hypothèse, la syllabe sya aurait été défigurée de deux façons différentes, d abord par la suppression de la semi-voyelle, ce qui a donné se (pour sje), et ensuite parla suppression de la voyelle L Le borussien a conservé Va, qui est le son le plus pesant, devant la terminaison la plus mutilée, tandis que devant la désinence plus pleine se, il a changé Va en e ou en ei. On pourrait aussi expliquer l’t de ei? par exemple dans steise, d’une autre façon : on pourrait supposer que Vi de la terminaison a passé dans la syllabe précédente, en sorte que steise serait pour stesie, et de même màise s de moi» pour masie, twaise «de toi» pour twasîe. C’est ainsi qu’en grec nous avons à la seconde personne du présent et du futur (pépst-s pour (pep-s-o-i - sanscrit Mr-asi, Sa-crsi-s pour Sco-as-vi = sanscrit dàsyâsi.
§ 191* Génitif gothique, — Génitif des thèmes en ar, en zend
et en sanscrit.
La désinence pleine sya s’est aussi peu conservée en gothique qu’en lithuanien et en lette : les thèmes gothiques en a se confondent au génitif avec les thèmes en %, leur a s’étant affaibli en * devant s final (§ 67 ) ; exemple : vulfis au lieu de vulfas, Mais en vieux saxon les thèmes de cette déclinaison ont conservé au génitif la désinence as à côté de la désinence es, quoique la première soit moins usitée que la seconde; exemple : dagas «du jour», au lieu du gothique dagis.
1 C’est ainsi qu’en grec ïa désinence de la ae personne m a perdu ï't (excepté dans le dorien ê<j-al), de sorte qu’on a, par exemple, èlêu-s.au lieu du sanscrit dttdàsi.
Les thèmes gothiques terminés par une consonne, excepté ceux qui finissent en nd, ont également pour signe casuel simplement un s; exemples : ahmin-s, brâthr-s (S 132). Au contraire les thèmes participiaux terminés en nd ( § 1 e 5 ) ont le génitif en is; exemples : msjandis «salvatoris »l. Mais peut-être faut-il attribuer cette forme à la nécessite de distinguer le génitif du nominatif singulier et du nominatif-accusatif pluriel : en effet, la forme nasjand-s se confondait avec ces cas, au lieu que le même danger n’existe pas pour des génitifs comme ahmin-s, brôthr-s, dauhtr-s. H est possible aussi que des génitifs comme mlfi-s, gasti-s, venant des thèmes mlfa, gasti, aient égaré l’instinct populaire, et fait croire qu’il fallait diviser ainsi : vulf-is, gast-is. Dès lors on aura fait d’après cette analogie nasjand-is. Quoique dans cette dernière forme is puisse aisément s’expliquer par la désinence as, qui est, en sanscrit, la terminaison du génitif pour les thèmes finissant par une consonne, je ne crois pas cependant que les thèmes en nd aient conservé une désinence plus pleine que les thèmes en r ou en n; j’aime mieux supposer que le thème a été élargi, en sorte que les thèmes en nd= sanscrit et latin nt, grec vt, ont passé soit dans la déclinaison des thèmes en i, soit dans la déclinaison des thèmes en a. Je divise donc nasjandi-s. Au lieu de nasjandi, il faudrait admettre un thème nasjanda, si les datifs pluriels comme nasjanda-m, donnés par Von der Gahelentz et Lobe, se rencontrent en effet, ou si, au commencement des mots composés , on trouve des formes en nda, appartenant à des substantifs participiaux.
Aux génitifs gothiques comme brâthr-s correspond le zend nar-s «viri, hominis». Mais, ce mot excepté, la désinence du génitif pour les thèmes zends en r est â (venant de as, S 56 comme en général pour tous les thèmes zends terminés par une
C’est l’exemple cité à l’appui de cette i*>rme par Massmann (Skeireins, p. 153 ).
consonne : seulement la voyelle qui précède r est supprimée conformément au principe des cas très-faibles (S 13o), et comme on le voit dans les formes grecques telles que Tsonp-ôs, prirp-és, et les formes latines telles que patr-is, mâtr-is. On peut comparer à ces mots les génitifs zends dâir-ô «datons» ou «creatoris», na-fëdr-ô «nepoiis», ce dernier par euphonie pour naptr-â (S 4o)1. Le génitif de âtar «feu» est employé fréquemment en combinaison avec ca (âtras-ca «ignisque»). Il ressort de là que si nar a au génitif une forme à part nar-s, qui se trouve être plus près de la forme du génitif gothique, cela vient uniquement de ce que
le mot en question est monosyllabique.
En sanserit, le génitif et l’ablatif de tous les thèmes en ar ou en âr, à forme alternant avec r (§ 127), sont dénués de flexion et finissent en ur; exemple hrâtur «fratris», mâtür «matris», dâtér «datons». Uu est évidemment un affaiblissement de Va : dâtür est donc pour dâtdr, lequel probablement est par métathèse pour dâtra: si nous rétablissons le signe casuel qui est tombé, nous avons le génitif dâtr-as, analogue au zend dâir-ô.
S 192. Le génitif féminin.
Les thèmes féminins terminés par une voyelle ont en sanscrit une terminaison plus pleine au génitif, à savoir âs au lieu de s (S 113 ) : ceux qui sont terminés par un i ou par un u bref peuvent à volonté prendrez ou as; on a, par exemple, deprïti, kdnu, tout à la fois les génitifs prïtê-s, hdnô-s et pnty-âs, hdnv-âs. Les voyelles longues â, î, û, ont toujours ^X\âs'340 341 ; exemples : dsvây-âs, Mvanty-âs, vadv-âs. Cette terminaison as devient en zend do (§ 56b); exemples ; hisvay-âo, pMUf»^***»*) bavain-
ty-âo. Je n’ai pas rencontré cette désinence pour les thèmes en
4 i, et en > u; c’est-à-dire qu’à côté des formes âfrîtôi-s, tanëu-s ou tanv-ô, tanav~ô, je n’ai point vu de forme âfrtly-âo, tanv-âo. Les langues de l’Europe n’ont point, au féminin, des désinences plus fortes qu’au masculin et au neutre; en gothique, toutefois, le génitif féminin montre un certain penchant à prendre des formes plus pleines : les thèmes féminins en ô conservent cette voyelle au génitif, contrairement à ce qui a lieu au nominatif et à f accusatif ; les thèmes en i prennent, comme on l’a vu plus haut, le gouna, au lieu que les masculins ne reçoivent aucun renforcement. On peut comparer gibô-s avec le nominatif-accusatif giba, qui est dénué de flexion et qui abrège la voyelle finale du thème, et anstai-s avec gasti-s. Sur les génitifs pronominaux comme thi-sô-s, voy. S 17 5.
En grec aussi, les féminins de la ire déclinaison conservent la longue primitive, contrairement au nominatif et à l’accusatif qui l’abrègent : on a par exemple <r(pôpâs9 Moverns, tandis que le nominatif et l’accusatif sont crÇüpâ, cr<pvpâv,'Movcrâ, Mova-âv342. Nous trouvons aussi en latin â-s, avec l’ancien â long, dans familiâ-s, escâ-s, terrâ-s, au lieu qu’il est bref dans familiâ, famihâ-m, etc. Il ne peut être question d’un emprunt fait à la Grèce : ces formes du génitif sont précisément telles qu’on pouvait les attendre d’une langue qui a s pour caractère du génitif. Que cette désinence, qui dans le principe était certainement commune à tous les thèmes en â, se soit peu à peu effacée;, hormis dans un petit nombre de mots, et que la langue l’ait remplacée comme elle a pu (§ aoo), il n’y a rien là que de conforme à la destinée ordinaire des idiomes, qui est de voir disparaître tous les jours un débris de leur ancien patrimoine.
Ln osque, tous les génitifs de la irc déclinaison finissent en a-s (as); de même en ombrien, avec cette différence, qu’ici les monuments les plus récents ont r au lieu de s, ce qui fait ressembler ces génitifs aux formes correspondantes en vieux norrois, telles que gioja-r, au lieu du gothique gibôs. Voici des exemples de génitifs osques : eituas « familiæ, pecuniæ », scrutas « scriptæ », maimas «maximæ», moltas «muletas». En ombrien, nous trouvons :/amenas Pumperias « familiæ Pompiliæ », Nonia~r « Noniæ ». On a aussi reconnu, en étrusque, des génitifs en as ou en es venant de noms propres féminins en a, ia (Ottfried Muller, Les Etrusques, p. 63); ainsi Marchas, Senties, de Marcha, Sentia1.
S 193. Génitif des thèmes en i, en lithuanien et en ancien perse.
Par son génitif âswôs, au lieu de aêwâs, le lithuanien se rapproche du gothique; il remplace encore à plusieurs autres cas Yâ du féminin par 0. Les thèmes en i9 qui, pour la plupart, appartiennent au féminin, ont le gouna comme en gothique, mais avec contraction de ai en ê, comme en sanscrit; comparez awês343 344 345 « de la brebis» au sanscrit dvês (de «-brebis») et aux génitifs
gothiques comme anstais.Le lithuanien, l’emportant sur ce point en fidélité sur le gothique, a conservé aussi le gouna avec les thèmes masculins ; exemple : gentês.
L’ancien perse emploie la gradation du yriddhi (S 26, 1) au lieu du gouna,c’est-à-dire â au lieu de a; exemples: cispâi-s, génitif du thème cispi «Teispes» (nom propre, Inscription de Bi-soutoun -1,6), cicilirâi-s, génitif de ciéiUri( nom propre, ib. Il, <j). Uâ de ces formes répond donc à Yâ des génitifs zends en dis (§ 33). Si, pour les noms de mois, nous avons des génitifs en ais au lieu de âis, cela tient à la même raison pour laquelle les noms de mois ont des génitifs en hya au lieu de la forme ordinaire hyâ ($ 188). C’est que ces génitifs en ais sont toujours accompagnés du mot mâhyâ «du mois», avec lequel ils forment une sorte de composé ; exemple : bâgayadais mâhyâ « du mois de Bâ-gayadï (ibid. I, 55).
Tableau
S 19A. Origine de la désinence du génitif. — Génitif albanais.
comparatif du génitif.
L’essence du génitif est de personnifier un objet en y attachant une idée secondaire de relation locale. Si nous recherchons l’origine de la forme qui exprime le génitif, il nous faut revenir au même pronom qui nous a servi à expliquer le nominatif, c’est-à-dire (§ i3A). La désinence plus pleine sya est formée aussi d’un pronom, à savoir sya, qui ne paraît que d'ans les
Védas (comparez S 55) et dont le s est remplacé par t dans les cas obliques et au neutre (§ 353), de sorte que sya est avec tya-m et tya-t dans le même rapport que sa avec ta-m, ta-t. Il ressort de là que sya/tya renferment les thèmes sa, ta, privés de leur voyelle et combinés avec le thème relatif 'qya.
L’albanais, qui a en grande partie perdu les anciennes désinences casuelles, s’est créé pour le génitif une terminaison nou-
-i.
velle, d’après un principe tout à fait conforme au génie de noire famille de langues; je crois voir, en effet, des pronoms de la 3° personne dans 1 \ et IV du génitif indéterminé346. Ce n’est certainement pas un hasard que les seuls substantifs qui prennent u au génitif de la déclinaison indéterminée soient ceux qui, dans la déclinaison déterminée, ont u comme article postposé; et que, dautre part, ceux qui prennent t comme article aient t au génitif de la déclinaison dépourvue d’article. On peut comparer, dans la 3 déclinaison de Hahn, xjév-t ^xuvésy) (nominatif-accusatif xjev) avec le nominatif à article xjév-t «ô mfov», et, dans la 3e déclinaison de Hahn, ju/x-w347 «<p/Xou» avec le nominatif a article p/x-u «ô <pAos». La déclinaison déterminée ajoute au génitif (qui sert en même temps de datif) après les désinences du génitif t, u, un t comme article2; du moins je crois devoir décomposer les formes comme xjévn nov xwésv, ft/xm « t ou (^iXov », de telle sorte que le t représente l’article, et la voyelle qui précède, la terminaison; xjévn, yJmr seront donc les équivalents de xvvSs^rov, Ç>i\qv-toü. L’origine de cet t, qui sert tantôt d article et tantôt de désinence du génitif, est le démonstratif sanscrit i, ou bien, ce qui me paraît encore plus vraisemblable, le thème relatif ya, lequel en lithuanien signifie « il ». L’origine de Vu de p/xu « amici » et a amicus » est, selon moi, le v du thème réfléchi sanscrit sva, qui, en albanais, s’est encore contracté en u dans beaucoup d’autres fonctions. Mais si t appartient au therne relatif sanscrit, lequel constitue une partie intégrante des thèmes démonstratifs s-ya et t-ya, il s’ensuit que la désinence du génitif dans xjév~t « du chien » et l’i des génitifs grecs comme to-To sont identiques avec le j i, devenu muet, des génitifs arméniens^comme Jiupq.ry mardoi — (3poTo7o (§ 188).
Nous faisons suivre le tableau comparatif de la formation du génitif*
37
|
A30 |
FORMATION DES CAS. |
1 1 1 | ||||
|
Sanscrit. |
Zend. |
Grec. |
Latin. |
Lithuanien. |
Gothique. |
& 1 V |
|
masculin, dsvasya |
aspa-hê |
hnro-fo |
potiô |
VUÎjirS |
1 | |
|
masculin. kdsya . |
ka-hê |
cvj-us |
kô |
hvis |
1 | |
|
féminin.. dsvây-âs |
hisvay-âo |
X<bp*-s |
terras |
âèwÔ-s |
gibâs |
1 |
|
masculin. jmtê-s1 |
patoi-s |
• » 1 » • * ♦ |
hostis |
gentes |
gasti-s |
1 |
|
masculin, ary-às |
'Gfôtri-os |
i | ||||
|
1 | ||||||
|
féminin.. prîlê-s |
AJ? AaA* ajnioi-s |
turri-s |
awe-s |
anstat-s |
1 | |
|
-féminin |
<p\J<JS-(ûS |
i | ||||
|
féminin.. Mvanty-âs |
bavainty-âo |
! | ||||
|
masculin, sûno-s |
paéëus |
pecû-s |
sünaû-s |
sunau-s | ||
|
masculin, paév-ds |
. t A 2 pasv-o |
véxv-os |
senatïi-os |
| | ||
|
féminin.. hdno-s * |
taneurS |
socrûs |
kinnaus |
s ; | ||
|
féminin.. hdnv-ds • |
tanv-ô |
yévv-o$ |
| | |||
|
féminin ly/tdii—sï'a |
: | |||||
|
1L11I1U111 » * (/ivLvt/ mas.-fém. gô-s |
gëus |
@o(F)-6s |
bov-is | |||
|
féminin.. nâv-ds |
vôl(F)-6 s | |||||
|
féminin.. vâc-ds |
A r A vac-o |
OTT-ÔS |
voc-is | |||
|
masculin, hârat-as |
barënt-ô3 |
@épOVT-OS |
ferent-is | |||
|
masculin, dsman-as |
asman-ô |
Sat ipov-os |
sermon-is |
akmen-s |
ahmin-s | |
|
neutre... ndmn-as |
nâman-o |
tà Xav-os |
nomin-is |
namin-s | ||
|
masculin, l'raiur |
brâir-o |
Tiïct. rp-ds |
frâtr-is |
brothrs | ||
|
féminin.. duhitùr |
dugdër-o |
&vya.Tp6s |
mâtr-is |
duktèrs |
dauhtrs | |
|
masculin, dâtâr |
dâir-ô |
hoTïjp—os |
dalor-is | |||
|
neutre.. . vdicas-as |
vacanh-ô |
éneicryos |
gener-is | |||
LOCATIF.
S 196. Caractère du locatif en sanscrit, en zend et en grec.
Ce cas a i pour caractère en sanscrit et en zend : de même en grec, où il a pris l’emploi du datif, sans pourtant perdre la signification locative. Nous avons, par^ggpiple, AcaSâvt, MapaÔâvt,
1 A la fin des composés; comme mot simple, pâty~usf voyez S 187.
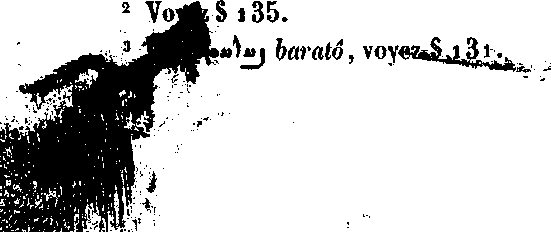
2aAap7vt, dypÿ, o&oi, ^ajwa/, et, en passant de l’idée de l’espace à celle du temps, rr? «üt^ ypépa, wxrL De même en sanscrit divas# « dans le jour », t%Rx aùu K dans la nuit ».
S 196. Locatif des thèmes en af en sanscrit et en zend. — Formes
analogues en grec. '
LV du locatif, quand le thème finit par ^sia, se combine avec lui et forme ê (§ 2). Il en est de même en zend; mais à côté de X5 êf on trouve aussi ^ Si (S 33), de sorte que le zend se rapproche beaucoup de certains datifs grecs comme otxoi, poé et trot, où Y1 n’a pas été souscrit et remplacé par l’élargissement de la voyelle radicale. Aux formes que nous venons de citer, on peut ajouter maidyôi « au milieu », auquel il faut com
parer le grec (xéercrot (venant, par assimilation, de (xeajot, § 19), Mais il faut se garder de conclure, d’après cette forme et quelques autres semblables, à une parenté spéciale entre le grec et le zend.
§ 197. Locatif des thèmes en a, en lithuanien et en lette.
Dans la langue lithuanienne, qui dispose d’un véritable locatif, les thèmes en a s’accordent à ce cas d’une façon remarquable avec le sanscrit et le zend; ils contractent en e cet a combiné avec IV locatif, qui d’ailleurs ne se montre nulle part dans sa pureté; on a, par conséquent, du thème dêwa le locatif dëwè «en Dieu » , qui répond u dêvé'et à ^>^"3 daivê. Il est vrai qu’en
lithuanien Yè du locatif des thèmes en a est bref (Kürschat, II, p. 47 ); mais cela 11e doit pas nous empêcher d’y voir originairement une diphthongue, car les diphthongues, une fois qu’elles sont contractées en un seul son, deviennent sujettes à l’abréviation. On peut comparer à cet égard le vieux haut-allemand, où IVdu subjonctif est bref dans bëre «feram, ferat», tandis qu’il est long dans hërê-s, bërêmês, berêt (S 81), et le latin, où nous
avons amëm, amët à côté de amês, amêmus, amêtis. Une autre preuve que le lithuanien a dû primitivement être long, c’est qu’en slave, dans la classe de mots correspondante (§ â68), il y a au locatif un 'b ê : or, le *6 représente à l’ordinaire Yê sanscrit (S ()â e). Le lette a supprimé IV du locatif et, pour le remplacer, a allongé Y a qui précède; exemple : rata «dans la roue», qu’on peut comparer au lithuanien raté (même sens) et au sanscrit râlé «dans le char», La forme lette prouve que c’est à une époque relativement récente qu’au locatif lithuanien de cette classe de mots ai a été contracté en e. Il est important d’ajouter que le lette a conservé la dernière partie de la diphthongue ai au locatif pronominal, et qu’il a même allongé IV dans ces formes; exemple : td «dans le, dans celui-ci». En lithuanien, ce pronom fait au locatif ta-mè, par l’adjonction du pronom annexe, dont il a été question plus haut(§ 165 et suiv.). Le sanscrit aurait tâsmê, si à ce cas ma |uivait la déclinaison régulière.
S 198. Locatif des thèmes en * et en u, en sanscrit.
Les thèmes masculins en ^ i et en ^ u, et à volonté les thèmes féminins ainsi terminés, ont en sanscrit au locatif une désinence irrégulière : ils prennent à ce cas la terminaison âu, devant laquelle i et u tombent, excepté dans pâti «maître » et sâUi «ami », où IV se change en Jf^y suivant la règle euphonique ordinaire {pâty-âu, $âMy-âu).
Si l’on examine l’origine de cette désinence, il se présente deux hypothèses. Suivant la première, et c’est celle que nous préférons, âu vient de et est un génitif allongé, une
sorte de génitif attique; en effet, les thèmes masculins en i et en u ont également en zend les désinences du génitif avec le sens du locatif; il faut de plus se rappeler la vocalisation de s en u, dont il a été question au § 56b, et en rapprocher le duel âu, qui, suivant toute vraisemblance, est sorti de^TT^«« (§906).
Suivant l’autre hypothèse, qui serait très-vraisemblable si la désinence locative âu était bornée aux thèmes en u, âu serait simplement une gradation de la voyelle finale du thème1 ; c’est ainsi que nous avons expliqué (8 17b) les datifs gothiques comme sunau, kinnau, auxquels on pourrait alors comparer les locatifs sanscrits comme sûnâü, hânâu. Mais cette explication ne peut guère convenir aux locatifs comme agnâu, venant de agnî « feu »; en effet, u est plus lourd que i, et les altérations des voyelles consistent ordinairement en affaiblissements. 0.n ne trouve nulle part en sanscrit un exemple d’un i changé en u : il est donc difficile d’admettre que, par exemple, agni «feu», dm «mouton», dont IV est primitif, ainsi que cela ressort de la comparaison des autres langues, aient formé leur locatif d’un thème secondaire agnu, avu, et qu’un procédé analogue ait été suivi pour tous les autres thèmes masculins en i (et à volonté pour les thèmes féminins). Il est bien entendu qu’il faudrait excepter les locatifs, mentionnés plus haut, pdty-âu, sdky-âu, où âu est évidemment une désinence casuelle, et y la transformation régulière de IV
final du thème.,
*
S 199. Locatif des thèmes en i et en «, en zend.
Au lieu du locatif, le zend emploie ordinairement pour les thèmes en u la terminaison du génitif ^ 6 (venant de as), tandis que, pour exprimer l’idée du génitif, il préfère la forme ëu-s; ainsi nous avons dans le Vendidad-Sadé2 :
aitahmi anhvé y ad usivainti «in hoc mundo quidem existente ». Cette terminaison zende ô (a + tt) est, par rapport à la désinence sanscrite âu} ce que Va bref est à Yâ long, et les deux locatifs se distinguent seulement par la quantité ê de ta première partie de la diphthongue. Au contraire, nous
1 Voyez Benfey, Grammaire sanscrite développée, p. 802.
s Page 387 du manuscrit lithographié.
i.
28 '
trouvons très-fréquemment, pour le.thème féminin tanu «corps», la vraie forme locative tanv-i1.
Il y a, dans le dialecte védique, des formes analogues en v-i, ou, avec le gouna, en av-4, telles que tanv4, de tanû (féminin) «corps» et avec le gouna fôwu'fë visnav-i, du thème masculin visnu (voyez Benfey, Glossaire du Sâma-véda). Pour mnü «fils», Benfey (Grammaire développée, p. 3oq) mentionne le locatif sûndv-i, avec lequel s’accorde parfaitement l’ancien slave sünov-i (locatif et datif).
Pour les thèmes en i, le zend emploie la désinence ordinaire du génitif ôi-s, avec la signification du locatif; ainsi dans le Vendidad-Sadé348 349 : yahmi tuimânê
yaà mâsdayasnois «in bac terra quidem masdayasnica».
S s o o. Le génitif des deux premières déclinaisons latines est un ancien locatif. — Le locatif en osque et en ombrien. — Adverbes latins en ê.
Nous venons de voir que le génitif en zend peut se substituer à l’emploi du locatif; nous allons constater le fait opposé en latin, où le génitif est remplacé par le locatif.^Fr. Rosen a reconnu le premier un ancien locatif dans le génitif des deux premières déclinaisons : l’accord des désinences latines avec les désinences sanscrites ne laisse aucun doute sur ce point; ce qui vient encore à l’appui de cette identité, c’est que le génitif n’a en latin la signification locative que dans les deux premières déclinaisons (Romœ, Corinthi, humi), et seulement au singulier. On dira par exemple ruri et non ruris. Une autre preuve est'fournie par la comparaison^ de l’osque et de l’ombrien; ces deux dialectes ne donnent jamais le sens locatif à leur génitif, qui a
conservé partout sa désinence propre. On trouve dans ces deux langues, ou au moins en ombrien, un véritable locatif distinct du génitif.
En osque, nous avons pour exprimer le locatif, dans la irc déclinaison, une forme ai qui est semblable à la désinence du datif, et dans la 9 e une forme ei, distincte du datif, lequel se termine en ul1. En voici des exemples : esai viai méfiai « in ea via media » ; müinikei terei « in terra communi » (terum est du neutre). Dans la diphthongue ei, Ye représente la voyelle finale du thème, comme elle est représentée par e au vocatif de la 9 e déclinaison latine (S 9o4) : l’on peut comparer la diphthongue ei à ïê (contracté de m) du sanscrit âévê «in equow.
Nous arrivons au locatif ombrien, sur lequel je me vois obligé de retirer, après un examen répété, l’opinion que, d’accord avec Lassen, j’avais exprimée dans mon Système comparatif d’accentuation (p. 55). Si je renonce à y voir le pronom annexe sma (8 166 et suiv.), je ne peux pas non plus partager l’opinion émise par Aufrecht et Kirchhoff (ouvrage cité, p. 111), qui, rapprochant de la forme ordinaire me la forme plus complète me/»350 351, y voient la désinence du datif sanscrit %«m. Ge n’est pas que le changement de B en m me paraisse impossible (compas ri ' § 9i5), ou que la désinence du datif ne puisse servir à former des locatifs352; mais ce qui, selon moi, s’oppose à cette explication, c’est le fait suivant : toutes les fois que, dans la ire déclinaison, les formes en mem, men, me, ou simplement m, expriment une véritable relation locative (c’est-à-dire toutes les fois qu’elles
répondent à la question uin}, la voyelle qui précède n’est pas Va du thème, mais e : ainsi Ton dit en ombrien tote-me «in urbe», et non tota-me. Si cet e se retrouvait également quand les formes dont nous parlons indiquent la direction vers un endroit (question quô), on pourrait voir simplement dans Ve un affaiblissement de Va du thème, affaiblissement dû à la surcharge que produit l’adjonction d’une syllabe. Mais il n’en est pas ainsi, et l’a reste invariable quand il s’agit d’exprimer le mouvement vers un endroit. Ainsi l’on dirait tota-me « in urbem »1. Si donc tote-me «in urbe» contient une désinence de locatif, cette désinence doit être renfermée dans Ve de la seconde syllabe, lequel très-probablement est long et est une contraction de ai. Mais il n’est pas nécessaire de reconnaître dans tote-me une désinence de locatif, car le datif de tota est toie (fotê), et, par conséquent, rien ne s’oppose à ce que nous supposions que le datif combiné avec mem, me, etc. et même quelquefois le datif seul353 354, exprime la relation locative.
Quant à la direction vers un endroit, elle est exprimée en sanscrit par l’accusatif, et nous admettons qu en ombrien elle est marquée par l’accusatif combiné avec les syllabes précitées, que nous regardons comme des postpositions. Mais, comme le redoublement d’une consonne n’est pas indiqué dans l’écriture ombrienne, non plus que dans l’ancienne écriture latine 355, on supprime le m de l’accusatif devant des enclitiques commençant par m. Au lieu de Akeruniamem, arvamen, rubiname, il faut donc lire Akeruniam-mem, arvam-men, rubinam-me.
On pourrait encore admettre que l’accusatif perd son m de-
vaut la poslposition, d’autant plus que, même à l’étal simple, il se trouve souvent sans m (ouvrage cité, p. 110). Gomme l’accusatif est plus propre qu’aucun autre cas à marquer le mouvement vers un endroit, ainsi que nous le voyons, non-seulement par le sanscrit, mais encore par le latin (pour les noms de ville), il n’y a pas lieu de s’étonner si quelquefois la direction est marquée en ombrien par des mots en a, sans adjonction d’aucun mot indiquant la relation.
Dans la 9° déclinaison ombrienne, le lieu où l’on est n’est pas distingué du lieu où l’on va, c’est-à-dire qu’on ne trouve la postposition qu’en combinaison avec l’accusatif, ou l’on emploie l’accusatif seul et dépouillé de son signe casuel; exemples : vuku-men, esunu-men, esunu-me, anglo-me, perto-me, carso-me, somo (ouvrage cité, p. 118); on pourrait lire aussi vukum-men, etc. Pour les thèmes en i, les formes locatives en i-men, i-me, i-m, e-me, e~m, e correspondent aux accusatifs en im, cm, e. Dans rus-e~me, du thème rus, lequel est terminé par une consonne, Ve est probablement voyelle de liaison (ouvrage cité, p. 128 ) et la forme dénuée de flexion rus l’accusatif neutre. On peut aussi regarder comme voyelle de liaison Ye des locatifs pluriels en cm, si cm n’est pas ici une simple transposition pour me, destinée à faciliter la prononciation à cause de la lettre f, signe de l’accusatif pluriel (S ai5, 2), qui précède. Il est important de remarquer à ce propos que les formes en f-em ne sont jamais de vrais locatifs, mais qu’elles marquent le lieu où l’on va (ouvrage cité, p. 11Ù), ce qui nous autorise d’autant plus à les expliquer comme des accusatifs avec postposition. L’ombrien suit d$ns les formations de ce genre son penchant ordinaire à rejeter un m final,,de sorte que la plupart du temps la postposition au pluriel consiste simplement dans un e; il faudrait même admettre qu’elle a disparu tout à fait, si l’on regarde e comme une simple voyelle de liaison. On pourrait à ce sujet rappeler
les accusatifs grecs comme #7r~a comparés avec les accusatifs sanscrits comme mc-am.
Ce qui porte encore à croire que la terminaison apparente des locatifs ombriens est une préposition devenue postposition, c’est que, en général, l’ombrien aime à placer après les noms les mots exprimant une relation (même ouvrage, p. i53 et suiv.). C’est ainsi que la préposition tu ou to, qui appartient en propre à l’ombrien et qui signifie «de, hors», ne se trouve qu’en combinaison avec les ablatifs quelle régit. De même l’ombrien ar = latin ad est toujours annexé au substantif qu’il gouverne, quoiqu’il paraisse quelquefois aussi comme préfixe devant une racine verbale.
Nous retournons au latin pour dire que les adverbes en ê de la 2e déclinaison peuvent être considérés comme des locatifs, au lieu que les adverbes terminés en ô sont des ablatifs : novê, par exemple, représenterait le sanscrit ndvê «in novo».
§ 201. Locatif des pronoms en sanscrit et en zend. — Origine de 1 *
du locatif.
Les pronoms sanscrits de la 3e personne ont m, au fieu de i, au locatif, et Va du pronom annexe sma (§ 165) est élidé; exemples : tâsfnin «en lui», kdsmin «en qui?». Ce n ne s étend pas aux deux premières personnes, dont le locatif est mdy-i, tvdy-i, et il manque également à la 3e personne en zend; exemple : ig* ahmi «dans celui-ci».
On peut se demande^ quelle est l’origine de cet i, qui indique la permanence dans l’espace et dans le temps : nous considérons i comme la racine d’un pronom démonstratif. Si cette racine a échappé aux grammairiens indiens, il ne faut pas s’en étonner, car ils ont méconnu de même la vraie forme de toutes les racines pronominales.
§ aoa. Locatif féminin. — Locatif des thèmes en i et en u,
en lithuanien.
Les thèmes féminins terminés par une voyelle longue ont en sanscrit une désinence particulière de locatif, à savoir âm. Les thèmes féminins en i et en u brefs peuvent prendra la même terminaison. Les thèmes féminins monosyllabiques en i et en u longs ont également part aux deux désinences, et peuvent prendre âm ou ^ t; exemples : Iny-âm ou Biy-î « dans la peur 57, de Hî.
En zend, au lieu de la désinence dm nous n’avons plus que a (comparez § 9t5); exemples : «**g»)356o yahmy-a tun quâ» de yahwî (comparez § 179). Mais cette terminaison paraît avoir moins d’extension en zend qu’en sanscrit, et ne semble pas s’appliquer aux thèmes féminins en i et en u.
Le lithuanien a perdu comme le zend la nasale de la désinence âm : pour les thèmes féminins en a il termine le locatif en ôj-e, forme qui répond au sanscrit ây-âm; exemple: âêwôj-e (=sanscrit dsvây-âm ). Le j a probablement exercé une influence assimilatrice sur la voyelle qui suit (comparez S 99k). Si le thème est terminé en i, à cet i, qui s’allonge en y (—i), vient encore s’associer la semi-voyellej; exemple : awyj-è, qu’on peut comparer au sanscrit âvy-âm (par euphonie pour avi-âm) de dvi « brebis »1.
La désinence casuelle des thèmes lithuaniens en i peut aussi être supprimée, comme dans awj (awi).
Gomme la plupart des thèmes lithuaniens en i sont du féminin, il est possible que cette circonstance ait influé sur les masculins
qui font également au locatif ij-e; exemple : gentij-è « dans le parent ». Ce qui est plus étonnant, c’est que les thèmes en u, qui sont tous du masculin, ont part à la terminaison j-e: c’est ainsi que nous avons sünnj-è \ au lieu duquel on trouve toutefois aussi, suivant Schleicher (p. 190), sünui9 qui ne se distingue du datif sunui (S 176) que par l’accentuation. Si la forme sünm, que Ruhig et Mielcke ne citent pas, est primitive, et ne vient pas d’une contraction de sünujè, elle s’accorde très-bien avec le védique et le zend tanv-i (du thème féminin tanu), que nous avons mentionné plus haut : la forme lithuanienne ne s’en distinguerait que par le maintien de Vu, qui, en sanscrit et en zend, est devenu un v> conformément aux lois phoniques de ces langues. On peut comparer aussi la forme védique masculine sûndv-i, qui est frappée du gouna, avec le slave sünov-i.
S ao3. Tableau comparatif du locatif.
Nous donnons le tableau comparatif du locatif sanscrit, zend et lithuanien, ainsi que du datif grec, qui par sa formation est un locatif.
|
Sanscrit. |
Zend. |
Lithuanien. |
Grec. | |
|
masculin.. . |
f r a 2 asve |
aspê |
pônè |
htTTOû 4 |
|
mas.-neutre |
kâr-sm’-in |
ha-mh |
• * * • « * | |
|
féminin. .. |
âsyây-âm |
hisvay-a? |
aswôj-e |
#p?3 |
|
masculin.. . |
pâty-âu1 |
5 |
'üibai-i | |
|
féminin . . |
priV-âu |
'crépTi-t |
1 Peut-être vaut-il mieux diviser sünu-j-è, comme au locatif pâli des thèmes en u, tels que yâgu-y-an ou yâgu-y-â (comparez S 43) «dans le sacrificev.
2 Comparez le latin .equî, humî, Corinthî, venant de eguoi, etc. Rapprochez aussi novè (venant de novade rrst nâvé «in novon (S aoo).
3 Comparez le lat- guce, Romæ, archaïque eqtiai, Romai (8 5).
4 ’^oyez S 198. -
5 Le locatif masculin est formé d’après l’analogie «es locatifs féminins.
LOCATIF SINGULIER. S 203. AM
Sanscrit. Zend. Lithuanien. Grec.
féminin. . . pnty-âm ......... awyj-è ........-
neutre. . . . üarwl-i .................. fôpt-t
féminin. .. Mmnty-âm bavainty-a? ..................
masculin.. . sûn’-âü ...........................
masculin... sûnâv-i1 ......... sünui véxv-t
féminin. .. hdn-au ...........................
féminin. . . tanv-i tanv-i . ....... yévv-t
neutre. .. . mâdu-n-i .................. péPv-t
féminin. . . vadv-am .......... ..................
masc.-fém.. gâv-i gav-i? . ....... @o(F)-(
féminin. . . nâv-i .................. i»a(F)-/
féminin. .. vâc4 vâc'4 ......... àn-i
masculin.. . barat-î barënt-i ......... Çépovr-i
masculin.. . âéman~i asmain-i ......... Saipov-t
neutre. ... namn-i3 nâmain-i ......... icikav-i
masculin... Bratar-i3 brâtr-i?* ......... Tscnp-l
féminin. .. duhitâr-i dugder-i5 &vycnp-i
masculin... dâtâr-i datr-i ? ......... So-r^p-t
neutre. . .. vâcas-i vacah-i ......... é7rs(<x)-î.
1 Forme védique, S î 99.
* Ounffman-i. (Voyezl’Abrégé de la grammaire sanscrite, S 191.)
5 Les thèmes qui, dans leur syllabe finale, font alterner ar et âr avec v, ont tous au locatif ar-i, au lieu que, d’après la théorie générale des cas très-faibles, nous devrions supprimer l’a qui précède r, ce qui nous donnerait pitr-% et non pitâr-i. La première de ces formes s’accorderait mieux avec le datif grec (Voyez
S i3a, 1.)
4 Je ne connais pas d’exemple de ces formes ; mais la voyelle précédant r doit vraisemblablement être supprimée, comme elle l’est au génitif singulier brair,-o, dâîr-ô, et au génitif pluriel èratr-twVm, dâtr-ahm. Au contraire , dans les thèmes zends en an, la voyelle, même précédée d’une seule consonne, est conservée à tous les cas faibles : ainsi bous avons ndmam-t , au lieu du sanscrit ndimn-% ou «âman-t ; nous avons au datif et au génitif nâmainë, tiâmanô, au lieu du sanscrit n$mn-ê} nttnm-as. (Voyez, dans l’index du Vettdidad-Sadé de Brockhaus, les cas formés de daman et nàman. )
5 Pour dufrdr-i, voyez § 178. Mais on pouvait aussi s’attendre à trouver dugdëirt et, par analogie, au datif, dugd'ëtré (S Ai).
VOCATIF.
§ voU. Accentuation du vocatif en sanscrit et en grec. — Vocatif
des thèmes en a.
Au vocatif des trois nombres, le sanscrit ramène l’accent sur la première syllabe du thème, s’il ne s’y trouve déjà placé357. Exemples ipltar « père », dêvctr « beau-frère » (frère du mari), matar « mère », dühitar «fille», râgaputra «fils de roi» tandis qu’à l’accusatif nous avons pitâram, dêvâram, mâtâram} duhitâram, râgaputrâm. Le grec a conservé quelques restes de cette accentuation : nous avons notamment les vocatifs nrdrep, Aaep, prrep, BvyaTsp*, qui sont, sous le rapport de l’accent, avec leurs accusatifs 'usctrzépQL, <Wpa, &wyonépoL, dans le même rapport que les vocatifs sanscrits que nous venons de mentionner avec leurs accusatifs respectifs. Dans les mots composés, le recul de l’accent 358 359
au vocatif singulier a, en grec, une cause différente : il se fait en vertu du principe qui veut que l’accent des mots composés soit le plus loin possible de la fin; on a, par conséquent, au vocatif, et/— Sotifjiov, au lieu qu’au nominatif, pour des raisons que l’on connaît, l’açcent se rapproche : evàatfjtwv.
Si de l’accent nous passons à la forme du vocatif, nous observons , ou bien qu’il n’a pas de signe casuel dans les langues indo-européennes, ou bien qu’il est semblable au nominatif. L’absence de désinence casuelle est la règle, et c’est par une sorte d’abus que le vocatif reproduit dans certains mots la forme du nominatif. Cet abus est borné en sanscrit aux thèmes monosyllabiques terminés par une voyelle ; exemple : « peur ! »,
de même qu’en grec nous avons jgâu-s «vache!», nâu-s «navire! ». Ici, au contraire, le grec a j8oS, voté*
En sanscrit et en zend Va final des thèmes reste invariable : en lithuanien il s’affaiblit en e K Le grec et le latin, dans la déclinaison correspondante, préfèrent également pour leur vocatif dénué de flexion le son de l’c bref à l’o et à Yu des autres cas. On comprend en effet que la voyelle finale du thème a dû s’altérer plus vite au vocatif qu’aux autres cas où elle est protégée par la terminaison, Il faut donc se garder de voir dans frnre, equë des désinences casuelles : ces formes sont avec diva dans le même rapport que 'tsévTsiqumquef avec pâiïéa; l’ancien devenu o dans iWos, ü dans equus, est devenu ë à la fin du mot.
En zend, les thèmes terminés par une consonne, s’ils ont un 5 au nominatif i le gardent au vocatif : c’est ainsi que nous avons trouvé plusieurs fois au participe présent la forme du nominatif avec le sens du vocatif. 357
S üo5. Vocatif des thèmes en i et en « et des thèmes terminés par une consonne. — Tableau comparatif du vocatif.
Les thèmes masculins et féminins en i et én u ont en sanscrit le gouna : les neutres peuvent prendre le gouna ou garder la voyelle pure. Au contraire, les féminins polysyllabiques en î et en û abrègent cette voyelje. Un ^TT à final devient ê, c'est-à-dire qu'il affaiblit en i le second «(d = «n-#)e tle combine avec le premier de manière à former ta diphthongue é. C'est évidemment le même but que poursuit la langue, soit qu'elle allonge ou qu'elle abrège la voyelle finale : elle veut insister sur le mol qui sert à appeler.
A la forme ^ ô, produite par le gouna ( a + u), correspondent des formes analogues en gothique et en lithuanien : comparez au sanscrit Æd les vocatifs sunau, sünaé L On ne trouve pas dans Ulfilas de vocatif d’un thème féminin en i; mais comme, sous d’autres rapports , ces thèmes forment le pendant exact des thèmes en u, et comme ils ont, ainsi que ceux-ci, le gouna au génitif et au datif, je ne doute pas qu’il n'y ait eu en gothique des vocatifs comme anstai. On ne rencontre pas non plus de vocatif d'un thème féminin en u; mais comme, à tous les autres cas, les thèmes féminins en u suivent l'analogie des masculins, on peut, à côté des vocatifs sunau, magau, placer sans hésitation des vocatifs féminins comme handau360 361. Les thèmes masculins en t
■v
ont, comme les thèmes masculins et neutres en a, perdu en gothique leur voyelle finale au vocatif, ainsi qu a l’accusatif et au nominatif ; exemples : vulf, daur, gast\ Le lithuanien, au contraire, marque, dans les deux genres, 17 final, comme l’w final, du gouna; exemples : gente «parent!», awê «mouton!», de môme qu’en sanscrit nous avons pâté, âvê.
Les adjectifs germaniques se sont écartés, au vocatif, delà règle primitive : ils conservent le signe casuel du nominatif Ainsi, en gothique, nous avons bltnd’s «aveugle!». En vieux norrois les substantifs participent à cette anomalie et conservent le signe du nominatif.
Le grec a assez bien conservé ses vocatifs : dans plusieurs classes de mots il emploie le thème nu, on le thème ayant subi les altérations que les lois euphoniques ou l’amollissement de la langue ont rendues nécessaires ; exemples : rctXav, par opposition a raXas; xaP^ev au ^eu de XaP^evTî Par opposition à ^ap/eis; nrat, au lieu de rsaiS, par opposition à 'ara??. Les thèmes terminés par une gutturale ou une labiale n’ont pu se débarrasser au vocatif du <7 du nominatif, x<? et nut (|, ÿ) étant des combinaisons qu’affectionne le grec et pour lesquelles il a même créé des lettres spéciales. Remarquons toutefois le vocatif dm, qui coexiste à côté de am|, et qui est conforme à l’ancien principe : en effet, un thème avouer, privé de flexion, ne pquvait conserver le xr, ni même, selon les règles ordinaires du grec, le x. «Au reste, ainsi que le fait observer Buttmann (Grammaire grecque développée, p. 180), on comprend sans peine que des mots qui ont rarement occasion d’être employés au vocatif, comme nroü$ par exemple, prennent plutôt, le cas échéant, la forme du nominatif L» Le latin est allé encore plus loin dans cette voie que le
ou si, comme en sanscrit, on emploie la forme nue du thème; en d’autres termes, si, pour le thème kanan, on dit au vocatif hana ou hanan.
1 C’est, à celte circonstance sans doute qu’est due, dans la déclinaison des thèmes
. . * . .
Je fais suivre le tableau comparatif du vocatif pour les thèmes
cités au § 1A8.
|
Sanscrit. |
Zend. |
Grec. |
Latin. |
Lithueuien. |
Gothique. |
|
masculin, âsva |
aépa |
frnre |
eque |
pone |
vulf’ |
|
neutre... dUna |
data |
dânu-m |
daur’ | ||
|
féminin.. âsvê |
hisva1 • |
equa |
asva^~ |
gïba | |
|
masculin. pâté |
paiti |
'VSàfJl, |
hosti-s |
gente |
gast* |
|
féminin.. prîïê |
afrîti |
TSÔpTt |
turri-s |
awe |
anstai ? |
|
neutre... vari |
vairi |
fàpt |
mare | ||
|
féminin., Bâvantt |
bavainti | ||||
|
masculin, sunô |
pasu |
véHV |
pecu-s |
sünaü |
sunau |
|
féminin.. hdnô • |
tanu |
yéw |
socru-s |
kinnau | |
|
neutre... màdu |
madu |
péOv |
pecû | ||
|
féminin.. vâdü | |||||
|
mag.-fém. gâu-s |
gâu-s |
|3o0 |
bô-s | ||
|
féminin.. nâu-s |
. VûtV | ||||
|
féminin., vâk |
vâU-s ? |
Ôiss |
voc-s | ||
|
masculin. Mran |
baran-s |
ÇépGûV |
fer en-s |
dugân-s |
jijandy |
|
masculin, âs'man |
asman |
haipoi) |
■ sermo |
akmu |
ahma? |
|
neutre..,, nîiman |
nâinan |
t éXav |
nâmen |
namô? |
neutres en o, l'introduction au vocatif du signe casuel v. Il ne faut pas oublier d’ailleurs que le grec a du se déshabituer d’autant plus aisément d’employer la forme nue du thème, qu’au commencement des composés on trouve beaucoup plus rarement qu’en sanscrit le thème dans sa pureté primitive (Sua).
1 C’est ainsique nous avons drvâipa, vocatif de drvâttpâ, nom d’une divinité (lit-térajlment, qui a dès chevaux solides), de drva = sanscrit druva, et aêpa (voyez Hurnouf, Yaçna, p. 4a8 et suiv,). Le dialecte védique a également des vocatifs de ce genre, c’est-à-dire abrégeant l’« long du féminin au lieu de le changer en ê. Dans le sanscrit classique, trois mots, qui signifient tous lés trois «mèren, suivent cette analogie : akfaî, ambu, alla; vocatif àkka, âmba, Alla, On trouve aussi dans le dialecte védique âmbéou lieu de âmba.
Sanscrit.
masculin. Bratar féminin. . dùhitar
m
masculin, ddtar neutre.. . vâcas
Zend.
Brâtarë1 dugdhrë dâtarë
f M
vaco
Grec.
Latin. Lithuanien. Gothique.
1 Voyez S hk,
3 Voyez S itt3.
'sràrep fréter .......brôthar
&ûy<%Tep mater dukte dauhtar
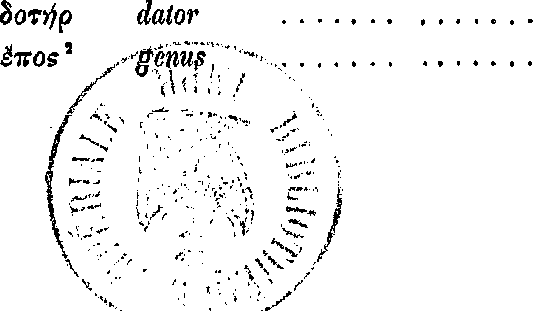
FIN DU PREMIER VOLUME.
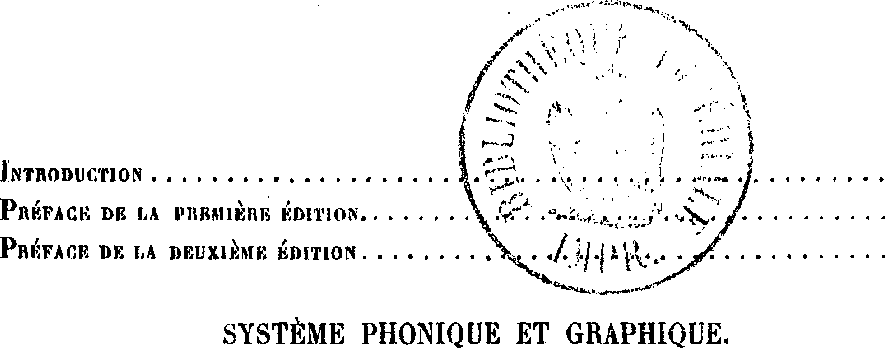
Pïlg'fiS,
111
1
11
ALPHABET SANSCRIT.
1.
S i * Les voyelles simples en sanscrit. — Origine des voyelles %£ ret«f/...
S 2. Diphthongues sanscrites...................................
S 3. Le son a en sanscrit et ses représentants dans lea langues congénères. .
S fi, L’d long sanscrit et ses représentants en grec et en latin............
8 5. Origine des sons a, œ et œ en latin...........................
8 6. Pesanteur relative des voyelles. — A affaibli en t.................
S 7. A affaibli en «..........................................
S 8. Pesanteur relative des autres voyelles.........................
S 9. L’anousvâra et l’anounâsika................................
S 10. L’anousvâra en lithuanien et en slave.........................
S 11. Le visarga.............................................
S 19. Classification des consonnes sanscrites.........................
$18. Les gutturales..........................................
S 1 A. Les palatales...........................................
S : 15. Les cérébrales ou linguales.................................
$ 16. Les dentales.. .........................................
S 170. i) affaibli en l ou en r....................................
S 17 b. N dental changé en n cérébral...............................
8 18. Les labiales............................................
S', tpi. Les semi-voyelles........................................
S a0. Permutations des semi-voyelles et des liquides..................
a9
23 38 3i 3a 33 35 38 fio fit fi 3 fi3 fifi fi 6
h
*9
*9
5i
5i
5a
53
58
Pîl(J(*B.
S 21 *. La sifflante »........................................... 61
8 21h. La sifflante s........................................... 63
S 22. La sifflante s........................................... 64
S al3. L’aspirée h............................................. 65
S 24. Tableau des lettres sanscrites................................ 66
S e5. Division des lettres sanscrites en .sourdes et sonores, fortes et faibles. . . 68
LE GOUNA.
8 26, i. Du gouna et du vriddhi en sanscrit........ 68
§ 26, 2. Le gouna en grec.......................... 7°
S 26, 3. Le gouna dans les langues germaniques..................... 71
S 26,6. Le gouna dans la déclinaison gothique...................... 73
S 9 6,5. Le gouna en lithuanien................................ 7 6
S a 6, 6. Le gouna en ancien slave........................ 7^
S 27. De l’i gouna dans les langues germaniques...................... 76
S 28. Du gouna et de la voyelle radicale dans les dérivés germaniques...... 76
§ 29. Du vriddhi............................................ 78
ALPHABET ZEND.
S 3o. Les voyelles * «, fê, «a.................................. 79
S 3i. La voyelle ^ è........................... 60
§ 3s. Les sons 81
§ 33. Les diphthongues ^ ôi, w ê et ai.......................• • 63
S 3k. Les gutturales ^ k et ^ Je................................... 65
S 35. La gutturale aspirée ................................... 66
S 36. Les gutturales et ....................... 67
S 37. Les palatales p è et * g........... 68
S 38. Dentales. Les lettres p t et<^ t........................*..... 9°
S 39. Les dentales^ d, çd' et £ d................................ 9°
S 4 0. Les labiales et P» è />_) ^.................................. 93
S ht. Les semi-voyelles. —- Epenthèse de Vi......................... 9^
S il 2. Influence de y sur Va de la syllabe suivante. — Y et v changés en
^voyelles. . ......................................... 9^
S 43. F comme voyelle euphônique de liaison........................ 96
8 44. La semi-voyelle r..... ................................... 97
S 45. Les semi-voyelles r et .................................... 97
8 46. Êpenthèse de Vu................ ......................... 96
867. Aspiration produite en zend par le voisinage de ceitaines lettrés. — Fait
identique en allemand.................................. 99
S 48. //inséré devant un r suivi d’une consonne..................... 101
8 4g. La sifflante a* «.............................*............ 101
Pages.
S 5p. Vchangé enp après é..................................... 102
S 5i. La sifflante ^ s......................................... 102
S 52. La sifflante s............. io4
S 53. La lettre çy h..................... io5
S 54. Le groupe hr........................................... io5
§ 55. 5e pour hé............................................. 106
S 56 \ Nasale n insérée devant un h............................... 106
56 b. As final changé en ô; as changé mao......................... 107
67. La sifflanteJ[ s tenant la place d’un h sanscrit.................... 108
58. £ s pour le sanscrit g ou g.................................. 108
59. La sifflante ^ i................ 109
60. Les nasales j et g n......................... 110
S 61. Le groupe ^ an.......... 110
S 62. Les nasales j et j£n. — Le groupe ^ nuk..................... 111
S 63. La nasale $ tn. — Le b changé en m en zend ; changement contraire
en grec...................................... 112
S 64. Influence d’un m final sur la voyelle précédente.................. 112
5 65. Tableau des lettres zendes.................................. it3
ALPHABET GERMANIQUE.
S 66. De la voyelle a en gothique................................. n4
S 67. A changé en i ou supprimé en gothique........................ 114
S 68. A gothique changé en u ou en 0 en vieux haut-allemand............ n5
S 69, 1. L’a long changé en ô en gothique.......................... 115
$ 69,2. L’d long changé en ê en gothique.......................... 117
S 70. Le son èi dans les langues germaniques...........!............ 118
S 71. I final supprimé à la fin des mots polysyllabiques................. 120
S 72. De ïï gothique........ 121
S 73. Influence de IV sur IV de la syllabe précédente.. .................. 121
S 74. Développement du même principe en moyen haut-allemand......... 122
S 76. Effet du même principe dans ïe haut-allemand moderne............ 122
S 76. De Vû long dans les langues germaniques.............. 123
S 77. U bref gothique devenu 0 dans les dialectes modernes.. ............ 126
S 78. Transformations des diphthongues gothiques ai et au dans les langues
• germaniques modernes................................. 12,5
S 79. La dfphthonguc gothique ai, quand elle ne fait pas partie du radical, se
^ change en é en vieux haut-allemand........................ 126
$ 80. Ai gothique changé en é à l’intérieur de la racine en vieux et en moyen
-haut-allemand...................... 127
S 81. Des voyelles finales en vieux et en moyen haut-allemand............ 1,27
$ 82. L’i et l’« gothiques changés en ai et en an devant 4 ou r........... 129
correspondantes....................................... i3o
S 8l\. Influence analogue exercée en latin par r et h sur la voyelle qui précède. i3i S 85. La diphthongue gothique iu changée en haut-allemand moderne en ie,
ü et eu............................................. i3a
S 86, t. Les gutturales........................................ 133
8 86, 9 a. Les dentales......................................... 139
S 86,2 b, Suppression dans les langues germaniques des dentales finales
S 86,3. Des labiales.......................................... tAo
8 86, h. Des semi-vovelles...................................... iè«
1 v
S 86.5. Les sifflantes......................................... i63
8 87 , 1. Loi de substitution des consonnes dans les idiomes germaniques. —
Faits analogues dans les aulres langues...................... 165
Ü 87,2. Deuxième substitution des consonnes en haut-allemand.......... i5o
S 88. De la substitution dès consonnes dans les langues letlo-slaves........ 153
§ 89. Exceptions à la loi de substitution en gothique, soit à l’intérieur, soit à
la fin des mots....................................... *55
8 90. Exceptions à la loi de substitution au commencement des mots....... 156
8 91,1. Exceptions à la loi de substitution. — La ténue conservée après s, h
{ch)etf.......................... i.r>6
8 91, 2. Formes différentes prises en vertu de l’exception précédente par le
suffixe ti dans les langues germaniques...................... 167
9 î , 3. Le gothique change la moyenne en aspirée à la fin des mots et devant
un s final........................................... *59
8 91, A. Le th final de la conjugaison gothique. — Les aspirées douces des
langues germaniques................................... *§9
ALPHABET SLAVE.
8 99. Système des voyelles et des consonnes........................ ibt
8 92*. d, €, 0, A, *U, a, e, o, an, un.......................... i6a
8 99b. H, I*, M............................................ 165
8 93e. 31, ü,ùü..........'............ ................. *66
. , ■ ' ►
8 99 d. 31 m pour a........................................... *68^
S Q2°. 'B ê............. 168
8 92 r. 0\f tî, K)ju'........................................... 170
S 9a8. Tableau des consonnes dans l’ancien slave. — La gutturale X....... *7®
S 92h- La palatale M c. — Le lithuanien dz.......................... *73
8 92 La déntale If z......................................... *7&
S 9aLe j slave. (ïl jat tA jan, feje, H) ju, H* jun.................. 17A
germaniques
18A
% 92 S 9a"1
Les sifflantes
Loi de suppression des consonnes finales dans les langues slaves et
Fajjus.
t'7»
MODIFICATIONS EUPHONIQUES AU COMMENCEMENT ET À LA FIN DES MOTS.
S q3 “. Lois euphoniques relatives aux lettres finales en sanscrit. — Comparaison avec les langues germaniques....................... 187
S 98b. La loi notkérienne. — Changement d’une moyenne initiale en ténue. 199 S 9^. Modifications euphoniques à la fin d’un mot terminé par deux consonnes,
en sanscrit et en hautr-allemand........................... 19/1
S 96. S euphonique inséré en sanscrit entre une nasale et une dentale, cérébrale ou palatale,, — Faits analogues en haut-allemand et en latin., 1 q5 § 96. Insertion de lettres euphoniques en sanscrit, en grec, en latin et dans
les langues germaniques................................ 195
S 97. Modifications euphoniques à la fin des mots en grec ot en sanscrit. ... 19C
MODIFICATIONS EUPHONIQUES À L’INTERIEUR DES MOTS, PRODUITES
■
PAR LA RENCONTRE DU THEME ET DE LA FLfFKlON.
S 98. Modifications euphoniques en sanscrit........................
S 99. Modifications euphoniques en grec..........................
S 100. Modifications euphoniques en latin..........................
^ 101. Modifications euphoniques produites en latin par les suffixes coinmen-
çant par un t........................................
* 1 oa. Modifications euphoniques produites dans les langues germaniques, en
xend et en sanscrit, par les suffixes commençant par un I.......
S jo3. Modifications euphoniques produites dans les langues slaves par les
suffixes commençant par un t............................
S 1 oAa. Déplacement de l’aspiration en grec et en sanscrit..............
198
*99
900
909
20/|
9f09 9 f O
LES ACCENTS SANSCRITS.
S 1 oAb. L’oudâtta et le svarita dans les mots isolés. ................ *219
S 1 oA Emploi du svarita dans le corps de la phrase................... 215
S ioAa. Cas particuliers........................................ 21 g
S t oA®. Des signes employés pour marquer les accents. ................ 917
DES RACINES.
S 1 o5. Des racines verbales et des racines pronominales................ 931
S 106* Monosyllabisme des racines................................ 22a
S 107, Comparaison des racines indo-européennes et des racines sémitiques. . 23.3 8 108. Classification générale des langues. — Examen d’une opinion de
Fr. de Schlegel................. ...................... a25
l'age».
S 109*. Division des racines sanscrites en dix classes, d’après des caractères
qui se retrouvent dans les autres langues indo-européennes....... 231
8 109% t. Première et sixième classes............................. a3i
S 109", 2. Quatrième classe.................................... a35
8 109% 3. Deuxième, troisième et septième classes.................... 2A1
§ 109% à. Cinquième et huitième classes........................... 2^7
S 109“, 5. Neuvième classe. — Des impératifs sanscrits en «ne........... 248.
S 109% 6. Dixième classe...................................... 253
S 10911, 2. Racines terminées par une consonne...................... 263
8 u 0. Les suffixes sont-ils significatifs par eux-mêmes?................ 268
8 111. Des mots-racines................................... 269
FORMATION DES CAS.
GENRE ET NOMBRE.
S 112. Du thème ............................................ 271
8 ti 3. Des genres............................................ 273
S 11 h. Des nombres.......................................... 273
S 115. Des cas............................................... 275
* r*
THEMES FINISSANT PAR UNE VOYELLE.
27 O
276
277
278 280
280
281
283
28/1
287
S 116. De la lettre finale du thème. — Thèmes en a..................
8 117. Thèmes en i et en u.....................................
8 118. Thèmes en «..........................................
8 119. Thèmes féminins en î. — Formes correspondantes en grec et en latin.
8 120, 1. Thèmes féminins gothiques en cm........................
8 120,2, Thèmes féminins gothiques en jo.........................
8 121. Thèmes féminins lithuaniens en i.......,...................
8 122. Thèmes sanscrits en û. — Thèmes finissant par une diphthongue. —
'Le thème dyô «ciel»...................................
8 123. Le thème gô «vache» et «terre»............................
S 12Ü. Le thème nâu « vaisseau »i................................
THÈMES FINISSANT PAR UNE CONSONNE.
S *125. Thèmes terminés par une gutturale, une palatale ou une dentale..... 290 8 126. Thèmes terminés par une labiale. — I ajouté en latin et en gothique
à un thème finissant par une consonne...................... 292
8 127. Thèmes terminés par r et i........................ . 296
S 128. Thèmes terminés par un s................................ 296
455
Pii^jca.
CAS FORTS ET CAS FAIBLES.
& 129. Les cas en sanscrit. — Division en cas farts et en cas faibles........ 207
S 13o. Triple division des cas sanscrits en cm forts, faibles et très-faibles.... 299
8 131. Les cas forts et les cas faibles en zend......................., 3po
S i3a, 1. Les cas forts et les cas faibles en grec. — De l’accent dans la déclinaison des thèmes monosyllabiques, en grec et en sanscrit....... 3oa
S i3a, 2. Variations de l’accent dans la de'clinaison des thèmes monosyllabiques, en grec et en sanscrit.............................. 3o/j
8 i32, 3. Les cas forts et les cas faibles, sous le rapport de l’accentuation, en
lithuanien.......................................... 3o(>
% i3a, h. Les cas forts et les cas faibles en gothique... ................ 807
S 133. Insertion d’un n euphonique entre le thème et la désinence à certains
cas de la déclinaison sanscrite............................ 807
SINGULIER.
NOMINATIF.
S i3ü. La lettre s, suffixe du nominatif en sanscrit. — Origine de ce suffixe.. 309 S 135. La lettre s, suffixe du nominatif en gothique. — Suppression, affaiblis
sement ou contraction de la voyelle finale du thème............ 809
8 i36. Le signe du nominatif conservé en haut-allemand et en vieux norrois. 3i3 S 137. Nominatif des thèmes féminins en sanscrit et en zend. — De la désinence es dans la 5e et dans la 3e déclinaison latine.............. 313
S i38. Conservation du signe s après un thème finissant par une consonne.. 817
S 139, 1. Nominatif des thèmes en n, en sanscrit et en zend............. 319
S 139, 2. Nominatif des thèmes en n, en latin....................... 320
S îèo. Nominatif des thèmes en n, en gothique et en lithuanien.......... 3a 1
§ 1 h 1. Nominatif des thèmes neutres en an, en gothique........ ........ 32a
S 1/12. Adjonction, engolhique, d’un» final au nominatif des thèmes féminins. 3 ai S 143, 1. Rétablissement de n an nominatif des mots grecs et de certains mots
germaniques........................................ 3a5
S i43, 2. Suppression d’un v en grec, à la fin des thèmes féminins en av. . . 327 S iA4. Suppression de r au ntominatif des thèmes sanscrits et zends en ar. —
Fait analogue en lithuanien.............................. 33i
S ih 5. Suppression du signe du nominatif après les thèmes en r, en germa-
nique, en celtique, en grec et en latin...................... 33a
. S 1A6. Thèmes en s, en sanscrit et, en grec......................... 335
S 1A7, 1. Thèmes en s, en latin. — Changement de s en r.............. 338
$ i47, a. Suppression d’un a au nominatif, dans le thème lithuanien mènes., 3Ao S iA 8. Nominatif des thèmes neutres. — Tahieau comparatif du nominatif.. . 1
f.'IgM,
ACCUSATIF.
S 1/19. Du signe de l’accusatif. — L’accusatif dans les langues germaniques. . 365
S i5o. Accusatif des thèmes terminés par une consonne................ 367
S i5i. Accusatif des thèmes monosyllabiques en sanscrit. — De la désinence
latine em........................................... 368
S 15 2. Accusatif neutre en sanscrit, en grec et en latin. — Nominatif semblable
à l’accusatif......................................... 369
S i 53. Nominatif-accusatif des thèmes neutres, en gothique et en lithuanien.. 351 S 156. Les thèmes neutres en i et en u avaient-ils primitivement un m au nominatif et à l’accusatif?................................. 352
S 155. Le signe du neutre dans la déclinaison pronominale.............. 353
S i56. Origine des désinences t et m du neutre......,............... 356
S .157. Le neutre pronominal toi en lithuanien, — Tableau comparatif de l’accusatif..................*........................... 355
INSTRUMENTAL.
S i58. L’instrumental en zend et en sanscrit......... 357
S 169. De quelques formes d’instrumental en gothique................. 359
S 160. L’instrumentai en vieux haut-allemand....................... 359
S 161. L’instrumental en lithuanien............................... 361
S 162. De quelques formes particulières de l’i nstr u mental en zend......... 36a
S i63. Tableau comparatif de l’instrumental......................... 363
DATIF.
S 166. Le datif en sanscrit et en zend............................. 366
S i65. Datif des thèmes en a, en sanscrit et en zend.,................. 365
S 166. Le pronom annexe sma, — Sa présence en gothique.............. 366
S 167. Formes diverses du pronom annexe sma en gothique : nsa et sva.....867
S 168. Le pronom annexe sma dans les autres langues germaniques........ 368
S 169. Autres formes du pronom annexe sma en gothique : nka, wfva...... 369
S 170. Autre formé du pronom annexe stria en gothique . ww/ifl............ 37o
S 171. Restes du pronom annexe sma en ombrien.................... 370
S 172. Autre forme du pronom annexe sma en gothique : s.............. 871
8 173. Le pronom annexe sma dans la déclinaison des substantifs et des adjectifs. 372
S 176. Le pronom annexe sma, au féminin, en sanscrit et en zend......... 373
S 175. Le pronom annexe sma, au féminin, en gothique. — Le datif gothique. 376
S 176. Le datif lithuanien............. 376
S 177. Le datif grec est un ancien locatif. — Le datif latin 377
S 178. Tableau comparatif du datif............................... 879
l’njjos.
ABLATIF.
$ 179. L'ablatif en sanscrit. .................................... 38o
H 180. L’ablatif en zen il....................................... 381
S 181. L’ablatif dans l’ancienne langue latine et en osque............... 383
§ 18a. Restes de l’ancien ablatif dans le latin classique................. 384
S 183n, 1. Les adverbes grecs en <as, formés de l’ablatif................. 384
S 183% 2. Les adverbes gothiques en 0, formés de l’ablatif.............. 386
•S i83% 3. L’ablatif en ancien perse. — Adverbes slaves formés de l’ablatif... 388
S i83% 4. L’ablatif en arménien. — Tableau comparatif de l’ablatif....... 390
g 183 % 1. De la déclinaison arménienne en général................... 3q5
§ i83b, 2. Alphabet arménien. — Du^i arménien................... Aoa
GÉNITIF.
S 184. Désinence du génitif..................................... 411
S 185. Gouna d’un i ou d’un u devant le signe du génitif. — Le génitif en haut-
1 allemand.,......................................... Ai2
S 186. Génitif grec en os. — Génitif latin en is (archaïque us)........... 413
S 187. Génitif des thèmes en i et en u, en zend et dans le dialecte védique. . 4i3 8 188. Génitif des thèmes en a, en sanscrit et en zend. — Génitif arménien. 4i4 S 189. Les génitifs grecs en oto. — La désinence pronominale ius, en latin.
— Le génitif en osque et en ombrien...................... 418
S 190. Génitif des thèmes en «, en lithuanien et en borussien........... 429
S 191. Génitif gothique. — Génitif des thèmes en ar, en zend et en sanscrit. 4 2 3
§ 192. Le génitif féminin...................................... 4a 5
S i q3. Génitif des thèmes en t, en lithuanien et en ancien perse.......... 427
S 1 q4. Origine de la désinence du génitif. — Génitif albanais. -— Tableau
comparatif du génitif.................................. 4a8
*
LOCATIF.
(
S 195. Caractère du locatif en sanscrit, en zend et en grec.............. 43o
S 196. Locatif des thèmes en «, en sanscrit et en zend, — Formes analogues
en grec............................................ 431
S 197. Locatif des thèmes en o, en lithuanien et en lelte............... 431
S 198. Locatif des thèmes en i et en u3 en sanscrit....... 43s
§ 199. Locatif des thèmes en t et en u, en zend...................... 433
§ 300. Le génitif des deux premières déclinaisons latines est un ancien locatif.
— Le locatif en osque et en ombrien. — Adverbes latins en é.... 434
Pages,
S 20 9. Locatif féminin. — Locatif des thèmes en i et en u, en lithuanien. . . 439 S ao3. Tableau comparatif du locatif.............................. /j/40
VOCATIF.
Ü2
hhh
S 20/1. Accentuation du vocatif en sanscrit et en grec. — Vocatif des thèmes en a......................................
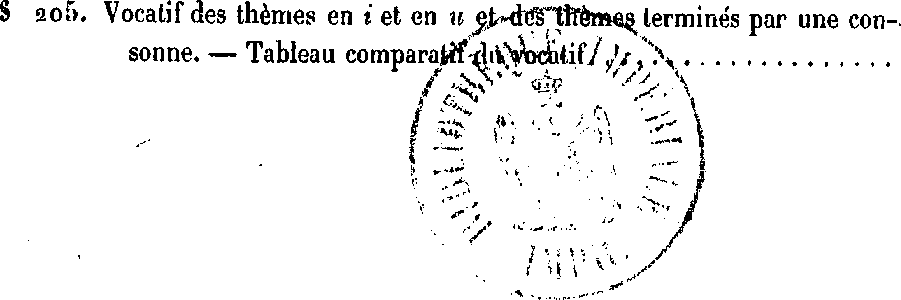
FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.
\
On trouvera des détails intéressants sur la part que prit Leibnitz au développement de la linguistique, dans le bel ouvrage de Max Muller : La science du langage. T. I, leçon quatrième. Le premier volume de cet ouvrage a été traduit en français par MM. Harris et Perrot. La traduction du second volume doit paraître prochainement.
Article sur la grammaire de Wilkins, dans le Moniteur du 9 G mai 1810.
Sérampour, 1806.
Londres, 1808.
a Calcutta, 1810. —La grammaire de Colebrooke, quoique publiée la première, ne lut connue de M. Ilopp que plus tard.
U faut excepter Je seul Adelung, qui, dans son Mithriciate {1, p, xxviit ,
et sïiiv.),'propose sur la nature et sur l’origine des flexions des vues pleines, de sens et de justesse. Mais il eût été en peine de les démontrer sur le greo : i ou sur le latin. Même après la publication du premier ouvrage de M, . >■
Ph. Buttmann, dans son Leœîlogus ( 1818 ), déclare qu’il est obligé de. , laisser les flexions en dehors de ses recherches, et Jacob Grimai, en i8.îï%, v dans la seconde édition de sa Grammaire allemande (I , p. 885), dit
les signes casuels sont pour lui « un élément mystérieux » dont il renonce* à:-1
découvrir la provenance. _ . "fl?:
Voyez surtout Grammaire comparée, § io8. ■
T. I, p. 425. , ■ ‘
Dès l’année 1819, quelques-unes des idées exposées par M. Bopp étaient reproduites en tête d’un livre qui est encore entre les mains de tous nos lycéens. Nous voulons parler de la Méthode pour étudier la langue grecque de J. L. Bumouf (voir Y Avertissement delà sixième édition); Le savant uniVer-
Grammaire comparée, S 537-61. '
a Ils ont pour titre collectif : Analyse comparative (tu sanscrit et des langues congénères. En voici la liste :
1826. Des racines et des pronoms de la t” et de la. a* personne. (Voir la recension d’Eugène Burnouf dans le Journal miattque, t. VI.)
Annales de critique scientifique, i83i. — Journal des Savants, 1833.
Cf.-Grammaire comparée, § 87, 1.
'*■ II s’agit de ce changement de voyelle qu’on observe dans les verbes comme-tek singé* tek sang, gesungen; I sing, } sang, sung.
M. Bopp n’a pas donné dans sa Grammaire comparée une. exposition d’ensemble sur ce sujet. Il explique les diverses variétés; dèq’a^phpm® ^ mesure qu’elles se présentent. Voir les SS 7 et suiv., 26 et syiv^ suiv., 506, 58q et suiv., 602 et suiv. La polémique contre Grimmsçbouve dans deux articles insérés, en 1827, dans les annales de critique scientifique., Ils sont reproduits dans le volume intitulé Vocalisme (Berlin, 18B6), QU ib sont suivis d’un autre article publié , en i835, dansle mêraerecueiL sur le Dictionnaire de Graff, ' • ;
’14 Grammaire comparée du sanscrit, du zend, du latin, du lithuanien,
du gothique et de l’allemand, in-6°. L’ouvrage parut en six livraisons, de
833 à 18/19. . ^ ;
Grammaire comparéeS A78.
II serait impossible d’entrer dans les critiques de détail : un travail aussi étendu sur des matières aussi variées et aussi neuves devait nécessairement Enfermer des points contestables.
Voici la liste des publications sanscrites de M. Bopp :
1. - GRAMMAIRES.
1834-1827. Exposition détaillée du système de la langue sanscrite. —Voir la recension d’Eugène Burnoüf, dans le Journal asiatique, t. VI.
1829-1832. Grammaüca critica lingius sans enta.
1834. Grammaire critique de la langue sanscrite, sous une forme abrégée, i845. 28 édition du même ouvrage. — C’est à cette édition que se rapportent les renvois de la Grammaire comparée.
1861-1863. 3e édition du même ouvrage.
- -2. - TEXTES ET TRADUCTIONS.
Nalus, carmen sameritum (Londres). Texte et traduction latine.
183o. 2e édition du même ouvrage (Berlin ). iS38. Nalas et Damayanti. (Traduction allemande.)
18a 4. Voyage d’Arjuna dans le ciel d’Indra, avec quelques épisodes du Mahâbhârata. (Texte et traduction allemande. )
1829, Le Déluge et trois autres épisodes du Mahâbhârata. (Texte et traduction allemande.)
..... 3. — GLOSSAIRES.
iBaS^-iBBo. Gîossarium sanscritum.
1840-1847. Glossarium sanscritum in quo omnes radices et vocabula usitatissima ex-
M. Schleicher a publié, en 1861, un Compendium de la grammaire comparée des langues indo-européennes, qui se recommande par l’exèeï-lente disposition des matières, par la précision des idées et la nouveauté d’une partie des observations. De son côté, M. Léo Meyer fait paraître une Grammaire comparée du grec et du latin, que distinguent Tabondance des exemples et la hardiesse souvent heureuse des rapprochements.
De là les nombreux sous-chiffres, l’auteur, avec raison, nayant pas voulu changer les numéros de ses paragraphes.
Dès 1858, M. Adolphe Regnier, sentant la nécessité d’une traduction française de la Grammaire comparée, avait entamé à ce sujet avec M. Bopp des négociations, qui, pour des raisons étrangères a leur volonté, ne purent alors aboutir,
Nous donnons, d’après une communication écrite de l’auteur, l’explication des mois physique, mécanique et dynamique : «Par lois mécaniques, j’entends principale-«ment les lois de h» pesanteur (SS 6, 7, 8), et en particulier l’influence que le «poids des désinences personnelles exerce sur la syllabe précédente (SS 48o, £89, « boA )* .Si, contrairement à mon opinion, l’on admet avec Grimm que le changement «de la voyelle dans la conjugaison germanique a une signification grammaticale, et «si, parëxernple, l’a du prétérit gothique band «je liai» est regardé comme Pexpres-«sioq du passëven opposition avec l’t du présent binda «je lie», on sera autorisé à «dire que cet a est*doué d’une force dynamique. Par lois physiques, je désigne les «autres Vègles de là grammaireot notamment les lois phoniques. Ainsi quand on dit «en sanscrit atrti «il mange».au lieu de ad-ti (de la racine ad «manger»), le chan-«gement du d en t,a pour cause une loi physique.»
j.
Le mot sanskrta (Si) veut dire «orné, achevé, parfait», et,èppliquéàla langue, il équivaut à notre mot «classique». On pourrait lo?ic>e’en servir très*hî|^ pour désigner la famille entière. Les éléments qui composans ce"moi; soht la prèpo sition inséparable mm «avec» et le participe krta (nominati J fer avec insertion d’un s euphonique (SS 18, 96). 24
Nous renvoyons le lecteur au jugement de Guillaume de Humboldt, sur la nécessité du sanscrit pour les recherches de linguistique et pour un certain ordre d'études historiques (Bibliothèque indienne, I, i33), Citons aussi quelques mots que nous empruntons à la préface de la Grammaire, de Grimai (a* edit. I, vî. ) : «Si «le latin et le grec, quoique placés à un degré supérieur, ne suffisent pas toujours r «pour éclaircir toutes les difficultés de la grammaire allemande, où certaines cordes «résonnent encore d'un son plus pür et plus profond, à leur tour ces idiomes, comme « l'a très-bien remarqué A. G. Schlegel, trouveront un correctif dans la grammaire «beaucoup plus parfaite du sanscrit. Le dialecte que l’histoire nous prouve être le plus «ancien et le moins altéré <Aoit servir de règle en dernier ressort, et il doit réformer «certaines iois admises jusqu’à présent pour les dialectes plus modernes, sans pour-« tant abroger totalement ces lois.»
Sur l’Age et l'authenticité de la langue zende et du Zend-Àvesta.
Tome II, p. 433. J; ,
Nous n’avons pas pensé qu’il fût nécessaire de reproduire une oote assezlongue,
où M. Bopp relève un certain nombre d’erreurs du vocabulaire zend-pehlvi. Le pro-grèsdes études iraniennes a mis ce point suffisamment ën lümière. —26 Tf. 26 ' ■
Je rappelle ici un principe qui 11e pouvait être rigoureusement démontré qu’à l’aide du sanscrit, et qui étend ses effets à la formation des mots et à toute la grammaire germanique : c’est que, sauf les cas indiqués au $ 69 2 , la longue de l’a en gothique est l’é; que, par conséquent, un 0 abrégé doit devenir a, et qu’un a allongé se change en d. On comprend dès lors comment de dags «jour» (thème daga) peut dériver sans apophonie l’adjectil -tlfign (thème dâga) qui marque, à la fin d’un mot, la durée par jours. En effet, cette dérivation est exactement de la même sorte que celle qui fait venir en sanscrit râgata aargenteus» de rügata «ar-gentum nV Nous reviendrons sur ce point dans la suite.
En général, la grammaire germanique reçoit une vive lumière de la comparaison avec le système des voyelles indiennes, lequel est resté, à peu d’exceptions près, à l’abri des altérations que l’influence des consonnes et d’autres causes encore pro-
Le rapprochement en question n’a pas encore été fait, que je sache: mais si on t’avait essayé, on se serait contenté de comparer le nominatif arménien au thème sanscrit, pùisque l’a, pas plus que l’o, l’« et l’i, n’avait été reconnu comme lettre finale des thèmes arméniens.
Pour cette nouvelle édition, je me sers, en tout ce qui concerne l’ancien-slave, des excellents écrits de Miklosich.
Les formes tmhaith, bairaith et svignjailh, qu’ont fait remarquer d’abord Von
der Gabelentz et Lobe, dans leur édition d’Ulfilas ( I, p. 315), ne m’étaient pas encore connues alors. Elles démentiraient la loi en question si elles; appartenaient en effet à l’actif, et si bairaith exemple, correspondait au sanscrit b'ârét qu’il «porte».
Mais je regarde ces formes comme appartenant au moyen, et je compare, par conséquent, bairaith au zend baratta» au sanscrit baréta, au grec (pépotro.
J’admets qu’au lieu de bairaith il y a eu d’abord bairaida (comparez le présent passif bair~arda = sanscrit hâr-a-tê, le grec^ép-e-Tai ). Après la perte de l’a final, il a fallu que l’aspirée, qui convenait mieux à la fin du mot, prît la place de la moyenne (§91, A ). Bairaith est donc venu d’une forme bairai-da, qu’il faut restituer, d’après l’analogie grammaticale, de la même façon que le nominatif-accusatif haubith vient du thème neutre hauhida (génitif haubidi-s). Les passifs gothiques, qui répondent tous, quant à leur origine, au moyen sanscrit, zend et perse, ont donc adopté une double forme à ia troisième personne du singulier : i’une, la plus fréquente, a ajouté un u à la forme primitive bairai-da = zend harai-ta, et fait , par conséquent, èatrui-dau (comparez les formes sanscrites comme dadâ'u «il plaçai?, au lieu qu’en zend noua avons dada); la seconde, comme on vient de le faire observer, a supprimé l’« final, ainsi que le font tous les accusatifs singuliers des thèmes masculins et neutres en a, et elle a donné à la dentale la forme qui convenait le mieux è la fin du mot. Je
On doit remarquer que le r peut se prononcer plus aisément que n’importe quelle autre consonne, sans être précédé ou suivi d’une voyelle; ainsi le r renferme dans le gothique brôthrs, brôthr «du frère, au frère n, pourrait être considéré comme une voyelle presque au même droit que le r sanscrit dans Vrâtr-Vyas «fratribus».
Grammatica àHlica lingual sansmtœ, § 33 nnnoL
Le système phonique de l’ancien perse, p. a3.
Racine pâ «conserver, protéger, commander» ; cf. 'zsârns de «rdritf. :
Les formes germaniques précitées ne sont pas appuyées d’exemples dans Graff; mais elles sont prouvées théoriquement, par les formes semblables dérivées de la racine gd (—sanscrit gâ « aller»), gê-s, gê~t, gé-més, gé-t. Sur des formes analogues en albanais, où nous avo^s,. par exemple, les formes hé-m «habeam », «ha» beat», ké-mi «habeamus», ké-ne «habeant», qui font pendant aux formes de l’indicatif ka-m, kâ, kë-mi (pour kâ-mi), kâ-ne, voir ma dissertation Sur Valbanais et ses affinités, p. 12 suiv.
Dans les monuments les plus anciens de la langue, c’est en effet la forme orthographique aï qui domine encore. (Schneider, I, p. 50 suiv.)
Une autre racine qui veut dire «s’efforcer» en sanscrit a pris en grec le sens
de «chercher», à savoir yat, dont le causatif yâtâyâmi répond au grec Kvféa!. (Sur K= y voir S19.) \ :
Je crois avoir reconnu la racine en question dans la langue albanaise, sous la forme fond. ( Voir mon Essai sur l'albanais, p. 56.)
. a J’ai rassemblé mes observations sur ce sujet, en les resserrant autant que possible, dans mon Vocalisme, p. a suiv. et p, 237 suiv.
11 sera question plus tard, dans la théorie du verbe, de la distinction entre les terminaisons pesantes et les terminaisons légères. Il suffira de dire ici que les terminaisons pesantes, à l’indicatif présent, sont celles du duel et du pluriel. — Tr.
En sanscrit, les labiales exercent souvent une influence sur la voyelle suivante et
L’auteur appelle inorganiques les voyelles qui ne sont pas primitives. (Comparez
SS 9-5 ).— Tr.
Quand elle n’est pas supprimée tout à lait, comme dans les désinences personnelles.
La racine contenue dans estgar, gr qui se retrouve, mais sans aspiration, dansTirlàndàis gar,degarairn M’échauffe», et dans le russe gor, de gorjuvje brûle».
Pour d’autres rapprochements, voyez le Glossaire sanscrit, 18*17, p. 29e-
Je donne la préférence à la première dénomination, parce qu’elle répond exactement au terme indien mnrdanyà «capitalisa (de mïïrdan «tête» ) et parce que l’on désigne ordinairement dans les langues de l’Europe sous le nom de linguales les consonnes qui correspondent aux dentales (§16) sanscrites.
* Les racines commençant par un n dental n) changent cette lettre en un n cérébral (XQV »t) sous l’influence de certaines lois phoniques; par exemple : pra-nai-yati «il périt», à cause de la consonne r qui précède. Dans ces cas, les grammairiens indiens supposent que le n cérébral est primitif : ils donnent par exemple une racine naà. Mais le verbe simple venant de cette racine, à laquelle répondent le latin nec (dans nex, necis) et le grec vex (dans vex-pos, véx-vs) a partout un n dental.
Voir ma Dissertation sur le pronom démonstratif et l’origine des cas. (Mémoires de l’Académie de Berlin, t8a6, p. 90.)
" La racine sanscrite correspondante gtip ne s’est pas encore rencontrée avec le sens de «parler». Jeregarde le grec Soiïisos, Sovitéu, comme des formes mutilées pour ydovnos, ySovTiéa), dont il ne serait resté que le surcroît inorganique, à peu près comme dans le latin vermis (venant de qvermis) et le gothique vaürms comparés au sanscrit hrmi~s venant de kâmw, en albanais brüm; ou comme dans l’allemand wer, comparé au gothique hva-n et au sanscrit kn-8.
C’est-sur ce mot que j’ai d’abord constaté Je fait en question. (Voyez mon Mémoire sur quelques thèmes démonstratifs et leur rapport avec diverses prépositions et conjonctions, i83o, p. so.) Je ne pouvais encore continuer celle observation par la comparaison du prâcrit, 1’ nue alors.
'• »
C’est sur cet exemple que j’ai constaté d’abord en grec l’assimilation du F. Voyez ma Dissertation sur les noms de nombre, (Mémoires de l’Académie de Berlin, 1833, p. 166.)
Entre autres At Fi , qui répond, quant à la forme, au locatif sanscrit dm ? dans le ciel».
Le changement de l’a en w a dû être amené en partie par le voisinage de la
nasale qui le suivait.
Peut-être aussi faut-il voir, dans le r du gothique ras-da «discours?), l’altération d’un ancien v, de sorte que ce mot appartiendrait a la racine sanscrite vad «parlera En effet, le d Ae vad doit devenir un t en gothique (S 87), et ce t doit se changer, a son tour, en sifflante devant la dentale qui commence la terminaison (S 102 ). Je regarde le suffixe da comme celui du participe passif. Nous reviendrons plus tard sur ce point. Rapprochez encore le vieux haut-allemand far-wâzu «maledico», où le v s’est conservé, et l’irlandais rrndrn «je dis».
Schleicher (Théorie des formes du slave ecclésiastique, p. i3i) rapproche le verbe rêkun du sanscrit lap; mais nous 11e pouvons approuver cette étymologie. Le sanscrit lap a donné, en latin, loquor, par le changement de la labiale en gutturale, qui se retrouve dans coquo comparé au sanscrit pâéâmi (venant de pale), au grec iséaaù), au serbe poèem (même sens), à l’ancien slave pehan. Lap a peut-être donne, en borussien, la racine laÿ> « commander» ( laipinna «il commanda»), et en lithuanien Ivpju «je commande», at-si-lépju «je réponds».
Le mot raf est employé, au commencement des composés, de la même façon et avec le même sens que le dis latin; nous qvons, par exemple, en rusé, raçbmiju « dirimo », raM'âju «distraho», raspmUju-sj «disrnmpor». ;
Voyez Système comparatif d’accentuation, note ai.
Je me suis déjà prononcé dans ce sens, quoique d’une façon dubitative, dans la première édition de cet ouvrage (p. 446) : «Si Ton voulait expliquer, par des «raisons historiques, le cas présent et plusieurs autres, il faudrait admettre que les «familles lette et slave ont quitté le séjour primitif de la race à une époque où la «langue s’était déjà amollie,et que ces affaiblissements n’existaient pas encore au «temps où les Grecs et les Romains (ainsi que les Germains, les Celtes et les Alba-«nais) apportèrent en Europe l’idiome primitif.» Depuis ce temps, ma conviction, sur ce point, n’a fait que s’affermir. Il est très-important d’observer que la formation de certains sons secondaires nous fournit comme une échelle chronologique, d’après iaquelle'nous pouvons estimer l’époque plus ou moins reculée où les peuples de 1 Europe se sont séparés de leurs frères de l’Asie. C’est ainsi que nous voyons que toutes les langues de l’Europe, même le lette et le slave, se sont détachées dù sanscrit avant les langues iraniennes ou médo-perses. Cela ressort particulièrement de ce que le zend et le perse n’ont pas seulement la sifflante palatale, mais encore les muettes de même classe (^é, s^g); l’accord avec le sanscrit est si grand à cet égard, qu’on ne peut admettre"que le zend et le perse les aient formées d’une manière indépendante, comme il est arrivé peut-être, en slave, pour le m c; il faut, ,au contraire, que ce soit, pour ainsi dire, un héritage du sanscrit.
Toutefois les grammairiens indiens écrivent par un è les racines qui, commençant par un s, le changent en è sous l'influence d'une voyelle précédente, autre que a, â, contenue, soit dans une préposition préfixée, soit dans 1$ syllabe rédupli-calive, exemple : ni-êîdati «il s'assied», en opposition avec ndati,prasidati.
Au sujet de la perte de l’ancienne aspirée en albanais, voir mon Jtfémoire sur l’albanais et ses affinités, pages 56 et 8A.
Toutefois, cette contraction a lieu partout en vieux saxon ; le vieux saxon bêt «je mordis, il mordit», est à cause de cela plus près du sanscrit bibéda que du gothique bait; et kôs «je choisis, il choisit», est plus près du sanscrit gugô'éa « j’aimai, il aima» (racine ff itê formée do gtw), que du gothique bans: -
At-gijù «je me récrée, je revis», et gyju «je reviens à la santé», ont évidemment
perdu un w comme le zend gi de hu-gîti «bonam vitam habens».
Ûiv par euphonie pour «, à peu près comme dans le sanscrit âbuv-am «j’étais» (aoriste), en lithuanien bwv~an-, de la racine ffu, en lithuanien bu «être».
J’ai renoncé depuis longtemps à l’opinion que IV des désinences ait pu influer par assimilation sur la syllabe radicale : en général, il n’y a pas lieu de reconnaître en gothique une influence de ce genre. 11 n’y en a pas trace non plus en latin; les formes comme pcrennis pour pemnnis, s’expliquent autrement que par l’action de IV de la terminaison (S 0).
Voyez Glossaire sanscrit, 1867, p. 385.
Abstraction faite des fautes de copiste* la confusion entre 1» et V étant, extrêmement fréquente dans les manuscrits zends.
En supposant que c’est à tort que j’attribue à 1»« la prononciation au, il est du moins certain que * et 1» dans cette combinaison ne forment qu’une seule et même syllabe, conséquemment une diphthongue : on ne peut admettre que le ■« a soit une voyelle insérée avant la diphthongue sanscrite ô, dont le zend 1» o serait la représentation. Il est, au contraire, certain que l’a est identique à la voyelle a renfermée dans la diphthongue sanscrite o (contractée de au) et que le 1» o est, quant à son origine, identique à la seconde partie de la diphthongue perse au et à l’« renfermé dans l’o sanscrit. On a donc, selon moi, le choix entre deux opinions : ou bien la diphthongue primitive au s’est conservée tout entière et sans altération en zend au commencement et à l’intérieur des mots, ou bien elle a laissé l’« se changer en o, à peu près comme en vieux haut-allemand l’w gothique est devenu très-souvent o. Il est certain que dans la prononciation la diphthongue ao diffère très-peu de aw. Si, dans l’éciiture, ^ 6 ne diffère de 1» o que par le signe qui sert à distinguer les longues des brèves (comparez Wet ,» î, > ne t ^ il ne s’ensuit pas que 1»
êtésâm (primitivement aitaiêâm). En effet, n’est pas autre chose que aitaisahm, et le thème démonstratif répond par le son comme par l’étymologie à l’ancien perse aita et au sanscrit êta (ipr). A la fin des mots, la diphthongue en question s’est également conservée dans sa prononciation primitive ai ()#*)> quand elle est suivie de l’enclitique ca «et»; exemple : ratwaica «dominoque» contrai-
Voyez Bulletin mensuel de l’Académie de Berlin, mars i848, p. t '16.
3 La diphthongue ai est régulièrement représentée en pârsi par j©*. (Spiegel, Grammaire pârsie, p. ai.)
Burnouf transcrit $w_par ç et incline à y voir une mutilation ou, à l’origine, la vraie représentation du son hv. {Yaçna, Alphabet zend, p. 73.)
a De la vient le persan I o^ hhudâ «dieu». En sanscrit evayam-Uu, littéralement «existant par lui-même», est u^Sumom de Vichnou.
Voyez Burnoul, Yaçna, notes, p. 8/i etsuiv. J Voyez Burnou f, Yaçna. notes, p. 89.
Études, p. èao, 1 .
La signification «ouverture» convient très-bien au passage en question (kêrè-
nûidiskêndëm éêmanô «ouvre son cœur», mot à mot «fais ouverture son cœur»). Né-riosengh, dont la traduction est très-utile en cet endroit, met üangan tasya manamh kuru, c’est-à-dire «fais ouverture de son cœur». Quanti la nasale de ékëndëm, elle se retrouve en sanscrit dans le thème spécial cind, et en latin dans scmd. Je rappelle, au sujet de la voyelle zende f, tenant la place d’an t sanscrit devant un n, le rapport
de hëndu «Inde» avec sindu.
Je préfère cette étymologie â celle qui, coupant le mot de cette iaçon, eis-ca, œs-ca, fait de ea un suffixe. En effet, le gothique aihtrô «je mendie», qui appartient à la même famille et qui suppose une racine aih (pour ih), est dans le même rapport avec le sanscrit ië, formé de isk, quefrah «demander» avec le sanscrit pmc, formé de prask. Rapprochez encore le grec tn dans àpo-îx-1vs, qui montre aussi que le k de yaska appartient à la racine.
Burnou!, laçna, p. a/n cl suiv.
Le mot anya «autre», qui est ie même en zend qu’en sanscrit, fait exception. Mais on voit, par l’exemple de maînyu, en sanscrit manyu (de la racine man «penser» ), que le n n’arrête pas l’action de y sur lVi delà syllabe precedente.
De là, par exemple, dâmabyô (et non dttniaibyo) au datif-ablatif pluriel du thème daman.
Remarquez que la terminaison mi, par elle-même, n’exercerait aucune influence euphonique sur la syllabe précédente, wi étant (S Ai) une lettre qui arrête lépen-thèse.
Je regarde yaé comme la racine sanscrite correspondante; elle a formé le
substantif «gloire»; mais le verbe n’est pas resté dans la langue; en zend,
la voyelle radicale a été allongée.
■"> Je ne regarde pas ce hî" comme étant la même diphtliongue dont j’ai parlé au
Sanscrit p%rva. Le zend suppose une forme sanscrite différente frappée du gouna : pôrva venant de paurva (cf. purâs « devant n).
s II est à remarquer que les diphthongues j* ai et >•*> au, qui sont formées par l’épenthèse, et qui appartiennent à un âge relativement récent, sont représentées dans l’écriture d’une façon autre et, jusqu’à un certain point, plus claire que les diphthongues 1»**, dont nous parlions plus haut (§§ 32 et 33); cela tient, ou bien à la différence d’âge de ces deux sortes de diphthongues, ou bien à la nature même des sons j*> et >*, qui, en réalité, ne forment pas une diphthongue, mais se prononcent séparément et font deux syllabes. Il faut prononcer paiii et non
paitif ta-u-runa et non tau-ru~na.
Comparez en sanscrit tank et tané «aller, (courir?)», lithuanien tehu «je cours», ancien slave Ickun (môme sens), grec ra^és, ce dernier avec une aspirée inorganique.
Voyez Grammaire sanscrite, S 101 \
a On écrit aussi «jj^g masfaja. Il y a encore quelques autres mots où devant jj on trouve^yy, qu’Ànquetil lit sch, mais que Rasli traduit par sk, comme semble l’indiquer aussi l’écriture, la lettre yp étant composée de j© a et de ^ k.
5ü. Le groupe hr.
?
Le groupe hr, comme représentant du sanscrit sr, est rare en zend, et partout où il paraît, si hr est précédé de a, on place un j n entre a et h (S 56n); exemples : ii)4p|»^j»4p hasanhra « mille »,
Yaçna, noies, p. 55. Pour expliquer celte forme gdum, il faut la rapporter à une forme sanscrite gavant, dont gâm n'est que la contraction ; en effet, nt gô tire ses cas forts de gau : nominatif pluriel gâva-s. Il se présente encore une autre . explication : on peut supposer que l'accusatif zend gdum appartient à un thème gava, qu’on retrouve eu sanscrit avec le sens de veau au commencement de certains composés; exemples : gava-râgan (littéralement «vitelîorum-rex»). Dans ce cas, l’d long de gdum serait une compensation pour la contraction de va en u.
Snr | n devant 6 voyez 8 aai.
pddànâm; baratin «ferant»J, au lieu de ba-rân, comme on devrait l’attendre d’après l’analogie des autres personnes. Troisièmement, à la fin des mots, a 1 accusatif pluriel des thèmes masculins en a, où je regarde la terminaison ^ ah comme un reste de la désinence complété a»£ ans, laquelle s est conservée devant l’enclitique ca «et»2.
S 6â. Les nasales $ et aT — Le groupe {y>j nuh.
Le zend a deux lettres pour représenter la nasale qui vient s’ajouter, dans certains cas (S 56a), comme surcroît euphonique à un Qy h, tenant la place du ^ s sanscrit : ce sont $ et aT, qu’Ànquetil prononce tous deux ng, et que nous transcrivons n, Ges deux lettres diffèrent l’une de l’autre dans 1 usage en ce que j se trouve toujours après « a et fi» do, tandis que aT, qui est d’un emploi plus rare, ne se trouve qu’apres * i et ê; exemples : y&tyhê «qui» (pronom relatif, nominatif
pluriel); ^u^yA^jj* ainhâo «hiijus» (au féminin); mais on écrit,
1 Imparfait du subjonctif avec le sens du présent. Voyez S 71 A. a Voyez S a89, et cf. la terminaison védique dû pour dnr, venant de
On a toutefois en vieux haut-allemand quelques exemples de è tenant la place d’un â primitif. Voyez S 109“ 3.
Je regarde râd’ «faire, accomplir n comme la racine sanscrite correspondante, laquelle ne pouvait devenir, en gothique, que râd ou réd.
Quand l’orthographe d’un mot est flottante en vieux haut-allemand, par suite de la substitution de consonnes (S 87, 1), j’adopte l’orthographe la plus ancienne et s’accordant en môme temps le mieux avec le moyen haut-allemand et le haut-allemand moderne. •
Graff (ï, p. sa) doute si cet ê est long ou bref, mais il regarde la brève comme plus vraisemblable. Grimm, qui était d’abord du même avis (I, p. 586), a changé (TV, 76 ). Je maintiens la brièveté de Ve jusqu’à ce que des manuscrits viennent me prouver le contraire, soit par l’accent circonflexe, soit par te redoublement des consonnes.
Je regarde le t qui déjà en vieux haut-allemand est fréquemment ajouté à la désinence s de la 2e personne du singulier, comme un reste du pronom de la s° personne; le pronom, dans cette position, a gardé le t, grâce à la lettre s qui précède • on trouve même le pronom, sous la forme pleine tu, ajouté fréquemment en vieux haut-allemand â la fin d’un verbe; exemples : bistu, fahistu, mahtu. (Voyez Graff, V, p. 80.)
II n’en est pas toujours ainsi du 3c » sanscrit, qui peut se trouver à îa fin d’un mot (S t3).
Je regarde maintenant, d’accord, sur ce point, avec le livre des Unâdi, et con-
La grammaire et la formation des mots en gothique ne se prêtent pas à la rencontre d’une sifflante avec un b.
Thème des cas obliques du pluriel du pronom de la a' personne. {Cf. S t67. )
;l On le trouve cependant au même endroit devant kvm « comment? ».
hauteur, qui suppose la loi de substitution connue de ses lecteurs, ne s’y arrêté pas dans sa deuxième édition. Nous avons rétabli une partie des exemples cités dans la première édition. — Tr.
II m’avait échappé, dans la première édition de cet ouvrage, que Rask avait déjà clairement indiqué la loi de substitution dans ses Recherches sur l’origine du
Sur la cause du changement du t en & dans S-pi'ê, > voyez § 106. a Thème dans les composés ga-dédi, missa-dédi, vaila-dêdi.
1 Prétérit avec le sens du présent. Comparez le lithuanien drasùs «hardi», le grec 3-paertk, le celtique (irlandais) dasachd «férocité, courage». (Voyez Glossaire sanscrit, éd. 18Ù7, p. 186. )
A Primitivement «ce qui est rouge» ; comparez rôtnta-s, venu de rêdita-s, et rap-
Je rappelle à ce propos que la racine sanscrite vid «savoir» a dû également avoir dans le principe le sens de «voir», lequel se retrouve encore dans le grec FtS et le latin vid. De même, la racine bwt«savoir» a dû signifier primitivement «voir», sens qui s’est conservé seulement dans lé zend bud\ Je soupçonne aussi que la racine sanscrite tark «penser» est de la même famille que daré9 toutes les deux venant de dark «voir» (éépxw) ,1a ténue s’étant substituée à la moyenne initiale (comme dans trhh, venant de dr,V «grandir»). K tark il faut rapporter peut-être le madécasse tsereq «pensée» ( Ouvrage cité, p. 135).
«Je demeure » s avec u frappé du gouna = sanscrit av ? de bav-â-mi «je suis».
Dans le composé brôthra-lubô «amour fraternel». Sur la moyenne, dans le latin lubet, voyez S 17.
ALPXIfô est terminé par un suffixe et répondrait à un mot sanscrit lagu-ka-s Le gothique leiht-8, thème leîhta, est, quant à la forme, un participe passif, comme mah-t-8, thèmemahta, de la racine mag «pouvoir» (slave mogun crit manh «grandir». Le h de ledits est donc mis aussi, à cause d g que demanderait le g sanscrit. Sur le h sanscrit, tenant la plac mollement, voyez S a3.
On trouve toutefois iywijô-n «je me conserve» = gîvâyâmi «je fais vivre».
On trouve aussi, en zend, g*. Les deux formes sont pour sîv, gîv. Une autre altération de la racine sanscrite gtv est le zend su ou gu, la voyelle ayant été supprimée et le v vocalisé. De gu vient gva «vivant», et de_>5 suvana (même sens, suffixe ana, comme dans le sanscrit gval-anâ-s «brillant»). Je renonce à l’hypothèse qui rapporterait le grec à la même racine, le K grec ne pouvant représenter qu’un y sanscrit, mais non un g ou un g. Je crois, en conséquence, que la racine grecque Çs doit être identifiée avec la racine sanscrite 37 ÿd «aller», d’où vient yiï-trâ «provision». La racine sanscrite car, qui signifie aussi «aller», a pris de même, en ossète, le sens de «vivre». Au sanscrit gîva-s zrien répond le grec filos, venant de filFos pour yfJ'off. (Voyez Système comparatif d’accentuation, p. 217.)
H ne paraît pas qu’une sifflante molle puisse subsister, en lithuanien,à la fin des mots ; voilà pourquoi nous avons a4 et non ai.
:s La racine sanscrite est rie, venant do rik, en latin lie, en grec hn.
Identique, par la racine et le suffixe, au sanscrit ma-ti «raison, opinion»; racine man «penser». ‘
Sur le sck, qu’on rencontre déjà en vieux haut-allemand, pour slt, voyez Grimm,
1,173,et Graff, VI,/ioa et suiv.
Sur les sifflantes préservant aussi en zend le t de toute altération voy. § 38.
3 Les mots entre parenthèses sont les formes correspondantes en haut-allemand moderne. — Tr.
Grimin, p. 161 et suiv. 189 et suiv.
C’est Vostokov qui a reconnu le premier dans A, comme dans d», une voyelle nasalisée.
Miklosich, Phonologie comparée des langues slaves, p. 63 et suiv.
Sur un fait analogue en albanais, voyez la dissertation citée § 5. Il suffit de rappeler ici le rapport de la ire personne jam «je suisw avec la 3e personne, qui n’a pas de prosthèse, iéte ou eêts (l. c, p. 1 i).
Gothique itaith. (Voyez mon mémoire Sur la langue des Borussiens, p. 39.)
Nous mettons l’actif, quoique la racine soit surtout employée au moyen , plàvc,
a Usité dans Je dialecte védique. (Voyez Weber, Études indiennes, l, 33p, noie. ) —■ En zend, nous avons étaura «bêle de sommes.
Le changement inverse, à savoir celui des gutturales en sifflantes, par l’influence rétroactive d’une voyelle molle, ressort de la comparaison des langues slaves entre elles ( voyez Dobrowsky, p. 3ç)4i); comparez, par exemple, les vocatifs A^V1116 ditée, E0?K€ boàe avec leurs thèmes AOtfXO ducho «'crvewfxa, spiritus», EOro bogo «dieu». Au contraire, le changement d’une ancienne sifflante en X, fait qui donne un aspect tout nouveau à certaines formés grammaticales, ne pouvait être découvert que par la comparaison avec des langues primitives de la même souche, comme le sanscrit et le zend, quoique les locatifs pluriels lithuaniens en se et sa eussent pu conduire, également à la connaissance du même phénomène.
a Voyez Grimm,Grammaire, I, p. 1069. Dobrowsky, Grammaire, I,ch. u,§ 19, ch. vn, § 90 , regarde le X comme une désinence personnelle.
G est ià 1 orthographe ancienne du son tch; on l’écr i to r d i n ai r em e n t cz; ce qui me paraît moins rationnel.
Cet », dans la prononciation actuelle, est presque imperceptible à l’oreille.
Comparez l'influence du y zend (S lequel a besoin toutefois de la présence d’un *, f ou e dans la syllabe suivante.
‘ Mikiosïen , Théorie des formes, p. 7.
;■Le thème sweéia «hôte» (Mielcke, p. a6) est, à ce qu’il semble, la seule exception ; nous dirons plus tard pourquoi ce thème n’opère pas au nominatif ia contraction en i, ni le changement en te aux cas obliques mentionnés plus haut : il fait swecia-s, swecia-m (datif duel), etc.
Ce dernier, seulement au génitif pluriel (Mielcke, p. 83), tandis quezwàkiû se trouve au duel comme au pluriel ; mais il n’y a guère de doute que giesmu «duorum carminum», si tant est que cette forme soit juste, n’ait été précédé de giesmjû. D’après Ruhig, le géiiïtif pluriel serait également gzWm, a« lieu de giesmjû.
Phonologie comparée, p. 111 s. et p, a8.
Nous ne.discuterons pas s il faut lire mo-i ou mo-jt; dans le dernier cas, il faudrait plutôt diviser ainsi : moj-Ccar le thème est mojo (S s58); le nominatif singulier gérait, s’il ne dérogeait à l’analogie des thèmes en jo, moju (mfi) au lieu de MOU moj, et le nominatif pluriel serait moji, comme vlük-i «loups» lithuanien = ttfc* (à diviser ainsi wllka-i, dissyllabe). Si, au contraire, il faut lire «bï,-c'est que le signe casuel et la voyelle finale du thème sont tombes, et l’i est la vocalisation de la semi-voyelle j du thème mojo. En tout cas, la représentation graphique serait défectueuse , sila syllabe jt était seulement représentée par h* puisque d’autres syllabes qui commencent par j sont écrites par des lettres doubles comme m (= ja), K (=/«)• (Voyez Kopilar, Giagolila, p. 5t.)
J’écris ainsi au Heu de «, qui doit être évidemment regardé comme une sim.nu simple, avant la prononciation du ^ S sanscrit, du slave Ul ê et du sch allemand. Ce derniër est sorti, dans les cas énumérés $ 47, d’un » ordinaire; mais hors de là il est une altération de sk.
* Au commencement des composés.
1 Primitivement «briller», védique évétyâ' «aurore».
* catT-d-TH «Briller». Le slave -h et le lithuanien t se rapportent à la forme sanscrite frappée d>" gouna èvét ( S 9 a * ).
Accentuation védique ; compares ie grec ôxmS. Le à de ce nom de nombre est la
transformation euphonique d’un ipalatal (comparez aiiti «quatre-vingts»), prodoite
par le t suivant, comme dans dsU «moran», de la racine venant de A grec San.
A ta première personne, H<\\diY\l> imamï «j’ai» a tout aussi bien conservé la désinence que jesmï«je suisr>,jamï «je mange», et damï «je donne»; mais tes autres verbes ont changé la terminaison mï en la nasale faible renfermée dans que nous avons comparée (§ 1 0) à l’anoiisvâra sanscrit.
G. ttoseti, Grammaire ossète, |>- <8.
J’ai cru, dans le principe (ira édit. § 255'), que la loi de suppression des con
sonnes finales primitives se bornait aux mots polysyllabiques, et je comparais le génitif-locatif pluriel de la il6et delà a* personne, NdC2, KdC^, pour lesquels Do-browsky écrit NdC nas, KrtC vas, aux formes secondaires sanscrites nas, ôpq
vas (loc. cit. S 338). Mais, plus tard, j’ai rapporté la sifflante contenue dans ces formes au génitif sanscrit sam (borussien son) et au locatif sanscrit sm, bien que croyant toujours qu’il fallait lire nas, vas au lieu de na-sü,va-sü. Si l’on donne au 2 la prononciation ü, le nominatif singulier d32 «je», que Dobrowsky écrit à tort d3 as, cesse lui-même d’être un monosyllabe, et il n’y a que le m final du sanscrit ahdm et du zend asem qui soit tombé. Au contraire, le gothique ik a perdu même la voyelle qui précède la consonne finale, comme cela est arrivé dans les dialectes slaves vivants, par exemple daps le slovènejn3. ïl n y a que très-peu de monosyllabes en ancien slave, tandis que, dans les dialectes plus recents, ils sont devenus extrêmement nombreux, à cause surtout de la suppression ou de la non-prononcialion du
2, et à cause de la chute iréquenle du I» ï final.
On peut dire qu’il n’y a pas de consonne finale en ancien slave, car la ou Dobrowsky croiL en trouver, il y a omission d’un b fou d’un 2 ü ($ 92e}- Il écrit, par exemple, HCCCT pour H£C€Tk nesetï «il porte», et N£C€M pour N€C€rt\2 nesemii «nous portons». Ces erreurs n’empêchaient pas de reconnaître les rapports gramma-licaux du slave avec le sanscrit, car on reconnaissait aussi dans neset, nesetn, des formes analogues à vâh~a~ti «voliit», vah-a-mas «vehirnus», de meme que, p«u
Sur la langue kavie, introduction, p. t53.
H faut remarquer que la palatale se prononce comme si elle commençait par un l (é^-téh). ‘ *
II n’est pas nécessaire de dire que nous écrivons, comme Vossius, ob-sotesco, et non, comme Schneider (p. 571), obs-ohsco.
Nous ne pouvons nous régler en ceci sur les manuscrits originaux, car ils no séparent pas les mots et écrivent des vers entiers sans interruption, comme s’ils n’avaient à représenter que des syllabes dénuées de sens, et non des mots formant chacun un tout significatif. Gomme il faut de toute nécessité s’écarter des habitudes indiennes, la méthode de séparation la pins complète est la plus raisonnable.
Comparez ie grec réperojxai, le sanscrit tari, tri «avoir soif» (primitivement «êtresec»), le gothique ga-thairsan «se dessécher» ( racine thars ). thauvsu-s «sec», thaursja «j’ai soit ».
Cette anomalie vient probablement de ce que i’i, inséré entre b racine elle verbe auxiliaire, n’est tombé qu’à une époque relativement récente (gi-miz-ta pour f>i-n<riz-i-ta).
Comparez J. L. BurnouJoum. asiat, III, 368, et Buttmann, p. 77, 78.
- On explique ordinairement ces faits en supposant deux aspirations, dont i une serait supprimée, parce que le grec ne soutire pas que deux syllabes consécutives soient aspirées. Mais nous voyons que la langue a évité dfes l'origine d’accumuler les aspirées : nous ne trouvons pas une seule racine en sanscrit qui ait une aspirée au commencement et une autre à la fin. Les formes grecques èQdQByv, te0d@0«c, re-fldfpfla, Te&xparaj, T£0p#0ai, èOpéÇdyv sont des anomalies : on peut les expliquer en supposant que la langue a fini par considérer dans ces mots 1 aspiree initiale comme étant radicale, et qu’elle l’a laissée subsister là ou elle n avait pas de raison d’être. Ou bien l’on pourrait dire que étant mis souvent pour ts0 ou (30, la langue a traité cè $ comme n’étant pas dans ces mots une véritable aspirée. H est vrai que celte explication, qui me paraît la plus vraisemblable, ne peut s’appliquer à T£0d@aT«i .
1 à.
Voyez Système comparatif d’accentuation, p. 22 ô noie.
B pour y,.comme, par exemple, dans (3/Snfxi, f3'05’ en sanscn!,
ilùrdmi, gurii-i (Ae gants),gâu-s,gfàa-s (de gtva-s).
. Voyez ie Glossaire sanscrit, ,84o,p.e,et Benfey,Lexique des racines grecques,
H, p. 66. On pourrait aussi rapporter à la même racine gâàÜ-o avadosus, non profondes», et regarder, par conséquent, agâda-* comme la négation de gddci-s.
* Pour les voyelles longues, nous mettons le signe qui indique 1 accentuation a
côté du circonflexe qui marque la quantité.
C’est ainsi qu’accentue également Bôhtlingk ( Ghrestomathie, p. a63). Voyez mon Système comparatif d’accentuation, note 3o.
a De hihalt, pour le gothique haihald, ainsi qtte Grimm l’a montré avec beaucoup do sagacité.
C’est le svarita secondaire que Roth appelle svarita enclitique ( Yâsha, p. LXIV). On peut s’en faire une idée par certains composés allemands, où, à côté de la syllabe qui reçoit l’accent principal, il peut s’en trouver une antre marquée d’un accent secondaire, mais presque aussi, sensible que le premier : tels sont les mais funsganger, mü'ssiggâ'nger. Il est en tout cas digne de remarque que l'allemand, dont l’accentuation repose sur un principe tout logique, ne supprime pas l’individualité des différents membres d’un composé comme le sanscrit ou le grec. Ainsi, les trois mots qui forment le composé ôberburgermei'ster ont conservé chacun leur accent, quoique le iôn appuie plus fortement sur le premier membre àber.
Voyez S îoft h.
Nous regardons ces deux locatifs comme répondant aux datifs grecs (S y o o ).
Voir, pour l’explication des mots mécanique et dynamique, pa{je 1 de ce volume, note.— Tr.
Dans son ouvrage Sur la langue et la sagesse des Indous,
i5 .
Dans son ouvrage, Observations sur la langue et la littérature provençales (en français), il établit toutefois trois classes de langues (p. ih etsuiv.) : les langues sans aucune structure gi'ammaticale, les langues qui emploient des ajjixes, et les langues à inflexions. Il dit des dernières : «Je pensé, cependant, qu’il faut assigner le premier «rang aux langues à inflexions. On pourrait les appeler les langues organiques, «parce qu’elles renferment un principe vivant de développement et d’accroissement, «et qu’elles ont seules, 8Î je puis m’exprimer ainsi, une végétation abondante et «féconde. Le merveilleux artificè de ces langues est de former une immense variété «de mots, et de marquer la liaison des idées que ces mots désignent, moyennant «un assez petit nombre de syllabes, qui, considérées séparément, n’ont point de «signification, mais qui déterminent avec précision le sens du mot auquel elles sont «jointes. En modifiant les lettres radicales, ci en ajoutant aux racines des syllabes
Lestemps qui correspondent en grec aux temps spéciaux sont: le présent (indicatif, impératif, optatif; le subjonctif manque au sanscrit ordinaire) et l’imparfait. Ils ont également en grec certains caractères qui ne se retrouvent pas dans les autres temps. Dans les langues germaniques, les temps spéciaux sont représentés par le présent de chaque mode.
Le chiffre placé après une racine verbale sanscrite indique la classe de conju-
\
gaison à laquelle elle appartient. — Tr.
Nous mettons le pluriel, parce que le singulier, plus mutilé, rend le fait moins sensible.
* En sanscrit, les voyelles longues ne comportent le gouna que quand elles sont à la fin de la racine, non quand elles se trouvent au commencement ou au milieu; les voyelles brèves devant une consonne double ne le prennent pas non plus. Les racines ainsi conformées font partie de la première classe; exemple : krî'd-n-(i «il joue».
C’est à cette place, pour la première fois, que ce rapport est exposé d’une façon complète. La conjecture que l’a de formes comme haita, haitarn, haitaima, etc. n’appartient pas aux désinences personnelles, mais est idenLique à l’a de la première et de la sixième classe sanscrite, a ete emise pour la première fois par moi dans la Recension de la Grammaire de Grimm; mais je n’avais pas encore aperçu toute l’étendue de la loi du gouna dans les langues germaniques. (Voyez les Annales de critique scientifique, février 1897, p. 289; Vocalisme, p. /18. )
Parmi les idiomes germaniques, nous mentionnons de préférence le gothique, parce qu’il est le point de départ de la grammaire allemande. On tirera aisément les conséquences qui en découlent pour le haut-allemand.
La racine gothique iuk «fermer» allonge son u au lieu de le faire précéder de 1 i gouna : w-luk-i-th «il ouvre», pour us-Unk-i-th. il importe de remarquer, à ce propos, qu’il y a aussi, en sanscrit, un verbe de la première classe, qui, par exception , au lieu de prendre le gouna, allonge un u radical : gtiïi-a-ti «il couvre» (pour gô'ljrarii), de la racine guh; venant degud'{en grec m6 ; voyez S io4ft). De même, en latin, dûc-i-t, de düc (duæ, dücis) et avec un changement analogue de IV: dîco, Jtdo (compmtjudeæ Judïcis ,cawidïcM ,fîdes). R faut encore rapporter ici les verbes ‘grecs qui allongent au présent un u et un 1 bref radical, comme rpî€a> [êTpfgyv, rpi-
oofiou, rpïStxs, rptéevs), 3-AfSw ( èôXiÇyv ), <ppéyco ( èÇpfynv). -
Comme l’écriture gothique primitive ne distingue pas la bref et Vu long (S 78), on pourrait admettre aussi que le mot w-luk-i-th, mentionné plus liant, a un « bref;
Sur l’orthographe suivie ici (Us au lieu de Hé), voyez S 5a. La contraction de va en u a lieu également dans le dialecte védique pour la même racine. En irlandais, fasaim, pour le sanscrit vàkéâmi, signifie «je croîs». (Voyez d’autres mots de la même famille dans le Glossaire sanscrit, p. 304.)
Excepte aux prétérits augmentes, lesquels, dans cette classe comme dans ton tes les autres, prennent le ton sur l’augment.
J’ai fait observer déjà, dans la première édition de ma gram maire sanscrit e abrégée (i83a, § 354) que les racines qui, suivant les grammairiens indiens, se terminent par une diphthongue, sont, en réalité, terminées par un â, à l’exception de Sçft gyô. Mais, pour laisser ces verbes dans la classe de conjugaison qui leur avait été assignée par les grammairiens indiens, j’essayais alors d’expliquer le y d’une autre façon ; de même dans la deuxième édition ( t845, p. a 11}.
8 D’après les grammairiens go*,de sorte qu’il faudrait diviser ainsi : g&y-a-ti, et rapporter le verbe à la première classe. . ^
Troisième partie , 1837, § 5oi, et deuxième partie, p. è 13 et sniv.
r*. ' * r>
On verra plus tard ce qu’il faut entendre par désinence légèi'c, S hSo et suiv. où il est question aussi de l’influence que le poids de la désinence exerce sur le déplacement de l’accent Voyez aussi Système comparatif d’accentuation, p. 92 et suiv.
II faut y ajouter yfff-rott; mais c’est seulement à cette 3e personne = sanscrit âfo-té «il est assis», et à l’imparfait v^-to — sanscrit ffn-ta, que la consonne finale
primitive de la racine a été conservée.
Comparez le sanscrit k'yft-mi «je dis», tëyft-si, My&ti. Je préfère actuellement considérer 1’*' de in-qui-s, etc..comme un affaiblissement de l’d, comme dans sisti-s, etc. j’y voyais autrefois le y sanscrit devenu voyelle.
II n’y a pas d’exemple de la ire ni de la 2e personne du pluriel.
a En zend, même sans préfixe, dd (pour dit, S 39) signifie «faire, créer».
Dans les racines grecques où la brève et la longue alternent, on regarde ordi
nairement la brève comme la voyelle primitive. La comparaison avec le sanscrit
prouve le contraire : par exemple, pour les racines dâ «donner», dd «poser», nous
n’avons jamais da, dd» Dans les formes anomales, la langue supprimera voyelle
plutôt que de l’abréger : elle met,'par exemple, dad-mâs et non dadamds. On
trouve aussi en sanscrit des affaiblissements irréguliers de l’d en î, par exemple,
dans la racine hâ «abandonner» (en grec %ii dans x»-ptis, j£»-T(s), qui fait gahî-mds «nous abandonnons», à côté du singulier’gâhâ-mi. Nous indiquerons plus tard
(S 48g et suiv.) la raison de ces affaiblissements ou de ces suppressions de la voyelle radicale. Pour la racinepâ, il y avait déjà, avant la séparation des idiomes, une racine secondaire pî, à laquelle appartiennent, entre autres, les verbes grecs et slaves
déjà mentionnés (§ l oq11, 2). La longue s’est conservée dang'srî0<.
Le v est du moins la leçon usuelle des manuscrits.
Le sanscrit gâganti «il engendre» ferait au moyen , s’il était usité à ce mode, gaganté'.
Parmi les temps spéciaux, il faut compter aussi en latin le futur de la troisième
Voyez Glossaire sanscrit, 1867, p. 355 et p. 110, grant, duquel je rapproche le latin ghU-ên «ce qui sert à lier».
Devant le v, ainsi que devant le m du suffixe du participe présent passif, lu voyelle de la syllabe caractéristique est a.
7
Le chiffre qui se trouve à la suite des racines indique la classe à laquelle appartient le verbe sanscrit ou zend qui en est formé. — Tr.
Sur la présence de cette racine en latin, voyez S 63e.
Voyez § 109% a. Cette racine, ainsi quesé «semer?» et lô «railler», n’a nulle
part de consonne complémentaire; je ne vois pas de raison suffisante pour admettre le principe que, dans les langues germaniques, il n’y aurait qu’en apparence des racines terminées par une voyelle longue, mais qu’en réalité elles auraient toutes rejeté une consonne (comparez Grimm, II, p. 1). Il y a, par contre, dans ces langues une tendance à ajouter encore une consonne aux racines terminées par une voyelle, soit s, soit une dentale, soit surtout h. Mais ce h est, en vieux haut-allemand, une lettre euphonique insérée entre deux voyelles, plutôt qu’un complément véritable de la racine; de knâ «connaître», nous avons dans Tatien incnâhu «je reconnais», in-cnd^nn «ils reconnaissent», mais m-cnd-ttm «ils reconnurent» et non pas in-cnâh-tun. Toutefois, l’insertion de h entre deux voyelles n’a pas lieu partout en vieux haut-allemand pour ce verbe : nous trouvons, par exemple, dans Otfrid ir-hnait «il reconnait» (pour ir~knahit), ir-knaent «ils reconnaissent»; dans Notker be-chnaet «il reconnaît». 11 en est de même pour les formes du vieux haut-allemand qui appartiennent aux racines gothiques vô et sô (voyez Graff, I, 6a 1, VI, 56). Au con
traire, le h de lahan «rire» appartient certainement à la racine, comme le montre le vieux haut-allemand lâche, ladite. On peut donc supposer que, en gothique, U a réellement perdu une consonne. Si cette racine est de ta même famille que la racine
Le j s’est endurci en g. ,
* Voyez S ao. Les grammairiens indiens ont aussi une racine dram, dont jusqu’à présent on n’a pas rencontré d’exemple, excepté dans le poème grammatical Rattikâvya. En tous cas, dram et drav (ce dernier est formé de dru à l’aide du gouna et se met devant les voyelles) paraissent être parents entre eux, et s’il en est ainsi, dram ue peut être qu’une forme endurcie de drav ; nous avons de même au duel du pronom de la a* personne la forme secondaire vàm, qui est pour vâv, venant de vâu (comparez le nâu de la iM personne), en zend j*»|* vâo (S 383).
Voyez Lassen, Vendidadi capita quinque priora, p. 6a. .
Par exemple, fva-frâpayâhi^hc ut Suât», 3e personne du subjonctif, La 1"personne frarfrâvayâmiparaît aussi appartenir au subjonctif. A Tïndicatif on attendrait, diaprés le S k<it fra-frâvayêmi; mais le subjonctif {Ut) conserve, à ce qu’il paraît, Vâ qui est sa caractéristique, et empêche le changement euphonique de Vâ en ê. On rencontre quelquefois le causatif même sans fra (voyez Brockhaus, index du Ven-didad-Sadé, p. 288) , frâvayêiti (3° personne du présent), frâvayôtd(potentiel).
Voyez Grimm, 3° édit. p. 101, où l’on conclut avec raison de la forme bau-i-th que ce verbe appartient à la conjugaison forte (c’est-à-dire, d’après notre théorie, à la 1 classe sanscrite). Le substantif bau-ai-na (thème bau-ai~ni) «demeure» appar-
Sur &f&> = sanscrit ya-mi «je vais» voyez S 88.
De la forme primitive rud1 vient rô'&ra-s, nom d’un arbre. Dans ies autres mots, le sanscrit a moins bien conservé la consonne finale de la racine que le zend et les membres européens de la famille.
Comparez le latin auctumnus. Sur d’autres dérivés de la racine sanscrite ruh voyez le Glossaire sanscrit, 18A7, p. 999.
L’irlandais/ofmg/itm «je demande» et ses dérivés paraissent contenir une syllabe rédupficative. (Voyez Glossaire sanscrit, p. aa5.)
Pour les exemples, voyez Brockhaus, index du Vendidad-Sadé.
Burnouf, Yaçna, p. A3a, n. 989. Le texte lithographié a la leçon fautive Jç|4îlH3'" ainôtti (S h 1).
D’après la classification de Mielcke.
Voyez Système comparatif d’accentuation, remarques a53 et a5h.
La longue s’est conservée dans du thème ^rj^o, lequel est lui-même du
féminin. Il faut rappeler à ce propos qu’en sanscrit aussi i’«, auquel correspond l’o grec, tombe devant l’adjonction du caractère féminin t; exemple : intmdr'-ï «jeune fille », (Iff kuÿsétâ «jeune garçon»; de même, entre autres, en grec
féminin de ,
190, 9. Thèmes féminins gothiques en jo.
. *».
Par l’addition d’un â (venant d’un «,869, 1), le caractère féminin sanscrit î est devenu en gothique jô : le son i s’est changé, pour éviter Thiatus, en sa semi-voyelle, d’après le même principe qui, en sanscrit, a fait venir de nadî'«fleuve» le génitif nady-as
1 Quant, n la formation, c’est un participe présent féminin, sorti du thème mas culin Q-epdnovr. .
An sujet du d, tenant la place de t, voyez, 8 9a \
Benfey, dans son Lexique des racines grecques ( I, p. h 90 ), voit dans celte forme yXaxr un mot simple désignant «le lait»; il l’explique par une racine hypothétique glahê, qu’il rapproche d’une autre racine non moins hypothétique mîaké. Dans le second volume du môme ouvrage (p. 358), il donne une autre explication : prenant yXay pour racine, il y voit une altération de pAay, qui lui-même serait une métathèse pour (xeÀy. Grimm, au contraire, cite (Histoire de la langue allemande, p. 999 etsuiv.), à l’appui de l’étymologie que j’ai donnée plus haut, des noms celtiques signifiant «lait» qui contiennent également le mot «vache», par exemple, l’irlandais b-leacM, pour bo-leaehd (bo «vache»). De son côté, Weber a fait observer (Études indiennes, 1, p. 3ôo, note) qu’il y a même en sanscrit, parmi les mots qui servent à désigner le lait, un composé dont le premier terme signifie «vache», â savoir gô-rasa, littéralement «suc de vache». En zend, gau désigne à lui seul l’idée de «lait». Quant à la syllabe -Aockt, en latin lact, il est possible qu’elle soit de la même famille que la racine sanscrite duh (l pour d, S 17®) «traire», d’où vient le participe dug-d'à, qui aurait dû être duh ta, sans une loi phonique particulière au sanscrit (comparez, par exemple, tyaktâ, de tyag). Si cette parenté est fondée, il faudrait regarder l’« de lact, -Aockt comme l’« du gouna, et admettre que la voyelle radicale est tombée, de sorte que lact serait pour laukt. La syllabe y a de yttX olxt est elle-même pour yav = sanscrit gâ (venant de gau) et en zend O11 peut
remarquer à ce propos que le zend a quelquefois aussi le gouna dans les participes passifs en ta ; exemple c -àulcta, pour le sanscrit nktc. '
Le sanscrit ( pour patâr) pourrait signifier «maître» aussi bien que «père»* étant dérivé de pâ «protéger, gouverner». L’affaiblissement du latin pater eh piter, dans le composé mentionné ci-dessus, est une conséquence de la composition (S 6).
Comparez gmt-mot «pourvu de lait, portant du lait».
Les thèmes en far, târ et quelques autres contractent à plusieurs cas, ainsi que quand ils se trouvent sous la forme fondamentale au commencement d’un composé. la syllabe ary àr en r : ce r est regardé par les grammairiens comme la vraie finale (S i). Dvâr r porte» est un exemple d’un thème en âr qui ne souffre pas la contraction on r.
Voyez Wilson, Dictionnaire sanscrit, s. v.
SéAas tient de près. par le suffixe comme par la racine, au zend qavènati « éclat: mentionné plus haut; le» ne fait pas partie intégrante du suffixe (§ rpî ih).
L'a qui précède le t ou le n n'appartient pas proprement an suffixe participial, voyez $78^.
C’est te nom donné dans les livres zends au laboureur : littéralement « celui qui engraisse» (la terre).
Au lieu de asatmt; voyez Sala.
Voyez mou mémoire Sur l’albanais, p. 33.
Én sanscrit, comme en grec, le n est rejeté devant tes désinences casuelles qui commencent par une consonne : ainsi au locatif pluriel évd-su, en grec, au datil, nv-cri De même, au commencement des composés, le n sanscrit est supprimé, non pas seulement devant les consonnes, mais encore devant les voyellesi
Comme te é de nié est sorti de fc, on peut admettre une parenté originaire entre nié et nâktam «noctu». Nâklarn vient d'un ancien thème nakt; nié est probablement an affaiblissement de naé. Je suppose que ces deux désignations de la nuit viennent de la racine naé (anciennement nak)y qui est encore employée en sanscrit (nâé-ya-ti «il succombe»), et dont le sens premier, dans une autre classe de conjugaison que la quatrième, a dû être «quire, détruire»; le latin noceo, qui, comme nex, necare, appartient à la même racine nas, nous représente la forme cau-sative nâé-âyâ-mi (noceo est donc pour nôceo). La nuit (en latin noc-t) serait donc proprement celle qui perd, qui mit, qui est hostile; nous retrouvons la même racine servant à désigner la nuit en grec, en germanique, en lithuanien, en slave et en albanais (rare). Cette racine a affaibli en sanscrit, son a en t dans les mois nié et niéâ (ce dernier mot veut dire également «nuit»), de la même façon que le verbe kar (ô|jï bp) fait au présent kir-â-ti «il s'étend», et que le verbe gothique hand «lier» fait bind-i-th. Peut-être l'i du grec v/xr? est-il également un affaiblissement de l'a, de sorte que «la victoire» serait proprement «la destruction». A la racine sanscrite naé appartiennent aussi véxvs et vexpàs, qui, comme vUr?, vixdce (dorien vixtifu), ne paraissent se rattacher à rien, si l’on considère le grec en lui-même.
y a encore en sanscrit deux autres noms de la nuit qui la désignent comme étant «la pernicieuse, la nuisible» : rfarrar», de la racine éar (ST ép) «briser, détruire», et éatvan, de éad«succomber».
ao
Le nominatif et Taccusatif ont, comme cas forts, l’accent sur le radical : <Stîo, Svùù. (Voyez Système comparatif d’accentuation, S a 5.)
Voyez Système comparatif d’accentuation, S 6a et suiv. et S 65.
:î Voyez Schleicher, Grammaire lithuanienne.
133. Insertion d’un n euphonique entre le thème et la désinence à certains cas de la déclinaison sanscrite.
Quand un thème terminé par une voyelle doit prendre un suffixe casuel commençant par une voyelle, le sanscrit, pour éviter l’hiatus et pour préserver en même temps la pureté des
Par l’influence du j. W
a Ce sont les mots choisis comme exemples par» on der Gabelentz et Leebe (Grammaire, p. -7/1 ). Ces auteurs ont tort toutefois de regarder i comme appartenant au thème,
la — sanscrit g" ya> voyez § 897, et, en ce qui concerne le lithuanien, S 898.
â Le thème est drusa ou dnm ( voyez Grimm , 1, 5y8, note i J.
De us-stas-ti, qui vient lui-même de m-slad-ti (S 102 ), à peu près comme vissa «je savais», de vis-ta, pour vit-ta.
Dans la première édition de sa Grammaire comparée (8 121), Fauteur exprime , quoique d’une façon dubitative, l’opinion que le s de la 5e déclinaison latine, dans les mots comme effigies, paupei'ics, pourrait appartenir à la plus ancienne période des langues indo-européennes. — Tr.
Le latin hil-aris appartient probablement à la même racine.
La faim, considérée comme «désir de manger», en supposant que ce mot dérive en effet de la racine fpety, en sanscrit Vahs «manger», et qu’il soit pourjogmes (voyez Agathon Benary, Phonologie romaine, p. t55).
Accusatifvêt'ëii'âganêm, pour le sanscrit m'tra-fuumm.
Voyez Abrégé de la grammaire sanscrite, S 198.
II faut remarquer toutefois que les suffixes en, men, ne passent pas par la triple
forme des suffixes sanscrits an, man. Us suivent partout la forme intermédiaire (SS 129, 1B0).
Vocatif nâ'man ou nâma.
. - *
* R n’y a pas d’exemple de ce mot au nominatif-accusatif en zend; mais il doit suivre l’analogie de dama et de barëéma, qui viennent des thèmes neutres dâman «création, peuple?) et barëéman « un paquet de branches?), le barsnm d’Anquetil, littéralement «planlen (de bërës «croître»).
Je suppose, en effet, que le masculin évâéura a supprimé l’a final et a transposé ut en vu, en i allongeant. En ce qui concerne l’allongement, il faut remarquer qu*i! y a aussi un certain nombre de thèmes adjectifs en « qui peuvent allonger cette
On peut rapprocher ce mot, dont l’étymologie n’est pas bien claire, de la racine sanscrite smar, smr «se souvenir», laquelle a perdu également son s dans le mot redoublé latin ïnemor; peu ai rapproché ailleurs (Vocalisme, p, i6/i) l’allemand fwhmerz «douleur», vieux liaul-nlleinand smèr-w, thème sm£r-zon. Le terme sanscrit
Le vieux norrois a perdu de même le n des thèmes masculins à tous les cas, excepté au génitif pluriel.
8 Le nom de à en juger d'après sa formation, doit être également un
abstrait.
Grammaire grecque développée, I, p. ai[L’auteur fait allusion aux formes
comme pour pe/|om, fiel%ov$ pour ptti£oves. — Tr.]
Journal de Kuhn, III, p. 8a. — Ahrens cherche à appuyer cette opinion sur la
comparaison des autres idiomes, notamment du sanscrit, où nous avons, par exemple,
à côté de darâ' «terre» (thème et nominatif) le génitif-ablatif daray-âs, le datif
d'arfiy-âi, le locatif dkrfty-âm, et l’instrumental darây-â. Mais si, pour expliquer
ces formes, il fallait admettre un thème eu ê (= ai) ou ai, il faudrait en faire autant
pour l’a bref des thèmes masculins et neutres; on aurait alors un thème âsvê pour
expliquer l’instrumenLai âévé-n-â, le génitif-locatif duel âsvay-oa, le datif-ablatif
pluriel dévê-byas, le locatif àsvê-éu.
est vi ai que dans ces exemples le changement de v en t a lieu au milieu du mot devant un o-, tandis que dans %eh§oï il a lieu à la lin.
En albanais vjer et yjeë signifient; «année» et vjerddp «annuel». Ce dernier Vc-
Signifie aussi «éclair» et «nuage» dans le dialecte vedique. A ce sens se rap
portent très-probablement le zend {«gau aéman «ciel» et le persan (jUyî asman
(même sens).
Quoique le sanscrit as devienne en zend à la fin des mots V â (8 56a) » je crois
Nous nous abstiendrons de citer ce thème, ainsi que les autres thèmes terminés par une consonne, dans les cas où ils ont passé dans la déclinaison à voyelle, par suite de l’addition d’un complément inorganique.
Dans ces tableaux comparatifs, l’auteur rapproche autant que possible des mots
de môme origine et de même formation, comme : sanscrit dévêt-s, zend aépô, grec i'mto-s, latin equus. Mais il est obligé souvent, pour compléter la série de ses comparaisons, de prendre des mots différents, soit que le terme correspondant manque dans une langue, soit q^’il aft?|^s4,dans une autre classe de déclinaison. G’est donc uniquement sur la lettre finale du thème et sur la désinence que porte la comparaison. — Tr. . ”
5 Avec èa : aépaéca, S i35, remarque 3. J
L’apostrophe, dans vulf’s et dans les aut|es mots gothiques, rappelle que la lettre finale du thème a été supprimée (S i35).Tr.
Je partage le mol ainsi, fatera-n, et non fater-an comme pour le sanscrit pitâr-am, parce qu’en vieux haut-allemand ce mot a passé, dans la plupart clés cas, grâce à l’addition d’une voyelle, dans ïa 1 r“ déclinaison forte.
Comparez le grec otï-s, tf-s, k vieux haut-allemand su c porc, truie» » le sanscrit su, qui, à la fin des composés, pigniGe «celle qui enfante». L’accusatif su-em répond n^SPT SMü-flW, le génitif stt-is à suv-às.
a Voyez mon mémoire Sur la langue des Borussiens, p. a5,
Sur la cause de ce fait, voyez S 287 et suiv.
Le thème pronominal latin i affaiblit, au neutre, le t en d, comme à l’ablatif archaïque latin nous avons, par exemple, gnaivo~d, au lieu de gnaivo-f.
;i Voyez Buttmann, Grammaire grecque développée, p. 85.
De gâv-am, voyez S 12 a. a Àvec m .* vacûêéa.
8 Voyez S tt8.
Cette règle ne s'applique qu'aux thèmes masculins et neutres.
s A la fin des composés pâti suit à tous les cas la déclinaison régulière ; quelquefois même, il est régulier à l’état simple : ainsi, pàti-n-â (Nalas, XVIF, vers lu).
Voyez Grimm, Grammaireallemande, I, p> 79V » Kasti se change en keiti, en vertu de 1» loi phonique exposée au S 78.
Contrairement à l’opinion de Grimm, je ne puis regarder l’u de l'instrumental comme long, même en faisant abstraction de son origine. Premièrement, dans Not-ker, les formes pronominales dui, etc. ne sont pas marquées de 1 accent circonflexe (il n’y a pas dans cet écrivain d’autres exemples de l’instrumental}; deuxièmement, nojus voyons cet « se changer en o, comme d’autres u brefs (S 77) » exemples : wio, wëo (à côté dewiu),wio-lih; troisièmement, on ne peut rien conclure des formes gothiques thé, hvé,avé, parce que, selon toute vraisemblance, elles ont conservé la longue à cause de leur monosyllabisme (comparez S 137).
a Nous formons cet instrumental devâ' à l'imitation de mahitvâ, etc. (§ i58). Sur l’accent lithuanien qui, dans un grand nombre de thèmes masculins en a, change de place, voyez Kurschat (Kuhn et Schleicher, Mémoires de philologie comparée, IL, p. /17 et suiv.), et Schleicher, Grammaire lithuanienne, p. 176 et suiv.
. 3 Les formes comme akiè (à côté de aki-tni) appartiennent à un theme qui s est élargi en ia (par euphonie w, voyez S 99266 ).
Comparez S 3q.
Daéina bâsvô «avec ie bras droit», havôya bâsvô «avec le bras gauche» ( Vendi-dad, chapitre 3).
Ibidem ^chapitre 18. Le deuxième a de bâsava est une voyelle euphonique. C’est ainsi que nous trouvons un a inséré par euphonie entre deux consonnes dans l’instrumental nMxdÿxçy hatiay-a, pour le sanscrit sàJèy-â, de sâlti «ami». On trouve aussi un a euphonique dans le possessif hava «suus», forme employée fréquemment au lieu de hva (sanscrit «va ); au lieu d’un a c’est un à euphonique que nous avons dans havôya «gauche» (en sanscrit savyâ), à cause du v qui précède. — A l'instrumental zend bâsv-a répondent les instrumentaux védiques comme pasv-U, de posé « bétail».
Buraouf, Etudes sur la langue et sur les textes zends, p. aao. La forme sanscrite correspondante e&t praéruli (de la racine sru «entendre»). Sur l’allongement de Vu dans frasrûiti, voyez S h i.
L’auteur dit, les thèmes simples, parce qu’il faut excepter certains thèmes comme dmâ, qui, à la fin d’un composé, font leur datif masculin et féminin en ê; exemple : sanUa-dkiâ «qui souffle dans une conque», datif masculin-féminin éahüa-dm. (Voyez l’Abrégé de la Grammaire sanscrite, S 156-) — Tr.
Excepté les racines nues placées à la fin des composés avec le sens de participes présente, lesquelles prennent toujoursV.
Grammaire allemande, I, p. 813. «Unsccra paraît dérivé de l’accusatif uns ; de même le datif unsis, qui, ainsi que izvis, a les mêmes lettres finales que te datif singulier. » .
* Nous regardions autrefois Vu de uma-ra «nostri», comme la vocalisation du v de veis «nous»; c’est une opinion qu’il faut abandonner, quoique 1’* de isvara «vestri», soit,,en effet, le j dqjus «vous». En sanscrit, la syllabe ïT yu (nominatif yûyâm «vous», S A3) appartient à tous les cas obliques, tandis qu’à la 1" personne le 5^ v de STÉPT vayâm «nous» est borné au nominatif : les cas obliques unissent le pronom annexe sma à un thème ïr a. C’est cet a qui est devenu u en gothique par l’influence de la liquide qui suit; de là unsa-ra, pour ansa-ra (S 66).
Voyez Annales de critique scientifique, mars i83i, p. 876 et suiv. [Ce pronom devient, par exemple, qa, au commencement des composés, mais il fait hva ou kava quand il est employé seul. — Tr.]
Voyez S 30 (à la fin) et Système comparatif d’accentuation, remarque a h.
H n’en est que pïus remarquable de retrouver cet u dans le frison du Nord ( voyez Grimm, Grammaire, 1, 81 h ), par exemple, dans ju-nke-r, ju-nh, formes qui, sous le rapport de la conservation du thème, sont plus archaïques que le gothique i-nqva-ra, i-nqvi-s.
On peut remarquer une certaine analogie, d’ailleurs fortuite, entre les formes
Bnrnouf, Yaçna, notes, pp. ^5 et 121.
Par s, je désigne, en lette, le « dur (qu’on représente ordinairement par un /
barré); par s (comme en slave, $ 99 *) le s doux: par à le s dur aspiré, et par à le * doux aspiré. ’
Le datif est remplacé par le génitif.
17.1). Le pronom annexe sma, au féminin, en gothique. —
Le datif gothique.
Nous venons de voir les altérations que le sanscrit et le zend
1 On comprend aisément que l’accumulation de trois consonnes ait paru un poids trop lourd pour nne syllabe enclitique.
Par exemple, dans sum, es, est, qu’on peut comparer au gothique tm?«,t«t,et d’autre part au grec éfi-ytt, èo-oi, êa-rt, au sanscrit as-mi, a-si, as-ti, au lithuanien
es-mi, es-i, es-tî.
L’écriture ombrienne ne fait pas de différence entre IV bref et Te long ; mais je ne doute pas que dans les formes citées par Aufreclit et KirchkoCf (p. 4i) 1 c ne soit tong;enosque, cet e est souvent remplacé par ei. Comparez IV, qui, en latin et en vieux haut-allemand, nous représente une diphlhongue (Sa, note, et S 5). L’osque a pour désinence du datif, aux thèmes terminés par une consonne, ei, et cet ei équivaut à 1 <? ombrien, sanscrit et zend, de la même façon que l’e* grec, par exemple, dans efyi, équivaut à IV sanscrit dans éhn «je vais»; exemples r quaistur-ei «quæstori», medikei «magistratui». L’f long latin tient d’ailleurs presque toujours la place d’une ancienne diphthongue, soit ai, soit ei, soit oi. D’autres fois, en latin, l’allongement de 1 i est une compensation pour la suppression de la syllabe suivante : la desinence ht, pai exemple, lient lieu du sanscrit ftyam ( iütfyam « tibi » ), pour lequel on aurait pu s attendre à avoir, en latin , bnm.
Voyez S 389.
“ Boruasien ka-smu.
Voyez S 176.
s Ou hânv-âi.
Je prends la forme régulière, c’est-à-dire la forme frappée du gouna, laquelle s’est conservée à la fin des composés (S 158).
En. combinaison avec ça on trouve ( Vcndidad-Sadé > p. à 73) Va^~
tyaiéa ~ sanscrit pâtyéca, voyez SS à 1, h 7.
Voyez S 176.
Ou prîty-âi. _
6 Avec ca dfrîtayai-êa.
Voyez SS 174, 34g.
1 Dissyllabe.
Le i ë de dugdërê et de l’instrumental dugdêi'a n’est là que
pour éviter la réunion des trois consonnes.
Plusieurs circonstances montrent clairement que cette hypothèse des grammairiens indiens est peu fondée : i° les ablatifs des pronoi *s des deux premières personnes (mat, tvat) ont pour terminaison at avec® bref, ou plutôt simplement le t; a° dans Pancienne langue latine on a comme suffixe de l’ablatif uniquement le d; 3° le zend, comme nous allons le montrer, a t pour signe de l’ablatif.
8 Nouveau Journal asiatique, 1839, L III, p, 3u.
Je ir'ai rencontré le mot ragi que dans ce seul endroit ( Vendidad-Sadé, p. 86),
ce qui rend le genre du mot incertain, le thème saratustri étant des trois genres.
Nous avons comme terminaison correspondante, en sanscrit, la désinence féminine âsf qui sert à la fois pour le génitif et pour l'ablatif. Au génitif, le as
sanscrit est représenté par pu âo en zend (§ 56 b).
3 Vandidad-Sada, p, Üi63 : —
yatq, vëhrkô catvoarë-gangi'ê niédarëdairyâd barë’tryâd haca puirëm «tanquam lupus quadrupes eripiat a génitrice puerum». Le manuscrit divise, mais à tort, ntidarë dairyâd.
Voyez sur cette forme § 17/1, à la fin.
II faut excepter, dans le sénatus-consuite, les derniers mots in agro Teurano, qui, par cela même, sont suspects, et sur la Colonne rostrale le mot prœscnte, lequel est évidemment mutilé. Voyez, dansRilschl, le fac-similé (Inscriptio quœfertnr Columnæ Rosir aim Dmllianœ) : pressente est à la fin de la partie conservée de la neuvième ligne. La lacune comprend le d de la désinence, ainsi que sumod et le d initial do diciatored.
Ici l’a appartient au thème, qui a tantôt 0, tantôt L
Comme, par exemple, dans oCfr<y, à côté de o^tw-s, dans c5£e, d$vù>, et dans les adverbes formés de prépositions, comme dfiw, xaxw, etc. Remarquons, à ce propos, qu’on voit aussi en sanscrit la désinence de l’ablatif dans les adverbes formés de prépositions, par exemple, dans ajustât «en bas», purâstât «devant», etc.
3e déclinaison de Petermann : c’est la plus nombreuse de toutes. Ce qu’on appelle d’ordinaire la lettre caractéristique n’est pas autre chose que la voyelle finale du thème : l’arménien supprime au nominatif-accusalif-vocatif cette voyelle finale. Pareille chose a lieu en gothique pour les thèmes en a et en i. De même qu’en gothique le thème g asti fait gast-s, gast, de même le thème arménien srti «cœur» fait dans les trois cas uftput sirt (abstraction faite de la préposition, qui, à l’accusatif, se met devant le thème). Au contraire, à l’instrumental, nous avons srti-v, au génitif-datif-ablatif pluriel uptnfttj srti-z, à l'instrumental pluriel srti-vq. Il est vrai que le thème correspondant, en sanscrit et en latin, se termine par un d (sanscrit hrd venant de hard, la lin cord); mais l’arménien a, comme le lithuanien éivdt-s, élargi le thème par l’adjonction d’un a, pour faciliter la. déclinaison. On peut donc rapprocher, à Tins-
En zend, vîé signifie «endroit» ; en sanscrit, vié signifie au féminin « entrée», au
masculin «homme de la troisième caste». ‘
a Comme il n’y a pas à l’ablatif de différence dans la flexion pour les divers genres, nous pouvons placer ici un mot féminin en regard des mots neutres. Quant à l’arménien, il ne distingue nulle part les genres.
J’infère cette forme d’après le génitif ddtr-ô, ainsi que d’après la forme usitée âtr-ad «igné» (du thème âtar). L’ablatif de dugdar «fille» ne pouvaiLélre autre que du§dëv-ad (par euphonie pour du£dr-ad, comparez 8 178); on peut en rapprocher l’arménien dster-ê, qui a changé l’ancienne gutturale en sifflante à cause du t qui suivait, comme cela est arrivé aussi pour l’ancien slave A^lUTH düêti (nominatif), génitif düéter-e.
L’auteur, qui, au paragraphe précédent, à propos de l’ablatif, a fait entrer pour la première fois l’arménien dans le cercle de ses comparaisons, revient maintenant sur l’ensemble de la déclinaison arménienne et sur le système phonique" de cette langue (comparez ci-dessus la Préface de la deuxieme édition, p. 11). Ir.
Le thème sanscrit n Smart « nom» donne de même en arménien la forme a-nun, ou ol u est l’affaiblissement de \'â sanscrit, et où il ne reste de la syllabe man que la nasale. À l’égard de la prosthèse, l’arménien se rencontre encore pour ce mot avec te grec (d-yoga).
èr e manque comme lettre finale des thèmes.
Voyez Schrüder, 6% 9e et 10e déclinaisons.
Le sanscrit miïr-ti «corps» appartient à la même racine.
De si «liern ; comparez le mot français une bande.
Nous avons de même en sanscrit les pronoms des deux premières personnes qui ne distinguent pas les genres, mais qui néanmoins se font reconnaître comme étant du masculin par leur accusatif pluriel asmftn, yuérniïn.
II se réunit avec pun (au lieu de puns; dans les cas forts pumâns)^ qui veut dire «mâle», pour former le mot composé pungava-s «taureau», littéralement «veau mâle».
Le n 0 médial est Altération d’un a primitif, comme l’o grec dans (So(F)ds, etc. et l’é latin dans bovis, etc.
Sur la valeur actuelle de toutes les muettes, voyez S 87, 1. Mais il faut remarquer qu’après avoir fait subir autrefois aux muettes la substitution dont nous avons parlé, la prononciation arménienne est souvent revenue aujourd’hui au son primitif. Ainsi la moyenne de la racine sanscrite <[T dâ était devenue «1 = t (uttotT Um «je donne»), d’après une loi de substitution analogue à celle des langues germaniques. Mais m a repris dans la prononciation actuelle la valeur de d : de sorte que nous avons aujourd’hui une forme dam «je donne» qui répond au sanscrit dâdami, et dus «tu donnes», qui sonne comme la forme équivalente en latin.
Cette voyelle se prononce aujourd’hui comme si elle était précédée d un j, la même chose a lieu pour le U slave (S 928). Voyez aussi, sur des faits analogues en
albanais, mon méfboire sur cette langue.
Dans cette lettre, que Schrôder transcrit dz, est contenue, selon lui, une
sifflante molle {s doux), dans d (n° 17), au contraire, une sifflante dure; aussi
transcrit-il cette dernière lettre ds. Je les représente toutes les deux par le ? grec,
auquel je souscris un point quand il doit marquer la combinaison du d avec un *
doux {?). Sous le rapport étymologique, les deux consonnes arméniennes sont,
Pâr-âyâmi vient de la racine par, pr {10e classe), qui a formé aussi le verbe arménien en question, l dans îzi étant pour pl.
Aya dans les temps spéciaux, ay dans les temps généraux.
Comparez, sous ce rapport, les aoristes lithuaniens comme jëékéjau (A® conjugaison de Ruhig), où le caractère de la 10® classe se montre d’une façon plus apparente qu’au présent jéâkau «je cherche» (S 109*, 6). En lithuanien, comme on voit, les verbes de la 10e classe ont également conservé leur aoriste indicatif, quoique la classe correspondante en sanscrit l’ait perdu.
Nous faisons abstraction du changement de quantité dans la syllabe yu.
3 Le mot Usmad a donné ensuite, par l’insertion d’un a euphonique, Usamad, lisamïïcëm, etc. (Voyez Brockliaus, Index du Vendidad-Sadé, p. a5o.)
As sert en outre de désinence aux thèmes monosyllabiques en d (à la fin des composés), î, d, âi et du (Viy-âs, bruv-âs, nâv-ds), et aux thèmes neutres en i et en u : ces derniers entrent, à la plupart des cas, par l’addition d’un n euphonique, dans la catégorie des thèmes terminés par une consonne, <1
1 Voyez O. Muller, Les Etrusques, p. 63.
L’a long du génitif perse est abrégé dans les noms de mois, probablement parce qu’ils forment une sorte de composé avec le terme générique mâhyd qui suit. Comparez S 193 et voyez le Bulletin mensuel de l’Académie de Berlin (mars 1848, p. 135 )* En voici un exemple : vHyàStnahya mâhyâ «du mois de VHyaTcnar>.
Nominatif «a, LVdu génitif est donc l’affaiblissement d’un ancien a. Quant à l’a final de no-r-a, il provient d’un pronom annexe (S 872, 3).
Voyez S ao. On peut ajouter comme exemples lui «jong», liel
«unir» (en sanscrit yug «jungere»). (Voyez Windisc'hmann, ouvrage cité, p. 17.)
On pourrait aussi supposer que Ta du thème s’est affaibli en 1 au génitif et au
datif, et que, par exemple, l’t de stani «regionis» est identique avec le second a de l’instrumental slana-v.
L eiï ÿ initial du pronom sanscrit est devenu en arménien un r, lequel a pris un 0 prosthétique, comme cela arrive souvent dans cette langue. Si l’on n’admet pas cette explication du pronom relatif, il n’en faut pas moins regarder oro comme le thème et admettre qu’au nominatif or il y a suppression de la voyelle finale.
Je crois reconnaître dans ce mot le thème sanscrit yûma « la huitième partie du jour, une veille de trois heures» ; le J arménien, qui équivaut au j français, tiendrait donc la place du y sanscrit. On trouve aussi en zend «1» J au lieu du ^ y, par exemple dans yûèëm. «vous», en sanscrit yûydm. Ce sont d’ailleurs les deux seuls exemples de ce changement que je connaisse en arménien et en zend.
a Frédéric Muller, dans les Mémoires de philologie comparée de Kuhn et Schlei-
Les thèmes osques en i finissent au datif en et; exemple : Herentatei. Mais je 11e saurais voir dans cette syllabe ci la vraie marque du datif. Je regarde, en effet, ei comme répondant à Vay du sanscrit agnây-e «igni» : après la suppression de la désinence casuelle, ce mot a dû devenir agne (pour agitai). C’est la forme que nous trouvons dans l’osque Herentatei (avec e pour a) ainsi que dans les datifs gothiques comme amt&i (S 175). En ombrien, le caractère du datif s’est également perdu dans la û® déclinaison (qui s’est confondue en osque avec la a*) ; on a donc manu, comme on a en gothique handau, avec cette différence qu’en ombrien il n’y a pas de gouna.
Le pronom ombrien en question est peut-être de la même famille que le pronom
Voyez Burnouf, Yaçna, p. 363, note, et p. a/11 etsuiv.
A l’exception seulement du petit nombre des mots monosyllabiques terminés en tel en û. (Voyez l’Abrégé de la Grammaire sanscrite,§ i3ô.)
La désinence attique est peut-être Téquivatent du sanscrit de sorte que les formes comme /zs6?.s-o>s répondraient aux formes commeprûy-âs. Bien que la terminaison ù)$ 11e soit pas bornée en grec au féminin, elle est du moins exclue du neutre (a<r7eos), et le plus grand nombre des thèmes en f est du féminin.
Dans les formes en es, il est possible que l’i qui précède ait exercé une influence
assimilatrice sur la voyelle suivante (comparez § 92k).
La forme usuelle awiës paraît reposer uniquement sur un abus graphique, attendu que IV, d’après Kurscliat, n’est pas prononcé, s’il est suivi d’un é long. Cet t n’ayant aucune raison d’être sous le rapport étymologique, je le supprime ainsi que fait Schleicher. On peut d’ailleurs s’autoriser, en ce qui concerne le génitif des thèmes en *, de l’exemple du borussien, qui n’a pas de gouna, et qui forme les génitifs pergimni-8, preigimm-s, des thèmes pergimni «naissance», prêigimni «sorte».
Voyez mon mémoire Sur l’albanais, pp. 7 et 60. Sur l’origine pronominale de la désinence du génitif féminin e, par exemple dans St-s voyez le même
écrit, p. 6 &, n. 17.
La rencontre de I’m avec la désinence grecque ou est fortuite.
1 2 Ce t est de la même famille que le thème démonstratif ta ($ Sèq), le gothique tha (S 87) et le grec t0. ’
Burnouf relève un locatif en p» âo appartenant à un thème féminin en u : c’est
përêtâo, de pèrëtu «pont» ( Yaçrîn, p, 5i3).
Page a34 du manuscrit lithographié. '
Voyez Mommsen, Études osques, p. a 6 et suiv. et 31 et suiv. '
9 Mm ne se trouve que deux fois, men trois fois (ouvrage cité, S üh, 3 et hb); me, au contraire, est très-fréquent. Au lieu de me, on trouve quelquefois simplement m. ,
J’ai moi-môme fait dériver de la terminaison Vyam la syllabe bi des adverbes locatifs ibi, ubi, etc.
Ce mot n’est pas ai nsi employé ; mais nous pouvons nous appuyer sur des l’ormes analogues.
Aufrecht et Kirchhoff (p. n3) citent rupinie, sale, Alæmnie, ïovine, tôle ru~
bine, sahate, exprimant le lieu où l’on est, _
Voyez Aufrecht et Kirchhoff, p. i3.
Notons à .ce propos qu’en pâli l’i final d’un thème devient régulièrement iy lithuanien ij) devant les désinences casuelles commençant par une voyelle. Exemple : ratti (féminin) «nuit», locatif rattîy-afi ou, avec suppression do la nasale, ^RÏT rattiy-â; cette dernière forme, si nous faisons abstraction de la quantité de la voyelle finale, se rapproche beaucoup des formes lithuaniennes comme tnvyj-è.
Le borussien peut, dans les thèmes masculins en a, prendre indifféremment a ou e, ou employer la forme du nominatif. Exemple : deiwa « Dieu ! » (= sanscrit déva) on deiwe (= lithuanien déwe) ou, comme au nominatif, deiws (le nominatif peut aussi faire deiwas). Le letle a perdu le vocatif et le remplace partout par le nominatif.
Les grammairiens indiens posent comme règle que les vocatifs et les verbes n’ont d’accent qu’au commencement d’une phrase, à moins, en ce qui concerne ces derniers, qu’ils ne soient précédés de certains mots ayant le pouvoir de préserver leur accent. Je renvoie sur ce point à mon Système comparatif d’accentuation, remarque 37. Il suffira de dire qu’il est impossible que des vocatifs comme râgaputra, oii des formes verbales comme àb'avièyâmahi «nous serions» (moyen) soient, à quelque place de la phrase qu’ils se trouvent, entièrement dépourvus du ton.
Le nominatif des deux dernières formes a dû être dans le principe un oxyton, comme en sanscrit mata, duhitâ': car il ressort de toute la déclinaison de ces mots que le ton appartient à la syllabe finale du thème. La déclinaison de àvép mérite, en ce qui concerne l’accent, une mention à part. Ici l’a n’est qu’une proslhèse inorganique , mais qui s’approprie le ton à tous les cas forts (S 129), excepté au nominatif singulier. Nous avons donc non-seulement dvep ~ sanscrit nar, mais encore àvSpa, dvSpe, dvSpss, dvèpae, en regard du sanscrit nâram, nârâu, miras ( nominatif-vocatif pluriel). Dans les cas faibles, au contraire, le ton vient tomber sur la désinence, suivant le principe qui régit les mots monosyllabiques : on a donc, par exemple : dvSpi, qui répond au locatif sanscrit nar-t ( comparez S i 3a, 1 ). Le datif pluriel fait exception, parce qu’il est de trois syllabes : on a âv§pd-/JtVenant de dvdp-m (S 254 ), en regard du locatif sanscrit nr-m venant de nar-éu.
En zend, le gouna est facultatif pour les thèmes en > u ; exemple : niainyô
et mcûnyu. Mais il n’y a pas, à ma connaissance, d’exemple de thème en i
prenant le gouna.
C’est par inadvertance que Von der Gabeleniz et Lobe donnent la forme sitnu au vocatif, car on trouve déjà dans la tieédition de la Grammaire de Grimm les formes sunau et thagau. Les exemples sont d’ailleurs rares, attendu que pour les objets inanimés on n’a guère occasion d’employer le vocatif. Je n’ai pu constater, pour celle raison, si le vocatif des thèmes en n (déclinaison faible) est semblable au nominatif,