
Gallica

Gallica

Grammaire comparée des langues indo-européennes. Tome 2 / par M. François Bopp ; traduite sur la seconde éd. parM. [...]
Source gallica.bnf.fr/ Bibliothèque nationale de France


Bopp, Franz (1791-1867). Auteur du texte. Grammaire comparée des langues indo-européennes. Tome 2 / par M. François Bopp ; traduite sur la seconde éd. par M. Michel Bréal,... ; registre détaillé rédigé par M. Francis Meunier. 1866-1875.
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978:
- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le cadre d'une publication académique ou scientifique est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source des contenus telle que précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » ou « Source gallica.bnf.fr/BnF ».
- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l’objet d’une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus générant directement des revenus : publication vendue (à l'exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit payant, un support à vocation promotionnelle etc.
CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE 2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l’article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s’agit :
- des reproductions de documents protégés par un droit d’auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l’autorisation préalable du titulaire des droits.
- des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d’utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter utilisation.commerciale@bnf.fr.

I

, GRAMMAIRE COMPARÉE
\ .C '
K /.wVv
DES
GRAMMAIRE COMPARÉE


DES
LANGUES INDO-EUROPÉENNES
COMPRENANT
LE SANSCRIT, LE ZEND, L’ARMENIEN LE GREC, LE LATIN, LE LITHUANIEN, L’ANCIEN SLATE ^_________ LE GOTHIQUE ET L’ALLEMAND
A v;I
,i . . 1 r.--“ | TRADUITE
V ' j£ jsm LA DEUXIÈME ÉDITION
V / H uVE-T/r RÉ CÉDÉE D’INTRODUCTIONS
V"' -
PAR M. MICHEL BRÉAL
PROCESSEUR DE GRAMMAIRE COMPAREE AU COLLÈGE DE FRANCE
TOME II
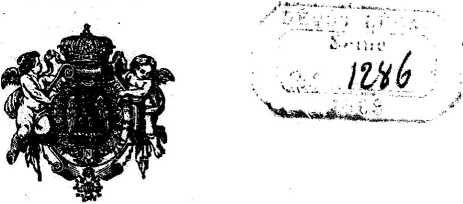
PARIS
M DCCC LXVHI
1867


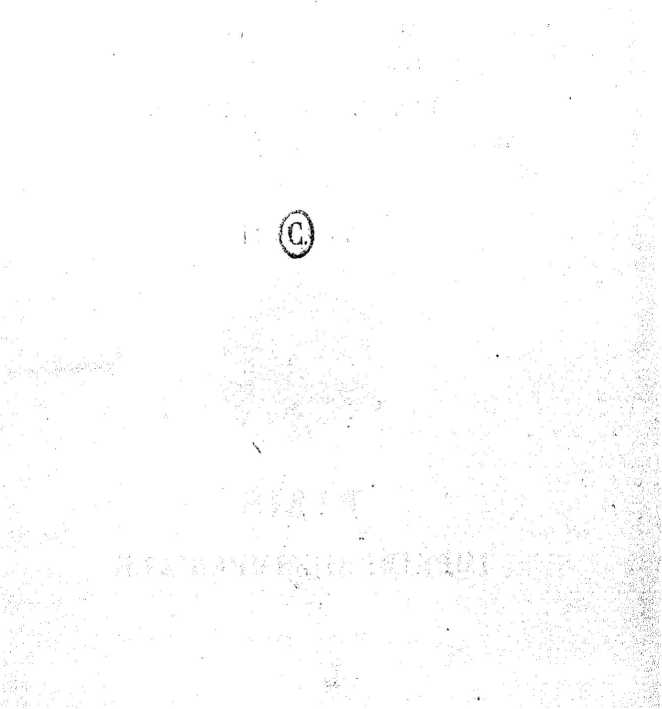


J’espère que je ne paraîtrai pas abuser de mon droit de traducteur, en faisant encore précéder ce volume de quelques observations préliminaires. Je voudrais passer successivement en revue les différentes parties de la Grammaire comparée de M. Bopp, pour essayer d’éclairer la marche de l’auteur et pour montrer comment ses re-u cherches se tiennent et s’enchaînent. Un tel examen ne sera sans doute pas inutile; au milieu de cette profusion de faits de toute nature, il est bon de marquer les grandes divisions et de prendre quelques vues d’ensemble. Ce n’est pas que le livre de M. Bopp manque d’ordre; mais l’auteur, qui se laisse conduire par son sujet, sous-entend volontiers les transitions. Je ne veux pas dire non plus que les considérations générales fassent défaut dans la Grammaire comparée; mais elles se cachent en des recoins où il faut savoir les découvrir.
DE LA PHONÉTIQUE.
Le premier chapitre décrit le système phonique et graphique des langues indo-européennes : c’est ce qu’en Allemagne on appelle la lautlehre, et ce que nous pouvons nommer en français la phonétique ou phonologie. De toutes
ii INTRODUCTION.


les parties de la Grammaire comparée, cette première série d’observations déconcerte le plus le lecteur resté étranger aux recherches de philologie comparative : il doit se demander pourquoi la linguistique moderne accorde une si large place à l’étude des voyelles et des consonnes, quand deux ou trois pages suffisent à la plupart de nos grammaires pour faire connaître les sons et les lettres de l’alphabet soit grec, soit latin, soit français. Mais on n’aura pas de peine à se rendre compte de cette différence de méthode, si l’on prend garde que la philologie comparative ne se propose pas le môme objet que nos grammaires classiques.
Nos livres de classe prennent le grec, le latin ou le français, non pas dans leur développement historique, mais à un moment donné de leur existence. C’est, par exemple, le latin que la société polie écrivait à Rome au temps de César ou d’Auguste, que le plus grand nombre des grammaires latines se proposent de nous apprendre. Il n’entre pas dans leur plan de se demander ce qu’étaient à l’origine, ni ce que sont devenus par la suite, ni même ce qu’ont pu être vers le même temps dans la bouche du peuple, les sons de la langue romaine. Le champ de l’étude grammaticale étant ainsi délimité, le lecteur peut se contenter de quelques indications sommaires sur la valeur et la prononciation attribuées par un certain nombre d’hommes, pendant un court espace de temps, aux différentes lettres de l’alphabet.
Mais supposez que le grammairien, oubliant pour un instant les bornes étroites qu’il s’est posées, s’avise seulement de comparer le latin de Virgile à celui d’Ennius, ou
INTRODUCTION.

ni

la langue de Cicéron à celle des Gracques : il sera aussitôt amené par la force même des choses à nous donner quelques règles de phonétique. Il nous dira, par exemple, qu’au temps d’Ennius et de Plaute, on prononçait et l’on écrivait manufestus, manubus, aurufex, sacrufico, maxumus, decumus, mancupium, alumenimn, lubet, inclulus, et que i’« qui figure dans ces mots s’est plus tard aminci en i; qu’on avait de même des génitifs comme Castorus, Cererus, Venerus, nomi-nus, partus, honorus, et qu’un plus ancien génitif en os, semblable au génitif grec, s’est conservé dans senatuos, ma-gistratuos, domuos; qu’au temps de Pyrrhus et des guerres puniques on écrivait au nominatif tribunos, Jilios, primos, Plaulios1 ; que l’s à la fin de ces nominatifs, de même qu’à la fin des adverbes magis, polis, et des secondes personnes du passif comme delectaris, videbaris, loquereris, ne faisait pas position et qu’il pouvait être omis2; qu’ainsi se sont formés mage, pote, et les secondes personnes deleetare, videbare, loquerere. Il dira encore qu’entre deux voyelles, au lieu d’un r, l’ancienne langue latine nous présente souvent un s; qu’au lieu de Lares, Valerius, arborent, robore, pignora, fœderum, plurima, meliorem, majortbus, erit, on trouve Lases, Valesius, arbosem, robose, pignosa,fœdesum, plusitna, meliosem, majosibus, esil; ainsi s’explique l’s qui est resté dans arbos, robustus, pignns, fœdus, plus, melius, majus, esse; par le même changement, on peut se rendre compte
' Corssen, Prononciation, vocalisme et accentuation de la langue latine, I, p. i43 et suiv. üho et suiv.
3 Vila ilia dignu’ locoquc.
Eamcs. .
Comparez Cicéron, Orator, /i8; Quintilien, IX, 4, 38.
IV INTRODUCTION.


du rapport qui existe entre les nominatifs æs, flos, jus, genus et ies génitifs œris, florin, juris, generis; entre les participes ustus, gestus, mœstus, questus et les infinitifs utero, gerere, mærere, queri; entre hesternm et Am; entre quœsumus et quwrimus. Le grammairien sera aussi conduit à montrer que ies diphthongues de l'ancienne langue latine, qui, au temps d’Auguste, se sont toutes résolues en voyelles longues, à l’exception de la seule diphthongue au, existaient encore du temps des Scipions; qu’on écrivait loucere, doucere, demis, deicere, feidere, foidus, moinia, praida, aidiles, au lieu de lucere, ducere, divus, dicere, fidere, fœdus, mœnia, præda, ædiles. Ainsi s’expliquera la différence de quantité qui existe entre dicere et causidïcus, entre dücere et dücem, entre fidere et juks, entre liicere et lücerna; car la voyelle est brève là où elle est restée pure, tandis qu’elle est longue quand elle est le débris d’une ancienne diphthongue '. Ces remarques et beaucoup d’autres de même nature s’imposeront au grammairien, aussitôt que, perdant de vue son objet immédiat, qui est le maniement pratique de la langue, il voudra comparer le latin à lui-même et en esquisser les transformations. Naturellement et presque à son insu, la phonétique s’introduira dans son livre à la suite de l’histoire.
Mais les règles de phonétique deviendront encore bien plus nécessaires si la langue, au lieu de nous être parvenue sous une forme unique, ainsi qu’il est arrivé pour le latin, est représentée par différents dialectes. Nos auteurs de grammaires grecques s’en sont bien aperçus;
1 Sur l’origine de cette diphthongue, qui provient d’un renforcement de la voyelle radicale, voyez S ;i6, t, et suiv.
INTRODUCTION.

v

mais comme ils ne voulaient pas s’écarter du plan tout didactique qu’ils s’étaient tracé, ils ont dû, pour leurs paradigmes, faire chois d’un certain dialecte qu’ils pré
sentent comme modèle. Vers la fin de leur ouvrage, après avoir montré la flexion du nom et du verbe, et après avoir donné les règles de la syntaxe, ils accumulent dans un chapitre à part, comme dans un musée des antiques, toutes les formes qui s’éloignent du dialecte arbitrairement proposé comme type : c’est là que, entre beaucoup d’autres choses, i’s nous apprennent, sans plus ample explication , qu’au lieu de (j5u<rt, (pépovcri, les Doriens disent (pari, (pépowri; qu’au lieu de 1sÂevo'opa», le dialecte attique fait 'tt'Xsvaovfixi ; qu’au lieu de xtsivm , (pOslpw, ysipwv, les Éoliens disent xxévvw, <pdèppw, yéppwv. Quel rapport existe entre ces variétés d’une seule et même forme primitive? comment la même langue estelle arrivée à se scinder en plusieurs dialectes? Ce sont là des questions que nos grammaires grecques ne cherchent point à résoudre et ne songent pas même à poser. Isolées des formes offertes en exemples, les formes dialectales ne servent point à les expliquer et ne sont point expliquées par elles.
Tout autre sera la méthode de qui voudra écrire une histoire de la langue grecque : il sera obligé d’examiner les sons dont elle disposait dans sa période la plus ancienne , et de montrer ce que chacun est devenu chez les diverses populations de race hellénique. Il devra faire voir, par exemple, que le t, suivi d’un », s’est changé en cr chez les Ioniens, mais que le dorien a souvent gardé l’ancienne consonne; qu’ainsi nous avons (par»' en regard
VI INTRODUCTION,


de la forme ionienne <pycri, (parts en regard de (patrts, trfÀooTtos en regard de ztXovmos, et (pépovn, Tidêvri, eixan en regard de (pépovai, Tidsïm, eïxoat. L’historien de la langue nous dira encore que deux consonnes primitives, le j et le v, disparues de l’alphabet classique, ont cependant laissé de nombreuses traces de leur présence dans les divers dialectes de la langue grecque : qu’en éolien, par exemple, lej s’assimile volontiers à une liquide précédente, en sorte qu’on a xTévvw (pour xtévjw1), (pQlppw (pour (pBépjw), yéppwv (Pour X%w*')’ au *‘eu que le dialecte attique vocalise ordinairement le j en t et le fait passer par-dessus la liquide précédente ; de là les formes xtsIvw , (pdstpw, ysîpwv. Au futur attique -roXeu-crovfiou (pour T-Xsva-topai), l’t s’est changé en e et contracté avec la voyelle suivante, tandis qu’il a disparu dans la forme ordinaire usXsvcTopdu2. Ce qui, dans les grammaires de nos écoles, s’appelle vaguement un échange ou une permutation, devient de la sorte un événement bien défini qui vient se ranger à sa place dans l’histoire de la langue : une chronologie au moins relative introduit 1 ordre et l’enchaînement parmi des faits qui nous étaient présentés comme autant d’accidents sans cause connue et sans lien visible.
Que le grammairien franchisse les bornes d'une courte période de temps ou qu’il étende sa vue au delà d’un certain dialecte, il est aussitôt amené à l’étude des lois phoniques. A plus forte raison ce genre de recherche sera-t-il nécessaire dans une science qui embrasse l’ensemble des
1
' Sur l’origine de ce/, voyez S 109", a. *•
5 L’t s’est conservé dans les futurs altiques comme ■apa^lopes.
INTRODUCTION.

VII

idiomes indo-européens et qui se propose d’en retracer l’histoire. Avant tout autre examen, le philologue relèvera les faits qui ont changé les sons et modifié le clavier des idiomes mis en parallèle. Comment rapprocherait-il le grec sïyov « j’avais t> du sanscrit avaharn «je transportais a , s’il n’avait d’abord ramené le verbe grec à sa forme plus ancienne sFeypv, et s’il n’avait montré que les deux mots se correspondent lettre pour lettre1? Comment verrait-il dans le gothique faillit «bétail, richesse a le représentant du latin pecu, s’il n’avait d’abord exposé la loi qui a rendu non-seulement possible, mais nécessaire, la substitution, en gothique, de deux aspirées aux ténues primitives2 ? La phonétique nous permet de rapprocher ce qui en apparence est dissemblable, de même quelle nous oblige quelquefois à séparer ce qui, à première vue, paraît identique. Guidée par elle, l’étymologie n’est plus obligée de se confier à des analogies trompeuses de son ou de signification : elle détermine le plus souvent à l’avance la forme que telle ou telle racine, telle ou telle flexion grammaticale, si elle s’est conservée en sanscrit, en grec, en latin, en gothique, a dû adopter dans ces idiomes.
On demandera, sans doute, par quelle voie la grammaire comparative est arrivée à établir ces règles. Comme toutes les sciences expérimentales, la phonétique a été
1 Sur l’s et To, qui remplacent habituellement en grec un a primitif, voyez S 3. Un m final devient v (S 18). Le % est le substitut du gh sanscrit (S i3 ), dont il n’est resté dans avaham que la seconde partie h (§ a3). —-Remarquez la différence de signification des deux verbes : le sens primitif « transporter* s’est conservé en grec dans le substantif à%os.
1 Voyez S 87, 1. Sur la dipbthongue ai, dans faihu, voyez S 8a.
INTRODUCTION.

VIU

constituée par une série graduelle d’observations. Les identités évidentes turent constatées d’abord : il n était pas difficile de reconnaître dans le sanscrit manas rr esprit n le pendant du grec fiévos, ni dans asti «il est» le représentant du grec sali et du latin est, ni dans da-dâmi «je donne», dadhâmi «je place», ceux de tîdyfu. Le comparatif sanscrit en taras, lard, tarant, répondait évidemment au comparatif grec en repos, repa, re-pov. En général, les flexions et les suffixes, qui, par leur nature, ne prêtent pas à l’équivoque, et qui sont plus faciles à reconnaître, parce qu'ils se répètent pour des centaines de mots, servirent à poser les premières lois phoniques. Celles-ci, une fois trouvées, en firent apercevoir d’autres plus cachées, quoique non moins certaines, qui à leur tour mirent le philologue sur la voie de découvertes nouvelles. A mesure que les observations devinrent plus nombreuses et plus exactes, on aperçut plus clairement les règles particulières qui modifient ou qui limitent les lois générales. On arriva de la sorte à décrire en détail les habitudes phoniques des divers idiomes indo-européens, et, par un résultat assez inattendu, quoique naturel, la grammaire comparée, en mettant chaque dialecte à sa place dans l’ensemble de la famille, fit mieux ressortir les traits qui le distinguent de ses frères.
L’expérience seule pouvait démontrer s’il était possible de retrouver les lois qui ont fait prendre des aspects si différents aux rejetons épars de la souche primitive. Supposons qu’au lieu de la langue des Védas, de l’Avesta, des Doif^e Tables, d’Homère, d’Ulfilas et de Cyrille, nous fussions réduits à rapprocher Findoustani,
INTRODUCTION. «


le persan, le français, le grec moderne, 1 allemand et le russe : il est probable qu’entre ces idiomes on aurait aperçu un air de famille; mais, vraisemblablement, la grammaire comparative des langues indo-européennes ne serait jamais devenue une science. Même avec le secours de ces antiques documents, le succès de ces recherches n’était pas certain a priori. Il aurait pu se faire, en effet, que les idiomes indo-européens se fussent séparés à une époque où leur système phonique aurait été encore assez flottant pour qu’il fût à jamais impossible de ramener à des lois de permutation régulières les modifications survenues dans la période de leur développement indépendant. Il n’en est rien : une étude attentive a prouvé que les différences qui séparent toutes ces langues peuvent généralement se résumer en un certain nombre de règles constantes et sûres. La phonétique, pour vérifier l’exactitude de ses principes, dispose du même moyen de contrôle que les autres sciences expérimentales : l’application à un nombre toujours croissant de cas des lois qu’elle est d’abord parvenue à établir.
Mais on ne s’est pas contenté de dresser pour les sons des différentes langues des tables d’équivalence. Faisant un nouveau pas dans la voie de l’observation, la grammaire comparée s’est attachée à distinguer dans chaque alphabet les lettres primitives, antérieures à la séparation des idiomes, et les lettres secondaires, dérivées à une époque relativement récente des lettres primitives. Dans l’alphabet sanscrit, par exemple, on a reconnu que des classes entières de consonnes sont sorties de consonnes plus anciennes. Ainsi le h grec a jusqu’à trois représen-
X INTRODUCTION.


tants habituels en sanscrit : le k, le c et le ç. Mais parmi ces trois articulations, le k seul est primitif; le c et le ç en sont des modifications représentant un changement de prononciation analogue à celui qui a eu lieu en français pour le c latin, dans les mots comme chaud (calidus) et cendre (cinerem), Si nous voulons donc rapprocher la racine grecque Atoc et briller v (par exemple dans xfitptXvxw « crépuscule », dans Xsvxos «blanc») de la racine sanscrite rue'1 c briller », ou le nom de nombre Six a «dix» du sanscrit daçan (même sens), il faudra, en quelque sorte, rajeunir les deux formes indiennes et leur substituer ruk2, dakan. Le grec et le latin donnent lieu à des observations analogues. Ainsi le gree Çvydv répond au sanscrit yugam et au latin jugum; mais le K n’est pas une lettre primitive : c’est une altération du j, analogue à celle que le y subit dans le dialecte vénitien. De même encore, le latin bis représente le sanscrit dvis et le grec Sis; mais si nous voulons nous rendre un compte exact de cette correspondance, il faut rétablir en grec le v qui s’est perdu (SFls), et restituer au mot latin le d qui ne pouvait guère manquer de tomber après que le v se fut durci en b (dbis)3. Cette histoire des sons a une grande importance : elle a permis de constater qu’il existe des échelles phoniques que les langues peuvent bien descendre, mais quelles ne remontent jamais. Elle donne au philologue
1 La permutation de r et de l est des plus fréquentes. Voyez 8 no.
. 5 L’ancien le s’est maintenu, par exemple, dans les substantifs rôka «lumière», rukma «or». .
3 Comparez duellum, qui est devenu bellutn; duonus, qui est devenu bonus. Le même fait a eu lieu également en zend, où bis (pour dvis, dbis) veut dire «deux fois'». Voyez S 3oq.
INTRODUCTION.

xi

les moyens de rétablir par la pensée la série des formes intermédiaires et d’expliquer par quelle succession de faits des lettres de valeur souvent très-dissemblable se trouvent
placées, comme dans Sis et bis, en regard les unes des autres.
Tantôt c’est le sanscrit ou le zend, tantôt c’est le grec, le latin, le gothique ou le lithuanien qui a conservé la forme primitive. Le plus souvent, aucun de ces idiomes ne l’a gardée intacte, mais chacun l’a modifiée suivant ses lois phoniques particulières. Le devoir du philologue est alors de rechercher si, en corrigeant les changements survenus de part et d’autre, comme fait l’éditeur qui compare les manuscrits d’un texte altéré, il n’est point possible de retrouver la forme mère. Ce travail de restitution n’est pas aussi conjectural qu’il peut le sembler à première vue, car le langage, étant l’œuvre instinctive des peuples, laisse au hasard une part moins grande que les distrac-. tions des copistes. Non-seulement la grammaire comparative peut faire remonter aux mots de chaque langue un ou plusieurs degrés de l’échelle phonique, mais dans un grand nombre de cas elle arrive jusqu’à une forme qui se trouve située comme au point de jonction des formes réellement conservées par les différents membres de la famille. Quand nous rapprochons, par exemple, le sanscrit vahanti cr ils transportent n, le zend vazenti, le dorien £%gvti, le latin vehunt, le gothique vigand, l’ancien slave vezuntï, tous ces mots nous ramènent à un primitif qui ne s’est conservé nulle part, mais qui est comme le type nécessaire de ces exemplaires diversement modifiés d’une seule et même forme primitive. Un nominatifpatar-s
xn INTRODUCTION.


nous est désigné comme l’ancêtre commun des nominatifs 'GSdrtip, paler, pita que nous présentent le grec, le latin et le sanscrit. Le latin pecu, le gothique faihu et le sanscrit paçu nous conduisent à un primitif paku «bétail». On est convenu d’appeler indo-européennes ou aryennes1 les formes ainsi restituées par induction1 2.
Pour exposer les lois phoniques des différents idiomes de la famille, le philologue a donc le choix entre deux méthodes. Après avoir décrit l’alphabet de la langue indoeuropéenne, aussi exactement que le permet l’état actuel de la science, il peut montrer ce que chaque lettre est devenue dans la bouche des divers peuples aryens. C’est la méthode déductive, qui se recommande par sa brièveté, par sa clarté et par l’ordre qu’elle peimet de donner à l’exposition. M. Schleicher, dans son Compendium, a employé cette méthode, qui convient surtout pour l’enseignement. Ou bien le linguiste, faisant assister le lecteur à ses recherches, lui montrera par quelle série de rap-
INTRODUCTION.

XIII

prochements il arrive à constater la correspondance des sons de même origine et pour quelle raison il les rattache à tel ou tel son primitif. C’est la méthode d’induction, qui nous associe au travail de l’auteur et nous permet de le contrôler. M. Bopp, qui ouvrait la voie à la science, et qui avait besoin de former son public à ce genre de recherches, s’est décidé pour cette seconde méthode, plus lente, mais plus sûre. L’un et l’autre procédé seront sans doute employés à l’avenir tour à tour, suivant qu’il s’agira d’enseigner une loi bien constatée ou d’exposer des faits encore peu connus ou contestables.
Nous avons parlé jusqu’à présent des changements phoniques qui modifient l’aspect extérieur des idiomes, sans nous demander quelle en peut être la cause. Il n’est pas douteux qu’il ne faille surtout la chercher dans la structure de l’appareil vocal3. Si chez certains peuples d’une même race des lettres permutent ou se confondent entre elles, si certaines articulations se renforcent ou s’amollissent, si des séries entières de sons se déplacent suivant une loi de progression régulière, il faut voir dans ces faits autant de modifications organiques qui, en dernier ressort, sont du domaine de là physiologie. Il semble donc cru’une phonétique bien faite doive être accompagnée et commentée par une description des organes de la parole. Mais, sans vouloir diminuer en rien l'importance des recherches physiologiques dont le langage a été l’objet2, on peut remarquer
-\IV INTRODUCTION.


qu’en générai le philologue les dirige plutôt qu’il n’est dirigé par elles. L’anatomie nous dira sans doute comment il a pu se faire que le s sanscrit soit devenu un h en zend; mais il est permis de croire que la parenté de ces deux lettres aurait longtemps échappé au physiologiste, s’il ne l’avait apprise du grammairien. Si l’on songe d’ailleurs qu’il est souvent difficile, pour les langues mortes, de constater la vraie prononciation des lettres, si l’on prend garde que les changements phoniques sont le produit d’altérations graduelles, souvent déterminées par des causes fort complexes, si l’on réfléchit enfin qu’il y a des possibilités physiologiques qui ne sont jamais devenues des réalités, on trouvera naturel que ces deux ordres d’observation restent pour un temps séparés. En ne prenant d’autre maître que l’histoire des idiomes, le philologue préparera à la physiologie des matériaux d’autant plus sûrs qu’ils auront été amassés sans aucune vue systématique. Il ne faut pas oublier d’ailleurs que tout en subissant les influences physiques qui modifient sa prononciation, l’homme intervient activement dans le développement de son langage : tantôt en corrigeant, tantôt en aidant l’action des lois phoniques, il les empêche de nuire êt parfois les lait servir à l’expression de sa pensée. . . :
De toutes les parties de la grammaire comparative, la phonétique est celle qui, dans les vingt dernières années, a été le plus cultivée et a fait les progrès les plus rapides. À mesure qu’on a approfondi la structure des langues indo-européennes, on s’est aperçu que les différences
Merkel. Voir aussi Max Millier, Leçons sur la science du langage, 9e sérié,' 3' leçon.
INTRODUCTION.

xv

matérielles qui les séparent tiennent en grande partie à l’effet des lois phoniques. On a remarqué combien les autres chapitres de la grammaire s’abrégent et se simplifient, une fois qu’on a fait la part des modifications extérieures que la prononciation des diverses langues fait subir au corps des mots. Pour montrer, par exemple, l’identité de l’imparfait sanscrit abharam et de l’imparfait grec sÇépov, il ne reste plus guère, après une exposition complète des règles phoniques, qua mettre les personnes des deux temps en regard les unes des autres. La recherche de l’origine des formes grammaticales, l’étude étymologique des mots ne doivent commencer qu’après que le philologue a mis à profit tous les renseignements que fournit la phonétique. Beaucoup de questions à première vue insolubles s’expliquent alors d’elles-mêmes; beaucoup d’exceptions apparentes sont ramenées sans difficulté à des règles générales. En effet, les formes que les grammaires spéciales regardent comme des anomalies ne sont souvent que des témoins isolés et mal compris d’une prononciation plus ancienne.
Loin de trouver trop grande la place accordée par M. Bopp à l’exposition du système phonique et graphique des idiomes indo-européens, on pourrait donc être tenté de penser qu’elle n’est pas assez large. L’auteur se borne trop au strict nécessaire : en ce qui concerne particulièrement le grec et le latin, on regrettera peut-être l’absence d’une étude spéciale où seraient marqués en détail les traits particuliers qui caractérisent ces idiomes. Grammairien avant tout, plus désireux de pénétrer dans le mécanisme du langage que de décrire les faits qui en modifient
XVI INTRODUCTION,


l’aspect extérieur, M. Bopp ne montre pas pour l’histoire des sons cette curiosité complaisante, cette passion désintéressée qui fait accumuler à J. Grimm, dans sa Grammaire allemande, des pages entières d’exemples pour un changement phonique, et qui lui a fait écrire un volume sur les transformations des voyelles1. Ajoutons cependant que toute la phonétique de M. Bopp n’est pas renfermée dans le premier chapitre. II y revient souvent par la suite, à propos de diverses observations grammaticales, et il complète de la sorte, à mesure qu’il en trouve l’occasion, les lois qu’il a esquissées en commençant.
Le progrès de la science, en confirmant la plupart des règles données par M. Bopp, a pourtant fait paraître quelques-unes d’entre elles un peu libres. Quand il suppose, par exemple, que le suffixe sanscrit -vaut est devenu en latin -lent, que le mot vâri « eau v est représenté par le latin mare, que la racine çvi recroîtrez se retrouve dans crescere, et que le causatif bhâvayâmi a fourni au latin le verbe facere2, il admet pour la seule lettre v quatre permutations différentes qui auraient besoin d’être appuyées sur des exemples moins contestables3. D’autres fois, les explications de notre auteur paraissent trop artificielles : pour montrer comment la désinence as est devenue ô en sanscrit et en zend, il admet que l’s s’est d’abord changé en v, puis en uk. Il ne tire pas toujours
1 Grammaire allemande. Troisième édition du tome I",
2 Voyez S 19.
3 C’est surtout le § 20 et les rapprochements qui s’y réfèrent qui donnent lieu à la critique. Voir sur ce sujet Corssen, Additions critiques à la théorie des formes en latin, p. 294 et suiv.
4 Voyez §§ 22 et 56 l.
INTRODUCTION.

XVII

une ligne de démarcation assez nette entre les dilïérents idiomes et s’autorise trop facilement de ce qui est licite dans l’un pour admettre la même faculté dans un autre. On est surpris, par exemple, de voir l’arménien cité en témoignage pour un changement de lettre qu’aurait opéré le latin1. Si des rapprochements de ce genre démontrent la possibilité d’une loi phonique, l’existence de la loi a besoin d’être établie par des preuves tirées de l’idiome lui-même. Les recherches de MM. Kuhn, Curtius, Sehlei-cher et Gorssen ont, sur certains points, rendu la phonétique indo-européenne plus précise et plus rigoureuse. La sévérité toujours croissante de la méthode est à la lois le résultat naturel et la condition nécessaire du progrès de ces études.
II faut rappeler d’ailleurs que, sous sa forme modeste, la phonétique de M. Bopp contient quelques découvertes capitales. Mais il en est des vérités scientifiques qui entrent dans le domaine commun, comme des inventions qui nous deviennent trop familières : on oublie de se demander quel en est l’auteur. Par la loi de suppression des consonnes finales dans les langues slaves, M. Bopp a jeté sur la déclinaison et la conjugaison de ces idiomes une lumière aussi vive qu’inattendue. Il a montré, par exemple, que dans l’impératif slave vesi « transporte! r>, vesi «qu’il transporte ! i>, nous avons des formes correspondant au potentiel sanscrit vahês, vahêt, au futur latin vehes, vehet, à l’optatif grec eyots, sypi, au subjonctif gothique vigais,
1 Voyez S 34a. Une autre fois (S 35g), c’est le prâcrit, le tsigane et le celtique qui sont invoqués à l’appui d’une permutation de lettre en lithuanien. ‘
XV1II INTRODUCTION.


vigai. Dans les génitifs singuliers comme nebese ce cœli d, dans les nominatifs pluriels comme sünove ccfiliin, il a fait voir, grâce à la même loi, des formations identiques au sanscrit nabhasas ce du nuage v, sûnavas « les fils v. Ainsi que le dit naïvement l’auteur1, cc cette loi était moins aisée à reconnaître quelle ne peut le sembler aujourd’hui qu’elle est trouvée, d D’autres fois, en constatant 1 origine d une lettre, M. Bopp rend leur caractère véritable à des formes jusque-là inexpliquées. Les locatifs slaves comme vïdo-vachü crdans les veuves n et les prétérits comme dachû et je donnais cessèrent d’être des énigmes, du moment que M. Bopp eut montré dans le ch le représentant d une ancienne sifflante : vïdovachü est formé comme le locatif sanscrit vidhavdsu, et les prétérits comme dachü, qu on avait pris pour des parfaits, répondent aux aoristes sanscrits et grecs en sam, trot.
A M. Bopp revient aussi l’honneur d’avoir le premier aperçu la cause de ces phénomènes singuliers, nommés par les grammairiens irlandais éclipse et aspiration, qui donnèrent aux langues celtiques une physionomie à part. Il découvrit que les modifications subies par la partie initiale des noms doivent être rapportées à l’action de la désinence qui, dans une période antérieure de là langue, terminait l’article précédent. La philologie comparative parvint de la sorte à reconstruire des formes disparues, à l’aide de l’empreinte que le mot voisin en avait gardée.
DES RACINES.
Après avoir étudié les éléments les plus simples du
1 Première édition de la Grammaire comparée. Deuxième fascicule, p. v.
INTRODUCTION. xix


langage, c’est-à-dire les sons, M. Bopp passe à l’examen des racines. Quoique, dans l’état où nous sont parvenus nos idiomes, il faille ordinairement recourir à une sorte de dissection pour dégager d’un mot sa racine, celle-ci ne doit pas être considérée comme un pur produit de l’abstraction scientifique. Elle est, au contraire, un tout significatif, qui a possédé, dans la première période du langage, sa valeur indépendante. On ne concevrait pas comment le verbe asmi peut signifier ttje suis n, si les deux éléments dont est formé ce mot, as nètre-n et mi (pour ma) <r je -n, n’avaient eu d’abord leur signification propre et leur existence individuelle1. Nous sommes ramenés de la sorte vers un âge antérieur à la flexion, où les groupes phoniques dont sont composés nos mots ne s’étaient pas encore agglutinés, et où les idées qu’ils expriment ne s’étaient pas encore subordonnées les unes aux autres. Mais, sans remonter vers une période aussi lointaine, on voit que certains idiomes ont encore gardé en partie la conscience des éléments qu’ils mettent en œuvre. Pour former des noms dérivés, les Grecs savent très-bien dégager de leurs verbes la syllabe qui en est le noyau. C’est ainsi que de yi-yvw-axw ils ont tiré yvw-ms, yvw-alés, yvw-fiv, yvéo-px, yvw-pipos; dans vspâaaw, ils ont pris la syllabe radicale tspay pour en faire ispciy-<Jis, TSpix-’twp, tgpây-pa2. De leur côté, les grammai-
1 Voyez t. I", p. xxi et suiv. Comparez aussi sur ce sujet un intéressant opuscule de G. Curtius : De la chronologie dans l’histoire des langues indoeuropéennes. Leipzig, 1867. (Extrait du tome V des Mémoires de l’Académie de Saxe.)
- * R est vrai que les Grecs étaient particulièrement servis par le mécanisme de leur conjugaison, qui, à l’aoriste second, leur fournit la racine
xs INTRODUCTIOiN.


riens de l’Inde, quand ils dressèrent la liste des racines sanscrites, lurent sans doute guidés autant par l’usage instinctif de leur idiome que par des règles analytiques. On peut donc dire que la racine, après avoir eu sa période d’existence libre et indépendante, garde encore au sein des mots où elle est enfermée une sorte de vie latente et de personnalité virtuelle.
M. Bopp distingue deux sortes de racines : les racines verbales, appelées aussi racines prédicatives ou attributives, qui marquent une action ou une manière d’être, comme i cfallerw, dhâ «posera, dd «donnera, bhar «portera, div « briller r> ; et les racines pronominales, nommées aussi racines indicatives, qui désignent les personnes ou les choses, avec une idée accessoire d’éloignement ou de proximité : telles sont a, ma, ta, sa, ya, ka, na, i. Cette division des racines en deux classes a été quelquefois contestée. Mais outre que les essais faits pour rapporter les racines pronominales à des idées attributives n’ont généralement donné que des résultats fort peu satisfaisants, nous ne voyons pas pourquoi la linguistique n’admettrait point une distinction si conforme à la nature des choses. Pour interpréter la pensée humaine, le langage dispose de deux moyens : il peut peindre les objets, en choisissant pour chacun sa manière d’être ou sa qualité la plus saillante (c’est le rôle des racines verbales); ou il peut montrer.les objets, en appelant sur eux, à l’aide de la voix, l’attention de celui qui écoute (c’est l’emploi des racines pronomi-
sous sa forme la plus simple. Mais ils ont eux-mêmes contribué au développement de ce mécanisme. Voyez G. Curtius, Formation des temps et des modes en grec et en latin, p. i Ut» et suiv.
INTRODUCTION. *x«


nales). La combinaison de ces deux sortes de racines a donné, dans les langues indo-européennes, les noms et les verbes, dont le caractère commun est de designer une personne ou un objet en même temps quils expriment une action ou une qualité.
La racine verbale marque une idée placée au-dessus ou en dehors de toute catégorie grammaticale : bhar, que nous traduisons par «portera, faute d’une expression plus générale, peut donner naissance à un substantif signifiant et porteur » ou « fardeau v, aussi bien qu à un verbe crje porter. Certaines familles de langues ont déterminé la racine à l’aide de modifications internes; mais, dans la famille indo-européenne, la racine est un corps fermé et presque invariable, qui se détermine en s’entourant de syllabes étrangères. Les seules modifications régulières que le mécanisme de nos langues permette à la racine sont le redoublement, le renforcement et'la nasalisation.
Le redoublement semble être un reste de la période où le langage, pour marquer la durée, l'achèvement, la fréquence ou le surcroît d’énergie de l’action, n’avait d’autre ressource que la répétition de la racine : ainsi la première syllabe du parfait ba-bhdr-a tr j’ai porté w est un débris de la racine bhar. Au contraire, le renforcement (gouna ou vriddhi1) paraît appartenir à l’époque où la combinaison de la racine verbale avec d’autres éléments a déjà donné naissance à la flexion. Ainsi la racine dvish « haïr y fait au présent de l’indicatif dvêsh-mi, <pvy fait (pevy-w, duc fait en latin archaïque douc-o. Quelques philologues attribuent à cette gradation de la voyelle une va-
1 Voyez $ s 6, 1, et suiv. .
INTRODUCTION.

XXII

leur significative, et en font par conséquent un moyeu interne de flexion. Mais il est plus probable que le renforcement a été dans le principe un effet purement mécanique dû à l’accentuation ou à des lois d’équilibre. Quant à l'insertion d’une nasale dans la racine, telle que nous l’observons, par exemple, dans le latin scind-o, comparé à scidri, dans le grec comparé à ë-Aaë-ov, dans
le sanscrit yung-mas « nous joignons n, comparé à a-yug-arn ce je joignis n, elle paraît être le produit d’une ancienne métathèse1, quand elle n est pas, comme dans le latin slinguo2 (exstinguo), le fait dune simple variété de
prononciation3. .
Des efforts ont été tentés par d’éminents linguistes pour ramener une partie de nos racines verbales à des éléments plus simples. Nous voyons, en effet, quelles ne présentent pas toutes une structure uniforme, et qu’en regard de types phoniques aussi peu complexes que i « aller ri, ad cc manger r, dâ « donnera, >1 s en trouve, comme yug ce joindre t , mard «écrasera, sarp cr glisser d, skand «sauter v, qui comprennent trois, quatre et jusqu à cinq lettres. On a remarqué, en outre, que certaines racines comme râg et bhrâg, yu et yug, mar et mard, sar èt sarp, présentent une certaine analogie de conformation et de sens, et l’on s’est demandé s’il n’était pas possible de les
1 Voyez S§ 109", 3, et 497. ,
3 Comparez stinguo au verbe grec <r7t?w (pour rfly-j’J) et au substantif
a'Uy-fia.
3 Pott et Curtius regardent la nasalisation de la racine comme un renforcement analogue au gouna. Voyez Pott, Recherches étymologiques (a- édition), tome II, pages 45i et 680, cl Curtius, Principes d’étymologie grecque (9' édition), page 52.
~...... m


INTRODUCTION. x*in I
eux, et dont chacun n’a guère pour lui jusqu’à présent |
que l’assentiment de son auteur. Mais quel que soit le succès réservé à ce genre de recherches, il suffira ici de faire observer que la grammaire comparative, telle quelle est traitée par M. Bopp, se trouve située en deçà de cette étymologie transcendante. Notre auteur ne se propose pas de remonter jusqu’au temps reculé où, sous 1 empire de lois encore inconnues, nos racines attributives étaient en voie de formation. Si, à l’époque de la séparation des idiomes indo-européens, yu et yug, mar et mard, râg et bhrâg étaient des groupes phoniques distincts, indivisibles de corps et de signification, la grammaire comparée de ces idiomes a le droit de les considérer comme racines.
11 est possible que les analyses dont nous parlons soient appelées à jeter du jour sur les premières conceptions de l’homme; peut-être révéleront-elles une affinité primordiale entre des familles d’idiomes que jusqu’à présent nous devons regarder comme séparées d’origine. Mais pour l’étude de la période historique de nos langues et pour l’explication du sens des mots, nous pouvons nous contenter des racines qui étaient en usage au temps, bien assez éloigné déjà, où les langues indo-européennes ont commencé à se constituer.
A la différence des racines verbales, les racines pronominales ou indicatives sont d’une structure si élémentaire qu’on n’a jamais songé à les décomposer en des corps plus simples. Ces petites syllabes comme a, sa, la,
XXIV INTRODUCTION.


na, va, ya, i, ont dans l’histoire de nos langues une immense importance. Pour nous rendre compte du rôle quelles ont joué et quelles jouent encore, il convient de les considérer à trois points de vue différents.
En premier lieu, elles sont venues se joindre comme suffixes aux racines attributives, quelles .enlèvent à leur signification indéterminée ef qu’elles rattachent à un certain objet ou à un certain être. Ainsi la racine ak exprime l’idée de rapidité de la façon la plus générale ; mais ah-va (en sanscrit ac-va, en latin eq-vô) désigne un être doué de rapidité, et, en particulier, le cheval. La racine kru (en sanscrit çru, en grec xXv) marque l’idée d’entendre : jointe au suffixe ta, elle signifie «ce qui est entenduv (çru-ta, xkv-ro). Dd exprime l’action de donner : dâ-na (en latin dé-nô) indique un objet qui a été donné. Div veut dire « briller n; la même racine, frappée du gouna, et combinée avec le suffixe a, nous donne dêv-a, qui désigne un être brillant, et spécialement un dieu. Yu$ «joindre v, frappé du gouna et suivi du suffixe ya, fait ydg-ya « ce qui doit être joint n.
Le langage ne se contente pas toujours d’un suffixe aussi simple. Pour augmenter le nombre de ces formations, qui n’aurait pas suffi à tous les besoins de la pensée, il a réuni deux ou plusieurs racines pronominales; ainsi ont sans doute été obtenus les suffixes ana, ira, târ, vân, mdn, mâna, ant, vaut, qui permettent de donner à une seule et même racine verbale les déterminations les plus diverses. Vac « parler n,.par exemple, combiné avec le suffixe ana, qui marque l’action, fait vac-ana «la parole u; avec târ, qui indique l’agent, vak-lâr «celui qui
INTRODUCTION. «v


parle « ; avec Cm, qui désigne l’instrument, vak-tra «la bouched1. Enfin, aux formes ainsi obtenues, le langage, par de nouvelles combinaisons, adjoint encore d autres suffixes, appelés suffixes secondaires, qui étendent presque à l’infini le nombre des déterminations dont une racine est susceptible2.
On demandera sans doute!comment des syllabes qui, à l’origine, avaient simplement une valeur indicative, ont pu arriver à exprimer l’action, 1 agent ou 1 instrument. Mais ici, comme dans toutes les autres parties de 1 histoire de nos idiomes, se révèle la présence dune intelligence toujours en éveil, qui, une fois en possession des premiers éléments du langage, y a fait entrer peu à peu des idées pour lesquelles ils n’avaient pas été créés. De même que des formes sœurs, mais devenues distinctes par une variété de prononciation, ont souvent reçu des acceptions très-différentes3, de même que des accidents phoniques sont devenus le principe de flexions grammati-cales4, de même aussi ces suffixes a, va, ta, ya, na, peut-être synonymes à l’origine, prirent peu à peu des significations particulières. Il ne faut pas reporter jusqu’aux
1 Sur les suffixes grecs, on consultera avec fruit l'excellent Traité de la formation des mots dans la langue grecque de M. Adolphe Regnier. Hachette,
*855.
2 Ainsi le suffixe secondaire tâti, qui forme des noms abstraits, joint à dêva ttdieu», fait dêvartàti «divinité».
3 Ainsi le latin species a donné au français les mots épice et espèce; pen-sare a donné peser et penser. De même, en latin, verleæ et vortex, firme et ferme ont pris des sens différents.
4 Nous rappellerons seulement les deux désinences différentes acvân «equos» et açvâs troquas», qui dérivent toutes deux d’un primitif açvans ou açvâns (S a 36).
xxv. INTRODUCTION,


premiers jours de ia parole humaine des nuances qui sont l’œuvre des siècles : instrument d’une pensée qui devenait plus riche et plus nette, le langage a dû, par une sage répartition de ses ressources, égaler ses moyens d’expression aux besoins toujours plus exigeants de l’esprit. Les suffixes à signification si variée des langues mdo—euro— péennes sont le produit d’un petit nombre de racines indicatives diversement combinées entre elles, et oû l’homme a insinué des idées qui leur étaient primitivement étrangères.
En second lieu, les racines pronominales fournissent les désinences de la conjugaison et de la déclinaison, qui viennent se joindre soit immédiatement à la racine principale, soit à cette racine pourvue d’un ou de plusieurs suffixes4/
Dans la conjugaison, l’addition des désinences a pour effet de rattacher à l’une des trois personnes du discours l’idée exprimée par la partie antérieure du mot. Une analyse pénétrante a montré que les désinences du verbe ne sont pas autre chose que les racines pronominales ma, tva, ta, employées seules au singulier, diversement copa-binées entre elles au duel et au pluriel, et deux fois exprimées dans la voix réfléchie. Ainsi vaé « parler n , combiné avec la racine pronominale ma, altérée en mi, a „ donné vac-mi «je parler; avec la racine ta, altérée en ti, vak-ti «il parler. Nah «lierr, suivi du suffixe ya, et combiné avec la désinence ti, fait nah-yar-ti «il lier. Dhrtsh
INTRODUCTION. xxvit


ffoseni, suivi du suffixe nu, et combiné avec la désinence mas, a l'ait dhnsh-nu-mm «nous osons-». Bhar « porter r, suivi du suffixe a, et de la désinence moyenne lé (pour la-ti), donne bhar-a-tê «il se porter1.
Les désinences casuelles servaient primitivement a marquer des relations appartenant à l’idée d’espace : ainsi l’accusatif indique le lieu où 1 on va, 1 ablatif le lieu d ou l’on vient. Au pluriel et au duel, l’exposant du nombre s’est ajouté à la marque du cas. Parmi les genres, le féminin seul semble avoir été désigné à laide d un signe spécial. Comme les désinences du verbe, les désinences casuelles viennent se joindre soit immédiatement a la racine principale, soit (ce qui arrive le plus souvent) à la racine pourvue d’un ou de plusieurs suffixes. Ainsi le s du nominatif, qui est probablement un débris de la racine indicative sa, se joint immédiatement- aux racines attributives bhî «craindre-», bhû «existera, pour former les nominatifs bhî-s «la crainte-», bhû-s «la terrer5 6. Mais cette désinence est séparée de la racine par des suffixes dans les mots çru-ta-s « entendur, dâ-tavya-s «qui doit être donnér, dêv-a-tâti-s «divinité».
Jusqu’à présent nous n’avons considéré les racines pronominales qu’en combinaison avec les racines attributives.
V’Mais non-seulement les racines pronominales fournissent les suffixes et les désinences : elles prennent elles-mêmes les désinences casuelles et deviennent des mots déclinables. On les appelle alors les pronoms, qu’on a divisés, sui-
I INTRODUCTION.

XXX111

vaut, leur signification, en pronoms personnels, réfléchis, démonstratifs et relatifs. Des pronoms proviennent les plus anciens adverbes, ainsi que les prépositions et les conjonctions primitives.
Cet exposé sommaire suffira pour faire comprendre l'extrême importance des racines indicatives. Si l’on distingue dans nos langues l’élément matériel et l’élément formel, ou, pour employer les expressions consacrées, le vocabulaire et la grammaire, on voit que tout l’appareil grammatical, comprenant la flexion et la dérivation des mots, est dû à ces racines : et elles ont fourni, en outre, une partie considérable du vocabulaire, puisqu’elles ont donné les pronoms et tout ce qui s’y rattache. Un idiome composé uniquement de racines attributives serait obligé de sous-entendre les rapports que nos idées ont entre elles.0 ) Ce petit nombre de syllabes, qui, par l’élasticité de leur sens, se prêtaient à toutes les modifications de l’idée, et, par la fluidité de leur forme, s’adaptaient à toute espèce de combinaisons, a été le principe de la richesse, de la clarté et de la liberté de construction de nos idiomes. Quoique nos racines attributives soient de leur nature presque invariables, elles ont, en se mêlant avec la substance plus molle et plus souple des racines pronominales, * pris l’apparence de corps organisés, qui semblent porter en eux-mêmes le principe de leur développement. Ainsi s’explique l’erreur de Fr. Schlegel, qui voyait des germes vivants dans nos racines1. C’est la fusion intime de l’élément matériel et de l’élément formel qui a produit le mot,
1 Voyez t. 1, p. xxii.
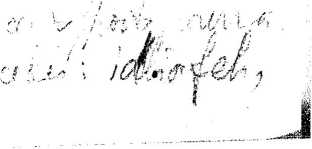
} £ «V/ rsJrl-V 4M.t Cffi '■
>7 ■ ; ;r- * ; ;
ir\j I*- s '/*-■>fj\AP
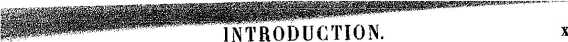
c’est-à-dire le type sur lequel la race indo-européenne a modelé tous les termes de son langage!En effet, la déclinaison et la conjugaison reposent sur un principe identique, et tous les vocables que renferment nos idiomes se rattachent soit au nom, soit au pronom, soit au verbe.


LE SUBSTANTIF,
Après avoir énuméré les caractères distinctifs des racines indo-européennes, l’auteur, dans les paragraphes suivants, examine la division établie par les grammairiens de l’Inde, qui ont, réparti les racines verbales en dix classes, suivant certaines particularités de leur conjugaison. Nous ne nous arrêterons pas en ce moment sur ces paragraphes, dont la place naturelle est plutôt au chapitre du verbe. Puis il cite un certain nombre de racines pour nous donner une idée de la variété de leur structure. Cette liste, nécessairement très-brève, pourra être aisément complétée à l’aide des glossaires1.
Si M. Bopp avait voulu suivre un ordre rigoureusement |. scientifique, il aurait dû nous donner ensuite la liste des
I principales racines pronominales, d’autant plus qu’au cha-r pitre de la déclinaison il va reconnaître ces racines dans | les désinences casuelles. La théorie de la formation des | mots, ou au moins l’analyse des suffixes, aurait pu trouver aussi sa place avant la déclinaison, puisqu’un mot, pour
1 Outre le Glossaire de M. Bopp (.3" édition, 1866), le lecteur pourra consulter (mais avec précaution) une liste de racines qui se trouve à la lin du premier volume de la Grammaire comparée de M. Léo Meyer. Un excellent dictionnaire des racines sanscrites a été donné par M. YVestergaard (Radices sanscrit®, Bonn, 1841). Pour les racines grecques, voir G.'Cnr-tius, Principes de l’étymologie grecque (9' édition, Leipzig, 1866).
c.
INTRODUCTION.

XXX

être fléchi, a d’abord besoin d’être formé1. Mais M. Bopp a craint sans doute de dépayser le lecteur en s’écartant à ce point de l’ordre habituel2. Rejetant à la fin de son ouvrage l’étude de la formation des mots, il passe immédiatement à la flexion du substantif.
Il y a une idée qui domine toute ta théorie de la déclinaison : c’est celle du thème. On appelle thème (ou forme fondamentale) le mot prêt à recevoir sa désinence casuelle, mais non encore revêtu de cette désinence. Ainsi que nous venons de le voir, il peut arriver que le thème se compose uniquement de la racine, comme par exemple dans les substantifs cft'l (efliys), à'tp (on-s), nex (nec-s), dux (ducs) ; mais plus souvent il comprend la racine déjà modifiée et suivie d’un ou de plusieurs suffixes, comme dans (/lotyp-s, ôrfltxé-s, necatus, ductili-s. Le thème, suivant une observation très-ingénieuse de M. Bopp, peut être considéré comme une sorte de cas général qui, à la vérité, n’est jamais employé isolément dans le discours, mais qui, au commencement d’un composé, tient lieu de tous les autres cas.
La notion du thème, malgré son extrême simplicité, est jusqu’à présent restée étrangère à nos grammaires classiques3. Les anciens ne concevaient le nom que pourvu
1 C’est l’ordre suivi dans leurs grammaires par MM. Schleichër et Léo Meyer, M. Pott, dans la deuxième édition de ses Recherches étymologiques, commence par les racines pronominales, ou plutôt, suivant un système qui lui est particulier, par les prépositions. -
* Comparez § 778.
11 ne faudrait pas confondre le thème tel que l’entend la philologie comparative, avec ce qui est improprement désigné comme le radical par

XXXI

d’une désinence; parmi les différents cas, le noniiiiatil, a cause de son rôle dans la phrase, leur avait paru présenter le nom sous sa forme véritable et primitive. Aussi lavaient-ils appelé le cas droit, et virent-ils dans les autres cas, nommés les cas obliques, une série de déviations de la forme normale. Les mots de déclinaison, de flexion, de cas, quand on remonte à leur origine, se rapportent tous à la même idée d’une règle que le discours tait plier ou fléchir. Une conception aussi éloignée de la vérité fermait la voie à toute recherche sur l’origine des désinences et sur la cause de la différence des déclinaisons. D un autre côté, comme le nominatif est précisément le cas où le nom est le plus contracté et la forme primitive le plus difficile à reconnaître, il fallut un nombre infini de prescriptions et d’artifices pour en tirer les cas obliques1.
La méthode de la grammaire comparative est tout autre. Au lieu de fléchir le nominatif (levas, elle prend le thème nos livres de classe. Dire-que Xoy est le radical de Xôyos, c’est diviser le mot d’une façon purement empirique. Le deuxième o est un suffixe, et quoiqu’il se trouve souvent englobé dans la désinence, l’histoire de la langue démontre qu’il n’en fait point partie. De même, nos grammaires disent que tsX est le radical et os la désinence de réXos ; mais la philologie comparée nous apprend que le thème c’est réXos ou réXes, et qu’il n’y a point de désinence au nominatif-accusatif singulier. Pour reconnaître la vraie îorme du thème, il existe un moyen commode, quoiqu’il ne soit pas toujours infaillible : c’est de consulter les mots composés. On a, par exemple: Xoyo-ypiÇos, Xoyo-dértjs, reXeo-Ç6pos.— Dans le cours de cette traduction, nous n’employons le mot radical que pour désigner ce qui appartient à la racine.
1 Un grammairien latin distingue cinquante-deux, un autre soixante et seize désinences pour le nominatif de la troisième déclinaison. Voyez le journal Hermès, 1866, page 333.
INTRODUCTION.

XXXII

(leva dont elle observe, au nominatifdêva-s comme à l’accusatif dêvar-m, au génitif dêva-sya, et aux autres cas, la combinaison avec la désinence casuelle. Cette différence de vue qui, au premier abord, peut sembler de médiocre importance, a totalement modifié la théorie de la déclinaison. Une fois en possession du thème, la grammaire est arrivée aussi à considérer isolément les désinences. Elle a comparé entre eux les exposants qu’on rencontre au même cas dans les noms appartenant à des déclinaisons différentes. Il ne fut pas difficile de reconnaître des traits de ressemblance générale sous des divergences quelquefois assez profondes. On s’est donc demandé d’où pouvait provenir la diversité des déclinaisons : elle ne saurait résider dans les exposants casuels, car une langue qui aurait marqué la même relation, tantôt d’une façon et tantôt d’une autre, se serait volontairement condamnée à l’obscurité et à la confusion1. C'est donc dans la diversité des thèmes, ou plutôt dans celle de leurs lettres finales, quil faut chercher l’explication du problème. Tous les thèmes ne sont pas également aptes à s’adjoindre le même signe casuel. La désinence c, par exemple, qui marque le datif, n’aura point de peine à s ajouter aux thèmes finissant par une consonne, comme marut-ê «venton, hrU-ê ffeordi*. Mais on conçoit aisément que quand la diphthongue ê voudra se réunir à un thème terminé par une voyelle, comme
1 11 semble pourtant qu’il y ait quelques exemples de deux flexions différentes usitées pour un seul et même cas. Ainsi M. Schleiclier, dans son Compendium (SS a58 et a59), admet deux désinences distinctes pour l’instrumental singulier; mais aucune des langues indo-européennes ne les emploie concurremment toutes deux. Nous avons aussi deux exposants pour le comparatif et pour le superlatif.
INTRODUCTION.

XXXIII

dêva « dieu », avi «brebis», sunu «fils», il se produira des contractions de diverse nature, à moins que le langage, pour obvier à cet inconvénient, n’ait recours à l’insertion d’une consonne euphonique. Au contraire, la lettre ni, qui est le signe de l’accusatif, se joindra sans difficulté aux thèmes finissant par une voyelle: on aura, par exemple, dêva-m, avi-m, sûnu-m. Mais, pour s’ajouter à un thème terminé par une consonne, elle devra emprunter le secours d’une voyelle de liaison : ainsi nous avons, par exemple, marut-am, vâc-am.
La tâche du grammairien sera donc de rechercher, en consultant tous les idiomes de la famille, quelle est pour chaque cas la forme la plus ancienne de l’exposant. Puis son attention se concentrera sur la soudure de l’exposant au thème et sur les modifications phoniques quelle occasionne. 11 étudiera comment chaque langue tranche ou résout les conflits qui éclatent entre des lettres incompatibles, comment elle évite ou favorise la fusion des lettres de même nature. C’est entre la partie extrême du thème et la partie initiale de l’exposant que se livrent les combats ou que s’opèrent les compromis dont le résultat est la multiplicité des déclinaisons. De là une nouvelle division fondée, non sur la variété apparente des désinences, mais sur la diversité des lettres finales du thème.
Aucun chapitre de la grammaire ne montre mieux le caractère propre à la méthode nouvelle. Les anciens se faisaient un spectacle de la variété des formes du langage. Ils semblaient croire que chaque classe de mots avait produit naturellement des flexions différentes, et ils se complaisaient à dresser leurs paradigmes comme le botaniste

XXXIV
INTRODUCTION.
a composer son herbier. Le philologue moderne lesseiubk au chimiste: fgn présence des formes multiples d’un seul et même cas, il se demande d’où provient cette diversité, et il cherche à extraire l’élément identique engagé en dif

férentes combinaisons.
Le mérite de cette théorie, également étrangère à la grammaire classique et à la grammaire indienne, revient tout entier à M. Bopp. En voyant notre auteur appliquer son microscope aux lois du sandhi1 a 1 intérieur des mots, H. H. Wilson, habitué aux formules purement mnémoniques de l’Inde, ne put cacher son étonnement. Il demanda quelle était l’utilité de ce genre d’observation2. Mais Eugène Burnouf, avec le coup d’œil du philosophe, aperçut aussitôt la portée de cette découverte, et il reconnut
dans cette analyse de la flexion une vue non moins profonde qu’originale3. Nous pouvons suivre dans les ouvrages de M. Bopp le progrès de ses idées sur ce sujet. Dans ses premiers traités grammaticaux, il admettait encore, au moins pour la pratique, six déclinaisons en sanscrit. Mais plus tard il a supprime tout a fait ces divisions et pose pour tous les noms une déclinaison unique.
Ce n’est pas assez pour M. Bopp de rechercher quelle est à chaque cas la forme la plus ancienne de la flexion. Il pose la question de l’étymologie des désinences, c’est-à-
„ > En sanscrit, les lettres finales et initiales des mois se modifient au contact les unes des autres : on appelle sandhi «contact» les changements aim produits.
4 OEuvres choisies, V, page 281, article sur la Grammaire sanscrite de Bopp, publié d’abord dans 1843.
•’ Journal asiatique, 182
les Transactions de la Société philologique, en i,»ne VI, page 870.
INTRODUCTION. xxxv


dire, qu’il essaye Je découvrir à quelles racines pronominales les exposants casuels se rattachent. Personne ne s’étonnera qu’un problème aussi neut et aussi difficile n ait pas toujours trouvé, du premier coup, une réponse satisfaisante. Les flexions remontent à une si haute antiquité, elles ont probablement subi de si fortes contractions, qu i! est très-malaisé de les ramener à leurs éléments constitutifs. Une autre cause a contribué sans doute à en obscurcir l’origine. Une fois que l’homme, pour exprimer certaines relations, eut emprunté le secours des racines pronominales, son instinct a dû le porter à effacer le plus possible la provenance de ces éléments auxiliaires. S’il est vrai que le nominatif pluriel doive son origine à la répétition de la racine indicative sa, on conçoit sans peine que, la marque delà pluralité une fois trouvée, le langage ait pris à tâche de la rendre moins matérielle. Chaque altération de ces exposants était un lien de moins pour la pensée. Il en est de ces flexions casuelles comme de certaines prépositions qui ne seraient pas aptes au rôle abstrait que nos langues modernes leur font jouer, si leur valeur originaire était encore présente à notre esprit1.
Comment des racines pronominales, dont le sens est presque toujours le même, ont-elles pu servir à marquer des cas différents? Ici encore, selon toute apparence, il faut faire la part très-large à ce qu’on peut appeler l’aménagement du langage, qui a affecté des fonctions distinctes
; 1 Quand nous disons, par exempte, chez les anciens, malgré le vent, nous
donnons aux mots chez, malgré, un sens abstrait qu’auraient pu prendre : difficilement leurs prototypes latins casam, male gratum.
!
INTRODUCTION.

XXXXl

à des signes à peu près équivalents. Peut-etre même M. Bopp est-il trop porté à regarder comme ayant été séparés dès le principe certains cas que des accidents phoniques, joints au besoin de multiplier les ressources de l’expression, ont pu faire sortir d’un seul et même type primitif. C’est ainsi que le génitif et le datif singuliers féminins sont peut-être des variantes d’une flexion unique1. De même encore le duel ne paraît être qu’une sorte de dédoublement, d’ailleurs fort ancien, du pluriel7 8. Ce chapitre de la linguistique renferme encore plus d’une question à résoudre : nous n’en citerons qu’un seul exemple. L’analyse de la flexion est parvenue à dégager un élément qui joue un grand rôle dans la déclinaison, à savoir la syllabe bhi, que nous trouvons dans les datifs singuliers comme tu-bhy-am, dans les datifs-ablatifs pluriels comme dêvê-bhy-as, dans les instrumentaux pluriels comme dêvê-bhi-s9, dans le duel dêvâ-bhy-âm. Mais nous ignorons encore absolument le sens de la syllabe bhi. Cet exemple nous montre l’exploration de la partie matérielle du langage en avance, comme il arrive assez souvent, sur l’étude du sens10.
Toutes les explications proposées par M. Bopp n’ont pas une égale valeur; mais le mérite de notre auteur,
INTRODUCTION.

XXXVII

c’est d’avoir hardiment attaqué un problème regardé avant lui comme insoluble. H a mis à découvert le jeu de la déclinaison, et il a commencé à démonter les pièces de ce mystérieux mécanisme. Ajoutons que sur certains points il est arrivé à des résultats aussi incontestables que curieux. 11 a montré, par exemple, que, pour marquer le nominatif, les créateurs du langage ont recouru à la racine sa, qui, bien des siècles plus tard, devait de nouveau être employée par les Grecs pour accompagner, sous la forme de l’article ô, ce même nominatif. C’est ainsi que dans la conjugaison nous voyons nos langues analytiques placei devant le verbe les mêmes pronoms qui avaient autrefois servi à former les désinences personnelles. Il a dégagé aussi, avec une rare perspicacité, la racine pronominale sma, qui revient si souvent dans la déclinaison, et qui est devenue presque insaisissable sous les formes multiples qu’avec le temps elle a revêtuesl.
Chemin faisant, tout en examinant ce que l’ancienne déclinaison à huit cas est devenue dans les divers idiomes | indo-européens, M. Bopp nous apprend plus d’une parti! cularité intéressante pour la syntaxe. Il reconnaît un loca-| tif dans le datif grec; il découvre que les adverbes grecs I en ms sont d’anciens ablatifs; il rend compte des formes [ homériques comme (3•vsaXâfAyÇiv, oyscrtpia. Toutes ! les langues de la famille tirent des éclaircissements de cette analyse comparative. C’est ainsi qu’en persan moderne les désinences du pluriel an et hâ sont rapportées à l’accusatif zend; Yi izâfet persan s’explique par le pronom
' Voyez S 166-175.
1 2 Voyez SS 177, a5o, i83\ 1, et 317.
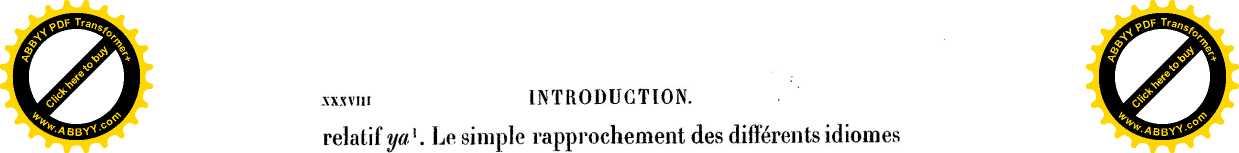
suffit le plus souvent pour faire jaillir la lumière sur des faits jusque-là inexpliqués.
Nous arrêtons ici pour aujourd’hui cette revue sommaire de la Grammaire comparée. Au commencement du prochain volume nous comptons examiner les chapitres qui traitent de l’adjectif, des noms de nombre, des pronoms et du verbe.
Paris, 1 h juillet 1867.
Michel Bbéal.
' Voyez SS 287, 3, aio et aii.







DES
LANGUES INDO-EUROPÉENNES.
(SUITE.)
DUEL.
NOMINATIF-ACCUSATIF-VOCATIF.
S a o 6. Le nominatif-accusatif-vocatif duel en sanscrit.
En- sanscrit, la désinence de ces trois cas est Au, pour les thèmes masculins et féminins; il est probable que la diph-thongue «« vient de As, par la vocalisation de s (§§ 5Gb et 198), et que As lui-méme est un renforcement de la désinence plurielle as. En général, le duel, ayant à marquer une idée plus I précise que la notion vague de pluralité, emploie, pour la mieux imprimer dans l’esprit et la personnifier d’une façon plus vive, les désinences les plus pleines. Cela est vrai des autres cas : comme de ceux dont nous nous occupons eh ce moment. On f peut comparer, au neutre, l’î long du duel avec l’t bref du pluriel, par exemple, àérunî avec '*|twTt!j dsrâni, de ds'ru
f «larme» (§ i7b). .
S 907. Forme primitive de la désinence âu en sanscrit et de In désinence 4o en zend.
!
j Tandis que le prâcrit et le pâli ont perdu le duel, le zend l’a
1
U.


conservé; mais on trouve, dans l’usage, souvent le pluriel à la place du duel; exemple : m> à êënubyascid «jus
qu’aux genoux». Dans la conjugaison, le duel est encore plus rare, sans pourtant s’être perdu tout à fait.
La désinence sanscrite âu est représentée en zend par pu âo; cette diphthongue répond à la désinence sanscrite âs (§ 5 6b), ce qui prouve encore que la désinence sanscrite âu n’est qu’une corruption de âs. 11 y a cette différence entre le sanscrit et le zend que le sanscrit n’offre dans toute la grammaire qu’un ou deux exemples de âs changé en âu (§ 198), au lieu qu’en zend le changement de âs en âo est devenu la règle constante. Si l’on concevait quelque doute sur l’origine de cette diphthongue âo, toute incertitude cesserait devant certaines formes où la sifflante s’est conservée ; en effet, quand le duel est suivi de la particule ca, nous avons âos-ca, et non âo-ca, comme il y aurait sans aucun doute, si en sanscrit âu était la forme primitive du duel et non une altération de âs. C’est ainsi que nous lisons dans le Vendidad-Sâdé11 : kurvâos'-câ amërë-
tai-âoi-èâ 2.
DUEL. § 208.

3

La forme naerekëiâo, donnée par Anquetil dans son vocabulaire (p. /i56) et traduite par «deux femmes», ne peut être autre chose que $wnâirikay-âo, du theme nai-
rilcâ. Or la forme nâirikayâo est évidemment plus pure que la forme nâirikê, comme devrait faire, d’après le principe sanscrit (S 213), le thème féminin nâirikâ.
Rask cite la forme bâsvâo «brachia», venant du thème
bâsu «brachium», sans faire remarquer que c’est un duel; le nominatif pluriel est bâsvô ou ÎD bâsavô.
§ 208. Au changé en â dans la langue védique; âo changé en â ou « en zend.
Dans le dialecte védique, on trouve souvent la désinence âu sous la forme mutilée â, avec suppression du dernier élément de la diphthongue; exemples : asvin-â «les deux As-vins», de aMn; ubâ dêva «les deux dieux », de uM •dêvâ; râ'gânâ «les deux rois», de râgan. En zend, la terminaison mutilée est également employée; elle l’est même plus fréquemment que la désinence complète. Nous retrouvons, par exemple, dans le ciel iranien ces mêmes As'vins dont il est question dans les Védas; on lit au quarante-deuxième lia du Yaçna : AufUiupgp.u
WilSutuX aspinâ-câ yavanô yasamaidê «As'vinosque juvenes veneramur », ce qu’Anquetil traduit par «je fais Izeschné à l’excellent toujours (subsistant)». Le mot sanscrit asvinâ ne pouvait prendre en zend que la forme aspinâ ou aspina (S 5o); mais il faut remarquer dans ce passage le pluriel yavan-ô (de yavanas) se rapportant au duel aspinâ : c’est une nouvelle preuve que dans l’état où le zend nous est parvenu, le duel était déjà près de disparaître; et, en effet, le verbe construit avec des noms au duel est la plupart du temps au pluriel.
aux noms latins en tât et aux noms grecs en t»t. On peut comparer sous ce rapport amSrltdtëm avec le latin immortalitâtm.

h
FORMATION DES CAS.
S -Joy. L’s ca grec, Tu en lithuanien, désinences du duel.

La terminaison védique â et Va bref qui ia représente en /end 12 nous conduisent tout naturellement au duel grec en e : de même que nous avions plus haut (§ 9,0à) le vocatif iWe répondant à asm, aspa, de même ici nous avons avSp-s (avec un S euphonique) qui répond au védique ^PÇï ndr-â et au zend nar-a. Mais il ne faudrait pas regarder iWa comme l’analogue de asm (S 211), encore bien que co représente souvent, comme cela a été dit (§ ù), le "Wï à sanscrit.
Au contraire, en lithuanien, l’w qui forme au duel la désinence des thèmes masculins en a est de la même famille que l’a de la terminaison védique et zende; il est sorti d’un ancien à, comme le prouvent les autres déclinaisons lithuaniennes, où le nominatif duel est toujours d’accord avec le sanscrit, et comme on le voit par beaucoup d’autres cas où l’u lithuanien est le remplaçant d’un ancien â (S 161); on peut comparer, par conséquent, dëwù «deux dieux?) avec le védique dêva et le zend daiva. Les pronoms de la troisième personne ont à (§ 92“) au lieu de u, mais ils se combinent avec le nom de nombre du «deux» (Schleicher, p. 195); exemples : tüdu «ces deux-ci», anûdu «ces deux-là??, jüdu «eux deux». A l’accusatif duel, on ajoute ordinairement à toutes les déclinaisons une nasale après la voyelle finale, par analogie avec 1 accusatif singulier5 cette nasale n’a aucune raison d’être étymologique, et comme elle a cessé d’être prononcée (§ 10), nous la supprimons, ainsi que l’a fait Schleicher. Nous écrivons donc <feu?tl à l’accusatif comme
DUEL, S 210-211. 5


fin nominatif et au vocatif; à ce dernier cas, il dillère du védique débâ par la place de l’accent (§ 20/1).
§ 21 o. Duel des thèmes en i et en u, en sanscrit et en zend.
Les thèmes masculins et féminins en i et en u suppriment en sanscrit la désinence casuelle du duel, et pour la remplacer ils allongent la voyelle finale du thème; exemples : pdtî, sûnu, de pâti, sûnu. Au contraire, en zend nous avons vu (S 207) que bâsv-âo «brachia» (de bâsu) a une terminaison exprimant le duel. Au reste, la forme mutilée ne manque pas non plus en zend : c’est même la seule dont on trouve des exemples dans le Vendidad-Sâdé. De mainyu «esprit» on a souvent
le duel mainyû; au contraire, au lieu de ërësû « deux
doigts» on a la forme abrégée, et, par conséquent, identique au thème ërësu.
§ 211. Duel des thèmes en « et en u, en lithuanien et en grec.
Le lithuanien, pour scs thèmes en i et en u, supprime également la désinence, mais il n’allonge pas la voyelle finale du thème, ou plutôt, dans le cours du temps, i’î et l’w, d’abord allongés, sont redevenus brefs. On a donc awi «deux moulons », sünù «deux fils», qu’on peut comparer au sanscrit dvî (nominatif-accusatif-vocatif), sûnu (nominatif-accusatif) et sünû (vocatif). Quoi qu’il en soit, l’accord des formes lithuaniennes avec les formes sanscrites dans ces deux classes de mots est si grand, qu’on peut difficilement l’attribuer au hasard. Or, si les formes lithuaniennes en question, et les formes analogues en ancien slave, comme kosti «deux os», remontent à l’époque où les langues letto-slaves étaient encore identiques avec le sanscrit, je verrai dans cette rencontre une preuve nouvelle que les idiomes letto-slaves se sont séparés des langues congénères de l’Asie à une époque relativement récente (comparez §21” ainsi
'formation des cas.

G

que la préface de la deuxième édition). En eflet, les formes grecques comme vsàm-s, «sépTi-s, véxv-s, yévv-e se rapportent à une époque où, en sanscrit, les thèmes masculins et féminins en i et en u avaient encore des désinences de duel. Au contraire, dans les formes comme iWw, Mouoû, le grec a supprimé la désinence casuelle, et l’a remplacée dapres le meme principe que le sanscrit, mais d’une façon indépendante uu sanscrit, par l’allongement de la voyelle finale du thème. Il est vrai que, dans la première déclinaison grecque, la est déjà long par lui-même ; mais le singulier est loin d avoir conservé partout la longue primitive et l’ancien son a. On peut s’en assurer par la différence qu’il y a entre le duel Motîoâ et le singulier Mo2<rà, entre xeÇali et xeÇaiM (venant de xsÇaXâ).
§ aïs. Le duel neutre, en sanscrit et en zend.
Les neutres sanscrits ont au duel î et non au comme désinence, de même qu’au pluriel ils ont un i bref et non as. Quand le thème se termine par a, cet a se combine avec h et forme un ê (§ 2); exemple : satê'« deux cents», formé de éata-î. D’autres voyelles insèrent un n euphonique; exemple : giïm-n-î «les deux genoux».
En zend, les thèmes terminés par a ou par une consonne suivent le même principe que le sanscrit; on a, par exemple, édité, qui;répond au sanscrit éaté'(§ h 1), duyê hasankrê « deux mille » (§ 5A), qui répond a ^ -àeê sahasrè13. Nous avons dans le duel casmaim «les deux
yeux»2 le pendant exact des formes sanscrites comme vdrtmanî «deux chemins», abstraction faite de lépentüese de 1 i (§ Ai). Mais on trouve aussi des exemples ou le 4 1 de la désinence ca-
DUEL.

7

suelle est abrégé, par exemple dans asauni «purs»,
vanuhi «bons» (transposé pour vanhvi, de vanhu)1. Cette abréviation de 1’* doit être considérée, je crois, comme la règle, car l’exemple casmainî, que nous citions plus haut, appartient à la partie du Yaçna où les voyelles finales sont ordinairement allongées (S î 88).
S 213. Le duel féminin, en sanscrit et en zend.
Le grec, aux cas dont nous parlons, n’a pas de désinence particulière pour le neutre; en sanscrit, au contraire, le duel neutre a la désinence î, et il semble, à première vue, que cette terminaison se soit étendue aux thèmes féminins en a. Mais cette rencontre des formes féminines comme àsvê «deux juments » avec les formes neutres comme dânê « deux dons » est purement extérieure, ainsi que nous le voyons par le zend; dans dânê ( formé de dâna + ï) il y a réellement une désinence du duel, à savoir la désinence î, qui est propre au neutre; dans àsvê, au contraire, la terminaison masculine et féminine du ( venant de âs, § ao6 ) s’est perdue, ainsi que le montre la forme zende nâirikay-âo « deux femmes » 14 15.
Je crois, en effet, que àsvê vient de âsvay-âu, et que le y, redevenu voyelle après la chute de la désinence du, a formé une diphthongue avec la du thème16. Le duel féminin àsvê, dans cette hypothèse, n’a qu’une apparence dé terminaison, c’èst-à-dire qu’il se compose uniquement du thème élargi qui portait dans le principe la véritable désinence casuelle. .
En zend, toutefois, on trouve également la désinence fémi-

8

nine mutilée ê, et c’est même la forme ordinaire Mais il est à remarquer que cette forme mutilée xj ê a conservé le signe casuel s, quand elle est suivie de la particule annexe «p en. De même que nous avions plus haut (§ 207) amërëtat-âos-câ «et les deux Amertats», de même nous avons amësês-ca spëntê «et les deux Amschas-pants»2. La forme complète eût dû être ay-âos (§207);
mais, après la chute de pu âo, la syllabe ay s’est contractée en ê, comme nous avons la désinence sanscrite ayâmi, qui, par la suppression de la, devient êmi en prâcrit (S 109% 6).
Nous pouvons encore donner une autre preuve à l’appui de l’explication qui fait venir âsvê de âsvay-âu. Dans le dialecte védique, les thèmes féminins en î peuvent également supprimer la désinence duelle au et rester sans flexion; nous trouvons, par exemple, chez un scholiaste de Pânini, va-
râld upândhàu « souliers en cuir de sanglier » au lieu de vârâ-hyâu, et, dans les Védas, yahvï «les deux grands» au lieu de yahvyâù3. Nous rencontrons en zend une forme analogue : ^vüî «les deux forts» du thème féminin tëvîsî; c’est
DUEL. § 214.

9

une épithète employée fréquemment en parlant des deux génies Khordad et Amertat17.
S 21 h. Duel féminin, en lithuanien et en ancien slave. — Tableau comparatif du nominatif-accusatif-vocatif duel.
Nous venons de voir, en sanscrit et en zend, des formes de féminin duel en ê; à ces formes répondent en lithuanien les duels en t, comme aswi « deux juments » = sanscrit ds'vê. De la diphthongue ê = ai, le lithuanien n’a donc gardé que l’élément final.
Au contraire, l’ancien slave a conservé le son ê; exemple: KtAOKU vïdovê «deux veuves» = sanscrit viiavê. Comme je crois que les duels féminins en ê, en sanscrit et en zend, sont le résultat d’une altération postérieure à la plus ancienne séparation des idiomes, je vois dans cette rencontre entre le sanscrit et le zend, d’une part, et le lithuanien et l’ancien slave, de l’autre, une preuve à l’appui de cette opinion, que les langues letto-slaves se sont détachées les dernières des langues sœurs de l’Asie.
Le seul reste que le latin ait conservé du duel consiste dans les mots duo et arnbo, qui se retrouvent en grec, et qui, en j latin, ont pris aux cas obliques des désinences plurielles.
Nous faisons suivre le tableau comparatif de la formation du nominatif-accusatif duel; les exemples mentionnés peuvent servir aussi pour le vocatif, sauf la différence d’accent en sanscrit l (§ üok) :

!
10 FORMATION DES CAS.
|
Sanscrit. |
Zenil. |
Grec. |
Lithuanien. | |
|
Masculin.. . |
dsvâu |
aspâo | ||
|
âsvâ |
aspa |
fairco |
pônii , | |
|
Neutre. . . . |
dirnê |
daté |
Sw peo |
......... |
|
Féminin. . . |
âsvê |
hisvê |
yçbpà |
tîkvi |
|
Masculin.. . |
pâti |
paitî? |
sbat-e |
1 |
|
Féminin... |
prî'tî |
âfrîtî? |
TSÔpTl-S |
awi |
|
A/ • . A |
tSpi-s | |||
|
Féminin. .. |
Bdvanty-âu |
bavainty-âo | ||
|
bâvantî |
lavainlî | |||
|
Masculin... |
sûniï |
pasû |
véxv-s |
sünu |
|
Féminin. . . |
hânû |
lanû |
yêvv-s | |
|
Neutre.... |
mddu-n-î |
madv-i |
péâv-e | |
|
Masc.-fém.. |
gav-âu |
gâv-ào | ||
|
gav-â |
yâv-a ? |
wn* | ||
|
Féminin. . . | ||||
|
vS.(F)-s | ||||
|
Féminin... |
vac-âu |
vâc-âo | ||
|
vac-â |
vâc-a |
Ôtf-S |
......... | |
|
Masculin... |
Bârant-âu |
barant-âo | ||
|
Mrant-â |
barant-a |
Çépom-s | ||
|
Masculin... |
âémàn-âu |
asman-âo | ||
|
âsmân-â |
asman-a |
batpov-s | ||
|
Neutre.... |
nUmn-i |
namain-i |
râXav-e | |
|
Masculin... |
Bratar-âu |
brâlar-âo |
........* |
• • «H..... |
|
Bratar-â |
brâtar-a |
-aotrép-e | ||
|
Féminin. . |
duliitâr-âu |
dufçdkr-âo |
......... |
........ |
|
duhitdr-â |
dugdar-a |
&vyar ép-s | ||
|
Masculin.. |
dâtar-âu |
dâtâr-ao | ||
|
dâtar-â |
dâtâr-a |
Sorçp-e | ||
|
Neutre... |
vâcas-î |
éîrsftr)-s |

1 Se forme d’un thème élargi en ta,


DUEL. S 215, 1.
11

INSTRUMENTAL—DATIF-ABLATIF *.
S ai5, i. La désinence sanscrite b'yâm et ses congénères byam et hyam.
— La désinence arménienne A
En sanscrit et en zend, l’instrumentai, le datif et 1 ablatif duels ont une seule et même désinence. En grec, c’est au contraire le génitif qui s’est confondu avec le datif et lui a emprunté sa terminaison. En sanscrit, la désinence en question est byâm. En zend byâm devient j»ji) bya; la forme complète, qui serait byahm (§ 6i), ne s’est conservée que dans un seul exemple : brvadbyahm, du thème brvat «sourcil»2.
A la désinence hyâm se rattachent en sanscrit, par les liens d’une origine commune, les désinences Byam, hyam, byas et bis. La terminaison byam est employée au datif pluriel des pronoms des cbux premières personnes (asmà-byam, yuêmdr-byam) et dans tü-byam, datif singulier du pronom de la seconde personne. Ori rencontre, au contraire, hyam, au lieu de byam, dans mà-hyam, datif du pronom de la première personne, par suite d’une altération de B en h, dont il y a d’assez nombreux exemples ( § a 3 ) :
t ? . v .. r . . t le i i A
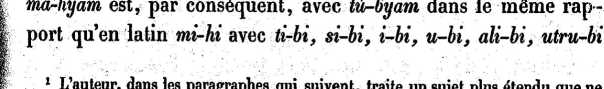
g: ---r--', r — UUJVB JI1UO VBUUUU quy UV
| le feraient attendre le titre et la suite de l’exposition. A propos de la terminaison T sanscrite b'yâm, qui sert à former plusieurs cas du duel, il examine les désinences I byam, byam, l'y as, Vis, qui n’appartiennent pas au duel, mais au singulier pronomi-
| nal et au pluriel.—Tr.
a Burnouf ( Yaçna, p. 158 et suiv.) considère cette forme mutilée bya. comme une désinence plurielle et la rapproche de la terminaison sanscrite byas. Mais, à la fin des mots, la syllabe sanscrite as devient toujours, en zend, ^ 6, ou bien ».» ai devant un enclitique. Burnouf cite (Yaçna, p. i5g et suiv.) une désinence byâ au lieu de bya; mais je crois qu’on n’en trouverait pas d’exemple hors du dialecte particulier dont il a déjà été question (§ 3t), lequel allonge toujours IVt bref à la fin
des mots.
1

12

(ces dernières formes venant elles-mêmes de ti-fi, si-JÎ, ele.). Mais je ne crois plus qu’il faille rapporter le hi latin de milii à une époque antérieure à la séparation des idiomes : je pense que la syllabe hi, venant de fi, s’est produite d’une façon indépendante. C’est ainsi qu’en espagnol un f initial devient ordinairement h, et qu’en latin nous avons hordus qui vient de fordus; hordus se trouve, par conséquent, avec le 6 du sanscrit Bârâmi «je porte», dans le même rapport que la désinence hi avec le Byarn sanscrit de tüByam.
L’arménien, au pronom de la première personne, a pour désinence casuelle 2 i, et à celui de la deuxième personne »/ s; on a donc (fui in«à moi », qe-s «à toi». Je considère le
? aussi bien que le s comme des altérations du sanscrit contenu dans la désinence Byam ou hyam; en ce qui concerne la suppression de la consonne initiale de la désinence, je rappelle provisoirement la terminaison du duel grec tv (Vnm-iv,
„ Movtra-tv) pour le sanscrit Byâm (§ aui), et le dorien iv de te-iv «à toi» (=g*rçr tü-Byam), êfi’-îv «à moi».
On pourrait dire qu’il vaut mieux identifier le 2 £ de in-‘( «à moi» avec le h de la désinence sanscrite hyam, d’autant plus que le I £ répond souvent à un h sanscrit (§ 183b, a). Mais nous avons vu (§ a3), par le témoignage des langues iraniennes, que le h, qui tient la place d’un ancien ^ d' ou d’un ancien 3* B, est, en général, d’une époque relativement récente; c’est ainsi qu’en regard du ha sanscrit de t - lui «ici» (pour i-d'a), sa-ha «avec» (pour sa-da), nous avons en zend i-d'a, ha-da; en regard de la terminaison de la première personne du pluriel moyen mahê (pour macTê — grec fieOa.), nous avons en zend maid'ê ou maidê; èn regard de hitd «placé» (pour dîta), nous avons en zend data ou, avec la préposition ni, nid'âta. 11 n’y a que la racine 1-i san «frapper» dont la lettre initiale suppose en sanscrit un h (fw han) sorti
DUEL. S 215, 1.

13

d’un ancien d; il faut donc admettre pour ce h une date plus ancienne que pour les autres. Au contraire, rien ne vient justifier en zend l’antiquité des f h sortis d’un ancien a* B; le h de grah «prendre» (védique graB) est représenté en zend par un b, un / ou un w; pour ïTirç mâhyam «à mci» nous avons maibyâ18.
Si l’on explique donc l’arménien A £ du datif »n-£ « à moi » comme tenant la place du y qui se trouve dans le sanscrit hyam et dans le zend byâ, il faut considérer que la lettre g z (qui représente ordinairement le y des flexions sanscrites) se change volontiers en I ? ou en J- ? après les liquides2. Ajoutons que 1 de qe-s «à toi» est lui-même parent du y sanscrit, avec lequel il est à peu près dans le même rapport que le j français avec le y latin, ou le s (*k) zend de yûéëm «vous» avec le y du sanscrit yûyâm (§ 5g).

u FORMATION DES CAS.
S ai5, 2. La désinence sanscrite byas. — Formes correspondantes en zend, en latin, en lithuanien, en gothique, en ombrien et en arménien.


La troisième forme congénère de la désinence duelle précitée Byâm est byas, qui est employé régulièrement comme signe du
datif et ablatif pluriel. _ §
La forme correspondante, en zend, est byô\ et en latin bus, au lieu duquel on aurait plutôt attendu Mus. Il est probable quil faut rapporter également ici le bis de no-bis, vo-bis, a moins que ces formes n’appartiennent par leur origine à un autre cas (S 216), et que bis ne réponde à la désinence sanscrite bis. g
Dans la première hypothèse, il faut considérer bis comme étant j
pour bius; cette contraction a son analogue, par exemple, aans le comparatif adverbial magis, au lieu de magius2; de son coté, la forme bus, qui a au contraire supprimé Yi, doit être rapprochée de minus, qui est pour minius.
En lithuanien, la forme la plus ancienne et la plus complète pour le datif pluriel est mus19 20 21; la forme moderne est ms. Ruhig et Mielcke ne reconnaissent la désinence complète qu’aux pronoms des deux premières personnes; mais de mu-mus «no-bis» et jù-mus «vobis» j’avais déjà conclu, dans la première édition de cet ouvrage, que la terminaison mus avait dû appartenir plus anciennement à tous les datifs pluriels. Le borus-sien a conservé l’ancien a de la désinence sanscrite byas; mais il fait précéder le s d’une nasale inorganique : de là mans, pour mas. On peut rapprocher à cet égard le n des mots latins ensi-s, mensi-s, comparés aux mots sanscrits asl-s «épée», mâsa-s
«mois». <
Le lithuanien ms, forme mutilée pour mus, nous conduit au
DUEL. S 215, 2. 15


gothique, qui présente une mutilation encore plus grande, car il a simplement un m; exemple : sunu-m, qu’on peut comparer au lithuanien sünù-mus, swnù-ms, au sanscrit sûnu-Byas, et aux
formes latines comme portubus L
De même que le germanique, l’ombrien na conservé de la désinence en question que la consonne initiale, qui est devenue un f, mais cette terminaison est employée par abus pour 1 accusatif; exemple : tri-J «Tpeîs» = sanscrit tri-byas, latin tri-bus, lithuanien tri-ms, gothique tliri-m2.
L’arménien, qui emploie la même désinence pour le datif-ablatif et pour le génitif, n’a gardé également qu’une seule consonne du sanscrit Byas, mais, au lieu de la première, cest la seconde, à savoir le y, qui est devenu un g z3. Quelque bizarre que puisse paraître au premier abord cette identification, je n’hésite pas à regarder l’arménien olfy ôÇi-z comme ayant même thème et même flexion que le sanscrit âlii-Byas (datif-ablatif pluriel, avec accentuation védique), le zend asi-byâ, le latin angui-bus et le lithuanien angi-mis. Plusieurs faits confirment le rapprochement que nous faisons entre la | lettre arménienne g i et le ^ y sanscrit : nous avons constaté
| 1 En ce qui concerne la permutation de la moyenne labiale avec la nasale de même
I organe, on peut comparer le rapport qui existe entre la racine zende mrû et la raI cine sanscrite Irû «parler» (S 63). Je ne saurais voir la preuve d’une parenté spé-I ciale entre les langues germaniques, d’une part-, et les langues letto-slaves, de l’autre, ï dans ce fait que l’une et l’autre famille d’idiomes ont au datif pluriel un m au lieu I du b. En général, je ne puis reconnaître un lien spécial de parenté entre le groupe . lelto-slave et le groupe germanique; je ne parle pas, bien entendu, des mots qui ont f passé de l’un à l’autre par voie d’emprunt. [Celte note fait allusion à l’opinion exposée par M. Scbleicber. Voyez ci-dessus, 1.I, pages xxxui et 17. — Tr.]
2 On ne trouve pas d’exemple de cette dernière forme, mais on peut l’induire avec certitude du nominatif thrm-s et du datif vieux haut-allemand dri-m.
\ 3 Comparez entre autres le Ç grec (qui est en quelque sorte la moyenne du
i! g i arménien) dans <5«f«i£e-T£ = sanscrit damâya-ta (S 19). Voyez ce qui a été dit S du g l arménien S 183 b, 2.

16
formation des cas.
(§ 215, î) que, dans in-i «à moi», le & lequel est au g z- ce que la moyenne est à la ténue, correspond au de la désinence sanscrite hyam; de plus, à l’ablatif pluriel des pronoms des deux premières personnes (» mên-g «a nobis», i Çên-g «a vobis»), nous voyons un g prendre la place du g z de la déclinaison ordinaire, exactement de la même façon qu’au futur nous voyons £ g prendre devant un i la place du g z : or cette dernière lettre représente le du caractère précatif sanscrit yâl. Il est Vrai qu’il n’y a pas de racine ayant un y i initial ou final correspondant â un sanscrit; mais ce n’est point là une raison pour contester l’identité de ces deux lettres : autrement, il faudrait nier aussi que le p final de certains dialectes grecs soit l’altération d’un s (§ 22), ou que le m des datifs pluriels, en gothique et en lithuanien, soit sorti d’un ancien b. En effet, ni en grec, ni dans les langues lettes et germaniques, on ne trouverait, hormis dans les positions qui viennent d’être indiquées, des exemples de ces changements de lettres. ■
1 L’ossète a avec l’arménien des points de rencontre curieux, ce qui d’ailleurs ne doit pas nous surprendre, puisque l’un et l’autre sont des idiomes iraniens. Au futui ossète, le y du sanscrit sya est représenté par un g (— di), c’est-à-dire par le son du £ arménien. Si l’on ne veut pas admettre que le a du sanscrit sya se soit perdu, on peut voir dans le futur ossète, par exemple dans éar-gi-ifam «nous vivrons», l’équivalent du précatif sanscrit. Quant aux syllabes du pluriel stam, s tut, ait, elles viennent du verbe substantif, c’est-à-dire de la racine sanscrite std «se tenir, être» : car-gi-stam signifie donc littéralement «vivre devant sommes nous». Je me suis longtemps demandé d’où venait le n des formes du singulier, comme èar-gi-nan tsje vivrai». Je crois maintenant que le d de dan «je suis» s’est changé.en n, comme b s’est changé enm dans les désinences lithuaniennes et gothiques mua, ma, ut. Cette syllabe dan appartient également, selon moi, au verbe auxiliaire, et le d est un amollissement du t sanscrit ou du t zend de std, std; une fois que la sifflante eut disparu, la ténue devait aisément se changer en moyenne. A la seconde personne du singulier, la forme composée a gardé, à la différence de la forme simple, le signe de la personne; exemple : êar-gi-na-s «vivre devant es tu», au lieu quon ait simplement da « tu es».
«
•V-,

DUEL S 215, 2. 22 ‘

17

En arménien, comme en lithuanien et en gothique, les thèmes en a conservent cette voyelle invariable devant la désinence casuelle en question; au contraire, le sanscrit mêle un i à l’a final du thème. On a donc des formes sanscrites comme mêgê'-Byas (thème mêgd «nuage»), kêsê-Byas (thème kê'sa «cheveu»), en regard de l’arménien rniga-z, gisa-z et des datifs lithuaniens et gothiques comme wllka-mus (wllka-ms) et vulja-m «lupis». Lf de miga-z, gisa-z est la seconde partie de la diphthongue sanscrite ê — ai de mêgd, kê'sa; au contraire, les formes qui ont perdu la voyelle finale du thème et qui sont, par conséquent, monosyllabiques, comme, par exemple, le nominatif singulier mêg, gês, le nominatif pluriel mêg-q, gês-q, ont conservé 1 ancienne diphthongue ai contractée en ê. Dans dev « démon » = sanscrit dêvd-s «dieu», la diphthongue £ s’est abrégée en L e; mais cet e est également remplacé par i aux cas polysyllabiques; on a, par exemple, le datif-ablatif-génitif pluriel diva-z, en regard du lithuanien dëwa-mus et du sanscrit dêvê'-ISyas. De même que mêg, gês, dev, et beaucoup d’autres mots arméniens abrègent la voyelle de la première syllabe quand la voyelle finale du thème est conservée ou quand il y a accroissement d’une syllabe, certains mots, en pareille occasion, suppriment la voyelle qui se trouve à l’intérieur du thème. C’est ainsi qu’en regard du nominatif singulier basuk «bras» (thème basuka = sanscrit bâ-huka22), nous avons le datif-ablatif-génitif pluriel baska-z, et, en regard du nominatif gub « fosse » (thème gubo = sanscrit kupa2), le génitif-datif singulier gb-i, l’instrumental gbo-v, le datif-ablatif-génitif pluriel gbo-z. Le thème duster « fille » (= sanscrit duhitdr), qui a perdu au nominatif dustr Ye de ia syllabe finale, supprime la voyelle de la première syllabe aux cas qui ont con-
18 FORMATION DES CAS.


serve cel e; exemple : datif-ablatif-génitif pluriel dster-z pour le sanscrit duhitr-Vyas. De même, sirti « cœur » fait au nominatif singulier sirt, mais au cas pluriel précité srti-z, malgré la dureté du groupe initial:M. Au contraire, les thèmes oJ/r kserpent» = sanscrit âhir, è-uftiofîfi {anô'ti «ami» (nominatif {ami), ne subissent jamais de mutilation; exemple : {anôii-z = sanscrit gndti-Byas (thème gnâti «parent», littéralement « connaissance»). Le suffixe sanscrit ti, que nous rencontrons ici en arménien sous la forme p~f> ti, se trouve aussi dans la meme langue sous la forme mfi ti; exemple : .sasti (nominatif sast, datif-ablatif-génitif pluriel sasli-z). Je rapproche, en effet, le mot en question du thème sanscrit sâs-ti2. On voit encore par là qu’il ne faut pas demander au nominatif la forme complète des suffixes qui appartiennent en commun à l’arménien et aux autres langues indo-européennes : c’est dans la seconde série de cas qu’on doit la chercher, et principalement au datif-ablatif-génitif pluriel, dont la désinence g z se joint toujours à la vraie lettre finale du thème. L’arménien, pour les thèmes enn, a même l’avantage sur le sanscrit et le zend, ainsi que sur le gothique, car un n final tombe dans ces idiomes devant les désinences casuelles commençant par ^ % **) by, et m (le remplaçant du b en gothique); on peut comparer, à cet égard, le thème gothique augan «œil», qui fait au datif pluriel auga-m (pour augan-m), au thème arménien akan (même sens), qui fait akan-z, et l’on peut rapprocher cette dernière forme du sanscrit dma-Byas «lapidibus», nâma-Byas «nominibus» (pour âsman-byas, naman-Byas). 23

DUEL. S 216.
11)
216. La désinence sanscrite Bis. — Formes ei lithuanien et en arménien. — Exemples en arménien.
correspondantes en zend, d’un ancien s devenu 4? g

La quatrième forme congénère de la désinenee duelle sanscrite byâm est Bis, qui sert à marquer l’instrumental pluriel. Le zend a comme forme correspondante bis (dans le dialecte de la seconde partie du Yaçna, bîs), le lithuanien mis (S îfii) et l’arménien pqi bq ou vq23. La forme bq, qui correspond mieux au sanscrit bis et au zend bis, ne s’est conservée, comme le b au singulier (§ i83a, b), qu’après une consonne, et n se change alors en m pour rendre la prononciation plus facile. On peut comparer l’arménien oô'(i-vq avec le sanscrit âhi-bis «par les serpents», le zend asi-bis et le lithuanien angi-mis; et, d’autre part, l’arménien akam-bq, venant du thème akan, avec les formes comme ds’ma-bis (pour dsman-bis) en sanscrit, et comme asma-bis (pour asman-bis) en zend. Au sanscrit duhitr-bis «par les fdles» correspond l’arménien dster-bq, contracté de duster-bq (S ai5, a).
On ne saurait douter que dans la terminaison en question le .£ q arménien ne soit sorti d’un ancien s, quoique le change-l ment d’un s sanscrit en.pt q ne se fasse voir que dans les dési— | nences grammaticales2. Parmi les exemples d’un pareil change-■ ment, il en est de plus remarquables encore que celui qui vient d’étre cité : nous voulons parler des formes où un W s final est précédé d’un a ou d’un «. On sait que dans cette position le s final a déjà disparu de l’ancien perse au temps de Darius, fils 24
20 FORMATION DES CAS.


d’Hyslaspe, et qu’il est également fort altéré en zend (S 56h); or l’arménien nous présente des formes de nominatif pluriel comme gês-q «cheveux» (pour le sanscrit Mas) et des formes de première personne du pluriel comme ber-c-mq (pour le sanscrit lidr-â-mas, le védique Mr-â-masi, le zend bar-â-mahi, l’ancien perse bar-â-mahy). Au nominatif pluriel, c’est Petermann1 qui, le premier, a considéré le >j arménien comme une altération de s; mais on a vu plus haut que le s final, quand il sc trouvait après un â long, s’est quelquefois conservé sans changement en arménien; ainsi nous avons utm-yb-u ta-ie-s «dabis» pour le sanscrit dê-yâ-s et le grec So-tri-s (§ i83b, 2); en zend, au contraire, on aurait dâ-yâo, en ancien perse dâ-yâ. Dans les formes comme ber-e-s «lu portes», le s arménien répond au si sanscrit (bâr-a-si), au là zend (bar-n-hi), au hy de l’ancien perse (bar-a-hy).
En ce qui concerne la conservation de l’ancien s, l’arménien (et je crois en pouvoir dire autant de l’ossète) est plus archaïque que l’ancien perse et le zend; au moment où l’arménien s’est détaché du rameau iranien, le changement de s en h et la suppression ou la vocalisation de s final n’avaient pas encore pris toute l’extension dont témoignent l’ancien perse et le zend. Nous avons en ossète car-i-s « tu vis » pour le sanscrit car-a-si, le zend nytAnp car-a-hi «tu vas». On ne peut pas dire que le s de car-i-s a été conservé grâce a 1 i qui précède , car cet i est de date relativement récente, étant sorti d’un ancien a par l’influence assimilatrice de Xi (aujourd’hui disparu) de la désinence personnelle; d’un autre c5té, si nous supposons que la forme zende car-a-lii a anciennement existé en ossète, il est impossible d’expliquer comment, après le changement du second a en i, le h est retourné à sa forme primitive s.
' Grammaire arménienne, p. n 5.

217.
21
Du reste, on trouve au futur ossète un autre exemple dun * conservé après l’a : nous voulons parler des formes comme car-gi-na-s « tu vivras » (§ 21 5, 2).

S 217. De la désinence Çnv, (pt, en grec.
Il est clair qu’il / a un rapport de parenté entre les désinences grecques (ptv, Çt et les désinences sanscrites commençant par un B. Mais on peut se demander si (ptv, (pt, qui, comme on sait, servent indifféremment pour le singulier et pour le pluriel, correspondent dans les deux nombres à une seule et même terminaison sanscrite, ou bien s’ils se réfèrent a deux désinences sanscrites distinctes, l’une pour le singulier, 1 autre pour le pluriel. C’est la seconde supposition qui me paraît aujourd’hui la plus vraisemblable25. Dans cette hypothèse, nous avons pour le singulier la désinence Byam, qui s’emploie au datif pronominal tü-Byam «à toi», et qu’on retrouve en latin, sous la forme bi, dans les pronoms ti-bi, si-bi, et dans les adverbes de lieu i-bi, i u-bi, etc. et en ombrien, sous la forme fe, dans i-fe «là». Quant I au pluriel, il nous fournit, d’une part, la désinence de l’instrumental Bis (qui devient hin en prâcrit), et, de l’autre, la dési-! nence du datif-ablatif «Hî Byas; pour toutes deux, il faut I admettre le changement de s final en v, changement qui n’a d’ailleurs rien que d’ordinaire (S 97). Je rapproche de préférence : la désinence plurielle (ptv, (pt de la désinence du datif-ablatif sanscrit Byas; en ce qui concerne la contraction de yà ch i, on peut comparer la syllabe bis dans le latin nobis, vobis (S 215, 2 ). Au singulier, j’identifie la désinence (pt ou (ptv, par exemple dans <xùt6(pt, fi(pi fit'nQt, xs(pa\vptv, <pç»jjpti(piv, ®a-
r 25 L’auleur a traité pour la première fois celte question dans sou mémoire Du pronom démonstratif et de l’origine des signes casuels (Mémoires de l’Académie de Berlin, 1826). Il y est revenu dans la première édition de la Grammaire comparée (S 317). — Tr. . •
FORMATION DES CAS.


MpnÇtv, ainsi que la désinence latine bi dans ti-bi, si-bi, i-bi, etc. avec la terminaison sanscrite byam dans tü-byam.
Quant aux diverses relations que nous voyons exprimer, dans la langue homérique, à ?<» et à ?< (<p« est probablement une forme mutilée pour Çtv), ces relations n’ont rien qui ne puisse s’accorder avec les désinences sanscrites byam et byas, dont la première exprime le datif, la seconde le datif et l’ablatif. On sait, en effet, que le datif grec cumule, comme l’ablatif latin, l’emploi du locatif et celui de l’instrumental. Toutefois, quand les formes en question sont employées dans le sens du locatif, on les fait souvent précéder d’une préposition ; exemples . èit oLv-tiÇi, ®ap’ aïnécpi «ici même», eV ixpdÇu «sur le tillac», vrap’ o*e<7<p« «auprès du char». Mais on a sans préposition: vra/MixtiÇtv «dans la main», 3vptiQi «dehors», proprement «à la porte», xsÇalbÇiv (Xa&îïQ «(prendre) à la tête », opeaQi «sur les montagnes». Voici des exemples du sens instrumental : éTépnÇt (Xa&efoti) «(saisir) avec l’autre (main)», xpcntpn^ fihÇiv «par forte violence», «avec puissance»; cette dernière forme est tout ce qui reste du thème * (comparez le latin vis). Les formes en Çiv, <p> ne paraissent guère, dans le sens de l’ablatif, qu’avec des prépositions : ce sont les mêmes prépositions qui, dans la langue ordinaire, gouvernent le génitif; mais l’ablatif, qui exprime l’éloignement, est plus conforme au sens; exemples : dvrè vavftv, éx SsôÇiv. En sanscrit, on mettrait simplement l’ablatif : nâubyds, dêvê'-byas (= dêvai-byas). Comme exemples d’un vrai datif marqué par la désinence <piv, on peut citer : Qprlrpr, ÇpvrpvÇtv âpdyv et SeiQtv pfalup
ârdXotvTOs. . .
On peut affirmer qu’il n’y a pas d’exemple de vrai gémtil
avec la désinence <p,v, On cite ordinairement comme tel : 25
DUEL.


23
217.
îXi6(ptv. . . xXvrà isiysa.25 ; mais dans le passage ou se trouvent ces mots, le locatif convient très-bien et l’on peut traduire : «à Ilion». Un autre exemple est : Saxpvotytv. . . orras 'm'unXavro2, où SaxpviCpiv joue le rôle d’un vrai instrumental; si l’on traduisait ces mots en sanscrit, il faudrait dérubis. De ce que la langue ordinaire construit ©(WAijfii beaucoup moins rationnellement avec le génitif, on n’a pas le droit de conclure que <5ix-xpvôtptv soit un génitif. Le même mot se retrouve, mais cette fois avec le sens de l’ablatif, dans ce passage 26 27 28 : ovSé ©ot’ orras baxpuétpw Tépaavro « neque unquam oculi a lacrimis siccaban-tur»; ici on mettrait en sanscrit dsruByas.
La désinence <pt, (piv est également étrangère à l’accusatif et on ne la trouve pas davantage avec les prépositions qui régissent habituellement ce cas ; la seule exception est ês ‘svvy<ptv dans Hésiode29. Buttmann oppose de justes raisons à l’opinion des grammairiens anciens qui soutiennent que Ç>t, Çuv peuvent se trouver aussi au nominatif et au vocatif; le même savant montre qu’il n’y a aucun motif pour mettre un s souscrit aux noms de la première déclinaison qui ont <pt pour désinence30.
FORMATION DES CAS.

2 h

S ai8. Combinaison de la désinence , Çiv avec les thèmes terminés par une consonne. — Comparaison avec le sanscrit.
Parmi les thèmes terminés par une eonsonne, il n’y a guère que les thèmes neutres en s (§ 128) que nous voyions se combiner avec <pi, <piv; exemples : â%ea--<pi, èpecr-Çi, t/hjOscr-tyiv. Les grammairiens ont d’ordinaire mal compris ces formes, parce qu’ils ne considéraient pas le a comme faisant partie du thème1. Des autres consonnes, v est la seule, et des thèmes en v, xotu-XySov est le seul que nous voyions se combiner avec <ptv; comme le v ne se joint pas aussi aisément que le a au <p de la désinence, on insère un 0 euphonique, ce qui donne xonXvSôv-o-<ptv2. Cet exemple est suivi sans nécessité par Sdxpv, qui fait SaxpvôÇuv (= sanscrit dsrur-Byas); au contraire, vav-Çuv est formé tout à fait comme le sanscrit nâu-byds, sauf la différence d’accentuation 2.
En sanscrit, les thèmes terminés par le suffixe as (= grec es, os) changent cette syllabe en 6 devant les désinences casuelles commençant par un è'4; les formes comme vdcô-Byas sont donc moins bien conservées que les formes grecques comme oyea-tpiv.
Si l’on veut rapporter la désinence Ç>tv, Ç>i, partout où elle se rencontre en grec, à la désinence sanscrite Byam, on n’a, pour les formes comme 3-e<5-(pm, §<zxpv6-<piv, vuü-fyiv, tysa-ÿw d’autre point de comparaison en sanscrit que les datifs des pronoms des deux premières personnes [asmàbyani «nobis», yuê-mdbyam, « vobis » ). Mais par leur forme ces datifs appartiennent
1 Ce qui a causé leur erreur, c’est que le a est supprimé devant les désinences commençant par une voyelle.
3 La même insertion a lieu dans les mots composés comme xvv-o-dapai/is.
* De- même, en composition, le thème vau s’abstient de prendre la voyelle de liaison o; il fait, par exemple, vaitsIaOuov, qui est lormé comme le composé sanscrit nàu-s'ta «se tenant» ou «étant dans le vaisseau».
1 C’est un changement qui n’a lieu ordinairement qu’a la fin des mots (§ 22 ).


au singulier; ils ne peuvent être très-anciens, car nous ne trouvons rien de semblable en zend, où nous avons un datif rnaibyo ttnobis» (§ 91 5, î) qui présente une vraie désinence du pluriel. A l’époque où le zend et le sanscrit ne faisaient encore qu’une seule et même langue, on a donc dû avoir asme-Byas, ymmê-Byas, ou plutôt asmaiByas, yusmaiByas. Les ablatifs pluriels asmât sa nobis», yusmdt «a vobisn, qui appartiennent également par leur forme au singulier, n’ont pas non plus d analogues en zend : c’est probablement le maibyô précité qui servirait d’ablatif, si le pronom en question se trouvait employé à ce cas dans les textes qui nous sont parvenus.
S 919. Combinaison des désinences sanscrites byâm, bis, byas avec les thèmes en a. — Origine de la désinence âis à l’instrumental pluriel.
Nous retournons au duel sanscrit en WTW Byâm, pour faire observer que, devant cette désinence, les thèmes terminés par un ^ a allongent celle voyelle, ce qui nous donne dsvâByâm au lieu de àsvaByâm. Il est probable que devant la désinence plurielle Bis l’a s’allongeait de même, et qu’on avait dsvâ-Bis à l’instrumental de dsva. Mais la langue ordinaire, au lieu de la forme complète dsvâ-Bis, nous présente une forme mutilée dsvâis. J’ex-i;plique cette forme par la suppression du B. En effet, la diph-thongue Tt âi représente d + i (S 2). Cette opinion que j’ai exprimée pour la première fois il y a longtemps1, m’a été confirmée depuis par plusieurs preuves nouvelles. En premier lieu, les pronoms des deux premières personnes, que je n’avais pas songé à citer à l’appui de mon explication, forment réellement de leur pronom annexe sma un instrumental smâ-Bis; entre asmaBis, yusmaBis et notre instrumental supposé dsvâ-Bis, il y a le même rapport qu’entre les accusatifs asmân, yusman «nos, vos» et le
Mémoires de l'Académie de Berlin, 1826, p. 79.
26 FORMATION DES CAS.


substantif ds'vân «equos». En second lieu, mon hypothèse, à laquelle j’étais arrivé par la voie de la théorie, a été justifiée par le dialecte védique où nous avons des formes d’instrumental terminées, sinon en â-bis, du moins en ê-bis, d’après l’analogie des datifs-ablatifs comme dsvê-byas; exemple : dsvê-bis «per equosy. Rapprochez, dans la langue ordinaire, la forme pronominale ê-bis «per hos», venant évidemment du thème pronominal vq a, lequel, comme on le verra, joue un rôle capital dans la déclinaison de iddm. Nous avons donc d’une part le pronom a qui fait ê-bis, d’un autre côté asma et yuêma qui font asmabis et yusmdbis; si, dans le dialecte védique, les thèmes substantifs et adjectifs se rattachent à la première de ces formes, il ne s’ensuit pas nécessairement que âis provienne de ê-bisl. Au contraire, âbis a fort bien pu devenir êbis, d’après l’analogie des datifs-ablatifs en ê-byas et d’autres formes où l’c est une altération de l’a, par exemple les formes duelles comme barété venant de bar-a-âtê 31 32.
S 920. Comparaison de l’instrumental pluriel en prâcrit, en lithuanien, en zend et en ancien perse, avec l’instrumental sanscrit.
On vient de voir dans le dialecte védique des exemples d’instrumentaux comme dsvê-bis, au lieu de asm-bis. Le prâcrit, allant jusqu’au bout dans cette voie, a changé en ê l’a de asmabis, yusma-bis et celui des locatifs asmâ-su, ytismd-su : il en a fait amhê-hin, tumhê-hin; amhê-su, tumhê-su. En outre, tous les autres thèmes en a, tant pronoms que substantifs ou adjectifs, ont ê-hin en prâcrit à l’instrumental; ainsi l’on a kmumê-
DUEL. S 220.

27

hin «floribus» (de kusuma) comme pendant du védique kusûmc-ïm. Mais avant que les formes en ê-bis, ê-hin fussent sorties de ûbis par le changement de la en ê, il fallait que par voie de suppression et de contraction ce même âbis eût déjà donné la forme âis. Les faits viennent confirmer notre raisonnement : déjà dans les Védas, à côté des instrumentaux en ê-bis. on trouve des
instrumentaux comme yagnâls, arhâis. En zend, la forme contractée âis est la seule dont on ait des exemples, et elle est très-fréquente dans cette langue.
De même, en lithuanien, les thèmes masculins en a, se séparant sur ce point de tous les autres, ont perdu la consonne initiale de la désinence casuelle ; exemple : dêwais « par les dieux », forme qui s’accorde d’une façon remarquable avec le sanscrit dêvâîs et le zend daivâis. Les masculins lithuaniens en
ia (= ja), nominatif i-s, ont eis pour iais1; exemple : wàlgeis, venant du thème wàlgia, nominatif wàlgi-s «nourriture»2.
En ancien perse, les instrumentaux des thèmes en a sont formés comme les instrumentaux védiques en ê-bis, mais ils conservent la diphthongue primitive ai(§ 2, remarque); exemple : bc.gai-bis, venant du thème baga « dieu »: Il y a de nombreux instrumentaux de cette sorte en ancien perse; quant à la forme rauca-bié3, elle vient, selon moi, d’un thème en n : devant une désinence casuelle commençant par Une consonne, ce n devait tomber, comme il tombe en sanscrit et en zend4.
* Voyez 8 92k.
8 Littéralement «ce qui doit être mangé», du verbe wàlgau «je mange». Comparez, en sanscrit, ies participes futurs passifs en xja (S 8gS ).
3 C’est un mot qui revient souvent sur tes inscriptions, et il est toujours précédé d’un signe numérique. Je traduis «post dies», en rappelant que l’instrumental sert souvent aussi en sanscrit à exprimer cette sorte de relation.
4 Hauéanest un neutre, comme on le voit par l’accusatif singulier rauéa. On a, par exemple (Inscription de Béhistoun, I, ao) : Tcéapa-vâ rauca-pati-vâ «pendant la nuit ou pendant le jour». Il faut de même considérer Uéapa comme un accusatif neutre venant du thème ksapan (comparez le zend lisapan, datif tisafn-e). Un antre
formation des cas.

28

s 2.2,. Combinaison de la désinence zeude hja avec les théines en a.
— Comparaison avec le grec.
Devant la désinence dueile bya, il existe, pour les thèmes en a, entre le zend et le sanscrit, la même différence qu’entre les instrumentaux védiques et prâcrits en ê-Bis, ê-hin et les instrumentaux primitifs en â-Bis (asmâ-Bis, yusma-Bis) : le zend présente hj- ai (§ 33) au lieu de VA sanscrit. Nous devrions donc avoir, au cas en question, aspai-bya; mais par suite de lépen-thèse (§ Ai), aspai-bya devient aspaii-bya. C’est ainsi que nous avons dans le Vendidad Mupxj j*w)<hj-»M* hmiibya pâdhii-bya «suis pedibus» = sanscrit svâByâmpâdâByâm; sastaiibya (sanscrit hdstâByâm) «manibus». On trouve aussi au même cas la diphthongue sanscrite ê représentée par Je zend oi (§ 33); exemple : ubôibya «ambobus». Si Ion rétablit
la nasale perdue â la fin de cette forme, et si Ion admet que la désinence du duel grec iv est, comme je n’en doute pas, une mutilation du sanscrit Byâm1, on peut rapprocher la forme précitée ubôibya des duels homériques comme &>[àoiïv.
Dans les formes en question , le premier t doit être placé du côté du thème qu’il sert à élargir, et le second du côté de la désinence (&jfiot-ïv). La troisième déclinaison, par ses duels comme Saty-ivotv, pourrait faire croire que la vraie desinence est otv, et non iv\ mais l’examen des deux premières déclinaisons (Motitrx-iv, Uyo-tv) prouve le contraire. Nous expliquons donc l’o qui se trouve devant tv, à la troisième déclinaison, de la même façon que celui qu’on a devant ytv (xoTvXvSov-é-Çtv, § a18); c’est une voyelle euphonique qui, des thèmes où elle
exempte de rama à l’accusatif se trouve sur la même inscription, III, 8, où i rauca
signifie «primum diemn. '
1 La labiale ayant été supprimée comme dans tlUolvJ dsvitis, venant de dsvdbis,
et fflï^ yâm ayant été contracté eu iv.
DUEL. S 222.

29

était nécessaire, c’est-à-dire des thèmes terminés par une con
sonne , a passé dans ceux où elle était superflue, c’est-à-dire dans les thèmes en * et en v. On peut remarquer d’une manière générale que les thèmes terminés par une consonne, dans la troisième déclinaison grecque, entraînent les autres : ils servent de modèle aux thèmes en * et en v. Il est vrai que la voyelle de liaison o n’était même pas nécessaire entre une consonne et la désinence iv, puisqu’on peut très-bien dire Scupov-tv; mais cet o remonte évidemment à une époque où tv était encore précédé de la consonne que fait attendre la désinence sanscrite Byâm, selon toute vraisemblance un <p, en sorte que Settfiév-o-iv vient de Sainov-o-tytv33.
Nous aurions donc ici un autre que celui que nous avons essayé de rattacher (§ 217) à Byatn, Byas; dans la désinence duelle la nasale a sa place légitime, car elle remplace le m primitif, comme cela est de règle en grec à la fin des mots. Pour montrer d’ailleurs comment des formes absolument semblables peuvent provenir de types primitifs tout à fait différents, il suffit de rappeler la première personne du singulier hvnlov qui est pour iruxlofx, et la troisième personne du pluriel ërnrlov qui est pour imrlovT.
S 22a. Instrumental-datif duel en lithuanien et en ancien slave.
En lithuanien, nous avons m pour désinence de l’instrumen-tal—datif duel; exemple : dewâ-m, qui fait pendant au sanscrit
30 FORMATION DES CAS.


dêvâ-thjâm. Mais ce m n’a rien de commun avec le m final de la désinence sanscrite, ni avec le v des formes grecques comme S-son*; il répond, comme le m des désinences mis et mus (ou ms), à la consonne initiale de la terminaison sanscrite (§ ai5, 2). C’est ce que montre la désinence correspondante en ancien slave, laquelle a conservé la voyelle du sanscrit Byam, et oppose, par exemple, novo-ma(masculin-neutre),nova-ma ^iémininj, au sanscrit nâvâ-Byâm (thème masculin-neutre nam, thème féminin ndvâ). Mais même en faisant abstraction du slave, il serait encore impossible d’identifier le m de la désinence lithuanienne avec le m du sanscrit Byâm, car m final ne s’est conservé nulle part en lithuanien : ou bien il est supprimé (même là ou 1 écriture prouve encore qu’il a existé autrefois, 8 10), ou bien il est devenu u, par exemple à la première personne du singulier de l’aoriste, où au répond partout au sanscrit am1.
S 993. Origine des désinences Bis, byam, byâm, byas.
Quelle est l’origine des suffixes casuels sanscrits commençant par «ït By (venant de Bi), savoir Bi-s, By-am ,by-am et By-as ? Avant tout, remarquons la parenté qui les unit a la préposition ■UfÎT aBi «vers, à, contre» (d’où vient aBî-tas «ad, prope»). Mais dans aBi lui-même Bi est évidemment une désinence ajoutée au thème démonstratif a% Cette préposition est donc, quant a sa seconde syllabe, de la même famille que le iatin ti-bi, si-bi, t-bi, etc. C’est le même rapport qui existe entre la préposition d-dï «sur», formée également du thème pronominal a, et les adverbes de lieu grecs comme &-6t, nsô-Ot, dllo-Bt, ovpctv6-9i (8 16). Un autre suffixe de même origine que dï est V dit, qui, en sanscrit, s’est altéré en ^ ha (8 2 S ), mais qui s est conservé en zend dans quelques adverbes de lieu et dans la prépo-
1 De même, en gothique, le jau du subjonctif présent répond au sanscrit ydm
(S 18).
DUEL. S 224.

31

sition ha-d'a «avec» (pour le sanscrit sa-hd, § à20). Comparez, en grec, le 6a de ’évOa, ivravûa1. Le xj c/, dans ces formations, est le substitut de t, comme on le voit encore par l’exemple de plusieurs autres formes2; da, dï viennent donc du thème démonstratif W ta. Mais il est plus difficile de démontrer l’origine du Bi de aBî (grec dfitpi) : je soupçonne qu’une consonne initiale a été supprimée. De même qu’en grec on emploie Ç>/v au lieu de aipiv, de même qu’en sanscrit vihsâti « vingt » est évidemment une forme mutilée pour dvinéati, et qu’en zend jyjj bis « deux
fois», Jtjjjoj) bitya «le second» sont pour dms, dvitya (en sanscrit dvitïya), de même aussi il se peut que fÎT Bi soit identique avec le thème pronominal sva ou svi (d’où dérivent <tÇ)bU, er<p(v, (Çiv, etc.). Il faut alors admettre qu’après la chute de s, la semi-voyelle suivante s’est fortifiée ou durcie de la même façon que dans le zend jçu bis, uum bitya, et dans le latin bis, bi (bi-pes, 8 3o9).
S 2 2 4. Tableau comparatif de l’instrumenlal-datif-ablatif duel.
Nous faisons suivre le tableau synoptique de ce cas en sanscrit, en zend, en grec et en lithuanien :
|
Sanscrit. |
Zend. |
Grec. |
Lithuanien. | |
|
Masculin... |
àévâ-Byâm |
aspaii-bya |
hnso-tv |
ponâ-m3 |
|
Féminin... |
àhâ-Üyâm |
hisvâ-bya |
Xtbpa-iv |
âëivô-m |
|
Masculin... |
pâti-üyâm |
paili-bya |
tsoal-o-tv |
genti-m |
|
Masculin... |
sûnù-Byâm |
pasu-bya |
vsxb-o-iv |
sûniirtn |
|
Féminin... |
Mnu-byâm |
tanu-bya |
yevb-o-w | |
|
Féminin... |
vâg-byam |
? |
im-o-ïv |
1 Au 6e v de évOev. êpéOev répond le yrp d'as (pour nrp tas), de a-d'ds
«sous, dessous». *
2 Par exemple'A la seconde personne du pluriel moyen, où sër dbé et dvam sont pour tvê, ^ôHT tvam (comparez le pronom tvam «tu»).
’ Voyez S 8 2 2.

32
Masculin.. Masculin.. Masculin.. Neutre. ..
FORMATION DES CAS.
Sanscrit. Zcnd. Grec-
Hdrad-Byâm baran-bya1 Çep bwc-o-iv
dsma-byâma asmarbya Sat pôv-o-iv
bratr-byâm brâtar-ë-bya iscnép-o-iv
Lithuanien.

GÉNITIF-LOCATIF.
S 925. Le génitif-locatif duel en sanscrit, en zend et en ancien slave.
— Le génitif duel en lithuanien.
En sanscrit, ces deux cas ont la désinence commune os, qui est peut-être parente de la désinence du génitif singulier. Exemples : dsmy-ôs (venant de asm et de dsvâ)38 39, pdty-ôs, hdnv-
ôs, vâc-os, Brâtr-ôs, vdcas-os. _
Le zcnd a renoncé à la sifflante : il présente )» 6 au lieu de ^ 6s. Comme exemple, on peut citer les mots Wü*3“ ubôyâ anhvô «dans les deux mondes»®; ubôyô répond au sanscrit uUy-ôs40 et anhvô aux formes sanscrites comme sûnv-ô’s, hdnv-ôs, venant de snnù, hdnu. Un autre exemple m’est fourni par ce
DUEL. S 225. *"»


passage du Vendidad-Sâdé ' : kaiâ asâi drugëm dyaimi sadtayô «comment donnerai-je au pur la drug dans les mains?» (cest-à-dire «dans le pouvoir»)2. Ici saitay-ô répond au sanscrit hdstay-ôs, venant du thème hdsta (masculin) «main».
J’ai cru autrefois que le lithuanien n’avait pas de désinence pour le génitif duel : j’identifiais lu de dew-û «amborum deo-rum» avec Xü du pluriel dêw-ü «deorum». Mais comme 1 ancien slave possède une désinence particulière pour le génitif duel3, et qu’il fait, par exemple, oeok) oboj-u «amborum, ambarum» en regard du sanscrit uBay-ôs (même sens), nous devons admettre également une parenté originaire entre le lithuanien dwej-û « duo-rum, duarum» et le génitif-locatif sanscrit dvdy-ôs (même sens), qui en zend ferait dvay-6 ou dvôy-ô, Mais si 1 on admet que 1 ü de dwêj-ü représente la désinence sanscrite la désinence
zende ^ ô, il est permis d’étendre la même explication aux autres génitifs duels : ainsi awi-u « ambarum ovium », malgré son identité apparente avec awi-u «ovium», répondra au génitif-locatif duel sanscrit dvy-ôs. Les thèmes substantifs et adjectifs en a et en ô4, qui correspondent aux thèmes sanscrits en a (pour le masculin et le neutre) et en a (pour le féminin), laissent, au génitif pluriel aussi bien qu au génitif duel, leur voyelle finale se perdre dans la voyelle de la désinence. La même chose a lieu pour les classes de mots correspondantes en ancien slave. Nous avons donc en lithuanien dew-ü, qui signifie à la fois «amborum deorum» et «deorum» en regard du duel sanscrit dêvdy-ôs et du pluriel dêvâ-n-âtn; de même asw-ü «ambarum equarum» et «equarum» en regard de dsvay-âs et de dsvâ-n-âm.
1 Manuscrit lithographié, p. 35'j.
3 Anquetil traduit : «Comment moi pur mettrai-je la main sur le Daroudj?»
3 Comme en sanscrit, elle est commune au génitif et au locatif. Le locatif manque, au contraire, au duel lithuanien.
4 Nominatif as et a.
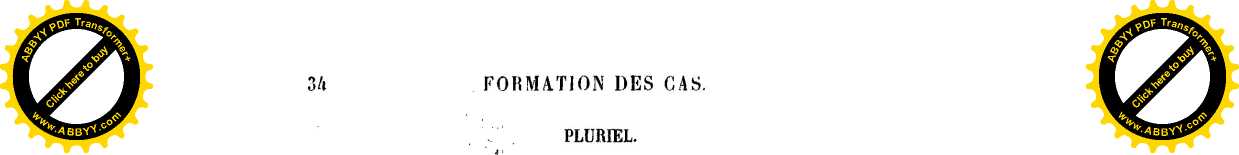
NOMINATIF-VOCATIF.
S 926. Thèmes terminés par une consonne. — Nominatif arménien.
A l’exception du sanscrit qui, au vocatif, recule l’accent sur la première syllabe (§ 20 4), toutes les langues indo-européennes ont le nominatif et le vocatif pluriels semblables.
En sanscrit, les masculins et les féminins ont as pour désinence : je regarde as comme un élargissement du signe du nominatif singulier s, et je vois dans cet élargissement du suffixe casuel une indication symbolique de la pluralité. Le neutre est privé au pluriel, comme au singulier et au duel, de ce signe s, qui est réservé pour le masculin et le féminin, c’est-à-dire pour les genres indiquant les personnes.
En zend, as est devenu 6 (§ 56b), ou bien as devant les particules annexes ca et cid. Le grec a pour désinence es, à l’exception des classes de mots dont il sera question au § 228"; le latin, le lithuanien et le plus souvent aussi le gothique ont perdu la voyelle contenue dans la désinence as. Je regarde comme appartenant au thème Yê des formes latines comme vôcê-s, fratrê-s, aussi bien que celui de ovê-s (= sanscrit dvay-as, grec «52—es). J’en fais autant pour Y y (prononcez î) lithuanien dans âwy-s, et pour Yei (= î) gothique dans gastei-s. J’admets qu’à'une consonne primitivement finale est venu se joindre en latin un i, et que cet t a été frappé du gouna, comme cela a lieu pour les thèmes originairement terminés en i, tels que ovi.
On peut comparer les formes gothiques comme aimants, les formes lithuaniennes comme âkmen-s s pierres », dùkter-s « filles » ', 41

35

avec les formes sanscrites comme àsmân-as, dukitdr-as, les formes rendes comme asman-ô, asman-m-ca, dugder-ô, dugd'ër-as-ca, les formes grecques comme §aî(xov-ee, 3vyaiép-ss.
L’arménien a changé, comme on l’a déjà fait remarquer (S a 16 ), la sifflante de la désinence sanscrite as en gi q, et il a sacrifié la voyelle, comme le gothique, le lithuanien et le latin. Nous avons donc dster-q « filles », qui répond au lithuanien duktcr-s, et akun-q «oculi», qui s’accorde avec les formes gothiques et lithuaniennes comme ahman-s, akmm-s. On remarquera que le signe casuel q se trouve aussi ajouté aux mots qui, comme akn « œil », étaient originairement du neutre ; mais cela vient, comme il a déjà été dit (§ i83\ 2), de ce que l’arménien a réuni les trois genres en un seul, à savoir le masculin 41. Lu de ahun-q a déjà été expliqué comme étant un affaiblissement de Va du thème akan (sanscrit aksany, il est avec cet a dans le même rapport que l’w du vieux haut-allemand hanun (le signe casuel est tombé ) avec le gothique hanan-s. Ceux des thèmes en an qui affaiblissent leur a en % au génitif-datif singulier (troisième déclinaison de Schrôder, huitième d’Àucher), conservent cet i au nominatif pluriel : c’est pourquoi Irqf/kg. esin-q «boves » (du thème esan, génitif-datif esin) ressemble plus au génitif singulier gothique aulisin-s qu’au nominatif pluriel auhsan-s. Mais ce n’est pas une raison pour faire dériver le nominatif pluriel de ces thèmes arméniens du génitif-datif singulier, pas plus que pour les thèmes arméniens terminés par une voyelle on n’est auto-nienne, p. 192 ), lequel fait observer que la forme âkmeny-s donnée par les grammairiens et les livres est fausse. Cependant, elle n’a pu être inventée : elle doit appartenir, comme la plupart des cas des thèmes ch n, à un thème qui s’est élargi par l’addition d’un i. La forme dukterôs qui se trouve dans Ruhig et Mielcke, au lieu de la forme dàktei'-s de Scldeichér, me paraît encore plus suspecte que aleineny-s, car i le thème est élargi par l’addition d’un t , on devrait avoir duktery-s.
1 II y a un fait analogue dans les langues ibériennes. (Voyez mon.mémoire : Les membres caucasiques de la famille indo-européenne, p. 5 et stiiv. )

36

risé à faire dériver le nominatif pluriel du nominatif singulier, sous le prétexte que l’un et l’autre suppriment la voyelle finale du thème. Cette suppression fait ressembler les nominatifs pluriels arméniens, si l’on accorde que le ^ ^ soit une altération d’un s primitif1, aux nominatifs singuliers des thèmes gothiques en a et en i; de même qu’on a, par exemple : vuif-s, gast-s, venant des thèmes vulfa, gasti, on aura en arménien gfa-à «cheveux», olp ôl-q « serpents » , venant des thèmes gêna ( par affaiblissement gisa) = sanscrit kê's'a, ôli = sanscrit AU, grec ê%i.
Les pluriels en er, ear, an, ean (Petermann, Grammaire arménienne, p. 9A) ne contiennent point de flexion casuelle; le mot entier appartient au thème, et l’élargissement qu’il a reçu, comparativement au singulier, est de la même nature que celui des pluriels allemands comme kinder, hàuser, graber (§ *3 41 ), marner, geister, ou bien encore comme celui des pluriels féminins de la première déclinaison forte de Grimm (par exemple gaben), lesquels ont ajouté un n à leur thème terminé par une voyelle. En arménien, la langue vulgaire fait un usage presque constant des pluriels ou des collectifs à thème élargi (voyez Schrôder, p. B07 et suiv. et Cirbied, p. 7&5 et süiv.), surtout de ceux qui sont terminés en r, mais qui par leur déclinaison se trouvent être des singuliers. Nous avons, par exemple,
1 Cette altération n’a lieu que dans les désinences, jamais dans les racines et dans les thèmes; le q arménien a cela de commun avec le g %, lequel figure dans les désinences, mais là seulement, comme l’altération d’un son ( j — sanscrit y), dont il parait aussi éloigné qu3^> q de s. Il ne faudrait pas, en effet, invoquer ici l’exemple du q dans qun «sommeil», thème quno, par corruption qno, ni celui de j>njp quir «soeur», qui correspondent aux thèmes sanscrits liidpna «rêve» et ivdtdr «sœur» ; en effet, le groupe tv est constamment devenu une gutturale dans les langues iraniennes (S 35); on peut, par conséquent, admettre que cette gutturale provient d’un durcissement du v, de même que nous avons |e v de StôTS^" ivdiura (pour svdiura) «beau-père», qui s’est changé en k dans u^lrunup ikesur
«belle-mère», et celui du pronom sanscrit Iva «toi», qui s’est changé en q dans qn, qê-n.
PLURIEL. S 227.

37

de <fmy liai « pain » (thème hazi) le pluriel, ou plutôt le collectil hazer (nominatif-accusatif-voeatif), dont le thème est liazeru, comme on le voit par le génitif dénué de flexion hazeru et par l’instrumental hazero-w. Dans l’arménien classique, on a de gir «lettre» le collectif grean «livres, écrits», qui se rapporte à un thème greano. On a, du reste, aussi, avec les désinences du pluriel, le nominatif grean-q, datif-ablatif-génitif grena-z (du thème grma)', de npktup orear «hommes42 » vient le génitif oreroi (prononcez orerô) ainsi que la vraie forme du nominatif pluriel orear-q. A côté.de kij* «âne» se trouve le pluriel iïan-q
«asini», datif-ablatif-génitif isan-z, formes qui dérivent d’un thème iéan avec lequel on peut comparer le latin asinu-s, le gothique asilu-s, le lithuanien asila-s, l’ancien slave oselü (thème oselo), la liquide l ayant pris la place de la liquide ». 11 est permis de supposer que les collectifs en ar, ear et les collectifs en an, ean ont eu à l’origine un seul et même suffixe; je considérerais alors les formes en n comme les formes primitives.
8 337. Nominatifs sanscrits en as. — Formes correspondantes en gothique et en lithuanien.
Dans les thèmes terminés en a, il s’opère une combinaison entre cet a et l’a dé la désinence. On a, par exemple, vrkâs «lupi», venant de varka + as, qui répond au gothique vulfôs ve-
’ Ce mot n’a pas de singulier, à moins qu’il ne soit de la même famille que lufai air «homme», qui forme la plupart de ses cas d’un thème mpuiu aran (par contraction arn). Le même élargissement du thème a lieu pour hair «père», qui ajoute à plusieurs cas la syllabe an au thème. Un rapport semblable existe entre le gothique fadar «père» ètfadrein «parents», entre l’anglais brother «frère» et brethrm «frères». -— La parenté du mot hair avec pitar, patet' est connue; l’insertion de l’t me paraît due à la liquide, comme dans qoir «sœur» (zend qanhar, sanscrit svàsdr) et dans mair «mère». Quant au thème aran «homme», je le rapprocherais volontiers du sanscrit nar, nr «homme», avec prosthèse de l’n comme dans le grec àiojp (S 183 1) et avec métathèse de nar en ran (ibidem).
38 FORMATION DES CAS.


nant de vulfa + as (S 69). Mais le gothique n’a conservé la désinence complète que dans les combinaisons de cette espèce; partout ailleurs, que le thème soit terminé par une voyelle ou par une consonne ,1e gothique n’a gardé de la désinence as que le s; exemples : sunju-s, ahman-s, pour smiv-as, ahman-as. On sait, d’ailleurs, qu’en général la désinence as a été, dans les formes polysyllabiques, affaiblie par le gothique en is ou en s (§§ i35 et 191). . _ ;
Les thèmes sanscrits terminés en â long font également âs au pluriel; exemple : «equæ », de âsvâ-as. En gothique,
on ne peut, pour la raison que nous venons de dire, décider avec certitude si la désinence, par exemple dans gibôs (venant du thème gibâ), est s ou as.
En lithuanien, on a des formes comme aswôs qui sont analogues au gothique gibôs. Considérées au point de vue de la langue lithuanienne, ces formes doivent être divisées ainsi : âswô-s, comme. au génitif singulier (§ 1.93); elles forment donc le pendant des nominatifs pluriels comme awy-s «moutons», sénü-s «fils», dùkter-s «filles», akmen-s «pierres». On pourrait toutefois regarder aussi âswôs comme un reste parfaitement conservé des temps primitifs; on le diviserait alors ainsi : âêwà-as ou àswô-as (ô = â, § 92“).
S 228“. Terminaison pronominale prenant en grec et en latin la place de la terminaison ordinaire.
Les thèmes pronominaux masculins en a n’ont pas, en sanscrit, en zend et en gothique, la terminaison pleine du nominatif : ils la remplacent en élargissant le thème par' l’adjonction d’un i. La combinaison de l’a du thème et de l’t donne, en sanscrit, un rç ê (§ 2)K, cet ê devient en zend x» ê ou 4]» ôi; exemptes : 42
PLURIEL. S 228*.

39

sanscrit,% tê; zend, jyça tê; gothique, tliai « ceux-ci ». A ces formes viennent s’opposer les formes féminines fTTB[ tâs en sanscrit, kîo (§ 56b) en zend, thôs en gothique.
En grec, nous avons au masculin toi (forme dorienne pour ol); mais en grec et en latin, cet i qui remplace dans l’usage la désinence as (ss, s) n’est pas resté borné aux thèmes pronominaux masculins en o, ô (= ^ a, § 116) : tous les autres thèmes de la deuxième et de la première déclinaison, en grec et en latin, ont suivi cet exemple. On a par conséquent 'ticnoi, x&pa.t au lieu de lmro-es, £«pa-es; equî (venant de equoi), equœ (venant de equai). La cinquième déclinaison latine, quoique originairement identique avec la première (§ qa42), a conservé le s de la désinence casuelle; nous avons rê-s, comme en sanscrit dsvâs venant de asvâ-as. Le lithuanien a posé des bornes plus étroites que le grec et le latin à cette extension abusive de la flexion pronominale, ou plutôt à cette absence de flexion. On dit bien, par exemple, demi (= 3-sot, diî, dîm); mais on a dswôs et non âswai, en regard du latin equœ.
avec cet ê que se combinent tes désinences casuelles, on est autorisé à admettre que dans tS et dans les formes analogues il n’est contenu aucun signe casuel. Les pronoms étant des mots spécialement destinés à marquer l’idée de personne, la personne était suffisamment indiquée au nominatif sans le secours d'aucune flexion. C’est ainsi qu’au singulier on dit sa au lieu de sas en sanscrit et en gothique, ô au lieu de 6s en grec; c’est ainsi encore qu’en latin, à côté de is-te, on a les pronoms ipse et ille qui sont dépourvus du signe du nominatif. Cette opinion est confirmée d’une façon toute particulière par la 'forme du pluriel ïPTt ami «illi» qui est évidemment un thème à l’état nu, comme on le voit par la plupart des cas obliques, tels que amî-Vyas «iliis», ami-êam «illorum». La forme zende ajusqgaai» vtépéê-ca «omnesque», qu’on doit considérer comme une contraction de vîspay-aé-ca (S a 13 ), fait supposer que la désinence a* pouvait aussi se joindre à rf (ê et à d’autres formes dénuées de flexion, de manière à faire tay-as. En zend, la forme pronominale en é est aussi employée d’ordinaire pour l’accusatif pluriel : ainsi l’cxemple.que nous venons de citer, vispés-ca, est nu accusatif.
FOHMATIOiM DES CAS.

AO

S a a 8 Formes latines archaïques en eis, en es et en is. — Formes osques et ombriennes. —Thèmes primitivement terminés par a en lithuanien, en slave et en vieux haut-allemand.
De ce que l’ancien latin nous présente, au nominatif pluriel de la deuxième déclinaison, à côté des formes en î (et), d’autres formes en eis, en es et en is, comme, p ar exemple, vtveis, guateis, facteis, populeis, leibereis, (conscr)iptes, duomvires, magistres, mi-nistris 1, il ne s’ensuit pas, à mon avis, que les formes en î ou en et soient purement et simplement des restes des formes en eis. En effet, le rapport étroit qu’il y a entre les formes latines en et, î, ai, ce et les formes grecques en ot, au, prouve qu’elles sont anciennes et qu’elles remontent à une époque où le grec était encore identique au latin2. Cela ne doit pas cependant empêcher d’admettre que, dans l’ancien latin, les formes organiques en s aient coexisté avec les formes en ei, î au nominatif pluriel de la deuxième déclinaison ; mais, même dans la période la plus ancienne, les nominatifs en s étaient beaucoup moins nombreux que les autres. Inversement, nous avons dans la déclinaison pronominale des formes comme ques au lieu de qui (dans le Sénatus-consulte des Bacchanales), hisce au lieu de hîce3, eis au lieu de ii, à moins qu’on ne préfère, ce qui vaut mieux, faire dériver ces formes de thèmes en i, comme nous faisons pour que-m, qui-bus et pour l’accusatif archaïque i-m — gothique in-a; dans cette dernière hypothèse, que-s (quê-s) est formé d’après le même principe que ovê-s = sanscrit âvay-as.
1 Voyez Ritschl, Monumenta epigraphtca tria, p. 18 et suiv. s II y a encore en latin d’antres exemples de formes pronominales qui se sont introduites dans la déclinaison des noms. Ainsi au génitif pluriel des noms de la première , de la deuxième et de la cinquième déclinaison, nous avons une désinence qui appartient exclusivement aux pronoms en sanscrit, en zend, en germanique, en bo-russien et en slave.
3 Sur la parenté possible de hi-c avec qui, voyez S 3gè.
PLUK1EL. S 22843.

Al

Au cas où l’explication que nous donnons ci-dessus ne serait pas fondée et où il faudrait admettre que les pluriels en eis = îs (comme vireis, leiberei-s) sont avec les pluriels en ei, î dans un rapport ou de fdiation ou de paternité, je n’hésite pas, d’accord en cela avec Pott, à me prononcer pour la première de ces deux hypothèses : c’est-à-dire que je regarderai le s comme une désinence nouvelle qui est venue se surajouter aux pluriels en ei, d’après l’analogie de la troisième déclinaison. Il faut rappeler à ce propos la surabondance de flexions casuelles dans les génitifs singuliers comme èytevs (S 189) et dans les nominatifs pluriels védiques comme dêv&-as (S 999).
En osque et en ombrien, ni les substantifs et adjectifs ni les pronoms ne prennent au nominatif pluriel la terminaison î. Dans le premier de ces dialectes, la deuxième déclinaison présente des nominatifs pluriels en üs1 : Nüvlanus sNolani», Abel-lanùs «Abellani»; la déclinaison pronominale nous donne pus « qui ». Aufrecht et Kirchhoff ont reconnu des nominatifs pluriels de la première déclinaison dans la forme scriftas «scriptæ» et dans pas «quæ»2. L’ombrien, dans sa période la plus ancienne, a des nominatifs pluriels masculins eh os (deuxième déclinaison) et féminins en as; dans la période plus récente, ils se changent en o-r, a-r; niais on n’a pas d’exemple, dans ce dialecte, de nominatif pluriel pronominal. Pour revenir aux formes latines archaïques en eis ou es, on ne peut les mettre dans une même classe avec les pluriels osques en ùs, ni avec les pluriels ombriens en o-s ou o-r ; ils ne se ressemblent que par le signe casuel s; mais s’il fallait renoncer à l’explication donnée plus

h -2

haut, suivant laquelle s aurait été ajouté par surcroît à un nominatif pluriel formé d’après la déclinaison pronominale, je regarderais la forme en es (ês) comme la plus ancienne, et je rapporterais virés, duomvirês à la déclinaison en i, c’est-à-dire aux thèmes vin, duomvvri, avec gouna {% s3o), comme nous avons ovês = omis venant de ovi. On arrive alors de la forme ês = dis à la forme eis (qui se prononçait probablement îs), par le meme principe qui nous a fait reconnaître dans fl du datif singulier (par exemple dans ped-î = sanscrit pad-ê) le dernier élément de la diphthongue ai, lequel a été allongé (§176). Le changement qui aurait fait passer dans la déclinaison en i des noms appartenant à la déclinaison en 0 serait de même nature que celui des thèmes annô, jugô qui en composition s’affaiblissent en enni (§ 6), jugi (bimnis, bijugis) et font au nominatif pluriel masculin ennês, jugés au lieu de annî,jugî.
Devant les nominatifs ordinaires en î, la voyelle finale du thème est supprimée; on a equî, tstî, illî au lieu de equot, isloi,.illoi. Un fait analogue a lieu en lithuanien; tandis que pour les substantifs en a, qui correspondent aux substantifs latins en ô, la diphthongue est conservée, par exemple, dans wilkai «loups», il ne reste, pour les adj ectifs, que la seconde partie de la diphthongue ; exemple : ger'i «boni» (au lieu de gérai), du thème géra. En slave, la mutilation de la diphthongue a lieu aussi pour les substantifs et les pronoms; exemples : baskiî vlwki «ïupi» au lieu de vlükoi, du thème vlüko.; th ti «hi», onh oui «illi», des thèmes to, ono. Au contraire, le lithuanien, d’accord en cela avec le sanscrit, contracte dans la déclinaison pronominale la diphthongue ai en ë (qu’on écrit ordinairement te); exemple : te «hi» = sanscrit tê (gothique thai, dorién to/). Je regarde cette rencontre avec le sanscrit comme fortuite (comparez § 9, remarque); le borussien y reste d’ailleurs étranger : il a la dqdithongue ai, quelquefois ei ou oi, que le thème appartienne à un substantif, à un
PLURIEL. S 229.

k 3

adjectif ou à un pronom ; exemples : stai «o« » *, quai et quoi « qui » (interrogatif et relatif), tawai «patres», swintai «sancti», des thèmes sia, ha, tawa, swinta.
Le vieux haut-allemand, dans les nominatifs pluriels en question, contracte, d’après le § 79, la diphthongue ai en ê, à moins qu’il ne faille admettre que cet ê, comme voyelle finale, soit devenu bref (§81). Quoi qu’il eu soit, il a été long primitivement, en sorte que nous pouvons rapprocher l’article diê ou die du védique tyê, venant du thème 3Ï tya (§ 355).
S 239. Nominatifs védiques en usas. — Formes analogues en zend et en ancien perse.
Dans le dialecte védique, or trouve des nominatifs pluriels en usas venant de thèmes masculins en a et de thèmes féminins en à, par exemple, dêvasas de dêm «dieu», dumâ'sas de iûmd « fumée », pâmMsas de pâvaka «pure»2. A ces formes se rapportent les formes zendes en Vu*#*9 donhô (§ 56b), lesquelles se sont abusivement étendues à l’accusatif, par exemple, vëhr-kâonhâ «lupi, lupos». De même KsvaiwâovM, comme épithète de asyô «serpents», également à l’accusatif; de même encore mdiyàonhô3. La plupart des autres exemples, comme yasatâonU de yasata, qui signifie littéralement «digne d’être adoré», et qui est devenu ensuite le nom des génies perses (en persan ized),
1 Les pronoms, y compris l’article, ont une seule forme au pluriel pour le masculin et pour" le féminin, en sorte que stai ne représente pas seulement ol, mais encore ai, et que stans (comparez le gothique thans) équivaut à la fois à tous et à ■tis. De tan-s «il» (thème tanna) nous avons le nominatif pluriel tannei.
3 Comparez Bohtlingk, Chrestomathie sanscrite, p. 377. Ces formes s’expliquent, selon moi, par l’addition de la terminaison as à un nominatif pluriel dont la flexion avait, cessé d’être clairement sentie, à cause de la fusion de l’a ou de t'd du thème avec l’a de la désinence. C’est aussi l’explication de Burnouf ( Yaçna, notes, p. 7 ê )■
3 Ce mot (trentième ha du Yaçna) est régi par dadad «il donna», et tient ,a place du datif, comme l’indique la traduction de Nériosengh qui le rend par rrrpfwj; manuéyéb'yaR «hominibus» (voyez Burnouf, Inftm, notes, p, 83).
FORMATION DES CAS.


sont des nominatifs de thèmes masculins en a44; le zend ne présente pas, que nous sachions, d’exemple d’une forme féminine en âonhô.
En ancien perse, la désinence sanscrite âsas est devenue, suivant les règles ordinaires, âha; exemple : bagâha «dieux», du thème baga. Mais cette désinence peut être considérée comme archaïque, car elle n’est employée que pour ce seul nom; je rappellerai à ce propos ce que j’ai dit plus haut (§ i ^19) des accusatifs singuliers en n dans les mots qui servent à désigner en vieux haut-allemand l’idée de « Dieu », de « maître » et de « père ». Les autres thèmes masculins en a font leur nominatif pluriel en à, avec la suppression de s final qui est constante en ancien perse après un a ou un â (§ 11). Il y a, par conséquent, analogie entre . les nominatifs pluriels comme martiyâ «hommes» (proprement «mortels») du thème martiya (védique martya) et les formes du vieux haut-allemand comme wolfâ «loups». En effet, contrairement au gothique, le haut-allemand a perdu, dès sa plus ancienne période, le s du nominatif pluriel dans toutes les déclinaisons de substantifs (comparez § 92 ra).
§ a3o. Renforcement de la voyelle finale dans les thèmes en i et en u. ' — Nominatifs latins en ês.
Les thèmes en i et en «prennent en sanscrit le gouna :pdtay-as, sûndv-as au lieu de paty-as, sûrn-as.
Ce gouna a aussi été conservé par le gothique, mais dans sa forme affaiblie i (§ 27), lequel devient j devant u; exemple : sunju-s «filii» (au lieu de suniu-s venant de sunau-s). Cette forme serait inexplicable sans la théorie du gouna qui a été donnée (§27) pour les langues germaniques. Dans les thèmes en i,-cette voyelle se fond avec l’t du gouna et produit un i long (qui


dans l’écriture est représenté par ei, § 70); exemples : gastei-s, anstei-s, des thèmes gasti, ansti (comparez S 109”, 1).
En zend, les thèmes en u prennent ou laissent le gouna à volonté; exemple : pasoô ou pasav-ô. Les thèmes en i ne
paraissent avoir au nominatif que les formes frappées du gouna, au lieu qu’à l’accusatif le gouna est facultatif; exemples : vay-ô, de vi «oiseau»; saratustray-ô (vocatif), de saratmtri «soroastri-cus»; fravasay-ô, du féminin fravaêi (voyez le Glossaire du Ven-didad-Sâdé de Brockhaus).
Le lithuanien allonge IV et Vu final; exemples : awy-sv.moutons», en sanscrit dvay-as; smû-s «fiiii»1, en sanscrit sûndv-as.
Le latin, dans ses thèmes en u (quatrième déclinaison), remplace le gouna par l’allongement de Vu, en sorte que nous avons fructû-s par opposition au singulier fructü-s. Mais un i final est frappé du gouna, avec contraction de ai en ê (§ 5); exemple : ovê-s, pour le sanscrit dvay-as.
Nous avons dit plus haut (§ 226) que les thèmes terminés par une consonne prennent en latin, dans les cas en question, un i inorganique, et que, par exemple, vôcê-s, ferentê-s ne viennent pas de vôc, ferent, mais de vâci, ferenti : nous rappellerons à ce propos qu’un certain nombre de mots et de classes de mots terminés par une consonne, entre autres les thèmes des participes en nt, élargissent le thème par l’addition d’un i devant la désinence du neutre a et la désinence du génitif um, Les thèmes sanscrits yûvan «jeune» et svan «chien» ont reçu cette addition d’un i même au nominatif singulier (juveni-s, canî-s), tandis qu’au génitif pluriel ils en sont restés exempts. LV, étant la plus légère des voyelles primitives, est venu aussi s’ajouter dans d’autres idiomes de notre famille aux thèmes terminés par une consonne; ainsi, en lithuanien et en ancien
1 Voyez Schleicher, Grammaire lithuanienne, p. 190. — Kurschat (p. io5) met un n bref et , pour les thèmes en i, admet indifféremment la brève et la longue.
/,6 FORMATION DES CAS.


slave, les thèmes en n et en r ne tirent quun petit nombre de cas du thème primitif; la plupart viennent de thèmes en ni, ri. En borussien, les thèmes participiaux en nt ne tirent que le nominatif singulier masculin du thème primitif; les autres cas dérivent d’un thème élargi en nti. En vieux naut-allemand, sans parler d’autres dialectes germaniques, les noms de nombre dont le thème se termine en sanscrit par n forment leurs cas d’un thème en ni. Exemples : nominatif masculin r sibuni, niuni, zëhani; neutre : sibuni-u, niuni-u, zêmi-u. En arménien, la dénomination du nombre «dix» (nominatif singulier u,mJü tasn, thème tasan = sanscrit ddsan, instrumental lasam-b) n’a pas reçu d’addition à l’état simple; mais les noms de nombre composés, de «vingt» à «quatre-vingt-dix», ont élargi le thème par l’addition d’un i; exemple : q-san «vingt», instru
mental singulier q-sani-v1, datif—ablatif-g^nitif pluriel q-sani-z.
L’explication que nous avons donnée des nominatifs pluriels latins comme vôcê-s, ferentê-s, fratrê-s, est confirmée d une façon frappante par l’osque. 11 est vrai que nous n avons pas d exemple 45 46 47 48 49
PLURIEL. § 231.

'.7

dans ce dialecte de nominatifs pluriels de thèmes terminés par une consonne ; mais au génitif singulier ces thèmes sont élargis par l’addition d’un i (S 189), et l’on a de bonnes raisons pour admettre que ledit élargissement n’est pas borné au génitif, mais que IV de l’accusatif medikim appartient au thème et n’est pas le représentant de l’a sanscrit et de l’a grec des formes comme Mrant-am, (pépovr-ot. Peut-être aussi IV de l’ablatif prœsentid (S 181) et des formes semblables n’appartient-il pas à la désinence, mais au thème. Quant au datif medikei, on peut aussi bien le faire venir de mediki que de medik, car les thèmes en i ont le datif terminé en ei.
H me reste à faire observer que dans le dialecte védique les thèmes en i et en u peuvent à volonté prendre ou laisser le gouna au nominatif-vocatif pluriel; exemples: ary-às, mumuksv-às,pâ-rayisnv-às, de arl, mumukêû, pârayisnü (voyez Benfey, Grammaire sanscrite développée, p. 3o5). Si l’on fait abstraction du changement euphonique dé i, u en y, v, ces formes correspondent parfaitement aux formes grecques comme 'sia-i-ss, véKv-es. A l’égard du zend, je remarquerai encore qu’au lieu du gouna de lVt on trouve aussi le vriddhi, en d’autres termes âv au lieu de av; exemples : dainhâvô «provineiæ», et dainhvô (de
dainhu) ; de même danhâvô et danhvô «provineiæ», de
danlm. On a un exemple du vriddhi de IV au lieu du gouna dans irâyô, nominatif de iri «trois».
§ a3i. Nominatif pluriel,des thèmes neutres, en zend, en gothique, en grec et en latin.
Les neutres ont en zend, comme dans les langues congénères de l’Europe, un a bref pour terminaison50 : c’est peut-être un
U8 FORMATION DES CAS.


reste de la désinence complète as appartenant au masculin et au féminin ; le s aura été supprimé comme ayant un caractère trop personnel pour le neutre. Cet a est conservé à 1 accusatif (comparez l’accusatif masculin et féminin qui fait ordinairement as, zend ^ ô, as'-c'a); exemples : asavan-a épura n,bërësant-a «magna, alta» (littéralement «crescentia»), me-a «verba», nar-a «homines». Dans les thèmes en a la désinence se fond avec
thique, le grec, etc. (Nouveau Journal asiatique, III, B09, 3io). Mais dans les formes comme huniata «bene cogitata», hûUta «bene dicta»,Ion ne peut pas bien reconnaître si l’a appartient au thème ou à la terminaison; en effet, la vraie terminaison aurait pu tomber et être remplacée par le thème, avec allongement ou non de la finale. Il fallait donc examiner des thèmes ayant une autre lettre finale, et principalement des thèmes finissant par une consonne. Mais il se présente cette circonstance inattendue que le zend, sans tenir compte du genre qu’un nom a au singulier, le fait ordinairement du neutre au pluriel; la langue est allée si loin, à cet égard, que, pour les nombreux thèmes finissant en a, le nominatif pluriel masculin s’est perdu (sauf les formes en âonhô mentionnées au S 339), et que 1 accusatif pluriel masculin est rare. Nous avons, par exemple, maéya «homme» qui fait au nominatif pluriel maéya (avec éa : iHaiyâ-ca) ; je considère maintenant cette forme maéya ou maiyâ comme appartenant au neutre, et non comme une forme mutilée pour mai-ydo, qui viendrait lui-même de maêyâs (S 56 k), car nous ne voyons nulle part dans la grammaire zende * a ou » â pour â>. Ce changement de genre s explique très-bien, car devant l’idée de pluralité s’efface sensiblement l’idée de genre et de personne, la personnalité individuelle étant absorbée dans la conception abstraite et inanimée du nombre. Nous avons, par exemple, td nar-a yd «ces hommes qui», ou nar-a est évidemment du neutre, comme l’indiquent les pronoms qui l’entoürent : si nar« était du masculin, U faudrait té et yé ou yôi. De même vaé «mot» fait â l’accusatif pluriel vaé-a, et, avec le pronom, aita vaêa. De aéavan «pur», on rencontre très-souvent le pluriel neutre aéavan-a. Cette forme nous indique, si elle vient en effet du thème en n et non du thème inorganique et rare aiavana, que les trois cas semblables du pluriel neutre sont, en zend comme en sanscrit, des cas forts, car aux cas faibles le thème aéavan se contracte en aiaun ou aidun (S i3l).
Il faut remarquer du reste que les pronoms et les adjectifs ne subissent pas toujours le même changement de genre que les noms auxquels ils se rapportent : il en résulte une véritable confusion, qui n’a pas peu contribué à obscurcir ce problème. On trouve, par exemple, tisarô (féminin) iata «trois cents» et iatwâré (masculin) sala «quatre cents», quoique iata (nominatif singulier iatim) soit évidemment un neutre. ,
PLURIEL. S 232. A9


la voyelle du thème; mais la qui en est résulté a été abrégé dans l’état où le zend nous est parvenu, suivant une loi de cette langue dont il a été souvent question. L’a long ne s’est conservé que dans les thèmes monosyllabiques et devant les particules annexes. Le gothique et le zend se correspondent à cet égard d’une façon remarquable, car on dit thâ «bæc» (au lieu de thâ, §69), venant àe thaa, hvô « quæ » au lieu.de /waa; mais avec a bref daura, de daura; de même, en zend, mp tâ «hase», ! yâ
rquæ», mais *** aga «peccatà», venant du thème aga. Il ne faut donc pas dire du gothique que l’a du thème est tombé devant la désinence, car il, ne pouvait pas tomber, la voyelle du thème et la désinence ayant été fondues ensemble dès le principe. Mais la longue primitive a pu être abrégée : c’est le sort ordinaire des voyelles longues, surtout à la fin des mots. On ne dira donc pas non plus que dans le grec rà Sâpct et dans le latin dona, Va appartient à la désinence. Cet « est un héritage des plus anciens temps, de l’époque où ce que nous appelons la seconde déclinaison avait ses thèmes terminés en a. Cet â devint depuis 0 ou e en grec (§ 20&), u, 0 ou e en latin; le son a n’est demeuré qu’au pluriel neutre, où Yâ, résultant de â + â, s’est abrégé. Tél qu’il est cependant, cet a qui contient à la fois, la voyelle finale du thème et la voyelle de la désinence peut être regardé comme une terminaison plus pesante que si nous avions des pluriels neutres comme Sapo ou Sape, donô ou donë.
S a32. Nominatif pluriel dès thèmes neutres terminés par u, en zend • \ et en .vieux liaut-aUenfind.
Devant la désinence neutre a, les thèmes zends en u p; ennent le gouna', ou bien ils changent simplement Vu en v. Comme forme marquée du gouna on peut citer yàtav-a, venant de yâtu «magie». Au contraire, il n’y a pas de gouna dans pësô-tanv-a,

50

venant depësô-tanu, littéralement «l’arrière-corps», et par extension «coup appliqué sur l’arrière-corps1». La désinence du pluriel neutre a est supprimée dans vôhû «richesses», du thème vôhu: mais elle est remplacée par l’allongement de Vu.
Le vieux haut-allemand a affaibli la terminaison primitive a en u; dans les thèmes numéraux en i, on a les formes neutres (lri-u « trois », fieri-u « quatre », finfi-u (finui-u = finvi-u) « cinq », sehsi-u « six », sibuni-u « sept », niuni-u « neuf », zêni-u « dix ». Dans toutes les autres classes de mots le vieux haut-allemand a perdu la terminaison du pluriel neutre u; il a, par exemple, hërzun «corda», pour le gothique hairtân-a (§ 1&1). Dans les thèmes substantifs en a il a également perdu la voyelle du thème; exemple : wort pour le gothique vaurd-a, venant de murda-a. Sur les formes comme hûsiru « maisons », voyez Sait.
S 233. Nominatif pluriel des thèmes terminés par as, en zend.
Les thèmes neutres terminés en »« as (= sanscrit as), qui devraient avoir comme désinence, au nominatif-accusatiî-vocalif pluriel, anh-a2, finissent, au contraire, en pu âo; exemples : pufiLtt) raucâo «lumières», pujuut? vacâo «mots», des thèmes ramas, vacas. Mais je ne puis voir dans âo une véritable terminaison : je crois plutôt que la vraie désinence a est tombée et que le thème a conservé l’allongement de la voyelle du thème, laquelle doit être allongée aux trois cas forts du pluriel (§ 129). En effet, le mot vacas fait en sanscrit, au nominatif-accu- 51
PLURIEL. S 234.

51

satif-vocatif pluriel, vdcàhs-i (avec insertion d’une nasale,§234): en zend, cette forme devrait être représentée par va-
câonh-a, ce qui nous donna, après la suppression delà désinence
casuelle, vacâo. Il y a le même rapport à peu près entre vacâo et la forme primitive vacâonha qu’entre le nominatif singulier, dénué de désinence, mâo «lune» (venant de mâs) et l’instrumental mâonh-a1. Ce qui fera encore mieux com
prendre le fait en question, c’est le double nominatif pluriel du thème masculin vanlm-dâé «qui donne le bien» (par euphonie vanhu-dâo) : on trouve à la fois la forme dénuée de flexion vanhudâo, qui est semblable au nominatif singulier, également dépourvu de flexion 52 53, et, d’autre part, on a la forme vanhu-dâonhô, avec la terminaison ô = sanscrit as.
S 234. Nominatif pluriel des thèmes neutres, en sanscrit.
En sanscrit, au nominatif-accusatif-vocatif pluriel neutre, au lieu de l’a que nous avons en zend et dans les langues de l’Europe, nous trouvons un i : je regarde cet i comme l’altération d’un ancien a. C’est la même altération qui a eu lieu, par exemple, danspitar «père» (delà racinepâ «soutenir, gouverner»), comparé au latin pater, au grec mattfp, au gothiqueJadar.
Les voyelles finales brèves sont allongées devant la désinence casuelle f;i et l’on insère un n euphonique (ou « d’après le § 17b) entre le thème et la terminaison; exemples : danâ-n-i, mrî-n-i, mddu-n-i, de dâna, van, mddu. Dans le dialecte védique on trouve fréquemment, au lieu de à-n-i, la désinence mutilée â, par exemple, visvâ « omnia », au lieu de vis'vâ-n-i. On a de même dans les Védas, pour les thèmes tri « trois » et puru «beaucoup », à la fois les pluriels trî-n-i, puru-n-i et tri et puru. Mais peut-être ces
52 FORMATION DES CAS.


dernières formes, ainsi que v'tsvâ et les formations analogues, ne sont-elles pas sorties des formes en ni, mais, au contraire, appartiennent-elles à une époque où l’a était encore la désinence régulière en sanscrit, comme dans les langues classiques^ et comme en gothique, en ancien slave et en zend. La de vïs'vâ serait alors la contraction régulière de a-a (visva-a), et la longue de trî et de puni serait là pour compenser l’a qui est tombé après l’t et Yu du thème : on peut comparer à cet égard Yî et 1 u du duel, dans les thèmes masculins et féminins en i et en u
(S 2 1°). .
Les thèmes neutres terminés par une consonne, à 1 exception de ceux qui finissent par une liquide ou une nasale, se renforcent en sanscrit, dans les trois cas en question, par l’insertion d’une nasale1 ; en outre, les mots terminés par le suffixe as us ou is allongent la voyelle du suffixe; exemples : hfnd-i de hrd « cœur », dmaldmln de lanaUB « obtenant des richesses », mdnâiist de marias « esprit r cœur» (racine man «penser»), édksûnsi de cdkêus «œil» (racine càks «parler», dans le dialecte védique «voir»). On a, d’autre part, sans insertion de nasale, éatvâr-t de catvdr « quatre » (forme faible catùr), nôimân-i de ndman (forme forte nâmân) «nom». On peut comparer avec mmân-i (pour nàmàn-a) le zend nâman-a2, le latin nômin-a, le gothique namn-a\ l’ancien slave imm-a (de nimrn-a) et les formes grecques comme TciXav-a.
1 Cette nasale appartiendra à la classe des palatales, des dentales ou des labiales,
suivant la classe de la consonne finale du thème.
2 11 n’y a pas d’exemple, en zend, de cette forme, mais on la peut restituer par conjecture d’après le modèle de aiavan-a (S a3i). L’o des thèmes en an n’est pas allongé en zend, comme on le voit par l’exemple de aiavdn-a, nâmina. En général, le zend évite d’allonger la pénultième dans les formes de plus de deux syllabes.
2 pour namôn-a. On trouve, au contraire, la longue dans les formes comme hairtôn-a, augôn-a, gajukSn-a (S »4»). Ces dernières formes concordent mieux que namn-a avec le sanscrit nXmân-i.

PLUK1EL. S 235.
53
a35. Tableau comparatif du nominatif-vocatif pluriel.

Nous faisons suivre le tableau comparatif du nominatit pluriel : le vocatif pluriel lui est identique, sauf la règle relative à l’accentuation en sanscrit (§ 204); l’accusatif pluriel neutre est semblable au nominatif.
|
Sanscrit. |
Zend. |
Grec. . |
Latin. |
Lithuanien. |
Gothique. |
|
Masculin, ds'vds |
1 |
vulfôs | |||
|
tr A n |
nJpamihn | ||||
|
Masculin, iè |
tê |
vol |
is-tî |
tê |
thai |
|
equî |
pônai | ||||
|
dâla |
Siwpa |
dôna |
daura | ||
|
Féminin. âsvâs |
hisvâo |
§ 228“ |
§ 228* |
aêwâs |
gibôs |
|
Féminin. lâs |
tâo |
S 228* |
S 228” |
t08 |
tkôs |
|
Masculin. pdtay-as |
patay-ô57 |
môai-es |
hostê-s“ |
ghity-s |
gastei-s |
|
Féminin . prîïay-us |
âfrîtay-ô |
■aôpTi-es |
lurrê-8 . |
dtivy-s |
anstei-s |
|
Neutre. . varî-ip-i |
var-a? |
tSpt-a |
mari-a |
lhrij-a1 | |
|
Féminin. Mvanty-as | |||||
|
Masculin, sândv-as |
f A 8 pasav-o |
véwi-ss |
pecu-s |
sânü-s |
sunju-s |
|
Féminin. hdnav-as |
tanav-ô ° |
yévv-ss |
socrû-s |
...... |
handju-i |
|
Neutre. . mâdu-n-i |
madv-a 10 |
péOv-a |
pecu-a |
Féminin . vad'v-às

54
FORMATION DES CAS.
|
Sanscrit. |
ZcikL |
Grec. (S6(/r)-ss vâ(F)-ss |
Latin. 2 |
Lithuanien. |
Gothique. |
|
Mas.-l'ém. gav-as Féminin . nav-as |
^ eu-s | ||||
|
A r A |
3 | ||||
|
Féminin . vac-as Masculin. Bârant-as Masculin, dsmân-as Neutre. , tlamân-i |
vac-o |
OTÏ-SS |
fijand-s | ||
|
aéman-ô A tg |
Salpov-ss Tà\ou>-a |
nômin-a |
dkmen-s |
ahman-s namn-a | |
|
nuttiüH-a |
5 | ||||
|
Masculin . uratur-ud ui wtw# -v Féminin . duhilàr-as dugdhr-6 |
$vyoiTép-es |
, duliler-s | |||
|
Masculin, aaiar-as Neutre. . vdc'âns-i |
auiur-v |
énefo)-* |
gener-a |
\ | |
|
vacao | |||||
ACCUSATIF.

S 236. De la terminaison ns de l’accusatif.
Les thèmes masculins terminés par une voyelie brève prennent en sanscrit un 11 et allongent la voyelle finale du thème; exemples : ddvâ-to, pdtî-n, sûniï-n, etc. On pourrait soupçonner une parenté entre ce n et le m de l’accusatif singulier, de même que dans le verbe la terminaison âni (première personne du singulier de l’impératif) est évidemment sortie de âmi.
Mais les dialectes congénères confirment la conjecture sagace de J. Grimm, qui reconnaît dans le n de l’accusatif pluriel masculin sanscrit un reste de ns. Cette désinence ns est conservée entièrement en gothique , dans les formes comme dulfa-m, gas- 64 65 66

55
li-m, swm-ns. ToufSais, dans la plupart des autres langues, l’une ou l’autre partie de cette terminaison s’est perdue : ainsi, en sanscrit, la seconde consonne a dû tomber (§ 94), et en compensation la voyelle finale du thème a été allongée; dans le grec ïnirovs, au contraire, la sifflante est restée, mais le v a pris le son plus fluide de l’y. 11 y a le même rapport entre 'innove et ïmtovs qu’entre nwlouai et tmlovai, venant de tuîr-nvti. Ces formes d’accusatif comme 'iitttovs, dont, dans la première édition de cet ouvrage, j’avais conjecturé 1 existence par induction, se sont en réalité conservées dans les dialectes crétois et argien, bien que jusqu’ici on n’en ait qu’un petit nombre d’exemples1. La forme iàve répond parfaitement au gothique tha-ns. Le borussien, mieux conservé à cet égard que le lithuanien, a des accusatifs comme deiwa-ns « deos d en re

gard du lithuanien dëww-s et du sanscrit dêva-n. Le borussien deiwa-ns est donc avec le lithuanien dëœu-s d|ns le meme rapport que t6-vs avec la forme ordinaire tous. De la foime cré-toise tspeiyevTclvs, mentionnée par Ahrens, je ne voudrais cependant pas tirer avec lui cette conclusion'que, dans la première déclinaison, non-seulement les masculins, mais encore les féminins avaient la désinence <x-vs. En effet, les masculins et les féminins de la première déclinaison sont plus éloignes les uns des autres, quant à leur origine, en grec quen latin, et il y aurait de bonnes raisons pour faire, d’après le genre des mots, deux déclinaisons de la première déclinaison grecque. Ce qui est certain, c’est que les accusatifs pluriels des thèmes féminins de la première déclinaison grecque correspondent en sanscrit et en gothique à des accusatifs sans n; ces deux dernieres langues ont s pour toute désinence casuelle65.
1 Voyez Ahrens, De gmetslinguœ dialecUs, II, S 1 h, 1.
' En borussien, te masculin a substitué ses formes à celles du féminin dans tous les cas du pluriel; on a, par exemple, germai «femûuea et genna-m «feminas», qui
OC. I
&<; FORMATION DKS'CAsj.


Quant aux formes éoliennes comme*' ufya'Aate, Tenais, vûfi-(pate1, on peut admettre qu’elles ont suivi l’enalogie des masculins comme rois, e/Ipatâyote, vipote (venant àmive, <rl paidyove, v6-pove), sans être obligé de conclure, pour les formes féminines en aie, quelles dérivent de formes plus anciennes en ave. Je me contenterai de rappeler pour le moment les datifs féminins* en aie, anciennement at-crt, qui forment le pendant des datifs masculins en ote, otcrt, quoique en réalité le masculin seul ait,droit à l’i, comme on le voit par le sanscrit, où nous avons au m^cuKn seulement la diphthongue ê—ai(§ 25i). Mais s’il n’en estpas ainsi, et que les accusatifs féminins éoliens en a*e soien* réeliement sortis d’anciennes formes en ave, de lâ même façon que le dorien fjiéXate est venu de fjéXave, rvÿate de Tiityave, alors le grec surpasse sous ce rapport en antiquité le sanscrit et le gothique ; en effet, le sanscrit ne prend jamais le n dans les accusatifs féminins, et le gothique, s’il a des accusatifs féminins comme ans-ti-ns, handu-m, n’a du moins pas (et c’est de quoi il s’agit surtout ici) de formes comme gibâ-ns; la forme gothique est gibô-s. C’est donc à la période primitive qu’îi faudra rapporter, dans cetle hypothèse, la désinence ns, comme ayant appartenu d’abord à tous les accusatifs pluriels masculins et féminins. Dans ce groupe ns, je considère le s comme la vraie marque du cas ou de la personnalité (comme au nominatif singulier, et pluriel), et j’admets qu’ici, comme à la troisième personne du pluriel des verbes, la pluralité est exprimée symboliquement par un élargissement de forme, à savoir par l’insertion d’une nasale; cette insertion n’a guère plus de valeur qu’un simple allongement de voyelle. On peut donc comparer les accusatifs grecs comme innove, venant de innove, avec les formes comme
sont de véritables masculins, quant à la forme, et qui correspondent aux masculins comme deiwai «dii», deiwa-m «deos».
1 Hartung, Des Cas, p. a63; Ahrens, De grœcœ lingua dialectis, 1, p. 71 et suivi

57

<pépovvi, venant de tyépovcrt, qui lui-même est pour (pépovn s sanscrit Bdranti, et l’on peut mettre en regard de ce pluriel la forme du singulier Mr-a-ti. ^
La forme primitive ns a donné naissance, dans le sanscrit ordinaire, à une double série de désinences : les thèmes terminés par une voyelle (excepté les monosyllabes) ont seulement le n s’ils sont du masculin, et seulement le s s’ils sont du féminin; exemples : dsvâ-n «equos» (de asm), dsvâ-s «equas» (de dsm); pdti-n «dominos» (depdti), prî'tî-s «gaudia» (deprftî); sûniï-n «filios» (de sûnû'j, hdnû-s «maxillas» (de hdnu). On voit par ces exemples que les voyelles brèves s’allongent devant la désinence en question. Cet allongement concourt avec la nasale à élargir le thème et à exprimer la pluralité; j’avais supposé dans la première édition que l’allongement dans les formes comme as'vâ-n, patî-n, sûnû-n compensait la perte d’une partie de la désinence casuelle ; mais cette hypothèse doit être retirée depuis que la publication des Védas1 a fait connaître des thèmes en i et en u terminés à l’accusatif pluriel en tir, comme fàri^Ç giri-nr, rtu-iîr, venant de girl «montagne», rté «saison». Ce Br ne se trouve dans les textes védiques que devant des voyelles ou devant un ^ y, un ^ v, ou un| h, c’est-à-dire devant des lettres qui exigent le changement euphonique d’un s final en r; nous sommes donc autorisés à regarder le r comme le remplaçant d’un s, et à rapprocher les foriïics primitives comme giriks, rtuns des accusatifs gothiques comme ga&ti-m, sunu-ns ■
1 Commencée par Fr. Rosen, qui a publie le premier livre du Rigvéda (Londres, i838). [One édition complète du Rigvéda a été entreprise depuis par M. Max Mülter. Londres, i8ég—186a. Une autre édition, en caractères latins, a été donnée par M. Anfrecht, tomes VI et VII des Études indiennes de M. A. Weber. — Tr.]
8 Le Prâtiçâkhya du Rigvéda regarde, dans les formes analogues à celles que nous venons de citer, r comme tenant la place d’un n dans la langue ordinaire; mais alors le n de girih, rttin serait représenté doux fois dans gïrî-fir, rtff-Hr, une fois par r et
58 FORMATION DES CAS.


Le latin a, dans ses thèmes masculins en o, à l’accusatif pluriel, ô-s : si l’on rapproche cette forme du grec ou-s, venant de ov-s, on reconnaîtra dans l’allongement de l’o une compensation pour la perte de n, et l’on verra dans equô-s, venant de equo-ns, le pendant des formes doriennes comme ràs v6(ico$, venant de Tbvs véfiovs, et non de toùs vipovs. Dans la première déclinaison , equâ-s répond au sanscrit dsvâ-s, aux formes grecques comme X&Spâ-s, aux formes gothiques comme gibô-s (de gibâ-s) et lithuaniennes comme âswa-s; toutefois, l’a lithuanien est bref, ce qui vient, je crois, de ce qu’il représente simplement la de asvâ-s «equas», à la différence de 1*8 = à du nominatif, qui représente â + a de ds'vâs (venant de dsvâ-as). Pour la même raison nous avons à l’accusatif pluriel des thèmes lithuaniens en i, tant masculins que féminins, la désinence i-s, qui répond au sanscrit î-s pour les féminins, î-n pour les masculins ; exemple : awï-s, qu’on peut comparer au sanscrit dvî-s, de dvi (féminin) «brebis»; au contraire, au nominatif, nous avons en lithuanien î-s (qu’on écrit y-s) en regard du sanscrit ay-as; exemple:* âwy-s (prononcez àwï-s), en sanscrit dvay-as. Il en est de même pour les thèmes lithuaniens en u, lesquels sont tous du masculin ; ils ont à l’accusatif pluriel u-s au lieu du sanscrit û-n, venant de û-ns, mais au nominatif ils ont ü-s au lieu du sanscrit av-as; exemple : smit-s = sanscrit sûniï-n(s) « filios », mais au nominatif sûnü-s = sanscrit sûndv-as «fdii». Les thèmes masculins en a ont, en lithuanien, affaibli cet a en u devant le s de l’accusatif; exemple : dëwù-s, en regard du sanscrit dèm-n(s) et du borussien deiwa-ns.
Retournons au latin; il y a identité dans cette langue entre
une autre fois par la nasale qui le précède (voyez Roth, Littérature et histoire du Véda, p. 72, et Regnier, Journal asiatique, 1856, II, p. 968 et suiv.). L’explication que nous avons donnée plus haut est encore confirmée par le zend (S 289), sans parler des langues européennes.
PLURIEL. § 237, 1.

59

le nominatif et l’accusatif pluriels pour les thèmes en u (de la quatrième déclinaison) et pour les thèmes en i, ainsi que pour les thèmes terminés par une consonne et élargis par l’addition d’un i; il est difficile de décider si cette identité extérieure vient de ce que le nominatif est en même temps employé comme accusatif, ou si à l’accusatif le thème a été élargi pour compenser la perte de n. Dans cette seconde hypothèse, Yê des thèmes en * serait pour a + i; quant à fructû-s, il serait pour fructu-m, à peu près comme en grec le nominatif singulier Seixvô-s est pour Sstxvtv-s (thème Ssixvvw) et fiéXâ-s pour fiéXdv-s. Je préfère cette seconde explication, ne voulant pas, sans nécessité, supposer que le latin ait perdu les accusatifs pluriels en question, quand les formes correspondantes subsistent encore dans le lithuanien d’aujourd’hui.
S 237, i. La désinence de l’accusatif pluriel as, en sanscrit et en grec.
Les thèmes terminés par une consonne, ainsi que les thèmes monosyllabiques finissant par une voyelle, prennent, en sanscrit, as comme désinence de l’accusatif pluriel; exemples : pdd-as, nav-as, qu’on peut comparer au grec isiS-as, vâ(,F)-a$ (dorien). L’a n’est très-probablement ici, comme au singulier (pdd-a-m, ndv-a-mj, qu’une voyelle de liaison, laquelle était indispensable pour les thèmes terminés par une consonne, surtout a 1 époque où la désinence était encore précédée d’une nasale; en effet, padr-ns serait aussi impossible à prononcer qu’à la troisième personne plurielle vid-nti, au lieu de vid-d-nti « ils savent », quoique vid-nti soit bien la forme qu’il faudrait pour correspondre à la première personne vid-mds, à la deuxième personne vit-ta.
Les mots monosyllabiques dont le thème est terminé par une voyelle longue suivent en sanscrit sur beaucoup de points la déclinaison des thèmes terminés par une consonne; il en est de même en grec des thèmes en 1, v, eu, ou, au. Les accusatifs
g0 formation des cas.


pluriels sanscrits comme brûv-a-s, bîy-a-s, venant de bru « sourcil », bî « crainte », ne doivent donc pas causer plus de surprise quen grec les accusatifs comme isSat-a-s, ■aopri-a.-s, véxv-ct-s, yé-rv-a-s, d’autant plus que si la voyelle de liaison manquait, 1 accusatif pluriel serait semblable au nominatif singulier. Pour le petit nombre de polysyllabes féminins dont le theme se termine en il, il arrive en sanscrit que les deux cas sont, en effet, semblables : ainsi vadïï-s signifie aussi bien « femina » que « feminas » ; pour les polysyllabes féminins dont le thème finit en î, les deux cas sont différents, grâce à cette circonstance fortuite que le nominatif singulier a perdu son signe casuel; exemple : nart «femina», nârî-s «feminas» (S 187). Mais, dans le principe, le nominatif singulier a dû être nârî-s et l’accusatif pluriel nârî-hs, ou plutôt nârî-ns, avec la nasale pleine au lieu de l’anousvâra.
S ü37, 2. Accusatif pluriel des thèmes terminés par une consonne, en gothique.
Le gothique a perdu à l’accusatif pluriel la voyelle de liaison a après les thèmes terminés par une consonne (comparez § 67 )* il a de même perdu le n qui appartenait à la désinence de l’accusatif. On peut comparer fijand-s (defijand «ennemi», littéralement «celui qui hait»), alman-s (de ahmin «esprit») aux formes grecques comme 0épovr-a-s, Sa.tfi.ov-a.-i, et aux formes sanscrites comme barat-a-s (pour bdrant-a-s. § 129), asman-a-s. \
g aB7, 3. Accusatif arménien. — Pronom servant à marquer la relation casuelle. — Fait analogue en ancien perse et en zend. — Origine de l’t isâfet persan.
L’arménien a dans toutes les classes de mots un simple s comme désinence casuelle de l’accusatif pluriel; il ne faut pas perdre de vue que dans cette langue, qui ne fait pas de distinction entre les genres, tous les mots déclinables sont proprement
PLURIEL. S 237, 3.

(U

des masculins. Nous pouvons, par conséquent, rapprocher des formes gothiques comme ahman-s l’accusatif arménien ml^iuUu (ikun-s1 «oculos», venant du thème akan, quoique, en sanscrit, le mot congénère soit du neutre. Du thème esin «bœuf» (nominatif-accusatif singulier em), forme afl ai blie pour esan, vient esin-s, qui correspond au gothique aulisan-s et au sanscrit ùksan-a-s. Les thèmes terminés par une voyelle suppriment la voyelle finale comme dans d’autres formes de la première série de cas2; exemple : wnasakar-s «noxios», littéralement «noxam facientes », au lieu du sanscrit vinâsa-karâ-n(s) ; rapprochez-en les formes gothiques comme vu]fa-ns et les formes lithuaniennes comme dêwu-s. Du thème «I/r oli «serpent», mentionné plus haut (§ ai5, 2), vient l’accusatif pluriel ôl-s, qui correspond au sanscrit âhî-n(s), au lithuanien angi-s, au grec éfci-a-s, ainsi qu’aux formes gothiques comme gasti-ns, ansti-ns. On voit que l’arménien également confirme le fait que. nous avons énoncé : à savoir que les accusatifs pluriels sanscrits en n ont été précédés de formes en hs ou ns. Si le s du nominatif pluriel sanscrit est ordinairement devenu en arménien.£ q (§ 216), tandis que le s de l’accusatif est resté, cela vient sans doute de la lettre n qui, dans une période plus ancienne, aura aussi précédé en arménien le s de l’accusatif pluriel, et l’aura ainsi préservé du changement en q.
1 Avec u pour a dans la syllabe finale, comme au nominatif (S aaô).
» On peut diviser les cas arméniens en deux classes : je range dans la première le nominatif-accusatif-vocatif des deux nombres ; tous les autres cas appartiennent à la seconde. La première série de cas supprime, dans les thèmes terminés par une voyelle, cette voyelle finale, au lieu qu’en gothique les thèmes en a et en i ne suppriment la voyelle qu’aux trois cas susdits du singulier. La deuxième série de cas arméniens supprime dans beaucoup de mots une voyelle à l’intérieur du thème, sans qu’il soit possible d’établir à cet égard une règle précise. Aux exemples mentionnés ci-dessus j’ajouterai encore ici le thème miso «chair», dont l’o final, qui répond aie sanscrit de mâiuâ, est supprimé dans la première série de cas, tandis que dans la seconde série le thème est mso, par exemple au datif-ablatif-génitif pluriel mso-i.
f)2 formation des cas.


Quant au q ? qui, au singulier comme au pluriel, est placé devant l’accusatif arménien, c’est, selon moi, un article dont l’usage est borné à ce seul cas; ou, en d’autres termes, cest un pronom, ce qui ne l’empêche pas de se combiner avec les autres pronoms, tant définis qu’indéfinis, comme on le voit par l’exemple de s-is, s-qes, c’est-à-dire littéralement «hune me, istum te». Il faut se rappeler à ce sujet qu’en sanscrit on dit, pour insister davantage, sn ’hx'm, c’est-à-dire littéralement «hic ego, oS’ êyeôv. Mais à l’exception des pronoms, le ^ s en question n’est préposé aux accusatifs que dans la déclinaison définie , qui, il est vrai, ne se distingue qu a 1 accusatif de la déclinaison indéfinie. On exprime, par exemple, «pain» (panem) par liai, mais «le pain» [ihv apiov) se dit sliai; au contraire, le nominatif haz représente aussi bien Apios que o apios et le génitif hazi représente Apiov aussi bien que iov Apiou. le ne puis donc pas approuver tout à fait l’usage où l’on est de placer toujours un t ? devant l’accusatif des deux nombres, dans les paradigmes des grammaires arméniennes : cela tend a faire . croire que cette lettre est l’exposant du rapport marqué par l’accusatif, au lieu qu’en réalité le rapport casuel n’est pas plus exprimé en arménien qu’il ne l’est en gothique dans les formes comme vulf «lupum», gast «hospitem», smu «filium». A proprement parler, l’emploi du préfixe arménien ^ ? relève de la
syntaxe. ;
Si nous nous posions la question de 1 origine de cet article
préfixe, il est difficile d’arriver sur ce sujet à une réponse certaine. Il ne faut pas songer au thème sanscrit sa «il, celui-ci, celui-là», d’où vient le nominatif de l’article en gothique et en grec, car jusqu’à présent nous navons pas dexemple dun ^ s sanscrit devenu en arménien un q s. Mais comme on rencontre 67
PLURIEL. 8 237, 3. 03


,L g tenant la place d’un \y sanscrit, et comme nous avons reconnu plus haut (S a 15, î) que cette lettre représente en arménien la désinence du datif sanscrit Byam dans tü-Byam, il ne me paraît pas invraisemblable d’admettre que l’article préfixe arménien contient le y renfermé dans le pronom démonstratif sanscrit lya (nominatif sya). C’est ce pronom qui a aussi pris en haut-allemand et en vieux saxon l’emploi de l'article, et c'est le même qui en ancien perse se rencontre dans des constructions où, selon moi, il s’explique le plus naturellement comme article. On le trouve : i° devant des substantifs placés comme apposition à côté d’autres substantifs; par exemple: gaumâta liyn magm «Gaumàta le Mage», accusatif gaumâtam tyam magum; 2° devant des adjectifs se rapportant à un substantif qui précède; exemples : kâra hya bâbiruviya haruva «populus à Babylonicus totus»67; kâra hya ïiamtriya «populus b iniinicus»68 69; plus bas: avant kâram tyam hamitriyaîti «ilium populum tbv inimicum»; 3° quelquefois devant des génitifs suivis du substantif par lequel ils sont régis; exemples : hyâ (féminin) amakam tauma «notre race», littéralement «rà vptûv yévosn70; hya Icuraui putra «o Ku-'pov viés»71 72 73; 4° très-souvent comme article postposé après des substantifs au nominatif ou à l’accusatif singulier, lesquels sont suivis par un génitif qu’ils régissent, ou par ùn locatif tenant la place du génitif; exemples : kâra hya nadîtabirahya «exercitus b Nadïtabiri»5; avant kâram tyam nadttabirahyâ «ilium exercitum jbv Nadïtabiri»0; avant kâram tyam bâbirauv (locatif) «ilium populum tBv Babvlone»74. Mais si le substantif dont dépend le
64 formation des cas.


génitif ou le locatif est à un autre cas qu’au nominatif ou à l’accusatif, il n’est pas suivi de l’article; l’ancien perse se rapproche beaucoup sous ce rapport de l’arménien, qui limite l’emploi de son article préfixé à l’accusatif des deux nombres.
Au contraire, le persan moderne fait un usage plus étendu de IV isâfet, lequel vient s’ajouter aux substantifs qui sont suivis d’un génitif ou d’un adjectif. Lassen a reconnu le premier75 dans cet i isâfet un pronom, et il l’a fait venir du pronom zend ya. Gomme le pelilvi, le pârsi et le persan moderne tiennent de plus près à la langue des Acbéraénides qu’au zend, il me paraît plus vraisemblable de faire dériver cet i de tya ou de hya que
du zend ya- t
Ce dernier pronom peut remplir également 1 emploi dun
article postposé; construit de cette façon, il se décline ou bien il paraît sous la forme du nominatif-accusatif neutre yad, lequel tient alors, comme mot indéclinable, la place des cas obliques. Exemples : ahmi nmânê yad mâsdayasnôis «dans cette maison la masdayasniennè fl ; Imca amnhâd tanvad yad daivôgatayâo «de ce corps le frappé par les daivas»2; ratavô asahê ya$ vahistahê ^ « domini puritatis ?îs sanctissimæ ». Uni à un accusatif masculin ou féminin, yad est moins usité; on emploie de préférence alors la forme yim pour le masculin, yahtn pour le féminin; exemple : yô sanad asîm s'ravarëm yim aspô-garëm nërë-garëm ym visa-varitëm ’sairitëm (ce derqier mot est le sanscrit hdntam) «qui tua le serpent rapide, le dévorant chevaux et hommes, le venimeux, vert»3. ■
Si, dans cet endroit et dans d’autres constructions semblables , on voulait considérer yim comme un relatif, ainsi que le fait, mais à tort, Nériosengh, qui traduit ce mot par le sans-


65
3.
crit yam *, il faudrait admettre une sorte d’attraction s’exerçant à la fois sur le relatif et sur l’adjectif qui le suit. La phrase en question devrait alors se traduire ainsi : «qui tua le serpent rapide, lequel [était] dévorant chevaux et hommes, lequel [était] venimeux, vert». On pourrait expliquer de la même manière les constructions en ancien perse dont nous avons parlé; en effet, le thème tya (nominatif hya), qui est seulement démonstratif en sanscrit, est aussi employé comme relatif en ancien perse, où le relatif sanscrit "5T ya manque absolument. Mais les constructions de ce genre seraient languissantes et embarrassées; on aurait, par exemple, «Gaumâta lequel [était un] mage», au lieu de «Gaumâta le mage», et «peuple lequel [est] babylonien», au lieu de «peuple le babylonien». J’aime mieux, appliquant au zend l’explication qui a été donnée plus haut pour l’ancien perse, regarder le nominatif yô, féminin yâ, comme un article, dans les phrases où il se rapporte à un substantif ou à un pronom au nominatif singulier; le substantif suivant doit alors être considéré comme une apposition; exemples : asëm yô ahurô-masdâo, tûm yô ahurô-masdâo, hâ druUs yâ nas'us «moi le Ahura-Masdâs, toi le Ahura-Masdâs, cette Drug la Nas'u» et non «moi qui [suis] Ahura-Masdâs, toi qui [es] Ahura-Masdâs, celte Drug qui [est] Nas'u. »
Peut-être aussi le zend ya, là où il joue le rôle de l’article, ne vient-il pas du thème relatif sanscrit , mais du thème composé 76
0G FORMATION DES CAS.


m tya (formé de ta-ya), qui fait au nominatif W*ya (de sa-ya,
§ 853). En ce qui concerne la perte de la consonne initiale, on pourrait rappeler le sanscrit dvis a deux fois» et dvitîya «le second», qui sont devenus en zend bis, bitya (pour vis, vitya).
Quoi qu’il en soit, nous pouvons conclure de ce qui précède que l’ancien perse et le zend ont au moins les rudiments de l’article; que l’article perse est identique avec celui du haut-allemand et du vieux saxon; que l’arménien a un article quil emploie seulement à l’accusatif, et que l’i placé en persan devant le génitif et devant les adjectifs est un article se rapportant au substantif précédent76.
S a38. Désinence o, as et s en zend.
A la terminaison sanscrite as correspond en zend, pour les thèmes masculins et féminins finissant par une consonne, la terminaison 6; quand le mot est suivi de ca «et», au lieu de ô, l’on a as-ca. La désinence en question s’étend, comme en grec, aux thèmes en i et en u, avec ou sans gouna; ainsi, de gain «montagne» (par euphonie pour gari, S 4a) nous avons à la foisgarayçô et gairy-ô; de tri « trois », à la fois iray-as-ia « tresque » et iry-as-ca2; de ratu « maître» l’on a ra'twô et ratavô. Pour les thèmes féminins en i et en u l’on trouve aussi quelquefois les désinences ^ î-s, ^ ù-s, qui sont le pendant des formes sanscrites; exemples : gairî-s «montes», ërësu-s «pontes»3. Les
1 Cet t persan se joint dans l’écriture avec le nom précédent ; exemples :pedcr-i tu, littéralement ®«rdp ô aov, pil-i hmurb «él&thant le grand», pluriel piUn-i bmrk «éléphants les grands». En pehlvieten pârsi?T* se rencontre encore séparé,comme
un mot indépendant. g.
a Dans la langue védique on trouve aussi quelques accusatifs en a* formés de thèmes en t et en rt, et même de thèmes polysyllabiques en î : ainsi nadyàs au lieu de nadi-s, venant de nadï* fleuve». (Voyez Benfey, Grammaire sanscrite développée, p. 307.) ■r
;i Je tiens pour fortuite la ressemblance de ces accusatifs avec les accusatils grecs

PLURIEL. S 239.
67
thèmes féminins en î ajoutent simplement s; exemple : asaunî-s «puras».

S 1239. Désinences ah, ans et eus en zend.
Les thèmes masculins en » a, quand ils ne sont pas remplacés par le neutre (§ 2 31), ont à l’accusatif ah (comparez § 61); exemples : imah >■ hos », masistah «maxi
mes». Devant la particule «p ca, la sifflante est conservée; exemples : amësans'-ca «non conniventesque»,
mantrahs-ca «sermonesque», aismahs-ca
«lignaque », vâstryahs-ca « agricolasque ». La forme
$>•»&“ ataurumhs-ca « presbyterosque » mérite d’être remarquée; en effet, comme on n’a aucune autre raison d’admettre un thème atauruna, cette forme tendrait à faire supposer la flexion hs même pour les thèmes terminés par une consonne, auxquels elle serait venue se souder à l’aide d’une voyelle euphonique ; mais il est possible que cet accusatif ait été formé par erreur, à l’imitation des thèmes en a. Les accusatifs ■*}>{!*{ narëus «hommes» et s'trëus «stellas», très-fré
quemment employés, ont plus d’importance1. Comment s’explique cette désinence eus? Nous croyons qu’elle dérive précisément de a>£ ans; le h s’est vocalisé (comme dans \6yovs) et le ü « s’est alors changé en ^ ë; la sifflante, qui après a a ou £ on devait devenir un » s, a dû rester un ^ s après le > u. Nous trouvons d’ailleurs dans le Vendidad-Sâdé nër-ahs,
comme ©épris, yévvs; en effet, les formes grecques de ce genre ne se trouvent pas seulement au féminin et à l’accusatif; je regarde d’ailleurs les féminins sanscrits et zends terminés simplement par un s à l’accusatif comme des formes relativement récentes; les accusatifs gothiques comme ansti-ns, handu-ns, appartiennent à une époque plus ancienne.
1 Le mot âtar «feu» est une exception en ce qu’il fait à l’accnsalif pluriel âtr-û et non âtr-éut. Le même mot s’écarte au pominatif singulier de l’analogie des noms en )•, et au lieu de dla l'ail dtars.
KOI! MAT ION DUS CAS.

(18

qui ut* peut être qu’un accusatif, quoiqu’il soit employé dans le sens du datif : (Midi ad nSrahs masdâ ahurâ asaunô «da quidem liominihus, magne Ahure! pu ris».
Remarque. — Des formes védiques en fis. — Au zend nér-a-iis répond le védique qrp nffis, et, avec le visarga au lieu de s, rf: nfhK. Mais ces deux formes ne sont employées que devant un p initial; au contraire, nf”r se met devant les voyelles '. Comme équivaut dans la prononciation à rî, je propose l’explication suivante pour ces formes, comme pour les formes de la langue ordinaire telles que nfn—nrî-n trmosn, pilf-n = pitri-n «®aré-pas», dâlf-n = dâtrî-n aàoTrjp-as» : dans les thèmes où le r alterne avec ar ou âr, j’admets à l’accusatif et au génitif pluriels une mé-tathèse et un alfaiblissement des voyelles a, â en i, de sorte qu’on a ri, au lieu de ar, âr; pitrî-n serait alors formé de pitri à peu près comme en gothique on afadru-ns, venant de fadru, au lieu de fadra, venant defadar. Cette explication déjà donnée ailleurs m’a été confirmée par une forme unique sur laquelle Benfeys a le premier attiré l’attention : il y a dans le Mahâ-Bhârata77 78 79 un accusatif pitaras qui correspond parfaitement au grec 'acnépas. La forme zende nërahs est encore plus complète, en ce quelle suppose, en sanscrit, nar-a-ns, et, par conséquent, pour pitar, pitar-a-iu, auquel correspondrait en grec ssinép-it-vs. Aux formes zendes comme masistah «maximes» répondent les formes védiques en ân, au lieu de ân; nous rencontrons ces formes en ân dans les positions où les thèmes en e et en u prennent ifir, ûfir, au lieu de in, un; nous sommes donc autorisés à croire qu’après ce n il y avait d’abord Une lettre qui a nécessité le changement de la nasale pleine ^ n en une nasale affaiblie. De même les formes zendes en $ ait sont certainement redevables de la conservation de leur n à cette circonstance, quil y avait primitivement à la fin du mot un " s, lettre qui ne supporte devant elle aucune autre nasale que n (S 61). C’est par le même principe que s’expliquent les nominatifs singuliers védiques comme mahdîi emagnus» (devant une voyelle); ils témoignent de la présence d’un ancien signe du nominatif, à savoir r tenant la place •le s (comparez S 138). . •
PLURIEL. S 240.

00

$ ■),hu. La désinence du pluriel ân, en persan moderne, vient d’un ancien accusatif masculin.
Parmi toutes les lettres, c’est la voyelle a qui revient le plus fréquemment en sanscrit clans la désinence des thèmes masculins; d’un autre côté, l’histoire de notre famille de langues démontre que les idiomes vieillis et usés cherchent à introduire les thèmes terminés par une consonne dans la déclinaison des thèmes finissant par une voyelle, et ajoutent à cet effet un complément inorganique à la consonne finale. Ces deux faits me conduisent à croire que la désinence ân, usitée en persan moderne pour le pluriel, mais seulement après les noms d’êtres vivants, est identique à la désinence ân, usitée en sanscrit à l’accusatif pluriel masculin; ainsi yiày-o merdân «homines» répond à flcÎTV mdrtân « homines » 1.
En ancien perse, le n n’est pas marqué dans l’écriture à la fin des mots, ni au milieu devant les consonnes; lemestmarqué à la fin des mots, mais non à l’intérieur, s’il est suivi d’une consonné. Ainsi «Cambyse» est écrit kabugiya, et le nom de l’Inde (en zend hëndu) est représenté dans les inscriptions cunéiformes par hidu (lisez hindu). Mais si l’on voulait admettre que ces nasales, là où elles ne sont pas indiquées dans l’écriture, manquent en effet à l’ancien perse, la langue de Darius aurait des formes moins pleines que le persan d’aujourd’hui, puisque la forme moderne berend « ils portent» (en sanscrit Bdranti, en zend barënti, en gothique bairand) correspondrait en ancien perse à baratiy80 81 82. Il faudrait dès lors, d’après le même principe, renoncer à rapporter les pluriels modernes comme merdân aux accusatifs sanscrits en ân et aux accusatifs zends en ah, ans [ne-
70 FORMATION DES CAS.


rans). Il ne resterait plus qu a expliquer, comme le fait Spiegel1, ces formes y! An comme venant du génitif pluriel, lequel se termine en sanscrit en â-n-âm et en zend en a-n-ahm; mais cette explication me satisfait peu, car le génitif est beaucoup moins propre à prêter sa terminaison à tout un nombre que l’accusatif, comme cela ressort entre autres de la comparaison du pluriel espagnol en os et en as, et des pronoms possessifs français comme mon, ton, son, mes, tes, ses, qui viennent évidemment de meum, tuum, suum, meos, tuos, suos, et, au féminin, de meas, tuas, suas. En ce qui concerne le persan îéân «eux» (aùroi), que Spiegel2 ramène au zend aisahm et au sanscrit êsâm «horum», je le fais venir du thème TJCf êsd «celui-ci», qui ferait à l’accusatif pluriel êsân s’il avait la déclinaison complète, comme il paraît l’avoir en osque et en ombrien. Pour expliquer y- men «je», nous n’avons pas non plus besoin de recourir à un génitif (en ancien perse manâ, en zend mana); nous le rapportons à l’accusatif sanscrit et perse mâm. Le rapport de men à mâm est à peu près le même que celui du possessif français mon avec l’accusatif latin meum, ou celui des accusatifs grecs et borussiens en n avec l’accusatif primitif en m.
S ait. La désinence du pluriel hâ, en persan moderne, vient d’un ancien
pluriel neutre. —Comparaison des pluriels neutres en haut-allemand.
Si la terminaison yî ân, usitée pour les êtres vivant^, se rattache à une ancienne désinence masculine, la terminaison employée en persan moderne pour le pluriel des objets inanimés devra se rattacher à un ancien neutre. Nous avons un suffixe formatif principalement affecté au neutre, à savoir ’STfas (§ i a 8), qu’on rencontre encore plus fréquemment en zend qu’en sanscrit, si l’on a égard au petit nombre de textes zends qui nous sont
1 Journal de Hœfer, I, p. aao.
2 Recueil cité, p. aaa.
PLURIEL. S 242.

71

parvenus. Au nominatif-accusatif-vocatif ces neutres devaient être primitivement terminés en anha, ou, d’après le principe des cas forts, en âonha (comparez § a3i), et, avec suppression de la désinence casuelle, do (§ 2 33). En ancien perse, où il ne reste pas d’exemples de pluriel neutre de cette classe de mots, on aurait des formes en âhâ ou ahâ, attendu que l’a final, dans les mots qui de toute antiquité se terminaient en a, s’allonge en ancien perse. C’est là, selon nous, l’origine de la désinence persane U hâ usitée pour les pluriels des noms d’objets inanimés; exemple : rûshâ1 «jours», qui se divisait d’abord ainsi
A 1 A
rush-a.
C’est le même suffixe qui, en haut-allemand, sert à élargir au pluriel un grand nombre de thèmes neutres; mais le changement de s en r fait que les pluriels comme hûsir « maisons », chelbir «veaux», ressemblent plus aux formes latines comme gener-a, oper-a, qu’aux formes perses en /i-d ou aux formes sanscrites ep dns-t venant de aws-a (SS a3a et 2 34)83. <vtrv? jfâpWf
§ 2 4a. Tableau comparatif de l’accusatif pluriel.
Nous faisons suivre le tableau comparatif de l’accusatif pluriel 84.
|
Sanscrit. |
Zend. . |
Grec. |
Latin. |
Lithuanien. |
Gothique. |
|
Masculin, dsvâ-n |
aspa-h |
(mro-us |
equô-8 |
pônh-* |
vulfa-tu |
|
Féminin. dsvâ-s |
hisvâ-o |
X,d>pâs |
equâ-s |
âswa-s |
gibô-s |
|
Féminin . tâ-s |
tâ-o |
ré-s |
is-tâ-s |
tà-s |
thâ-s |
|
Masculin. pàti-n |
paiiy-â85 |
rsàtri-as |
hostê-s |
genti-s |
gasti-ns |
1 Comparez le thème zend raucai «lumière», nominatif-accusatif-vocatif pluriel rattcdo pour rauéâonha ou rauêanha, par euphonie pour rauéâha, rauéaha (S 56‘). 9 Comparez J. Grimm, Grammaire allemande, I, p. 6aa et 63i.
* Pour l'arménien; voyez S #37, 3. Pour les accusatifs neutres, voyez le tableau «lu nominatif, S a35. .
4 Onpalay-â; avec ca : paity-ai-ca, patay-ai-ca.

72
Sanscrit.
FORMATION DES CAS.
J 1
Féminin . Féminin . Masculin. Féminin . Féminin . Mas.-fém. Féminin . Féminin . Masculin. Masculin. Masculin. Féminin . Masculin. >
hdnû-s
vadu-s ..................
ffâs4 gâu-s5 @ô(F)-as °
nav-as .......vx(F)-ots ....
vite-as vâc-67 ân-as ' Mrat-as barënt-ô Çépovr-as .... âsman-as asman-6 Salpov-as .... b'ralr-n* brâir-eus?10 'aavép-as .... duhtr'-s11 dugdêr-ëutâ &uyatip-zi . . . . dâtf-n dâïr-ëus bovijp-xs . .
?Y «... (2/6/ ^ WW5»
INSTRUMENTAL.
Zend.
prî'tî-s âfrîty-ô1 Vâvanlî-s bavainli-s sûniï-n pasv-ô2 tanv-ô3
|
Grec. |
Latin. |
Lithuanien. |
Gothique. |
|
'VSÔpTl-tt.S |
turrê-s |
awi-s |
amti-ns |
|
véxv-as |
pecû-s |
sünk-s |
sunu-ns |
|
yévv-ots |
socru-s |
handu-ns |

§ a 43. Tableau comparatif de l’instrumental.
La formation de ce cas a été exposée § *3 16-2 2 4. II suffira de donner ici un tableau comparatif des formes sanscrites, zendes et lithuaniennes12. 86 83 84 85 87 88

73
PLURIEL. S 2 h U.
|
Sanscrit. |
Zend. |
Lithuanien. | |
|
Masculin.,. |
âévâ-is |
aspâ-is |
pona-is1 |
|
Féminin .. |
dévâ-bis |
hisvâ-bis2 |
aswihmis |
|
Masculin... |
pâti-Bis |
paiti-bis |
genti-mls |
|
Féminin. .. |
dvi-Bis3 |
âjrîli-bis |
awi-mls |
|
Féminin. .. |
bdvantî-bis |
bavainti-bis | |
|
Masculin... |
sûnü-bis |
pasur-bis |
süm-mis |
|
Féminin. .. |
go-bis |
gau-bis | |
|
Masculin... |
dsma-bis |
ama-bis | |
|
Neutre. ... |
nama-Bis |
nâma-bis | |
|
Neutre. ... |
vàc'ô-bis |
vace-bis | |
|
DATIF-ABLATIF. | |||
|
2BU. Des formes latines en ts. |
— Tableau comparatif du datil | ||
|
et de l’ablatif. | |||



pour lupô-bus : c’est ce qui ressort de la comparaison de ambù-bus, duo-bus. De (Unis la langue est d’abord arrivée à i-bus (;parut-bus, amici-bus, dii-bus1), par un allégement de la voyelle finale du thème analogue à celui qui a lieu à la fin du premier membre d’un composé (nmlti-plex pour multu-plex ou multo-plex). Dans la première déclinaison â-bus s’esl conservé dans un assez grand nombre .de mots, mais le degré intermédiaire i-bus manque. Cependant il est difficile de croire que la langue ait passé sans transition de â-bus à î-s ; il faut admettre, au contraire, que la de â-bus s’est d’abord affaibli en ï, lequel ï s’est allongé pour compenser la suppression de la syllabe bu : tem-s vient donc de terrï-bus pour terrâ-bus, comme mâlo de mâvolo.
On peut comparer :
|
Sanscrit. |
Zeild. |
Latin. |
Lithuanien. |
|
Masculin, âsvê-byas1 |
equi-s |
ponar-mux * | |
|
Féminin. àsvâ-byns |
hisvâ-byô |
equâ-bus |
âèwô-mus |
|
Masculin. pdti-byas |
paiti-byô |
hosù-bus |
genlt-mus |
|
Féminin . prî'ti-byas |
âfrîti-byô |
turri-bus |
awl-mus |
|
Féminine Bdmntî-byas |
bavainti-byô | ||
|
Masculin. sûnu-Byas |
pasu-byù |
pecu-bus1 |
sünh-mus |
Gothique.
vulfa-m
gibô-m
gasti-m
ansti-m
sunu-m
Féminin . vâg-byas .........vôc-i-bus
Masculin, bdrad-byas barèn-byô* ferent-i-bus
Masculin, dsma-byas aéma-byô sermon-i-bus
Masculin, brdtr-byas brâtar-ë-byô Jrâtr-i-bus
Neutre. . vdc'â-byas vacê-byô1 gener-i-bus
ahma-m
PLURIEL. S 24 5.

75

Remarque. — Des formes osques en ûis et en ois. — On trouve, en osque, à la seconde déclinaison, des datifs-ablatifs pluriels en ùis ou ois, par exemple, zileolois, nesimois, ligalùis Nuvlanàis (Mommsen, Études osques, p. 3g). Dans la première déclinaison, la forme régulière serait ms, qui s’est contracté en ombrien en ês (Aufrecbt et Kirehhoff, Monuments de la langue ombrienne, p. 114, 11). Il resterait donc is pour la désinence casuelle; les auteurs que nous venons de citer cherchent à la rattacher à la désinence bis de l'instrumental sanscrit. Je préférerais, si en effet la terminaison est is, la rapporter à la désinence du datif-ablatif sanscrit vç^byas; je reconnaîtrais alors dans is une contraction pourras, de même que nous avons dans la désinence du duel grec iv ( ïittto-iv, ytbpa-tv) une contraction pour yâm venant de VTTPXbyâm (8 2a 1). Je rappelle encore le latin bis de no-bis, volts, lequel est, comme on l’a vu plus haut (215,2), pour bius (en sanscrit
byas). ' - _
Si les formes de datif et d’ablatif en îs sont en corrélation avec les datifs osques et ombriens dont nous venons de parler, il faut renoncer à l’interprétation donnée plus haut, et l’allongement de l’t s’expliquera par la suppression de la première partie de la diphthongue, comme au nominatif pluriel equi venant de equoi — ftrir01 (S 228") et au datif singulier de la déclinaison pronominale illi venant de illoi (S 177 ).
GÉNITIF.
S 2 45. Désinence du génitif pluriel.
La désinence sanscrite pour le génitif pluriel des substantifs et des adjectifs est âtn; la désinence zende est ahm (§ 61). Le grec (ov est à la forme âm, ce que êSlSav est à adadarn
(§§ 4 et 18). Le latin a, comme toujours, conservé la nasale labiale ; mais, sous son influence, il a abrégé la voyelle précédente; ainsi, dans ped-um — sanscritpad-âm, 1 u bref ferait supposer en sanscrit un a bref, comme dans equum= ij^asvam, ’lmtov. Les langues germaniques ont supprimé la nasale finale (§ 18); mais le VTt â qui reste, en prenant une double forme en gothique, a introduit, pour le génitif, une différence inorganique entre la désinence féminine et la désinence masculine et

76

neutre. En eifet, la terminaison ordinaire est ê, tandis que la désinence plus pleine ô n’est restée qu aux thèmes féminins en u et en n. Le lithuanien a la désinence ü; exemple : akmen-ü «lapi-dum», qu’on peut comparer au sanscrit dsman-âm. Le borussien a, au contraire, conservé la nasale sous la forme d’un n (S 18) et a supprimé la voyelle; exemples : swinta-n «sanetorum» (comme à l’accusatif singulier), nidruwingi-n «incredulorum». (jette dernière forme doit être rapprochée des formes latines comme hosti-um, tri-um.
§ a 46. Insertion d’un u euphonique devant la désinence du génitif pluriel, en sanscrit et en zend.
A l’exception d’un certain nombre de monosyllabes, les thèmes terminés par une voyelle insèrent, en sanscrit, un n euphonique (ou un n, § l7b) devant la désinence; la voyelle finale du thème, si elle est brève, est alors allongée. Cette insertion paraît très-ancienne, car le zend y a part, quoique dans des limites plus étroites; il l’opère notamment pour tous les thèmes en « a et en *» à; exemples : aspa-n-ahm,
Crfl^fro* hisva-n-ahm. Il y a un accord très-remarquable entre ces dernières formes et les génitifs en ô-n-ô, e-n-a, que nous rencontrons en vieux haut-allemand, en vieux saxon et en anglo-saxon dans les mots de la même classe; exemples : vieux haut-allemand et vieux saxon gëbâ~n-ô, anglo-saxon gife-n-a
(S 133 ). , \ • '
8 2A7. Génitif pluriel des thèmes zends en i, î et u.
Les thèmes terminés par un i bref et un î long prennent également en zend le n euphonique, s’ils sont polysyllabiques. Mais les thèmes monosyllabiques en i ajoutent immédiatement la terminaison, avec ou sans gouna de la voyelle finale du thème; exemples : Iry-aiim ou tray-anm «trium» de tri: vay’-ahm,
PLURIEL. S 2à8.

77

savium» «le vi. Les thèmes en > u admettent à volonté l’adjonction immédiate de la désinence ou l’insertion d’un n euphonique : cependant je ne trouve pour le masculin pas'u que le génitif pasv-ahm, au lieu que pour certains thèmes féminins comme >|»p> tanu « corps t>, >»*>) nasu •« cadavre » (comparez vém, § ai), je n’ai rencontré jusqu’à présent que la désinence u-n-ahm.
§ 2/18. Génitif pronominal. — Du génitif latin en mm. ,
Les pronoms de la troisième personne ont en sanscrit au lieu de âm, et peut-être sâm est-il la forme primitive du suffixe du génitif. Dans cette hypothèse, dm ne serait proprement que la partie finale de la désinence, dont la partie essentielle serait le s, qu’on voit aussi figurer au génitif singulier. Si, en effet, sâm a d’abord été la terminaison généralement employée au génitif pluriel, il faut que pour les substantifs et les adjectifs la mutilation ait eu lieu de bonne heure, car le gothique, qui, au nominatif pluriel, a très-exactement conservé la ligne de démarcation entre les noms et les pronoms (§ 228“), ne prend la sifflante au génitif que dans la déclinaison pronominale. Il n’y a d’exception que pour les adjectifs forts; mais comme ils s’adjoignent un pronom (du moins à la plupart des cas, voyez § 287 et suiv.), il n’est pas étonnant qu’ils présentent la désinence pronominale. Exemples ; thi-sê (§ 86, 5) = sanscrit tê-sâm95 «horum, illorum», tlii-sô = sanscrit tâ-sâm «harum, illarum»; blindaisê. «cæcorum», blmdaisô «cæcarum». Le sanscrit élargit en ê, comme on peut le voir par l’exemple que nous venons de citer, l’a des thèmes masculins et neutres (S 143, 2). En zend, cet J est représenté par xj* «*"; exemples : aitnisanm « horum » (masculin-neutre), pour le sanscrit été sâm.;

7B
au féminin, au contraire, aitâonhahm. pour le sanscrit etasâm (S 56"). Nous n’examinerons pas si Yi des formes gothiques comme tlii-sê est l’affaiblissement de l’a du thème (de sorte que thi-sê serait pour tha-sê), ou si c’est la seconde partie de la diph-thongue = De toute façon, nous devrions au féminin avoir thô-sô en regard du sanscrit tâ-sâm; mais il paraît que le masculin et le neutre ont entraîné le féminin, qui se distingue d’ailleurs suffisamment par sa terminaison sô.
L’ancien slave, dont la désinence xs chu représente la désinence sanscrite sâm (§ q 2s), a egalement étendu au féminin la forme masculine et neutre; il a, par exemple, Ttxs tê-chü, non-seulement au masculin et au neutre pour le sanscrit té-sam,, mais encore au féminin pour le sanscrit ta-sâm (sur t, répondant au sanscrit ê, voyez § 92 e). Le borussien nous présente la forme son (sur n au lieu de m, voyez S 18), qu’il réserve pour la déclinaison pronominale, mais en l’étendant a la première et a la seconde personne : on a donc stei-son «horum, harum», nou-son iou-son zvfxôivn. Ces formes sont plus régulières,
quant à la désinence, que les formes sanscrites asma-kam, yusmâ-kam (S 34o), au lieu desquelles on attendrait asmê-sâm, yusmê-sâm : ces deux dernières formes ont dû, en effet, exister autrefois, comme on le voit par les nominatifs védiques asmé', yusmê' (d’après le modèle deJ(tê «hi, illi»). Si nous retournons à l’ancien slave, nous trouvons, pour les pronoms des deux premières personnes, la désinence ex su; exemples : na-sü «rjpt&w», va-sü (§ 92”). De même, en lithuanien, mû-su, ju-su. Le haut-allemand a changé l’ancienne sifflante en r; nous avons, par exemple, en vieux haut-allemand, dë-rô (aux*trois genres), qui de sa désinence n’a conservé en haut-allemand moderne que le r.
En latin, on a, comme cela devait être (S 22), rum au lieu de sum; exemples : istérum, istâvum. Cette syllabe rutn, qui pro-


PLURIEL. S 248. '


vient de la déclinaison pronominale, et qui s’est, introduite, ou, si l’on veut, qui est retournée dans la première, dans la deuxième et dans la cinquième déclinaison, devait s’y implanter d’autant plus facilement que tous les pronoms, au génitif pluriel, appartiennent à la première ou à la seconde déclinaison96. Mais on trouve, surtout dans l’ancienne langue, des formes qui montrent que la désinence rum n’a pas été également en faveur a toutes les époques du latin (de-uni, socï-um, amphor-um, agricol’-um, etc.). D’un autre côté, la terminaison rum paraît avoir essayé de prendre pied dans la troisième déclinaison, ainsi qu’on le voit par les formes citées dans Varron et Charisius : bôve-rum, Jove-rum, la-pide-rum, rege-rum, nuce-rum; je regarde le qui, dans ces mots, précède la désinence rum, comme un ancien i (§ 84 ) qui est venu s’ajouter au thème; le même i s’est introduit dans les nominatifs pluriels bovê-s, regê-s, qui viennent des thèmes élargis bovi,regi (§ 996); bove-rum, rege-rum sont donc pour bovi-rum, regi-rum, qui eux-mêmes auraient dû faire, d’après la réglé ordinaire des thèmes en i, bom-um, regi-um.
En grec, l’analogie demanderait un génitif en ercov qui manque même pour les pronoms; il y a donc, a cet égard, opposition complète entre le grec et le latin. Cependant les formes en a-eov, e-uv (par exemple aind-uv, a.vré-uv, àyopd-av, iyopé-wv) indiquent qu’un o- a dû être supprimé (comparez § 128).
Outre 1? latin, l’ombrien et l’osque justifient l’hypothèse de la suppression d’un a. La première déclinaison a rum en ombrien, zum en osque2; exemple (en osque) : eisa-zun-k egma-zum k illarum rerum r. La seconde a uni ou om dans les deux dialectes, avec suppression de la voyelle finale du theme, comme
80 FORMATION DES CAS.


dans ie latin soci’-um; exemples : (en ombrien) Abellan-um,
Nuvlan’-um, zicol’-om «dierum».
Quant à i’o long du latin equô-rum, quâ-rum, je crois que cet allongement est une compensation pour la suppression d’un i, comme au datif singulier (S 177). Le latin quô-rum répond de la sorte au sanscrit kê-sâm, pour kai-sâm, du thème interrogatif ka. Dans les thèmes féminins ^ 1 a est long par nature. qixd'^vwîïi répond donc très-bien au sanscrit ka-sâm.
§ 2A9. Tableau comparatif du génitif.
. Nous faisons suivre le tableau comparatif de la formation du génitif pluriel. .
|
Sanscrit. |
Zend. |
Grec. |
Latin. |
Lithuanien. Gothique. |
|
Masculin. dsvâ-n-dm |
aspa-n-anm |
ftnr’-aw |
equô-rum |
pdn’-.ü vulf-ê |
|
Mas.-neu. lê-sâm |
aitai-êanm |
istô-rum |
t’-û thi-sê | |
|
Féminin . âsvâ-n-râm |
hisva-n-nhm ywpd-wv |
equâ-rum |
àêw’-ü gëbô-n4\ | |
|
Féminin . ta-sâm |
âonhanm2 |
râ-cûv |
islâ-rum |
t’-ü thi-sô |
|
Mas.-neu. trt-n-am’ |
try-ahm |
Tpt-ù)V |
tri-um |
trij-ü thrij-ê |
|
Féminin .prïiî-n-âm |
âfrîti-n-anm |
tso pri-cov |
turri-um. |
awi-u4 arnt’-ê |
|
Masculin. sûniï-n-âm pasv-ahm |
vexv-oôv |
pecu-um |
sün’-u suniv-e5 | |
|
Féminin . hdnû-n-âm |
lanu-n-aiim |
yevv-wv |
socru-um | |
|
Mas.-fém. gav-âm |
gav-anm |
@o(F)-a>v |
bov-um |
* * *........ |
|
Féminin .nâv-am Féminin . vâc-am. | ||||
|
vâc-ahm |
ÔTt-ÜV - |
vôc-um | ||
|
Mas.-neu. Mrat-âm. |
barënt-anm6 |
(pspbvr-wv |
S o.3o. |
... ^ . . Jijand-ê |
|
Masculin. déman-âm |
asman-anm |
Saipôv-ajv |
sermôn-um |
: akmen-u ahvian-ê |
1 Pour le vieux haut-allemand, voyez S 2/16; gothique gib -ô.
' 2 Cette forme répohd au sanscrit UFCtT^ â-sâm «harum» (8 56 L); J»p («.devrait
faire tâonhanm ; niais on n’en trouve pas d’exemple. Les thèmes pronominaux composés abrègent l’avanl-dernièie syllabe;* «xcmple : tijtfFf1#* ai-tanhanm,,^,non ai-tâonhanm, comme on devrait t’attendred’après le sanscrit yrueu'A* é-tiï-sâm.
3 Forme védique : dans la langue ordinaire trayâ-n-iïm, du thème élargi traya.
4 Dissyllabe.
6 Voyez? 12/1.
0 On baranlanm.
LOCATIF.
S siïo. Caractère du locatif pluriel. — Le datif grec en cri est un ancien locatif.
En sanscrit, le caractère du locatif pluriel est ^ su; cette syllabe se change en gstt dans les cas indiqués au § a 1b. En zend, nous avons, au lieu de cette dernière forme, >qj su (§ 5s), tandis que g su devient >y» hu (§ 53)5. Toutefois, la forme la plus ordinaire est sva, hva, ce qui nous conduit a
une syllabe sanscrite *»«• C’est là, selon toute apparence, la forme primitive de la terminaison, car il n’y a rien de plus ordinaire, en sanscrit, que de voir les syllabes va et ya supprimer leur voyelle et vocaliser leur semi-voyelle, comme, par exemple, dans uktd « dit », pour vaktâ. L’hypothèse de la mutilation de la désinence sanscrite est donc beaucoup plus vraisemblable que celle de l’élargissement de la désinence zende par l’addition ultérieure d’un a, d’autant plus qu’it n’y a aucun autre exemple
1 Forme védique (du thème nar, nr «hommeti) = zend mr-anm. Ce dernier thème, étant monosyllabique, ne perd pas en zend sa voyelle, comme la perdent bratr-anm tifratrum», dtr-anm «ignium». En sanscrit, les génitifs Ihiïty-ry-âm, duhitr-n-âm, qui sont les formes de la langue ordinaire, appartiennent en réalité a la déclinaison en t, comme les accusatifs analogues (S a3g, remarque).
2 Forme védique (Rigvéda, l, 65, U) du thème tvâsâr, svâsr «sœur». Sauf la suppression de la voyelle de la seconde syllabe, cette forme répond au latin sorSr-um, qui supposerait en sanscrit svdsâr-âm.
3 Ddty-fi-âm ddtri-n-am, de ddtvi (S a3q, remarque).
1 Je restitue cette forme d’après l’analogie de brâir-aian et d après d autres cas faibles de la même classe de rhots.
s On trouve aussi stî et hû.
ü

PLURIEL. S 250.
Sanscrit.
Zend.
Grec.
Latin.
Masculin. nàr-âm ' brâlr-anm marép-cov frâtr-um Féminin . svdsr-âm! dugd'ër-ami Qvyœtép-av mâlr-um Masculin.97 dâtr-ahm97‘ bortfp-aiv datôr-um
Neutre. . vàcas-âm vacanh-anm ènè(a)-(Dv gener-um.
81
Lithuanien. Gothique.
......brôthr-ê
dukter-û dauhtr-ê

h.

83

d’un accroissement de ce genre. Mais si sva est la forme primitive de la terminaison, elle est identique avec le thème du pronom possessif et réfléchi sva. Nous reviendrons sur ce point.
En grec, la terminaison du datif m (avec le v ephelkysticon criv) répond au locatif sanscrit; je ne regarde plus cet < comme une altération de Vu de su, mais comme un affaiblissement de l’n de la forme complète sva; c’est ainsi que l’t du latin si-bi (pour sui-bi) et l’t du thème grec crÇu sont sortis de l’a du thème sanscrit sva (S 341). .
S s5i. Datif grec en ois, aïs.
Les thèmes en a ajoutent, au locatif, à cette voyelle, comme à beaucoup d’autres cas, un i: de a + i se forme Xf ê, auquel correspond le grec oi ; exemple : ïmtoi-at (et par la suppression de l’i, ’lmtot-s) = sanscrit dsvê-su, zend aspai-sva. Mais, en grec, l’< s’est étendu aux thèmes en a et en n [Hfiépat-s, xs(pa.\cü-s), au lieu qu’en sanscrit et en zend la reste pur; exemples : «*■
vâ-su, hi.wâhva. A ces formes correspondent le mieux
les locatifs de noms de ville, comme WXa-vatauiv, ÙAvpmaai, A9rlvtj<rt *.
§ a5a. Datif grec en ercri.
On a déjà fait observer (§ 128) que, dans les anciens datils éoliens et doriens, comme Teti^eo-o-i, ëpsero-i, le premier <r appartient au thème. Ils répondent aux locatifs sanscrits comme vdcas-su (de vdcas-sva, voyez § a5o). J’ai supposé, dans la pre- 97

83

mière édition, que les formes comme xvveaai, vemeaat, yvvat-Xe<jai, 'sfâvTeaan, viennent de thèmes élargis par l’addition de la syllabe es, et j’ai rapproché ce suffixe de celui qui vient s’ajouter aux pluriels comme hûsir, chelhr en vieux haut-allemand (8 a4i); mais je préfère aujourd’hui l’explication donnée par Aufrecht \ suivant laquelle aai est pour crFi, par un effet de la même assimilation régressive qui a changé réaFctpes ( du sanscrit catvaras) en aéaaapes (S 19). 11 faut donc diviser le mot ainsi : xbv-e-aai, et regarder comme une voyelle de liaison le, qui est remplacé par un a dans le dorien des Tables d Heraclée (zspaaa6vi-a.-aai, ■ù'napypva-a.-aaiv, 'usoihv’t-a.-aoi) 98 99.
Les thèmes en es comportent à volonté l’adjonction immédiate de la désinence f ou l’insertion de la voyelle de liaison ; le a final du thème tombe devant cette voyelle, comme il tombe devant les voyelles des désinences casuelles; exemple : èite-s-w^Ae èitea-e-tr<7i) et ënea-at. Nous avons vu que les thèmes de la troisième déclinaison qui sont terminés par une voyelle suivent, au génitif singulier (S 186) et au génitif-datif duel (§ 991), le principe de la déclinaison des thèmes finissant par une consonne : nous ne serons donc pas surpris de leur voir prendre aussi devant la désinence du datif pluriel la voyelle euphonique s; exemples : vzv.l-e.-aai (à côté de vévv-aai), lyQv-e-aai, vsoki-e-aai (à coté de vsokl-e-at ), StaXvai-e-aat, va[(F)-e-aai, j3i(F)-e-aat. On peut comparer avec ces deux derniers mots la formation des locatifs sanscrits nâu-sü, gô-su, en zend gau-éva100. L assimilation de la première lettre par la seconde explique les formes cpmme yov-vtta-at et ScopMa-ai, venant de yovvar-at et Swpar-ai, peut-être

1
84 FORMATION DES CAS.
aussi Tsoa-ai venant de rsoS-at. Comparez le sanscritpad-sû, qui est devenu, conformément aux lois phoniques, pat-su.
S a53. Locatif pluriel en lithuanien.
Le lithuanien a, au locatif pluriel, les désinences sa, su ou se, ou plus souvent, comme le lette, un simple s. Schïeicher regarde su comme la forme primitive et fait observer que les plus anciens manuscrits ont ordinairement su, les autres sa ou se. Mais si la forme sa n’est pas entièrement exclue des plus anciens manuscrits, je persiste dans mon opinion que sa est la forme primitive, et que Y a qui y est contenu est identique avec l’a de la désinence sva que nous avons reconnue comme ayant dû exister en sanscrit, et avec l’a de la désinence sva, hva subsistant en zend101. En effet, sa nous conduit naturellement, par des affaiblissements phoniques bien connus, à su et à se; au contraire le changement de l’a en a serait une anomalie. En ce qui concerne la suppression, en lithuanien, de la semi-voyelle du groupe sanscrit sva, je rappellerai le rapport du lithuanien sâpna-s « rêve » et sesü <$. sœur » avec le sanscrit svâpm-s, svdsâ. Dans sàwa-s, sawà

PLURIEL. $ 254.

85

«suus, sua», au lieu du sanscrit sva-s, sm, on a évité le groupe peu habituel en lithuanien sw par l’insertion d’une voyelle euphonique qui devient longue au masculin, parce qu’elle reçoit l’accent.
S a54. Tableau comparatif du locatif pluriel en sanscrit, en zend et en lithuanien, et du datif pluriel eu grec.
Nous donnons le tableau comparatif du locatif pluriel en sanscrit, en zend et en lithuanien, en y joignant le datif pluriel grec, qui est le cas correspondant.
Sanscrit. Zend. Lithuanien. Grec.
Masculin... àsvê-èu aspai-êva ponu-se imoi-oi
Féminin... âévâ-su hisvâ-hva aiwôse ÙAupirli-at,
Féminin... pnti-êu afrîti-êva1 awi-sè -rsàpri-ai
Masculin... sùnù-su poJu-sva sfmû-sè véKV-ai
Mas.-fém. . gu-su gau-ka ? ......... fiov-ot
Féminin... nâu-êu ................... vctv-crt
Féminin... vâk-éû vâU-sva? .........im-al
Mas.-neutre Bàrat-su .................. Çépov-cn
Masculin... dsma-su asma-hva102 103 .........balpo-oi
Masculin... lirdtr-su brâtar-ë-êva .........vfUTpi-ai102
Neutre.... vâcas-su vacô-hva104 105 ........énea-ai.
FORMATION DES CAS.

86
RÉCAPITULATION.
g 255. Tableau général de la déclinaison dans les langues indo-européennes.
Après avoir exposé les règles de formation de chaque cas, nous pensons qu’il ne sera pas inutile, pour donner une vue d’ensemble, de choisir quelques exemples dans les classes de mots les plus importantes, et d’en présenter la déclinaison complète. Nous prenons le sanscrit pour point de départ, et nous rangeons les autres langues suivant qu’elles ont conservé plus ou moins fidèlement, dans chaque cas, la forme primitive1.
Thèmes masculins terminés en sanscrit par a, en grec par o, en latin par S, en arménien par a,o, u (S i8Sb, î etsuiv.), en ancien slave para.
SINGUMF.lt.
Sanscrit.. .. Lithuanien.
Zend.....
Grec......
Latin.....
Ancien slave

Nominatif. âsva-s,
pona-s. .
aspô, avec c'a : aspas-ca. ïirjfo-s. equu-s.
KA3K3 vlükü «loup». '
ne peuvent venir que de thèmes en »» ai (V S 56b), dontI un signifie le «jour», l’autre la «nuit». De même qu’en sanscrit nous avons un fhot àkm «jour» qui emprunte plusieurs cas aux thèmes dhas et é/iur, le mot zend Kiapaf «nuit» emprunte la plupart de ses cas aux thèmes Utapar et tëmpaft.cüfiiÉêroè encore qu’eu sanscrit nous avons une forme dérivée, 4»u «jour» qu’on rencoùtre è la fin de plusieurs composés ( par exemplep^rvdlfna «la première partie du jour») et dans le dérivé adverbial ah-nâya «bientôt, tout de suite», de même en, zénd le mot Ksapô a fait htafna, dont on
rencontre le locatif Ssq/hÀ . .
1 Nous comprenons l’ancien slave dans ce tableau, en nous référant pour ses lois de formation aux paragraphes suivants.

RÉCAPITULATION. S 255. 87
Gothique...............vulf’-s.
Vieux haut-allemand......wolf’.
Arménien.............. Jk-t mêg’ «nuage» (instrumental miga-v,
S 2i5, a), Jiupn- rnard’ «homme»',
i{aipuiq_ waras’ «sanglier»106 107 108 109 110.

Sanscrit..........
Zend............
Latin...........
Borussien........
Grec............
Lithuanien.......
Slave ...........
Gothique........
Vieux haut-allemand Arménien. .......
Accusatif.
âsva-m.
aspë-m.
equu-m.
deiwa-n.
ïmco-v. \ ■
pona-n.
vlülcü.
mlf’.
wolf’.
mêg’, mard’, waras Instrumental.
Sanscrit................
Zend.................
Lithuanien.............
Vieux haut-allemand......
Arménien............^.
Slave..................
àévê-n-a.

pônit. -{ ■'.
wolf-u. ■' ■ . - •’
miga-v (S i83’, 6), mardo-w, warasu. ■vlülcô-mt.
Datif.
Sanscrit................ âévâi/a.
Zend. ,.., ;...........aspât, ..
Lithuanien.............j)^#(clissyllabe).
* . |

|
88 |
FORMATION DES CAS. |
|
Latin............ |
.....populo-i Romano-i. equô. |
|
Arménien......... |
.....mig-i (§ 189), mardo-i (prononcez mardô, même paragraphe), warasu. |
|
Gothique......... | |
|
Vieux haut-allemand. |
..... wolfa, wolfe. |
|
Slave............. |
Ablatif. |
|
Sanscrit.......... | |
|
Zend............ | |
|
Latin............ | |
|
Osque............ | |
|
Arménien. ........ |
..... migê (S 183a, h), mardoi (prononcez mardô) ', warasu ou warasê *. Génitif. * |
|
Sanscrit........... | |
|
Grec............. | |
|
Zend............ |
...... aspa-hê, dans le dialecte de la seconde partie du Yaçna aspa-hyâ ou as'pa-Kyâ (S 188). ( |
|
Osque........... |
......surets (suve-ts, venant dé snve-si) trsui» = sanscrit svâ-sya. |
|
Borussien........ | |
|
Ancien saxon...... | |
|
Vieux haut-allemand |


|
RÉCAPITULATION. S 255. | |
|
Gothique............... |
vulfi-s. |
|
Lithuanien............. |
ponô. |
|
Arménien.............. |
mig-i (S 188), mardo-i |
|
Slave.................. |
warasu. vlüka. |
|
Sanscrit................ |
Locatif. âsvê ((le àsva-i). |
|
Zend................. |
aspê, maidyôi (§ 196). |
|
Lithuanien............. |
pône. |
|
Slave................. |
KrtSKt vl&Icê. |
|
Grec (datif)............ |
ïirnw (ofxot, ftoi, aol). |
|
Latin (génitif)........... |
equ’-î (novê rr nouvelle: |
|
Sanscrit............... |
«dans le nouveau»). Vocatif. âsva. |
|
Zend.................. |
aspa. |
|
Borussien.............. |
deiwa, deiwe. |
|
Lithuanien............. |
pone. |
|
Slave.................. |
vlülte. |
|
Grec................. |
faire. |
|
Latin. ................ |
equ£. |
|
Gothique................ |
vulf. |
|
Vieux haut-allemand...... |
wolf. |
|
Arménien.............. |
mêg’, mard’, marna’. |
|
DUBt.. Nominatif-accusatif-vocatif. | |
|
Sanscrit............... |
àsvâu. |
|
Védique............... |
dsvâ. |
|
Zend.................. |
aépâo, aspa. |
|
Slave................ |
vlüka. |
|
Lithuanien............. |
ponu. |
|
il faut admettre que L’a de tvolfe-s |
est sorti directement de la |
|
du gothique vulfi-a (S 67 ). | |
80

= ;fcl nàvè

90
FORMATION DES CAS.
I nstrumental-dalif-ablatif.

Sanscrit............... asvâ-fiyâni.
Zend................. âspaii-bya.
Grec (datif-génitif).......(irao-tv.
Slave (instrumental-datif).. vlüko-ma. Lithuanien (instrum.-datif) . ponà-m.
Génitit-tocalif.
Sanscrit...............dsvay-âs.
Zend.................aspay-ô.
Slave.................. oboj-u (taniborunm, vlülc’-u.
Lithuanien (génitif).......pon’r-û.
PLURIEL.
Nominatif-vocatif.
|
Sanscrit............. |
... âsvâs. |
|
Védique............ |
... âsvâsas. |
|
Zend.............. |
. . . aspâonhê. |
|
Gothique............ |
. .. vulfôs. , |
|
Osque.............. |
... Abellanus. |
|
Vieux haut-allemand... |
... wolfâ (S 99 m). |
|
Arménien........... |
. . . mêg’-q, mard’-q, waras-q (8 996). |
|
Accusatif. | |
|
Sanscrit...........à . |
... àsvâ-n(s). |
|
Zend.............. |
aspa-h (avec c'a : aspaiis-ca «equosquec |
|
Gothique.......... |
..., vulfa-ns. |
|
Borussien.......... |
. ... deiwa-ns. |
|
Grec.............. |
. . .. irniovs (de ïmro-vs, 8 986). |
|
Latin............. | |
|
Lithuanien.......... | |
|
Arménien.......... |
. . .. mêg’-s, mard’s, waras-s. |
|
Slave............. |
..... BA2KSI vlükü. ■ |
Vieux haut-allemand...... woljâ.

RÉCAPITULATION. § 255.
1)1
|
• Instrumental. | |
|
Sanscrit.............. |
.. âévàis. |
|
Zend............... |
. . àspâis. |
|
Lithuanien........... |
.. portais. |
|
Slave................ |
. . r làkü. |
|
Védique............. |
r r A if . . asve-ots. |
|
Vieux persan.......... |
.. bagai-biê. |
|
Arménien............ |
., miga-vq, mardo-vq, warasu-q. |
|
Datif-ablatif. | |
|
Sanscrit.............. |
. . dsvê-byas. |
|
Zend............... |
. . àspaii-byô (avec ca : aspaii-byi |
|
Latin............... |
.. duo-bus, ambô-bus, amici-b |
|
amici-s. | |
|
Lithuanien (datif)...... |
. . pona-mus, ponâ-ms. |
|
Slave (datif).......... |
. . vlüko-mü. |
|
Gothique (datif)....... |
. . vulfa-m. |
|
Vieux haut-allemand.... |
. . wolfu-m. |
|
Arménien (datif-abl.-génitif). miga-i, mardo-i, warai | |
|
Génitif | |
|
Sanscrit.............. |
. qsvâ-n-àm. |
|
Zend............... |
.. aspa-n-anm. - |
|
Latin............... |
. . soci’-um. |
|
Grec................ |
. . ïirn'-nv ( de hnso-mv). |
|
Borussien........... |
. . deiwa-n. |
|
Lithuanien........... |
.. pon’-ü. |
|
Gothique............ |
.. vulf’-ê. |
|
Vieux haut-allemand.... |
.. wolf’-ô. |
|
Slave.............. |
.. vîük’-ü. |
Locatif (datif grec).

Sanscrit........... ...... dsvê-èu.
Zend.................uépai-ÿva, aspai-su.
Lithuanien. ............pon&sa, pom-su , ponü-se, ponli-s.
Crée.................. i'wTroi-cri.
Slave.................. BASK’bXS vlfikê-chu.

92
FORMATION DES CAS.
Sanscrit...........
Zend...........
Latin...........
Grec....... ....
Borussien........
Lithuanien.......
Slave............
Gothique. ..... . Vieux haut-allemand
Thèmes neutres en a, grec o, latin 6, ancien slave
SIUGULIEU.
Nominatif-accusatif.
ddna-m. dàtë-m. dônu-m.
8 üpo-v.
billito-n (rdictum». géra.
AtAO dêlo ctouvrage».
daur’. tor’.
O.

Vocatif.
Sanscrit................ddna.
Zend.................. data.
Slave.................. dêlo.
Gothique............... daur’.
Vieux haut-allemand...... tor’.
Le reste comme au masculin.
DUEL.
Nominatif-accusatif-vocatif.
Sanscrit..........,......danê.
Zend..................daté.
Slave................. AtAU dêls.
Le reste comme au masculin.
\ \
PLURIEL. v
. -''tîfc
Nominatif-accusatif-vocatif.
Sanscrit...............danâ-n-i.
Védique............... dtinà.
Zend................. d&ta.
Grec.................. 8"Pa-

RÉCAPITULATION. S 255.
1)3

Gothique.. ! ............ dauru-
Slave.................. dék-
Vieux haut-allemand...... tor’.
Le reste comme au masculin.
Remarque 1. — L’insertion d’un n euphonique n’a pas Heu à l’instrumental des thèmes en a, en zend et en ancien perse. — A l’instrumentai j
des thèmes en a, Burnouf1 admet en zend des formes insérant un », en j
sorte que la désinence a-n-a correspondrait au sanscrit ê-n-a de asve-n-a, danê-n-a. Il cite entre autres là forme matsmana .urmâ», qu i
fait dériver d’un thème en ma ; mais je crois que ce mot est formé à 1 aide du suffixe man (S 796) et je le divise ainsi à L’instrumental : mauman-a.
Quant aux instrumentaux cités par Burnouf maxana, srayana et vanharn, je persiste à les faire venir de thèmes en an (de sorte qu’il faut diviser masan-a, srayan-a, vanhan-a). Cette opinion me paraît d’autant plus vraisemblable que, depuis la publication de la première édition de cet ouvrage, l’on a constaté dans la langue védique la présence d’un mot mahan .grandeur», qui correspond pour le sens comme pour la forme au zend marna, et qui n’est également employé qu’à l’instrumental (mahn-â*). Quant à la forme kana, qui est l’instrumental du pronom interrogatif, je la regarde comme venant d’un thème composé kana, dont la syllabe na est la même que nous trouvons dans le sanscrit a-na, ê-na (§ 36g et suiv.), dans te grec xe.ro, nVvo, rVvo, et dans le borussien ta-nna, nominatif ta-ns .il» . J ai déjà fait observer ailleurs ‘ que l’insertion de » n’a pas lieu non plus à 1 instrumental des thèmes en a dans 1 ancien perse.
Remarque 2. — Formes de génitifs messapiens en ht. — Dans la classe de mots en question tes génitifs singuliers du dialecte messapien méritent d’être considérés de plus près. Ils se terminent tous en ht \ ce qui rappelle
' s.
1 Commentaire sur le Yaçna, p. 99 su*v' n0'es P- 7^*
1 Voyez Benfey, Glossaire du Sâma-veda.
3 La première partie du pronom borussien est évidemment identique au thème sanscrit ta «il, celui-ci» (S 343). Sur 1e redoublement des liquides et des sifflantes après une voyelle brève, voyez ma dissertation Sur la langue des Borussiens, p. 10.
4 Bulletin mensuel dé l’Académie de Berlin, 1848, p. i33.
4 Voyez Mommsen, Dialectes de l’Italie inférieure, p. 80 et smv. et Stier, dans le Journal de Kulm, VI, p. 14a et suiv.
FORMATION DES CAS.


aussitôt les génitifs perses et sentis en hyâ = sanscrit sya (S 188). Mais comme le messapien ne présente aucune particularité qui le rattache spécialement au rameau iranien, il faut mettre cette coïncidence sur le compte du hasard, ou, en d’autres termes, il faut l’expliquer par le rapport phonique qui existe entre le s et le h (comparez § 53). L’» de la désinence messapienne, comme l’« dans les génitifs grecs en 10, est la vocalisation de la semi-vovelle sanscrite et iranienne y, qui se trouve dans sya, hya. Le messapien ki et le grec 10 se complètent donc 1 un . aube en „e sens que le premier a conservé la consonne (h pour a) et le second la voyelle (0 pour «) de la désinence primitive. Mais je ne voudrais pas conclure de la forme messapienne que les génitifs grecs en m ont été précédés de formes en »; car pourquoi le a ne serait-il pas tombé dans certaines positions aussi bien que beaucoup d’autres consonnes, que le r, par exemple, dans les formes comme f*p«, de Çsps-rt, en sanscrit Mr-a-li, en prâcnt bar-ardx ou inr Urdi? La parenté du messapien avec le grec noblige pas plus, selon moi, à admettre une première forme en o-io, devenue ensuite 0,0 que les formes latines comme gener-is ne nous obligent à admettre une forme ye-vsp-0S qui aurait précédé (S 108). Malgré 1 intime parenté des
deux idiomes classiques, qui évidemment ne se sont séparés que sur le so européen, chacune des sœurs jumelles a suivi, dans certains cas particuliers,
des lois qui lui sont propres.
Les nominatifs de la classe de mots en question se terminent en messapien par a-s ou par os. Dans le premier cas ils ressemblent aux nominatifs sanscrits et lithuaniens comme dêm-s «dieu*, dêwa-s; dans le second aux nominatifs grecs comme *sbs et aux thèmes slaves comme vlulcô « oup* = sanscrit 1dha (de varka), lithuanien wllha, ou aux thèmes arméniens comme arlaîo « argent * == sanscrit ragatà (S .8S‘, 1). Les nominatifs en a-s ont généralement le génitif en ai-hi, plus rarement en ;j° "PP«q. l’t ajouté à Ta du thèmé vient de l’influence euphonique de U final, d apr le même principe qui amène l’adoucissement {umlaut) de la voyelle dans les langues germaniques et l’épenthèse en zend (S Ai). Les thèmes messa-piens en 0 ont généralement au génitif i-hi (par exemple popx.-A., au nominatif pop*o-S),ce que je regarde comme une altération pour o«-A« ; dans la forme popm-A., je tien^également K pour provenant de 1 influence euphonique de la désinence, d’autant plus qu’on rencontre quelques formes e U’ et en o-hi (ce dernier sans « euphonique) et qu’on a aussi parfois des 111
RECAPITULATION. S 255.

95

génitifs en i-hi, venant de nominatifs en as'. 11 est impossible de décider si les formes en eihi (xpxôeheiht, Ka.l<tpsiht) viennent de oihi ou de aihi, attendu que les nominatifs correspondants manquent. ,
Thèmes féminins en â, correspondant à des thèmes en ô en gothique et en lithuanien, en a en ancien slave.
SINGULIER.
Nominatif.
|
Sanscrit.............. | |
|
Grec................ | |
|
Lithuanien........... | |
|
Zend................ | |
|
Latin............... | |
|
Gothique............ | |
|
Vieux haut-allemand. . . | |
|
Slave............... | |
|
Accusatif. | |
|
Sanscrit............. | |
|
Latin.............. | |
|
Zend............... | |
|
Grec............... | |
|
Borussien........... | |
|
Slave.............. | |
|
Lithuanien.......... | |
|
Gothique............ | |
|
Vieux haut-allemand... | |
|
Instrumental. | |
|
Sanscrit............. | |
|
Védique........... | |
|
Zend............... | |
|
Slave............... | |
|
Lithuanien.......... |
1 Stier, Journal de Kuhn, Vtvp. tA3.

FORMATION DES CAS.
96
Sanscrit...........
Zend.............
Latin........... • •
Lithuanien........
Slave.............
Gothique.........
Vieux haut-allemand.
Datif.
dsvây-âi. hisvay-âi. equa-i, equœ. aswa-i (dissyllabe). EtAOE'U vïdovê. gibai (8 175). gëbu, gëbo.

|
• |
Ablatif. |
|
.. hisvay-âd- | |
|
Sanscrit............. |
,. àévây-âs (de âévây-ât, S 102 |
|
Latin............... |
. . prœda-d. , |
|
.. touta-d. | |
|
Génitif. | |
|
.. àévây-âs. | |
|
.. hisvay-âo. | |
|
Latin............... |
. . terrâ-s. |
|
Lithuanien........... |
.. âsvoô-s. |
|
Gothique............ |
. . gibô-s. |
|
Vieux haut-allemand.... |
. gëba, plus tard gebo. |
|
.. BbAOKSI vïdovü. | |
|
Locatif {datif grec). | |
|
... âsvây-âm. | |
|
Zend..........• • |
... hisvay-a? {S 202). |
|
Lithuanien.......... | |
|
.. . KbACE'b vïdovê. | |
|
Vocatif. | |
|
Sanscrit............ |
... âkka (S ao5), àsvê. |
|
Latin.............. |

RÉCAPITULATION. S 255.
97
Gothique...............giba.
Vieux haut-allemand ......gëba.
Lithuanien............. âswa.
Slave.................. vîdovo (S 979).

Duel.
Nominatif-accuealif-vocatif.
Sanscrit................ àsvê.
Zend.................. hi§vê.
Slave.................. Et.AOE’B vïdovê.
Lithuanien.............àswi (S a 1 A).
Instnimental-datif-abiatif.
Sanscrit................
Zend..................
Grec (datif-génitif)........
Slave (instrumental-datif ).. Lithuanien (instrum.-datif).
àsvâ-b'yâm. hisvâ-bya.
^(ûpa-iv. vïdova-ma.
aêmô-m. . «
Génitif-tocatif.
Sanscrit................ âévay-ôs.
Zend.................hisvay-ô ?
Slave.................. vidov’-u.
Lithuanien (génitif)....... dèw’-û.
PLURIEL.
Nominatif-vocatif.
Sanscrit................ âsvâs.
Osque................. scriftas (nominatif).
Lithuanien. ..., aéwôs.
Zend.....
Vieux haut-^l^ai^>('.(fJ.j,')t Slave......i 7L Jï&Xvkù i{idpi{ü.
7
H.
si Oïv è
r>- /
/il S
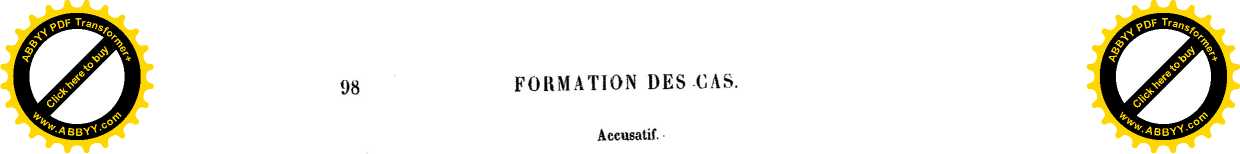
|
Sanscrit.............. |
. . âsvâ-s. |
|
Latin............... |
.. equâ-s. |
|
Grec................ | |
|
Lithuanien......... • ■ |
. . aswa-s. |
|
Gothique............. |
.. gibô-s. |
|
Zend................ |
, . . hisvâo. |
|
Vieux haut-allemand.... |
. . gëbô. |
|
Slave............... |
. . vïdovü. |
|
Instrumental. | |
|
Sanscrit.............. |
... âsvâ-bis. |
|
Zend............... |
. . . hisvâ-bis. |
|
Lithuanien.......... |
, . . asmô-mis. |
|
Slave............... |
. .. vldovartni. |
|
Datif-ablatif. ‘ | |
|
Sanscrit............. |
. . . Asvâ-Byas. |
|
Zend............... |
.. . hisvâ-byô (avec c'a : hisvâ-byaé-ca). |
|
Latin.............. |
. . . equâ-bus. |
|
Lithuanien (datif )r.... |
. .. aèwô-mus, plus tard aêwô-tns. |
|
Slave (datif)......... |
.,. vïdova-mü. |
|
Gothique............ |
. .. gibâ-m. |
|
Vieux haut-allejnand... |
... gëbâ-m. |
Génitif.
àévâ-n-âm.
hisva-n-ahm.
gëbô-itnfe;
•gtapà-mv.
amphor’-um.
gib’-ô.
âsw’-ü.
vïdov’-ù.
Sanscrit.............
Zend...............
Vieux haut-allemand. . >
Grec...............
Latin...............
Gothique............
Lithuanien..........
Slave...............
Sanscrit,
Locatif (datif grec). dsvâ-su.
RÉCAPITULATION. S 255.

99

Zend.................. hifvà-hva.
Lithuanien............. àêwô-sa, âswô-su, âkvoô-se, âèvoü-s.
Slave.. ............... KLAOBd-XS vîdova-chü.
Grec.................. dXvpir/â-eri, ^tùpai-ui, yéptu-s*
Thèmes féminins en i '. SINGULIER. 113 114 115 116 112
Nominatif.
|
Sanscrit.............. |
. . prili-s. |
|
Zend................ |
.. àfrîti-s. |
|
Grec................ |
.. •srdpri-s. |
|
Latin............... |
. . lurri-s. |
|
Lithuanien........... | |
|
Gothique............. | |
|
Slave............. ... |
.. HOUiTf noêtï «nuit». |
|
Vieux haut-allemand. ... |
.. anst’. |
|
Arménien............ |
... |
|
Accusatif. | |
|
Sanscrit.............. | |
|
Latin............... | |
|
Zend................ |
., âjrîti-m. |
|
Grec................ |
.. ‘trôpn-v. |
|
Borussien............ |
. . nakli-n «noctem». |
|
Lithuanien. .......... | |
|
Slave............... |
100 FORMATION DES CAS.


Gothique et vieux haut-alleni. anst’.
Arménien..............
Instrumental.
Sanscrit................prîty-â.
Zend.................. âfrity-a.
Slave.,................ HOUlTHMi noêtij-vh.
Lithuanien............. awi-ml.
Arménien..............o?is117. v
■ Datif.
Sanscrit................prîtay-ê ou pnty-âi (S i64).
Zend.................. âjritë-ê (avec c'a : âfritay-ê-ca).
Latin................. turrî.
Li thuanien............. awi-ei ( dissyllabe, S 176).
Slave.................. noêti.
Gothique............... anstai.
Vieux haut-allemand...... ensti, ■
Ablatif.
Zend.................. âjritâi-d.
Sanscrit................prîtes (de prüi-t, S 10s) ou pnly-âs {àt
prîty-âl).
Latin.................navale-d (S i83\ 4). .
Arménien..............âiê (S i83', 4).
Génitif.
Sanscrit...........’>. . .. prî'tês ou pniy-âs.
Zend.................. âjrîtâi-s. .
Gothique............... anstai-s.
Lithuanien - .............awe-s.
Latin.................turris.

RÉCAPITULATION. S 255.
101
|
Vieux haut-allemand. .. | |
|
Arménien........... | |
|
Locatif. | |
|
Sanscrit............. | |
|
Lithuanien.......... | |
|
Slave............... | |
|
Vocatif. | |
|
Sanscrit............. | |
|
Lithuanien.......... | |
|
Gothique............ | |
|
Zend............... | |
|
Grec............... | |
|
Slave............... | |
|
Vieux haut-allemand. .. | |
|
Arménien........... |
... oT- |
DUEL.

Nominatif-accusatif-vocatif.
Sanscrit................prîti.
Zend.................. âjrîtî ?
Lithuanien............. «tel.
Slave................. noèti.
Inatrumental-datif-ablatif.
Sanscrit................prîti-Syâm.
Zend............;. ..,. âjriti-bya.
Grec ( datif-génitif )....... ’aoprl-o-tv.
Slave (instruraental-datif).. . noêtï-ma. Lithuanien (instrum.-datif ). awi-m.
Génitif-locatif.
Sanscrit................prily-ds.
Zend......... ? ; ......âjrîiy-6?

102
FORMATION DES CAS.
Slave...........
Lithuanien (génitif)
HOU1THK) nostij-u. awi-u (dissyllabe).

PLURIEL.
Nominatif-vocatif.
Sanscrit.......... ......prîiay-as.
Zend.................. âfrîtay-ô (avec c'a : âjrîtayas-c'a).
Grec.................-srépTi-ss.
Latin................. turrê-s (S 23o).
Gothique..............anstei-s.
Lithuanien............. âwy-s ( = awi-s ).
Slave.................. nosti '.
Vieux haut-allemand......ensti. .
Arménien.............. ôi’-q.
Accusatif.
. ' *
Sanscrit............ ... pritî-s.
Zend..................âfrîtay-ô, âjrity-ô, âfrîlî-s (avec c'a : âfri+.
tay-as-ca).
Grec................... «éprt-as, «<Jpr*-s.
Gothique-........... . .. ansti-ns.
- Lithuanien............. amis.
Arménien............. ô^’-s.
Slave.................. H0U1THM rioètif.
Vieux haut-afiemsnd...... ensti.
■ «
Sanscrit...........v • • • pnti-Vis.
Zend................. • • âfrîti-bw■ -
Arménien.............. ôli-vq.
Lithuanien.............. awi-mh. • -
Slave................ - noêti-m■
Datif-ablatif.
Sanscrit................. prtti-b'yas.1
1 Le thème masculin punti « chemin s tait au contraire (1/NTHK puntij-e.
RÉCAPITULATION. S 255.

103

2en(l.................. (îfrîti-byô (avec c’a : âfrili-hjaé-cu).
Latin................. tun-i-bus.
Lithuanien (datif). ....... awï-mus, plus tard awï-ms.
Slave (datif)...........noête-mü.
Gothique (datif)......... ansti-m.
Vieux haut-allemand......ensti-m, ensti-n.
Arménien (datif-ablatif-gén.). ôli-i (S ai5, a).
Génitif.
Sanscrit................ prïtî-n-âm.
Zend.................. âfrîli-n-anm.
Latin................. turri-um.
Grec.................. «opTt-iwi».
Lithuanien....... ...... awi-û (dissyllabe).
Borussien.............. nidruwitigi-n (masculin) rincredulorunm.
Vieux haut-allemand......ensti-ô.
Gothique............... anst’-ê.
Slave.................. NOLUTHH nostij.
Locatif.
Zend..................âfrtti-éva (ou -su).
Sanscrit................prüi-su.
Lithuanien............. avoi-sà, -su, -se.
Slave................. H01HT6X3 mste-chü.
Grec (datif)........\ . . . «épTi-a-i.
Thèmes neutres en ».
SINGULIER.
Nominatif-accusatif-vocatif.'
|
Sanscrit........... .. | |
|
Zend............... | |
|
Grec............... | |
|
Latin.............. | |
|
Le reste comme au |
masculin. |

104
FORMATION DES CAS.
DUEL.
Nominatif-accusatif-vocatif.

Sanscrit................ mri-iyî (sur n, voyez S i7b).
Le reste comme au masculin.
PLURIEL.
Nominatif-accusatif-vocatif.
Sanscrit................varî-n-i.
Zend.................var’-a?
Crée..................(Bpi-a.
Latin.................mari-a.
Gothique............... thrij-a expia».
Vieux haut-allemand......dri-u ( S 2 3 9 ).
Le reste comme au masculin.
Thèmes masculins en u, correspondant à des thèmes jjrecs en v, à des thèmes slaves en 2 «.
singulier.
Nominatif.
Sanscrit................mrn-s.
Lithuanien. ............sünîi-s.
gothique............... sunu-s.
Zend..................pasus.
Latin. ...........V. . . pecu-s.
Grec................. vêtais. ■
Slave................. C2IN2 sünù «fils».
Accusatif.
s y
Sanscrit................ sûnù-m.
Latin................. pecu-tn. %
Zend..................pasû-m.
Grec.................. vénv-v.

RÉCAPITULATION. S 255.
105
Lithuanien Gothique. -Slave. . • •
sunu-h.

Sanscrit. Zend...
sünü.
Instrumentât.
s&m-Vrâ (védique pralâhav-â,
S i58).
paév-a.
de prabâhu,
Datif.
Lithuanien.............*«»«-*' (dissyllabe).
Ablatif.
2en(j..................pasau-d (i»« S 3a ), paéëu-d.
Latin................magistratu-d.
Génitif.
Védique..............paév-as.
2end................. paéëu-s, pasv-ô (de paév-as).
Latjn................pecâs, senatu-os.
Grec................véwt-os.
Locatif.
Védique............... sânàv-i.
Slave................ sünov-i.
Lithuanien............. «miu (dissyllabe).

10G
FORMATION DES CAS.
Sanscrit.. . Lithuanien. Gothique. .
Zend.....
Grec.....
Slave....
Vocatif.
sunô (de s&nau).
sAmau.
sumu.


vénv.
CSIHOtf sünu.
DUEL.
?
, Nominatif-accusatif-vocatif.
Sanscrit (nomin.-accusatif).. suniï; vocatif : sunu.
Zend..................P«sâ.
Lithuanien............. sünù.
Slave................. CSIHSI sünü.
Instrumeutal-datif-ablatif.
Sanscrit..........-,..... sunû-liyatn.
Zend..................pasu-bya.
Grec (datif-génitif)....... vexv-o-tv.
Slave (instrumental-datif ).. süno-ma.
Lithuanien.............sünh-m (§ a a a).
Génitif-locatif.
Sanscrit. ............. mnv-os. ,
Zend...........................
Lithuanien (génitif)......sûn’-u.
\ PI,UIUEL.
Nominatif-vocatif.
Sanscrit (nominatif )......mmv-as; vocaLif: sunav-as.
Grec.................. véxv-es. \
Zend..................pasv-â (avec c'a : pasvas-ca).
Latin.................pecû-s. . .
Gothique............ ... sunju-s (pour urniu-s, de sunau-s, S a3o).
Lithuanien............. sunü-s.
Slave.............«i • - ■ sünov-e.
Datif-ablatif.
Sanscrit................ mm-liyas.
Zend..................pah-byô. *
Latin.................pecu-bus.
Lithuanien (datif)........ süm-mus.
Gothique........:----- • sunu-m,
Génitif.
Sanscrit...
Zend.....
Latin. . .. Grec. .... Gothique.. Lithuanien
sûnû-n-âm, paév-ahm. pccu-um.
VSKb-COV. .
suniv-ê. sün’-û.
Locatif.
Sanscrit..............sûnùrêu.
Zend........... . , . paéu-im (ou poJu-êu).
Lithuanien............. s&nùrsà, -sù, -si, -s.
Grec (datif)......, ... véxv-ai.

RÉCAPITULATION. S 255.
107
Sanscrit.. . • Gothique.. .
Latin.....
Lithuanien.
Zend......
Grec......
Sanscrit...
Zend.....
Lithuanien Slave.....
Accusatif.
sûniï-n(s).
sunu-ns.
pecu-s.
sünii-s.
pasv-o (avec c'a : paév-oé~ca).
'H?
véxv-as. .
Instrumental.
sùm-bis.
pasu-bis.
sûm-mis.
süno-mi.

Remarque* Il y a en sanscrit les mêmes différences entre la déclinaison des thèmes*féminins en w et celle des thèmes masculins qu entre ulfrl priti (féminin) et îrfPT agni (masculin).
FORMATION DES CAS.

108

Thèmes neutres en u, correspondant aux thèmes grecs en o.
SINGULIER.
Nominatif-accusatif-vocatif.
|
Sanscrit......... | |
|
Zend........... | |
|
Grec........... | |
|
Latin........... | |
|
Gothique........ |
Le reste comme au masculin.
DUEL.
Nominatif-accu8atif-vocalif.
Sanscrit................ màdu-nrî.
Zend.................. maê>-i.
, Le reste comme au masculin.
PLURIEL.
Noininalif-accusatif-vocalif.
Sanscrit................ màM-n-i.
Zend........ madb-a.
Grec.................. (téffv-a.
Latin.................pecu-a.
Le reste comme au masculin.
N .
Thèmes finissant par une consonne. i° Mot-racine (S 111).
singulier.
Sanscrit. Zeurt. Latin. Grec.
Thème...........vâe vdc' vôc àit
Nominatif. ......vâk vâU-s voc-s dit-s
Accusatif..........viïc-amvâc-ëm vâc-em Ôir-a

|
Sanscrit |
Zcnd. |
|
. vâc-â' |
vâc-â |
|
. vâc-e |
A / A vac-c |
|
. vâc-âs* |
vâc-ad |
|
. vâc-âs |
vâc-ô3 |
|
. vâc-i |
vâc-i |
|
. vâk |
vâU-s ? |
RECAPITULATION. S 255.
109

Instrumental......
Datif............
Ablatif..........
Génitif.........
Locatif (datif grec). Vocatif..........
Latin. Grec.
VÔC-Î • . . . ■
vôc-e(d) .. ..
vôc-ü ÔTt-ÔS
......... crtc-i
vôc-s Ôir-s.
Nom.-accusatif-vocatif. vac-âu vâc-âo
Védique..........vâc-â vâc'-a
Instrum.-datif-vocatif. vâg-liyâm ?
Génitif-locatif.....vâc-us vâc-ô?
PLURIEL.
Nominatif-vocatif. . ■ vâc'-as
Accusatif..........vâc-as
Instrumental.......vâg-Vts
Datif-ablatif....... vâg-tiyàs
Génitif...........vâc-üm
Locatif (datif grec).. vâle-êû
vâc-ô 4 ÔTt-SS
vâc-Ô ......... Sir-as
? ...............
? vôc-i-bus5 .....
vâc’-ahm vêc-um ôir-âv
vâü-sva ? .........irtt-ol.
> Sur l’accentuation des mots monosyllabiques en sanscrit et en grec, et sur la différence qui existe à cet égard entre les cas forts et les cas faibles, voyez S 13a.
* Venant de vd<!-ât, voyez S 102.
3 Avec éa : vdôaif-éa.
4 Voyez S 226.
5 On peut aussi diviser ainsi : vâci-bus, et admettre que le thème a été élargi par l’addition d’un i, comme au nominatif et à l’accusatif. De même au duel de la troisième déclinaison grecque (ô-rceiv, moetoity etc.), on peut considérer 1 o comme une addition au thème qui a eu pour effet de le faire entrer dans la deuxième déclinaison, On peut comparer à cet égard l’o qui, dans les composés comme (jSuo.oMyos, ®o-èovéSit, est ajouté à la fin du premier membre. De même aussi en pâli les formes comme carantê-hï (instrumental pluriel) viennent d’un thème caranta, qui s’est formé par élargissement de éarrnt «allant», comme en grec Çepôvioiv {<pep6vxo-w) d’un thème pepovro.
|
Sanscrit. Virant 1 Varan Vâranl-arn |
Zend. Grec. bavant* Çépovr baran-s pépwv barënt-ërn pépovr-a |
Latin. ferent r.____ .. jvrvn-8 ferent-em |
Gothique. fijand3 jijuna-s fijand |
|
barat-ê |
barënt-ê ........ |
ferent-i |
fijand |
|
Vàrat-as4 |
barënt-ad ........ |
ferent-e(d) ...... | |
|
Vâral-as |
barënl-ô6 pépotn-os ferent-is |
fijandis8 | |
|
MraH |
barënt-i pépov T-t | ||
|
Varan |
baran-s pépuv |
feren-s |
fijand. |
|
DUEL. | |||
|
bavant-âo ........ | |||
|
Vârant-â |
barant-a pépovr-e |
■ I t M t < | |
|
b'àrad-Vydm |
baran-bya1 <psp6v r-o-iv |
8 . | |
|
Vàrat-ôs | |||
|
PLURIEL. | |||
|
’ Vârant-as |
barënt-â8 pépovr-ss |
S 226. |
fijatid-s |
|
Vârat-as |
barënt-â pépotn-as |
. fijand-s | |
|
Vârad-Vis |
bar an-bis ....... | ||

HO
FORMATION DES CAS.
TUcmc masculin finissant par un t (un d en gothique).

Instrumentai.
Instr.-datif-abl. Datif-gén. grec. Génitif-locatif..,
Instrumental.
1 Forme faible Virât, voyez S 129. En gépêral, dans les thèmes primitivement terminés en nt, le sanscrit ne conserve la nasCe qu’aux cas forts.
3 Ou barènt. ' '
s «Ennemi» en,tant que «haïssant»; voyez S s 25.
4 De b'ârat-at,tijffyezS 10a.
6 Barënt-ai-éa «ferentisque». • .
8 Voyez la note de ia page précédente sur Qepovroiv.
4 Avec ca : barënt-ai-ia.
RÉCAPITULATION. S 255. Ml


Sanscrit. Zend. Grec. Latin. Gothique.
Datif-ablatif. . . . lidrad-Iiyas baran-byô ........1 2
Génitif.......Mrat-âm barënt-ahm pspôvr-av .......fy'and-ê
Locatif(dat.grec) bàrat-su ........(pépov-ai ..............
3° Thème masculin finissant par un n. Nous prendrons comme exempies les thèmes suivants :
Sanscrit................ üsman «pierre».
Zend.................. asman «ciel».
Grec.................. Saffwv.
Latin.................sermon.
Gothique............... ahman «esprit».
Vieux haut-allemand...... ohson «bœuf».
Lithuanien............. akmèn «pierre».
Slave.................. KdMEN kamen «pierre».
Arménien.............. akan «œil» (§ i83\ t), esnn
«bœuf». •
SINGULIER. 118
Nominatif.
|
Sanscrit.............. | |
|
Zend............... | |
|
Latin.............. | |
|
Lithuanien........... | |
|
Slave.......... ;____ | |
|
Gothique............. | |
|
Vieux haut-allemand... | |
|
Grec............... | |
|
Arménien........... | |
|
Accusatif. | |
|
Sanscrit............. | |
|
Zend............... |

112
FORMATION DES CAS.
Latin...........
Grec............
Gothique.........
Vieux haut-allemand Arménien........
Sanscrit.. Zend.... Arménien
Sanscrit..........
Zend............
Latin...........
Slave............
Gothique.........
Vieux haut-allemand Arménien........
Sanscrit.. Zend.... Latin. .. Arménien
sertmn-em. balpov-tx. ahman. ohson. akn, esn.
Instrumental.
àématirâ.
aémavra.
akam-b, esam-b (S i83\ h).
Datif.
déman-ê. asmain-ê. . sermôn-î. kamen-i. ahmin.
ohsin. - -
aie an, esiti.
Ablatif.
àéman-as (de dhmn-at, % 10a).
aéman-ad.
sermôn-e{d).
akan-ê, esan-ê.

Sanscrit..... ....
Zend............
Grec...........
Latin...........
Gothique.........
Lithuanien. ......
Slave............
Vieux haut-allemand Arménien........
Génitif.
àéman-as.
asman-6 (avec c'a : aéman-aé-c'a).
baffiov-às.
sermôn-is.
ahmin-s. .
akmèn-s.
ohsin. akan, esin.

RÉCAPITULATION. S 255.
113
Locatif (datif grec).

Sanscrit................ âsman-i.
Zend.................. asmaitiri,
Slave.................. kamen-i.
Grec.................. Sa/ftotM.
Vocatif.
Sanscrit................ âsman.
Zend.................. asman.
Grec.................. Safftot».
Arménien.............. akn, em.
Latin................. sermô.
Gothique.............. - ahma?
Vieux haut-allemand......ohso.
Lithuanien............. aJaniï.
Slave................Icamü.
DUEL, '
Nominatif-accnsatif-vocatif.
Sanscrit................ dsmân-âu.
Védique..............âémân-â.
Zend............. ... asman-âo ou arnan-a.
Grec.................. Sa/fiov-e.
Sanscrit.........
Zend...........
Grec (datif-génitif)
Instrumental-datif-aMatif.

asma-bya.
Satfxôv-o-iv (S a55, p. 109, note 5).
Génitif-locatif.
Sanscrit................ àsman-âs.
Zend..................asman-ô?
Lithuanien (génitif)....... akmen-û (S aa5).
h.

114 FORMATION DES CAS.
PLURIEL.

Nominatif-vocatif.
Sanscrit................ ûémân-as.
Zend.................. asman-ô (avec c'a : asman-aé-ca).
Grec................. WfMw-es.
Gothique............... ahman-s.
Lithuanien.............. dkmen-s.
Arménien. ............. akun-q, esin-q.
Slave......... ........ kamen-e.
Vieux haut-allemand...... ohsun ou ohson.
Accusatif.
Sanscrit................ àéman-as.
Zend.................. asman-ô (avec c'a .- asman-aé-ca).
Grec.................. S*((top-as.
Gothique............... ahman-s.
Arménien.............. akun-Sj esin-s.
Vieux haut-allemand...... ohsun, ohson.
Instrumental.
Sanscrit................ àéma-b'is.
Zend.................. aéma-bis.
Arménien.............. akam-bq, esam-bq.
Datif-ablatif. .
Sanscrit..........>.....déma-b'yai.
Zend.................. asma-byô (avec ca : aéma-byaé-c'a).
Gothique (datif)......... ahma^m.
Vieux haut-allemand......ohsô-ml. 119 120
Arménien (datif-ablatif-gén.). akan-i, esan-i1.

RÉCAPITULATION. S 255.
115
Sanscrit..........
Zeml............
Latin...........
Gothique.........
Vieux haut-allemand Lithuanien.......
Sanscrit. Zend... Grec. . •
Génitif.
âéman-âm.
asman-ahm.
sermân-um.
ahman-ê.
ohsôn-ô.
akmen-u.
Locatif (datif grec).
àéma-m.
ama-hva.
Saffto-tri.

' h° Thème neutre finissant par un n.
Nous prenons pour exemples les thèmes suivants :
Sanscrit..........
Zend............
Grec............
Gothique.........
Vieux haut-allemand
Latin...........
Slave............
ritiman.
nâman.
TdtXav.
hairtan «cœur». hërzan, hërzun. nômen, nômin. imen «nom».
SINGULIER.
Nominatif-accusatif.
Sanscrit..........
Zend........... .
Gothique.........
Vieux haut-allemand
Grec-...........
Latin...........
Slave............
mina.
nâma.
hairtô.
kêrza.
T*Xai>.
nômen.
HAU iman.
Sanscrit.
Vocatif.
niïman ou nama.
S.
11G

FORMATION DES CAS.

Zend.................. nâman.
Grec..................
Latin................. nômen.
Gothique...............hairtô.
Vieux haut-allemand...... hërza.
Slave.................. *««»•
DUEL.
Nominatif-accu6atif-vocalii’.
Sanscrit. Zend... Slave...
namn-î. nâmain-i. imen-i.
PLURIEL.
Nominatif-accusatif-vocatif.
Sanscrit................ nUmân-i.
Zend..................nâman-a.
Grec.................. TâXav-<x.
Gothique............... hairtôn-a.
Latin................. nôtmtira.
Slave.................. imen-a.
Vieux haut-allemand...... hêrzûti.
5“ Thème finissant par un r.
Nous prenons pour exemples les thèmes suivants :
Sanscrit................ dubitdr « fille r.
Zend..................duÿdhr.
Grec..................S-iyarep.
Latin................mâter-
Gothique...............dauhtnr.
Vieux haut-allemand...... tohter.
Lithuanien. ........... duktkr.
Arménien. .. ....... duster.
Slave........ *......... ASUlTep düMer.
Nominatif.
|
Sanscrit ............. duhita. | |
|
............. dusdh. | |
|
Lithuanien.......... | |
|
Vieux haut-allemand... | |
|
... &vyârnp. | |
|
i .im .............. mater. | |
|
Arménien........... | |
Accusatif.
Vieux haut-allemand...... tohter.
Arménien. ........ • • • • • de ter.

RÉCAPITULATION. 8 255.
smeutiEit.
117

Sanscrit................ duhitar-am.
Zend..................dufedkr-ëm.
Latin................. mâlr-em.
Grec.................. S-uyarip-a.
Slave.................. düker-e.
Gothique............... dauhtar.
Vieux haut-allemand......lohter.
Arménien.............. dustr.
Instrumental.
Sanscrit........ ........duhitr-à.
Zend.................. du§târ-a.
Arménien.............dster-b (S i83 , 4).
Datif.
Sanscrit................ duhilr-ê.
Zend.................. dv$d%r-ê (8 178).
Latin................. mâtr-{-
Slave................. düiter-i.
Gothique............... dàuhtr.

118
FORMATION DES CAS.

Ablatif.
|
Sanscrit.............. |
.. duhitùr. |
|
Zend................ |
.. dujrder-ctd. |
|
Latin............ • • • |
.. inâtr-e(d). |
|
Arménien............ |
.. dster-ê. |
|
Génitif. | |
|
Sanscrit.............. |
.. duhitùr. |
|
Zend................ |
. . dugder-ô (avec c'a : dufcdër-ai-ca). |
|
Grec................ |
.. &vya.Tp-ôs. |
|
Latin............... |
. . mâtr-is. |
|
Lithuanien........... |
. . duktèr-s. |
|
Gothique............. |
.. dauhtr-s. |
|
Slave................ |
. . düster-e. |
|
Vieux haut-allemand. ... |
. . tohter. |
|
Arménien............ |
. . dster. |
|
Locatif (datif grec). | |
|
Sanscrit.............. |
.. duhitâr-i (S 20B). |
|
Zend................ |
. . dufedër-i. |
|
Grec............... |
. . . Qvyavp-l. |
|
Slave................ |
. ,. düéter-i. |
|
Vocatif. | |
|
Sanscrit.............. |
. . dûhitar. |
|
Grec................ |
.. Q-ùyarep. |
|
Gothique............. |
. . dauhtar. |
|
Vieux haut-allemand,' ... |
. .. tohter. |
|
Arménien........... |
. .. dustr. / |
|
Latin.............. |
... mater. |
|
Zend............... |
... dufedhrt (S 46). |
DUKL. .
Nominatif-accueatif-vocatif.
Sanscrit (nomin.-accusatif). duhitâr-âu; védique duhitâr-â; vocatil duhi-
tnr-âu ; védique dùhitar-â.
I nslrumentai-d atif-ablatif.
Sanscrit..........
Zend...........
Grec (datif-génitif)
. . duhitr-Vyâm.
.. dujrditr-ë-bya.
. . &vyaiép-a-iv (8 205, p. 109. note 5).
Génitif-locatif.
Sanscrit................. duhitr-os.
Zend.......... dufed'ër-ô ?
Slave.................. düster-u.
Lithuanien (génitif)....... dvkter-u.
PLURIEL.
Nominatif-vocatif.
Sanscrit (nominatif)...... duhitàr-as (vocatif duhitar-as).
Zend.................. dufedhr-â (avec ca ; dufeddr-as-ca).
Grec.................. &vyarép-es.
Lithuanien.............dhkters.
Arménien..............dsler-q121.
Accusatif.
Sanscrit.. Zend... . Grec.... Arménien

RÉCAPITULATION. 8 255.
119
Zend.. Grec..
dufedar-âo ou dufcd'a Q-vytnép-s.
r-a.

duhitfs (= duhitrî-S; S aAa ). dufr£ër-6? (avec c'a : dujrdér-aé-ca). &uy«.Tép-its. dster-s.
Instrumental.
Sanscrit................ duhitf-bis.
Zend.................. du$cfér-ë-bis.
Arménien.............. dster-bq (S 216).
Sanscrit................ duhitr'-Hyas.
Zend..................dufcdër-ë-byô.
Arménien (datif-ablatif-gén.). dster-z.
Génitif.
Sanscrit................ duhilr-n-âm ’ ; védique svâsr-âm îrserorams
(S a4g).
Zend.................. dufadèr-aim.
Latin................. mâtr-um.
Grec.................. QvynTép-cov.
Gothique............... dauhtr-ê.
Slave.................. dûêter-ü.
Locatif (datif grec).
Grec..................QvympirOi (de Qv/arâp-tri, S 254).
6° Thème neutre finissant par un s. Nous prenons pour exemples les thèmes suivants :

120
FORMATION DES CAS.
Datif-ablatif.

Sanscrit................iwtias irair, ciel».
Slave.................. nebos, nebes122.
Grec.................. véÇos, véÇss.
Zend.................. marné «esprit».
Latin................ grenus, gener.
SINGULIER.
Nominatif-accusatif-vocatif.
Sanscrit................ ndb'as.
1 —dubitrt^n-âm, du thème duhitri. Ce génitif ainsi que l’accusatif duhitf-t ne devraient pas, à la rigueur, figurer id. . .
’ La différence de la voyelle dans les çaB dépourvus de flexion (véÇot, slave neho) vient très-probablement de ce que les formes .chargées d’une désinence casuelle ont préféré à Vo la voyelle plus légère e. C’est le même rapport qui existe en latin entre gémis et grnr-w, entre corpus et corpor-ù (voyez S 8 ).

121
RÉCAPITULATION. 8 255.
|
Latin......... |
........genm. |
|
....... manô (avec c’a : manas-ca). | |
|
Slave.......... |
Instrumental.

Sanscrit................ naBas-â.
2en(l........ mananh-a *.
Datif.
Sanscrit................nàbas-è.
Zend.................. mamnh-ê.
Ablatif.
Sanscrit................ nâbas-as (de mbas-at, S îoa ),
Génitif.
Sanscrit................ ndÜas-as.
Grec..................vé<pe(o)-os.
Locatif (datif grec).
Slave................... nebes-i.
Grec..................' t>éÇe(<r)-t. 122

122
FORMATION DES CAS.
DUEL.
Nominatif-accusatif-vocatif.

Sanscrit......... ......nabas-i.
Slave.................. nebes-i.
Zend..................manah-i.
I nstrumental-datif-abïatif.
Sanscrit............... • nabo-b'yam.
Zend.................. mauê-bya.
Grec (datif-génitif)....... vepé(<r)-a-tv (S s55, p. 109, note 0).
Génilif-iocalif.
Sanscrit................ nabas-o.
Zend.................. mananh-ô ?
Slave.................. nebes-u.
PLURIEL.
Nominatif-accusatif-vocatif.
Sanscrit................ nàbâns-i.
Zend.................. manâo, de man&onh-a (S 233).
Slave.................. nebes-a.
Grec................. vé?s(e)-a.
Latin.................gener-a.
Instrumental.
Sanscrit................ nàbô-bis.
Zend.................. manë-bis (S 3i).
Datif-ablatif.
Sanscrit................ mbô-byas.
Zend.................. mam-byô (S 3i).
Génitif.
A ^
Sanscrit................ mbas-am.
Zend.................. manành-abm.
Latin.................generum.

DÉCLINAISON SLAVE. § 256.

Grec.................. vsÇé(ar)-uv.
Steve.................. nebes-&-
Locatif (datif grec).
Sanscrit................ nâVas-su ou nâliak-su.
■jm\.................. manô-hva.
Grec.................. véÇ&a-ai.
LA DÉCLINAISON EN ANCIEN SLAVE.
THÈMES.
S a56. Nécessité de rechercher la vraie forme du thème.
Pour pouvoir comparer les suffixes casuels de 1 ancien slave a ceux des langues congénères, il faut avant tout chercher a reconnaître quelles sont les vraies lettres finales des diverses sortes de thèmes : au nominatif singulier ces lettres finales se sont généralement émoussées ou altérées, de sorte qu’elles ont l’air, dans les cas obliques, ou bien d’appartenir à la désinence, ou bien d’être introduites dans le mot comme un élément étranger à la fois au thème et à la terminaison. Dobrowsky les appelle, en effet, des augments; mais après avoir constaté jusqu’où s’étend véritablement le thème, nous trouverons souvent pour les désinences casuelles de tout autres formes que Dobrowsky. Ainsi nous n’attribuerons pas au nominatif des thèmes neutres une désinence voue, mais nous reconnaîtrons que ces thèmes ont mieux conservé à ce cas leur voyelle finale que le masculin. Poui le maniement pratique de la langue et au point de vue exclusif des idiomes slaves, on pourra continuer a regarder comme flexion ce qui est ordinairement présenté comme tel. Mais l’objet que nous nous proposons est autre. Il ne suffit pas que 1 instinct de ceux qui parlent une langue prenne certaines syllabes pour 1 ex-
FORMATION DES CAS.

124

pression des relations casuelles : il faut encore que l’analyse comparative nous démontre que ces syllabes sont des flexions authentiques et qu’elles en remplissent l’oflice depuis des milliers d’années123.
§ 257. Thèmes masculins et neutres en 0.
Aux thèmes masculins et neutres en e* a répondent, en ancien slave comme en grec, des thèmes en o2; cette voyelle devient s ü au nominatif-accusatif singulier ; mais elle reste invariable au neutre, ainsi qu’au commencement des composés, où c’est le thème nu qui paraît, suivant l’ancien principe des langues indo-européennes. Ainsi, au lieu de nova «novus», on a nom dans plusieurs composés (noeopo;kaenx novo-rosdenü «nouveau-né»); mais novo ne représente pas ici le neutre : c’est le thème commun au masculin et au neutre, dans lequel le genre n’est pas indiqué.
La preuve la plus claire que la classe de mots en question représente celle qui en sanscrit , en lithuanien et en gothique se termine par a, c’est que les thèmes féminins correspondants finissent en a (pour le 1T â sans ;rit) ; ainsi à rabü (pour rabo) «valet» répond un féminin raba «servante». Tous les adjectifs primitifs, c’est-à-dire ceux qui suivent la déclinaison indéfinie, représentent des adjectifs terminés en sanscrit par as, à, a-m, en grec par o-s, v (a), 0-1», en latin par
DÉCLINAISON SLAVE. S 258.

125

n-s, a, u-m, quoiqu’on puisse être tenté de rapprocher, d’après leur apparence extérieure, les adjectifs terminés au nominatit masculin en t « et au neutre en e, par exemple am sini «cæru-leus», CHNE sine «cæruleum», des adjectifs latins comme miti-s, mite.
Dans les adjectifs comme celui.que nous venons de citer et dans les substantifs de formation analogue, comme kha3i, knahsï «prince», more «mer», je reconnais des thèmes qui, sans la . règle euphonique mentionnée précédemment (S .92k), seraient terminés en jo; jo s’est changé en je qui, au nominatif-accusatif masculin , en vertu de la loi de suppression de la voyelle finale du thème, est devenu k l, et au neutre e, avec suppression du j et maintien de la voyelle. Ces thèmes répondent donc aux thèmes indiens en ^ ya, aux thèmes grecs et latins en to, iô (âyio-s, ayio-v, sociu-s, prœliu-m).
Les féminins confirment encore cette explication, car les thèmes féminins sanscrits en ^TT yâ (grec ta, latin ia et lé) répondent aux thèmes slaves en ja, et cette forme fait pendant, au nominatif dépourvu de flexion, à la désinence masculine k ï et neutre e; exemple : cimra sinja «cærulea», à côté de smï «cæ-ruleus» et de sine «cæruleum». Quand le j des thèmes masculins en jo est précédé dhme;voyelle, si IV est supprimé, le j, suivant la différence des cas, devient h i, ou il est maintenu (sûus la forme ii) et il fait alors une diphthongue avec la voyelle précédente; exemples : Kpdü kraj «margo, marginem», instrumental KpdUMH krai-mi, du thème masculin krajo; uiotfit suj «sinister», de sujo = sanscrit sttvyâ, nominatif masculin savyâ-s; eoamii bosij « divinus », du thème bdsijo.
"1

126

FORMATION DES CAS.
S 25g. Triple origine des thèmes en jo.
Les thèmes masculins et neutres en jo124 avec leurs féminins en ja proviennent d’une triple origine :
i° Ceux qui, comme sujo = ÇRT savyd «sinister», ont eu de tout temps, comme parties intégrantes du thème, la semi-voyelle et la voyelle suivante ; ce cas est peut-etre le plus rare.
9° Ceux qui se terminaient primitivement par i, auquel est venu se joindre un o inorganique, de même qu’en lithuanien les thèmes masculins en i passent à plusieurs cas dans la déclinaison en ia, ie (SS 178 et 91 h). Tel est, par exemple, morjo, nominatif-accusatif more « mer », dont 1 e n a, comme on voit, rien de commun avec l’e du latin mare, lequel est pour mari; si nous voulions trouver en slave le représentant de cet e latin, ce serait plutôt le j, que nous retrouvons au génitif morja et au datif morju, qui y répondrait; mais il faudrait que le mot latin, pour être de la même classe que le mot slave, fît au nominatif mariu-m.
B° Ceux où jo (= sanscrit ÿ«) est un suffixe secondaire sans influence sur le sens; il est ajouté à un premier suffixe de la même façon que le suffixe correspondant en lithuanien ia s’ajoute dans les cas obliques aux suffixes de participe ni et ms (§§ 787 et 788). Nous avons, par exemple, en ancien slave, teljo, nominatif T£<\K telï, qui répond au suffixe sanscrit târ (forme faible tr ou tr), grec ti;p, Top (nominatif tûjp), latin târ ; exemple : BAdro-Æ'fcTÉAt blago-dêtelï, thème blago-dêteljo «heneficus», mot com-

DÉCLINAISON SLAVE. S 260-261.
127
posé dont le second membre est identique au sanscrit dMtr, d'âtf « créateur, auteur».

S 260. Thèmes féminins en a. — Thèmes masculins en i.
Aux thèmes féminins sanscrits en « répondent, comme on l’a déjà dit, en ancien slave, des thèmes en a; exemples : BtAomi vïdova ( thème et nominatif) = sanscrit vidava « veuve », KOEd nova— sanscrit ndvâ « nova».
Parmi les thèmes en i il n’y en a pas en slave qui soient du neutre, et il n’y en a qu’un petit nombre qui soient du masculin (de même en lithuanien). Dobrowsky125 les considère comme des anomalies, et voudrait les rapporter à sa seconde déclinaison masculine ; mais en réalité ils n’ont rien de commun avec cette déclinaison, qui comprend les thèmes en 0 et eu jü (§ a63), au lieu que ceux dont nous parlons sont terminés en i. Ce n est qu’au nominatif-accusatif singulier que, par des raisons diverses, ces trois classes de mots se rencontrent, et que, par exemple, gostï «hôte», venant de gosti (gothique gasti, latin hosti), a la même forme que KHAqs knahzl «prince», de knanzjo, et que vraéï «médecin», de vraejü. Les thèmes masculins primitivement terminés par n (il n’y en a d’ailleurs qu’un petit nombre) forment la plupart de leurs cas d’un thème élargi par l’addition d un i ; par exemple, haïtien «pierre» (sanscrit asman) s élargit
en kameni et se décline ensuite sur gosti.
S 961. Thèmes féminins en i et en ü.
Aux thèmes féminins sanscrits en t répondent en ancien slave de nombreux thèmes terminés de même (S 255) : le slave se rencontre notamment avec le sanscrit dans la formation de thèmes féminins en ti, appartenant à des noms abstraits, comme pa-mah-ti

128

« mémoire », nominatif ridAUTi, pamahtï, qu’on peut comparer au sanscrit matî (pour manti) «esprit, opinion», de f^raan «penser» (comparez memini, mens, fxévos). Ces mots affaiblissent, il est vrai, au nominatif-accusatif, leur h en h ï, mais ils ne prennent aucun complément inorganique et ils ne sortent à aucun cas de la classe de thèmes à laquelle ils appartenaient primitivement; il ne faut donc pas les confondre avec la plupart des masculins qui ont au nominatif-accusatif la même terminaison. C’est une confusion de ce genre qu’on peut reprocher à la troisième déclinaison féminine de Dobrowsky, dont le type est tjtpKOEi. zer-kovï, qu’il faut lire, d’après Miklosich1, Ljp%Km zrükuvï. L’ancienne forme du nominatif est ypssai zrukü2, d’après l’analogie de cBeHpsi svekrü «belle-mère». Déjà dans la première édition de cet ouvrage j’ai conclu de ce fait que 21 ü est la vraie lettre finale du thème pour cette déclinaison, d’ailleurs peu nombreuse, et que le 21 ü doit se rapporter, au moins pour une partie de ces mots, à 1m sanscrit : en effet, svekrü répond parfaitement au thème sanscrit svasrû et au latin socru. Le nominatif sanscrit est svasrû-s auquel répond, à part l’abréviation de la voyelle, le latin socru-s, dont la désinence casuelle devait tomber en slave (S 9 2 m). Quant au reste de la déclinaison des thèmes, féminins en 21 ü, il ne répond pas à la déclinaison sanscrite des thèmes polysyllabiques comme svasrû, vadïï, mais à celle des thèmes monosyllabiques comme Brû «sourcil», Bû «terre»; cela ressort, comme il me semble, principalement de l’accusatif ijp2KXKe zrüküv-e, forme très-intéressante que j’ai seulement appris à connaître par Miklosich. Dobrowsky met zerkovï, comme ail nominatif; mais cette forme appartient à un thème en i, et non à un thème en ü, et correspond, par conséquent, à nostï «nox, noctem »(§ 2 5 5 ). Au contraire, l’accusatif zruküv-e « ecclesiam »,
1 Lexique.
a Miklosich, Théorie des formes en ancien slave, a' édition, p. 55.
DÉCLINAISON SLAVE. S 262.

129

que nous venons de mentionner, répond a'ux formes sanscrites comme Brüv-am, Büv-am, avec lesquelles nous avons comparé plus haut le latin su-em, gru-em1. Ce que zrüküv-e «ecclesiam» est au sanscrit Brüv-am, Büv-am, le génitif de même forme zrü-küv-e l’est à Bruv-ds, Buv-ds. Pour répondre aux génitifs des thèmes polysyllabiques sanscrits en û, comme vadv-âs, on s’attendrait à trouver en ancien slave une désinence si ü (§ 271). Au locatif sanscrit Bruv-l, Buv-i répond le slave zrüküv-i, qui compte en même temps comme datif, mais qui, en tant que datif, se rapporte probablement aux formes sanscrites comme Bruv-e, Buv-é (§ 267). Au génitif pluriel, zrüküv-ü s’accorde avec le sanscrit Bruv-âm, Buv-âm. Quant aux autres cas des thèmes slaves en 21 ü, ils ont tous élargi le thème par l’addition d’un i ou d’un a; l’addition de l’a a lieu seulement devant les désinences casuelles commençant par une consonne; exemple : zrüküva-mi «par les églises », zrüküva-chü « dans les églises » ; au contraire, zrüküvij-uh «par l’église», zrüküvi «les églises» (nominatif-accusatif et en même temps vocatif), suivant l’analogie de nosti.
S a6a. Thèmes masculins en ü.
La déclinaison sanscrite en u n’est représentée en ancien slave que par des masculins. Nous en avons un exemple dans C21112 sünü « fds », qui répond comme nominatif au sanscrit simit-s, au lithuanien sünù-s, et comme accusatif au sanscrit sûnû-m, au lithuanien sünu-n1. Les signes casuels s et m devaient tomber en slave (§ 93 Mais comme, en ancien slave, la voyelle finale des thèmes en 0 s’affaiblit également en 2 « au nominatif-accusatif, sünü 126 127
ii.
130 FORMATION DES CAS.


«filius, fdium» ne se distingue pas, quant à la désinence, de la forme mentionnée plus haut (§ 2 55) vlükü « lupus, lupum», en lithuanien wllka-s, mlka-h : c’est la même confusion qui a lieu en latin entre lupus, lupum (ancienne forme lupo-s, lupo-m) et Jructu-s,fructu-m, ce dernier avec un u organique=sanscrit u, grec u. Il y a une équivoque du même genre pour les cas où la désinence casuelle est précédée de o, parce que Fo est le représentant le plus ordinaire de Va sanscrit; mais comme ^ u également est devenu quelquefois o en ancien slave, j’ai rapporté plus haut (§ e55) les cas en question à la déclinaison sanscrite en u. Toutefois, les formes citées sous le S 2 55 sont en partie tres-rares et sont ordinairement remplacées par des formes de la déclinaison en o; par exemple le génitif sünu (=lithuanien sûnau-s) est remplacé par süna, le vocatif de même forme (= lithuanien sünaü) par süne, et le nommatif-accusatif-vocatif duel siinü (= lithuanien sûnù) par süna128. 1
Plusieurs cas de la déclinaison en ü, en ancien slave, s expliquent par l’élargissement du thème qui reçoit un o, avec gouna de la voyelle finale primitive; exemple : sünovo, qui est formé comme le sanscrit mânavâ «homme» (en tant que descendant de Manu), venant du thème primitif manu (§ 91 B). On peut comparer aussi cet élargissement du thème en slave avec celui qui a lieu en grec dans les formes du duel en o-iv, comme vexvotv (voyez p. 109, note 5), et Ton peut rapprocher de ce fait l'addition de Va du féminin à plusieurs cas des thèmes féminins en si ü, ce qui fait ressembler les formes comme zrüküva-chü r dans les églises » aux formes commevïdova-chü=sanscritm/avâ-su (S 279). De même le locatif sünovè-chü ressemble à vlükê-chü = sanscrit vrM-su. L’instrumental pluriel sünom est dérivé d’un thème sü-
DÉCLINAISON SLAVE. S 263. 131


mo, et répond conséquemment aux formes comme vlükü (S 2 77)
_ lithuanien wllkais, sanscrit vrkâis (venant de varkâis), zend vêrkâis; il ne peut s’expliquer que par un thème en 0, correspondant aux thèmes en a en lithuanien et en zend. Les autres cas que je fais dériver du thème élargi sünovo sont, au pluriel, le datif sünovo-mü, analogue à vlvko-mü (§ 255); l’accusatif s&novü, analogue à vlükü (S 255); le génitif sünov’-ü, analogue à vlük’-ü, et, au duel, le génitif-locatif sünov-u, analogue à vlük -u (§ 255). Mais on peut aussi, en ancien slave, décliner â tous les cas les thèmes primitifs en ü comme ceux en 0 (venant de a) et d’une façon inverse les thèmes primitifs en 0 d’après l’analogie des thèmes en»129. Toutefois, les adjectifs se sont tenus à leur ancienne forme dans la déclinaison indéfinie, c’est-à-dire dans la déclinaison simple; on n’a pas, par exemple, du thème masculin Mro «bon» (nominatif-accusatif Aoups dobrü), de formes comme dobrov-%, dobrov—c, mais seulement dobru comme datif, ACEpt dobrê comme locatif, dobn comme nominatif pluriel; et, de même, tout le reste de la déclinaison d’après vlükü (§ 255).
La déclinaison sanscrite et lithuanienne en u a tout a fait disparu pour les adjectifs en ancien slave : ainsi le thème sanscrit mrdû «doux, mou» (venant de mradü, comparatif mradîyas) est devenu en ancien slave mlàdo et se décline sur Mro, ce qui nous donne au nominatif masculin mladü, au féminin mlada, au neutre mlado.
S a63. Insertion d’un j devant l'u final du thème.
Nous avons vu (§ 2 58) que la présence d’un j devant la finale des thèmes en 0 = sanscrit et lithuanien a produit un change-
FORMATION DES CAS.

132

ment de déclinaison dont la cause est purement euphonique. Le même fait a lieu pour les thèmes en 2 ü, en sorte que la forme jev ou ev répond à la forme frappée du gouna ov, et pareillement je ou e répond à la voyelle o tenant la place d’un 2 ü dans les formes comme süno-mi «par le fils », siino-ma «aux deux» ou « par les deux fds ». Mais il n’y a pas, à ce qu’il semble, de thèmes organiques en jü pour représenter les thèmes sanscrits en «j yu et lithuaniens en iu, comme stég-iu-s «couvreur», dont le suffixe, ainsi que nous le verrons plus tard, répond au sanscrit yu. Les thèmes slaves en jü sont, ou bien des altérations de thèmes enjo, et nous ramènent, par conséquent, à des thèmes sanscrits en ya et lithuaniens en ia; ou bien ils viennent de thèmes masculins en i par l’addition d’un 2 ü inorganique.. G est ainsi que Dobrowsky 1 cite entre autres les datifs ognev-i «igni» et kamenev-i «lapidi», pour lesquels le sanscrit présente les thèmes agnl et dsman (venant de dkman). Le datif kamenev-i a besoin d’une explication spéciale : en ancien slave les thèmes en n forment une partie de leurs cas d’un thème élargi par l’addition d’> i i; du thème lcameni est donc venu, par un nouveau complément inorganique, un thème kammjü, qui a donné le datif kamenev-i.
§ s6A. Thèmes terminés par une consonne : thèmes en n, s, l.
Les thèmes terminés par une consonne ont pour finale en ancien slave n, r, s oq t; mais ils ont tous reçu, à la plupart des cas, une voyelle comme complément inorganique, principalement i130 131, ou bien encore o = sanscrit a. Nous reviendrons sur ce point en examinant les cas un à un. Dans le tableau comparatif de l’ancien slave avec les langues congénères (§ a55), je n’ai admis que
DÉCLINAISON SLAVE. § 264.

133

ceux des cas de la déclinaison à consonne qui ne viennent pas d’un thème élargi.
Les thèmes en n sont du masculin ou du neutre, et ont un suffixe formatif qui répond au sanscrit man (SS 799 et 801).
Les thèmes en s sont tous du neutre : leur suffixe formatif correspond, comme on l’a déjà fait remarquer, au sanscrit as, au grec os, S5, au latin us, er (§ 128 ). Comme ils ont aux cas dénués de flexion (nominatif-accusatif-vocatif singulier) la voyelle plus pesante 0 au lieu de la voyelle el, et comme ils sont oBligés de supprimer la consonne finale du thème (S 92“), ils deviennent semblables à ces cas aux thèmes neutres en 0 ( comme novo « novum ») : il n’est donc pas surprenant que plusieurs thèmes neutres en 0, entraînés en quelque sorte par leur analogie avec l’o des thèmes en s, adoptent le s dans les mêmes cas où ceux-ci l’ont conservé. Le fait que nous signalons n’a lieu d’ailleurs que pour les substantifs, jamais pour les thèmes neutres d’adjectifs en 0 : il n’y a point, par exemple, de génitif comme noves-e à côté du nominatif-accusatif-vocatif moto. Mais le substantif a*ao dêlo «œuvre» peut former ses cas d’après la déclinaison en s132 133. Inversement, les thèmes primitivement terminés en s peuvent tous être fléchis d’après la déclinaison en 0134, de sorte qu’au lieu du génitif organique nebes-e = sanscrit ndiïas-as (S 269), on peut trouver aussi neba. .
Les thèmes en T sont également du neutre : ils ont tous la voyelle nasalisée a ah comme avant-dernière lettre, qui devient la finale dans les cas dénués de flexion, attendu que le t du thème tombe quand il est à la fin du mot (§ 92 m). On peut comparer, par exemple, teaa telah «veau», pluriel telaht-a; osilah «petit âne», pluriel osïlaht-a, avec les formes grecques comme
134 FORMATION DES CAS.


îaUv, iaUvr-a, Çépov, (çépotn-ct. Je regarde, en effet, le suffixe formatif de cette classe de mots slaves comme identique avec celui du participe présent, et je mentionnerai d’avance un fait analogue pour le suffixe sanscrit ta, qui, d’une part, sert à former le participe parfait passif, et qui, de l’autre, forme des dérivés venant de substantifs ; ainsipaKtdns «pourvu de fruit» est forme du thèmepald «fruit». Sur des faits analogues dans les iangues congénères, voyez § 8ak et suiv. Mais pour revenir aux thèmes neutres en at ant de l’ancien slave, osïkh (thème ostlant «petit âne») est en quelque sorte un «âne qui commence» (deosïlü, thème osïlo «âne»), dêtan «petit garçon» est un «garçon qui commence» (du thème primitif dêto135, qui, à ce quil semble, n’est employé qu’au commencement d’un composé). Pour plusieurs formations en aht nous n’avons pas le mot primitif correspondant : il manque, par exemple, pour le nom précité tehn «veau», dont le primitif a dâ signifier «bœuf» ou «vache» (comparez le slovène telege (pluriel féminin) «joug à bœuf», téliti-se «vêler»). Il y a cette différence entre les véritables participes présents et la classe de mots en question, que les premiers élargissent dans les cas obliques, par une addition inorganique (S 783), le thème primitif terminé en t : de même, en gothique, les substantifs participiaux, comme frijônds «ami» (littéralement «celui qui aime»), se distinguent des participes présents proprement dits par une plus grande fidélité au thème

S a65. Thèmes eu
135

A la elasse de mots en r mentionnée au § 1 kk appartiennent en ancien slave les thèmes féminins mater «mère» (= sanscrit mâtdr, dorien (iôasp) et düéter «fille» = sanscrit duhitdr, grec Svycmp. Pour les cas formés du thème non élargi, voyez § 2 5 5 ; les autres cas viennent des thèmes élargis par l’addition d’un 1 (materi, düéteri) et se déclinent sur nosti, nominatif noétï «nuit». Les nominatifs mati, düéli n’ont pas la consonne r du thème, non pas, selon moi, à cause de la loi phonique examinée au §92“, mais parce que le r était déjà tombé au nominatif avant que les langues letto-slaves se fussent séparées de leurs soeurs de l’Asie (§ ihh). Si la perte de r dans les nominatifs slaves mati, düéti avait pour cause la loi phonique dont il était question plus haut, nous aurions probablement mate, düéte, car cette loi prescrit uniquement la suppression de la consonne finale et ne commande pas le changement de Ye précédent en i. Si, au contraire, on explique mati, düéti par le nominatif sanscrit mata, duhita, et si l’on accorde qu’il y a, quant au thème, entre le nominatif d’une part et les cas obliques de l’autre, une certaine opposition, on ne pourra s’étonner de rencontrer un i dans mati, düéti, et un e dans les cas obliques, par exemple à l’accusatif mater-e, düéter-e (= sanscrit mâtar-am, duhitàr-am). Le lithuanien, qui est très-étroitemenl uni au slave, présente les nominatifs môtê, duhte, sesü en regard des thèmes môtèr, duktèr, sesèr (les seuls qui soient terminés en r) : cet accord vient confirmer notre proposition, que la perte de la lettre r dans les formes analogues en slave appartient à une époque où les langues letto-slaves, le sanscrit, l’aiicien perse et le zend ne s’étaient pas encore séparés, et qu’elle ne doit pas s’expliquer par la loi phonique déjà plusieurs fois mentionnée.

136
SINGULIER.

S 966. Formation du nominatif, de l’accusatif et de l’instrumental.
Considérons maintenant de plus près la formation des différents cas, et d’abord celle du nominatif et de 1 accusatif singuliers. Ces deux cas ont perdu (§ 92 m) les signes casuels s et m, à l’exception des thèmes féminins en a, dont l’accusatif représente le m primitif et le n borussien par le son nasal faible dont il a été question ci-dessus (§ 92“) : ce son nasal détermine le changement de l’a primitif en u, de même qu’en latin nous avons au génitif pluriel la désinence um au lieu du sanscrit âtn (ped-um= sanscrit pad-am). On peut comparer klaoka vïdovu-ii avec le sanscrit vidavâ-m et le latin vidua-m; novu-h avec le sanscrit ndvâ-m, le latin nova-m; et, d’autre part, novü «novus, novumn (thème novo, § 267) avec le sanscrit ndva-s, wdva-m, latin novus, novu-ni, grec vdo-s, véo-v. Les thèmes en r, dont le nominatif vient d’être examiné {% q65), ont, quand ils ne passent pas dans la déclinaison en i, à l’accusatif un e, qui n’est évidemment qu’une voyelle de liaison (à l’origine un a), à l’aide de laquelle le signe casuel perdu était joint au thème. On peut comparer mater-e1 avec le sanscrit mâtdr-a-m, zend mâtar-ë-m, latin ma-tr-e-m, dorien fiârép-a. Les thèmes masculins en n ont au nominatif 21 M au lieu du sanscrit â, du lithuanien * ( § 1 ho ) ; exemple : KdA\2i kamü «pierre» = lithuanien akmü, sanscrit àsmâ. Si la suppression de la consonne finale avait eu lieu seulement au temps où la langue slave formait déjà une langue à part, et si elle devait s’expliquer par la règle énoncée au § 92 kamen aurait très-probablement donné kame, et non kamü, et le lithuanien,
Mikloaich, ouvrage cité, S 67.
DÉCLINAISON SLAVE. S 267. 137


qui tolère le groupe ns à la fin des mots, aurait conservé le n avec le signe casuel; il aurait donné par conséquènt akmèn-s au lieu de alcmü, dont Yù représente évidemment la sanscrit de âsm($ 92 ■). Les thèmes neutres en en n’ont pas laissé périr tout à fait la consonne finale du thème au nominatif-accusatif-vocatif, ou bien ils l’ont reprise sous la forme affaiblie h : aussi novfc imah «nom» (venant de nhnan) concorde mieux avec le latin nômen qu’avec le sanscrit nâma, le zend nâma et le gothique namô.
A l’instrumental, tous les masculins et neutres ont la terminaison mi. ml136. Pour les féminins, au contraire, cette terminaison manquerait si la désinence féminine a un n était pas, comme je le suppose, en ce qui concerne son h, un reste demi, mi, de même qu’à la première personne du singulier du présent la plupart des verbes ont it-w pour le sanscrit â-mi. Je crois, en effet, que l’instrumental ki>aokom\ vïdovoj-uh ( du thème vidova), dont le correspondant sanscrit est vidàvay-â, a ajouté a la desinence indienne ou primitive une désinence nouvelle, dont la forme plus ancienne ml s’est altérée en n. En ce qui concerne cette accumulation de deux désinences casuelles à signification identique, je rappelle le procédé analogue du dialecte védique et du zend, au nominatif pluriel (S 229).
Les thèmes féminins en h i changent cette voyelle devant la désinence * un en ij, comme en général, même dans les masculins, un i précédé d’une consonne et suivi d’une voyelle devient ij; exemple : noêtij-un «par la nuit». On a de même en pâli rattiy-â du thème ratti (§202).
8 267. Formation du datif et du locatif.
Pour les thèmes à consonne et pour les thèmes finissant par Zü = sanscrit u, le datif est en apparence identique au locatif : il
FORMATION DES CAS.

138

a îa désinence t ; exemples : sünov-i, kanieii-t, mater-i, nebes-t, quoi; peut comparer aux locatifs sanscrits sûndv-i( forme védique), dsman-i, mâtàr-i, ndbas-i. Mais je crois à présent que cet i slave représente le caractère du datif sanscrit ê = ai : de cette dipli-thongue, la dernière partie seulement se sera conservée en ancien slave, comme en lithuanien et en latin; pareille chose a heu au nominatif pluriel des thèmes masculins en o, comme vlük-i « loups », qu’on peut comparer au lithuanien mlka-i (dissyllabe), et th ti kceux-ci», qu’on peut comparer au dorien toi', au gothique thai, au sanscrit tê, au lithuanien te et au lette tce (= te). Ge qui me confirme surtout dans cette opinion, c’est que, en ancien slave, dans la plupart des classes de mots, le datif et le locatif sont rigoureusement distingués. Pour les thèmes masculin» et neutres en o, le n ê, qu’on rencontre par exemple dans NOEt novê r in novo », représente Vê sanscrit de ndvê ( venant de nava-i) et i’e lithuanien de formes comme wükè (en slave baxk-s vlüke). Au contraire, le oy tt du datif vlüku représente 1 ut lithuanien de wïlkui (8 176); il y a, par conséquent, suppression d’un t. Dans la déclinaison pronominale, TOAtoy to-rnu r a celui-ci » répond au sanscrit td-smâi et au lithuanien ta-mui (archaïque); tâ-m et le locatif to-ml to-mï répondent au sanscrit td-smin et au lithuanien tü-mi.
§ 268. Datif et locatif des thèmes féminins en a et en ja, des thèmes en i, en jo et en jü.
Le -b ê du locatif des thèmes féminins en a représente , comme contraction de ai, le sanscrit ây et le lithuanien ôj, par exemple dans dsvây-âm, et dans aswôj-e r in equâ » (§ 2 0 a ). On aura donc vïdovê sanscrit vicTavây-âm, pssKt ruhkê r in manu » = lithuanien rankôj-è. Au datif, le n ê du slave ruhkê répond à l’ai lithuanien de rankai (S 176). Les thèmes en H i, tant masculins que féminins , ont comme finale au datif et au locatif la finale du thème ;
DÉCLINAISON SLAVE. S 269. 139


exemples : gosti qui signifie aussi bien «hospiti» que «in hos-pite„ ; noéti « nocti » et «in nocte». On peut admettre qu’ici le caractère casuel i s’est fondu avec l’t du thème, comme dans les datifs latins tels que ovî = ovi-î, turrî = turri-î. Les thèmes mas-culinsTet neutres en jo et en jü, et les thèmes féminins en ja, contractent cette syllabe en i au locatif (ces derniers également au datif) sans adjonction de signe casuel; exemples : khasu knansi «dans le prince», ahijh lizi «dans le visage», vraci «dans le médecin », voli « voluntati » et « in voluntate », des thèmes lennhsjo (masculin), lizjo (neutre), vracjü (masculin), volja (féminin).
S 269. Formation du génitif. — Origine de la désinence pronominale go.
Au génitif, la terminaison as, os, is qui, dans les langues congénères, se joint aux thèmes finissant par une consonne, a dû perdre le s (§ g2ra); mais la voyelle est restée. Elle paraît sous la forme e à tous les thèmes finissant par une consonne, ainsi qu’aux thèmes féminins en 21 « (S 961); on a donc imen-e «du nom» qui répond à nâmn-as, nômin-is; nebcs-e «du ciel» qui répond à ndBas-as, vétyslo^-os ; mater-e qui répond à matr-is, fttirp-és; svekrüv-e «socrûs» qui répond aux formes comme bruv-ds « supercilii », b$pv-os. A cette analogie obéissent aussi les formes pronominales mcw-e « mei », teb-e « tui », seb-c « sui », dont les thèmes sont men, teb, seb.
La terminaison plus pleine des génitifs sanscrits en ^ sya se retrouve dans la désinence gu du génitif pronominal, par exemple dans to-go*=td-sya (S 188). Ce rapprochement seul pourrait tenir lieu de preuve ; mais qu’on veuille bien, pour achever 1 évidence, se rappeler le durcissement si fréquent de la semi-voyelle y en g et, en prâcrit, en (8 19); il serait d’ailleurs extrêmement invraisemblable que le slave se fût créé une terminaison toute nouvelle de génitif, terminaison complètement étrangère à toutes
1/tO FORMATION DES CAS.


les langues congénères. Si l’on prend donc le g de la désinence go pour un durcissement de j ( en sanscrit \y), ü se trouve que l’ancien slave a conservé de la terminaison sya exactement autant que le grec; go répondra au grec to (S 189), et, en particulier, to-go «hujus» sera le pendant du grec to-îo. Mais comme, en slave,les sifflantes alternent souvent avec les gutturales (892*), on pourrait conjecturer aussi que le g de go est l’altération de la lettre sanscrite s, et que la semi-vovelle de sya a disparu. Toutefois il ne faut pas perdre de vue qu’à l’ordinaire, en ancien slave, c’est seulement x, et non la moyenne gutturale, qui a pris la place d’une sifflante primitive. Aussi Schleicher1 et Miklosich137 138 adoptent-ils la première de ces deux explications139.
S 270. Génitif des thèmes en 0, en ü et en i.
Les thèmes en 0, soit de substantifs, soit d adjectifs, ont perdu l’ancienne désinence du génitif go; mais, par compensation, ils ont gardé l’ancien a du thème, au lieu de l’aflaiblir en 0 (§ 92 ); exemples : raba tr. servi », nova (= sanscrit nava-sya) « novi » (comparez S 190). Les thèmes en ü font régulièrement leur génitif
DÉCLINAISON SLAVE. S 271.

m

on ovf u, c’est-à-dire qu’ils prennent le gouna (§ 92 f); cette forme répond à la forme sanscrite ô-s et à la forme lithuanienne et gothique au-s, avec la suppression obligée de s (§ 92 "') ; exemple : cjiiiov sünu «filii», qu’on peut comparer au sanscrit sûnô'-s, au lithuanien sünaé-s, au gothique sunau-s. Les thèmes en i, tant masculins que féminins, ont le theme a 1 état nu ; exemples . jrosti, en regard du gothique gasti-s, du latin hosti-s; noéh * noe-tis», en regard du lithuanien nakte-s et des formes sanscrites et gothiques comme prîïê-s, anstai-s (§ 185),
S 271. Génitif des thèmes féminins en a.
Les thèmes féminins en a, à l’exception de ceux qui ont 7 comme lettre pénultième, changent au génitif cet « en si ii; exemple : vodü « aquæ », de voda. J’explique cet ü, ainsi que celui du nominatif-accusatif-vocatif pluriel, par l’influence euphonique de la lettre s qui terminait primitivement cette forme (§ 92J). Après j, le génitif est a ah; exemple : eoaia voljah «voluntatis». De même, dans la déclinaison féminine pronominale, on a des formes comme toia tojah, en regard du sanscrit ta-syas, du gothique thi-sôs (S 1 <7k) et du borussien stei-ses. Cette nasale, en ancien slave, ne peut guère s’expliquer autrement que comme la transformation d’un ancien s : je rappellerai la désinence prâ-crite ftj hih représentant le sanscrit bis et les formes grecques comme pépofxsv (dorien (pépopss), (pépsrov pour le r ■> ut barâmas, bdratas, bdratas (§ 97). Mais il est remarquable quen ancien slave la semi-voyelle j ait le pouvoir de protéger, jusqu a un certain point, le s qui se trouve à la fin de la syllabe suivante, en sorte que cette lettre ne se perd pas complètement, mais devient un n140. L’effet subsiste même dans les formes ou le j a dû dispa-
142 FORMATION DES CAS.*


raître en vertu du § 99k; ainsi nous avons de aovwaduia «âme» (pour dusja, venant de duchja = lithuanien düsià), le génitif singulier et le nominatif-vocatif pluriel AotfUJA dma-h, en regard du lithuanien dûsio-s, dusô-s.
S 272. Vocatif.
Au vocatif, qui en ancien slave comme dans les langues congénères est dépourvu de suffixe casuel, l’o s’affaiblit en e (s) et l’a en 0 (§ 9a*)1; on aura, par conséquent, nove venant de novo «neuf» : comparez le sanscrit nâva, le latin nôvë, le grec vé(F)e et les formes lithuaniennes comme porte. Le vocatif de voda «eau» est vodo, celui de volja est vole pour voljo, celui de knansjo «prince» est knanse2 pour knahsje. Les thèmes en 2 w frappent cette voyelle du gouna, ce qui nous donne otf m (§ 99f); exemple : csmovf sünu «fils», en regard du sanscrit suno, du lithuanien swnaû, du gothique surnu (§ ao5). Mais plus souvent les thèmes en ü, si la voyelle finale n’est pas précédée d’un;', passent dans la déclinaison des thèmes en 0; on a donc : süne, qui nous présente une forme plus altérée que Bp<mov vracu «médecin» venant du thème vraéjü. Ici encore, comme plus haut (S 271), dans les formes en jah, le; exerce une influence protectrice sur la partie du mot dont il est suivi.
Les thèmes en i, en ancien slave comme en zend et en grec, ont le vocatif identique au thème ; exemples : gosti «hôte ! », noiti «nuit! », comme nous avons en zendpaiti, âfrîti, et en grec on a au datif pluriel, en borussien, ma ru au lieu de ma» (S ai 5, a), et que, la consonne finale ayant été supprimée, le n fût demeuré.
1 Les thèmes adjectifs terminés au féminin en a gardent cette voyelle au vocatif : on a, par exemple, dobra «bona !» en regard de vfdovo «veuve!». s 3 *, devant «, se change en ÎK ». '

143
DUEL.

S 273. Les trois cas du duel, en ancien slave.
L’ancien slave a gardé le duel; il surpasse par là le gothique, à qui ce nombre manque pour les substantifs. Les désinences du duel sont mieux conservées en ancien slave qu’en lithuanien, et la déclinaison est d’un cas. plus riche qu’en grec. On ne saurait méconnaître l’accord qui règne entre l’ancien slave, le sanscrit et le zend. Comparez :
Sanscrit. Zentl» Ancien slave.
Nominatif-accusatif* (masculin).....uba (forme ubâ oba
véd.) «ambo»
* (féminin-neutre), ube ubê obê
Instrum.-datif-abl. (masc.-fém.-neutre). uba-byâm ubâi-bya instr.-dat.
obê-ma*
Génitif-locatif (masc.-féminin-neutre). ubây-és ubôy-â oboj-u\
Le neutre sanscrit ubê'se compose du thème ubd et du suffixe casuel î (S 212 ) ; le féminin ubê’ est une forme mutilée pour nbay-âu : elle n’a donc pas de désinence casuelle (S ai3). 141 142 143

1 kh

Les thèmes masculins et féminins en h i gardent cet i invariable , au lieu de l’allonger comme font le sanscrit et le zend ( § 21 o et suiv. ) ; comparez gosti « deux hôtes », rwêti « deux nuits v avec les formes sanscrites comme pâti, pritî, et les formes lithuaniennes comme awï (§ 211). Les thèmes en 2 ü suivent le même principe et ont, par exemple, csinsi sünü « deux fils », en regard du sanscrit sûniïei du lithuanien sünù1. Toutefois, les formes duelles comme sünü sont rares142 : ordinairement les thèmes en ü passent, aux cas en question, dans la déclinaison des thèmes en 0; on a, par conséquent, süna, d’après l’analogie de vlüka.
Les formes neutres en i, venant de thèmes terminés par une consonne, comme imm-i, nebes-i, telaht-i, sont très-dignes de remarque143, si cet i est réellement la désinence casuelle et s’il correspond, par conséquent, à l’î sanscrit de nâmn-î, ndbas-î, bârat-î, et à Yi zend de nâmain-i. Cette supposition n’a rien quelle très-plausible, surtout si l’on observe que l’ancien slave représente par t ê Yê du duel sanscrit provenant de a + î, comme dans OEt obê = sanscrit ubê' (venant de uba-î). Pourquoi imen-i, nebes-i ne correspondraient-ils pas à ndmn-î, ndbas-î? Il est vrai qua plusieurs cas les thèmes terminés par une consonne passent, en ancien slave, dans la déclinaison des thèmes en i (surtout devant les désinences commençant par une consonne) ; mais il n y a pas en slave de thèmes neutres en i dont l’analogie aurait pu influer, aux cas en question, sur la flexion des thèmes neutres terminés par une consonne. Ajoutons que si l’on considère li de imeni, nebesi, telanti comme la désinence casuelle et non comme la voyelle 144 145 146
DÉCLINAISON SLAVE. S 27 4. 145


finale du thème élargi, il n’y aura plus un seul cas à désinence commençant par une voyelle qui ne se forme du thème primitif. _
11 en est autrement pour les thèmes masculins en n, comme
kamen «pierre». Ils élargissent le thème, non-seulement au nominatif-accusatif-vocatif duel kameni, mais encore au génitif-locatif duel kamenij-u1 et au génitif pluriel mmcniih karnenÿ-, qu’on peut opposer aux formes neutres imen-u, imen-ü.
Quant aux formes en -6 ê, qui, au nominatif-accusatif-vocatif duel des thèmes terminés par une consonne, prennent ordinairement la place des formes organiques en i (mené, nebesê, telahtê pour irnen-i, nebes-i, telant-i), elles dérivent évidemment d’un thème élargi par l’addition d’un o (imeno, nebeso, telahto). Le même fait se présente pour les locatifs pluriels de tous les thèmes terminé^par une consonne, en sorte qu’on a ux? ê-chü qui supposerait en sanscrit la désinence êsu.
PMjBIFX.
S 974. Nominatif-vocatif pluriel.
Au nominatif-vocatif pluriel la désinence sanscrite as, en grec es, s’est maintenue sous la forme e, c’est-à-dire avec la suppression obligée de la consonne finale. Comparez, par exemple, sü-nov-e «fils », kamen-e «pierres» avec le sanscritsunav-as, asrnan-as et les formes grecques comme véxv-es, Sai'iiov-es ; rapprochez encore gostij-e «hôtes» des formes sanscrites et grecques comme pâtay-as, tséa-t-ss. Au contraire, les féminins noéti «nuits», ma-teri «mères» (ce dernier venant d un thème élargi par 1 addition 147 148
s.

Hi(i

FO KM AT 10 N DES CAS.
d’an i) paraissent au. .nominatif-vocatif pluriel sans désinence casuelle. Une lacune analogue existe dans la déclinaison du vieux haut-allemand : dès la,plus ancienne période de cette langue, les féminins ont perdu au génitif singulier le signe casuel s, tandis que les masculins à forme forte l’ont gardé : rapprochez, par exemple, ensii «gratiæ» de gaste-s «hospitis».
En ce qui concerne les pluriels comme vïdovû, voljan, venant des thèmes vïdova, volja, je renvoie au § 271. Pour les formes comme vlük’-i «loups» pour vlükoi ou vlukoj (comparez Xvxoi, lithuanien wilkai), voyez § 2 28b.
Gomme en zend, en grec, en latin et en gothique, les neutres ont a pour désinence du nominatif-accusatif-vocatif pluriel; exemple : imen-a, qu’on peut rapprocher du zend nâman-a, du latin nômin-a, du gothique namn-a et des formes grecques comme l&éXav-a. Nebes-a surpasse le grec vé<pe(a)-a. par la conservation de la consonne finale du thème; telant-a «veaux» s’accorde très-bien avec les formes grecques comme ialavT-a, Xvaavr-a (§ a 6 4 ) ; les formes comme A'SAd dêla (du thème dêlo «œuvre ») répondent aux formes zendes, grecques, latines et gothiques comme dâia, Sapa, dôna, daura. Dans cette classe de mots, la voyelle finale du thème, laquelle est ou était un a, s’est partout confondue avec la voyelle de la désinence (S 2 31).
§ 375. Accusatif pluriel.
Les thèmes masculins et féminins ont perdu la désinence s de l’accusatif: elle a subsisté en lithuanien, mais elle a dû être supprimée en ancien slave par suite de la loi phonique déjà souvent mentionnée (S 92“). Les thèmes en 0 et en a ont changé leur voyelle finale en ü, sous l’influence, comme il semble, de la lettre s qui suivait à une éppque plus ancienne (§ 971); nmu signifie donc aussi bien « novos » que « novas », suivant qu il vient du thème novo ou nova. Les thèmes masculins en jo (par
DÉCLINAISON SLAVE. S 276-277. 147


euphonie K je) et les thèmes féminins en jet se terminent à l’accusatif pluriel en i&jah; exemples: kohia fconja» «equos», du thème konjo; voljaii «voluntates», du thème volja. Je reconnais actuellement dans cette lettre n la pénultième de la forme primitive
en ns.
Des thèmes gosti « hôte » et nosti « nuit » viennent les accusatifs semblables vosli , nosti : au contraire , en lithuanien , nous avons des formes comme genâ-s, awi-s (§ 2 4 2 ). Les thèmes en 2 ü forment leur accusatif pluriel d’un thème élargi en ovo; exemple : siinovü « fdios n. Les thèmes en n et en r sont élargis par l’addition d’un i : hammi, materi.
S 276. Instrumental pluriel des thèmes en 0 et en jo.
A l’instrumental pluriel, les thèmes en 0 et ceux qui ajoutent un 0 à la lettre primitivement finale ont 2i ü comme désinence : j’y reconnais la désinence sanscrite et zende âis, le lithuanien ais, s ayant été nécessairement supprimé et le deuxième élément de l’ancienne diphthongue s’étant perdu; le 21 ü représente donc, comme à l’acctisatif pluriel, l’o du thème. Comparez vlükü «par les loups» avec le lithuanien wilkais, le sanscrit vrlcâis, le zend vëhrkâis. On a de même sünovü, imenü, nebesü, telaiitü des thèmes élargis sunovo, imeno, nebeso, telanto.
Les thèmes masculins et neutres en jo ont a 1 dll liGU de jü, qu’on s’attendrait à avoir d’après la règle générale; exemple : MO pu mori (qu’il faut peut-être prononcer motji), du thème mvrjo «mer».
S 977. Instrumental pluriel en mi. — Datif pluriel.
Les classes de mots qui, dans le sanscrit ordinaire et en zend, ont conservé à l’instrumental pluriel la désinence fïw^è'îs, jyjj bis, ont en ancien slave mi, La désinence lithuanienne est mis

148

( § g 2k ). Exemples : vïdova-mi=sanscrit vidavâ-Bis « par les veuves » ; (WiKdMH rmka-mi — lithuanien rankô-mh «parles mains».
Les thèmes en h i affaiblissent cette voyelle devant mi en t, ï ; exemples : gostï-mi, nostî-mi en regard des formes lithuaniennes comme genti-mh, awi-mls, des formes sanscrites comme pati-Bis. priti-Bis, des formes arméniennes comme ôli-vq (§ 216). Les thèmes masculins en n et les thèmes féminins en r suivent la même analogie et forment ce cas d’après la déclinaison en i; exemples : kamenï-mi, düsterï-mi. En lithuanien, nous avons des formes comme akmerii-mh, dukteri-mis, lesquelles viennent également d’un thème inorganique en i.
Au datif pluriel, la désinence pour toutes les classes de mots est mû : il n’est pas difficile de.reconnaître dans cette syllabe le mus lithuanien (= sanscrit Byas, latin bus) avec l’affaiblissement de la voyelle et la suppression nécessaire de la consonne finale (§ 92 n‘). Les thèmes en i changent cette voyelle devant la désinence mû, en e, et tous les thèmes terminés par une consonne, quel que soit leur genre, passent dans la déclinaison en i; exemples : goste-mü, noste-mü, kamene-mü, düstere-mü, nebese-mü, te-lante-mü. On peut se demander pourquoi nous avons à l’instrumental pluriel le changement de IV du thème en ï, et pourquoi au datif le changement en e. Je crois que cette différence vient du poids de la terminaison. La désinence mû ne forme qu’une demi-syllabe et les thèmes qui en sont suivis gardent le nombre de leurs syllabes, quoique avec le changement de IV en e. Au contraire, la désinence de l’instrumental mi forme une syllabe entière , et les thèmes en i qui en sont suivis réduisent de moitié leur syllabe finale, en changeant h t en 1. ï, cette dernière voyelle ne formant qu’une demi-syllabe. C’est sur le même principe que repose le changement qui a lieu dans le thème devant la désinence mï de l’instrumental singulier et devant mi de l’instrumental pluriel. Devant mï, qui ne forme qu’une demi-syllabe,

m

gosti, nosti et les thèmes de même sorte gardent leur caractère dissyllabique, tout en changeant IV en e; exemples : goste-mi «par l’hôte», noste-tnï «par la nuit». Mais au pluriel nous avonsgosiï-
mi, nostï-mi.
S 978. Génitif pluriel.
La syllabe âm, qui est la désinence du génitif pluriel sanscrit, devait perdre en slave sa consonne finale, en vertu de la loi phonique souvent mentionnée. Mais l’d lui-même a subi un grand affaiblissement, quand la désinence n’est pas totalement supprimée; il est changé en x ü, c’est-à-dire que le slave nous présente une forme beaucoup plus altérée que le lithuanien, où tous les génitifs pluriels sont terminés en ü long. On peut comparer kamen-ü avec le lithuanien ahnm-û et le sanscrit dsman-âm; imen-ü «nominum » avec le sanscrit namn-âm, le latin nomin-um, le gothique namn-ê. C’est d’après le même principe que sont formés neHes~ü (-—sanscrit ndbas-âm, grec ve(pé(a^-av'j et teîaiit-ü; ce dernier exemple répond aux formes grecques comme foldvT-uv.
Les thèmes en 0 et en a suppriment leur voyelle finale devant la désinence casuelle; exemples : riitÆ’-w «luporum », runk’-ü «ma-nuum», en regard des formes lithuaniennes wllk’-ü, rank’-û et des formes latines comme soci’-um, amphor’-um. Au contraire, les thèmes.en ? ont perdu la désinence casuelle: mais le changement de IV du thème en niî ij prouve qu’il y a eu plus anciennement une voyelle à la désinence ; exemples : rocrnà gostij «hos-pitum», M0U1THH nostij «noctium» (venant de gostij-ü, nostij-ü). Parle changement de IV en ij, ces formes s’accordent bien avec les nominatifs commegostij-e « hôtes » ( § 9 7 U ). Le génitif desaht-ü, venant du thème féminin desahti «dix», est seul de son espèce149 : on ce qui concerne la suppression de IV du thème devant la dé-

150 FORMATION DES CAS.


sinence casuelle, il ressemble aux génitifs gothiques comme gast’-ê, anst’-ê; mais il est plus altéré que les génitifs lithuaniens comme awi-ü «oviunm (dissyllabique).
La déclinaison pronominale présente xx chü comme désinence, en regard de la terminaison sanscrite sâm ou sâm1 et du borus-sien son (§ 2 48) ; exemple : Ttxx tê-chü «liorum», pour le sanscrit tê'sâm (masculin-neutre) et aussi pour le féminin tà-sâm, qui devrait plutôt faire en ancien slave ta-chü.
S 279. Locatif pluriel.
La désinence du locatif pluriel est *3 chü, comme au génitif de la déclinaison pronominale : comme su ou su (§ 91 *) en sanscrit, chü se trouve dans toutes les classes de mots. Le changement de la sifflante en gutturale aspirée n’a eu lieu qu’après la séparation des langues slaves d’avec les langues letles (§ 92g) : en effet., au lieu de xx chü le lithuanien a les formes su, su, se ou simplement s (§ 2 53). Dans la désinence sanscrite su nous avons reconnu une forme mutilée pour », dont le ^v s’est vocalisé en u : nous pouvons donc nous demander s’il faut aussi voir dans le slave x ü une vocalisation de b v, ou si, dans la terminaison slave la semi-voyelle a été supprimée et l’a changé en ü, comme au génitif (S 278 ). Je regarde la seconde explication comme la vraie, à cause du rapport que nous avons constaté (§ a53) entre la désinence lithuanienne su et la désinence plus organique sa, et à capse de la relation qui existe entre le lithuanien sâpna-s s rêve n et le sanscrit svdpna-s. Nous trouvons également un exemple de suppression d’un v après un s dans lé slave sestra «sœur», qui est évidemment pour svesim.
Devant la désinence xx chü, un o (= a) final se change en n ê, comme en sanscrit a se change en ê. Au contraire, a a (=sans- 150

DÉCLINAISON SLAVE. S 279. 151
ciit à) reste invariable. Nous avons, par conséquent , novê-cliü «in noviss (masculin-neutre) en regard du sanscrit nâvê-su, du zend mvai-éva ou navai-su ; mais nous avons nova-chü en regard du féminin sanscrit nâvâ-su et du zend navâ-hm.
Dc\ant la désinence chü, les thèmes en i changent cette voyelle en e; exemples : goste-chü, noéte-chü. Les thèmes terminés par une consonne passent, au locatif pluriel, dans la déclinaison des thèmes en i; exemples : kamene-chü, ncbese-chü, formés des thèmes élargis karneni, nebesi.



ADJECTIFS.
DÉCLINAISON DES ADJECTIFS.
8 280. Adjectifs à déclinaison pronominale.
La déclinaison des adjectifs ne différé pas de celle des substantifs. Il est arrivé, sans doute, que certaines formes de flexions qui, en sanscrit et en zend, appartiennent uniquement à la déclinaison pronominale, ont franchi dans les langues congénères les limites de cette déclinaison pour entrer dans celle des adjectifs; mais alors elles ne s’en sont pas tenues là et ont pénétré également dans celle des substantifs. Il a déjà été question (§§ 238, a48 et 27/i), en ce qui concerne le grec, le latin elle slave, de ce mélange de la déclinaison pronominale et de la déclinaison ordinaire. Nous ne voulons ajouter ici qu’une seule observation.
La syllabe annexe stna, qui est, en sanscrit, un des caractères de la déclinaison pronominale (§ i65 et suiv.), et qui ne sort pas de cette déclinaison, a pris, en pâli, une plus grande extension. Elle peut dans cette langue, à différents cas, venir se joindre à des thèmes substantifs et adjectifs masculins et neutres; elle peut notamment être ajoutée à tous les thèmes en a, i, u> y compris ceux qui primitivement se terminaient par une consonne , mais qui ont passé dans la déclinaison à voyelle, soit en prenant un complément, soit en subissant une apocope. Cest ainsi que kêsa «cheveu» fait a 1 ablatif et au locatif singuliers, ou bien simplement kêsâ (pour kêsât), kêsê, ou bien kêsa-smâ,
DECLINAISON..§ 281.

153

kêsa-mhâ, kêsa-smin, kêsa-mhi; dans ces dernières formes, nous voyons le thème kêsa joint à sma ou à mha, qui est une sorte de mélalhèse de sma.
■ En lithuanien, cette même syllabe sma, moins le s, est passée au .datif et au locatif singuliers dans la déclinaison ad-jective, sans entrer dans la déclinaison substantive1, et sans laisser aux adjectifs la faculté de renoncer à cette syllabe annexe. Exemples : gera-m (anciennement gera-mui) «bono», gera-mè «in bono».
S 281. Cause de la double déclinaison des adjectifs en allemand.
J’avais cru autrefois qu’on pouvait aussi appliquer au gothique l’explication qui vient d’être donnée au sujet des formes lithuaniennes comme gera-mui ou gera-m, et je rendais compte de l’accord qui règne au datif entre les adjectifs comme blin-damma «cæco» et les pronoms comme iha-mma «huic», i-mma «ei», par un empiétement irrégulier de la déclinaison pronominale sur la déclinaison adjective. Mais je suis revenu de cette opinion en examinant la déclinaison de l’ancien slave. En effet, dans.cette langue, les adjectifs indéterminés ne présentent aucun mélange de déclinaison pronominale et ils se déclinent exactement suivant le même principe que les substantifs forts dans les langues germaniques. J’en conclus que si la forme de déclinaison adjective, appelée par Grimm la forme forte et par Fulda Informe abstraite, s’écarte sur un certain nombre de points (il en est jusqu’à neuf) des substantifs forts, c’est-à-dire des substantifs à thème terminé par une voyelle, et s’accordent au contraire avec la déclinaison pronominale, cela vient de ce que ces adjectifs renferment réellement un pronom, comme il arrive
En lelte, le pronom annexe est entré en outre dans la déclinaison substantive; tous les substantifs masculins finissent au datif singulier par m. (Voyez S 173.)
ADJECTIFS.

15k

pour les adjectifs déterminés, en slave et en lithuanien; or, il est naturel que ce pronom suive la déclinaison qui lui est propre.
Mais comme les adjectifs forts, dans les langues germaniques, sont définis ou personnifiés par le pronom qui leur est incorporé, il n’est pas étonnant qu’on évite cette forme de déclinaison, lorsque la fonction du pronom ainsi annexé est remplie 9 par un pronom placé avant l’adjectif; c’est pour cette raison qu’on dit en allemand guter et der gute, mais non pas der guter; cette dernière forme blesserait l’instinct grammatical, car on sent dans guter la présence d’un pronom, comme on la perçoit encore dans im «dans le », am «auprès du», beim «chez le», quoique dans ces locutions le thème pronominal ait disparu et qu’il ne reste plus que la désinence casuelle1. L’usage a donc ici fidèlement maintenu les vrais principes, et la science grammaticale, qui sur d’autres points avait déjà expliqué ou dépassé les leçons de l’instinct, était moins avancée à cet égard que le sentiment irréfléchi ; nous percevions dans les formes comme guter, gutem, gute plus que nous n’y reconnaissions, et le pronom, dont le corps avait disparu, faisait encore sentir en esprit sa présence2. La langue allemande fait preuve sous ce rapport de beaucoup de délicatesse et de logique : ainsi le mot ein, étant privé de son élément défini pronominal, se fait suivre de la forme forte, c’est-à-dire de la forme déterminée; exemples : ein grosser kônig, ein grosses haus (et non ein grosse kônig, ein grosse haus). Mais aux cas obliques, où nous avons eines, einem,
' On ne dit pas : im dem haus, mais in dem haus ou im haus «dans la maison»; on ne pourrait dire beim dem rater, mais il faut bei dem rater ou beim rater «chez le père». — Tr. '
3 L’auteur fait allusion à la double déclinaison des adjectifs en allemand : guter manu, gutem matin, gute mamiter, 4 côté de der gute matin, dem güten matin, die giitcn mâtmer. — Tr, ' .
DECLINAISON. S 282.

155

c’est-à-dire le mot eiri pourvu de son élément pronominal et défini, c’est la forme indéterminée de l’adjectif qui devra suivre; exemples : eines 'rossen kônigs, einem grossen kônig (et non eines grosses kônigs, einem grossem kônig). L’accusatif masculin grossen est à la fois défini et indéfini : mais, comme forme indéfinie, grossen est simplement le thème à l’état nu, et, par conséquent, il est identique avec le génitif et le datif indéterminés, lesquels sont également dépourvus de flexion. Au contraire, comme forme définie, grossen doit son n à la flexion.
S 282. Origine de la déclinaison déterminée en lithuanien et en ancien slave. — Déclinaison du pronom ja.
Le thème pronominal qui sert à former la déclinaison déterminée, en lithuanien et en ancien slave, est ja151. En ancien slave, ja devait devenir jo (§ 257) et ensuite je ou e (§ 92k) : grâce au monosyllabisme de cette forme, le j, qui aurait disparu dans un mot polysyllabique, a été conservé; mais il s’est changé, à certains cas, en i, après la chute de la voyelle. En lithuanien comme en ancien slave, ja signifie «il»; mais cette dernière langue a conservé l’ancien sens relatif déjà, quand il est uni avec se (i-se «lequel»).
Nous donnons la déclinaison complète de ja dans l’une et l’autre langue :

156
ADJECTIFS.
LITHUANIEN.
Duel.
Pluriel.

Singulier.
|
Masculin. |
Féminin. |
Masculin. |
Féminin. |
|
Nominatif, jis |
F |
F |
F |
|
Accusatif., jih |
jev |
ju |
il |
|
Instrum... jü4 |
ie |
jêm |
jôm |
|
Datif..... jâm ‘ |
jei |
jëriî |
jôm |
|
Génitif. . . jô |
jôs |
jü |
. |
|
Locatif.. . jamh |
jôft |
Masculin. Féminin.
Je j&s jeis jëms ‘ jû
, jûs'e8
jiis jes jônùs jôms1 3Ü (
jôsc.
ANCIEN SLAVE.
Singulier.
|
Masculin. |
Féminin. |
Neutre. | |
|
Nominatif..... |
Ht" |
ra ja |
t£ je |
|
Accusatif...... |
. H i |
hî. juii |
K je |
|
Instrumental. . |
. MAU. imï |
t£IA> jejun |
(Le reste comme |
|
Datif........ Génitif...... Locatif....... |
. KM0\f jemu . rero jego . tertu. jemï |
KH jej KtA jejah t£H jej |
au masculin.) |
> On attendrait plutôt je, qui répondrait au m J/« sanscrit, avec changement de l’a slave en t, à cause du j qui précède (S 92l) : quand ce pronom est combiné avec lui-même, on trouve, en effet, ji-jé plus souvent que ji-ji (voyez Schieicher, p. aos, etMielclce, p. 68). \
2 Combiné avec du «deux» : juin.
3 Avec dwi «deux* :jédtvi. ■
1 On a aussi j&trii et j&m.
5 Ancienne forme jâmui.
6 Ancienne forme jémus.
7 Ancienne forme jémus.
8 Voyez S a53. . .
« Le nominatif, dans les trois nombres, n’est employé qu’en combinaison avec
ÎKé 6e, et il a le sens relatif.
Duel.
|
Masculin-neutre. |
Féminin. | |
|
Nominatif..... |
la ]«■ |
Il i |
|
Accusatif...... |
ta ja |
H i |
|
(nstrum.-dalif. . |
Hrt/ld ima |
HAM ima |
|
Génitif-locatif... |
t€K) jeju |
K K) jÿu. |
Pluriel.

DÉCLINAISON. S 283.
157

Masculin. Féminin. Neutre.
Nominatif.---- H * IA j ah ta ja
Accusatif...... IA jah i& jah ta ja.
Masculin-féminin-neulre.
Instrumental. .. HA\M irai
Datif........ Mrttè mû
Génitif....... H7G ichü
Locatif........ MJCS ichü.
§ 283. La déclinaison déterminée en iithuanien.
En lithuanien, le pronom annexe, dans la déclinaison déterminée, se combine de telle façon avec l’adjectif que l’un et l’autre gardent leurs désinences casuelles; toutefois, le pronom, à certains cas, perd son j ou la voyelle i qui en tient lieu; de son côté, l’adjectif fait subir des mutilations à sa désinence, ou bien, quand plusieurs terminaisons sont possibles, il prend la plus courte. C’est ainsi qu’au locatif pluriel (§ 2 53) la désinence de l’adjectif déterminé est s, et au locatif singulier masculin simplement m et non me152. A certains cas, l’adjectif est renforcé,

158

comme pour lui permettre de porter le poids du pronom annexe. En .conséquence, l’a du nominatif féminin gerà «bona» devient ô (on sait que l’ô est le représentant ordinaire, en slave, de la long primitif); exemple : gero-ji «la bonne», au lieu de gerà-ji. La voyelle u devient ü dans plusieurs désinences, par exemple à l’instrumental singulier masculin gerû-ju «par le bon»; de meme au nominatif—accusatif duel masculin .
Comme modèle d’un adjectif déterminé en lithuanien, nous prendrons geràs-is «le bon», féminin gero-ji. 11 se décline de la façon suivante :
Masculin.
|
Singulier. |
Duel. |
Pluriel. | |
|
Nominatif..... |
geràs-is |
gerïï-ju |
geré-ji ou geré-je |
|
Accusatif...... |
géran-jin |
geru-ju |
ger&s-ius |
|
Instrumental. .. |
gcrïï-ju |
gerems-ëm* |
gerais-eis |
|
Datif......... |
gerâm-jdm |
gerems-ëm |
gerems-ems |
|
Génitif........ |
géro-jo |
geru-jü |
geru-jü |
|
. geriïs-iûse. | |||
|
Féminin. | |||
|
Nominatif..... |
gero-ji |
’ gere-ji |
gerôs-ês |
|
Accusatif...... |
géran-jeh |
gcre-ji |
gerâs-es |
|
Instrumental. .. |
gera-je |
geroms-iôm |
geroms-iômis |
|
Datif......... |
gerai-jei |
geroms-iôm |
gerdms-iôms3 |
|
Génitif........ |
geros^ês |
geru-jü |
geru-ju |
|
Locatif....... |
gerd-jôje |
. geros-iôse. |
sma; toutefois, pour le lithuanien comme pour l’allemand (dans dem, voem, ihm, etc.), ce m a pris la valeur d’une désinence casuelle.
1 Les verbes lithuaniens, quand ils prennent le s du pronom réfléchi, éprouvent un renforcement de même nature (8 476 ).
2 Le s de l’adjectif n’est pas ici à sa place et parait emprunté au datif pluriel.
3 Ancienne forme gerômusiSm». (Voyez Schleicher, Grammaire lithuanienne, p. 209.)

DÉCLINAISON. S 284.
159
§ g8i.
La déclinaison déterminée
en ancien slave.

En ancien slave comme en lithuanien, nous trouvons établi le principe que dans la déclinaison adjective déterminée on décline à la fois l’adjectif et le pronom annexe. Toutefois, certains cas ont éprouvé des mutilations, soit dans l'adjectif, soit dans le - pronom. Dans l'adjectif, il y a perte de la désinence casuelle 1 ; dans le pronom, on supprime foj initial du thème2.11 faut aussi remarquer l'influence euphonique exercée par le j initial du pronom, ou par Tt qui remplace le j, sur la voyelle finale de l’ad-jcctif qui précède : cette influence s’exerce notamment sur Yo, ou sur le x ü qui le remplace au nominatif-accusatif-vocatif singulier masculin, ainsi que sur le 2 & du génitif pluriel ; dans quelques cas, Y a final des thèmes féminins est également affecté. Cette loi phonique n’est pas sans analogie avec l’adoucissement (umlaut) germanique et avec quelques faits de même sorte en zend (§ Ai) : elle nous fait comprendre le rapport qui existe entre Aoupsiit dobrü-j «le bon» (nominatif-accusatif-vocatif) et le simple AOBps dobrü; entre dobrü-i-ma (instrumental-datif duel masculin-neutre) et le simple dobro^ma. 11 est possible quau féminin,l’a du thème se soit d’abord affaibli en o (S 93”) qu’en vertu de cette loi d’assimilation, l’o soit devenu ensuite ü; dobra-ima aurait fait d’abord dobro-ima et ensuite dobrü-vnia. L a en soi n’est pas sujet à l’influence de la lettre initiale du pronom annexe : c’est ce qui ressort du nominatif singulier féminin dobra-
1 Ce sont notamment les désinences commençant par une consonne (M ou X) qui ont disparu; exemples : instrumental-datif duel (masculin-neutre) dobrü-ima pour dobroma-ima (thème dobro «bon») ; locatif pluriel (pour les trois genres) dobrü-ichi), au lieu de quoi on aurait dû avoir au masculin-neutre AOEp’feXSHJC^ dobrechü-ichü, et au féminin dobrachü-ichü.
a Le thème entier est tgmbé au datif-locatif singulier du féminin, ou nous avons H j en regard du pronom non composé ICH je;; exemple : dobrê-j eà la bonne, dans la bonne».

160
ADJECTIFS.
ja, ainsi que du nominatif-accusatif-vocatif pluriel neutre, qui fait de même dobra-ja.
Dans la déclinaison adjective déterminée on peut aussi apercevoir une influence exercée par la désinence de l’adjectif sur la voyelle du pronom annexe. En effet, le/ initial du pronom s’est perdu au génitif, au datif et au locatif du singulier masculin-neutre ; après cette suppression du j, la voyelle suivante est devenue a, u, *6 ê ou i, selon la nature de la voyelle précédente, laquelle appartient à l’adjectif. Exemples : dobra-ago « du bon» (pour dobra-jego), dobru-umu «au bon» (pour dobru-jemu), AonpiïtAU, dobrê-êmï «dans le bon» (pour AOEptreMt dobrê-jemi), dobli-imï «dans le vaillant» (pour dobli-jemï). Mais il s’est conservé encore au datif et au locatif des formes en u-jemu, ê-jemï et ê-emi. On trouve aussi des locatifs en ê-ami, au lieu de ê-êmï153.
Pour faciliter la comparaison entre la déclinaison indéterminée et la déclinaison déterminée, nous les plaçons l’une en regard de l’autre. Nous conservons les mots choisis comme modèles par Miklosich, à savoir le thème dobro «bon», féminin dobra, et le thème dobljo «vaillant» (par euphonie doblje, voyez § 258), féminin doblja.

SINGULIER.
\ Masculin.
Féminin.
Indéterminé. Déterminé.
Nominatif.........dobrü dobrü-j*
Accusatif.......... dobrü dobrü-j
Indéterminé. Déterminé.
dobra dobra-ja
dobruh dobruh-jun
1 Voyez Miklosich, Phonologie, S 55, et Théorie des formes, a° édition, S g5.
2 On trouve aussi sans adoucissement dobrü-j, et, avec suppression du pronom, mais avec conservation de l’adoucissement, dobrü. (Voyez Miklosich, Théorie des formes, a8édition, Sg5.)

DÉCLINAISON. $ 284.
161

Masculin.
Féminin.
|
Indéterminé. |
Déterminé. |
Indéterminé. |
Déterminé. | |
|
Instrumental...... |
dobrü-imï |
dobrojuii |
dobro-juh ' | |
|
Datif............ |
. dobra |
dobru-amu |
dobrê |
dobre-j |
|
Génitif.......... |
. dobra |
dobra-ago |
dobrü |
dobrü-jan |
|
Locatif.......... |
. dobrê |
dobre-êmï |
J uuurc |
ÜOOTB-J |
|
Vocatif.......... |
. dobre |
ttobrü-j |
dobra |
dobra-ja. |
|
DUEL. | ||||
|
Nominatif-ace.-vocatif. dobra |
dobra-ja |
dobrê |
dobrê-i | |
|
Instrumental-datif. . |
. dobromâ |
dobrii-ima |
dobrama |
dobrü-ima |
|
Génitif-locatif..... |
. dobru |
dobru-ju |
dôbrtt |
dobru-ju. |
PLURIEL.
|
Nominatif-vocatif.. . |
, dobri |
dobri-i |
dobrü |
dobrüjah |
|
Accusatif......... |
dobrü-jan |
dobrü |
dobrü-jan | |
|
Instrumental...... |
dobrü-imi |
dobra-mi |
dobrü-imi | |
|
Datif............ |
dobrü-imù ‘ |
dobra-mû |
dobrü-imü | |
|
Génitif. ......... |
dobrü-ichü |
dobrü. |
dobrü-ichü | |
|
Locatif.......... |
dobrü-icliü |
dobra-chü |
dobrü-ichü | |
|
Vocatif.......... |
dobri-i • |
dobrü |
dobrü-jan. |
Neutre.
Indéterminé. Déterminé.
Nominatif-accusatif-vocatif singulier. ... dobro dobro-je
Nominatif-accusatif-vocatif duel.......dobrê dobre-i
Nominatif-accusatif-yocatif pluriel.....dobra dobra-ja.
Le reste comme au masculin. 153

ADJECTIFS.
|
11. | ||||
|
, , SINGULIER. | ||||
|
Masculin. |
Féminin. | |||
|
Indéterminé. |
Déterminé. |
Indéterminé. |
Déterminé. | |
|
Nominatif........ Accusatif......... Instrumental....... Datif............ Génitif........ • ■ Locatif.......... Vocatif.......... |
. dobli . dobli . dobljemï . doblju . doblja . dobli . dobli |
dobli-j dobli-j dobli-imï doblju-umu doblja-ago dobli-imï dobli-j |
doblja dobljuh dobljejun dobli dobljan dobli doblja |
dobljaja dobljunjuh dobljejun dobli-j dobljah-jan dobli-j doblja-ja. |
|
DUEL. | ||||
|
Nominatifacc.-vocatif. doblja lnstrumental-datif... dobljema Génitif-locatif......doblju |
doblja-ja dobli-irna doblju-ju |
dobli dobljama doblju |
dobli-i dobli-ima doblju-ju. | |
|
PLURIEL. | ||||
|
Nominatif-vocatif... Accusatif........ Instrumental...... Datif........... Génitif.......... Locatif.......... |
. dobli . dobljan . dobli . dobljemü , dobli . doblichü |
dobli-i dobljan dobljan-jan dobljan dobli-imi doblja-mi dobli-imü doblja-mü dobli-ichü dobli dobli-ichü dobljachü |
dobljan-jan dobljan-jan dobli-imi dobli-imü dobli-ichü dobli-ichü. | |
|
Neutre. | ||||
|
Indéterminé. |
Déterminé. | |||
|
Nominatif-accusatif-vocatif singulier.... Nominatif-accusatif-vocatif duel....... Nominatif-aceusatif-vofatif pluriel...... |
doblje dobli doblja |
doblje-je dobli-i doblja-ja. | ||
Le reste comme au masculin.


163
§ 285. La déclinaison déterminée
dans les dialectes
slaves modernes.

Dans les dialectes slaves d’un âge plus moderne, le système de la double déclinaison des adjectifs a éprouvé une grande perturbation, en ce qui concerne la forme comme en ce qui touche le sens. Le russe, par exemple, dans la déclinaison déterminée, ne distingue clairement le. pronom annexe quau nominatif et à l’accusatif singuliers des trois genres et aux cas correspondants du pluriel. Exemples : singulier masculin : dobrü-j « bonus, bonum » ; féminin : dobra-ja « bona », dobru-ju « bonam » ; neutre : dobro-e (venant de dobro-je) «bonum»; pluriel, nominatif-accusatif masculin : dobrü-e; féminin-neutre : dobrü-ja. Partout ailleurs le pronom annexe ne fait plus sentir sa presence, sinon par l’adoucissement (u ü, voyez § 284) qui a lieu a certains cas, et qui a été produit par son) ou son i initial. Exemple : instrumental singulier masculin-neutre : dobrü-m, en regard de l’ancien slave dobrü-imï, par euphonie pour dobro-imï. ■
La signification du pronom annexe s est tout a fait éteinte en russe dans la déclinaison composée. En effet, dobrü-j, dobra-ja, dobro-e équivalent simplement à «bonus, bona, bonum», et l’adjectif composé a presque partout remplacé en prose l’adjectif simple. Celui-ci n’est plus guère usité que comme attribut, c’est-à-dire dans le meme emploi ou 1 allemand se sert de 1 adjectif privé de flexion. Mais il y a cette différence entre le slave et l’allemand que l’adjectif, même dans les dialectes slaves les plus modernes, quand il est construit comme attribut, prend le genre et le nombre du substantif ou du pronom auquel il se rapporte.
g 286. Double déclinaison ndjective dans les langues germaniques. — Examen de l’opinion de J. Grimm.
Les adjectifs germaniques ont une double déclinaison, comme
ADJECTIFS.

164

les adjectifs slaves et lithuaniens; il est donc naturel de se demander si l’une de ces déclinaisons ne provient pas de l’adjonc-lion d’un pronom qui est venu se souder à l’adjectif. C’est dans la déclinaison forte, comme on l’appelle, que nous sommes amenés à chercher ce pronom, car elle reproduit toutes les particularités de la déclinaison pronominale. Cette idée a déjà été exprimée par moi dans la première édition du présent ouvrage. Mais, depuis ce temps, Jacob Grimm, dans son Histoire de la langue allemande *, a présenté les adjectifs faibles comme les adjectifs déterminés primitifs. Il a cherché a expliquer le n final de leur thème comme un reste du gothique juins (thème jaina). Ainsi blinda, blinda, blindé auraient déjà signifie par eux-mêmes «l’aveugle»; si, dans la langue gothique, telle quelle est parvenue jusqu’à nous, on prépose encore 1 article, cela viendrait de ce que le pronom annexe a perdu sa signification et est comme s’il n’existait pas. Il serait arrivé pour l’adjectif ce qui. est advenu pour le verbe, qui représente deux fois la personne, par la désinence d’abord, laquelle a perdu sa signification, et ensuite par le pronom dont le verbe se fait précéder. Grinnn rapproche, en outre, les dialectes norrois, qui expriment, en effet, l’article par un pronom suffixé, dont le thème contient un n : Grimm identifie cette lettre n avec la lettre finale des thèmes adjectifs faihles.
Mais nous ne pouvons souscrire à cotte identification : dans les formes norroisek comme dagr-inn «le jour», littéralement «jour-le», génitif dagis-ins, datif dagi-num, etc.2, nous voyons l’article annexe suivre de tout point la déclinaison pronominale. Au contraire, dans toutes les langues germaniques, y compris le norrois, les adjectifs faibles suivent très-exactement, dans les 154
DÉCLINAISON. S 286.

165

trois genres, les thèmes substantifs en n. Ainsi le thème gothique blindait « aveugle 5; se décline au masculin sur ahman „ esprit U 154, au neutre sur hairtan « cœur 55, et le thème féminin blindôn se décline sur viduvôn, nominatif viduvô155 156. Si les adjectifs germaniques à forme faible contenaient réellement un pronom, nous aurions, selon toute vraisemblance, en gothique, des datifs masculins comme blmda-namma et des accusatifs comme blinda-nana, au lieu que nous avons blindin, blindait, d’après l’analogie de ahmin, ahman. Dans des formes comme blindanamma, blindanana, je .n’hésiterais pas à reconnaître un article suffixé dont la signification se serait effacée. Mais comme les adjectifs faibles n’ont ni le sens des adjectifs déterminés, ni aucune des particularités de la déclinaison pronominale, je persiste dans l’opinion que j’ai autrefois énoncée : je crois que le thème des adjectifs faibles a été élargi par l’addition purement phonétique d’un n, comme il est arrivé pour beaucoup de substantifs; nous avons, par exemple, le thème svaihran «beau-père 55 (nominatif svaihra) en regard du sanscrit svdsura, du latin socerô, du grec éxupé; et le thème féminin svaihrôn (nominatif svaihrn) «belle-mère55 en regard du latin so-cera, du grec êxvpd.
En haut-allemand moderne, tous les féminins à forme forte de la première déclinaison de Grimm élargissent leur theme, au pluriel, par l’addition d’un n : on ne reconnaîtra certainement pas dans cette lettre un article dont la signification se soit obscurcie. Je rappelle encore l’élargissement que prennent régulièrement en gothique les thèmes féminins terminés en sanscrit par î : ainsi Bdrantî « (pépovtja 55 devient en gothique bairandein157. A ce complément purement phonétique n on peut comparer en
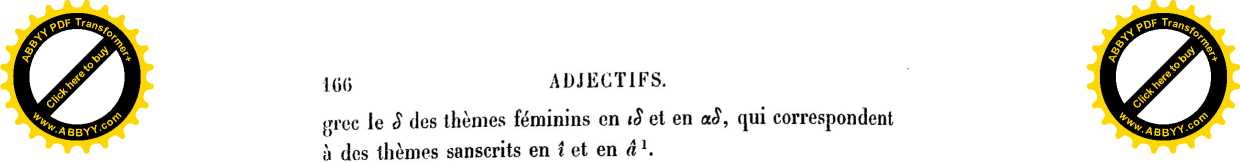
s 287. Déclinaison des adjectifs forts dans les langues germaniques,
Si l’opinion que je viens d’exposer est fondée, les adjectifs forts, dans les langues germaniques, ont à peu près eu le même sort que les adjectifs déterminés dans les dialectes slaves les plus modernes, notamment dans le russe2 : en d’autres termes, ils contiennent un pronom annexe dont la signification est éteinte. Le vieux haut-allemand blindêr, par exemple, que je décompose en blinda-ir3, signifie «è ™<p\6s n et non «rv<p\6s». Je regarde 1 ’i qui est contenu dans Yê (venant de aij de blindêr comme une contraction du thème pronominal ja (^T ya). Ce thème a aussi en zend des emplois analogues à ceux de l’article4; il a donné au slave le pronom suffixé de la déclinaison adjective déterminée; c’est lui enfin que nous retrouvons, selon toute vraisemblance, dans l’article suffixé t en albanais (nominatif féminin ja. ou a)5. Dans le féminin, en vieux haut-allemand, la syllabe iu6 de blind-iu est un affaiblissement pour ta, et correspond au yâ sanscrit, à l’article dans l’ancien slave dobra-ja
1 Voyez SS 119 et ia5.
3 Voyez S 2 85. < _
* Sur le vieux haut-allemande provenant de la diphthongue ai, voyez S 79.
4 Voyez S 337. J’ai émis (endroit cité) l’hypothèse que le zend ya, quand il est employé comme article, est peut-être pour tya; mais tya lui-même contient le pronom relatif (sanscrit t-ya j>our ta-ya, S 353).
5 Exemples : hjév-i «canis», kjév-i-ve ttcanem»; 1 pfp-i «bonus», vg ylp-i-ve «bonum»; ypûa-jaala femme». (Voyez mon mémoire Sur l’albanais et ses affinités, p, 58.) Je rapportais autrefois cet 1 albanais au thème démonstratif Z *> mais le théine îT ya explique mieux le féminin ja ( forme mutilée a, par exemple dans e plp-a, en albanais du nord e mireia — e mire-ia « la bonne» ). Le thème ar ya est d’ailleurs plus répandu dans toutes les langues indo-européennes que le thème ^ i, qui, en sanscrit même, a perdu presque toute sa déclinaison.
5 11 est impossible de dire s’il faut prononcer iu ou ju, 1 ej manquant dans l’écriture.
DÉCLINAISON. S 287.

167

«ja bonne», ainsi qu’à la syllabe ja dans l’albanais ypûa-ja.
«la femme». Au lieu de blind-iu, on trouve aussi, suivant les divers manuscrits ou les différents dialectes, blind-u, plmt-u; mais le moyen haut-allemand a seulement blindiu. De même au pluriel neutre, où le vieux haut-allemand présente aussi . bien k que u. Ici tu (ou ju) correspond, en zend et dans le dialecte védique, au nominatif-accusatif pluriel neutre va du pronom relatif, et, en ancien slave, à la syllabe ja de dobra-ja «T* âyaOd ».
A la plupart des autres cas, le pronom annexe des adjectifs forts n’est reconnaissable, en vieux haut-allemand, quaux désinences de la déclinaison pronominale; on peut comparer, à cet égard, le datif masculin-neutre blindemu (gothique blindamma) avec œoJfu, l’accusatif masculin blinden. (gothique blkdana) avec wolf. Dans ces formes, la voyelle qui précède le m et le n appartient, selon moi, au pronom annexe, et non au thème adjectif primitivement terminé en a; la final du thème semble s’être perdu comme au nominatif singulier féminin blind-iu (pour bUnda-ju) et comme au nominalif-accusatif-vocatif pluriel, qui est également blind-iu. En conséquence, je divise ainsi : blind-emu, blind’-en, gothique blind’-amma, blind -ana. J admets seulement qu’on a supprimé la semi-voyelle initiale du pronom annexe : encore s’est-elle conservée, en gothique, avec les thèmes adjectifs en u, par exemple dans manv-ja-na «paratum» pour manvu-ja-na (§ 288). Conséquemment je regarde blind -a-na comme étant pour blind’-ja-na, et, en vieux haut-allemand, < blind’-e-n comme étant pour blind’-je-n.
Aù nominatif-accusatif-vocatif neutre, la forme gothique manv’-ja-ta fait supposer avec assez de vraisemblance que blin-data et le vieux haut-allemand blindaz sont des formes mutilées pour blind’-ja-ta, blind’-ja-z, et que, par conséquent, la voyelle qui précède le t ou le z appartient au pronom.
ADJECTIFS.

108

A» génitif singulier féminin, dans les formes comme blindax-sâs «cæcæ», la seconde partie de la diplithongue ai1 appartient très-vraisemblablement au pronom annexe : je vois dans l’i le représentant du thème ja, avec suppression de sa voyelle et vocalisation de sa semi-voyelle; i-sôs, dans blindaisôs (à diviser ainsi : blinda-i-sôs), répondra donc au sanscrit yd-syâs158 159.
11 n’y a pas d’autre moyen d’expliquer la diphthongue gothique dans la forme en question : car si, dans les langues germaniques, les adjectifs forts avaient seulement les désinences pronominales sans s’adjoindre un pronom annexe, il faudiait s’attendre à trouver en gothique blindi-sôs, d’après l’analogie de thi-sôs pour le sanscrit tâ-syâs; mais il n’y aurait aucune
raison pour qu’on eût la diplithongue ai. Au génitif pluriel, lt des formes comme blindaisê «cæcorum» (masculin-neutre), blin-daisâ «cæcarum», doit être attribué également au pronom annexe, en sorte qu’il faudra diviser ainsi : blinda-isê, blinda-isô. En effet, comme nous voyons qu’à la désinence sanscrite esam (= aisâm), âsâm, dans les formes comme té'-sâm «horum», td-sâm «harum», le gothique oppose -i-d, -i-sô (par exemple thi-sê, thi-sô)160 161, il faudrait s’attendre à avoir blindi-sè, blindi-sô, si les adjectifs forts suivaient simplement la déclinaison pronominale, sans contenir réellement un pronom à la plupart de leurs cas. De même, en vieux haut-allemand, on aurait blindi-rô ou blindë-rô11 pour les trois genres, au lieu de la forme réellement usitée blindêrô, ■venant de blindairô.
DÉCLINAISON. S 288.

169

S 288. Thèmes adjectifs en u, en gothique.
Considérons de plus près les thèmes adjectifs gothiques en u, qui sont d’une importance particulière pour la théorie ci-dessus exposée. Ils n’ont pas la déclinaison ditq faible, c’est-à-dire qu’ils n’élargissent pas leur thème par l’addition d’un n inorganique; en général, il n’y a pas, dans les langues germaniques, de thèmes en un, pas plus qu’en sanscrit, en zend, en latin, en lithuanien et en slave. Mais les thèmes gothiques en u, autant que nous pouvons en juger par les textes arrivés jusqu a nous, ajoutent la syllabe ja, non-seulement à tous les cas où les pronoms à genre variable s’écartent de la déclinaison substantive, mais encore à l’accusatif pluriel masculin (unmanv-ja-m « impa- ^ ratos»); Vu du thème simple est supprimé devant cette syllabe ja, comme il est supprimé devant N des suffixes marquant les degrés de comparaison (hard’-isô «durius»), devant le caractère ja de la première conjugaison faible (gahard-ja «je durcis») et devant le suffixe dérivatif janl. Nous arrivons de la sorte, pour le thème manvu «préparé», au thème composé manv-ja, lequel peut être comparé au thème pronominal composé W t-ya «celui-ci» (nominatif HT s-ya)2 ; non - seulement. le dernier membre du composé est le même en gothique et en sanscrit, mais l’une et l’autre langue ont supprimé la voyelle finale du premier membre. Rapprochez l’accusatif masculin manv -ja-na3 du sanscrit t’-ya-m, où le pronom relatif y a est privé de signification absolument comme dans le gothique manv -ja-na. ^
Au nominatif pluriel masculin sanscrit t’-yê'(venant de t-yai)
> Forme faible d’un suffixe dont la forme forte serait ja = sanscrit u ya (S 901). Le seul exemple de ce suffixe ajouté à un thème en u est laushandjan «ayant les mains -vides».
a Venant de ta-ya, sa-ya. S 353.
3 Voyez S 287.
ADJECTIFS.

170

répond tulÿ;-jai (venant de tulgu «solide»1); au datd-ablati! pluriel t’-yê'-Byas (venant de t-yai-byàs) répond le datif gothique mam-jai-m; à l’accusatif t’-yâ-n (venant de t’-yâ-m, § a36) répond la forme précitée unmanv-ja-ns «imparatos»; au nominatif-accusatif singulier neutre t’-ya-t répond manv’-ja-ta «paratum», pour lequel on trouve aussi le simple manvu. 11 n’existe du nominatif masculin et féminin que des exemples à forme simple et identique pour les deux genres, comme thaursu-s esiccus, sicca», par exemple dans ce passage d’Ulfdas162 : handus vas thaursus «manus erat sicca». Il faut remarquer ici quil y a aussi en sanscrit des thèmes adjectifs en u qui ont le nominatif féminin semblable au masculin, notamment les thèmes dont l’a final est précédé de deux consonnes ; exemple : pându-s, pândârs, pândü (venant du thème pândû «blanc, gris»); rapprochez le gothique hardu-s, hardu. Nous connaissons, en outre, pour les thèmes adjectifs en a, le datif pluriel féminin, lequel a la forme composée; hnasqv’-jai-m163 correspond aux datifs pronominaux féminins comme thai-m (qui sert également pour le masculin et pour le neutre). Au génitif singulier féminin, nous devons nous attendre à avoir des formes comme manv’-ji-sôs, d’après l’analogie de thi-sÔs (§ i75); au datif manv-jai pour manv-ji-sai, comme on a blindai «cæcæ» pour blinda-i-sai, auquel se rattache le vieux haut-allemand blindêru et l’allemand moderne blinder. Au génitif singulier masculin-neutre, on pourrait s attendre à
' La racine tulg, venante talg, correspond à la racine sanscrite <kh (venant de darl}) tt grandir», qui .a donné <M« a solide, fort». (Vojez Glossaire sanscnt, édition 18/17,p. i55.) -
2 Luc, VI, 6. , . ,
.1 Matthieu, XI, 8 : Imasqvjaim vastjôm *èv fia/axoîs /parfois» du thème simple
hrnsqvu, dont il ne reste pas d’exemple, mais qu’on peut supposer d’après l’analogie d’autres thèmes adjectifs en vu; le v, quand il est précédé d’une gutturale, est peut-être un complément euphonique (S 86, 1 ). Nous avons notamment angvu-s a étroit» , qui répond au sanscrit an],m-s (même sens). -

171

trouver des formes comme manv’-ji-s, quoique la forme conservée filau-s Rinulti» semble contredire cette hypothèse; mais cejikus est toujours employé substantivement1 et ne peut, par conséquent, nous renseigner sur la forme adjective.
Je fais suivre la déclinaison de manvu-s «paratus» comme elle ressort, soit de ce mot lui-méme, soit d’autres adjectifs en u. Je mets entre parenthèses les formes reconstruites par hypothèse : ^
Féminin.
Masculin.
Singulier. Pluriel. Singulier. Pluriel.
Nominatif.. manvu-s manv’-jai manvu-s (manv -jo-s)
Accusatif. . manv’-ja-na manv’-ja-ns (manv’-ja) (manv’-jâ-s)
Datif.....(manv’-jarmmaY manv’-jai-m (manv’-jai) manv’-jai-m
Génitif . .. (manv’-ji-s) (manv’-ji-sê) (imanv’-ji-sôs)’ (manv’-ji-sây. 164 162 163 165
ADJECTIFS.

17-2

Neutre.
Singulier. Pluriel.
Nominatif-accusatif. . mmw’-ja-la' mmw’-ju.
$ 389. Le pronom interrogatif gothique hvarjis.
Le même pronom que nous avons reconnu comme partie intégrante des adjectifs forts se trouve aussi comme dernier membre d’un pronom composé. Je ne doute pas, en effet, quil ne soit renfermé dans hvarjis (pour hvarjas, § 67) «qui?», dont le premier membre, employé seul, signifie «où?» (S 38i). Dans le composé en question, hvar joue le rôle du thème, à peu près comme font en sanscrit certains pronoms qui gardent au commencement d’un composé la terminaison du nominatif-accusatif singulier neutre, au lieu de paraître sous la forme du thème166 167. Dans le gothique hvarjis, la signification interrogative de hvar absorbe la valeur démonstrative (primitivement relative) de l’annexe ji-s (= sanscrit y as), en sorte qu’il ne lui reste qu’à exprimer le rapport casuel. On peut rapprocher du gothique hvar-jis, hvar-ja, lwar-jata l’ancien slave kü-j, ka-ja, ko-je* qua-lis? quale?», qui, aux cas obliques, fléchit seulement le pronom
annexe (l’article sufïixé des adjectifs)168. ^ _
Examinons à présent la déclinaison du gothique hvar-jis : je ne crois pas que cet interrogatif suive entièrement, comme on l’a dit, la deuxième déclinaison adjective et se décline exactement sur midjis = sanscrit mddyas169; je suppose que la partie
DÉCLINAISON. S 290.

173

liliale, étant un thème pronominal en a, féminin ô, suivait dans sa flexion, partout ailleurs qu’au nominatif, le thème tha, féminin thâ; qu’il faisait, par exemple, au génilif féminin, ji-sôs i comme thi-sos) et non jai-sôs (comme midjaisôs)1. En effet, dans hvar-ja-i-sôs, venant de hvar-ja-ji-sôs, le thème relatif sanscrit serait contenu deux fois, tandis que -ji-sôs est avec le sanscrit yd-syâs dans le même rapport qu e thi-sôs avec ti syas et hvi-sôs2 avec kd-syâs. Le nominatif féminin hvar-ja (et non hvar- _ jô, comme on pourrait le supposer d’après l’analogie de sà) n’a rien de surprenant, car sô (= sanscrit sa) doit à son caractère monosyllabique la conservation de la voyelle longue (§ 118), au lieu que hvar-ja, étant polysyllabique, a abrégé la voyelle finale, suivant la règle ordinaire.
Au génitif pluriel masculin-neutre, nous devons avoir hvar-ji-sê, et au féminin lmar-ji-sô, d’après l’analogie de thi-sê, thi-sô. Au datif singulier féminin, il ne serait pas impossible qu’on eût hvar-jai au lieu de hvar-ji-sai (comme thi-sai); en effet, la surcharge produite par la composition pouvait amener une mutilation du pronom annexe, comme dans blindai pour blinda-i-sai (vieux haut-allemand blindêru).
A l’état isolé, le thème pronominal gothique ja n’a laissé que quelques adverbes et quelques conjonctions (§ 383 et suiv.) : pareille chose est arrivée en latin pour le thème sanscrit ta, gothique tha, grec to çt slave to (S 343). 170

m

dont il vient d’être parlé, et je mets en regard celle du relatif sanscrit. Les formes dont il ne reste pas d’exemples sont mises entre parenthèses (comparez § 282) : 171 172 173
MASCULIN.
|
Singulier. |
PîurifiL |
|
Sanscrit. Gothique. |
Sanscrit. " Gothique. |
|
Nominatif. . . |
ya-s |
hvar-ji-s |
F |
hvar-jai |
|
Accusatif. ... |
ya-m |
hvar-ja-na |
yâ-n |
hvar-ja-ns |
|
Datif..... . |
yâ-smâi |
Iwar-ja-mma1 |
yê-b'yas |
(hvar-jai-m) |
|
Génitif...... |
yâ-sya |
hvar-ji-s |
yê-sâm |
(hvar-ji-sè). |
|
FÉMININ. | ||||
|
Nominatif. . . |
yâ |
hvar-ja |
yâ-s |
(hvar-jôs) |
|
Accusatif. ... |
yâ-m |
hvar-ja |
yâ-s |
(hvar-jô-s) |
|
Datif...... |
yâ-syâi |
(hvar-ji-sai) |
yâ-liyas |
(hvar-jai-m) |
|
Génitif...... |
yâ-syâs |
(hvar-ji-sôs) |
yâ-sâm |
(hvar-ji-sô). |
|
NEUTRE. | ||||
|
Nom.-accusatif |
' */«-< |
hvar-ja-ta |
ya-n-i |
hvar-ja |
S 291. Les suffixes tara et tamu.
n \
J (Kaa ri

DEGRÉS DE COMPARAISON. S 291.
175
DEGRES DE COMPARAISON.

Le comparatif est exprimé en sanscrit par le suffixe tara, féminin tard, et le superlatif par tama, féminin tamâ; ces suffixes viennent s’adjoindre au thème (masculin et neutre) du positif. Exemples : pünya-tara, punya-tama, de punya «pur»; édci-tara, sûci-tama, de süci «pur»; mahât-tara, mahdt-tama, de malutt «grand» (forme forte mahâ'nt). En zend, par une déviation de l’instinct grammatical, les suffixes tara et «gjp tëma vont se joindre au nominatif singulier masculin, et non, comme ils le devraient, au thème; exemples : huskôtara,
de huska, nominatif masculin huskâ «sec»;
spëntôtëma, de spënta, nominatif masculin spëntà «saint»;
vërëtrasanstëma, de vërëtrasant, nominatif vërë-trasaM «victorieux» (littéralement «tuant Frira»)1.
L’origine du suffixe tara est, selon moi, la racine tar (a tf) •« transgredi » ; c’est la racine qui a donné entre autres la préposition zende taré «au delà», le védique tiras (môme sens), le celte (irlandais) tar, «air «au delà, à travers, par-dessus», le latin trans, le gothique thair-h, l’allemand dur-ch (§ 1016). J’admets avec Grimm que le suffixe du superlatif vient de celui du comparatif, sans cependant croire avec lui pour cela que le superlatif devait nécessairement passer par la gradation intermédiaire du comparatif174 175. Mais tama, en tant que primitif, n’a pas d’étymologie satisfaisante : je pensais autrefois à la racine rH tau

176
(a

«étendre», d’où l’on aurait aussi pu tirer xaxos; mais alors rfu tama ne serait pas une formation régulière, et je préfère maintenant y voir une forme mutilée pour tarama. Ce qui me confirme dans cette opinion, c’est que le suffixe superlatif ^ n\a s’explique très-bien comme une dérivation du comparatif correspondant en îyas (§ 298), ® l’aide de ce même suffixe ta, ta que nous trouvons en grec dans «x-xos aussi bien que dans xa-Tos (ce dernier pour xapxos ou xapoxos). Ainsi se trouverait éclairci le rapport de xaxo-s et de tama-s : ils contiennent tous deux un seul et même primitif (tara) mutilé de la même façon, mais ils ont pris deux suffixes dérivatifs différents, comme cela est arrivé pour Wpwr-To-s comparé à panca-ma-s «le cinquième»; la voyelle est toutefois mieux conservée dans le dérivé xaxos que dans son primitif repos.
jf L’allongement de la voyelle finale du thème positif, dans les formes comme ao(pcô-Tspos, o-o^w-raxos, repose, a ce que je i crois, sur le même principe que le renforcement de la voyelle,
; en gothique, devant les particules enclitiques h et km, et, en ? lithuanien, devant le suffixe réfléchi « (8 290). C’est pour une-raison du même ordre qu’en grec les thèmes positifs en 0, dont la pénultième est longue, soit par nature, soit par position, n’allongent pas leur 0 final : grâce à cette longue, ils sont assez forts pour porter le poids du suffixe. On a, par conséquent,
5 Seiv6-Tspos, Sstvé-Tortos, ©ixpô-xepos, ©ixpd-xaxoî, et non Sei-i vd-Tspos, etc. Au sujet des formes en e<x-x£pos, ea-rmos ou yc-xspos, /ff-xaxos, voyez S 298*.
En latin, tama-s est devenu timu-s ou tumu-s (■optivrn, intimas, extimus, ultimus, pos-tumus) et stmus par le changement du « en s, qui d’ailleurs a lieu plus fréquemment en grec qu’en latin; exemples : maximus (mac-simus) pour mag-simus, proximus (proc-simus) pour prop-simus, la gutturale ayant permuté avec la labiale à peu près comme en lithuanien dans le nom de nombre
0Col
Mt '
ali-
DEGRÉS DE COMPARAISON. S 292.

177

ordinal sêlc-nia-s «le septième» 176 à côté de septyni, «sept». Après r et l on trouve, en latin, rimus, limus [pulcher-rimus, facil-limus) par assimilation pour simus. Mais ordinairement simus est précédé de la syllabe is, que nous expliquerons plus loin (§ nq8). Une formation unique en son genre est sum-mus, par assimilation pour sup-mus (avec perte de la syllabe finale de super) : dans ce mot, le suffixe de gradation a perdu sa syllabe initiale, en sorte que nous pouvons rapprocher la syllabe mu-s de la syllabe sanscrite ma-s dans les noms de nombre ordinaux comme panca-mas «quintus», pour panca-tamas (§ 3a î). Outre sum-mus, in-timus, ex-timus, pos-tumus, je crois encore reconnaître dans optimus le rejeton d’une préposition (S 1006).
S 399. Le suffixe comparatif tara ajouté aux pronoms.
Comme le comparatif suppose toujours deux termes et le superlatif plusieurs, il est naturel que leurs suffixes aient été transportés à d’autres mots qui impliquent une idée de dualité ou de pluralité. Parmi les pronoms, nous avons, par exemple, êfirPCïT katard-s, «qui des deux?» et katamd-s «qui de plusieurs?», êkatard-s «l’un des deux» et êkalamds «l’un de plusieurs». 11 est à peine nécessaire de rappeler les formes grecques comme 'airepos (pour xérepos), sxarspos. Dans êxoutîos, le suffixe superlatif (cr7os pour t&los) amène un autre sens que dans êkatamd-s : àu lieu de signifier, comme le mot sanscrit, «l’un parmi plusieurs», exotalos signifie «chacun parmi plusieurs». En latin et dans les langues germaniques, le suffixe tara, qui ne s’emploie pas avec les vrais comparatifs, s’est conservé avec les pronoms : il a pris, en latin, la forme terô [ter, teru-m) et en gothique la forme thara. Exemples : uter, neuler, alter; gothique hva-thar «lequel des deux?», vieux haut-allemand huëdnr. Ce

178

dernier se retrouve, en allemand moderne, dans l’adverbe weder «ni», qui est un reste du moyen haut-allemand newëderl. Le même suffixe a formé anthar, d’où vient l’allemand moderne nnderer « autre » ; il répond au sanscrit antara-s, dont la syllabe initiale est la même qui dans anyâ « abus » s’est unie au thème relatif "Q ya. De ce pronom anyâ vient anyatard-s «alter ». Quoique ünfiQantara-s signifie «l’autre» en général2, on s’explique très-bien pourquoi il a le suffixe comparatif : antara marque tout ce qui dépasse, tout ce qui n’est pas l’objet désigné3. Il faut entendre de même le latin ceterus, qui vient du thème démonstratif ce (comparez ci-s, ci-ira). De même encore, nous avons en sanscrit îtara-s « l’autre » du thème démonstratif i, et en latin, venant du même thème, l’adverbe ilerum'i.
S ag3. Le suffixe comparatif tara ajouté aux prépositions, en sanscrit
et en latin.
H y a aussi des prépositions qui prennent le suffixe comparatif ou superlatif; quelques-unes ne sont même jamais employées qu’avec une désinence comparative. Il ne faut pas nous en étonner : il est dans l’essence de toutes les vraies prépositions de marquer, au moins à l’origine, un rapport entre deux directions contraires. Ainsi «sur, hors, devant, à» ont pour pôles opposés et pour points de comparaison les rapports marqués par «sous, dans, derrière, de», de même que la droite est opposée à la gauche, comme on le voit dans le latin, où l’on dit, avec le suffixe comparatif, dexter ddksina), sinister. Mais la nature
1 Newèder contient le comparatif en question uni à une particule négative.
a C’est-â-dire sans acception du nombre des objets comparés. — Tr.
3 Sur les deux éléments renfermés dans antara, auxquels l’auteur fait allusion ici, voyez SS 291, 369 et 374. — Tr.
4 J’ai démontré pour la première fois la nature comparative de cet adverbe, que
Vossius fait dériver de iter «voyage», dans ma recension de la Grammaire sanscrite de Forsler (Annales de Heidelberg, 1818, p. 479). •
DEGRÉS DE COMPARAISON. $ 293, 179


comparative de ces formations a fini par n’être plus sentie en latin, et l’on a encore ajouté au suffixe ter la désinence ordinaire ior (dexterior, sinisterior, comme exlerior, interior), au lieu f[ue le superlatif timus a été joint au noyau du mot (.dexlimus,
dextumus, sinistimus). '
Les prépositions qui, en latin, contiennent un suffixe comparatif, sont inter, prœler, propter, subter (qui est employé adverbialement) et probablement aussi obiter (comparez audacter, pa-riter)1. Au latin inter répond le sanscrit antâr «sous, entre»177 178, quoiqu’il n’y ait pas, en sanscrit, un primitif an, la relation marquée en latin par in étant toujours exprimée par le locatif. Néanmoins antâr est, en ce qui concerne son suffixe, un analogue de prâtar «au matin», qui vient de la préposition pra «devant»179, avec allongement de Ya, comme le grec ®pw< de 'nspo.
Outre antâr, le sanscrit possède, pour exprimer la relation
«sous», la préposition adds, que j’ai expliquée ailleurs comme venant du thème démonstratif «. Du même thème viennent aussi d-d'ara et a-damd «celui qui est en dessous» et «celui qui est le plus en dessous»; le latin inferus et infimus sont de la même famille, avec / pour i comme dans fûmus = iûmd-s «fumée», et avec insertion de la nasale comme dans â^l comparé à abi, ou dans , ambo comparés a ubciu, en ancien slave oba. Les suffixes d'ara et dama sont, selon moi, des variétés légèrement altérées de tara et tama (§ 291), dont la dentale a éprouvé une substitution d’une nature un peu différente dans pratamd «le premier», venant de pra «devant». Le suffixe d'as de adds «sous» est avec tas, par exemple dans d-tas «d’ici», dans le même rapport que d'ara,


ADJECTIFS.
180
dama avec tara, tama. Nous regardons donc adds, forme modifiée de dtas, comme étant, en ce qui concerne le suffixe, de même
famille que subtus, tntus. L’emploi ordinaire du suffixe tas, comme celui du latin tus, est de marquer l’éloignement d’un lieu (§ 4 a 1).
§ g g 4. Le suffixe comparatif tara ajouté aux prépositions dans les langues germaniques.
Les> langues germaniques sont plus portées encore que le latin à unir les prépositions au suffixe comparatif. Au sanscrit antdr (§ 293), au latin inter, répond l’allemand moderne unter «sous», le gothique'wndar ’. Mais si l’on reconnaît 1 identité, incontestable selon moi, de cette dernière forme avec les deux premières, on ne peut faire venir, comme le fait Grimm180 181 182, undar de la préposition und «jusqu’à» et du suffixe ar; il ne faut pas chescher en gothique les éléments d’un mot qui était déjà tout
DEGRÉS DE COMPARAISON. S 295.

181

formé avant que les idiomes germaniques arrivassent à une existence indépendante.
Il n’en est pas de même du vieux haut-allemand af-tar « apr ès », car nous ne trouvons de mot correspondant dans les autres langues indo-européennes que la préposition ^PT âpa, àni «de»; c’est seulement dans les idiomes germaniques que cette préposition a pris l’ancien suffixe comparatif, de la même manière que l’ont pris en sanscrit et en latin les mots antdr, inter, subter.
§ 995. Autres exemples de prépositions et d’adverbes germaniques pourvus du suffixe comparatif tara.
En gothique, aftra signifie «de nouveau». Je vois dans ce mot une forme mutilée pour aftara, de même que je regarde en latin extrâ, intrâ, contrâ, comme des ablatifs féminins venant de exterâ, etc. En ce qui concerne la désinence, aftra et d’autres formes semblables en tra, thra peuvent être considérées comme des instrumentaux. Ce cas est aussi employé adverbialement en sanscrit; exemple : dntarêna «entre». Peut-être même les adverbes pronominaux sanscrits en tra, comme yâtra «où », doivent-ils être pris pour des instrumentaux, quoiqu’ils aient la signification locative183.
Le même rapport qui existe entre le gothique aftra et aftar se retrouve entre vithra «contre» et le vieux haut-allemand widar, l’allemand moderne wider. Le primitif s’est conservé en sanscrit, où nous avons la préposition inséparable vi qui marque la séparation, la dispersion, par exemple dans vi-sarp (vi-srp) «se séparer, se disperser». Le sanscrit ni «en bas»2 est
182 ADJECTIFS.


de même le primitif de l’allemand moderne nieder «en bas», en vieux haut-allemand ni-dar. Le gothique hin-dar, en vieux haut-allemand hin-tar, en allemand moderne hin-ier «derrière», dérive du thème démonstratil lu, dont 1 accusatif lima ne se trouve qu’en combinaison avec dag ( hinadag « ce jour»)1.
Dans le vieux haut-allemand sun-dar, en gothique sun-drô «seorsum», devenu plus tard une préposition (en allemand moderne sonder), la syllabe dar est évidemment le suffixe comparatif; quant au thème, malgré la.différence de signification, je le crois parent de la préposition sanscrite sam «avec», l’a primitif s’étant affaibli en u. La différence de sens n’est pas plus grande qu’entre le latin con-tru et son primitif cum. Au même thème se rapportent le gothique samatli, le vieux haut-allemand samant «simul»; ce dernier s’accorde d’une manière surprenante avec le sanscrit samanta (venant de sam + dnta «fin»), dont l’ablatif samantât et le dérivé adverbial samantatas signifient «undique». Peut-être le mot dnta «fin» est-il contenu dans tous les autres adverbes terminés par nt en vieux haut-allemand2 : il n’y aurait rien d’étonnant à ce que l’idée de fin ait servi à former, comme celle de milieu (comparez, par exemple de cette acception ; j’en ai reconnu le premier la vraie valeur ( Grammatiea critica, p. 69). Si ni-vié signifie «entrer», cela ne tient pas à la préposition, mais au verbe qui de lui-même a ce sens. Au contraire, la valeur do la préposition PT m ressort bien clairement de composés comme ni-pat «tomber», ni-yam «opprimer», ny-as«jeter en bas», ni-Mïp (même sens), ni-Var (ni-fc) «cacher», littéralement «porter en bas» ; joignez-y l’adjectif ntta «bas», lequel est opposé à utba (par euphonie pour utca) «haut», venant de ut «en haut». Il y a dans Wilson une autre explication de ntca, qui est probablement donnée par les grammairiens indiens : ntca viendrait de la négation m «ne pas», du substantif f «fortune» et de la racine « «assembler», avec le suffixe a; il est clair qu’il n’aurait plus dès lors aucune analogie avec ubia.
1 Voyez S 396. C’est à l’accusatif him que se rattache l’adverbe allemand fini i« là», en vieux haut-allemand hina, hinna. '
1 Grimm, Grammaire allemande, t. lll, p- 01 h.
DEGRÉS DE COMPARAISON. S 29G.

183

exemple, l’allemand inmitten «parmi») et celle de commencement, des expressions adverbiales et des prépositions. Ainsi hinont «en deçà», mont «au delà» signifieraient littéralement «hoc fine, illo fine».
Parmi les mots à suffixe comparatif, il faut encore mentionner le vieux -haut-allemand for-dar, fur-dir «porro, amplius», qui a donné l’allemand moderne für-der. Les adjectifs der vorderef vorderste «celui qui est en avant, le plus en avant» en sont dérivés.
S 296. Le suffixe superlatif tama en gothique.
Le suffixe superlatif sanscrit tama a également laissé des traces en gothique : il prend le complément habituel n, c’est-à-dire qu’il suit la déclinaison dite des adjectifs faibles (§ 386), et il affaiblit le premier a en u, comme font pos-tumu-s, op-tumu-s en latin. On a donc en gothique : af-tuman, nominatif af-tuma ' «posteras, ultimus», venant de af «de»1. De af-tuman, ou plutôt du thème primitif aftuma, vient, par l’adjonction du suffixe superlatif ordinaire, aftum’-ista, nominatif masculin aftumists. L’ancienne ténue s’est conservée dans af-tuman, grâce à l’aspirée qui précède (§91, 1 ), au lieu que dans hin-dum’-ist’-s «le dernier», venant d’un thème hin-duman, dont il ne reste pas d’exemple, la liquide n a amené le changement du t suivant en d; le môme changement a eu lieu dans hlei-auman « gauche », à cause de la voyelle qui précède le *(§91, 2 ). Le mot hlei-duman «gauche» a le même suffixe que le latin dextimus184 185 186, au lieu que dans sinister nous avons le suffixe comparatif, qui semble plus

m

à sa place. Je crois reconnaître dans Met, considéré comme positif de Meiduman, le sanscrit sn «bonheur» (venant de /en)'; si cette explication est fondée, nous avons dans la dénomination gothique de la gauche le même euphémisme qui se trouve dans le grec dpi</iep6s et etiüvvpos.
Le thème féminin Mei-dumein s’accorde très-bien avec les superlatifs sanscrits en lamî, si 1 on fait abstraction de la lettre H qui est venue s’ajouter comme un surcroît inorganique au thème masculin-neutre Meiduman. La forme féminine tami ne se trouve d’ailleurs pas avec les thèmes superlatifs ordinaires, lesquels prennent tamâ (punya-tamâ), mais seulement avec les noms de nombre ordinaux comme vinsati-tami ^ la vingtième». Les noms de nombre ordinaux qui ont mutile tama en ma prennent de même mi, au lieu de mâ; exemple : panéa-mU la cinquième». Rapprochez-en le gothique mein dans fru-mein «la première», nominatif frumei187 188.
11 faut encore ajouter aux formes gothiques qui ont mutilé le suffixe superlatif sanscrit tama en ma, et qui l’ont élargi par l’addition d’un n inorganique, le thème auhu-man «superus»189. Je doute qu’il faille considérer ce mot comme étant pour liauhu-man et le rapporter au thème hauha «haut»; je serais plutôt porté à rapprocher auhu-man du mot ucca «haut» (§ 2g5), qui vient de la préposition ut et est pour ut-ca, anciennement ut-ka (§ 14). Après la suppression de la première consonne, il resterait uka qui, transporté en gothique, devrait donner auha (§§ 8a et 87, 1); devaptle suffixe superlatif mon (pour ma), l’a final
DEGRÉS DE COMPARAISON. S 297. 185


du thème s’affaiblit toujours en u, de sorte que nous aurions
avhvr-man.
Il n’en est pas du thème midjuman «médius» comme des mots qui viennent d’être cités : si l’on fait abstraction de la lettre n qui a été ajoutée, midjuman répond au sanscrit madya-md, venant de m'tdya par le suffixe ma.
S 297. Le suffixe comparatif tara en lithuanien et en slave.
Le lithuanien a conservé le suffixe comparatif tara, sous la forme ira, dans antra-s « deuxième »190 = sanscrit antara-s « autre », gothique an-tliar (thème antliara, même sens), et dans katra-s «uter» = sanscrit ka-tara-s, gothique hva-thar (thème hva-thara). L’ancien slave présente le même suffixe dans ESTopsi v&torü «le second», KOTopzi kotorü «lequel» (relatif) et të'rcpx jeterû « quelqu’un ». Les deux premiers appartiennent à la déclinaison déterminée et sont, par conséquent, pour EXTopsiit vütorü-j, KOTopxiiï kotorii-j (S a84). Abstraction" faite du pronom annexe qui a perdu sa signification, kotorü s’accorde avec le sanscrit katard-s et avec les formes congénères des langues de 1 Europe, surtout avec l’ionien xé-repo-s; il y a toutefois cette différence que la forme slave a changé le sens interrogatif contre le sens relatif et quelle a laissé s’éteindre la signification du suffixe. De même, je-terü, thème jetero, a perdu sa valeur primitive; mais la forme du mot coïncide très-bien avec le thème sanscrit ya-tara «qui» (employé, dans le sens relatif, en parlant de deux). Quant au mot précité vütorü «Asiîrspos», es vü répond au thème sanscrit dva (forme affaiblie dvi, S 309); le d s est perdu de même dans le nom de nombre ordinal zend fotya, au lieu que dans le grec Seu- la voyelle finale du thème
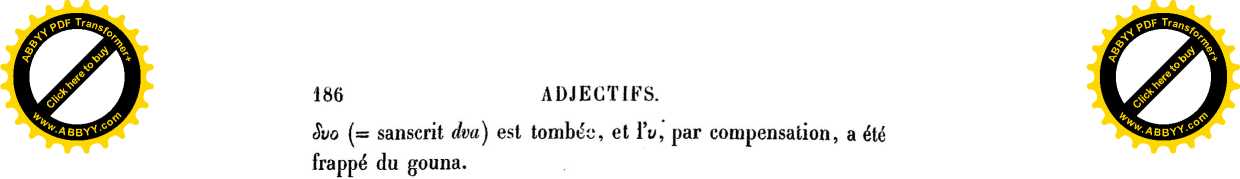
S 298*. Comparatif et superlatif en îyas, ièia.
Un nombre relativement petit de comparatifs est formé en sanscrit par îyas et le superlatif correspondant par ista. Dans la première syllabe de cette dernière forme, nous reconnaissons une contraction de îyas ou yas1 : le suffixe superlatif est donc, en réalité, TSf ta, qui sert aussi à former les noms de nombre ordinaux catur-td-s « reVap-TO-s » et sas-fd-s k&-to-s». La présence du suffixe superlatif dans les noms de nombre ordinaux n’a rien de surprenant : l’idée du superlatif est étroitement liée à celle des noms de nombre ordinaux au-dessus de deux, de même que l’idée d’ordre a une grande affinité avec l’idée marquée par le superlatif. C’est pour cette raison que nous trouvons aussi le suffixe cffl tama avec les noms de nombre ordinaux, par exemple dans vihs'ati-tamd-s « le vingtième ». Pour la même raison, on peut regarder le ma des formes telles que padcama-s «le cinquième» comme un reste de tama.
A la forme sanscrite is, contractée de îyas ou yas, correspond is en grec et en zend, et en latin le is des superlatifs en is-simus. Cette forme is-simus vient, selon moi, Par assimilation, de is-timus; quant à la syllabe is qui, si nous nous plaçons au point de vue de la langue latine, est une contraction pour ius, elle se trouve employée seule dans l’adverbe mag-is ( comparez peyts dans pépicr-TOs).
Aux cas forts (§ 129), le comparatif sanscrit présente une forme plus large que îyas, à savoir îyâhs. Il est probable qu’à l’origine, cette forme, comme toutes les formes fortes (S 129)» a été usitée pour tous les cas : c’est ce qui semble ressortir de
1 Voyez S 3oo et comparez le rapport qui existe entre ié-tâ «sacrifié» et sa racine UsT, yé’- Au sujet i pour s, voyez S a 1 \ et sur 5 t pour ?r C, S 15.
DEGRES DE COMPARAISON. S 298*.

187

la comparaison du latin, où nous avons grav-iôr-em, grav-iôr-is, venant de grav-iôs-em, grav-iôs-is *, en regard du sanscrit gar-îyâhs-am, gdr-îyas-as.
Devant le suffixe en question qui* même sous la forme îyas, ajoute au mot un surcroît assez notable, le thème du positif subit de fortes diminutions : non-seulement des voyelles finales sont supprimées à la fin du thème, comme cela est de règle devant tous les suffixes taddhita2 commençant par une voyelle, mais on rejette des suffixes entiers, y compris la voyelle qui les précède; exemples : irfïPR\mati-mdt «raisonnable», venant de mati «raison», donne le comparatif mdt’-îyas, le superlatif mât-is\a; bdlavat «fort» (littéralement « doué de force », de bala + vat) donne bdl’-îyas, bdl’-is(a; ksipra «rapide» (de la racine ksip «jeter») donne ksê'p-îyas, ksêp-wta; ksudrd «petit» donne ksôd-iyas, ksodr-wi,a. Les voyelles susceptibles du gouna compensent, comme on peut le voir, la perte du suffixe par le renforcement de la syllabe radicale à l’aide du gouna; c’est ainsi que nous avons en zend vaidista, que Burnouf, avec autant de justesse que de pénétration, fait dériver de vîdvas (vîdvô, § 5 6 b), en sanscrit vidvds = « sachant » s.
Par un trait de ressemblance remarquable entre le sanscrit et le grec, ce dernier idiome, devant les suffixes exprimant la gradation, se débarrasse aussi de certains suffixes trop encombrants; exemples : êyOiav, êyOi</los, aia^îcov, atayte/los, xvSiuv, xdSterlos, venant de êxfipbs, aia%p6s, xvSpés. Je crois devoir expliquer l’allongement de la voyelle dans ptfxi(r1os, p-âaaov, venant de tiaxpôs, par le même principe qui a introduit le gouna dans 191 192 193
ADJECTIFS.

188

les mots sanscrits : cet allongement sert à compenser la suppression du suffixe. Il en est de même pour la longue dans les formes comme B-âaaov, âaaov. Buttroann1 admet ici un recul de Yt du comparatif qui se serait uni avec l’a : mais j’explique d’une façon différente ce qui est avenu de l’< dans ces formes; nous y reviendrons bientôt (§ 3oo).
Remarque. — Exemples d’accumulation de suffixes en latin, en grec et en persan. — Jacob Grimm194 195 donne une autre explication de la forme latine issimus. 11 ne croit pas quelle vieime par assimilation régressive de is-limus, mais il y voit un redoublement purement phonétique de la lettre s du comparatif. Il divise donc novissimus de la façon suivante : nov-iss-i-mus; le second i serait une voyelle de liaison et le suffixe superlatif se composerait uniquement de mu-s. Il explique dextimus comme étant pour dec-is-timus, c’est-à-dire qu’il voit aussi- dans ce mot la reunion des suffixes comparatif et superlatif; mais le positif sanscrit dâksina edexter»196 prouve bien que le s contenu dans le x du mot latin appartient à la racine, et ne provient pas d’une syllabe mutilée is.
Corssen197 cite une forme qui nous montre très-clairement la réunion du suffixe comparatif is avec le suffixe timus : c’est soll-is-timus, venant de sollus trentier, sain et sauf".
iNous trouvons deux suffixes comparatifs réunis dans mag-is-ter et dans min-is-ter : le premier de ces deux mots contient le comparatif magis, pour magius; le second nous présente le comparatif minis, qui a rejeté \u, à la différence de minor et de minus où T/ a disparu et ou la seconde voyelle est restée. Il est probable que dans sin-is-ter il y a aussi deux suffixes comparatifs, et que, par conséquent, dans sitiris-limus nous avons une forme analogue à soll-is-timus. \ ■
En grec, je reconnais comme des analogues de mag-is-ter, min-is-ter, les formations en ea-repos et la-repos, par exemple dans sùScupov-éa-repos, ànpar'-èa-repos, \tik'-la-repos. Conséquemment, dans les super-
DEGRÉS DE COMPARAISON. S 2981

189

lalils comme siiSatyov-éa-raros, nous avons le suffixe superlatif ordinaire réuni au suffixe comparatif e<r, ta = sanscrit yas, par exemple dans src-yas ttmeilleur» Nous n’examinerons pas si sa et ta ne faisaient à l’origine qu’une seule et même forme (le serait alors une altération de l’<), ou si |’s de sa correspond à l’a du sanscrit y as, tandis que ta serait une contraction comme dans ijh'-ta-ros — sanscrit svad-is-tas .
Il est possible que dans la diphthongue ai des formes comme laakspos. psaakaaos, nous ayons conservé également une partie du suffixe comparatif îy&hs, îyas, ou ymis, yas, soit l’f des deux premières formes, soit le ^ y vocalisé en i. Il faudrait alors attribuer l’a de la diplithongue ai au thème positif, dont l’o est une altération d’un a primitif. Le thème ysaa de fis-aa-î-TotTos correspondrait au thème sanscrit mâdya itmedius».
Le persan moderne réunit, comme il me semble, les deux suffixes comparatifs, dans les superlatifs en tenu; exemple : behterîn «optimus», littéralement temagis melior». Je crois, en effet, que la syllabe tn est une contraction pour îyâns, thème fort du suffixe sanscrit.
g 298b. Comparatif et superlatif en yas, êta.
Placés en contact immédiat avec une voyelle précédente, les suffixes de gradation îyas, îyâns, is{a perdent leur voyelle initiale; exemples : stê'-yas, ste-yâm, stê-sia, venant de stird «solide», avec suppression du suffixe et avec gouna de la voyelle du mot fondamental; de même spê-yas, spê-yâns, spê-sta, venant de spird «enflé»; srê-yas, srê-yâhs, srê-sta, venant de srila ou de mmat «heureux, excellent»; prê-yas, prê-yâhs, prê-sta, venant de priyd « cher»198 199 200; Biï-yas, M-yâns, venant de M-ri201 «beaucoup »; gyâ-yas, venant probablement d’un thème gyâ-y-in «vieux»,

190

dont ii ne reste pas d’exemple S avec insertion d’un y euphonique (S 43). Dans le dialecte védique, on trouve aussi des formes qui joignent le suffixe comparatif commençant par y à une consonne précédente; exemple : ndv’-yas, thème fort ndv’-yâhs, venant de ndva «nouveau»202 203 204. Comparez l’accusatif masculin ndv’-yâhs-ain avec le latin nov-iâr-em. 11 est probable que yâiis est la forme primitive du suffixe et que l’î est simplement une voyelle de liaison; on ne la trouve pas en zend (S 3oo).
L’f du latin iôr- s’explique aussi bien par ^y que par et 11 grec de ton, quoique long, peut être regardé comme la vocalisation de la semi-voyelle ^ y. Je rappellerai la'contraction de ^rr yâ en î au potentiel sanscrit moyen, par exemple dans dvié-î-td comparé à l’actif dvis-ya-t «qu’il haïsse»; puis les formes latines comme s-î-mus = sanscrit s-ya-tna «que nous soyons», ainsi que les formes gothiques comme et-ei-ma3 «que nous mangions» (et = t) comparées au sanscrit ad-ya-ma «eda-mus» (en ancien latin ed-î-mus).
8 299. Déclinaison des comparatifs en îtjas.
Du thème fort %*ti^î-yâns vient le nominatif masculin îyân, avec la suppression obligée de la consonne finale (§ 94); après cette suppression, le son nasal affaibli en anousvara (§ 9) re“ devient un n. Le vocatif a un a bref; exemple : svudiynn «dul-ciorl», en regard du nominatif svâdîyân; en général, le vocatif singulier affectionne les voyelles brèves dans la syllabe finale. Le grec a partout abrégé la voyelle du suffixe comparatif;
DEGRÉS DE COMPARAISON. § 300. 191


exemple : rjSiov-a, rjSiove, nSiavss = sanscrit svâcl’-îyâhs-am, svâd’-îyâhs-âu, svâd’-tyâns-as. Aux cas faibles, le grec et le sanscrit se complètent l’un l’autre, en ce que ce dernier a sacrifié partout la nasale et le premier la sifflante205; nous avons, par exemple, au génitif singulier, le sanscrit svâd’-îyas-as en regard du grec jS’-iov-os, et au génitif pluriel svad’-îyas-âm en regard de JjS’-ïév-ew. Au nominatif singulier masculin, la longue de la svllabe finale, par exemple dans »JSiwv, n’a rien de commun avec la longue dans la syllabe finale de svadîyân, car au heu que la sanscrit se retrouve à tous les cas forts, 1 co grec n a d autre raison d’être que de compenser, comme dans (pépwv, Sa.ip.wv, la suppression du signe casuel.
Le grec et le latin n’ont pas gardé de forme spéciale pour le féminin : ils sont inférieurs, à cet égard, au sanscrit, qui ajoute au thème faible îyas (§ i3i) le caractère féminin i ; exemple : svâ'd’-îyas-î «dulcior», en regard du grec ri S -ïeov et du latin suav-ior.
Sur l’accord remarquable qui existe, pour les comparatifs féminins, entre le gothique, le slave et le sanscrit, voyez §§ 3on et 3o5, 2.
S 3oo. Formes correspondant en zend et en grec aux comparatifs et superlatifs sanscrits en iy&n, ista.
En zend, les exemples de superlatifs en ista sont plus
nombreux que les comparatifs correspondants. Grâce a la protection de la sifflante, ils ont conservé le t3 qui, en sanscrit,

i9i

s’est altéré en (; le zend ressemble à cet égard au gothique, qui a gardé également le t de ista, grâce à la lettre s qui précède (§ 91, 1). Je rappellerai seulement les superlatifs zends âsista «le plus rapide» et masista «le plus grand». Le premier répond au védique âsista : le positif est nsu «rapide», venant de âkü = grec èm; en grec, la forme correspondante est ôixta-% (latin âc-is-simô, venant de ôc-is-timô). Quant à masista, il répond au grec txéyialo. En regard des superlatifs zends en ista, il y a des comparatifs en yas' (par euphonie yô) = sanscrit yas (§ 298 b); le féminin est yêhî, venant de yahî (en sanscrit yasî), par l’influence simultanée du y et de l’t (§ 42). On a, par exemple, masyêhî «plus grande», qui répond au védique mdMyasî1 ; Krausd-yêhî206 207, dont le thème
positif est Urausda «violent» - sanscrit krudda «iratus», de la racine krud’(§ 102). Nous avons un exemple de thème comparatif masculin-neutre en yas (par euphonie yô) dans vah-yô, venant de vôlia «bon» 208.
Les comparatifs zends et védiques qui ont un y précédé d’une consonne nous conduisent à parler des comparatifs grecs comme xosbawv, (3aarcTMv, fipolcrcrcov, yXvcrawv, êXiacrwv, qui ont deux fois la même consonne devant l’w du suffixe. Je vois dans le second a un ancien y, que le <7 précédent s’est assimilé209. Quant au premier a, il est l’altération d’une linguale ou d’une gutturale; ainsi xpsiaaav vient de xpeiv-jwv pour xpen-jwv ou xpon-jccv, de xpctzvs. 11 y a le même rapport entre fiaa-aw. venant de fia.ar-iwv, et la forme primitive j3«,6-juv, qu’entre [da-cros, venant de fisa-jos, et le sanscrit mndya-s «médius», pour
DEGRES DE COMPARAISON. S 300.

193

lequel on aurait pu s’attendre à trouver en grec (isÔtos et, auparavant, jj-sOjoe (S 12). Remarquez que H et probablement aussi l’ancien j favorise en grec l’affaiblissement d’un t en <7; exemple : SîSw-crt pour le dorien SiSeo-vt, en sanscrit dddâ-ti; rappelons aussi le suffixe abstrait ui pour le sanscrit til. Au sujet du changement des gutturales en cr, dans les comparatifs en question, il faut observer qu’en slave aussi les gutturales deviennent quelquefois des sifflantes, quand elles sont suivies de la semi-voyelle j ou des voyelles h i, t î, e e, t é : cela arrive notamment pour y ch, qui devient 111 s ou c s; exemples : dusa «âme» pour duèja, qui lui-même est pour duchja (düch-a-ti «souffler»); düéuh «je souffle» pour düsjuh, qui lui-même est pour düchjuh; uses-e «de l’oreille» en regard du nominatif-accusatif ucho (venant de uchos, S 264); c’est le même fait qui a lieu en grec, par exemple, pour èXdtrcrav, venant de éXay-jwv.
On peut encore citer une autre série de faits qui vient confirmer cette explication des formes comparatives en cra’cov : la syllabe ^ ya, qui sert à former en sanscrit les verbes de la quatrième classe, produit dans les verbes grecs les mêmes groupes phoniques que le du comparatif (§ 109"). Ainsi le verbe ÇpltT-arcû est avec son primitif (ppix-jco exactement dans le même rapport que yXvcr-trwv avec yXvx-juv. Les verbes en question et les comparatifs se prêtent donc un appui réciproque. De même que nous avons XX pour Xj dans le thème àXXo pour dXjo (§ 19) et dans les verbes </léXXw pour aleX-ja, de même le comparatif adverbial fiüX-Xov est pourpdX-jov210 211. Nous trouvons un double p dans l’éolien yéppwv, venant de yepjoov, et dans le dorien xàp-
ii.

m

paw, venant de xap-jwv. Dans ce dernier exemple, il y a méta-thèse de la syllabe pa en ap et suppression du suffixe formatif tu , qui se trouve dans le thème positif xponv 1 ; en ce qui concerne la suppression du suffixe formatif, comparez ce qui a été dit pour syfitwv (§ 298 a).
Les comparatifs âpsi'vcav et yeipcov font passer f 1 dans la première syllabe, comme paîvopcu et yo-ipv = sanscrit ifïtanys, Jivsyëf venant de Iiarsyê (S 109 a). Mais il en est sans doute autrement pour l’i de ptefëuv, au sujet duquel j’adopte l’opinion de Corssen2 : je regarde fisî&v comme étant pour ftetjav, et je vois dans le '( un j (=\y) qui s’est durci. Nous avons de même v pour àXijuv. La moyenne gutturale du thème positif a été supprimée comme dans le latin ma-jor (pour mag-ior) et dans le gothique ma-isa (thème ma-isan). Il reste à savoir si l’i de pe/£wr = psijm appartient au thème positif ou au suffixe comparatif. Dans la dernière hypothèse, l’i de représenterait l’t sanscrit de îyâhs, nominatif masculin îyân; sauf la suppression de la consonne finale de la racine, p.z-l\wv représenterait le nominatif védique mdh-îyân. Mais je regarde il, dans les comparatifs sanscrits de cette espèce, comme étant relativement récent, et je tiens yâns pour la forme primitive du suffixe; j’aime donc mieux diviser ainsi : [iet-£o>v, et j’explique et comme un élargissement de le, pour compenser la suppression de la consonne suivante, à peu près comme nous avons d-p!, venant de êppl pour êcr-pt. Dans pelcov, qui est pour pi-jwv (venant de ptxpo, par la suppression du suffixe et de la gutturale apparte-
1 Je regarde cette forme comme étant de même famille que la racine sanscrite kar, kr «faire*, d’où vient krd-tu «sacrifice*.
5 Nouvelles Annales de philologie et de pédagogie, t. LXVIH, p. a44. Je regardais autrefois le £ de fiellosv comme une altération du y de fiéyas. Avec l’explication proposée par Corssen, nous sommes dispensés d’admettre qu’un K soit jamais sorti d’un y, et nous avons deux exemples intéressants de plus pour le changement de; en Ç (S 19).

DEGRES DE COMPARAISON. S 301.
195
liant à la racine), le est pour i; on a donc fis-fov, venant de fii-iav, à peu près comme isôXei, venant de •us6\i-i.

S 3oi. Formes correspondant en gothique aux comparatifs et superlatifs sanscrits en îyân, ista.
Nous avons vu qu’un suffixe assez rarement employé en sanscrit et en grec est devenu, au contraire, en latin, le suffixe habituel du comparatif; peut-être était-il à l’origine d’un usage général, concurremment avec la forme en tara, repo. De même, dans les langues germaniques, en slave et en lithuanien, les degrés de comparaison sont marqués par la forme la plus rarement usitée en sanscrit et en grec.
Le gothique nous présente le plus souvent le suffixe comparatif abrégé de la même façon qu’il se montre à nous en sanscrit, en zend, en grec et en latin, quand il est combiné avec le suffixe superlatif (§ 298“). Cette forme abrégée est.t's, qu’on reconnaît le plus clairement dans les adverbes comme ma-is «plus»; de la comjparaison avec le mot congénère latin mag-is (rapprochez (lé-yur-ros, § 298a) il ressort que la forme gothique en question a perdu une gutturaleJ, laquelle s’est conservée dans mikils «grand»212 213 214 215.
Remarque. — Comparatifs adverbiaux en ix, en gothique. — R y a encore plusieurs autres adverbes comparatifs en is, tels que hauhis «âvcbtb-povi), raihtis irpotius», wirs «pejus», allis tcomnino»216. Il y a le même

196

rapport entre Itauhis et hauhisa «altior» qu’entre mais et maisa «major». Contrairement à Grimm, je considère raihtis comme un adverbe, quoique le vieux haut-allemand i-élites ait tout l’air d’un génitif, si l’on ne consulte pas les langues congénères, et quoique le comparatif adverbial soit rëhtôr. En effet, nous sommes autorisés à supposer qu’à côté du comparatif gothique ga-raihtôsa «justior», dont il reste des exemples, il y a eu aussi un comparatif raihtisa, puisque tous les adjectifs peuvent aussi bien former leur comparatif en isa qu’en osa'. Peut-être la confusion s’est-elle introduite, en vieux haut-allemand, entre le suffixe comparatif fs et la désinence géni-tive i-s, de sorte que quelques anciens comparatifs ont été pris pour des génitifs et ont gardé leur s, qui aurait dû, suivant la règle, se changer en r. Je regarde aussi le gothique allis «omnino» comme un comparatif. En vieux haut-allemand, à côté de ailes tromnino», il y a un autre ailes «aliter», qui est pour aljes (comparez en grec âXXos, 8 19); le thème est différent, mais le suffixe est également d’origine comparative : on peut rapprocher en latin l’adverbe alt-ter et d autres semblables, qui ont le suffixe tara. Ce qui ajoute encore à la vraisemblance de l’explication qui précède, c’est qu’à côté de eines «seine!» et anderes «aliter», nous trouvons aussi des adverbes à forme de superlatif, savoir ernest* «quondam», andernt «rursus».
Quelques comparatifs adverbiaux de même formation ont perdu en gothique l’t de is; exemples : min-s «moins» (comparez minor, minus, pour minior, minius), vair-s3 «pis» (lequel a reçu un nouveau comparatif vairsisa «pejor»), seith-s, dans thana-seiths «amplius» (venant de seithu «tardif»), et probablement aussi suns «statim» et anales «subito».
§ 3oa. Comparatifs gothiques en is, isan.
Le gothique ne peut plus décliner les thèmes finissant' par un s4; il fallait donc qu’il ajoutât au suffixe comparatif is un
1 Nous avons, par exemple, à côté du comparatif adverbial frmnôsô «d’abord» le superlatif frumists.
5 Voyez Graff, Dictionnaire vieux haut-allemand, 1, colonne 327.
a Peut-être ce mot est-il de même famille que le sanscrit doara «posteras».
• Un thème en s, par exemple le thème précité mais, devrait faire mais à ious les cas du singulier, ainsi qu’au nominatif-accusatif pluriel. En effet, les formes finissant par deux s rejettent le dernier (comparez laus «vide» pour laus-s, venant de lausa-s, S i35, remarque 1) : au nominatif et au génitif singuliers, mais-s serait
DEGRÉS DE COMPARAISON. S 302.

197

complément inorganique, ou bien qu’il supprimât la sifflante. Mais la valeur de ce suffixe était encore trop clairement sentie pour que la langue le laissât mutiler; elle l’a conservé en ajoutant le complément si fréquemment usité an, que nous avons vu plus haut (§286) s’adjoindre, sans qu’il y eût une nécessité aussi pressante, aux thèmes participiaux en nd quand ils sont employés adjectivement. Mais un s placé entre deux voyelles doit se changer en s (§ 86, 5); de là le thème relativement récent maisan, à côté du thème primitif mais, resté invariable dans l’adverbe. Le nominatif masculin est maisa, le nominatif neutre maisô (§§ i4o et i4i). Quant au thème féminin, il n’est pas tiré du thème masculin-neutre maisan : en générai, les thèmes inorganiques en an des adjectifs faibles ne donnent pas naissance à des féminins. C’est au thème féminin primitif en i, qui subsiste en sanscrit et en zend, que vient s’ajouter un n, comme cela a lieu au participe présent : nous avons donc, en gothique, le thème féminin maisein (et — î, § 70), venant de mais + ein; cette forme correspond, en zend, au thème féminin mas'yêhî,
et, dans le dialecte védique, à mdhîyasî. Le nominatif maisei peut s’expliquer de deux manières : on le peut regarder comme formé de maisein d’après le § 1U 2, ou bien l’on y peut voir l’ancien nominatif féminin qui, en sanscrit et en zend, est semblable au thème (§ 187); ici encore il convient de comparer ce qui a 'été dit du participe présent (§ îûa)1.
donc devenu mais; de même au nominatif-accusatif pluriel. Le datif singulier des thèmes finissant par une consonne est toujours dénué de flexion, ce qui nous donne encore mais; enfin l’accusatif est sans flexion, quelle que soit la lettre finale du thème.
1 J’ai expliqué pour la première fois cette formation du féminin gothique en ein dans les Annales de critique scientifique (1837, p. 743 et stiiv.). Jacob Grimm s’est rangé à cette explication (Grammaire allemande, t. III, p. 65o), après avoir d’abord présenté cette particularité de la langue gothique comme un fait dont la cause était inconnue (ibidem, 1.1, p. 756, et III, p. 566).

198
ADJECTIFS.

Le vieux haut-aliemand a ramené ses comparatifs féminins à
an type plus usité. En regard du gothiqu eminnisei s plus petite», il présente la forme munira et non minnirî. On voit aussi par cet exemple qu’il change la sifflante gothique en r; il en résulte que minniro, tninniva ressemble plus, sous un rapport, au latin nu-nor qu’au gothique minnisa, minnisei. Ce changement a lieu, en vieux haut-allemand, pour les comparatifs, dès la période la plus ancienne.

S 3o3. Comparatifs gothiques en os, os-an.
Outre la forme is, is-an, le suffixe comparatif, en gothique, présente aussi la forme ôs, ôs-an. Cette forme, qui est la plus rare en gothique, a si bien pris le dessus en vieux haut-allemand qu’il y a dans cette langue plus de comparatifs en ôro, ora qu’en iro, ira ou ëro, ëra. Le petit nombre de formes en ôsan dont il nous reste des exemples en gothique sont : smnthôsan «fortior», frôdâsan «prudentior», frumôsan «prior», hhsôsan «hilarior», garaihtôsan «justior», framaldrôsan «provectior ætate » , usdaudôsan r sollicitior », unsvikunthôsan «inclarior». Ajoutez-y les adverbes sniumundôs sernouSixtoTépwsh et aljaleikôs «êrépas». Comment expliquer les formes en question? Je crois que l’d de ôs représente l’n217 du thème fort sanscrit tyaks ou yans (SS 299 et 3oo). Si l’on prend pour point de départ la forme y ans, il faut admettre quelle a perdu : i° la nasale, qui manque aussi en latija et aux cas faibles en sanscrit; q° le y (=/) dans les formes en ôs, ôsan, l’« dans les formes en is, isan (apres la perte de Yâ, la semi-voyelle j ne pouvait manquer de se vocaliser en t).
Les formes gothiques ôs, ôs, et plus encore le vieux haut-allemand ôr, répondent exactement à la forme latine ôr dans
DEGRES DE COMPARAISON. $ 30A.

199

tninor, minôr-is, pour minior, miniôris. Il y a des raisons de croire qu’en gothique le j et lo ont primitivement existé l’un à côté de l’autre, que, par exemple, pour minnisa «plus petit» on a dit d’abord minnjôsa, pour frôdôsa «plus intelligent» frôdjôsa. Les formes qui ont perdu le j sont représentées en latin par minor, minus, plus-, les formes qui ont supprimé l’d sont représentées par mag-is.
Si le gothique a des comparatifs en âs, ôs-an, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’il doive avoir des superlatifs en ôsta, nominatif ôst’-s. Nous voyons, en effet, que ce degré de comparaison est toujours exprimé en sanscrit, en zend, en grec et en latin, par une forme qui dérive du comparatif contracté is, is. On ne sera donc pas étonné de trouver en regard defrumôsa « prior » un superlatif frumists «primum», et non frumôsts. Pour les autres comparatifs en osa, les exemples de superlatifs manquent. Néanmoins, dans les dialectes plus récents, les comparatifs en ô se sont créé des superlatifs à leur image. En vieux haut-allemand, nous avons ordinairement ôst au superlatif, là où le comparatif a ôr. Le gothique lui-même nous fournit déjà deux exemples de cette déviation de l’usage : lasivôsts «infirmissimus» et armâsts « miserrimus ».
S 3o4. Jonction des suffixes du comparatif et du superlatif au thème positif, en gothique.
Les langues germaniques sont d’accord avec les idiomes congénères en ce quelles rejettent la voyelle finale du thème positif devant les suffixes de gradation; exemples : sut’-isa, venant de sutu1 «doux»; liard’-isa, venant de hardu «dur»; seith’-s \diana-seiths «amphus»), venant de seithu «tardif». Comparez le grec venant de rjSiî, et le sanscrit svddîyàn, venant
1 II n’y a pas d’exemple du positif; mais ie sanscrit tvâdû-s et le grec ÿS-j-s autorisent à croire que la voyelle finale du thème était un u. '

200

de svâdii On supprime aussi ja; exemples : spêd’-isa, venant de spêdja « tardif»; reik’-isa, venant de reikja «riche». Il ne faut donc pas regarder l’o des formes telles que frôdôsa comme étant un allongement de la de frôda (§ 69); un tel allongement serait tout à fait contraire au principe de ces formations
(S3o3).
S 3o5, 1. Comparatif masculin et neutre, en ancien slave.
En ancien slave, le suffixe comparatif sanscrit îyas (masculin-neutre) s’est contracté en ’biiui êjs ou lui ïs. Toutefois, les trois cas semblables du singulier neutre ont conservé l’a de fy^îyas sous la forme d’un e (par euphonie pour 0), tandis qu’ils ont renoncé, en vertu de la loi exposée au § 92 m, à la sifflante finale du suffixe. La même sifflante a dû tomber aussi, en vertu de la même loi phonique, au nominatif-accusatif-vocatif masculin. Exemples : Aoeptii dobrêj «melior, meliorem», AOEptK dobrêje «melius». La formation en tiu ïs présente au nominatif-accusatif-vocatif masculin t«ü ij, au neutre je; exemples : bolje «majus»218 219, bolij «major, majorem». Pour comprendre ces formes, il faut remonter au suffixe sanscrit îyas (forme forte îyàhs), dont l’î est représenté par i’i slave, et la semi-voyelle ^ y par fi j. En faisant abstraction de la lettre n, qui se trouve dans les cas forts en sanscrit, on peut donc comparer bolij, en tant que nominatif, avec le sanscrit bdlîyân, en tant qu’accusatif avec baUyânsam et en tant que vocatif avec bdlîynn. Si Ton part, en slave, du nominatif bolij, on considérera le lui ïs (pour isj) des cas obliques comme une contraction de ufiui ijs (pour ijsj), d’autant plus que, dans les formes comme AOBpufi dobrêj, le fi j est conservé à tous les cas obliques du masculin et du neutre, ainsi qu’au féminin
DEGRÉS DE COMPARAISON. S 305, 1.

201

AOEP'SÜwh dobrêjsi. Mais le suffixe qui se termine en sanscrit par un s s’élargit en ancien slave, aux cas obliques du masculin et du neutre, par l’addition d’un nouveau suffixe jo (par euphonie je\ dont le j se supprime, en vertu de la règle exposée au § g a l, à cause de la sifflante qui précède. On a donc au génitif et au datif masculin-neutre dobrêjsa, dobrêjéu, au lieu de do-brêjsja, dobrêjsju1, qu’on aurait pu s’attendre à trouver d’après * l’analogie de konja «equi», konju aequo», venant du thème konjo. Dans les comparatifs en question et dans les participes présents et passés qui sont fléchis d’une façon analogue, on ne s’aperçoit donc de la présence du suffixe jo qu’aux seuls cas où, la voyelle de la syllabe jo ayant été supprimée, la semi-voyelle devient iou ï2, et à ceux où le;', avant de disparaître, a changé l’o qui suivait en e3.
Le nominatif pluriel masculin dobrêjs-e mérite une mention spéciale. Si Miklosich a raison, comme je le crois, de diviser le mot de cette façon, et s’il faut diviser de la même manière les participes précités tels que chvalahst-e, chvaiivûs-e, on devra at- » tribuer ces formes à la déclinaison à consonne; en conséquence, la flexion casuelle e répondra à la désinence sanscrite as dans les formes comme svâdîyâhs-as, et à la désinence grecque es dans les formes comme vSi'ov-ss. C’est pour cela que dobrêjs-e et les formes participiales analogues ne sont pas en accord avec koni
1 Ui j est mis pour s, probablement à cause de l’influence rétroactive dui qui se trouvait anciennement dans le mot. Il n’est pas rare toutefois de rencontrer en slave un 111 é à la place d’un rp s sanscrit, sans qu’aucune loi phonique particulière ait déterminé ce changement (S ga h).
2 Voyez Sga !. On peut comparer, par exemple, le locatif singulier dobrêjsi avec koni vin equor (sans désinence casuelle), venant du thème konjo; le locatif pluriel dobrêjsi-ehü avec koni-chü, et le génitif pluriel dobrèjiï avec koni requorumr. Cetle dernière forme est sans désinence casuelle, contrairement a ce qui se passe pour vlük-ü nluporumn (S a^Ô).
8 On peut comparer, par exemple, l'instrumental singulier dobrèjée-mï avec konje-mï, l'instrumental duel dobrcjée-ma avec konje-ma.
ADJECTIFS.

202

«equi», ni avec les formes adjectives telles que dobli1 « fortes» (thème doblyo).
Dans le plus grand nombre des formes comparatives, un -a ê prend la place de 1 ï de bolÿ, par exemple dans AOEpt.ü dobrêj, génitif dobrêjsa (du thème positif dobro); ce 1. ê représente peut-être, ainsi que le suppose Schleicher2, le gouna de l’î du suffixe sanscrit îyâhs, forme faible îyas : c’est cette voyelle î qui, sans gouna, est représentée simplement par Yi de bol’-ij. Si l’on n’admet pas cette hypothèse, il faudrait voir dans t, ê la contraction de IV du comparatif avec la voyelle finale du thème positif dobro; cette contraction devrait remonter à une époque où l’o était encore un a, comme dans les langues lettes et en gothique. Rappelons, à ce sujet, qu’en lithuanien le suffixe comparatif semble aussi commencer par un ê; mais dans les formes comme gerêsnis « melior », cet S provient de la contraction de l a du thème positif (géra) avec l’i du suffixe comparatif; et dans les formes comme grazêsnis « pulchrior », l’ë peut s expliquer par la contraction de ia avec i. On sait, en effet, que les thèmes adjectifs en u tirent plusieurs de leurs cas de thèmes inorganiques en ia; de même donc qu’on a au locatif grazia-mè, on peut supposer une forme de comparatif grazia-isnis qui aura donné grazêsnis.
§ 3o5, a. Comparatif féminin, en ancien slave. — Déclinaison déterminée
du comparatif.
Au nominatif singulier féminin, il y a complet accord entre les comparatifs en si de l’ancien slave et les comparatifs sanscrits
1 Je m’éloigne de l’opinion de Miklosich en plaçant l’s du côté du thème; j’admets que ta désinence casuelle a été supprimée et que la syllabe finale du thème a opéré la contraction de jo en i. C’est la même chose qui a lieu au locatif singulier , et au nominatif-accusatif-vocatif du duel neutre, où Miklosich aussi met l’t du côté du thème.
8 Théorie des formes du slave ecclésiastique, p. i84.
DEGRÉS DE COMPARAISON. § 305,


203
2.
en sî; il n’y a de différence que pour la quantité de la voyelle, qui a été abrégée en slave. Le iju s correspond à la lettre sanscrite K s (S 9s1); on peut comparer la deuxième personne du singulier du présent, car il existe à peu près le même rapport entre ves-e-si «tu transportes» et le sanscrit vdh-a-si qu’entre eoaliuh bolïsi «plus grande», AOKp’fcüuiH dobrejsi «meilleure» et les formes sanscrites telles que srê'-yas-î «meilleure», trya-yas-î «plus vieille» (§ 3oo). Quant au thème, auquel est venue s’ajouter la caractéristique féminine, il finit dans l’une et l’autre langue par une sifflante; et l’on ne peut dire que 1 i, dans les nominatifs slaves en question, soit la contraction de la syllabe ja, comme, par exemple, a 1 accusatif bolïsun (pour bolïsjuh), car les thèmes féminins en m ja conservent cette syllabe au nominatif1.
Dans la déclinaison déterminée, on a, en ajoutant a bolïsi, dobrêjsi l’article comme suffixe, les formes bolïsi-ja, dobrêjéi-ja, et à l’accusatif, en ajoutant l’article à bolïsun, dobrêjsuh, on a bolïsuh-juh, dobrêjsuii-juh (§984). Au nominatif-accusatif-vocatif singulier masculin, bolij, dobrêjdeviennent eoahh, aoep'ëmh. Nous ne chercherons pas si le dernier h doit être prononcé i ou ji (§ 92k): dans le dernier cas, le j de boliji, dobrêiji appartiendrait au nominatif indéterminé, de sorte qu’il faudrait diviser bolij-i, dobrêij-i, et que l’article ajouté comme suffixe serait représenté par i, et non comme d’habitude par fi j (§ 284); dans le premier cas, l’avant-dernier H de eoahh, AOEpuHH (= boli-i, dobrêi-i) serait la vocalisation du fi j de bolïj, dobrêîj, le u ï précédent serait supprimé et le pronom suffixe serait représenté également par i, au lieu de l’être par j.
1 Comme en sanscrit, où ndvyâ «nova» est à ia fois le thème et le nominatif singulier du féminin. Il y a seulement cette différence qu’en slave le j est supprimé après une sifflante (S 92 ‘ ), en sorte que le thème féminin bolïija, duquel se forment les cas obliques, devrait faire au nominatif singulier boliêa, d’après 1 analogie de dusa «anima», pour duêja, en lithuanien düiià.

204

Le neutre déterminé eoaic bolje «majus» et les formes analogues ajoutent K (= sanscrit a la forme indétermi
née : on a, par conséquent, EOAitie bolje-je «le plus grand»; au contraire, AOEp’fiie dubrêje et ses analogues, pour former leur nominatif-accusatif-vocatif déterminé, se servent du thème en êjo (par euphonie êje) des cas obliques; exemple : AOEpuüuiïie clobrêjseje «le meilleur».
§ 3o5, 3. Le superlatif dans les langues slaves.
Dans les langues slaves, le suffixe comparatif sert en même temps comme expression de la gradation la plus élevée; toutefois, les dialectes les plus récents, notamment le slovène, le serbe, le bohème et le polonais, font alors précéder le comparatif de la particule Ndii naj (polonais nay). On trouve même en ancien slave des tours de cette sorte, par exemple : nam rnme naj face1 « potissimum », Hdü CKopnc naj skorêe « citissime » 2. Il est probable que naj est lui-même le comparatif de la préposition na «au-dessus»3; naj serait alors une forme mutilée pour naje, qui lui-même serait un accusatif neutre adverbial. Sans l’hypothèse d’une apocope, naj ne pourrait être, en tant que forme comparative, qu’un nominatif-accusatif masculin, ce qui conviendrait peu pour un adverbe.
S 3o6. Le comparatif en lithuanien et en borussien.
En lithuanien, le suffixe comparatif est, au masculin, êsnia (nominatif ësnis) et, au féminin, ésne4. Nous avons donc ici un
1 On a e au lieu de je, à cause du H c qui précède. Celui-ci tient lui-même la place d’un le; ce fc s’est changé en palatale sous l’influence du ; qui suivait.
5 Kopilar, Glagolita, p. vin.
3 Compares Miklosich, Radicet lingwe slovenicæ veteris dialecli, p. 56 et 73, et Schleicher, Théorie des formes du slave ecclésiastique, p. 180.
4 Au féminin, le nominatif est semblable au thème; sur êtne, venant de ésma, voyez S 9s*.
DEGRÉS DE COMPARAISON. S 307*.

205

complément inorganique ia, e, comme nous avions en slave jo, ja; quant à sn, c’est une transposition pour le groupe ns, que nous trouvons aux cas forts en sanscrit, par exemple dans gd-rwâimni «graviorem»1. J’ai cru autrefois reconnaître dans le du suffixe êsnia la du sanscrit îyâhs ou yâns220 221. Mais je ne connaissais pas encore le suffixe comparatif aisi, en borussien, dont l’a appartient au thème positif, de sorte qu’il reste pour le suffixe de gradation isi (forme élargie de is). Nous citerons, comme exemples, malda-isi-n «jùniorem», malda-isei «juniores», ura-isi-n «seniorem», ura-isi-ns «seniores» (accusatif), venant des thèmes positifs malda, ura222 223 224. L’ê lithuanien, ainsi que le t ê des comparatifs tels que dobrêj, en ancien slave (§ 3o5, 1), sont de même origine que la diphthongue ai du suffixe borussien aisi.
Au comparatif adverbial, le suffixe borussien se termine en is, ou, avec suppression de Yi, simplement en s; on a de la sorte massais (massa-is) «moins» qui répond aux formes gothiques comme ma-is «plus» (en latin mag-is), et toûl-s «plus» (pour toûla-is, du thème toûla) qui répond par son suffixe au gothique vair^s «pis».
S 307’. Le superlatif en lithuanien. — Comparatifs et superlatifs adverbiaux, en lithuanien, en borussien et en gothique.
En lithuanien, le suffixe superlatif est seulement une autre forme du suffixe comparatif. La nasale, au lieu d'être transposée (§ 3o6), est restée à son ancienne place; mais elle s’est vocalisée en « (S i 8 ). Conformément au principe que nous avons déjà vu (S 298"), la voyelle finale des thèmes primitifs est sup-
i


206 ADJECTIFS.
primée, et l’t (= sanscrit ^ y, grec /, iatin i), au lieu de se combiner avec l’a du thème positif comme dans les formes en êsnia, reste invariable. On ajoute, comme au comparatif, la syllabe inorganique ia, qui ne subit aucun changement ; exemple : ger-iaésia-s «optimus», ger’-iaûsia «optima»225, génitif geriaûsiô, geriaüsiô-s.
Gomme adverbes, ces formes ont conservé la signification comparative, et se terminent en s, sans prendre le complément inorganique ta', exemples : lab-iaus «très», ger-iaus «mieux», des thèmes positifs làba «bon», géra (même sens). Il est probable que ces formes sont en réalité des accusatifs neutres du thème primitif en s, c’est-à-dire du theme non élargi, et qu elles doivent, par conséquent, être rapprochées des comparatifs adverbiaux comme Bu-yas « plus », srê'-yas « mieux » en sanscrit, et comme pl-us, tiun-us (pour pl-ius, min-ius) en latin. Il faut aussi, je crois, considérer comme des accusatifs neutres les comparatifs adverbiaux tels que mais, liauhis (§ 3oi) en gothique, et tels que massais «moins», toûl-s «plus» en borussien2. Quant aux superlatifs adverbiaux lithuaniens en et, tels que lab’-iaûsei «le mieux», je les regarde comme des datifs féminins, avec contraction et changement de l’a en e (§ 92 k); lab-iausd est donc pour lab’-iausiai.
S 307b. Le comparatif en arménien.
Il nous reste à voir les degrés de comparaison en arménien. Les comparatifs ont leur nominatif singulier en nyb gain, ce
DE COMPARAISON. S 307


207
DEGRÉS
qui rappelle les nominatifs comme svadîyân en sanscrit, et comme r/Stuv en grec1. On pourrait admettre que dans ces formations le q- g est un durcissement de la semi-voyelle sanscrite \ y —]■
11 est vrai qu’il n’y a pas d’exemple de ce changement en arménien; mais il n’est pas rare dans d’autres langues, notamment en slave, où nous avons les génitifs pronominaux en go = sanscrit sya (S n6(j). Le thème du suffixe précité est -7-'-'—gunh -e là l’instrumental singulier guni-v, le datif-ablatif-génitif pluriel guni-z. On ne doit donc pas confondre l’t du nominatif singulier (guin) avec T» du grec <«v, lequel a déjà son représentant dans le g arménien : cet i provient plutôt du penchant qu’ont les liquides finales à se faire précéder de cette voyelle; c’est ainsi que nous avons un 1 dans hair «père», mair amère», oir «homme» (S 226). Quant à l’i final du thème guni, j’y verrais le complément inorganique dont se sert habituellement l’arménien pour faire passer dans la déclinaison à voyelle les thèmes primitivement terminés par une consonne *. ■
On peut toutefois objecter contre l’explication qui fait de guin, guni un suffixe comparatif, que les mots ainsi formés ont l’apparence de mots composés, car ils prennent la voyelle a qui sert à indiquer la composition226 227 228. C’est ainsi que nous avonsVamstoi229 «sapiens», qui fait au comparatif imastnaguin (imastn-a-gmn) ; basum «beaucoup»230, qui fait au comparatif basm-a-guin. On peut rapprocher les nombreux composés qui commencent par bam-a, tels que basm-a-kin «ayant beaucoup de femmes»,

208

bam-a-ganl «ayant beaucoup de richesses», basm-a-bcr «ayant beaucoup de productions, fécond». Si l’on veut donc regarder comme des composés les comparatifs en guin, guni, il faudra admettre que le second membre est guin «couleur». Il est vrai que le thème de guin « couleur » est guno et non guni; mais il y a des exemples de mots composés qui se terminent en i, quoique le dernier membre, construit isolément, n’ait pas un i pour lettre finale. Nous avons, par exemple, à côté du simple gin «prix», dont le thème contracté est gno et l’instrumental gno-w, le composé melagin «précieux», dont le thème est melagni, et l’instrumental melagni-v.
On demandera, sans doute, comment un mot qui signifie «couleur» est employé pour marquer la relation du comparatif. Mais ce substantif a pu avoir à l’origine d’autres significations qu’il a perdues comme mot simple. En persan, gûn possède, outre le sens de «couleur», celui de «genre, espèce»; le sanscrit gund, qui est de même origine, signifie principalement «bonne qualité, vertu, excellence», et son dérivé gunitd veut dire «assemblé, amoncelé» et, en arithmétique, «multiplié»1. Combiné avec des noms de nombre, gund correspond au latin -plex, à l’allemand -fach; exemple : dviguna «double», triguna «triple»; il est employé aussi de cette façon comme forme périphrastique du comparatif, là où l’on détermine exactement en chiffres la mesure de la supériorité. Le composé ayant le mot guna pour dernier membre est alors construit avec l’ablatif comme un comparatif ordinaire; exemple : indrâc catagunaK sâuryê2 «cent fois plus valeureux qu’Indra», littéralement «[a partir] d’Indra centuple en valeur». Comme terme de grammaire, gund marque la gradation de la voyelle, et l’on pourrait dire qu’en général le mot gund exprime la gradation d’une
1 Voyez le Dictionnaire de Wilson. a MaMbhàrata, I, vers i A/19.
NOMBRES CARDINAUX. S 308. 209.

209.

qualité. Si nous appliquons à l'arménien ce qui vient d’être dit, et si nous considérons melaguin «plus grand», lavaguin «meilleur» comme des composés possessifs, nous pouvons traduire ainsi : «possédant un degré supérieur de grandeur, de bonté; grand, bon à un haut degré; parfaitement grand, parfaitement bon». Ainsi compris, les comparatifs arméniens seraient devrais composés, ayant légitimement l’a qui sert à marquer la composition.
Il n’y a pas de véritable superlatif en arménien ; ce n’est pas le lieu de traiter ici des formes périphrastiques qui le remplacent231; •
NOMS DE NOMBRE.
NOMBRES CARDINAUX.
S 3o8. Le nombre «un».
Pour l’expression du nombre «un», il règne une grande diversité parmi les langues indo-européennes : cette diversité provient de ce que le nombre «un» est marqué par des pronoms de la troisième personne; la multiplicité des termes employés tient à l’abondance de ces pronoms.
Le sanscrit é'ka, dont le comparatif êkatard-s se retrouve dans le grec êxarepos, est, selon moi, la combinaison du thème démonstratif ê avec le thème ka. Il est vrai que ce dernier thème pronominal a ordinairement le sens interrogatif : mais ka se dépouille quelquefois de cette signification; ainsi il veut dire «aliquis» quand il est construit avec l’adverbe dpi «aussi»; même sans cet adverbe, il signifie encore «aliquis» quand il est précédé d’une expression interrogative; exemple :

210

lai 'tah sa puruéah pârta kah gatayati hanti kam 1 « quomodo illc vir, ô Pârtha, aliquem occidi sinit, occidit
Le zend i»»w» aiva se rattache aux adverbes pronominaux sanscrits êvd, êvdm « ainsi », dont le dernier est un accusatif, et le premier, selon toute vraisemblance, un instrumental formé d’après le principe de la langue zende (§ i58).
Le gothique et le borussien airi-s, thème ama (allemand moderne einer'j se rattachent au pronom défectif sanscrit êna (§2), dont nous avons entre autres l’accusatif masculin êna-m «ilium».
Il faut probablement rapporter aussi au même thème pronominal l’ancien latin oinos, d’où l’on peut faire venir la forme plus moderne ûnus, par le changement ordinaire de l’ancien ô en u, avec allongement destiné à compenser la suppression de li. 11 y a toutefois une ressemblance étonnante entre le latin ums et le sanscrit ûnd-s, lequel signifie proprement «moindre» et est placé devant certains nombres pour indiquer qu’ils sont diminués d’une unité; exemples : ûnavinsati « undeviginti », unatrih-sat «undetriginta». Conservé de la façon la plus parfaite, cet ûnd-s n’aurait pu donner en latin que ûnu-s, ou plus anciennement ûno-s. '
Le grec èv se rattache probablement aussi au thème démonstratif Tt«l êna; il a perdu la voyelle finale, comme le thème gothique et borussien aina au nominatif masculin ains. En ce qui concerne l’esprit rude et la voyelle e pour H ê =* ai, comparez êxthepos234. Au contraire, olos «unicus», s’il est sorti de oîvos
NOMBRES CARDINAUX. S 308.

211

(comparez oinos), comme iâsi%co de fistlova., a mieux conservé la diphthongue indienne et a sauvé aussi la voyelle finale de TpT êna.
Si &vos, qui désigne le nombre «un» sur les dés, a été, en effet, un nom de nombre dès l’origine, on peut le ramener au thème démonstratif and, slave ono (nominatif masculin onü «celui-là»), ou bien il faut admettre que ovo a perdu un t, à la différence du féminin oïvri « une », où l’t s’est conservé.
L’ancien slave kahhzjedinü «un» (thème jedino) est probablement de même famille que le sanscrit âdl «le premier», et se rapporte peut-être à la forme élargie âdimâ, avec n pour m; peut-être aussi le suffixe no a-t-il été ajouté à une époque où le slave avait déjà une existence indépendante. Au commencement des composés, on trouve également hho ïno comme expression du nombre « un » ; exemple : ino-rogü « fiovéxepas ». Employé seul, ino (nominatif inü, ina, moi) signifie «abus»; il vient du sanscrit anyâ (même sens)1.
Le lithuanien menas et le lette weens (wên’s) s’accorderaient avec le thème gothique et borussien aina, si la semi-voyelle initiale était, comme je croyais pouvoir l’admettre autrefois, une prosthèse purement phonétique. Mais comme on ne trouve pas d’autre exemple, dans les dialectes en question, dune prosthese de ce genre devant une voyelle initiale primitive, et comme le w et le m permutent volontiers entre eux2, je suis tenté de voir
diphthongue, c’est-à-dire t’a. Mais si cette hypothèse n’était pas fondée, il faudrait rapporter èv au thème démonstratif U-T ana. En ce <pii concerne 1 esprit rude, on peut comparer épais, qui correspond au védique usiné'« nous» et à l’éolien iififies.
1 G’est le thème auquel se rapportent le grec i)Xo-e (S 19) et, très-probablement aussi, évioi = sanscrit amjn -alii n. Du thème êvto, on a l’adverbe ivio-te, dorien èviom.
2 Voyez S 20 et Système comparatif d’accentuation, remarque ai. C’est ainsi que le lithuanien œidus «milieu» est évidemment de même famille que le thème sanscrit mâdya, gothique midja, latin mediô, et que le sanscrit mydm «nous» est très-pro-bnblcmert une altération pour mayam.
2l-2 NOMS DE NOMBRE.


dans ivéna-s, ween’s des formes altérées pour mêna-s, meens, signifiant proprement «petit» ou «peu». Nous serions ramenés de la sorte à une famille de mots très-répandue : en sanscrit, manâk (adverbe) signifie «peu»; on en peut rapprocher le latin minor, le gothique minnisa «minor», minnist’-s «miniums», le slave aunhh mïmj «minor», l’irlandais min, mion «petit», etc.h A l’explication que nous proposons, on pourrait objecter que l’adjectif lithuanien menka-s «mauvais, petit», et l’adverbe men-kay «mal, peu», qui appartiennent à la même famille de mots, ont conservé leur m; mais nous avons de même en sanscrit le ni du thème pronominal ma qui coexiste a coté du v de vayam.
En arménien, tfkfy mêk (thème mêka) et min (instrumental mno-w, pour mino-w), qui signifient l’un et 1 autre « un », peuvent être également rattachés à l’adverbe sanscrit manâk «peu», à côté duquel il y avait peut-être un thème adjectif manâka; le thème mêka aurait perdu la syllabe du milieu, le thème mno (venant de mina) la syllabe finale du manâka en question. De mino pourrait être dérivé, par la suppression de n, le thème mio, nominatif mi, instrumental mio-w-. Mais la forme la plus mutilée, c’est Jhl. mu, si, comme il est probable, elle appartient au même thème et représente la syllabe initiale du sanscrit manâk, avec l’affaiblissement habituel de l’a en u (§ i83b, 1).
Si le grec ftéa, qui pourrait faire supposer un thème masculin pio, est parent avec le thème arménien mio, il faudrait admettre que le grec et l’arménien, qui n’ont entre eux aucune affinité spéciale, ont'perdu l’un et l’autre le n qui se trouvait devant la seconde voyelle. Mais si \ua est d’origine pronominale, j’aimerais mieux, pour l’expliquer, recourir au thème féminin sanscrit smî235 236 237. Il faut ajouter, pour terminer, que le grec fxâvo-s
NOMBRES CARDINAUX. S 308.

213

appartient aussi à la famille des mots signifiant primitivement t«peu» et qu’il peut, par conséquent, être placé à côté de l’arménien min (thème mino, mno) «un».
Remarque. — Composés germaniques renfermant le nom de nombre !rUn».— Termes signifiant «demi, entier». — Les langues germaniques présentent quelques expressions dignes d’attention où le nom de nombre itun» se trouve renfermé, mais d’une façon si peu apparente qu’on en distingue à peine la forme et le sens. Ce sont, en gothique, haihs « borgne», r hanfs «manchot», halts «paralytique» et halbs «demi». Dans tous ces mots, le nombre «un» est exprimé par ha : je reconnais dans cette syllabe ha le ka du sanscrit ê'ka «un»1. On ferait fausse route si l’on pensait au ha du zend ha-kërëd «une fois» (sanscrit salcrt); en effet, le h zend
répond toujours à un s sanscrit, lequel n’est jamais représenté en gothique par un A2. J. Grimm compare haihs avec cœcus3, sans toutefois approfondir l’origine de ces deux termes congénères. L’un et l’autre renferment le mot «œil» : le sens primitif paraît avoir été «borgne». Le thème de haihs est haiha; que l’on décompose ce mot en ha-iha ou en h-aïha, le dernier membre du composé correspond au sanscrit akèa «œil»4. En effet, si l’on divise h-aiha, la diphthongue s’explique par l’influence euphonique de A (S 8a);
comme mot indépendant, il est sorti de l’usage. Sur le masculin-neutre sma, comme pronom annexe, voyez S i65 et suiv. Sur sma, employé comme mot indépendant, dans le sens démonstratif, voyez 8 54o. Sur fa désinence grecque ia — sanscrit », voyez S î ig, — Je ne saurais entrer ici dans la discussion de l’hypothèse de Léo Meyer, qui suppose que sïs, fila, £v sont dérivés tous les trois du sanscrit samd «semblable» (Journal de Kuhn, t. V, p. i6A). Je me contenterai de rappeler que le sanscrit samàrs est régulièrement représenté en grec par éftd-s; au féminin samScorrespond le grec <5ftrj, dorien opta. '
1 Sur le h substitué au k, en vertu de la loi générale qui préside à la substitution des consonnes dans les langues germaniques, voyez 887,1.
3 On pourrait, au contraire, reconnaître le thème pronominal sa dans l’â du grec i-nXovs.
3 Grammaire allemande, 1.11, p. 316.
* Du groupe ki, le gothique n’a conservé que la première lettre, au lieu que le zend aii «œil» (par exemple dans Ksvas-aélm «ayant six yeux») a gardé seulement la seconde. Le latin ocus (le primitif de oculus) a, au contraire, conservé là première lettre, comme le gothique.
NOMS DE NOMBRE.


uihu sera pour iha, lequel est lui-même pour aha. Si, au contraire, on divise ha-iha, ce que je préfère, on comprend sans peine que l’t, quoique suivi d’un h, «ait Pas éié changé en diphlbongue, puisque l’a du premier membre, en se combinant avec lui, donnait déjà un ai. Rappelons encore le latin codes, où l’idée de l’unité ne peut être représentée que par le c, car l’o appartient à oclcs, qui est une dérivation de oculus. Quant à cœcus, s’il renferme en effet le nombre «un» et si l’on a raison d’écrire ce mot par un ai, il faut le diviser ainsi : caricus. L’a du sanscrit aksa serait affaibli en i, comme il arrive habituellement pour l’a du thème dans les composés
latins (§ 6). . ^
y Nous passons à hanfs (thème hanjii) «manchot», ou le second membre du composé n’est pas facile à reconnaître. Je soupçonne que nfa a supprimé une voyelle après le n, comme il arrive souvent en composition ou après une syllabe réduplicative; comparez, par exemple, le sanscrit gagmimà mous allâmes», où la racinegam est restée sous la formegm, et le grec ■aMu pour ■unwéTW, où correspond au sanscrit pat « tomber». Si la voyelle supprimée dans ha-nfa est un i, on pouvait regarder nifa comme une métathèse pour le sanscrit paui «main»
, Dans ha-lts (thème ka-lta) «paralytique», ha est encore le nom de nombre; quant au seeond membre du composé, je soupçonne qu’il signifie «pied», en sorte que le sens primitif du mot serait «ayant un pied». Nous voyons, en effet, que halts est opposé (Marc, IX, 65) à tvansfôtuns haban-din «ayant deux pieds» : c’est le passage où il est dit qu’il vaut mieux entrer dans la vie avec un pied que d’être jeté avec deux pieds dans l’enfer. 11 est du moins certain qu’une langue ayant un mot dont le sens serait «unum pedem habens», l’emploierait très à propos en cet endroit. Si le dernier élément de ha-lta signifie «pied», nous rappellerons qu’en sanscrit plusieurs dénominations^ pied sont dérivées de racines signifiant «aller». Or, il y a en gothique Une racine lith «aller» qui a donné lithus «membre», et qui pourrait bien aussi avoir formé le second terme de ka-lta, pour hxi-litha .
Avant de passer à l’analyse de Mb «demi», je rappellerai l’explication très-juste, selon moi, que J. Grimm a donnée du pronom allemand sclber «jnêtne»; il le divise en deux parties et reconnaît dans la syllabe si du go' Le/substitué au p, d’après S 87, 1.
* H est vrai que dans halta nous avons un t et non un t/i. Mais en composition, les consonnes de même organe se substituent quelquefois l’une à l’autre; nous avons, par exemple, quadraginta à côté de quatuor.
NOMBRES CARDINAUX. S 308.

215

thique silba le pronom réfléchi (comparez sei-na, si-s] si-k). Quant à la seconde partie, il se réfère à un verbe leiban «rester» et suppose que silba signifie «ce qui reste en soi». Nous pouvons de même diviser halba en deux éléments : le premier veut dire «un» et le second «partie, reste» (eu gothique laiba veut dire «reste»). Le composé halba devra être entendu comme les composés possessifs sanscrits, et comme le mot précité haihs, c’est-à-dire en suppléant le mot «ayant» ; il signifiera donc «comprenant une partie».
il est à peine nécessaire de faire observer que l’idée de «demi» n’est pas une conception primitive et simple, et qu’on ne doit pas s’attendre à trouver un mot simple expressément créé pour la représenter. C’est par la notion de «partie» que le langage est arrivé à exprimer celle de «moitié». Le latin dimidius se rapporte à l’idée du milieu à travers lequel s’est fait le partage. Le zend exprime «demi» par «s»"! naima, auquel correspond le sanscrit nê'ma «partie»; je vois dans ce mot la contraction régulière de na «non» et de imà «ceci» ou «cela», de sorte que nêma désigne la partie d’un tout par l’exclusion de l’autre partie. •
Nous avons encore en sanscrit le mot srrfxT sdmi, dans lequel on reconnaît aussitôt iè vieux haut-allemand sdmi, le latin sdmi et le grec rj(u ; les quatre langues emploient ce mot toujours dénué de flexion et au commencement d’un composé. On peut considérer sdmi comme venant de samd «égal, pareil», avec le suffixe dérivatif i dont la présence a occasionné la suppression de la voyelle finale et l’élargissement du premier a. Si cette explication est fondée, sdmi désigne proprement une partie d’un tout égale à la partie qui manque. On voit que v(ii ne vient pas de rffuavs, mais bien que ijjucrvs est un dérivé de flfu; je reconnais dans <ru le possessif sanscrit «suus». C’est un fait curieux, qu’en zend ce même possessif s’unit, avec le sens de «partie», à des noms de nombre; exemples : tri-sva «tiers», cairu-êva «quart» ; accusatif ; tri-sâ-m, catru-sûm
(S 4a); ces mots rappellent de près le ervv de yfuiaw. fifu-ovs signifie donc «ayant une partie égale», et le simple marque seulement l’égalité.
Mentionnons encore le sanscrit sa-kala-s «entier», littéralement «ayant ses parties», qui fait pendant au gothique halbs, dont il est à la fois l’antithèse et le commentaire. Le mot sakalase compose évidemment de sa «avec» et de kald «partie»; si nous supposons donc que ce dernier membre du
composé est pris dans le sens du duel (et le dernier terme d’un composé peut exprimer chacun des trois nombres), sakala désignera l’objet dans lequel les deux parties sont réunies. De même tlUïJ sam-agra désigne «ce

216
NOMS DE NOMBRE.
qui est plein», et, en particulier, «la pleine lune»; le sens propre du mot est «qui a les pointes ensemble (dont les pointes se touchent)».

S 309. Le nom de nombre «deux».
En sanscrit, le thème déclinable est dva : naturellement les flexions sont celles du duel. De dva, le gothique fait tva (S 87), et n’ayant pas la déclinaison duelle, il le fléchit comme un pluriel, mais à la façon des pronoms; nominatif : tvai, tvâs, tva; datif : tvaim; accusatif : tvans, tvôs, tva}. Le sanscrit ne fait pas au duel de différence entre la déclinaison pronominale et la déclinaison ordinaire : dvâu se fléchit donc comme asvâu, dvê (féminin) comme dsvê, et dvê (neutre) comme ddnê (§ 255). En zend, le nominatif-accusatif-vocatif masculin est dva (pour dvâ, S 208). En ancien slave, le masculin est également dva, tandis que le féminin-neutre est AK’B dvê comme en sanscrit (§ 92e)- Le nominatif-accusatif-vocatif neutre, en zend, est 238
NOMBRES CARDINAUX. § 309.

217

àiyè, avec un y euphonique (§ A3) et avec vocalisation du v en m. Dans le grec Sveo, Suo, dans le latin duo, l’ancien v est également vocalisé, mais la voyelle finale du thème est conservée.
Le grec ne distingue plus les genres : à cet égard, il est inférieur au latin et aux autres langues de l’Europe. En lithuanien, le nominatif-accusatif-vocatif est au masculin du, au féminin divi. Au sujet de la première de ces formes, on peut douter si l’fl du thème dwa a été supprimé et le w vocalisé en u (auquel cas du serait formé comme le duel sünù «deux fils», § 211), ou bien si le w de dwa est tombé, comme, par exemple, dans sapnas «rêve», pour le sanscrit svâpna-s, wisa-s «tout», pour le sanscrit vlsva-s (auquel cas du aurait la même formation que dêwù238 «deux dieux», abù «tous deux», venant du theme aba).
Le nominatif-accusatif-vocatif féminin dwi, en lithuanien, s’accorde avec âêwi « deux cavales » (8 21A ) et, par conséquent, avec le sanscrit dvê (= dvai'j et le slave AK’t dve. Aux autres cas, les deux genres sont semblables; ainsi dwê-m, qui sert à la fois de datif et d’instrumental, répond aussi bien a « duabus » qu a «duobus». En ce qui concerne son ê, le lithuanien dwë-m sac-corde avec le slave ak-sma dvê-ma (S 273). Au génitif, le lithuanien garde le .■ il fait dwej-ü (pour dwaj-ü) en regard du sanscrit dvay-ôs et du slave aeoh) dvoj-u.
Au sujet du thème sanscrit dva, il faut encore remarquer qu’au commencement des composés il affaiblit son a en i (S 6), de là la forme dm que les grammairiens de l’Inde posent comme le vrai thème (§ 112). En grec, au lieu de SFi, nous avons St; exemple : Stjidwp = dvimâtar (thème) «ayant deux
mères». Par une rencontre curieuse, le zend et le latin ont altéré de la même façon cette forme dm, c’est-à-dire que l’une et l’autre langue ont rejeté le d et durci le v en b; on a, par
Voyez S 309.

218

exemple, bipaitistana «ayant deux mamelles»,
comme on a, en latin, biceps, biàens, etc. De cette forme mutilée bi vient aussi dans les deux langues l’adverbe bis «deux fois», en regard du sanscrit dvis et du grec Sis. Il ne faut donc pas, comme on a l’habitude de le faire, expliquer le grec St au commencement des composés comme venant de Sis.
Les langues germaniques, à l’exception du haut-allemand, exigent tvi au lieu de dm (S 87) au commencement des composés; nous avons, par exemple, en anglo-saxon tvi-fête «bipes», tvi-finger «duos digitos longus», tvi-hive «bicolor». Le vieux haut-allemand a zui (= zwi) ou qui; exemples : zui-beine «bipes», qui-falt «duplex»239. Mais il ne faut pas rapporter immédiatement à dvis, Sis, bis, l’adverbe zuiro (zwiro) «deux fois», dont la forme complète est zuiror et qui s’écrit aussi quiro; il ressort du vieux norrois tvis-var que ro est sorti de sva, par apocope de l’a et vocalisation du v elri u, puis en o2. Mais dou vient le vieux norrois svar, que nous trouvons aussi dans thrisvar « trois fois » et auquel se rattache la syllabe ce dans l’anglais twice, thrice? Je crois bien que la lettre s qui précède var est identique avec le s de fg^dvis, Sis et de f^Qtris, rpls; mais le var qui suit répond, selon moi, au substantif sanscrit vâra qui signifie «fois», par exemple dans êkavâra «une fois» vârahvaram «mainte fois». De vâra vient aussi le persan moderne bar, par exemple dans bâr-i «une fois»; comme la signification primitive de ce mot est «temps» et comme le v peut se changer en b, ainsi que nous venons de le voir par l’exemple du persan, nous rapportons aussi au même mot la syllabe ber qui termine, en latin, les noms de mois comme septem-ber, octo-bcr (littéralement «la septième, la huitième division du temps»). Pour revenir au
NOMBRES CARDINAUX. S 310.

219

vieux norrois soar dans tvisvar, thrisvar, que nous décomposons ainsi, tvis-var, thris-var, on voit que ces mots, d’après notre explication, contiennent doublement exprimée l’idée de «fois». C’est ainsi que le vieux haut-allemand mêriro renferme un double suffixe comparatif, parce que le premier suffixe ne fait plus sentir sa présence d’une façon assez nette. De cette forme s-var, dans tvis-var, le vieil allemand a d’abord sacrifié le r, puis l’o (venant de a), de sorte qu’en moyen haut-allemand, la forme zwir (venant de zwis) est rentrée dans les limites primitives du dvis sanscrit. ■
Il a déjà été fait mention de l’expression arménienne signifiant «deux» (§ s3o). Nous avons expliqué e-rku-q
comme venant de e-dvu-q, et l’w a été présenté comme un affaiblissement de Va sanscrit du thème dva. Mais au lieu du nominatif pluriel erku-q nous trouvons aussi une forme erku, qui semble dénuée de flexion, mais qui en réalité est un duel1. Il n’est pas surprenant qu’un nom de nombre signifiant «deux» nous conserve un reste de l’ancien duel (comparez le latin duo). L’u de erku est pour l’a long du nominatif duel (S 208); comparez le nominatif duel, en lithuanien : dëwù «deux dieux» (§ 209).
S 3io. Le nom de nombre «trois». — Origine de ce nom.
En sanscrit, en grec, en latin, en lithuanien et en ancien slave, le thème du nom de nombre «trois» est tri. En gothique, la loi de substitution des consonnes (§87, 1) exige la forme thri, et en zend, par suite d’une autre loi phonique (§67), nous avons également tri. .
Dans la plupart de ces langues, la déclinaison du thème en question est parfaitement régulière. En gothique, IV de thri, an
' Pelermann, Orairtmaira arménienne, p. 15a.
220 NOMS DE NOMBRE.


lieu d’être supprimé devant les désinences commençant par une voyelle, se change en ij1; la cause de ce fait est le monosyllabisme du thème. On a, par conséquent, le génitif thrij-ê, le nominatif neutre thrij-a (§ a3fl). Du reste, la déclinaison gothique ne nous a pas été conservée tout entière : outre les deux formes que nous venons de mentionner, on ne trouve que le datif thri-m et l’accusatif thri-ns. Le sanscrit forme le génitif d’un thème élargi traya2, ce qui donne trayâ-n-am, au lieu que le génitif zend iry-ânm ou tray-ahm vient du theme primitif3. Mais les deux langues sont d’accord sur le point suivant : elles réservent le thème tri, Mi tri pour le masculin et le neutre, et quoiqu’il y ait, en sanscrit comme en zend, des exemples de thèmes féminins en i, elles emploient pour le féminin un thème d’une forme à part, à savoir tisar (fïï*ï tisr, § i). Au nominatif-accusatif-vocatif sanscrit, Va de tisar est irrégulièrement supprimé; on a, par conséquent, tisrds4 en regard du zend tisarô. Il est probable que le thème tisar provient d’un redoublement, le t primitif ayant été affaibli en s dans lai syllabe principale : le même changement de t en s a lieu dans le persan sih, qui a perdu le r, tandis que dans l’arménien e-ri (datif-ablatif génitif e-ri-z) c’est le t qui s’est perdu5.
. Je crois reconnaître dans le thème tri la racine tar («J ti ) «transgredi»; la voyelle radicale aurait été supprimée, comme
1 Comparez ce qui a été dit du pâli, S aoa.
5 C’est à ce thème élargi qu’on peut comparer le nominatif masculin dns, qui se trouve dans la traduction d’Isidore en vieux haut-allemand; iriê appartient à un thème dria fléchi d’après la déclinaison pronominale. Le féminin driô suppose également un thème masculin-neutre dm. .
3 Dans le dialecte védique, nous avons un génitif qui est régulièrement
formé du thème primitif. * ^
« A l’accusatif, les règles ordinaires exigeraient ti*f* (S a^a). La >ormo
tisrds est plus complète.
5 La forme arménienne a pris un e prosthétique, dont il y a de nombreux exemples en arménien, comme en .grec (S i83b, i).

NOMBRES CARDINAUX. S 311-312,
221
dans le latin irans. La signification étymologique de tri serait donc «dépassant, surpassant [les deux nombres inférieurs])».

§ 3i 1. Origine du nom de nombre «quatre».
En sanscrit, le nom de nombre «quatre» présente pour le féminin un thème catasar (catasr), qui se décline comme tisar «trois» (§ 3to). La ressemblance de ces deux formes est si grande qu’on est amené à penser que le nombre «trois» est contenu dans la désignation du nombre « quatre » : tasar viendrait de la forme redoublée tatar1 et conserverait l'a du thème dans le redoublement, au lieu que tisar l’affaiblit en i, comme cela est arrivé, par exemple, dans ffcWfïî biüdrmi «je porte», de la racine Bar, Br. La syllabe initiale ca (venant de ha) représenterait le nombre «un», et comme c est toujours sorti d’un ancien k, elle serait identique avec la syllabe finale de êka «un» (S 3o8), ainsi qu’avec le préfixe gothique ha «un» (§ 3o8, remarque)240 241.
S 3ia. Le nom de nombre «quatre».
En sanscrit, le nom de nombre «quatre», au masculin et au neutre, a éatvâr pour thème fort et catur pour theme faible. Nous avons donc au nominatif masculin catvar-as, à l’accusatif catür-as, au nominatif-accusatif neutre catvar-i. Le génitif mas-
■m NOMS DE NQMliRE.


culin-neulre fait irrégulièrement catur-n-âm, au lieu decatur-âm, une nasale ayant été insérée entre le thème et la désinence, comme pour les thèmes terminés par une voyelle (§ 2 46). En zend, le thème fort est catwâr (S k'])\ de là le nominatif masculin catwârô. Le thème faible, qui subit
une métathèse, se trouve, par exemple, dans catru-mâliîm « quatre mois» (accusatif singulier). En regard du génitif sanscrit catur-ndm, nous trouvons £#|JlüM'u(u catrmnahm et, avec insertion d’un a, catrusananm. Au commencement des composés, on a assez fréquemment aussi la forme catwarv, où l’affai
blissement du thème consiste uniquement dans l’abréviation de la, et où le r est suivi d’un ë euphonique (§ 44); exemple : catwarë-paitistanyâo «ayant quatre mamelles» (génitif singulier féminin).
Dans les langues de l’Europe, nous devons nous attendre à trouver à la place du c une gutturale ou une labiale (S i4). En gothique, nous avons fidvôr, l’aspirée étant, selon la règle, substituée à la ténue (§87, 1); dans la déclinaison, cette forme fidvôr, qui se rapporte au thème fort catvdr, s’élargit encore par l’adjonction d’un i inorganique : de là le datif fidvôri-m, qui est d’ailleurs le seul cas dont nous ayons conservé des exemples. Le thème non élargi fidvôr se trouve dans le composé fidvôr-tiguns «quarante» (accusatif pluriel). Au contraire, dans fidur-dôgs «qui dure quatre jours», nous avons une for§pe fidur faisant pendant au thème faible sanscrit catûr. Le lithuanien et le slave ont, comme le gothique, un thème contracté; mais il ne faudrait pas en conclure que le thème faible était déjà formé avant la séparation des idiomes indo-européens. Le gothique a été conduit aussi naturellement à contracter fidvôr en fidur (d’après le même principe qui nous donne, par exemple, tlnu-s «valet», venant de thiva-s, génitif thivi-s) que le sanscrit à contracter catvdr en catûr.
.NOMBRES CARDINAUX. S 312. 223


Le lithuanien suit l’exemple de ces idiomes en opérant la contraction à l’intérieur; niais il élargit le thème extérieurement: le nominatif masculin est keluri (thème keturia) et le nominatif féminin lëturiôs. L’ancien slave, qui a metsipu cetiiri pour thème au masculin et au féminin, décline le masculin sur gosti, le féminin sur nosti (S 255) : nous avons donc au nominatif masculin cetürij-c, au féminin cetiiri1, comme, pour le nombre «trois», on a trij-e, tri; la forme féminine sert aussi pour le neutre. Au commencement des composés, on trouve une forme élargie par l’addition d’un o, cetvoro ou cetvero (par exemple dans cetvoro-nogü ou cetvero-nogü «quadrupes»), qui reproduit plus exactement le thème fort sanscrit catvar 242 243.
C’est également au thème WrWTX catvar que se rapportent le latin quatuor et le grec réercrap-es. Le latin, moins bien conservé à cet égard que les autres idiomes indo-européens, a fait de quatuor un indéclinable. A côté de la forme tsW«p-es, nous avons en grec tst1 ap-ss, qu’on peut rapprocher du pâli cattârô; dans l’une et l’autre langue, la semi-voyelle s’est assimilée au t précédent (§ 19). En ce qui concerne le t initial de isaaapss, le w de l’éolien vséavpss et de la forme épique rslavpes, je rerp- u voie le lecteur au § iâ.
On a vu tout à l’heure que le zend fait subir une métathèse(K&Tr«/ au thème faible et en fait catru, qu’on trouve au commencement des composés. A cette forme ressemble d’une façon surprenante, quoique fortuite , le latin quadru dans les composés comme quadrupes. Le s adverbial, qui sert à former, par exemple, dvis «deux fois» et tris «trois fois» (en zend tris), a du

224

être supprimé en sanscrit (S 9k ) à la fin de catür. Mais caturs a existé primitivement, car on le retrouve dans le zend catrus. Le latin, quoique soumis à des lois phoniques moins rigoureuses que le sanscrit, a également laissé perdre le s final, de sorte que c’est seulement par des modifications internes que ter et quater ont l’air de se distinguer des noms de nombre cardinaux.
En arménien, le nom de nombre «quatre» subit une contraction analogue à celle du mot latin quar-tus comparé à quatuor : il fait ip?#. cor-q, thème cori, instrumental éori-vq. A côté de cor-q on a aussi cors, qui, comme plusieurs autres formes de nominatif pluriel, a conservé l’ancien a1. Une autre désignation du nombre «quatre» estqar, thème qari, instrumental qari-v (avec les désinences du singulier). Le q initial soulève des difficultés : cette lettre ne tient pas ordinairement la place du c (venant de le) sanscrit et zend, et il est difficile d’admettre que l’arménien ait conservé ici la gutturale primitive, quand nous voyons quelle était déjà changée en palatale avant la séparation du sanscrit et du zend; on ne peut pas davantage supposer que la palatale soit redevenue en arménien une gutturale. J’aime donc mieux reconnaître dans la forme qar, ou dans le thème qari, la syllabe vâr du sanscrit éatvâr, dont le commencement s’est perdu. On trouve fréquemment en a?mé-nien un41 q tenant la place d’un v sanscrit et zend2, et le «/ a arménien représente plus souvent un â long qu’un a bref sanscrit.
S 3i3. Le nom de nombre «cinq». — Origine de ce nom.
Le nom de nombre «cinq» est en sanscrit pancan, en
1 Petermann, Grammaire arménienne, pages 115 et i53.
2 Comparez le nom de nombre q-san « vingt», dans lequel q représente le nombre
«deux» (S a3o). ■ .
NOMBRES CARDINAUX. § 313. 225



zend )n(Uj£*aj pancan, en lithuanien penld \ en grec -aévrs, en ^p, éolien ws^we, en gothique fimj244 245, en latin quinque, en arménien ' hing, en ancien slave panti246. Le thème, en sanscrit et en zend,
pancan, pancan; pour ce nom de nombre, non plus que poulies noms de nombre suivants, on ne fait la distinction des genres.
De plus, au nominatif-accusatif-vocatif, il a toujours la forme d’un singulier neutre (par conséquentpânca, § 13q, i) ; les autres cas ont des désinences plurielles; exemple : génitif sanscrit pancânam, zend pancananm. Par ce désordre dans la déclinaison, le sanscrit et le zend nous préparent en quelque sorte à l’absence totale de flexion que nous allons rencontrer en grec et en latin.
Un autre fait remarquable, c’est que les langues européennes, pas plus que l’arménien, n’ont gardé aucun souvenir d’un n final, tandis que, pour les noms de nombre suivants, la nasale sanscrite et zende a laissé des traces de sa présence dans tous
22G NOMS DE NOMBRE.


les idiomes de la famille. En effet, le n de sdptun, ndvan, dâsan s’est conservé en gothique, en lithuanien et en arménien. Le lithuanien a aussi gardé le n de 3lë*p dstan «huit» (aétünl). L’ancien slave a un n dans les nombres «neuf» (devan-tï) et «dix» (desan-iï). Le grec dénote par son a que les noms de nombre eV7a, êvvéa, Séxa étaient plus anciennement terminés par une nasale : en effet, le grec conserve fréquemment l’a devant une nasale, tandis que devant les autres consonnes il l’affaiblit en s ; on peut comparer la première personne de l’aoriste sTvÿa(p) ou hv^a.(v) avec la troisième £tu^s(t) , ou encore la première personne du parfait rérv<pa(jtij avec la troisième thv-H t«). Or, nous avons pour le nom de nombre «cinq» la forme ■aévTB, et non tsévtol. De tous ces faits on peut être tenté de conclure que la nasale finale de pdncan, en sanscrit et en zend, est une addition de date postérieure.
S’il en est ainsi, la syllabe finale ca pourrait être expliquée de la même façon que le ca de catasar (§ 311 ), à savoir comme l’expression du nombre «un». Quant à la syllabe pué de pan-ca, je la regarderais comme étant pour pain, dont le m devait nécessairement se changer en n devant un c; cette lettre m ne serait pas autre chose que le signe casuel pétrifié et en quelque sorte soudé au thème. Reste le thème pa que je prendrais pour une modification de la syllabe ca ou plutôt de sa forme primitive ka; on sait, en effet, que le sanscrit peut faire permuter les gutturales avec les labiales. Cette syllabe ka représenterait le commencement du nom de nombre « quatre », en sorte que l’expression «cinq» aurait pour sens étymologique «quatre plus un». On objectera, sans doute, que le nombre «quatre» se trouve représenté dans ce mot composé précisément par la syllabe que nous avons expliquée précédemment (§ 3n) comme signifiant elle-même « un » ; mais un pareil fait ne serait pas plus surprenant que de voir dans le composé sas-li «soixante» le nombre «dix»
NOMBRES CARDINAUX, S 31 h.

227

représenté par la syllabe ti, qui est tout ce qui reste de dasn-ti (S 3ao, remarque).
On pourrait aussi proposer l’explication inverse, c’est-à-dire considérer la première syllabe de pan-ca comme étant pour kan (forme mutilée de êkam) «un», et la deuxième ca comme représentant le mot catvdr « quatre » ; les deux termes se suivraient alors selon le même ordre que dans le nom de nombre précédent, c’est-à-dire que le plus petit nombre serait le premier membre du composé 1. Il est difficile de dire sur ce sujet quelque chose de certain : nous avons seulement voulu indiquer la possibilité d’analyser ces mots et de découvrir les éléments dont ils ont été formés.
Le nom de nombre arménien hing2 termine le plus souvent son thème par la voyelle i ou a, qui représente le deuxième a depdnca; nous avons, par exemple, à l’instrumental singulier, hngi-v ou hnga-v; au datif-ablatif-génitif pluriel, hngi-z ou hnga-z, pour hingi-v, hinga-z247 248 249.
S 3iU. Le nom de nombre «six».
Le nom de nombre «six» est en sanscrit n sas, en zend ksvas, en arménien iflrg wei (thème wezi), en lithuanien sesi, en ancien slave sesti (thème sesti, S Si 3), en gothique saihs (S 8a), en latin sex, en grec On peut supposer avec raison que la gutturale qui se trouve au commencement du mot zend a aussi existé originairement en sanscrit et que sas est pour un ancien ksas; en effet, le s sanscrit n’est ni une lettre initiale ni une articulation primitive : mais en supposant
NOMS DE NOMBRE.

228

un h initial, s est bien, parmi les sifflantes, la seule qui pouvait suivre (S si b). En latin, en grec et en germanique, la gutturale paraît s’être déplacée, de sorte que, par exemple, le latin sex peut être considéré comme une métathèse pour xes. L’arménien wez1 a perdu à la fois la gutturale et la sifflante initiales, de manière que sans le zend Usvas il eût été difficile de le rattacher au reste de la famille. En ce qui concerne la gutturale initiale de Usvas, on peut rapprocher aussi l’albanais yjda-re.
S 315. Le nom de nombre «sept».
Le nom de nombre «sept» est en sanscrit saptan, en zend haptan2, en arménien bt-p-'ù ev'tn (thème evtan),
en grec ê-rrld, en latin septem, en gothique sibun (thème sibuni), en lithuanien septynl, en ancien slave sedmï (thème sedmi). Le m de septem et de sedmï me paraît provenir du nom de nombre ordinal, qui est en sanscrit saptamd (nominatif saptamâ-s), en slave sedmü-j. Nous en dirons autant du slave osmï «huit» et du latin novern, decem (en sanscrit navamd-s «neuvième», das’amd-s «dixième»); en effet, il n‘ st pas vraisemblable que le n du nombre cardinal sanscrit soit devenu un m en latin et en slave, car l’altération de « en m est aussi rare que le changement contraire, surtout à la fin des mots, est fréquent.
Le nom de nombre arménien est fléchi au singulier et au pluriel : on a, par exemple, le génitif singulier evtan et le datif-ablatif-génitif pluriel evtan-z. A côté du thème evtan, qui est le mieux conservé, nous trouvons encore en arménien des thèmes secondaires ev'tin et evtean, ainsi qu’un thème evtni élargi par l’addition d’un i, avec lequel on peut comparer le thème go-
1 Ce nom de nombre peut être fléchi au singulier et au pluriel; exemple : instrumental singulier : weii-v, instrumental pluriel : wezi-vj.
a Le nominatif-accusatif est en sanscrit sàpta (védique saptâ), eirzend hapla
(S 3.il).
NOMBRES CARDINAUX. S 316.

229

thique sibuni; de plus, le thème mutilé ev'ti (instrumental singulier evti-v)’, enfin les thèmes ivtan, eavian et eôtan1, nominatif ivtti) etc. A l’égard du v tenant la place d’un p primitif, on peut rapprocher l’anglais seven.
S 3i6. Le nom de nombre «lmit».
Le nom de nombre «huit» est en sanscrit astan ou
astâu : du premier vient le nominatif-accusatif âsla (védique astd); du second, la forme semblable au thème âétâu (védique astâu). En zend, nous avons {«(ojçm astan, nominatif «pjç* asta; en lithuanien aétünï; en gothique ahtau; en grec bxtco; en latin octo; en arménien ut (thème uii, instrumental singulier uti-v, pluriel uii-vq); en ancien slave osmï (thème osmi). Le sanscrit astâu et le grec bx-zé font l’effet d’être au duel (§ 206) : je regarde toutefois astâu comme un thème à l’état nu, aussi bien que astan; peut-être est-ce cette dernière forme qui a donné naissance à astâu, par le changement si fréquent de « ou de m en u (S 18 ), avec allongement de l’a. Il est possible aussi que astâu soit pour astâs (§ 206). De astâu viennent, avec suppression du deuxième élément de la diphlhongue, les cas as la-bis, asta-byas, astâ-su, formés comme râ-bis, râ-byas, râ-su, du thème râi «chose, richesse». De son côté, astan a donné régulièrement, aux mêmes cas, astâbis, asldbyas, astâsu ■(§ 255). Le génitif n’a qu’une seule forme, savoir astânâm. La comparaison des autres langues prouve aussi que la diphthongue Au de astâu appartient au thème; nous avons, en effet, octâv-us en latin, 6ySooe pour 6y§oF-os en grec, le datif pluriel ahtowe-n en vieux haut-allemand, dans Notker; cette dernière forme est pour ahtowim, venant du thème ahtowi.
’ La voyelle 0 esl «ne contraction de av, qui a donné d’abord au et ensuite 6.

230

S 817. Le nom de nombre «neuf».
Le nom de nombre «neuf» est en sanscrit -qR^navan; en zend navan (nominatif-accusatif nam); en gothique niun1; en latin novem, venant de nava-ma-s «neuvième» (§ 3io); en grec èwéa., venant de vsFn, avec un g prosthétique et le redoublement de la liquide (comparez ïvveov, venant de t's«y); en lithuanien dewyni; en ancien slave devantî (lheme devahti). Les deux dernières expressions semblent d’une autre origine, mais elles reposent sur la même permutation entre la nasale et la moyenne que nous avons vue dans (2por6s et *u\q^mrtd-s «mor-tuus». On trouve pareillement un d au lieu dun n, en lithuanien, dans debesh «nuage», comparé au sanscrit ndbas (même sens), tandis que le mot slave nebo (génitif nebes-e) a conservé la liquide. Dans le nom de nombre en question, le borussien a gardé le n primitif, ou plutôt il l’a rétabli2, car il est très-probable que le changement de n en d, dans ce mot, a eu lieu avant la séparation des idiomes letto-slaves.
L’arménien, comme le grec, a une voyelle prosthétique avant la liquide : la forme la mieux conservée est fiiu/ii i-nan (thème), dont l’a était peut-être long originairement. Il est possible, en effet, qu’il représente les deux a du thème sanscrit nd(v)an confondus, de même que l’d =>U du nom de nombre latin nôn-us représente les deux a brefs de na(v)an, et suppose un nom de nombre cardinal nôn, venant de na(t))aw.
Du thème arménien fi'mfii inan se forme régulièrement le
1 Ou bien ta syllabe va s’est contractée en u, ou bien te v est tombé, en sorte que «i(t>)u» serait pour nivan, venant de navan, avec « pour a comme dans stbun et m-hun. Le génitif piuriel nirn-é, dont on trouve des exemples, pourrait venir du thème organique niun aussi bien que de muni. Mais le thème, en vieux haut-allemand, est
muni.
s Newinl’-s pour ncwmta-* «neuvième». Voyez mon mémoire Sur la langue des Borussiens, p. S8.
NOMBRES CARDINAUX. S 318.

231

nominatif pluriel inun-q (§ 226) ou, avec redoublement de n ( comme dans le grec èvvéct), innun-q. L’affaiblissement de l’a en u peut avoir lieu également aux trois cas finissant en z, ce qui donne inun-z ou inan-z, ou, avec suppression du dernier n (après u) et redoublement du premier, innu-z. Le nominatif singulier inn vient d’un thème inni élargi par l’addition d’un i : mais 1’* initial s’affaiblit en £ ë à tous les cas qui ont gardé l’t final; on a, par conséquent, au datif-génitif ënni, à l’instrumental singulier ënni-v, à l’instrumental pluriel ënni-vq, au datif-ablatif-génitif pluriel ënni-z.
8 3i8. Le nom de nombre «dix». — Origine de ce nom.
Le nom de nombre «dix» est en sanscrit dds'an, venant de dakan (§ 21a); en zend )jmbmj daéan (nominatif-accusatif dosa)-, en arménien ututuii tasn (thème terni); en grec Séxa; en latin decem, formé du nom de nombre ordinal dasamà-s s dixième » (§ 315); en gothique taihun; en lithuanien dêsimtis1-, en slave desahtï (thème desahti). Le gothique taihun est privé de flexion, mais il est probable qu’anciennement ses cas étaient formés de taihuni ou taihani : c’est ce qui ressort du vieux haut-allemand, où zëhani (par assimilation zëhini ou zëheni, par contraction zêni) est le thème de la déclinaison.
La diphthongue ai, dans taihun, provient de l’t (S 82), qui lui-même est l’affaiblissement d’un ancien a; taihun est donc pour tilmn, venant de tahun, comme saihs «six» est pour sihs, venant de salis. Je ne puis donc partager l’opinion de Lepsius250 251 252, qui reconnaît dans la syllabe initiale de taihun le nom de nombre
232 NOMS DE NOMBRE.


tvai « deux », avec suppression du v, et suppose que le mot entier signifie «deux mains». Toutefois, je pense aussi que le nombre « deux » a servi à la formation du nom de nombre «dix» : je crois retrouver le root « deux » dans la syllabe initiale du sanscrit dàsan \ et je regarde la seconde syllabe comme exprimant le nombre «cinq»253 254 255; en effet, dâ-san vient de da-kan, et la syllabe kan peut être considérée comme une mutilation de panam, venant de pah-kan ®. Il n'est plus nécessaire dès lors de faire intervenir la main dans la composition du nombre « dix », a moins qu'on ne veuille renoncer à l'explication de pancan donnée plus haut ( § 3 j 3 ), et qu’on ne le fasse venir du sanscrit pânî « main ».
§ 319. Les noms de nombre de «onze» à «dix-neuf».
De « onze » à « dix-neuf », on combine les neuf premiers nombres avec le mot « dix » :
«onze»
«douze»
«treize»
«quatorze»
Sanscrit.
ekàdasan
dvadasan
trayodasan
c'atùrdasan
Zend.
aivandaéan
dvadasan
(ridasan
calrudasan
Arménien.
mc-t'asan256 erlco-tasan ereq-tasan hreq-tasan
NOMBRES CARDINAUX. S 319. 233

|
Lithuanien. |
Golliique. |
Latin. |
Grec. |
|
wênô-lika1 |
ain-lif |
undecim |
ërSstta |
|
dwtj-lika |
tva-lif |
duodecim |
SdiBsxa |
|
trti-lilta |
thri-taihun* |
TpisxatSsHa 4 | |
|
keturô-lilea |
fidvôr-taihun |
quatuordecim |
TeffcapsîKaiSejca. |
|
Et ainsi de suite. Les langi |
ues slaves insèrent entre les deux | ||

noms de nombre la préposition na «au-dessus de». Dans les dialectes slaves les plus récents, l’expression du nombre «dix» est plus ou moins mutilée, en sorte que ces composés qui comprennent trois mots ont pris l’apparence de mots simples. En serbe, par exemple, au lieu de deset «dix» nous avons est dans jedanaest (pour jedan-na-deset) «onze», dvanaest «douze», trinaest «treize», cetmaest «quatorze». En slovène, «onze» se dit enajst (pour ednajst et jednajst, qui est lui-même pour jeden-na-deset); de même dvamjst « douze », trinajst « treize », stimajst « quatorze ». L’ancien slave ne mutile ni l’une ni l’autre des deux expressions, et dit, par exemple, dvanadesantï, à moins peut-etre quil ne faille écrire dva na desahtt.
Remarque. — Comparaison des nombres de «onze» à «dix-neuf» et des nombres de «un» à «neuf». — ARérations du nom de nombre «dix» comme membre d’un composé. — On vient de voir, dans le tableau qui précède, que les nombres «onze» et «douze» sont exprimés en gothique par ain-iif, tva-lif, au lieu que «treize» se dit thri-taihun, «quatorze» julvôr-taïhm, «quinze» fimf-taihun, et ainsi de suite. Le mot tnih.nr, est la représentation exacte du sanscrit dàsan (venant de dakan), c est-a-dire que la forme gothique présente les modifications exigées par les lois phoniques propres à cette langue (SS 82 et 87, 1). Mais avant l’époque relativement
234 NOMS DE NOMBRE.


récente où ces lois ont commencé à entrer en vigueur, il est possible que dàéan ait déjà donné une autre forme en gothique, à savoir libi, par le changement si fréquent de à en l, et par la permutation non moins ordinaire des gutturales et des labiales (comparez, entre autres, le gothique fidvôr «quatre» avec le lithuanien keturi et le latin quatuor). Libi est le thème de lif renfermé dans ain-lif «onze», toa-lif «douze» ; c’est ce que nous voyons par le datif tm-libi-m et le génitif tva-lib’-ê. Le/de tvalif ne doit donc pas s’expliquer par la loi de substitution des consonnes (S 87, 1), mais par la loi relative aux moyennes finales (S 98' ). Les deux a de dàéan se sont affaiblis en i. ...
Gralf1 objecte que le b du thème libi est contraire à la loi de substitution
qui exigerait une aspirée. Mais nous avons déjà indiqué (S 89) que cette loi souffre en gothique de fréquentes exceptions; rappelons seulement fidvor au lieu Aejithvôr. On pourrait citer, en outre, le latin quadraginta au lieu de quatraginta, le grec Ôyloos au lieu de Ônroos, éSbogos au lieu de écopas, et quelques autres faits qui prouveraient que les noms de nombre ne se conforment pas toujours, en ce qui concerne le degré de leurs consonnes, aux règles ordinaires; dans les formes surchargées par la composition, ils semblent préférer la moyenne à la ténue et à l’aspirée. Si l’on objectait la différence considérable qu’il y a entre libi et le mot tathun, nous rappellerions qu’en français la différence n’est pas moindre entre le mot dix et l’expression du même nombre renfermée' dans on-ze, dou-ze, tm-ze.
II n’est pas douteux que onze, douze ne dérivent de undecim, duodecm, et que ze ne soit la corruption du mot latin decirn, dont dix est une autre représentation moins altérée. Qui cependant, sans le témoignage de l’histoire, oserait affirmer que ze est apparenté ou identique avec dix ? De même que les mots français onze et douze, les mots allemands eilfet zwolf ont pris l’apparence de .mots simples, dans lesquels on distingue bien encore une affinité avec les nombres «un» et «deux», mais ou le nombre «dix» est devenu méconnaissable. L’anglais eleven «onze» est encore allé plus loin, car même sa parenté avec «un» (one) est absolument effacée.
Le nombre «treize» est exprimé en allemand par drei-zehn et non par dreilf, «quatorze» se dit vier-zehn et non vierlf, et ainsi des autres. La rai> Dictionnaire vieux haut-allemand, 1, p. 317. J. Griram, daus son Histoire de la langue allemande (p. 246),'soutient au contraire l’explication donnée «-dessus, en rappelant les faite analogues en prâcrit et en indoustani. Comparez aussi Schleicher, Théorie des formes du slave ecclésiastique, p. 187.
NOMBRES CARDINAUX. S 319. 235


son de cette différence est que les Germains, à partir de «treize», ont oublié les anciens composés indo-européens, et ont de nouveau créé ces expressions en combinant entre eux les termes simples, tels qu’ils les avaient dans leur langue. Le même fait a eu lieu en grec, où les anciens composés, à partir de «treize», se sont également perdus, et où il a fallu les remplacer par des expressions nouvelles; on peut même ajouter que la langue grecque, en visant trop à la clarté, a créé des mots quelque peu gauches et lourds. La particule xal a été jugée nécessaire dans rpiexaihxa, rscraapssxal-§sxa, au lieu que les anciens mots ëvësxa, SdëiHct sont de vrais composés et ont un air plus aisé et plus libre.
A côté de ëéëexa, nous avons en grec SuéSsx® et hvwësxa. Le premier répond très-exactement, sauf la perte du F, au sanscrit dvddaéa (venant de dvâ-daka) ; il paraît être le terme usité de toute antiquité. Au contraire, Mëem et èoebësxa semblent être de formation nouvelle. En sanscrit, trayodaéan est un terme relativement récent, qui est surpassé en fidélité même par le lithuanien try-lika (== tri-lika). En elfet, le composé sanscrit renferme, au lieu du thème tri, un nominatif masculin pluriel trayô (par euphonie pour frayas), qui est en quelque sorte pétrifié, car on le conserve invariable à tous les cas. Le zend a l’expression correcte îri-daéa (S 319), ce qui prouve qu’il s’est séparé du sanscrit avant l’introduction du mot trayodaéan,
Le lithuanien try-lika, qui vient d’être mentionné, répond très-bien à cette forme rende fri-daéa (venant de tri-daka). Par le changement du d en l, lika est devenu aussi différent de dcHmtis que le gothique libi de laihun, d’autant plus que lika n’a pas affaibli, comme dêsimtis, sa gutturale en sifflante. La langue n’a plus conscience de la signification du second terme , dans les composés wêno-lika «onze», dwy-lika «douze», etc. Mais elle connaît encore là valeur du premier terme, de sorte que les altérations subies par les noms de nombre de «un » à « neuf» se retrouvent assez exactement dans les composés. Quoique wêno-lika puisse être considéré comme un composé ayant déjà existé avant la séparation des idiomes, son premier membre n’en a pas moins subi des altérations parallèles à celles du mot simple «Un». La même observation s'applique-au gothique ainlif, au grec ivësxa, au latin undecim : dans toutes ces langues, le premier membre du composé s’est modelé sur le terme simple. Au contraire, Sc&Sexa, comme on vient dé le dire, est presque la reproduction du sanscrit dvadasa, qui ne pouvait guère être rendu plus exactement, puisque 1« grec répond à la sanscrit (S 4), et qu’un F dans cette position devait néces-
NOMS DE NOMBRE.

236

sairement être supprimé, ne pouvant être assimilé par la lettre précédente (comme, par exemple, rétfapss, venant de ré-rFapes). Dans le latin duodecim, le premier membre s’est réglé entièrement sur la forme du mot simple. En français, au contraire, l’analogie qui devrait rattacher onze à un, douze à deux, treize à trois, na pas été prise en considération , c’est-à-dire que les composés en question ont été purement et simplement dérivés des composés latins, sans avoir égard aux noms de nombre simples; autrement, nous devrions avoir des formes telles que unie, deuze, Iroize.
D’après ce qui vient d’être exposé, les mots allemands eilf «onze» et zwülf «douze» contiennent un terme signifiant «dix», et, si étrange que puisse sembler à première vue ce rapprochement, je suppose que ce terme est identique, par son origine, au sanscrit ddsan, au grec èéxa, à l’allemand zehn. C’est l’étude des changements phoniques qui nous a conduits à ce résultat. Si l’on voulait expliquer le gothique libi, lif , et le lithuanien lika, sans le secours de la comparaison des autres idiomes, on arriverait à la même hypothèse que Ruhig, qui fait dériver ces formes de la racine lithuanienne lik et de la racine gothique lif ou lib. Toutes deux signifient «rester» (gothique af-lifnan «relinqui, superesse71, laibos «reliquiæ») et sont de même origine que le grec Xefato. Ruhig 1 prend lika pour la troisième personne du pluriel ; «Dans les nombres cardinaux, dit-il, la com-«position se fait de «dix» à «vingt* en ajoutant lika, qui est la troisième «personne du pluriel du présent de l’indicatif (venant de lika ou liekmi);
« lika indique que les dixaines doivent rester sous-entendues avec le nombre «simple, tel que «un, deux, trois*. Toutefois, ce complément lika, ainsi «placé en composition, dégénère en un nom déclinable du genre féminin, «sur lequel il faut, en outre, que se règle le nombre simple qui précède.* Mais les idiomes n’ont pas l’habitude de recourir à des procédés aussi pé-dantesques; s’il leur arrive de sous-entendre une idée, ils ne prennent pas la peine de prévenir qu’il reste quelque chose de sous-entendu.
Nous venons de voir que les langues slaves ayant perdu les anciens composés de «onze* à «dix-neuf», les ont remplacés par des composés nouveaux, où elles insèrent la particule na «par-dessus». Le lette, qui est intimement lié avec le lithuanien, mais qui est plus altéré, emploie un procédé analogue : il dit, par exemple, weenpazmit «onze» (wceiirfa-zmit «un par-dessus dix»), diwpazmit «douze», trïspazmit «treize»; dans ces com-
Voycz. la traduction de Mielcke, p. 58.
NOMBRES CARDINAUX. S 319. 237


posés, la syllabe des de desmit «dix» est contractée en a (= ts). Rappelons encore une rencontre remarquable entre le lithuanien et le germanique d’une part, et le prâcrit de l’autre : en prâcrit, «dix» employé isolément se dit 55 daha; mais à la fin des composés en question, il devient raha. Exemples : vâraha «douze», venant de dvadasa; aûàraho «dix-huit», venant de astadasa. Le d s’est affaibli en la semi-voyelle r, évidemment pour diminuer la surcharge causée par la composition : or, c’est le même fait qui a lieu dans try-lika, car la parenté de r et de l est connue (§ 17). De même, en indoustani, le mot «dix» à l’état isolé est dos; mais, dans les composés dont nous nous occupons, il est devenu rah; on peut comparer, par exemple, l’indoustani bârah «douze» et la forme prâcrite précitée baraka; l’un et l’autre sont sortis immédiatement du primitif dvadasa, sans chercher h mettre leur forme d accord avec celle du simple du «deux», ni avec celle de das «dix». Nous faisons suivre le tableau comparatif des composés in-doustanis, ainsi que les formes sanscrites dont ils sont des corruptions. Nous ajoutons le nombre «vingt», ainsi que «dix-neuf» qui est désigné comme «vingt diminué [de un] » ; en regard des composés, on trouvera les nombres simples en indoustani.
|
Indousiani. |
Indoustani. |
Sanscrit (nominatif). | |
|
«un» |
êk |
«onze» igà-rah |
êlcâdasa |
|
«deux» |
dô |
«douze» bâ-rah |
dvadasa |
|
«trois» |
tîn |
«treize» tê-rah |
trayodasa |
|
«quatre» |
car |
«quatorze» cau-dah260 |
cdturdaéa |
|
«cinq» |
pâne |
«quinze» pand-rah |
pâncadasa |
|
«six» |
ca |
«seize» sô-lah2 |
èodasa |
|
«sept» |
sât |
«dix-sept» sal-rah |
sàptadasa |
|
«huit» |
ât |
«dix-huit» atâ-rah |
astadasa |
|
«neuf» |
nau |
«dix-neuf» unis |
ûnavihsati |
|
«dix» |
das |
«vingt» bis |
vinéàli. |
|
Sanscrit. |
. Zend. |
Grec. |
Latin. | |
|
«vingt» |
vihéâti |
vîsaiti |
eixari |
viginti |
|
«trente» |
trihsdt |
triéata 261 |
rpidixonva |
Iriginta |
|
«quarante» |
calvârihiàt |
c'aimarësata |
TSffffapànovra quadrâginta | |
|
«cinquante» |
pancâsdt |
panc'âsata |
'aevnjxovTz |
quinquaginta |
|
«soixante» |
saki |
lcsvasti |
shjxovTCt |
sexâginta |
|
«soixante-dix» |
saptati |
haptâiti |
éë&opyxovra.* septuâginla | |

238
- NOMS DE NOMBRE.
S 3
20. Les noms
de nombre de «vingt» à «cent».
Dans les noms de nombre de « vingt » à « cent », l’idée de la dixaine est marquée en sanscrit par Tjfïï sati, 1T^ sat ou fft ti; en zend par saiti, sata ou jço ti. On forme ainsi, en combinant l’une de ces formes avec les neuf premiers nombres, des mots composés qui sont traités comme des substantifs singuliers; en sanscrit, l’objet compté est mis au même cas que le nom de nombre et lui est adjoint comme une apposition, ou bien encore, comme en zend, il est mis au génitif. Quelquefois aussi on trouve en sanscrit les noms de nombre employés adjectivement avec des désinences plurielles.
Voici le tableau des noms de nombre de «vingt» à «cent»:


NOMBRES CARDINAUX. S 320. 239
|
Sanscrit. |
Zentl. |
Grec. |
Latin. | |
|
«quatre-vingts» |
asîtî |
. ôyhoijxovra |
octôginta | |
|
«quatre-vingt-dix» |
navati |
navaiti |
èvevyjKOVTO, |
nônâginta |
|
«cent» |
salà-m |
satë-m |
è-wrvb-v |
centu-m. |

Remarque. — Formation des noms de nombre de «vingt» à «cent». —
Le nom de nombre.«mille». — Je regarde sati, sat, data, ti comme des formes mutilées venant de daéati, dasat, dasala, et, par conséquent, je les tiens pour dérivées de ddsan «dix» à l’aide d’un suffixe ti, ta ou t.
En lithuanien et en slave, le suffixe ti sert aussi à former le simple deêim-tis, desahtï «dix». Il ne faudrait d’ailleurs pas s’autoriser des composés comme trysdesimtis tridesante «trente», où l’expression de la dizaine ne subit aucune mutilation, pour dire que le slave a mieux conservé les formes primitives que les idiomes congénères ; ce sont là des formations nouvelles, ainsi que l’indique clairement le lithuanien qui, à partir de «quarante», sépare les deux nombres; exemple: kêturiôs desimtys «quarante».
Le gothique, pour cette catégorie de noms de nombre, présente aussi des formes relativement récentes. Il a perdu les anciens composés (comme il a perdu les composés signifiant «treize», etc.) et il emploie de «vingt» à «soixante»2, pour exprimer la désinence, le masculin ttgus, qu’il décline régulièrement; «vingt» et «trente» fléchissent aussi le premier nombre.Nous avons, par exemple, à l’accusatif, tvansliguns, thrinstiguns, fidvorliguns, fimftiguns; au génitif, thrijêtigivê. Quant à l’origine du substantif tigus, elle est la même que celle de taihun et de libi, qui, en conséquence, forment, pour ainsi dire, trois noms jumeaux. Tigus diffère de taihun en ce qu’il a changé l’aspirée en moyenne (S 89); par là il a rendu superflu l’a'dont l’insertion dans taihun est due uniquement à la présence de à (S 82). On peut rapprocher du g de tigus le g du latin ginti, ginta, au lieu que le grec xari, xovra, en conservant la ténue, est resté plus près de Séxa. Tigti-s est peut-être identique avec le nom de nombre ordinal sanscrit dosa, nominatif masculin dasa-s, qui est seulement employé en composition;
sanscrit ndvan «neuf». C’est à ce dernier thème, et non à novetn (S 3i5), que se rapporte on latin le nén de nânaginta et de nônus.
1 Les deux noms de nombre dont, est formé trysdeümlis sont au nominatif pluriel ; le second a,abrégé sa désinence (;/ = »)•
2 II ne s’est pas conservé d’exemple de ce dernier nombre. .
2/,o NOMS DE NOMBRE.


exemple : dvàdaéà-s « douzième*. L’a de ligu-s est avec l a de dasa-s dans le même rapport que l’a de fôtu-s «pieds avec l’a de pdda-s (même sens).
Dans les noms de nombre «soixante-dix, quatre-vingts, quatre-vingt-dix», la dizaine est exprimée par le substantif neutre tehund (thème tehunda, génitif tchundi-s)1, on a, par conséquent, sibun-têhund, ahtau-têhund, niun-têhund. L’ê du thème têhunda représente Y ai de taihun ; quant à la syllabe da, je la regarde comme le suffixe ordinal, qui dans les vrais nombres ordinaux a encore pris un « inorganique, ou, pour employer le langage de Grimm, suit la déclinaison faible; de là taihundan, nominatif taihunda «décimas». La formation de tèhund confirme l’hypothèse émise un peu plus haut, que tigus est par son origine un nom de nombre ordinal.
En allemand moderne, tigus, transformé en zig ou ssig, s’est étendu aux nombres «soixante-dix, quatre-vingts, quatre-vingt-dix»; exemples. dreissig, vierzig, siebenzig, achtzig, neunzig. En vieux haut-allemand on a la désinence zog ou zoc; exemples : sibunzog, ahtozog, niunzog, ou sibunzoc, ahtozoc, niunzoc. «Cept» se dit zëhanzog ou zëhanzoc, en gothique laihuntêhmd.
Le nom de nombre «cent» (en sanscrit sata, nominatif sinn. datant; en zend data, nominatif satëm) tire son origine, selon moi, du nom de nombre dâéan « dix », dont il est dérivé a 1 aide du suffixe ta. La suppression de la nasale finale de daéan est conforme aux lois phoniques ordinaires. Je regarde donc sata comme une forme mutilée pour- dasata, de même que plus haut nous avons considéré va fri sati, STr^ sat et le zend Mfna sata comme étant pour dasati, dosât, dasata. Le retranchement de la syllabe initiale, par suite duquel le mot sata prend 1 aspect dun terme nouveau et expressément créé pour signifier «cent», appartient à la période la plus reculée de notre famille de langues : nous avons en grec mtov (èxotrov signifie littéralement «un cent»), en latin centum, en lithuanien èimta-s (masculin), en ancien slave süto (à la fois thème'et nominatif-accusatif neutre). Le gothique hund et le vieux haut-allemand hunl (thème hunda, hunta) ne sont employés qu’en composition, par exemple dans tva-hunda, thrija-hunda, zuei-hunt, driu-hunt, ou le premier nombre est également fléchi. La mutilation des formes STfff sati, ««G fIu*> a'ns' que nous l’avons vu, ont perdu, comme data., leur syllabe initiale, remonte aussi à une époque extrêmement ancienne; si 1 on compare, par exemple, le sanscrit fgiuilw tùbsdti au zend vtsaiti, au grec elxcm, shoot,
et au latin viginti, on voit que les éléments dont ces mots sont composés se trouvent soudés ensemble depuis un temps immémorial. Je ne veux pas
NOMBRES CARDINAUX. S 320. 2A1


affirmer pour cela que la perte du d initiai de vihsati doive être rapportée également à une époque aussi lointaine : il a pu se faire que les quatie idiomes, pour alléger un mot surchargé par la composition, soient arrivés chacun de leur côté à se débarrasser de l’une des deux consonnes initiales; c’est ainsi que le latin et le zend ont tiré l’un et l’autre, mais d’une façon indépendante, de fois, foi les formes bis, bi, et que le prâcrit et l’indou-stani. pour obtenir un allégement analogue à celui dont nous venons de parler, ont laissé tomber le d initial du nombre » douze s (S 3iq, remarque).
En sanscrit et en zcnd, par une altération nouvelle à laquelle le grec et le latin n’ont point de part, le mot dasati s’est réduit à son suffixe dérivatif ti, qui correspond dès lors à la syllabe le dans le français trente, quarante. C’est à partir du nombre et soixante» que commence cette nouvelle mutilation; on a, par exemple, en sanscrit saki (ti par euphonie pour ti); en zend, ksvasU (fsoixântfii)»
Au sanscrit sati, renfermé dans vinsdti, correspond exactement le naTi du dorien etxau, tandis que la ténue s’est changée en moyenne dans le latin ginli, ainsi que dans ginta qu’on peut comparer a xovret. Le n qu on trouve dans vihsâti, trihsât, catvârinsat est particulier au sanscrit : peut-être le d initial de dasati s’est-il affaibli en n \ comme nous avons vu plus haut (S 319, remarque) le d de dosa s’altérer en r ou en l, et comme inversement le n initial du nombre reneuf» est devenu un d en lithuanien et
en slave (§ 3)7). _
Conformément à cette hypothèse, on peut, en décomposant catvârihsât, mettre la nasale du côté du second membre du composé. La première partie serait alors c'alvdri qui est un pluriel neutre. Dans rptaxovra, rsa-aap«xorra, Tpiet, reererapa sont vraisemblablement aussi des formes de pluriels neutres; la désinence de Tpia a été allongée, et il est probable qu il en était de même à l’origine pour reaaapa, comme l’indiquent l’ionien ’îeaffT.prjxovTHL, le dorien tstpuixovra,*, le latin quadrâginta. L u de rstro-a- 262 263
242 NOMS DE NOMBRE.


pjxovnx nous conduit à supposer que celui de é&txovrx. éëàop)xovTct, èvsvtfxovTOL, ôyborfxovTd, ainsi que là de sexagmta, septuaginta, nonagtnta, >
sont des allongements* de la désinence du pluriel neutre. L’v de «eirnfxovTix peut être considéré comme l’allongement de Ve final de asévts ; cet rj ainsi que la du sanscrit paricu-iât (thème pane an) et celui du latin quinquàginta peuvent s'expliquer par l’habitude qu'ont prise les trois idiomes d’avoir une voyelle longue à la fin du premier membre de ces composés. Quant à la dernière partie des noms de nombre comme xptet-xovra, il n est pas douteux quelle n’ait la forme d’un pluriel neutre. A ne considérer que les langues classiques, il serait permis de se demander si le thème est xovt ou xovto, gint ou gintô; la seconde hypothèse est la plus probable, a cause du nominatif singulier pmicâsatëin «cinquante» (S 320, page 238, note 1), lequel, transporté du zend en grec et en latin, donnerait une forme «stm;-xovtov, quinquâginiwm.
Il a déjà été question (S 2 3o) des noms de nombre arméniens de «vingt» à «cent». Si, au lieu de l’a de q-san «vingt», nous trouvons un u dans ere-sun1 «trente», qar-sun «quarante», etc., cette différence vient probablement du besoin d’alléger la voyelle, à mesure que le mot s’allonge; c’est ainsi qu’en vieux haut-allemand nous avons, a côté de bant ou peut «je liai, il lia» (en sanscrit babnnda), les formes polysyllabiques bunti «tu lias», buntumês «nous liâmes». Dans la seconde sérié de cas, ou le thème des noms de nombre arméniens est élargi par 1 addition d un i inorganique, 1 u de ere-sun est supprimé, au lieu que qsan garde sa voyelle; comparez, par exemple, à l’instrumental singulier, ere-sni-v et q-sani-v. Il faut encore mentionner la transformation que subit le nom de nombre hing «cinq» qui devient jl> ki dans le composé Kisun «cinquante», le 4 h étant remplacé par j K%, et le reste du mot éprouvant une mutilation analogue à celle des noms de nombre latins qutnque, sex, decetn, dans qui-ni, se-ni, de-ni.
L’arménien n’a pas pour le nombre «cent» le même terme que les autres idiomes indo-européens : il a hariur, dont le thème est hariuro ou harittri.
Au contraire, le nombre «mille» est représenté par hasar (thème
hasara ou hasari) qui correspond très-bien au sanscrit sahasrci et au zend
été supprimée dans jerpcUxovra, comme elle est supprimée dans tstpAxts, rerpa-itXovs, qui renferment également des formes de pluriels neutres.
1 On devrait s’attendre à trouver eri-sun, cri (pour ri) étant le thème du nom de nombre «trois».
5 Voyez Petermann, Grammaire arménienne, p. 69.
3 J. Grimm, dans son Histoire de la langue allemande, explique snhdsra par le
NOMBRES ORDINAUX, s B21. *243


hasanhra (§57). Les longues de l’Europe n’ont rien de semblable, à moins qu’on ne rapproche le grec ytXto : il faudrait alors admettre que la syllabe initiale a été supprimée et que x,tXt° est pour aayiXto ou àyjXio ', avec changement de r en X; le lesbien yéXXtot (pour yéaXtot) aurait conservé dans son premier X le représentant d’un ancien a, lequel serait devenu 1 dans le béotien yslXtot (comparez si fit pour sergi) et aurait été remplacé dans le dorien ytjXîot par l’allongement de la voyelle. R faudrait prendre 10 pour un suffixe dérivatif, comme si, en sanscrit, nous avions sahasrya
(§ 899)- .... ....
Le terme qui signifie a milles dans les langues germaniques et lelto-
slaves, thusundja en gothique, tusantja en ancien slave, lukstanti en lithuanien, vient probablement de la racine tu «grandirs, qui a donné dans le dialecte védique le mot tuvi «beaucoup»2. L’accord des langues germaniques avec les idiomes letto-slaves s’explique peut-être par un emprunt de la part de ces derniers ; l’aspirée gothique, si elle existait déjà au moment de l’emprunt, a dû naturellement redevenir une ténue en slave. R n’est pas étonnant que les noms de nombre les plus élevés soient prêtés par un peuple à un autre : ce ne sont pas là des termes appartenant au langage populaire. C’est ainsi que le latin mille a pénétré dans plusieurs dialectes celtiques modernes : nous le retrouvons dans l’irlandais mile, dans le gallois mil.
NOMS DE NOMBRE ORDINAUX,
S Bai. Le mpt «premier» dans les langues indo-européennes. — Suffixes servant à former les noms de nombre ordinaux.
Tandis que les langues indo-européennes présentent ia plus grande diversité dans l’expression du nombre «un», elles ont presque toutes le même terme pour l’idée de «premier». Aucun
mot séhas «force»; cette étymologie me paraît très-plausible, car les idées dé force, de grandeur et de nombre se touchent de près.
1 On peut rapprocher le sanscrit turya ou turîya «quatrième», qui est pour ca-turya, catyrîya (S 3aa). En ce qui concerne la perte deson «, le grec ytho (pour ■yiaho) ressemblerait à l’arménien et au persan hasar, qui a egalement supprimé le second s du sanscrit sahâsra (en zend hasanhra).
5 Comparez mon mémoire Sur la langue des Borussiens (p. A6 et suiv.).
i<>.

244 NOMS DE NOMBRE.
des idiomes que nous examinons ici ne fait dériver ce nombre ordinal du nombre cardinal correspondant. Nous avons en sanscrit pralamd-s (nominatif masculin); en zend fralëmô
(§ 56l); en latin primu-s; en lithuanien pirma-s; en gothique frum-s (venant de fruma-s, pour frama-s, § 396), ou, avec la forme faible, fruma (thème fruman), ou, avec le suffixe superlatif qui est venu se joindre une seconde fois au thème , frumist’-s; en vieux haut-allemand êristêr, ou ordinairement, avec la forme faible, êristo (venant de l’adverbe êr «plus tôt», en allemand moderne eàer); en grec 'srp&ÎTOs; en ancien slave prïwüj.
Il a déjà été question de v^mpratamà, qui vient de la préposition pva (§ 298). De même, ■©pÜTOs vient de la préposition correspondante «rpo, dont l’allongement en «p« est parallèle à celui du sanscrit prâ dans prâtàr «de bonne heure».
Le suffixe t0 est une abréviation du sanscrit tama ou tama; nous retrouvons la même abréviation dans les thèmes sanscrits catur-td « quatrième » et sas-\d « sixième », ainsi que dans le latin quartô, quintô (quinctô), sextô. En grec, cette mutilation s’étend à tous les noms de nombre ordinaux, excepté Seûrepo, è'SSopo et oySoo. En lithuanien, le suffixe ta paraît constamment à partir de «quatre»; cependant, à côté de septvnta-s, aétunta-s, on a aussi sêkma-s (pour sepma-s) et âsma-s. Ici, c’est la syllabe ma du suffixe superlatif qui a subsisté : il en est de même dans les noms de nombre sanscrits pancamd-s, saptamà-s, astama-s, navarnd-s, daêamà-s. En combinant cette syllabe ma avec le ta de caturtd, on arrive à destituer le suffixe entier tama ou tama, en sorte que celte double série de formes se complète l’une l’autre. Le zend présente les mêmes faits : il y a seulement cette différence que la forme haptatô (nominatif) se rapproche plus
du lithuanien sepüntas que du sanscrit saptamàs1 et du
1 Ajoutons toutefois qu’on trouve dans les Védas saptà-ta-s, paAcâ-ta-s, au lieu de saptamà-s, pmièaniâ-s. w '

$
1
I
3

ipp»1*”"""


NOMBRES ORDINAUX. S 321. 245
latin septimus; de même puk-iïô «cinquième» est plus
près des formes usitées dans les langues européennes et particulièrement du lithuanien pènk-ta-s. Mais le mot lithuanien est mieux conservé que le mot zend, qui a aspiré les deux ténues primitives1 et qui, en outre, a rejeté la nasale et affaibli irrégulièrement l’a en u. _
De «onze» à «vingt», le suffixe superlatif, en s'anscrit et en
zend, est encore plus mutilé que dans le simple <^xi+ï dasama, dasëma; du suffixe tama, il ne reste que la, devant lequel, suivant un principe général de la dérivation, l’a du mot primitif doit tomber; exemples : dvâdasa, dvadasa
«douzième»; caturdaid, catrudaéa «quator
zième ». Le latin semble démontrer que cette mutilation est relativement récente, car il présente les formes undecimw, duode-cimus, et non undécus, duodecus qui répondraient aux formes des noms de nombre équivalents en sanscrit et en zend. Mais il ne poursuit pas plus loin la série de ces formations et, au lieu de Iredecimus, il dit tertim decimus2. Le latin octav-w, le grec oyèoF-os ne sont pas moins mutilés que les mots sanscrits et zends terminés en dasa qui viennent dêtre mentionnés . on aurait dû s’attendre à trouver octomus, oySofxos; mais ils nont conservé du suffixe ordinal que la voyelle finale.
Cette rencontre entre le latin et le grec est d’autant plus surprenante que, pour les autres noms de nombre ordinaux, le latin se tient bien plus près que le grec des langues congénères de l’Asie : c’est ce que nous voyons par les noms de nombre ordinaux au-dessus de «vingt», lesquels prennent le suffixe complet sitnu-s (venant de timu-s - tama-s) ; exemples:
> La forme puMÔ est pourpufitô. (Voyez S 34, et Burnouf, Yaçna, notes, p. 44
etsuiv.) . • i
2 C’est ainsi que dans les langues germaniques, à partir de «treize», les noms
de nombre cardinaux renoncent à la composition avec lif.
24G NOMS DE NOMBRE.

NOMS DE NOMBRE.

vicêsimus ou vigêsimus, trigêsimus; comparez en sanscrit vihsati-iarnd-n, Irinsattama-s1. Le latin rejette la syllabe nli ou nta des primitifs et, par compensation, allonge la voyelle précédente, qui devient é2. Dans les noms de nombre ordinaux comme tixo-trlis, rpiaxoalés, le grec présente le suffixe superlatif correspondant à isia : l’i de laloe est supprimé, comme dans sm-aloe, ix6-aîos (comparez êxaio-alés). Ainsi que le latin, le grec a retranché du nombre cardinal la syllabe n, ai ou via.
Les langues germaniques, à partir de «vingt», prennent aussi le suffixe superlatif. Nous avons, par exemple, en vieux haut-allemand, drî-zugôsto «trentième», fior-zugosto «quarantième». De «quatre» à «dix-neuf», nous trouvons, dans les langues germaniques, le suffixe tans : le n est le complément inorganique qui vient s’ajouter aux adjectifs faibles (§ 285)4. Comme exemple d’un nom de nombre ordffial, en gothique, comparez jtmftan (nominatif masculin fimfta)5 au grec isép.Tt'lo-s et au védique pancata-s.
1 On peut aussi, en sanscrit, former ces nombres et les nombres suivants d’après l’analogie de êkâdaiâ-s «onzième»; exemples : vinsd-s, trinid-s. Je ne connais pas, en zend, d’exemples de noms de nombre ordinaux au-dessus de «vingt».
2 A l’égard de la suppression d’une partie du primitif, on peut rapprocher les formations de comparatif examinées au S 298*.
3 Ou dan, suivant la nature de la lettre qui précède (S 91).
1 C’est, en effet, la déclinaison faible que suivent, dans les dialectes les plus anciens, les noms de nombre ordinaux, excepté «un» et «deux». Au contraire, en allemand moderne, on les'peut décliner comme des adjectifs forts (S 286). On a, par exemple, vierter «quatrième»,fünfter «cinquième», à côté de vierte, fünfte.
5 Dans les composés comme Jimftataihunda «quinzième», le plus petit nombre a conservé le thème primitif, encore exempt de la lettre n qui est venue s’ajouter plus tard (car dans ces composés on ne fléchit pas le plus petit nombre), ou bien fimfta est l’abréviation régulière du thème Jimftan, les thèmes en n rejetant cette lettre, en gothique comme en sanscrit, quand ils se trouvent au commencement d’un compose.

NOMBRES ORDINAUX. S 322.
247
& 3aa. Suite des noms de nombre ordinaux.

Du thème affaibli dvi «deux» (S 3oq) et de tri «trois» contracté en tr, le sanscrit forme les noms de nombre ordinaux dvitïya-s, trtiya-s, qui, en zend, deviennent bitya, ’tritya. La semi-voyelle y, dans les formes zendes en question, n’a pas changé le t précédent en aspirée, ce qui prouve que la syncope qui a amené le rapprochement des deux lettres est de date relativement récente (§ liy). Comme le zend s’est séparé du sanscrit à une époque moins reculée que les autres langues congénères, nous pouvons admettre que le suffixe sanscrit tîya a été lui-même précédé d’une forme tya dont il est un élargissement1. Peut-être y avait-il à côté de dvitïya-s, trtiya-s, des formes simples comme dvita-s, trta-s ( tri-tas )2 ; on pourrait alors regarder dvit’-ïya-s, Irt’-ïya-s comme des formes dérivées de dvita-s, trta-s à l’aide du suffixe ya (élargi en îya). C’est ainsi que catûr « quatre » a donné à la fois comme noms de nombre ordinaux catur'tâ-s, tur-ya-s (ou tur-ya-s) et tur-îya-s (ces deux derniers avec perte de la syllabe initiale). Â türya ou tûrya se
' Rappelons Pt inséré devant le suffixe comparatif ydris (S 298b) qui devient
îydm.
a On ne saurait citer comme preuve de l’existence de ces formes les noms des divinités védiques dvitd, trild (à côté desquels on a aussi êkatâ). En effet, quoique ces dieux soient ainsi nommés à cause de l’ordre où ils sont venus au monde (voyez le mythe exposé par Kuhn dans le Journal de Hôfer, t. I, p. 276 et suiv.), le suffixe joint au nom de nombre,peut avoir dans ces mots une signification très-générale. C’est ainsi qu’en allemand les mots zaeiev, dreier, sechser, zelmer, elfer ont pu prendre les acceptions les plus diverses. II n’est, guère probable qu’on ait jamais appelé en sanscrit «le premier» êkatd-s au lieu de pratamds ($ 321), car les langues de l’Europe tirent, presque toutes le nombre ordinal correspondant d’une préposition, et aucune ne le dérive du nombre «un». Mais, quoi qu’il en soit, le sanscrit tritâ-s n’en est pas moins, sous le rapport de la forme, l’image du nombre ordinal grec rpho-s. [Le mot sechser cité dans cette note désigne à la fois le chiffre 6 et une pièce de monnaie; le mot zelmer peut signifier un membre du Conseil des dix; le mot elfer s’emploie pour le vin de 1811, etc. — Tr.]


rattache le zend tûirya (S k 1), ce qui confirme l’hypothèse que IV du sanscrit turïya est. une insertion inorganique. A trlïya-s, ou plutôt à la forme organique tri-tya, qui a disparu, se rattachent le latin ter-tiu-s (venant de tri-tiu-s), le borussien tîr-ti-s (accusatif tîrtia-n = sanscrit trtiya-m), le lithuanien trecia-s, par euphonie pour tre~tias (§ 9211), le gothique thri-djan, thème élargi par l’addition d’un n (nominatif masculin thri-dja), et le vieux haut-allemand dri-tton, par assimilation pour clri-tjon. En ancien slave, IV du thème primitif trelijo, d’où vient, dans la déclinaison déterminée, le génitif TpeTHranro tretija-ago1, est une insertion relativement récente, comme IV du nominatif pluriel gostij-e, ou celui du génitif duei gostij-u (§ 273), venant du thèmegosti. En général, les noms de nombre ordinaux, sauf quelques rares exceptions, n’ont en ancien slave que la déclinaison déterminée, c’est-à-dire renfermant le thème pronominal jo = sanscrit y a. Ainsi cetvrutü-j2 (ou éetvrütû), féminin cetvrü-
ta-ja, neutre éetvrüto-je, se rattache par sa première partie au thème sanscrit catur'td, féminin catur'td, ou plutôt, comme le lithuanien ketwlrta-s, à la forme catvâr-ta que devrait donner le thème fort catvar3. De la même manière, pah-tü-j « qui n tus», ses-tü-j « sextus », sed-mü-j « septimus », os-mü-j « octavus », ou pantü, sestü, sedmü, ostnü, se rattachent aux thèmes sanscrits paned-ta (forme védique), sas-ÿl4, sapta-md, asta-md, zend astë-ma. Au contraire, devah-tü-j (pour nevah-lü-j) «nonus » et desan-tü-j «decimus» s’accordent mieux, en ce qui concerne leur suffixe ordinal tô to, avec le grec ëvva-To, Séxa-m et le gothique niun-dan, taihun-dan qu’avec le sanscrit nava-md (zend nâuma),
1 Matthieu, XXVII, 64.
a Venant par métathèse de cetvürtü-j, pour fatvartü-j.
a C’est à cette forme tatvdr-ia que se rapporte aussi ie grec -cérapTos, venant de
xerF ttptos.
* Zend Ustva par métathèse et syncope pour Uivas-ta. Après le s, la dentale du suffixe ordinal est nécessairement une ténue (S 38).
NOMBRES ORDINAUX. § 323.

249

dasa-md, à côté desquels on pourrait s’attendre à trouver aussi, dans le dialecte védique, nava-îa et dasa-ta, d’après l’analogie de paAcd-ta, saptd-ta. La dénomination du «premier», prüvü~j, par mélalhèse pour pürvü-j, s’accorde avec le thème sanscrit piïrva «antérieur», zend pauurva «premier». On a des
exemples de l’expression slave fléchie d’après la déclinaison indéterminée, particulièrement au génitif singulier neutre pruva1. Pour le nom de nombre ordinal «troisième», nous avons aussi un reste de la déclinaison simple ; c’est le génitif tretija «ter-tii», qu’on peut rapprocher du génitif composé tretija -ago qui vient d’être mentionné. L’altération en e de l’i du nombre cardinal Tpri <n'264 265 n’est pas sans exemple; ainsi noêti «nuit» fait noste au commencement des composés : noste-vorïstvo « vvxrco-jjiayja», noste-dïnïstvo «.vuxti{pspovv. De plus, les thèmes en i affaiblissent cette voyelle en e ou en ï devant différentes désinences casuelles266.
S 3a3. Féminin des noms de nomhre ordinaux. — Noms de nombre ordinaux en arménien.
A partir du « cinquième », le sanscrit forme le féminin de ses nombres ordinaux à l’aide du caractère féminin t, au lieu d allonger simplement l’a final du thème; exemples : pancamî', sasli, saptarai, etc. Il est probable qu’à l’origine il y a eu aussi des formes comme saptamiï, ainsi que semblent le prouver les langues congénères, car nous avons en latin seæta, en grec emn, en lithuanien seità, en ancien slave sesta (dans le composé sesta-ja). Je ne connais pas d’exemple, en zend, de noms de nombre ordinaux au féminin.

250

L’arménien, qui ne distingue pas les genres, fait terminer ses noms de nombre ordinaux, au nominatif-accusatif singulier, en npij- ord ( thème orda ou ordi). Il faut excepter quelques mots signifiant «le premier» et les formes secondaires en ir qui existent à côté de erkr-ord Rsecundus», err-ord r terlius », savoir erkir, erir. Petermann1 rapproche la syllabe ord du substantif npufi ordi2 rfils». La racine de ce mot est le sanscrit avd', ri rcroître», auquel évidemment il faut joindre nid' (forme primitive de ruh, qui signifie également « croître»). A rud' correspond la racine gothique lui (même sens), d’où vient lauths, génitif laudi-s rhomme», vieux haut-allemand lut rpeuple», luti Ries gens». De ces mots nous pouvons rapprocher, en ancien slave, na-rodü r peuple», en ancien celte rhodora (nom d’une plante). C’est une observation générale que les racines qui signifient r croître» sont fécondes en mots voulant dire r homme» (à tout âge), ou r peuple», ou r plante, arbre»3. Nous pourrions donc prendre l’arménien ord, à la fin des noms de nombre ordinaux, dans le sens de r personne» et traduire, par exemple, jiwn.npq. qarord par r quatre-personne », c’est-à-dire la personne ou l’objet qui est nommé d’après le nombre r quatre» ou qui est en rapport avec ce nombre. Mais pour expliquer ord, on s’adressera peut-être avec plus de raison au sanscrit ard'd-s /qui vient également de la racine ard', ri Rcroître»); arià-s signifie ordinairement Rmi, moitié», mais,
' avec l’accent tonique sur la première syllabe, il veut dire aussi r partie, endroit, contrée, village»4 : qar~ ord (thème
1 Grammaire arménienne, pi î(ia.
3 Nominatif-accusatif singulier. La seconde série de cas prend pour thème ordvo et ordea.
3 Je rappellerai encore le gothique mag-us «garçon», mavei (forme mutilée pour rnagvei) «fille», magath «virgo»; l’irlandais mag «fils», macamh «garçon». Ces mots se rapportent à la racine sanscrite manh «croître».
4 Weber (Etudes indiennes, 1.1, p. aaq) rapproche avec raison de celte forme
ADVERBES NUMÉRAUX. S 32A. 251


àar-orda ou qar-ordi) signifierait donc littéralement «quatre-place», c’est-à-dire «qui a la quatrième place [dans la série des nombres] ».
La plupart des nombres ordinaux ajoutent encore, en arménien, au nombre cardinal la terminaison er; peut-être cette syllabe er se rattache-t-elle à la désinence r du génitif singulier des pronoms démonstratifs (ais-r «hujus») : hhig-er-ord « cinquième» signifierait alors sla personne [ou chose, ou place] de cinq». On a de même aragn-er-ord «premier», à côté duquel on trouve aussi, sans la désinence du génitif, aragn-ord, ou simple- • ment avagin, dont IV est supprimé dans les composés.
ADVERBES NUMERAUX.
S 3a4. Les adverbes numéraux en sanscrit, en grec, en latin et en lithuanien.
Il a déjà été question (§ 3og) des adverbes qui signifient «deux fois, trois fois, quatre fois». A partir de «quatre», nous trouvons en grec le suffixe »us, dans lequel je crois reconnaître le sanscrit sas (venant de kas). Ce suffixe se combine surtout avec les mots exprimant un nombre élevé ou désignant une multitude ; exemples : satasàs « par centaines », sahasrasds « par mille », ganasds «par troupes», sarvasds «totalement». Réuni à bahé «beaucoup », sas a tout à fait le sens du grec xts; bahusds «beaucoup de fois, souvent » équivaut au grec ssoXkdxts. Le contraire de balmas est exprimé en sanscrit par alpasds (venant de dlpa «peu») et en grec par bhydxts; dans ce dernier, comme dans ’BsolXolxts, c’est le pluriel neutre qui sert de thème.
Le £ de awa£ est peut-être un reste de xts qui a rejeté la
l’allemand ort «endroit», en anglo-saxon ord. Peut-être aussi le latin a-t-il lire de celte racine le mol or do.
252 NOMS DE NOMBRE,


voyelle; on pourrait alors diviser ainsi : àhra-Z, et regarder le tt comme tenant la place d’un x. De cette façon, on aurait dna qui représenterait, comme éxa dans èxchepos, eKaaios, le sanscrit ê'ka; l’adverbe aita-Z correspondrait au sanscrit êka-sas (venant de aika-kas), avec cette différence que le mot sanscrit signifie k un à un» et non «une fois ».
Les adverbes numéraux, en latin, ont pour suffixe iès ou, sous une forme plus complète, iens; le môme suffixe se trouve dans les adverbes pronominaux totiens, toties, quotiens, quoties, aliquotiens, ahquoties1. L’explication qui me paraît la plus viai-semblable est celle qui rattache iens, tes au suffixe sanscrit vaut (forme faible vat) : combiné avec les thèmes pronominaux, vaut a le sens de «beaucoup » (§ &09 et suiv.); avec les substantifs, il signifie «ayant» ou «pourvu de»2. La représentation la plus fidèle du sanscrit vant serait en latin, au nominatif des trois genres, vans ou vens3 : mais v, après les consonnes (excepté r et l), devient u; nous avons donc ums qui, par 1 1 changement de l’« en i dont il existe de nombreux exemples (comparez fructi-bus), peut devenir iens. Nous regardons les adverbes en question, non comme des nominatifs, mais comme danciens accusatifs neutres.
A partir de «cinq», le sanscrit exprime l’idée de «fois» par krtvas; exemple : pancakrtvds «cinq fois». Dans le dialecte védique , krtvas est séparé du nom de nombre et celui-ci garde l’accent qui lui est propre; exemples : pdnca krtvas, ddsa krtvas. D’accord stvec Bôhtlingk et Roth4, je reconnais à présent dans
1 II faut ajouter l’adverbe pluries, dans lequel il y aurait un double suffixe comparatif, si l’on expliquait, comme le fait Aufrecht (Journal de Kuhn, t. I, p. ia5), la syllabe iens , ies, par le suffixe comparatif sanscrit yâns, îyans.
s Suc la forme qu’a prise, en latin, le suffixe sanscrit vant avec les substantifs, voyez SS ao et 957.
3 Comparez ferens avec le zend barani, S t38.
* Dictionnaire sanscrit, II, p. 4o3. ,
ADVERBES NUMÉRAUX. S 325. 253


ce mot l’accusatif pluriel d’un thème substantif krtu1, venant de la racine kar, kr «faire»; de là aussi l’adverbe sakrt «une fois» (proprement «faisant un»).
Je rapporte à la même origine le lithuanien kar-ta-s «fois», qui était originairement un participe signifiant «fait». Comme le védique krtvas, le lithuanien kartas est employé à l’accusatif; mais il peut être mis au singulier ou au duel aussi bien qu’au pluriel. Exemples : wênah kàrtan «une fois», du kariù «deux fois », tris kartùs « trois fois », keturis kartùs « quatre fois » 2. L’ancien slave KpdTSi kratü (par métathèse pour kartü), quand il est précédé de düva (düva kratü «deux fois»), est, selon moi, 1 accusatif duel du thème (= védique krtü)3-, mais après tri (itri kratü «trois fois»), la même expression est l’accusatif pluriel d’un thème en o, formé d’après l’analogie de vlükü «lupos», novü «novos» (§ 275); en général, les thèmes primitivement terminés en ü peuvent à tous les cas passer dans la déclinaison en 0 (§ 268). Après les nombres supérieurs à «trois», le substantif est à l’accusatif singulier, au moins dans le composé sedmï-kratü «sept fois», qui est peut-être la seule expression de ce genre dont il y ait des exemples4.
§ 3a5. Adverbes sanscrits en d'à comparés avec tes adverbes grecs
en x*.
A l’aide du suffixe ià, le sanscrit forme des adverbes qui correspondent, quant au sens, aux adverbes grecs en ya. Y répondent vraisemblablement aussi quant a la forme, car les
1 Sur les accusatifs pluriels védiques en os, venant de thèmes en u (comme en grec vixv-as, yévv-as), voyez S a38.
4 On peut aussi supprimer l’a de l’accusatif pluriel et dire Iris karts, kéturis karts, etc. Cette forme mutilée de l’accusatif pluriel s’emploie également au duel au lieu de kartù; on a donc du karts à côté de du kartu.
3 Comparez sütiü «deux fils» (S ay3 ) = sanscrit sunû, lithuanien sviiu. ,
* Voyez Miklosich, Radiers, p. 3g, et Lexique, p. 6/1.
254 NOMS DE NOMBRE.



aspirées des différents organes permutent volontiers entre elles. Comparez dvi-da, tri-ia. catur-da, panca-da avec Sl-ya, tpl-yct, ■téipa-ya, vsévta-ya.. Les formes hyÿ, Tpix»7, rsTpaxv, ayti, qui ont une voyelle longue et l’accent sur la dernière, sont encore plus près des adverbes numéraux sanscrits.

s

PRONOMS.

PREMIÈRE ET DEUXIÈME PERSONNE.
S 326. Thèmes et déclinaison des pronoms personnels.
Toutes les langues indo-européennes s’accordent sur ce point quelles ne font pas la distinction du genre pour les pronoms de la première et de la deuxième personne267.
Ces mêmes langues se rencontrent encore d’une façon remarquable, en ce qu’elles emploient au nominatif singulier de la première personne un autre thème qu’aux cas obliques.
Le nominatif du pronom de la première personne est en sanscrit afjtdm, en zend asëm, en grec êyoi, en latin ego, en gothique ik, en lithuanien as, en ancien slave asü, en arménien es.
Le m de ahâ-m appartient à la désinence ; il en est de même pour celui de tva-m «tu»2. .L’éolien êydv représente en-

core mieux que èyâ le sanscrit andrn; je préférerais toutefois une forme êy6v, qui permettrait d’expliquer la longue dans syco comme étant une compensation pour la suppression de la nasale. Il est possible, du reste, que la forme mutilée èyé ait réagi sur la forme plus complète èyév et lui ait transmis sa voyelle longue. Dans la plupart des autres langues européennes, non-seulement la désinence, mais encore la voyelle finale du thème a disparu. C’est ce qui est arrivé aussi pour la seconde personne : comparez le latin et le lithuanien tu, le grec ai, tu, le gothique thu, l’ancien slave tsi iü et l’arménien y-m- du au sanscrit tva-m; on voit que dans toutes ces langues la voyelle tient la place du v sanscrit. En zend, nous avons la forme complète tûm (§ 42)
que le béotien toiv suit de très-près, si le v, dans ce mot, ap

partient au pronom1.
Les cas obliques du singulier ont en sanscrit, à la première personne, le thème ma, et, à la deuxième, le thème tva qui sert en même temps pour le nominatif. Ces thèmes s’élargissent à certains cas par l’immixtion d’un i (comparez § 158), et deviennent mê, tvê. Au contraire, le datif remplace tva par la forme mutilée tu et fait tû-Byam au lieû de tva-byam. Au thème ma correspond le grec pto, qui est là forme fondamentale du génitif (jlov et du datif floi. L’e de e>o est prosthétique : le grec aime à placer une voyelle devant les formes commençant par une consonne, comme on peut le voir en comparant Ôvofue, à Bois, iÇipis,
\ ..\Xv
àda<ld-m «je donnais» (èêlSa>-v), dad’-yX-tn «je donnerais» (SiSo-tv-v), et, d’un autre côté,la désinence atndans les formes comme dstr-nav-am «je répandais», au lieu de attr-nô-m (comparez èalàp-vo-v).
1 11 se pourrait que le v de toiv fût un reste de la particule annexe vv qu on rencontre dans le dôrien tô-ihj et le laconien Tou-iof. Dans cette hypothèse, le v de èydiv pourrait également être rapporté à vr7. Mais, d’un autre côté, vit peut être expliqué, aux deux premières personnes, comme issu du signe casuel v = sanscrit m, auquel serait venue s’adjoindre une voyelle complémentaire (à la façon des accusatifs gothiques eu na) ou une particule annexe ».

320.
257
skayÿs, ipvOpôs, âvv'p au sanscrit nama « nom », ddnta-s « dent », drû-s r sourcil », lagû-s r léger », rudtrd-m r sang », Mar r homme w. L’o de (jlo , êjxo est souvent remplacé par un e : on a, par exemple, e’ftsïo, èyéOevpour s’ftdto, è(i6-0ev (comparez zsôOev, cDj.oQsv, etc.); ifiso pour s’[â6o1; susv , pieu pour e’ptoû, fiov. Dans les formes éoliennes et doriennes e’pteDs, êuovs (comparez -revs, tsovs), le a est un complément ajouté postérieurement, à une époque où l’on ne pouvait plus se douter que ce <y, destiné à exprimer le génitif, avait autrefois existé, non pas à la fin, mais au milieu du mot (§189). O11 peut rapprocher, à cet égard, le s qui est revenu, en allemand moderne, dans les génitifs comme herzens (§ i43, 1). A l’accusatif dénué de flexion jze, è(té, nous avons e au lieu de 0 pour la même raison qui fait qu’au vocatif on a mus au lieu de ’iirno (§ 2où). En ce qui concerne la perte de la nasale de l’accusatif, il faut rappeler qu’à côté des formes sanscrites mâm, tvâm on a aussi les formes mâ, tvâ sans signe casuel, ni accent; c’est peut-être la suppression de m qui a été la cause première de l’allongement de l’a, en sorte qu on pourrait appliquer à mâm, tvâm l’explication que nous avons proposée plus haut pour êyûv au lieu de sySv-, Les accusatifs latins mè et tê prouvent également que la suppression de la flexion est très-ancienne. ,
Remarque. Le nominatif du pronom de la première personne. — D’accord avec Benfey \ je vois dans la syllabe ha de ahd-m la particule ha
1 D’après les règles de contraction ordinaires, pour passer de la forme ïrnoio à îa forme iWou, il faudrait admettre, après la suppression de l’i, une forme intermédiaire ïm$o.
2 On pourrait supposer aussi que l’a dans mâm, tvâm a été allonge parce que ces formes sont monosyllabiques, quoique l’ablatif mat, tvat, qui est monosyllabique également, soit bref. Il est possible encore que mâm, tvâm contiennent l’enclitique ha, dont il va être question, et soient pour maha-m, tvaha-m (voyez Benfey, Lexique des racines grecques, I, pages xiv et suiv. ).
3 Lexique des racines grecques, I, p. xiv et suiv.

11.
‘7
PRONOMS.

258

qui est venue sg souder au thème pronominal ci. Cette particule, qui est ordinairement sans accent, se rencontre aussi dans les Védas sous la forma U, §■« et gd : elle est souvent jointe aux pronoms, comme en grec le mot congénère ye (dorien et éolien ya.'). C’est la même particule que nous retrouvons dans les langues germaniques à l’accusatif singulier des trois pronoms dénués de genre (gothique mi-k, thu-k, si-k), et, en vieux haut-allemand, à l’accusatif pluriel unsi-h «nous», iwi-h «vous». Les gutturales Je, h sont ici les substituts réguliers du y grec. On rencontre aussi en afghan des restes de cette particule annexe, laquelle est devenue ou est restée déclinable dans cette langue; on a au nominatif masculin hagha «il, celui-ci» = védique xâ-ga ou sâ-gâ, grec Ôye ; pluriel haghû; nominatif singulier féminin haghê268 269.
On a dit plus haut que le thème du nominatif singulier n’est pas le même que celui des cas obliques, ni que celui du nominatif pluriel et duel. Je mentionnerai ici un fait analogue qu’on observe dans les langues de la mer du sud. En nouveau-zéelandais on a au singulier ahau «je» (comparez le malais âkû, le javanais aku, le tagalien aco, le madécasse ahau, z-aho, z-ao)\ mais au pluriel on a ma-tu (littéralement «moi trois») et en parlant de deux ma-ua (littéralement «moi deux»). Ua est pour dua qui signifie «deux» (ensanscrit dva)270.
g 337. Les pronoms personnels en grec et en gothique.
Le thème de la seconde personne tva prend en grec la double forme erv et cto (pour ct/’o); dans ou, cest la voyelle, dans <ro, c’est la semi-voyelle qui a été supprimée. L’o de cto est remplacé par un e (S 326) dans veto, oéOev, etc. Dans la forme homérique isoh, popr *.Teo-(<r)«o271, Ys représente ou bien le F qui s’est résolu en voyelle, ou bien l’u qui s’est aminci comme
PHONOMS PERSONNELS. S 328. 259


dans pour 'zsrjyy-os ; ^eoîo suppose donc un ancien
rroffio ou tvoaio, qui répondrait parfaitement au zend twa-hyâ
(§ 188).
Le gothique a affaibli en i la du thème ma, et contracté en u le va du pronom de la seconde personne; on a, par conséquent, mi, thu, datif mis, thus (§ 172), accusatif mi-h, thu-k (§ 396, remarque).
Le sanscrit, contrairement à ses lois de formation habituelles, fait au génitif mâma, tâva. La première forme a l’apparence d’un redoublement; mais le zend, au lieu de marna, nous donne mana.
La syllabe na, en gothique, a si bien pris le caractère dune flexion qu’elle s’est introduite aussi à la seconde et à la troisième personne : mei-na, thei-na, sei-na. Je regarde thei-na, sei-na comme des formes mutilées pour thvei-na, svei-na. Le thème est thva et non thu, lequel aurait fait thuna; mais de même que ma est devenu, en gothique, mi, et par allongement mei(= mî), de même tva est devenu thvi et thvei (= thvî). Il y a donc, en ce qui concerne le thème, entre le génitif iheina (pour ïhveina) et thu le même rapport qu’entre le grec aav (de a-Fov) et ou, ou entre reu (de t Fsu) et tu.
§ 328. Les pronoms personnels en latin.
Le latin a, comme le gothique, affaibli ma en mi : par suite de ce changement, le pronom de la première personne a passé, en quelque sorte, de la seconde déclinaison, à laquelle il devait appartenir (§ 116), dans la troisième. Nous avons au datif mi-ln en regard de md-hyam, venant de ma-hyam (§ 215, 1);
à l’accusatif, mê (pour mem) au lieu de mu (pour mwm); à l’ablatif, mê (venant de med) au lieu de mô (venant de mod=sanscrit mat ).
Le génitif met représente (§ 200) le locatif *4fil nuiy-i (par
*7-
PRONOMS.

260

euphonie pour mê-i) et appartient, par conséquent, au thème élargi % mê 1. A la seconde personne, on devrait s’attendre à trouver, par analogie avec met, une forme tveî, qui répondrait à «srfa tvdy-i: cette forme, qui, plus anciennement, a pu exister en effet, est devenue impossible dans le latin tel qu’il nous est parvenu, car le v ne peut plus y être précédé dune consonne autre que q, g, r ou l. Toutes les fois que le v est précédé dune autre consonne que l’une de celles que nous venons de citer, ou bien il se résout en u, avec suppression de la voyelle suivante, comme dans sudo qui répond au sanscrit svid « suer », ou bien il disparaît, comme dans canis qui répond a svan «chien», dans sonus (pour svonus) qui répond a svana-s «ton»; ou bien encore il fait tomber la consonne précédente, comme dans bis, pour dvis (S 309).
Ti-bî est de même, pour tvi-bî, En effet, quoique le datif sanscrit soit tü-Byam, et quoique le changement de Tu en i ne soit pas rare en latin272 273, je ne crois pas que la contraction sanscrite de tva-Byam en tü-Byam soit de date assez ancienne pour qu’on puisse rapporter à cette dernière forme le latin ti-bi. Je considère tibi, sibî comme des formes mutilées pour tvi-bî, svi-bi, et non comme des altérations de tu-bî, su-bî.
§ 399. Formes sanscrites secondaires me, tê. — Leur origine.
Nous avons en sanscrit, à côté des génitifs marna, tava, et des datifs mdliyam, tüByrim., les formes privées d accent mê, tê, qui servent également pour le génitif et le datif. J ai reconnu, il y a
PRONOMS PERSONNELS. S 330.

261

longtemps, que tê est pour tvê; ma conjecture a été justifiée depuis par les Védas274, où nous trouvons tvê, et par ie zend qui présente la forme ft»dt. On trouve de plus, en zend, les
formes mutilées toi et gy» tê, qui ont subi exactement la même altération que le latin ti-bî et le gothique thei-na. Quoique % mê et % tvê servent de forme fondamentale à plusieurs cas (S 3q6), il ne faudrait peut-être pas les regarder pour cela, non plus que tê, là où ils sont employés en guise de génitifs et de datifs, comme des thèmes à l’état nu; il répugne, en effet, au génie de la langue d’introduire dans le discours des thèmes sans flexion aucune. On peut les considérer comme des locatifs formés d’après l’analogie des thèmes ordinaires en a (§ 196), d’autant plus qu’en sanscrit le locatif prend très-souvent la place du datif2. Si mê, tê, tvê et les formes zendes correspondantes sont en effet des locatifs, ils sont identiques avec les datifs grecs (tôt, aol,, t0/ (§ 19®)'
S 33o. Les pronoms personnels en lithuanien, en ancien slave - et en arménien.
tes génitifs marna, *J*6 mana et tdva (§ 327) servent, en lithuanien^ de forme fondamentale aux cas obliques du singulier : il en est de même en ancien slave, excepté à l’accusatif, à l’ablatif et au génitif. Les cas où l’on reconnaît le mieux ces formes sont l’instrumental et le locatif lithuaniens ■manimi, manyjè (y = î), tawiml, tawyjè. On voit que 1 a final a été affaibli en t. Le génitif, le datif et l’accusatif sont nianehs, tawehs; man, taw; manèh, tawèh; quoique de formation irrégulière, ils dérivent également de l’ancien génitif. En ancien slave, les accusatifs ma man, ta tan ont conservé la forme

202

primitive et répondent a *i t«i^ mam «mo», tvuni «te»,
avec suppression du v dans la seconde personne. Le génitif mene «de moi» correspond exactement au zend mana, et tebe « de toi » au sanscrit et zend tava. Si 1 on se renfermait dans la grammaire slave, il faudrait, au contraire, regarder men, teb, comme le thème, et faire de l’e la désinence ordinaire du génitif (§ 96g). Le datif—locatif ftCHt münê, teg’è tsbs, a évidemment pour thème müno, tebo. Le datif, s il avait conservé une forme a part, devrait, dapres le S 967, münu, t&bu. Mais le locatif, dans ces pronoms, sert aussi pour le datif.
En arménien, le pronom de la première personne a im ou in pour thème des cas obliques du singulier1. Le génitif est m, sans désinence casuelle : le même fait a lieu pour d autres thèmes terminés par une consonne (par exemple akari «oculi», dster «filiæ»). Le datif /&«? in-{ a déjà été expliqué (§ ai5, 1). L’ablatif ffhlfh inê-n2, une fois le n enclitique (§ i83\ 4) supprimé, correspond à akan-ê, dster-ê. A l instrumental, on s’attendrait à avoir im-b; mais on a in-e-v, dont l’e est probablement une voyelle euphonique comme celle de iur-e-v (comparez le génitif iur).
11 reste à nous demander quelle est l’origine des thèmes obliques im,, in : je regarde in comme une altération pour im, dont le m se rattache, évidemment au theme sanscrit et zend ma; mais il est difficile de décider si im est une métathèse pour mi qui lui-même serait une forme affaiblie pour ma, ou si 1 «
1 Excepté à l’accusatif et à l’instrumental. En arménien, l’accusatif singulier est presque constamment identique au nominatif, sauf l’article qui est préfixé au premier de ces cas. Il y a toutefois cette différence pour le pronom en question qu’au lieu de l’e de es «je» nous avons à l’accusatif un i (j-i's «me»). Ce change-mentde voyelle a peut-être été amené par l’influence des autres cas obliques, qui ont tous un ».
a Avec la préposition préfixe de l’ablatif : h-inê-n.
' PRONOMS PERSONNELS. S 331. 263


du thème primitif a été supprimé, et Pt ajouté comme lettre prosthétique1.
Pour la seconde personne, le thème des cas obliques du singulier est j>lr qe, et qo au génitif dénué de flexion. L’e de l’instrumental qe-v appartient ici incontestablement au thème. L’ablatif est qê-n, avec allongement de la voyelle finale du thème, comme dans la déclinaison sanscrite et zenue des thèmes nominaux en a {àsvâ-t, aspâ-d). Dans le .p <j je reconnais, ainsi que j’en ai déjà fait l’observation?, le v du thème sanscrit tva : la dentale initiale s’est perdue après le durcissement du v275 276 277.
Sur l’origine de la désinence du àatii^.tnpqe-s, voyez § 215, 2.
S 331. Pourquoi le pronom de la première personne a un autre thème au pluriel qu’au singulier.
Dans la plupart des langues indo-européennes, le pluriel du pronom de la première personne a un autre thème que le singulier. J’ai déjà essayé ailleurs de donner 1 explication de ce fait278 : c’est, je pense, que le moi ne peut pas, à proprement parler, avoir un pluriel, car il n’y a qu’un moi. Quand je dis «nous», j’exprime une idée qui comprend à la fois le moi et un nombre indéterminé d’autres individus qui ne sont pas moi; ils peuvent même appartenir chacun à une autre espèce. Au contraire, quand je dis «leones», j’exprime une pluralité d’individus dont chacun est un lion. La même différence se retrouve entre le moi et tous les substantifs, adjectifs et pronoms. En effet, quand je dis «ils», je multiplie la notion marquée par «il» au singulier. On peut même, à la rigueur, concevoir un
2g/| PRONOMS.

PRONOMS.

« loi » multiple : l’idée du moi, au contraire, ne souffre pas la multiplicité.
S’il est vrai pourtant que dans quelques idiomes «nous» soit exprimé par le pluriel de « moi », c’est là une sorte d abus de la langue : le sentiment de la personnalité efface alors tout le reste au point d’absorber et de laisser sans dénomination tout ce qui n’est pas le moi. Il n’est pas impossible q 136 16 nominatif sans— crit vaydm «nous» (venant de vê + arn) se rattache originairement au thème singulier H mê (§ 326); m et v permutent fréquemment, et le changement a pu se produire ici d autant plus aisément qu’il avait, comme nous venons de le montrer, sa raison logique. Ajoutons toutefois que, si ces deux thèmes ont la même origine, la différence qui s’est établie entre le singulier et le pluriel doit être ancienne, car nous la retrouvons dans les langues germaniques : or, une rencontre de ce genre s’expliquerait difficilement par le hasard1. ,
§ 33a. Pluriel du pronom de la première personne en sanscrit et en grec.
Dans le sanscrit ordinaire, tous les cas obliques du pronom de la première personne sont formés, au pluriel, du theme astna. Dans les Védas, on trouve, en outre, à côté de vaydm, le nominatif asmê'-. C’est au thème asnm que se rapporte aussi le pronom grec; en effet, la forme éolienne, qui est la plus pure, à'ptptss, vient par assimilation de àafxes (comparez § 170)’ cornm(! èfxfii de êa-fii, en sanscrit dsmi «je suis». Pour répondre au védique asmê', on devrait avoir âpfloi et non dtfifzes, attendu que
1 On trouve en pâli la forme mayam «nous» (Ciough, Grammaire pâlie, p. 61), qui est peut-être simplement un retour à la forme, primitive par suite d’une nouvelle permutation de lettres. C’est ainsi qu’en vieux haut-allemand la troisième personne du pluriel a recouvré son ancien t, par suite de la seconde substitution de consonnes; ou a, par exemple, berant «ils portent», en regard du gothique bairand, du sanscrit VAranti, du doricn pépovn, du latin ferunt. .
* Sur la formation de ce pluriel, voyez S 2281.
PRONOMS PERSONNELS. S 33 3.

265

le thème usma ferait en grec da-po (S 116); mais la forme grecque, renonçant à l’ancienne voyelle finale, a passé dans une autre déclinaison. 11 en est de même pour types par rapport au védique yusmé'. De leur côté, vpsîs, vpeïs supposent un thème tyi, vfu, dont î’i doit être considéré comme un affaiblissement de l’a de asrnd, yusmà, de même qu’en gothique nous avons unsi, isvi (§ 167) à côté de misa, leva, G est aussi a des thèmes en i qu’il faut rapporter les génitifs àppé-uv, typs-uv (pour dppi-eov, vppt-uv), et, dans la langue ordinaire, ijpûv, vpuv. Même observation pour les datifs vpîv, vpîv, venant de vpt-iv, tyi-tv; iv tient la place de la désinence indienne byam dans asmdhyam, yusmâEyam (§ 215,1). Les accusatifs vpas, vpiïs, qu’on peut comparer aux accusatifs sanscrits asma-ns, yusma-ns, sont formés de vpa-vs, vpa.-vs, de la même manière que pélâ-s est formé de péXav-s (comparez § a36). L’e des accusatifs éoliens dénués de flexion type, type, devra donc être considéré comme l'affaiblissement de l’a final du thème. Suivant la loi de formation ordinaire, npà-vs, tyà-vs auraient dû donner vpovs, vpovs, comme nous avons ïnnovs qui répond au sanscrit àsvâ-n, au gothique mlfa-ns et au borussien deiwa-ns.
S 333. Origine du thème pluriel et du thème duel du pronom de la première personne.
C’est la seule voyelle a qui, dans asmê'et types, est l’élément caractéristique de la première personne, car le reste du mot se retrouve dans le pronom de la seconde personne yusmé', types. Peut-être cet a n’est-il pas autre chose que l’a du thème singulier ma; il faudrait alors admettre que m est tombé par aphérèse, à- une époque très-ancienne, puisque le grec et les langues germaniques279 en sont privés comme le sanscrit et le

266

zend1. Si cette explication est fondée, nous pouvons arriver à déterminer la nature des éléments qui ont concouru à exprimer l’idée de «nous, vous». Remarquons d’abord que le pronom annexe sma ne se rencontre en sanscrit et en grec2 qu’au pluriel et non au singulier des pronoms de la première et de la deuxième personne; ce sma, qu’on trouve aussi à l’état isolé5, ne peut être autre chose qu’un pronom de la troisième personne. A-smê sera donc un composé copulatif (S 972) signifiant «moi [et] eux»; yu-émê signifiera «toi [et] eux». La réunion de l’élément singulier «moi, toi» et de l’élément pluriel «eux», l’un représenté par a et yu, l’autre par smê, aurait donc servi à marquer les idées complexes « nous » et « vous », qui ne pouvaient recevoir une expression plus naturelle, plus claire et plus complète.
Il ne faut pas s’étonner si un mot dont le sens étymologique est «moi et eux» a pris dans l’usage une signification assez générale pour désigner le moi toutes les fois qu’il est associé a d’autres individus4. Il est impossible au langage de créer des mots exprimant à la fois toutes les modalités de l’objet qui doit être désigné : il faut donc qu’il se contente de mettre en relief l’une des manières d’être les plus caractéristiques5.
asmd. Vu est dû à l’influence de la nasale, comme, par exemple, dans sibun «sept», nim «neuf», taihun «dix» = sanscrit sâpkm, nàvan, ddéan.
1 Benfey (Lexique des Racines grecques, I, p. i5t et suiv.) a adopté cette hypothèse que j’avais déjà exprimée dans la première édition de cet ouvrage. Il explique de môme le nominatif singulier a-hâm comme une forme mutilée pour mu-hâm.
1 Dans cette dernière langue, sous une forme plus ou moins altérée.
3 Employé isolément, sma n’a pas de sens appréciable, ou bien il sert à éloigner une action, en la transportant du présent dans le passé.
4 Le même mot est employé pour signifier, par exemple, «moi et eux, moi et elles, moi et vous», etc. — Tr.
« Ainsi l’éléphant est appelé hastm, c’est-à-dire pourvu d’une trompe (hdsta), quoique l’éléphant ait encore d’autres attributs qui le caractérisent. [Cette idée est plus amplement développée par l’auteur au S 537, remarque. — Tr.]
PHONOMS PERSONNELS. S 33h, 267


Le duel â-vâm «nous deux » est, à ce que je crois, une forme mutilée pour â-tvâm1. Il signifierait donc littéralement «moi [et] toi», quoique le plus souvent il soit employé pour signifier «moi [et] lui»2. L’a initial de â-vâm (si nous admettons cette explication) serait allongé en vertu de la même loi que Va dans les composés copulatifs indrâ-visnû « Indra [et] Vishnou » (S 9 7 2), indrâ-pAênôs «d’Indra [et] du Soleil» (§ 97B).
Nous venons de considérer la de asmê', âvâm, comme étant une mutilation pour ma. Mais quand même cette conjecture ne serait pas fondée, je ne croirais pas pour cela devoir renoncer à l’explication que j’ai donnée de la nature composée de ces pronoms. Je verrais alors dans l’a de a-smê', â-vâm, ainsi que dans celui de a-hdm, le thème démonstratif a. On peut rappeler à ce propos que, dans les drames indiens, au lieu de «je, moi», on emploie souvent la périphrase ayaAganas «hichomo»3. Il n’était peut-être pas possible à l’homme d’inventer un theme désignant expressément le moi : rien n’était plus naturel dès lors que de désigner le moi comme la personne la plus rapprochée de celui qui parle. Nous ferons encore observer, à ce sujet, que ma, thème des cas obliques du singulier, est identique à un theme démonstratif ma, qui marque la proximité, et qui, à ce que je crois, se trouve en composition dans le pronom i-ma (§ 368).
S 334. Thème pluriel et duel du pronom de la seconde personne.
La syllabe yu de ymrnê' « vous » est probablement un amollissement pour tu; nous la retrouvons au duel yu-vam, yu-vày-ôs, yu-vâ-byâm (§ 336). Le prâcrit et le pâli et plusieurs autres dialectes indiens ont ou conservé ou rétabli le t au plu! Au lieu de â-tvdu. On a de même mm au lieu de tvâu (§ 338). a La langue se sert de âvâm, qu’il s’agisse d’associer au moi la personne a qui l’on parle, ou toute autre personne. ■
5 Voyez Glossaire sanscrit, au mot /fana.
En gothique, yu-stnà est devenu i-sva, par la suppression de Vu et le changement de m en v; i-sva lui-même a donné i-svi, par l’affaiblissement de l’a en i (S 167).
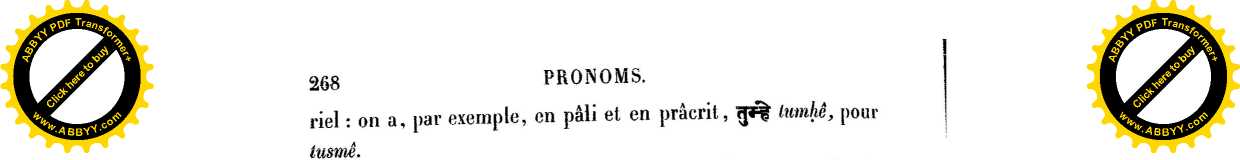
En lithuanien, le thème est ju, à la plupart des cas du duel et du pluriel; pour la première personne, le thème est mu. excepté au nominatif qui fait mes. Le pronom annexe sma ne s’est conservé qu’au locatif pluriel, avec suppression de m ; on a donc ju-sû-sè en regard du sanscrit yu-sma-su. Toutefois, la forme lithuanienne a disparu de l’usage ordinaire, ainsi que son analogue mu-sü-sè «en nous» : on les remplace par mû-syjè ou mu-sij, jü-syjè ou ju-sÿ, qui sont formes comme les singuliers manyjè, manÿ, tawyjè, tawÿ1.
$ 835. Les nominatifs pluriels mes, jüs, en lithuanien; veis, jus, en gothique; voir, ihr, en allemand.
H est très-probable que le s du nominatif lithuanien mis « nous », jus «vous», et celui des nominatifs gothiques veis, jus, ne sont pas des signes du nominatif, comme ils paraissent l’être quand on se place exclusivement au point de vue de ces langues. Je suppose plutôt que ce sont des restes de la syllabe sma. Cette conjecture devient presque une certitude par la comparaison du zend, où Ton a deux formes pour le pluriel du pronom de la seconde personne : i° Gtibf-d yusëm (§ 5g), qui répond au sanscrit yûydm (venant de yû + am, avec insertion d’un y euphonique, § /i3); a0 dont ^ s est ^en~
tique, comme l’a déjà reconnu Burnoyf 2, au \ s sanscrit de ^f^yusmdl, ou plutôt du védique yusmé. 11 serait impossible d’expliquer le s zend comme signe du nominatif, car,
1 Rapprochez le locatif awyjè «inovi»,ou, sans la désinence casuelle, aœjM i 20a).
2 Yaçna, notes,p. 121.
PRONOMS PERSONNELS. S 336. 269


d’après la déclinaison ordinaire, le thème yu aurait fait au nominatif-vocatif pluriel yavô ou yvô, et d’après la déclinaison pronominale il a fait, ainsi qu’on vient de le voir, yûsëm (sanscrit yûydm). En lithuanien, si le s de mes était le signe casuel, ce serait là une forme tout à fait exceptionnelle pour un nominatif pluriel masculin1.
On en peut dire autant pour les langues germaniques : l’allemand, dès sa période la plus ancienne, a perdu le signe casuel du nominatif pluriel, tandis que le r de wir, ilir, qui représente le s des formes gothiques veis, jus, s’est conservé jusqu’aujourd’hui; de ce fait, ainsi que de plusieurs autres indices caractéristiques, on peut conclure que le r de ces pronoms n’est pas destiné à marquer la relation casuelle.
S 336. Origine des formes secondaires sanscrites nas, vas, nâu, vâm, et du duel yu-vâm.
C’est d’après le principe que nous venons d’exposer que nous expliquons aussi les formes sanscrites nas, vas, qui sont les formes secondaires, dénuées d’accent, ae 1 accusatif, du datif et du génitif des pronoms de la première et de la seconde personne. Des cas si différents n’auraient pas pu, suivant les règles de la langue, avoir tous la même désinence, si le s, a 1 origine, avait en effet été destiné à marquer la relation casuelle. Mais de même qu’en zend yûs est un reste de yûsmê, de même, en sanscrit, nas et vas peuvent être considérés comme étant pour nasmân, vasmân à l’accusatif, et pour nasmaByam, nasmakam, vasmaByam, vasmâkam au datif et au génitif : de cette façon, le s convient aux trois cas, précisément parce quil nest 1 expression d’aucun.
1 Quoique ce pronom ne fasse pas la distinction des genres, les pluriels sanscrits usmé', asmXn appartiennent par leur forme au masculin, ainsi qu’on l’a déjà fait remarquer (S 3a6).
PRONOMS.

270

Une fois que nous avons détaché le s, débris de l’ancien pronom annexe, il nous reste na et va comme élément principal; de na et de va viennent les formes secondaires du duel, également dénuées d’accent, nâu et vâm (pour vâu). Le n de na est un affaiblissement pour m : l’accord du grec, du latin, du slave et du borussien (§ 2/18) avec le sanscrit montre que cet affaiblissement remonte à une époque très-reculée. Ya est une forme mutilée pour tva, comme viiisati «vingt» pour dvinsati; je reconnais la même mutilation dans la seconde partie du pronom yu-vdm «vous deux» (S 334). On peut regarder ce pronom comme un composé copulatif1 signifiant «toi [et] toi» : yu-vâm est pour tu-tvâm (§ 334), comme â-vam, qui signifie «moi [et] toi», est pour û-tvâra (§ 333).
S 337. Les pronoms nos, vos, en latin.
En regard des thèmes if na, ^ va, on s’attendrait à trouver en latin nô, vô, qui feraient au nominatif pluriel nî, vî, et à 1 l’accusatif nôs, vos. Mais, au lieu de ces formes, nous avons au nominatif nôs, vôs, avec un s qui se retrouve également dans les possessifs nos-ter, ves-ter (pour vos-ter). Ce fait démontre clairement que le ôs de nôs, vôs n’a rien de commun avec celui de equâs. L’explication que nous avons donnée (§336) des formes sanscrites na-sfva-s, doit donc s’étendre aux formes évidemment congénères nô-s, vâ-s; quelque bizarre que puisse paraître cette explication au point de vue exclusif de la grammaire latine, nous reconnaîtrons dans le s de nôs, vôs, un reste du pronom annexe sma.
»
C’est le même pronom sma que je crois retrouver, mais privé de son s initial, dans la syllabe annexe met de egomet, memet, tumet, nosmet, etc. En sanscrit, la forme correspondante est smat:
1 Dàt||te genre du composé sûrya-candramatâu «le soleil {et] la lune». (Voyez S 97a.) '
PRONOMS PERSONNELS. § 338. 271


nous la trouvons dans les ablatifs pluriels asmdt, yu-smdt, qui, ainsi qu’on l’a vu (§ 112), sont aussi employés comme thèmes, au commencement des composés.
Citons encore, parmi les mots latins contenant le même pronom annexe, l'adverbe immo (par assimilation pour ismo) : jai essayé ailleurs de montrer qu’il se compose du pronom démonstratif i et du pronom annexe sma1.
S 338. Les formes secondaires du duel nâu, vâm, en sanscrit. —
Les formes grecques v&ï, aÇ&ï.
On a vu plus haut (S 336) que nas, là ou il est employé comme accusatif, peut être considéré comme un reste de na-smân signifiant «moi [et] eux», et quon peut expliquer dune façon analogue ms employé comme datif et comme génitif. Si cette explication est fondée, nous sommes peut-être en droit de l’étendre à la. forme secondaire du duel, nâu, laquelle signifiera, suivant le cas auquel elle est employée, «moi [et] lui, à moi [et] à lui, de moi [et] de lui», et sera pour nâsmâu, nâsmâ-Eyâm, nâsmay-ôs. On peut, en effet, regarder nâu comme une altération pour nâs, de la même façon que plus haut (S 206) on a expliqué âu, désinence du duel, comme une altération pour âs, et as lui-même comme un allongement de la désinence du pluriel as. De la long de nâu = nâs on peut rapprocher la de â-vâm «moi [et] toi», ainsi que celui de certains composés copulatifs du dialecte védique (§ 972). Mais s’il faut abandonner cette explication, et si vft nâu contient la désinence du duel âu, laquelle aurait été abusivement employée pour l’accusatif-datif-génitif, au lieu de marquer, comme à l’ordinaire, le nominatif-accusatif-vocatif., on pourra se rendre compte du sens de nâu, en rapprochant certains duels qui s’écartent aussi, dans
1 Pour tes autres formes renfermant le pronom annexe sma, le lecteur doit se reporter au S « 66 et suiv. — Tr.
PRONOMS.

272

l’usage, de leur sens littéral : ainsi pitdrâu ne signifie pas seulement « les deux pères», mais souvent aussi «les parents» (le père et la mère), et svdsurâu «éxupw», au lieu de signifier «les deux beaux-pères», peut désigner le beau-père et la belle-mère1.
La forme secondaire du duel est vâm pour le pronom de la seconde personne. Je regarde vâm comme venant de vau2 ; nous avons, en effet, en zend, puj? vâo, qui suppose un vau ou un vas sanscrit (§ 56b). Mais je ne crois pas que vâu soit devenu vâm sans passer par une forme intermédiaire : vâu a dû faire d’abord vâm, et le v final s’est durci en m (§ 20). De même que nous avons vu plus haut nâu, venant de nâ-s, s employer non-seulement comme accusatif, mais encore comme datif et comme génitif, de même vâm, venant de vâu, qui lui-même est pour vâ-s, peut signifier «toi et lui, à toi et à lui, de toi et de lui» : cette diversité d’emploi vient, ainsi que nous l’avons dit (S 336), de ce que le s n’est pas l’expression d’une relation casuelle. Au contraire, dans â-vam, et yv^vâm (= a-vau, yu-vau), le au, devenu âm, nous représente un véritable duel, attendu que ces formes ne s’emploient qu’aux cas qui ont régulièrement au comme désinence.
En grec,les pronoms des deux premières personnes ont pour thème, au duel, va>, <tÇ>co280 281 282. Ces formes, qui sont avec «Tt nau, KTO vâm (pour vâu), dans le même rapport que bu rca avec dètâu (§ 316), confirmént l’opinion éniise plus haut que âu, dans les pronoms sanscrits, n’est pas la désinence casuelle. En effet, si en grec le thème était vo, crÇo, nous devrions avoir un génitif-
PRONOMS PERSONNELS. S 339.

273

datif voiv, aCpoiv, caron ne comprendrait pas pourquoi la longue serait conservée devant la désinence tv, quand elle ne l’est pas dans la déclinaison de ïrntos, qui fait Ïtc-itu, ïirnoiv. Qu’est-ce alors que ces formes du duel vüï, ertpüï1, qui n’ont pas d’analogues en grec? Max Schmidt283 284 285 suppose que l’i est un reste de \'î, désinence du duel neutre en sanscrit (§ 212). Mais prenons carde que les pronoms de la première et de la seconde personne ne faisaient point primitivement la distinction des genres et qu’ils ne paraissent en sanscrit qu’avec les désinences masculines : il faut donc, moins que partout ailleurs, s’attendre à trouver dans ces pronoms la désinence neutre î que le grec a perdue. Je préfère voir dans l’i de viïi, a<püï un affaiblissement de la désinence duelle a, laquelle appartenait primitivement au masculin et au féminin, et est devenue s* dans la déclinaison ordinaire (S 209). On a d’ailleurs des exemples de vue au lieu de v&u; à la troisième personne, c’est o-cpué qui est la vraie forme et non crCpui, et les grammairiens admettent l’un et l’autre pour la deuxième personne286. <
S 33g. Pluriel et duel des pronoms des deux premières personnes, en ancien slave.
En ancien slave, les pronoms des deux premières personnes, à tous les cas du duel et du pluriel, excepté au nominatif eu vê tu vain, MSI mü «tifjtsïs», ont pour thème nu m, eu va, et se rattachent, par conséquent, aux formes secondaires sanscrites nas,

27A

vas, nâu, vâm. Leur déclinaison est plus près de celle des thèmes féminins en a que de celle des thèmes masculins en o. Comparez, par exemple, à l’instrumental-datif duel, na-ma, va-ma avec vïdova-ma, et à l’instrumental pluriel na-mi, va-mi avec vïdova-mi; au contraire, le thème vlüko fait vlüko-ma et vlükü (S 276). De même, au nominatif pluriel, mil «nous» et vu «vous5? s’accordent avec vïdovü= sanscrit vidavâs, et non avec vlüki($ 37/i). Le nominatif duel et vê «nous deux» a tout l’air d’un féminin et s’accorde avec vïdovê = sanscrit vidavê. Au contraire, va «vous deux» est plus en accord avec les formes masculines comme vlüka «les deux loups» et avec les duels zends comme aipa uïnirav. Le génitif-locatif pluriel des deux pronoms est na-sü, vasü; nous retrouvons ici l’ancien s du génitif (en sanscrit sâm, en borussien son, en gothique sê, § 268) et du locatif (en sanscrit su, venant de sva, en lithuanien sa, su, se). Dans toutes les autres classes de mots, la sifflante sanscrite du génitif et du locatif est représentée en ancien slave par un x (§ 92*).■
S 3Ao. Pluriel des pronoms des deux premières personnes, en arménien.
En arménien, le pronom de la première personne a pour thème du pluriel Jb me; toutefois, à l’ablatif, ce thème prend un n dont la valeur, selon moi, est purement phonétique, et devant ce n Ve s’allonge : mên-g. De même, le pronom de
la seconde personne, qui forme les cas obliques du pluriel du thème Ib le, fait à l’ablatif lên-g287. Dans ces pronoms,
l’accusatif pluriel est identique avec le datif et s’en distingue seulement par l’article préfixé (§ 237), comme cela a lieu.également au singulier pour le pronom de la seconde personne;
PRONOMS PERSONNELS. S 340.

275

on a donc qJtrtj s-me-s « ijuàs », q£kq_ s-^e-s « ûfxâs »1. Les génitifs me-r « tjixuv », '(e-r « v(tâv 5) sont probablement, quant à leur origine, des possessifs (§ 188); il en est de même pour les génitifs pluriels sanscrits asmdkam, yuêmakam, dont il est impossible de méconnaître la parenté avec les thèmes possessifs asmàka, yusmâka, usités dans le dialecte védique. Peut-être faut-il regarder les formes sanscrites précitées comme d’anciens accusatifs singuliers neutres; la signification exacte serait alors « en ce qui concerne le nôtre, le vôtre », à moins qu’on n’y voie une sorte de locution adverbiale servant à déterminer un substantif. Comme possessifs, mer signifie en arménien « n osier » et 1er «vester»; ils viennent des thèmes mero, £ero, dont l’instrumental singulier est mero-w, lero-w, le datif-abîatif-génitif pluriel mero-z, lero-z, etc. Les pronoms possessifs signifiant «mon, ton» sont également dans un rapport étroit avec le génitif du pronom personnel correspondant : nous avons notamment im «meus» qui est complètement identique avec le génitif im «de moi»; mais ici c’est le pronom possessif (dont le thème est imo, l’instrumental singulier imo-w) qui dérive du pronom personnel, car le datif in-l (venant de im-{) «mihi» montre bien que le thème de ces deux cas est un thème terminé par une consonne. L’opinion exprimée plus haut (§ 33o) que ft" des cas obliques du singulier (im, etc.) pourrait bien être une voyelle prosthétique, comme l’e du grec è-fxov, é-fxoî, est confirmée par le thème possessif i-mo, qui est presque identique avec le grec é[xo.
Le possessif de la deuxième personne est moins près, à son nominatif j>nj qui2, du pronom personnel correspondant que ne l’est 4M « meus » du pronom personnel de la première personne. Le thème de j>nj qui est quio : c’est ce qui ressort de l’instru-
1 Sur ia désinence dative dans ces formes et sur le datif singulier qe-s k à toi », en regard du 7X y sanscrit de tû-llyam b à toi », yuêmâ-tiyam « vobis », voyez S a 15, î.
2 Sur la diphtbongue ni, voyez S i83 b, 2.
. 18.
276 „ PRONOMS.

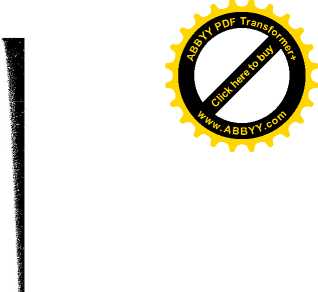
mental quio-w (à côté de qo-w) et, du datif-ablatif-génitif pluriel
Diyn-g quio-z (à côté de qo-i).
Il nous reste à rechercher l’origine des thèmes me, au pluriel des deux premières personnes : je ne regardé pas me comme identique avec le sanscrit ma = grec fio des cas obliques du singulier; j’y vois, comme dans le persan moderne mâ «nous»
(§ 3a6, remarque), la syllabe finale du thème pluriel a-smâ.
Le nominatif, d’après la 'déclinaison ordinaire, serait asnm, et c’est à ce s final que se rapporte le # q de l’arménien me-q «nous» (§ 226). Dans la syllabe U des cas obliques de la seconde personne, je reconnais, avec Fr. Wmdischmann la syllabe initiale du thème sanscrit yu-smd1. Au sujet du 2 i tenant la place du sanscrit ^y, comparez -W*//» lavar «épeau-tre» avec le sanscrit et le zend yava «orge», le lithuanien jawm (nominatif pluriel)2 «blé», le grec &«'; au sujet de l’e tenant la place d’un u, comparez IrquHt esan «bœuf» (nominatif esn) avec le sanscrit ülcsan3. Le pronom arménien de la deuxième personne forme son nominatif pluriel du nominatif singulier du;
on a donc dit-ÿ. , .
Nous faisons suivre le tableau comparatif de la decunaison des pronoms des deux premières personnes. On verra que, si les langues mises en parallèle présentent les mêmes thèmes, elles ne sont pas toujours d’accord en ce qui concerne la flexion.
En grec, pour rendre les comparaisons plus sensibles, nous choisissons les formes dialectales les plus voisines du sanscrit et du zend.
> A la syllabe yu, dans yvrimâ, se rapporterai le H du persan moderne iu-mâ «VOUS». , » _ . 1
5 Thème jawa. . - ■
3 Voyez S 183b, 1.
PRONOMS PERSONNELS. S 340.

277


Pronom de la première personne. SINGULIER.
Nominatif.
Sanscrit................ ahdm.
Zend..............
sytav.
ego.
ik.
asü.
as.
es.
Grec...............
Latin..............
Gothique............
Ancien slave.........
Lithuanien.........
Arménien..........
Accusatif.
|
Gothique..... |
... mi-k (S 3a6, remarque) | |
|
Lithuanien. ... | ||
|
Ancien slave. .. | ||
|
Instrumental. |
|
. mâyâ. | ||
|
Lithuanien...... |
. manimi. | |
|
Ancien slave. . • • |
. . m&twjun. | |
|
Arménien...... |
. . inev. Datif. | |
|
.. mâhyam, mê. | ||
|
.. maibyâ (S ai5, i | ||
|
.. è(itv (S ai5, î ), | ||
|
.. miht (8 ai5, i). | ||
|
Gothique. ...■•* |
;. • . '• • • |
.. mis (S 17a)- |
|
Lithuanien..... |
Vvs-v* |
.. ma». |
Nominatif. . 288
Sanscrit.......... ^..... avant (S 333).
Grec..................... (8 338).
Gothique............. • • - ***’• > ,
Lithuanien.............masculin : mvrdu; féminin : mù-dwi.
Ancien slave............ K'b

|
278 |
PRONOMS. |
|
Ancien slave........ |
. .. münê (§ 33o). |
|
Arménien.......... |
.... /.W inl (S 2i5, i). |
|
Ablatif. | |
|
Sanscrit........... • |
.... mat. |
|
Zend.............. |
.... mad. |
|
Arménien.......... |
..... inê-n (S t83*, A). |
|
Génitif. | |
|
Sanscrit............ |
.....mâtna, mê. |
|
Latin............ |
.... Voyez le locatif.. |
|
Gothique.......... | |
|
Lithuanien........ |
..... manehs. |
|
Ancien slave....... | |
|
Arménien......... |
.....im. |
|
Locatif. | |
|
Sanscrit........... | |
|
Latin (génitif)..... |
.....met (8 328). |
|
Lithuanien........ |
.....manyje. |
|
Ancien slave....... |
.....ittZH’fc münê. |
nu el.

Sanscrit................âvam, nâu.
Grec..................
Gothique...............unkis (88 169 et 172).
Lithuanien............. masculin : mù-du; féminin : rnù-dm.
Ancien slave............ na.
Instrumental.
Sanscrit................ âviïtiyâm.
Lithuanien.............muni, mkm-dwcm, mh-dwëm.
Ancien slave............nama.
Datif.
Sanscrit... .
Grec......
Gothique. .. Lithuanien. Ancien slave
Avaliyâm, nâu.
VÛÛÏV.
unkis (S 172)- •
nom, rmim-dwêm, mu-dwëm. na-ma.
Ablatif.
Sanscrit................âvabyâm.
Génitif.
Sanscrit....
Grec......
Gothique . . Lithuanien. Ancien slave

PRONOMS PERSONNELS. S 340.
Accusatif.
279

âvâyôs, nâu. vüiv. unkara.
mima288, mùma-dwëju, mh-dweju. naju.
Locatif.
Sanscrit................âvâyôs.
Ancien slave............naju.
• ' ' ■' - st A - *. ■
de m en », le slave E’fi ^ressemble au nominatif pluriel vaydm en sanscrit et vei» en gothique (S 33 i).
1 La désinence ma, dans mù-ma et jù-ma, parait provenir du datif-instrumental, dont la désinence m est un reste de mu (S sss). Elle se sera introduite par abus au génitif, qui n’y avait point droit.

280
PRONOMS.

Nominatif.
|
Sanscrit............ . |
... vayâm, védique : as me (S 33a). |
|
Zend............... |
. .. vaêm. |
|
Grec............... |
... âppes, tjfiets. |
|
Latin............... |
.. . nos (S 337). |
|
Gothique............. |
. . veis (S 335). |
|
Lithuanien........... |
.. mes (S 335). |
|
Ancien slave.......... |
.. mü (8 339). |
|
Arménien............ |
.. meq (S 34o, page 276). |
|
Accusatif. | |
|
Sanscrit.............. |
. . asman, nas. |
|
Zend................ |
. . . nô, {1 në ’. |
|
Grec....... |
. .. dfifxs, (S 33a). |
|
Latin........... . .. |
. .. nos. |
|
Gothique...... |
. . . unsis2 ou uns. |
|
Lithuanien........... |
. .. mus. |
|
Ancien slave.......... |
. * nü. |
|
Arménien............ |
, . . s-mes. |
|
Instrumentai. | |
|
Sanscrit............. |
. . asmaSis. ■ |
|
Lithuanien........... |
.. mumis. |
|
Ancien slave.......... |
. . nar-mi. |
|
Arménien........... |
. . mevq. . |
|
\ |
Datif. |
|
Sanscrit.............. |
. . asmâhyam, nas. |
|
Zend................ |
.. nuàbyè (S 215, 1 ), m, në. |
|
Grec................ |
... &p(u(v), tifttv’. |
1 Sur la forme {| né', voyez S 3i.
8 Sur le thème, voyezS » 66 ; sur le s final, voyezS 17a. Ajoutons ici que le s du pronom annexe sanscrit tma a pris, eu gothique, l’apparence d’une flexion casuelle, non-seulement au datif, mais encore à l’accusatif due) et pluriel des deux pronoms de la première et de la deuxième personne.
s 1et ipïv sont de vrais datifs : comme éfi'-tv et re-l (S 315, i), ils Se rap-
PRONOMS PERSONNELS. S 340.

281

Latin................. nôbis (S ai5, 2).
Gothique.............. unsis ou uns.
Lithuanien............. mùmus, mums.
Ancien slave ........... namü. -
Arménien.............. mes (S 34o, page 275, note 1 ).
Ablatif.
Sanscrit................ asmit.
Latin................. nôbis (§ 215, 2).
Arménien.............. Jk'u^mêng (S 215, 2).
Génitif.
Sanscrit................ asmakam (S 34o, page 275), ms.
Zend.................. ahmâkim.
Grec.................. àfifiéwv.
Latin................msirî, nostrum (S 34o, remarque).
Gothique.....;......... unsara (S 34o, remarque).
Lithuanien............. musu.
Borussien. . ..........nouson (S 248).
Ancien slave............ nasü.
Arménien.............. mer (S 34o, page 275).
Locatif.
Sanscrit................ asmasu.
Grec (datif)... ........ ipçxéat.
Lithuanien,............. musüsè.
Ancien slave............ nasü.
Pronom de la deuxième personne '.
SIHGOLIEB.
Nominatif. \
Sanscrit................. tvam.
portent à la désinence sanscrite tiyam. Au contraire, ipfiém représente le locatif sanscrit tumà-iu (venant de asmâ-tva, S 260). *
1 Compare» à tous les cas les formes correspondantes du pronom de la première personne.
Instrumental.
|
Sanscrit........ |
.. tvâyâ. | |
|
Lithuanien..... |
.. tawimi. | |
|
Ancien slave .. .. |
. . tobojun (8 a66). | |
|
Arménien...... |
. . qev. | |
|
Datif. | ||
|
Sanscrit........ |
. , tù-byam, tê, védique : tvê. | |
|
Zend.......... |
. . iwoi, tôi, tê. | |
|
Grec.......... |
. . Tsiv, rot. | |
|
Latin......... |
. . tibi. | |
|
Gothique...... |
. . thus. | |
|
Lithuanien..... |
.. taw. | |
|
Ancien slave. .. |
.. tebê (voyez le locatif). | |
|
Arménien..... |
.. jes (8 ai5, i). |

|
282 |
PRONOMS. |
|
Zend............. | |
|
Gothique.......... | |
|
Lithuanien........; | |
|
Ancien slave....... | |
|
Arménien......... | |
|
Accusatif. | |
|
Sanscrit........... | |
|
Zend............. |
...... twahm, twâ. |
|
Grec............ | |
|
Ombrien......... | |
|
Latin............ | |
|
Gothique........ | |
|
Lithuanien....... | |
|
Ancien slave..... | |
|
Arménien........ |


PRONOMS PERSONNELS. S 340
Ablatif.
283

Sanscrit................ Ivat.
Zend.................. î-m«4-
Latin.................. te{^)-
Arménien.............. qê-n{S t83°, 4).
Génitif.
Sanscrit................ tâva',tê.
Zend.................. twa-hyâ (S 188), tava, Iwôi, tôi.
Latin................ Voyez le locatif.
Gothique............... theina.
Lithuanien.............tawehs.
Ancien slave............ tebe.
Arménien.............. jo.
Locatif
Sanscrit................ teâyi.
Lithuanien............. tawyjè.
Ancien slave............ TtE’B tebê.
DUEL.
Nominatif.
Sanscrit................yuvam (S 336).
Grec..................a<p&ï (8 338).
Lithuanien. ............masculin i jhrdu; féminin : jù-dmi.
Ancien slave............ Biva.
1 Le génitif mima «m'eii> a été présenté ci-dessus comme étant peut-être un redoublement du thème ma; d’accord avec J. Grimm (Histoire de la langue allemande, p. a 6a ), je crois actuellement devoir expliquer aussi le génitif lava comme une forme redoublée; Je ne crois pas, cependant, que tava soit pour tvalva; je suppose qu’il est pour Uitva, d’après les lois ordinaires du redoublement, qui donnent tatviïra comme parfait redoublé de tvar «courir». Entre tdva et tatva il y a le même rapport qu’entre le vieux haut-allemand jior r quatre» et le gothique fidv&r.

284
PRONOMS.
Accusatif.
|
Sanscrit........ | |
|
Zend......... | |
|
Grec......... | |
|
Gothique...... | |
|
Lithuanien.... |
......masculin : jù-du; féminin : jii-dwt. |
|
Ancien" slave. .. | |
|
Instrumental. | |
|
Sanscrit....... | |
|
Lithuanien.... | |
|
Ancien slave. .. | |
|
Datif. | |
|
Sanscrit....... | |
|
Zend......... | |
|
Grec......... | |
|
Gothique...... | |
|
Lithuanien. ... |
.....jum, jùm-d-æsm, jh-dwëm. |
|
Ancien slave. . | |
|
' |
Ablatif. |
|
Sanscrit...... | |
|
Génitif. | |
|
Sanscrit...... | |
|
Zend........ | |
|
Grec |
......\ ‘ ' <7<?à)‘v- |
|
Gothique..... | |
|
Lithuanien. .. |
..........jüma (voyez S 34o, page 379 |
|
jùma-dvoëju, jù-dmëju. | |
|
Ancien slave. . |
.......... vaju. * |

Locatif.
Sanscrit................ ywâyù.
Ancien slave............ vaju.

PRONOMS PERSONNELS. § 340.
285.

. Nominatif.
Sanscrit................ yûyâm (S 335); védique : yuêmê'(S 334). ■
Zend..................yûéëm, yùs'. /»
Grec.................. types.
Latin.................. vos (S 337).
Gothique...............jus (S 335).
Lithuanien.............jus.
Arménien.............. duq.
Accusatif.
Sanscrit.. . .
Zend......
Grec......
Latin......
Gothique... Lithuanien. Ancien slave Arménien. .
yusman, vas. vâ, vë s.
tyfte, iftâs (S 33a). vos (S 337). isvis3.
jus. ,
vü.
çâty S-&S (8 34o, page 275). 289
Instrumental.
|
Sanscrit........... | |
|
Lithuanien. ....... | |
|
Ancien slave....... | |
|
Arménien......... |
...... |etiq. |
|
Datif. | |
|
Sanscrit, ..... | |
|
Zend . .......... | |
|
Grec............ |
...... ôfïfii(vï. tyfr (S 34o, page 280, note 3). |

286
Latin......
Gothique... Lithuanien. Ancien slave Arménien. .
PRONOMS.
vôbis:
isvis (voyez l’accusatif).
jkmus.
vamü.
les (§ 34o, page 975, note 1).

Ablatif.
Sanscrit.. Zend.... Latin.... Arménien

xjùsmad.
vôbis.
Sanscrit....
Zend......
Grec......
Latin......
Gothique.. . Lithuanien. Borussien. . Ancien slave Arménien. .
(S ai5, a).
Génitif.
yuémakam (S 34o, page 975), vas.
yûsmâkëm, vâ, vë.
ùjjtfzéaw.
vestrî, veslrum (S 34 0, remarque). isvara (S 34o, remarque).
touson.
vasü.
1er.
Locatif.
Sanscrit................ yusmasu.
Lithuanien.............jusüsè.
Ancien slave. i..........vasü.
Remarque. — Pronoms possessifs servant de génitifs aux pronoms personnels. — Les génitifs nostrî, vestrî, nostrum, veslrum appartiennent au pronom possessif, quoique la langue latine s’en serve comme de pronoms personnels. Nostrî, vestrî sont des génitifs singuliers, mstrurn, vestrum des génitifs pluriels formés comme socium (8 248); Aulu-Gelle (N. Att. xx, 6) donne aussi, d’après Plaute, la forme ordinaire vestrorum.
En gothique, les génitifs pluriels unsara «de nous», isvara «de vous» sont identiques aux thèmes possessifs unsara «notre», isvara «votre» (nominatif singulier masculin unsar, isvar).
En présence de ces faits, il est permis de se demander si les génitifs
PRONOMS PERSONNELS. S 340.

287

singuliers meina, theina, seim, ainsi que les génitifs pluriels mettra, isvara, ne sont pas des pronoms possessifs *. On y pourrait voir alors des accusatifs singuliers neutres qui auraient conservé la voyelle finale du thème. Celte explication concorderait avec celle qui vient d’être donnée (page 275) des génitifs sanscrits asmâkan1, yusmakam, qui ont également la forme d’accusatifs singuliers.
Peut-être même les expressions sanscrites marna, tâva «de moi, de toi», qui n’ont nullement la forme de génitifs, étaient-elles primitivement des pronoms possessifs. Les formes secondaires mâmakâ, tâvakâ «meus, tuus» en ont pu dériver à une époque où l’on avait cessé de sentir la vraie valeur de marna, tâva. Rapprochez encore de tâva le thème possessif grec tso (venant de reFo), qui a donné ensuite la forme aôs, l’e ayant été syncopé et le t s’étant changé en <7s.
C’est ici le lieu de citer ce qui se passe en indoustani, où les suffixes possessifs, en venant s’ajouter, soit aux noms, soit aux pronoms, ont induit les grammairiens en erreur. Le suffixe possessif des pronoms est râ devant un mot masculin, ri devant.un mot féminin; le suffixe possessif des autres mots est kâ devant un mot masculin, kî devant un mot féminin. Exemples ; mêri ma «mea mater», têrîmâ «tua mater». On a suppose à tort que ces syllabes râ, ri, kâ, kî étaient des désinences de génitif : la cir- • constance seule qu’elles varient selon le genre du mot suivant aurait dû montrer que ce sont des suffixes possessifs; kâ représente le suffixe sanscrit ha, que nous avons dans asmaka, yusmaka, mâmakâ, tâvakâ. Le changement de kâ en kî, de râ en ri n’a rien que de conforme aux lois sanscrites sur la formation du féminin (§119)’.
Pour revenir au latin, il est indubitable que les génitifs singuliers meî, tut, qu’on a rapprochés plus haut (S 3a8) des locatifs sanscrits mây-i, 290 291 292
PRONOMS.

288
tvây-i, peuvent être expliqués comme d’anciens génitifs du pronom possessif.
Rappelons enfin qu’en grec èftoô «de moi» est identique à è[to0, génitif du pronom possessif è(xàs. Je ne crois pas cependant que ie pronom possessif ait prêté son génitif au pronom personnel; je ne suppose pas davantage que le pronom possessif èpôs vienne de sftoü291. J’admets que l’une et l’autre forme se rattachent à un thème, a la fois personnel et possessif, epo. Le thème sva, dont nous allons nous occuper, nous présentera l’exemple d’un fait analogue.
PRONOMS DE LA

TROISIÈME PERSONNE.
LE THÈME PRONOMINAL SVA.
S 3A i. Le thème sva et ses dérivés en sanscrit, en zend, en grec, en latin, en germanique et en slave.
Il n’y a pas dans la langue sanscrite, sinon en composition, de pronom de la troisième personne, à genre invariable et à signification purement substantive292. Mais le témoignage unanime des langues de l’Europe prouve qu’il a dû exister un tel pronom dans le principe. Gela ressort aussi de là comparaison du zend, où nous avons, au génitif et au datif des trois genres, jgy» hê et /rit4; de son côté, le prâcrit nous présente % sê 293
PRONOM RÉFLÉCHI. S 3kl.

. 289

aux mêmes cas293. Pour la signification comme pour la forme, nous avons ici le pendant des pronoms de la première et de la deuxième personne, qui font, en sanscrit, mê, tê, tvê; en zend, «g mê ou môi, jjy» tê ou twôi (§ 3 2 9 ).
Comme thème de ce pronom, il faut admettre en sanscrit sva (forme élargie svê), de même qu’on a pour thèmes des deux autres pronoms ma et mê, tva et tvê (§ 326).
De svê, combiné avec la désinence nominative am (pour m,
§ 326), vient svayam qui signifie «ipse». Dans la langue sanscrite, telle quelle est arrivée jusqu’à nous, svaydm est indéclinable et peut s’employer pour tous les cas, pour tous les nombres et pour tous les genres. Mais c’est seulement comme premier membre d’un composé qu’il est employé avec la signification d’un cas oblique; exemples : svayam-Bû «existant par lui-même»; svayam-praha «brillant par lui-même»; svayah-vara (par euphonie pour svayam-vara) «choix [fait] par soi-même»2.
Le thème nu ^ sva est employé de la même manière au commencement des composés : il a le sens d’un cas oblique du pronom personnel réfléchi; exemples : sva-Bû «existant par lui-même»; sva-sta, littéralement «se tenant en soi», cest-â-dire «sui compos»; sva-Bânu (védique] «ayant de 1 éclat par soi-même». Comme pronom personnel, sva se combine aussi avec le suffixe adverbial tas; on a donc svatas «de soi, par soi»3
peut-être se traduire «le se souiller soi-même», en considérant hanm comme le régime du verbe contenu dans le substantif abstrait raitwëm (compares SS 91 h et gao).
1 Je ne connais en zend que des exemples du masculin. Mais, en prâcrit, rf sè est souvent employé pour le féminin (voyez Urvasî, éd. Lenz, pages h6, 55). Le prâcrit ne m’a présenté jusqu’aujourd’hui que des exemples de sc au génitif. En zend, au contraire, les deux cas.se trouvent, et le datif est même employé plus fréquemment que le génitif. ,
3 C’est le nom donné au mariage d’une jeune fille qui choisit elle-même son époux. '
3 Mahâbhêrata, chant m, vers ioo5. Svntali iôb'amânah «brillant par soi-même».
PRONOMS.

290

(grec ÜOsv, venant de crFsOsv, S 42i)’. Comme possessif, sva a sa déclinaison complète; mais il peut alors s’employer aussi pour la première et la deuxième personne, et signifier «meus, tuus, noster, vester»294 295.
A ce sva correspond aussi exactement que possible le grec <rÇ>6-s; le pluriel du pronom personnel (o-Çeîs, aQi-çri) a o(pi pour thème, c’est-à-dire que l’ancien a est affaibli en i, comme au pluriel des deux premières personnes (§ 832). Au duei, la deuxième et la troisième personne semblent avoir, en grec, le même thème : mais le a de la deuxième personne est sorti d’un ancien t, tandis que le- a- de la troisième personne est primitif. Dans o3, oï, S (pour aÇov, erPoi, a<ps), le digamma, qui pouvait se maintenir sous la forme d’un <p après un a, a du nécessairement être supprimé, le a- étant devenu un esprit rude. C est ainsi que ol se trouve ressembler au zend 4%)» ou jyu» hé (pour hvâi, Iwê) et auprâcrit sê (pour svê).
Nous retrouvons la même suppression du v, ainsi que l’affaiblissement de l’ancien a en i, dans le gothique sei-na, sis, si-k, pour svei-na, svi-s, svi-k (§ 3 2 y). Le v s est au contraire conservé dans l’adverbe sva (allemand moderne so) «ainsi», littéralement «de cette façon», et dans svê (allemand moderne wie) «comme»; le premier de ces mots a changé son sens réfléchi contre le sens démonstratif, le second contre le sens relatif. J’ai présenté plus haut (S i5q) svê, ainsi que thé et hvê296, comme des instrumentaux; niais je ne saurais admettre avec J. Gnmm que le v de svê et de sva y ait été inséré, et que ces adverbes soient de la même famille que sa, so (= sanscrit sa, sa «celui-ci, celle-ci», § 345), En effet, le v de hvas «qui?» = sanscrit kas, auquel se réfère Grimm, a été attiré par la gutturale pré-
PRONOM REFLECHI. S 342.

291

eédente, comme Vu (= t>) du latin quis (§ 86, î); mais il n’v a pas de motif semblable pour l’insertion d’un v dans sva, svê. Dans sva «ainsiv, il y a changement du sens réfléchi en sens démonstratif : on peut comparer, à cet égard, le latin si-c, dont la parenté avec sut, si-bi, se n’est pas douteuse. La suppression du v et l’affaiblissement de l’ancien a en i que nous observons dans si-c, comparé au gothique sva (même sens), se retrouve dans les formes gothiques si-s «sibi», si-k «se». Peut-être sva est-il un datif formé comme vulfa « lupo » : sinon, sva doit être un instrumental, comme svê, mais avec abréviation de la voyelle297.
En lithuanien et en ancien slave, ce pronom suit exactement le pronom de la deuxième personne, dont il ne se distingue que par son s initial, au lieu de t. Mais, comme il est seulement usité dans le sens réfléchi, il est privé de nominatif, comme en latin, en grec et dans les langues germaniques; de plus, le singulier sert aussi pour le pluriel et le duel.
S 342. Différentes formes du thème sva en zend. — Le pronom sva en arménien. — Tableau comparatif de la déclinaison de ce pronom.
En zend, sans parler des formes précitées hê, hôi (§ 34i), le thème sanscrit sva se présente à nous sous un double aspect : qa et u»çy hva .(§ 35). Le premier est employé comme pronom personnel réfléchi dans le composé qa-iâta «créé par soi-même»; partout ailleurs, il est possessif, par exemple à l’instrumental singulier qà (§ i58), pluriel qâis, génitif singulier jahê. Je ne connais, pour le thème hva, que des exemples

292

du sens possessif; en ancien perse, au contraire, hum (pour/uw,
§ a53) signifie «celui-ci» ou «celui-là».
Nous passons à l’arménien, où nous trouvons le génitif /ri_p iur «sui», dont le r appartient au thème, car il se trouve aussi à l’instrumental iure-v1 et à l’ablatif iurmè-. Au commencement des composés, iur prend la voyelle a, qui sert ordinairement à la composition des mots arméniens; exemple : iur-a-lin «né de lui-même», littéralement «ayant par lui-même sa naissance»298 299 300. Comme pronom possessif, iur «suus» vient du thème tu-ro, de même que nous avons vu plus haut (S 3ùo) me-r «notre», £e-r «votre» venir des thèmes me-ro, tfi-ro; ce suffixe formatif ro correspond au sullixe gothique ra des thèmes possessifs comme unsa-ra «notre», et au suffixe indoustani ra, féminin rî (§ 3io, remarque). Si nous retranchons du pronom personnel arménien iu-r «sui» le suffixe possessif, il reste iu comme le véritable thème, lequel a perdu la consonne initiale du thème réfléchi sanscrit sva; la même chose est arrivée, en grec, au datif pluriel <p(v, qui s’emploie dans la langue épique concurremment avec cr<piv. L’arménien [il. iu représente donc les deux dernières lettres du sanscrit sva, avec vocalisation du v en u, et peut-être avec affaiblissement de l’a en i; on peut encore rapprocher, à cet égard, en grec, le thème pluriel otyi, (pi, et, en latin, la syllabe si de si-bi301. Nous aurions donc dans fn. iu une méta-thèse de ui qui est lui-même pour vi; sinon, il faut regarder l’t de iu comme une voyelle prosthétique, ainsi qu’on l’a vu pour le nom de nombre «neuf» (§ 317), et ainsi que cela a lieu
PRONOM RÉFLÉCHI. S 312. 293


peut-être pour le génitif im « mei t> , s’il n’est pas une métathèse pour mi.
Mais on peut aussi, comme il me semble, reconnaître en arménien le thème réfléchi sva sous une autre forme que ftL- iu. En effet, quoique svaydm sipse» soit, quant à la forme,
un nominatif, nous avons vu qu’au commencement d’un composé il fait l’office du thème (svayam-Bû r existant par lui-même * il ne serait donc pas étonnant que svaydm fût aussi traité en arménien comme un thème pronominal et qu’il fût devenu déclinable, avec altération de m final en n et de sv en q (.g)1. Je suis donc très-porté à rattacher au sanscrit svaydm la deuxième partie de fiigU in-qn « il » ou « lui-même » 2, dont le thème, dans la seconde série de cas, est (fiiglrtuu in-qean (instrumental singulier in-qeam-b, pluriel in-qeam-bq). Quant à la première partie de ce pronom3, j’y reconnais le thème démonstratif sanscrit
and, avec l’affaiblissement de l’a initial en i (§ 372 et suiv.).
Je crois pouvoir admettre une composition analogue pour le latin i-pse, dont la seconde partie, comme il me semble, renferme une métathèse pareille à celle du datif pluriel en dorien (ij/m pour cr(piv, venant de le p de i-pse serait donc,
comme le ® renfermé dans \p, un durcissement du v de sva. Quant â IV de i-pse, c’est le thème du pronom is (§ 361).
En ce qui concerne le composé lithuanien pa-tl-s « ipse », voyez § 359.
Nous faisons suivre le tableau synoptique de la déclinaison du pronom de la troisième personne. 11 ne distingue pas les genres, et le singulier peut aussi s’employer pour le pluriel et
1 Pour te changement de m final en n, comparez l’accusatif en grec et en horus-sien, ainsi que te datif arménien in-£ «à moi» (au lieu de Pour le changement de sv en q, rapprochez le thème réfléchi zend qa (SS 35 et 326).
a Aucher, Grammaire arménienne-anglaise, p. 38.
3 On le trouve employé après d’autres pronoms, avec le sens de «ipse» ; exemples: es inqn «moi-même», du inqn «toi-même», na inqn «lui-même».
PrJcrit. Zend. Grec. Latin. Gothique. Lithuanien. Ane. slave.
Accusatif............. a<pè, ê sê si-k saw'eh sah
Instrumental......................Sdmimi sobojuh
Datif....... sê hè, hôi oï sibi ÿs sàm sebê, si
Génitif...... sê /te., hôi eïo,ov sut siina sawêns sebe
Locatif...............................sawyj'e sebl
Arménien.
Singulier. Pluriel.
Nominatif. . . in-qn in-qean-q Accusatif. .. . s-in-qn s-in-qean-s Instrumental . in-qeam-b in-qeam-bq
Datif....... in-qean in-qcan-z
Ablatif...... in-qen-ê302 303 in-qean-z
Génitif...... in-qean in-qean-i.

m
PRONOMS.
le duel (excepté en grec). La déclinaison de l’arménien tfytb in-qn «il, lui-même » forme un paradigme à part.

LES THÈMES PRONOMINAUX TA ET SA.
S 343. Le thème ta et ses dérivés.
En sanscrit, le thème ïf ta, féminin «TT ta, signifie «il, celui-ci, celui-là ». La forme zende est identique à la forme sanscrite; mais on trouve fréquemment la moyenne au lieu de la ténue, notamment à l’accusatif singulier masculin, où «gp tëm est remplacé par dëm ou, encôre plus souvent, par dim. En grec et en gothique, ce pronom a pris le rôle d’article; il est, au contraire, resté fidèle à son caractère de pronom démonstratif en latin, en lithuanien et en slave, où l’article est inconnu. Le thème ta est
PRONOMS DÉMONSTRATIFS. S 3A3.

295

devenu en grec to, en gothique tha, en ancien slave to; il est resté ta en lithuanien (nominatif tas «celui-ci»). Au féminin, nous avons tâ en sanscrit et en zend, tâ. en grec, thâ en gothique1, ta en ancien slave et en lithuanien2.
Le latin n’emploie pas ce pronom à l’état simple, si ce n’est dans les formes adverbiales turn, tune (rapprochez hune), tam, tan-dem, ta-men. J’ai rapproché autrefois3 ce dernier mot du locatif sanscrit tàsmin; mais je suis arrivé aujourd’hui à douter que le « des locatifs pronominaux en sm’-in ait fait partie primitivement de la désinence casuelle. En effet, nous ne le retrouvons dans aucune langue congénère, pas même en zend, et les pronoms des deux premières personnes, en sanscrit, s’abstiennent de prendre au locatif (mdy-i, tvây-i) ce n inorganique, quoique sur d’autres points ils s’éloignent de la déclinaison ordinaire en a; je crois donc qu’il faut comparer cette lettre n avec le v ephel-kysticon en grec, là où celui-ci n’est pas simplement ajouté pour éviter un hiatus. Au sujet du latin tam-en, je retourne a 1 opinion que j’avais exprimée dans le principe, et je vois dans meti une particule de même famille que le (tév grec; tamen serait donc, en quelque sorte, le grec (lévTot renversé, avec cette différence que ta, dans tamen, serait un accusatif pluriel neutre.
Comme dérivés du pronom en question, nous avons encore en latin les formes tâlis, tantu?, tôt, totidem, totiês. Quant au pronom lui*même, il se présente à nous dans le composé tste, où il a conservé sa déclinaison. Ou bien la première partie, îs, est un nominatif masculin pétrifié, qui conserve aux cas obliques un signe casuel dont la valeur a cessé dêtre comprise (istius pour ejustîusy, ou, ce que je crois moins vraisemblable, le s de
1 Vaje* S 89, t.
~ VOjÔES yâ".
3 Voyez la ire édition de la Grammaire comparée, S 343.
* Un fait analoguo so voit on allemand, où l’on dit au génitif jedamam’s «de l'hacuit» (pour jedesmannts).

296

is est une addition purement phonétique, qui s’expliquerait par le penchant qu’a le latin à rapprocher les lettres s et t (§§ 95 et 96).
S 344. Pronoms renfermant le thème ta, en sanscrit, en zend et en grec. •
» . % .
Le sanscrit et le zend peuvent combiner, comme le latin
(S 343), le thème pronominal ta avec un autre pronom. Ils le combinent avec ê, et forment ainsi le composé HTT êtd « celui-ci, celui-là», en zend aita (S 33). Le nominatif singulier est en sanscrit êsd, êsâ, état; en zend, a^> “{gSXÎ* a™a>
aitad.
En grec, outrés est un composé analogue, dont le premier membre av sera examiné plus loin. Le pronom avrés se combine à son tour avec l’article et fait ovros, avrrj, rovro , pour ô-otv-tos, v-av-rtj, ro-av^ro. Les formes outos, rovro peuvent être expliquées de différentes manières. On peut supposer que la voyelle de l’article a été supprimée et que l’a de la dipbthongue av a été affaibli en 0, pour alléger le mot composé1. Dans cette hypothèse, oSros serait pour h-ovros, et rovro pour r-ovro. Quant à la forme féminine aura, elle aurait conservé la diph— thongue intacte, comme ravré. Mais on peut aussi admettre que c’est le premier élément de la diphthongue qui est tombé et ([ue ailrrj est pour '«-iJt>7 ; le genre se trouverait alors exprimé deux fois dans le composé, et la différence qui sépare le féminin ailrf) du thème masculin-neutre rovro serait mieux justifiée. Cette seconde explication peut s’étendre au masculin et au neutre, qui seraient pour è-vros, ro-vro.
Max Schmidt2 attribue à oSros une autre origine: il suppose qu’un v a été inséré dans ce mot, qui contiendrait deux fois
• ■ - ■ ■ • ■ ' ’ p, \ ■ ;
1 On a vu (SS 3 el 6 ) que l’a est plus pesant que l’o et que l’e. : : H •
s Oc pronominc prteco-et latino, p. 38 et suiv.
PRONOMS DÉMONSTRATIFS. S 345. 297


l’article; ouzos serait donc pour &tos, avzrt pour &rt\. Il se réfère à to<tovtos, toioütos, 'ryXixovros, qui, selon lui, auraient opéré la même insertion. Mais je crois que ces formes contiennent le thème avro et non pas l’article to; pourquoi, en effet, ce thème, quoique composé, n’entrerait-il pas aussi bien que l’article en composition avec un autre pronom? Je reconnais dans èvzavOa, èvreufev (pour sv9a.v9ai, èvSeüOev, en ionien êv9avza, êvQeürev) l’assemblage de deux adverbes formés de la même façon,-et non, comme le fait Max Schmidt, la répétition des suffixes 3-a, 3-er. En effet, êvzav9a est, selon moi, pour êvO’ + «39a., et èvrsvOsv pour 'êv9zv + aùBevx. La première aspirée a été changée en ténue (en ionien c’est la seconde), pour évites la présence d’une aspirée au commencement de deux syllabes consécutives. Je ne veux pas rechercher si l’e de eù9ev est un amincissement de l’a de aù9sv, en sorte que le premier terme du composé aurait à la fois perdu son v et son e, ou si le second membre du composé a supprimé son a initial. Dans ce dernier cas, on pourrait aussi diviser êvraü9a en êvza-S9a. Quoi qu’il en soit, il est plus naturel d’admettre la réunion de deux adverbes et l’amincissement de l’un d’entre eux, pour éviter la surcharge produite par la composition, que de supposer le redoublement d’un suffixe formatif et l’insertion d’un y inutile, d’autant plus qu’il serait sans doute difficile de justifier- par l’exemple de faits analogues ces deux dernières hypothèses.
S 345. Le thème pronominal sa.
Au nominatif singulier masculin et féminin, le sanscrit remplace par un s la dentale initiale du pronom en question; il en est de même en gothique. Au lieu d’un s, nous devons trouver en zend un qy h (§ 53) et en grec un esprit rude. Le pronom
1 Les adverbfis aCiïa, aOBsv, qui, il est vrai, ne sont restés usités qu’en composition , dérivent tous deux du thème pronominal «tî, sur lequel nous reviendrons.
298 PRONOMS.


ta fait donc, au nominatif, en sanscrit, sa, sa, tat; en gothique, sa, sô, thata; en zend, hô, liâ, tad; en grec, ô, c5, t6. Dans Je sanscrit classique, ce thème pronominal sa n’est employé que comme sujet, c’est-à-dire au nominatif; mais il a peut-être eu à l’origine une déclinaison complète, car nous trouvons encore dans le dialecte des Védas le locatif sd-smin, formé comme td-smin, et en latin nous avons l’accusatif sum pour eum, sam pour eam, sôs pour eôs, et le nominatif féminin sapsa pour ea ipsa. Le s de ce pronom nous a fourni plus haut (§ i34) une explication satisfaisante du signe du nominatif; de même que le « du pronom, celui du nominatif est exclu du neutre.
Le grec a conservé un reste de cet ancien s dans les adverbes cw'ixepov et ctâtss; mais comme ces deux composés expriment la relation de l’accusatif et non celle du nominatif, et comme le s, en sanscrit, est réservé à ce dernier cas, ils sont moins conformes à la grammaire sanscrite que l’attique ty'pepov, tâtés. Si nous décomposons ces deux adverses, nous voyons que le thème pronominal qui forme le premier membre a affaibli son o final en e, pour s’unir d’une façon plus intime avec l’e ou avec Yy suivant : tâtes, ctâtsî viennent de te-etes, ere-erss (pour to-etss, cto-etes); Trlfispov, a-ypepov viennent de is-ypepov, ' a-e-ypspov (pour ro-ypspov, cro-ypepov).MCes adverbes correspondent aux composés adverbiaux sanscrits304 (S 988) qui contiennent comme dernier membre un substantif, lequel prend toujours la forme accusative neutre.
Nous mentionnerons, en albanais, quelques adverbes de temps qui contiennent, dans leur première partie, des restes intéressants du thème pronominal sanscrit sa; la seconde partie présente les mêmes dénominations du jour, de la nuit et de l’année qu’on retroure dans les autres idiomes de la famille. Ce

PRONOMS DÉMONSTRATIFS. S 346-347.
sont : cto-t (albanais du nord so-d) «aujourd’hui», « cette nuit », crt-vjét « cette année »1.
299
aé-vTs

S 346. Le pluriel oi, ai en grec.
C’est par abus que le grec opère aussi au nominatif pluriel oi, ai, le remplacement du t primitif par l’esprit rude. Nous avons, au contraire, conservé les anciennes formes dans le do— rien et l’épique toi, tal. Comparez le sanscrit % tê, rTT^ tâs, le zend tê, pup tâo, le gothique thai, thôs (S 228“).
S 347. Absence du signe casuel au nominatif sa, en sanscrit. —
Fait identique en grec et en gothique.
Il nous reste à parler de la coïncidence remarquable qui fait qu’au nominatif singulier masculin, le grec, le gothique et le sanscrit s’abstiennent du signe casuel : nous avons en grec ô, au lieu de bs, comme en sanscrit et en gothique sa, au lieu de sas. Cependant sas, en gothique, serait analogue au nominatif hvas du thème interrogatif hva «qui?» (§ i35). En sanscrit, la suppression du signe casuel n’est toutefois pas constante, car devant une pause nous avons sali, par euphonie pour sas (S 22), et devant les mots commençant par un a, nous avons sô2. A la forme sô se réfère le zend î?0» hô, qui est la seule forme usitée dans cette langue; il n’y a pas d’exemple de la forme ha, qu’on pourrait s’attendre à trouver en regard de sa. Quoiqu’il y ait entre ^ hô et le grec b une ressemblance frappante, il ne faut pas chercher dans le son 0 la preuve de la parenté des deux formes, car le grec b représente, comme d’habitude (§3), 305
PRONOMS.

300

le m a sanscrit, et la désinence casuelle de l’article est supprimée, tandis que le zend hô suppose la présence du signe casuel (s devenu u) et sa contraction avec l’a du thème.
S 348. Explication du fait exposé dans te paragraphe précédent.
On vient de voir que le pronom dont il est question s’abstient volontiers de prendre le signe habituel du nominatif : on peut donner deux raisons de ce fait. Le signe casuel s provient lui-même du thème sa, de sorte que sa aurait été exprimé deux fois et se serait combiné avec lui-même; en second lieu, le rôle propre des pronoms étant de désigner les personnes, ils n’ont pas besoin d’être encore accompagnés du signe qui sert a marquer la personnalité. Voilà pourquoi «je», <«l|t^tvam
«tu», ayant «celui-ci», svaydtn «ipse», prennent
bien une désinence, mais la désinence de l’accusatif qui sert aussi pour le neutre, et non la désinence agissante et personnelle du nominatif; dans wf asâü (masculin-féminin) «celui-là, celle-là», la désinence manque absolument305. Le latin obéit au même principe pour ses pronoms hi-c, 'Me, iste, ipse, au lieu desquels on attendrait his-c (comparez hun-c, venant de hum-c), illus, istus, ipsus (lequel, en effet, est quelquefois employé); il distingue le relatif qui de l’interrogatif quis, lequel a quelque chose de plus énergique, grâce à la présence du signe casuel.
C’est pour une raison analogue que les thèmes pronominaux en a, au nominatif masculin pluriel, n’ont pas la désinence habituelle as, mais suppriment le suffixe casuel et élargissent en TJ ê, par le mélange purement phonétique d’un i, l’a final du 306
PRONOMS DÉMONSTRATIFS. 8 349. 301


théine; exemple : w tê, d’où viennent le datif-ablatif tê'-byas, le génitif tê'-sâm, le locatif te-su. On a montré précédemment (§ 228°) le rapport qui existe à cet égard entre le sanscrit et les langues congénères. Ajoutons encore ici que les pronoms de la première et de la deuxième personne n’admettent pas non plus au pluriel la désinence as, mais font, avec une désinence de singulier neutre, ô^s^vaydm «nous», i^ij^yû-y-dm «vous». Dans le dialecte védique, nous trouvons 'i?r% asmê' «nous», 3* yuémê' «vous», d’après l’analogie des pronoms de la troisième personne. Les formes grecques amies, v/ipes, ùjieis, ti[iets paraissent donc n’être pas primitives ; elles renferment la désinence ordinaire du nominatif qui se sera introduite par abus dans la déclinaison pronominale. Ce qui a été dit plus haut (SS 335 et 337) de la lettre s du lithuanien mes, jüs, du gothique veis, jus et du latin nos, vôs acquiert par les exemples précités une nouvelle vraisemblance. Le thème pronominal amü «celui-là» évite également au pluriel masculin la désinence nominative as; il fait ami, et cette forme sert de thème à tous les cas du pluriel, excepté à l’accusatif : ami-bis, ami-byas, amî’-sâm, amî'-su. Cet exemple vient encore confirmer l’explication que nous avons donnée du nominatif pluriel lê et des formes analogues, que nous regardons commé privées de flexion.
S 3kg. Tableau comparatif de la déclinaison du thème pronominal ta.
Je donne ici le tableau comparatif de la déclinaison complète du pronom en question. Pour le latin, je prends le composé is-te, la forme simple n’étant pas restée dans la langue. J’ai mis entre parenthèses les formes zendes dont je ne connais pas d’exemple : je les ai restituées d’après l’analogie du composé upX)* ai-ta et d’autres pronoms de la troisième personne, dont le pronom ta n’a pas dû s’éloigner à l’origine. Rappelons

302
toufefois ici l'amollissement du l en à dont il a été question plus haut (§ 343).

SINGULIER.
Masculin.
|
Sanscrit. |
Zend. |
Grec. |
Latin. |
Gothique. Lithuanien. |
A. slave. |
|
Nominatif, sa,sali,sô |
hâ |
6 |
is-te |
sa tas |
t& |
|
Accusatif., tara |
tëm |
T ÔV |
is-tum |
tham tah |
tü |
|
Instrumen. tenu |
(tâ) |
thé1 tu, tûmi |
tèmi | ||
|
Datif..... tdsmâP |
(tahmâi) |
S 195 ss. |
is-tî | ||
|
Ablatif. .. tâmât |
(tahmâd) |
is-to(d) | |||
|
Génitif. .. tasya |
(tahêy |
TOÏO |
is-lîus |
this - tô | |
|
Locatif... tàsmin |
(lahmi) |
Neutre. |
lomt321 | ||
|
Nom.-acc.. tatu |
tad |
TÔ |
istud |
thata tai |
to'\ |
Le reste comme au masculin.
PRONOMS DÉMONSTRATIFS. S 849.

303

Féminin.
Sanscrit. Zeml. Grec. Latin. Gothique. Lithuanien. A. slave.
Nominatif, sâ hâ % v is-ta sô ta ta
Accusatif., tâm (tanin) w,tvv is-lam thô tah tun ^
Instrumen. tàyâ (tahmya)'.............‘T”
Datif..... tâsyâi (tanhâi)322 323 324 325 326 S 190 **-ft thisai tai toj
Ablatif. .. làsyâs tanhâd .......is-ta(â)............... • •
Génitif. . . tàsyâs (tanhâo) tSs, ir)s is-lîus thisâs tôs toj ail
Locatif. . . tàsy&m (tahnya) .................toî‘
DUEL.
Masculin.
Sanscrit. Zend. Grec. Lithuanien. Ancien slave.
Nominatif-acc. tâu, tân (lâo, ta) reb tiï-du ta ^
Instr.-dat.-abl. lab’yâm {taiibya) dal. rom327 328 329 dat. tem-dwèm330 331 332 instr.-d. ténia'”
Génitif-locatif, tâyôs (tayô) gén.-roïv gén. tû-dwëjü toju11.
Neutre.
Nominatif-acc. le 333 (té) .................te •
Le reste comme an masculin.

PRONOMS.

Féminin.
|
Nominatif-acc. |
Sanscrit. tê1 |
Zend. (tê) |
Grec. X Ta |
Lithuanien. Ancien slave. ie-dwi tê2 |
|
Instr.-dat.-abl. |
taliyâm (tâbya) |
dat. tcüv |
tom-dwêm, tôm tenta | |
|
Génitif-locatif. |
tdyôs |
gén. Tam |
gén. tu-dwêjü toju. | |
|
Nominatif. ... |
Sanscrit. tê3 |
PLURIEL. Masculin. Zend. tê |
Grec. Latin. TOI, 01 is-tî | |
|
Accusatif. ... |
tân |
(tan) |
TÙVS, tous4 is-tos | |
|
Instrumental. . |
tais |
(tais) |
V. le locatif, is-lis | |
|
Datif-ablatif... |
tê'Hyas |
taiibyô | ||
|
Génitif...... |
tê'sàm5 |
(taisahm) |
T!ûv is-lorum | |
|
Locatif...... |
têsu |
(taiêva) |
datif toôti ........ | |
|
Gothique. |
Lithuanien. Ancien slave. | |||
|
Nominatif. .. |
thai° |
tê1 |
a'8 | |
|
Accusatif. . . |
thans |
tus, tus |
tü9 | |
|
Instrumental. |
. tais |
têtni | ||
|
Datif-ablatif.. |
thaim |
témus |
têmü | |
|
Génitif..... |
thisê |
tu |
têchü10 | |
|
Locatif..... |
. tûsè |
têchü. | ||
1 Voyez S a 13. _ '
» Sur la différence d’origine, au duel, des formes féminines en * o el des formes
neutres, voyez S aiA. \ •
3 Yoyez S aa8 -
4 Voyez § a36.
5 Voyez S aü8. ,
6 Voyez S 228°. ,
7 On écrit ordinairement lie, mais on prononce tê; de même, en letle, tce= la.
(Voyez S aa8b.)
8 Voyez S aa8b.
9 Voyez S 276.
14 Voyez 8 379.

PRONOMS DÉMONSTRATIFS. 8 349.
Neutre.
305

Sanscrit. Zcnd. Grec. Latin. Gothiqac. Liihuan. A. slave.
Nominatif-accusatif. . lani, là tâ' râ is-ta thé ..... ta*
Le reste comme au masculin. 334 335 336 337 338 339 340
Féminin.
|
Sanscrit. |
Zend. |
Grec. |
Latin. | |
|
Nominatif...... |
(tâo) |
tai, ai3 |
is-tœ | |
|
Accusatif...... |
... tas |
(tâo) |
J. ras |
is-lâs |
|
Datif-ablatif. . .. |
(tâhyô) |
V. le locatif. |
is-tts | |
|
Génitif........ |
( tâonhahm)4 |
râatv, rûv |
is-târum | |
|
. . . tasu |
(tâhva) |
datif taîm | ||
|
Gothique. |
Lithuanien. |
Ancien slave. | ||
|
Nominatif...... |
tôs |
tüs | ||
|
Accusatif...... |
tas |
tü | ||
|
Instrumental.. . . |
tômls |
têmi | ||
|
Datif-ablatif.. . .. |
. . . thaim6 |
datif lâmus |
datif têmii | |
|
Génitif........ |
tü |
têchü | ||
|
Locatif........ |
tôsè |
téchü1. |
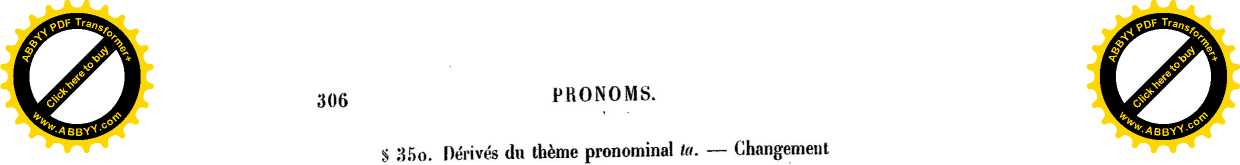
du l initial en d.
On a vu plus haut (§ 343) que le zend amollit souvent le t du thème pronominal ta en d. Le même fait a lieu en grec pour la particule annexe Sé (employée aussi a 1 état isolé comme conjonction), à laquelle on ne saurait sans doute assigner une origine plus vraisemblable que le thème pronominal to. L affaiblissement de la voyelle o en s est le même qu’au vocatif dénué de flexion des thèmes en o (§ 204), ou aux accusatifs également dénués de flexion fie, o-e', s (§ 3q6). L abaissement de la ténue en moyenne a lieu aussi en sanscrit dans les formes neutres i-ddm «hoc» et a-dds «îllud», en supposant que ces mots doivent être divisés ainsi ', ce qui semble être confirmé, en ce qui concerne i-ddm, par le latin i-dem, qui-dam. En sanscrit, i-dam et a-dds sont seuls de leur espèce; mais, à l’origine, ils ont pu avoir une déclinaison complète, comme nous voyons que le grec Se a encore dans Homère un datif pluriel Sevcrt, Seat (to?s<Wi, tohSemy. Rappelons ici que toutes les vraies conjonctions, dans la famille indo-européenne, tirent leur origine, autant qu’il est possible de la constater, des pronoms. Leur signification pronominale se montre encore d’une façon plus ou moins apparente; ainsi les conjonctions pév et Sé sont entre elles dans le même rapport que «hoc» avec «illud» ou «alterum». On peut, à l’égard du sens, rapprocher l’allemand aber « mais », vieux haut-allemand afar, dont la parenté avec le sanscrit
avec la forme usitée dans le sanscrit ordinaire 4-b'ü «par ceux-ci». Au contraire, le
lithuanien tant, pour lequel on s’attendrait à trouver en ancien slave TXI tù (S 376),
s’accorde avec le sanscrit tâis. A l’accusatif pluriel féminin, T2I tü s’accorde aussi bien avec les accusatifs des thèmes masculins en 0 qu’avec les accusatifs des thèmes féminins en a (S 375).
1 Voyez mon mémoire De l’influence des pronoms sur la formation des mots, p. 13.
> Sur la désinence aoi, venant de oFt, voyez SS a5o et a5a.
11.
PRONOMS DÉMONSTRATIFS. § 351. 307


àfara-s «l’autre?? a été démontrée ailleurs1; de même, le gothique ith «mais??, sur lequel nous reviendrons, et le latin au-tem sont d’origine pronominale.
8 35 j. Autres dérivés du thème pronominal te.
Le même abaissement de la ténue en moyenne que nous avons observé pour le grec Sé et que nous constaterons plus tard pour Ssha, se montre en latin dans les adverbes dum, démuni, dônec, dônicum, dênique, qui tous, avec plus ou moins de certitude, peuvent être regardés comme appartenant à notre thème pronominal. Peut-être faut-il ajouter dudum, en le considérant comme le redoublement de dô (pour tô). En sanscrit, le redoublement des pronoms exprime la multiplicité; mais les deux pronoms restent déclinables. Ainsi yô yas signifie «qui que ce soit??; accusatif : y ah yam; ce sont les corrélatifs de sa saK, tan tam. Si lotus ne vient pas de la racine g tu «croître??2, on y peut voir le redoublement de deux pronoms, en sorte qu’il signifierait «ceci et cela, les deux moitiés, l’ensemble??. Il en est de même pour quisquis. Dans dudum l’idée de multiplicité est si clairement contenue que j’aime mieux y voir l’assemblage de deux éléments semblables que la réunion de diu et de dum. Entre dudum et totus le rapport phonétique est le même qu’entre dum et tum. Nous avons expliqué plus haut (§ 343) tum comme un accusatif; il est vrai que nous ne trouvons pas dans ces adverbes pronominaux la signification qui est marquée habituellement par ce cas; mais il arrive souvent que dans les adverbes les flexions casuelles s’éloignent de leur acception ordinaire.
Je ne voudrais pas nier toutefois que dans tous les adverbes pronominaux de cette espèce, ou dans quelques-uns d’entre eux, le m final ne pût être expliqué comme appartenant au pronom
1 Vocalisme, page 155.
2 Vojez S (>i5.
308 PRONOMS.


annexe sma, qui est si fréquemment employé en sanscrit et dans les langues congénères, et que nous avons reconnu déjà dans immo (pour ismo). Si cette conjecture est fondée, les formes latines clum, tum, tam, quant, etc. ont gardé du pronom annexe et des désinences casuelles qui y étaient jointes juste autant que les datifs allemands dem « au », wem « a qui ? ». Le locatif conviendrait très-bien pour dum «pendant» et tum «alors», qui correspondraient, par conséquent, au sanscrit ta-smin, a 1 ancien slave to-mï. Le latin tum signifie aussi «ensuite», qu’on exprime en sanscrit par tâtas (littéralement «de là»); on pourrait songer ici à l’ablatif WT^ td-smât, car il n est pas nécessaire que tum appartienne, dans toutes ses acceptions, à un seul et même cas, et le m de sma se trouve aussi bien à l’ablatif smât qu’au locatif sm*n ou au datif # smâu
§ 35e. Autres dérivés du thème pronominal ta.
Le latin dêmum, considéré comme forme démonstrative, s’accorde très-bien avec le grec riff/os, si l’on fait abstraction de l’amollissement de la consonne initiale; la ressemblance est encore plus grande avec la forme archaïque dêmus. Dans rüfios, qui a pour corrélatif ifcos, il n’est pas nécessaire de reconnaître avec Buttmann le substantif ifaap comme dernier membre, quoique cette explication semble confirmée par mrnfsap; j’aime
étant simplement un allongement des thèmes to, ô1. C’est ainsi que nous avons en sanscrit *TT^ya^vat «quot, quamdiu, dum » et son corrélatif m^ta-vat, avec allongement de la voyelle du thème. 11 ne serait peut-être pas trop hardi de voir dans pos une altération de vat, le «s’étant durci en fi (§ ao) et le t s’étant changé en s à la fin du mot, ainsi qu’il arrive toujours en grec quand le t final n’est pas supprimé (§ i83\ i).
1 On a vu (SS 3 et 4 ) que o représente le u a, et v le UT « sanscrit.
PRONOMS DÉMONSTRATIFS. S 352. 309


Le sens démonstratif n’apparaît plus d’une façon aussi visible dans dêmum, clêmus, que dans l’expression grecque congénère : la signification ordinaire de dêmum est «seulement, enfin». Remarquons toutefois qu’une phrase comme nunc dêmum vents ? peut s’entendre ainsi : «c’est à cette heure que tu viens?» Dans cette phrase, l’idée de temps est marquée à la fois par nunc, venant du thème démonstratif nu, et par dêmum.
H n’est pas nécessaire que dans les adverbes de temps et de lieu le temps et le lieu soient formellement exprimés; on peut même observer que le plus souvent l’expression formelle de cette idée est absente. Mais l’esprit humain fait entrer après coup dans un mot déjà créé les catégories de l’espace et de la durée. C’est le propre des pronoms de marquer d’une façon accessoire la situation dans l’espace, en même temps quils désignent un objet ou une personne : or, de l’idée d espace on est conduit aisément à celle de temps. Ainsi, en allemand, wo «où» se dit du lieu, wann «quand» se dit du temps, et da «ici, alors» de l’un et de l’autre, quoique ces trois mots, si nous en examinons l’origine, n’expriment qu’une notion pronominale.
S’il s’agit de marquer des divisions du temps tout à fait précises, il est naturel que le pronom se réunisse à un mot désignant la division en question; exemples : Mie, o-faepov, heute (vieux haut-allemand hiutu, § 16o). Mais cest encore la notion pronominale qui est la plus indispensable, et si 1 un des deux termes devait cesser d’être représenté, ce serait plutôt celui qui marque la division du temps. En effet, avant tout il importe de savoir si nous parlons du moment présent ou d’un moment éloigné. Aussi la langue conserve-t-elle de préférence l’élément pronominal, comme nous pouvons le voir par 1 allemand moderne heute', et même par le vieux haut-allemand hiutu, où le
deuxième terme est déjà fort effacé.
Je ne peux donc pas croire que les adverbes dum, dêmum,


dôme, dênique renferment le mot «jour». Je m’y résoudrais plutôt pour quon-dam et tan-dem, sans que pourtant cette explication soit nécessaire; encore moins sommes-nous obligés d’admettre cette origine pour qui-dam, qui-dem, i-dem. Si cependant quondam contient véritablement le nom du «jour», la forme la plus voisine, en sanscrit, est l’accusatif dyâm, du thème dyôK Mais comme les accusatifs dyâm et gâm sont des contractions relativement récentes de dyâv-am et gav-am (§ 129), ainsi que le prouvent les accusatifs latins Jov-em et bov-em, il faudra recourir au thème féminin divâ 2, d’où vient également le theme latin diê «jour» (avec ê = â, §§ 5 et 92k). A l’accusatil divâ-m on peut rapporter aussi le grec Syv «longtemps», s il vient en effet, comme le latin dm3, d’une désignation du jour. Dans ce cas, Sr{v serait pour Siyv (venant de SiFyv), comme en latin dem, dans pridem, pour diem (comparez pridie). Quant a la particule Srf, je la rattache de préférence à notre thème démonstratif, dont elle rappelle encore dans l’usage la signification, puisqu’elle sert à mettre en évidence et à renforcer le mot auquel elle est jointe.
1 En sanscrit classique, dyô signifie seulement «ciel»; mais dans les Vedas il est aussi employé avec le sens de «jour».
2 Ce thème ne paraît plus, en sanscrit, qu’au commencement des composés, comme divâ-kara-s «auteur du jour, soleil», divâ-râtrar-m «jour et nuit». Mais, à l’origine, divâ a eu sans doute la déclinaison complété.
3 Au latin diû répond, en sanscrit, le thème dyu «jour», dont ïu est la vocalisation du v de la racinç div «briller». Le nominatif dyu-s n’est peut-être pas employé; mais le dius du latin nu-dius s’y rapporte (voyez Pott, Recherches étymologiques, 1" éd. t. I, p. 96). Au contraire, le s de interdius paraît appartenir au thème, ainsi que celui des adverbes sanscrits commepûrvê-dytt» «hier», littéralement «le jour d’avant». D’accord avec Pott, je considère ici dyus comme un accusatil neutre, dont le thème non contracté serait diva». Si nous n’avons pas conservé divas, nous avons du moins ie mot divam , qui paraît en être dérivé comme lamasâ de tdmas «ténèbres» (voyez Bohtlingk, Les suffixes rnâdi, III, 116). En effet, le suffixe Ma semble n’être pas autre chose qu’un élargissement du suffixe ordinaire as. On peut comparer, à cet égard, en gothique, le suffixe neutre i»a (S 933).
PRONOMS DÉMONSTRATIFS. S 353. 311


Nous retournons au latin dônec, dont la forme plus complète dânictm doit être divisée ainsi : dô-nicum*; j’y reconnais un mot formé des mêmes éléments et de la même manière que le grec
sur lequel nous reviendrons plus loin. La signification j
de dônec est «aussi longtemps que », ce qui équivaut à «pendant le temps où» : dô exprime l’idée pronominale, et nec, nicum l’idée de durée; en effet, il est probable, ainsi que nous le montrerons plus tard (S 4ah), que la seconde partie du mot désigne j une division du temps. Au contraire, dans «H4^ ydvat, qui vient du thème relatif ya et qui signifie «aussi longtemps que» fit «jusqu’à ce que», c’est l’idée pronominale seule qui est exprimée. On en peut tirer un argument nouveau pour reconnaître dans dônec, dônicum la présence d’un élément démonstratif. L’origine de dênique paraît être la même que celle de auquel il ressemble d’une façon surprenante; au sujet du changement de k en qu, rapprochez, par exemple, le sanscrit hi-s, ki-m, qui est représenté en latin par qui-s, qui-d (S 86, i )■
S 353. Les thèmes dérivés tya et sya, en sanscrit et en gothique.
Le thème pronominal n ta se combine en sanscrit avec le thème relatif ^ ya pour former un nouveau pronom de même sens, qui est employé surtout, sinon uniquement, dans les Vé-das, et qui, comme il est arrivé pour beaucoup d’autres particularités du dialecte védique, est resté d’un usage plus fréquent dans nos langues de l’Europe que dans le sanscrit ordinaire. Dans ce pronom composé, l’a de ta est supprimé, ce qui donne tya. Comme pour le simple ta, le t, au nominatif singulier masculin et féminin, est remplacé par s; on a, par conséquent, syas, sya, tyat; mais, à l’accusatif, tyam, tyârn, lyat, etc. Le theme sya,qui, avec son féminin syâ, ne sort pas en sanscrit du nonii-
* Voyez mon mémoire De l’influence des pronoms sur la formation des mots, page ta.
PRONOMS.

312

natif, s’est formé dans plusieurs langues congénères une déclinaison complète; en slave, il a pénétré même dans le neutre. C’est le gothique qui s’est le mieux maintenu dans les bornes du sanscrit; il ne laisse pas sortir ce pronom du nominatif singulier. Toutefois, il n’a conservé que la forme léminine si, qui ferait attendre un masculin sji-s (plus anciennementsja-s, § i35). La plupart des formes qui expriment en gothique 1 idee de a il, elle» sont dérivées du thème démonstratifs parmi lesquelles si, quoique d’origine différente, est venu se mêler1. Ce si, venant du thème sjô = sanscrit syâ, est une forme mutilée pour sja, d’après l’analogie des thèmes substantifs en jô'\ tels que thiujô, qui fait au nominatif thivi au lieu de thiuja.
I 354. Le thème dérivé sya, en vieux haut-allemand.
Mieux conservé que le gothique si est le vieux haut-allemand siu (ou sju), lequel n’a pas laissé périr complètement la sanscrit de syâ, mais qui l’a abrégé en a et affaibli ensuite en u. La forme siu n’est pas d’ailleurs aussi isolée en vieux haut-allemand que si en gothique, car le thème sio a donné en outre l’accusatif singulier sia et le nominatif-accusatif pluriel sio. Cette dernière forme supposerait comme accusatif, en gothique, s/os et, en sanscrit, ^Tt\syâs. En regard du nominatif singulier siu, on peut être surpris de trouver un accusatif sia, car on aurait pu s’attendre à trouver une même forme pour les deux cas. La différence vient de ,ce que le nominatif, dès la période la plus ancienne, était privé de toute désinence casuelle, au lieu qu’à l’accusatif la voyelle du thème était protégée par une nasale; c’est cette nasale qui aura préservé l’a, de même quen grec nous trouvons souvent un a final là où originairement le mot avait encore après l’a une nasale, au lieu que dans les mots où
1 En allemand moderne, de, ■— Tr.
- Deuxième déclinaison forte de Grimm.
PRONOMS DÉMONSTRATIFS. S 355.

313

l'a, de toute antiquité, était final, il est ordinairement devenu e ou o. Comparez eV7a, êvvéot, Séxa avec le sanscrit sdptan, ndvctn, (Ms/.in1 ; ëSciÇet. avec ddikéatn; tsoSa. avec ViïÇtfpddam. On
a, au contraire, ëSsiÇs en regard de ^r^ddilcsat, <m! en regard de Wïï dsva, êSeî^aTo en regard de ddiksata.
$ 355. Déclinaison du thème tya, en vieux naut-aiiemand.
Nous avons vu (§ 3A3 et suiv.) qu’en gothique comme en grec l’article provient des thèmes ^ sa, *fT sâ, <T ta, în tâ. Au contraire, en vieux haut-allemand, l’article est représenté par le pronom composé Sf tya, féminin tyâ, qui est employé même au nominatif; on a donc ati féminin diu (ou peut-être dju), comme plus haut nous avons eu siu; à l’accusatif dia, en regard du sanscrit tyâm, et au nominatif-accusatif pluriel dio = tyâs. En ce qui concerne le pluriel masculin, comparez die avec le nominatif sanscrit W lyê; la forme du nominatif, en vieux haut-allemand, sert aussi pour l’accusatif, de sorte que ces deux cas du pluriel sont semblables dans les trois genres. Au neutre pluriel, diu s’accorde avec les formes comme clmnniu, qui viennent des thèmes substantifs en ta. Au singulier masculin et aux cas du singulier neutre qui sont identiques à ceux du masculin, on n’aperçoit pas du premier coup d’œil la nature composée de ce thème pronominal : si nous bornions notre examen aux formes dër, des, dëmu, dën, nous ne les rapporterions pas à tya, mais au thème simple (T ta, comme les formes gothiques de même sens. Mais à moins de séparer absolument dër, dës, dëmu, dën du reste de la déclinaison, ou à moins d’admettre qu’un i parasite a été inséré dans diu, dia, die, ce qui n’est justifié ni par le sanscrit, ni par le lithuanien et le slave, et ce qui n’a lieu nulle part ailleurs en vieux haut-allemand, il est
1 On a vu (SS 189 el 313 ) qu’en vertu des lois phoniques du sanscrit ces noms de nombre font au nominatif-accusatif sâpta, ndva, àma.
314 PRONOMS.


impossible d’expliquer dër, des, dëmu, dm, sans admettre d’anciennes formes djar, djas (= tyas, tydsya). Je suppose que la syllabe ja a sacrifié l’a et vocalisé le j, comme il arrive fréquemment en gothique (§72); c’est ainsi que nous avons vu plus haut (§ 353) si dériver de sja et thivi de thiuja : or, le en vieux haut-allemand tient très-souvent la place d’un t gothique.
§ 356. Tableau comparatif de la déclinaison du thème tya, en sanscrit et en vieux haut-allemand.
Si la déclinaison du pronom en question s est partagée en deux séries de formes, les unes avec ë, les autres avec i (ou j) suivi d’une voyelle, ce partage ne s’est pas fait au hasard : presque partout où nous avons la contraction en ë (au lieu dt), le sanscrit a un a bref après le ^ÿ1; quant à la forme plus complète, elle se trouve seulement là où un â long ou la diph-thongue ê suivent, en sanscrit, la semi-voyelle. La réciproque, cependant, n’a pas toujours lieu : ainsi au génitif pluriel nous avons dëro (pour les trois genres), quoique le sanscrit ait tyê'sâm (masculin-neutre) et tyâsâm (féminin); et au datif nous avons, en vieux haut-allemand, à côté de diêm ou dien341 342, les formes plus usitées dêm ou dên. L’instrumental neutre diu (§ 160) se rapporte à une forme tyâ, qui serait, en ancien perse, la forme régulière de l’instrumental343; ici encore IV ou le j s’est conserve là où originairement Je y était suivi d’une voyelle longue. On peut comparer :
Singulier.
|
Sanscrit. |
V. haut-allemand. | |
|
Nominatif. . .. |
dër1 | |
|
Accusatif. . . . • |
. . . tyam, |
dën |
|
Datif........ |
dëmu | |
|
Génitif....... |
des |
Sanscrit. V. haut-allemand.
tyê
tyân
tyeüyas
tyesâm
NEUTRE.

PRONOMS DÉMONSTRATIFS. S 356.
315

Pluriel.
die
die
diêm
dëro.
Nominatif-accusatif, tyat daz tyam, tyâ diu
Instrumenta!.....tyêna, tya344 345 346 diu tyais
Le reste comme au masculin.
FÉMININ.
|
Nominatif. ... |
... syâ |
tyâs |
dio | |
|
Accusatif... . • |
dia |
tyâs |
dio | |
|
Datif........ |
dëru |
tyiïhyas |
dtèrn | |
|
Génitif....... |
dëra |
tyasâm |
dëro. |
Remarque 1. — L’article en vieux haut-allemand et en vieux frison. — On vient de voir que l’article gothique se rattache par ses cas obliques et par son nominatif neutre (tha-ta) au thème démonstratif ta : si ce thème n’a pas entièrement disparu de la déclinaison de l’article en vieux haut-allemand, on y dpit rapporter le neutre daz\ en allemand moderne das, en vieux saxon that. Mais il se pourrait aussi que ces formes eussent perdu
I


3l6 PRONOMS.
un i ou un j devant leur a , en sorte que le vieux saxon lhat fût une forme mutilée pour tjal ou thial (sanscrit tyat) et que le vieux haut-allemand claz fût pour cljaz ou diaz'. Je préfère actuellement cette dernière explication, à cause des mutilations analogues qu’on rencontre dans la déclinaison des thèmes substantifs en ja. Le thème gothique hairdja (nominatif hairdeis) n’a conservé le j du thème, en vieux haut-allemand, qu’au nominalif-ae-cusatif, où il s’est vocalisé en i (hirti «pastor, pastorem»); Ye du génitif hirte-s est l’altération de Y a du thème (comparez en vieux saxon hirtjes, h côté de hirtea-s). Pour les autres cas, on peut rapprocher le datif gothique hairdja du vieux haut-allemand hirta; au pluriel, le nominatif et l’accusatif hairdjôs, hainlja-ns de hirta, le génitif hairdj’-ê de hirt’-o, le datif hairdja-m de hirtu-m.
Le vieux frison, dont l’article appartient également au thème sanscrit tya, a vocalisé, au nominatif masculin, le y en i et supprimé la voyelle finale du thème; de là la forme thi de». Il a, au contraire, supprimé la semi-voyelle au datif singulier masculin-neutre, ainsi quau datif et au nominatif-accusatif pluriels des trois genres; de là la forme tha, dont Y a est probablement long au datif singulier, où tha est pour tha-m (venant de lhja-m), et au datif pluriel, où tha est pour tkaim (venant de thjaim). Je fais suivre la déclinaison complète d’après Grimm* :
Singulier. Pluriel.
Masculin. Féminin. Neutre. < Pour les trois genres. )
Nominatif....... thi thiu thet3 tha
Génitif.......... thës1 thëre thés thëre
Datif........... thâ thëre thâ , tliâ
Accusatif........ thë-ne thia thet. tha. 349 350 351 352
PRONOMS DÉMONSTRATIFS. S 357.

317

Remarque 2. — Le thème sya en zend, les thèmes sya et tya en ancien pCrse. — Tandis que le sanscrit n’emploie le thème sya qu’au nominatif masculin et féminin, le zend le transporte encore au nominatif-accusatif neutre; il fait donc, avec le changement obligé de s en & h, hyad.
Je ne connais pas, en zend, d’exemple du thème sanscrit tya. Au contraire, l’ancien perse suit exactement l’analogie du sanscrit, et fait hya au nominatif masculin, hyâ au féminin et tya au neutre; cette dernière forme a perdu, comme on devait s’y attendre, la dentale finale (S 86, a “). L’absence du signe casuel au nominatif masculin hya est également conforme aux lois phoniques de cette langue (S il).
S 357. Pronoms composés renfermant les thèmes tya ou sya, en vieux haut-allemand et en lithuanien.
Le pronom allemand dieser « celui-ci » est un pronom composé, comme cïso, ceso en ancien slave (§ 269)• premier membre nous représente le thème sanscrit W tya, qui est devenu l’article allemand (§ 355); mais il n’est pas nécessaire d’admettre que ie suppose un ancien ia : on doit regarder ie comme un allongement inorganique de l’t de la forme notké-rienne di-sêr1. Quant au second membre de ce pronom démonstratif, on en pourrait diviser la déclinaison en deux parties : l’une se rapporterait au thème simple sa, 1 autre au theme composé sya; c’est à ce dernier qu’appartiennent évidemment le nominatif féminin dësiu (= MTT syâ «cette») et le nominatif pluriel neutre de même forme. L’accusatif féminin, ou, au lieii de dësia, nous avons dësa, l’accusatif masculin, ou, au lieu de dësian ou dësën\ nous avons dësan, se rattacheraient avec les formes analogues au thème simple M sa, MT sâ. Mais on peut admettre aussi que Fi ou le j est. tombé comme dans la décli- 353 354

318

liaison de hirti (thème liirtia ou hirtja). Si c’est là, ainsi que je le pense, la vraie explication de la déclinaison de dësêr, la différence qui existe entre les cas de dër et ceux de sèr vient de la surcharge causée par l’adjonction de l’article ; IV est tombé, par exemple, dans dësa «hanc», mais il est resté dans sia «eam».
Il est remarquable de trouver en lithuanien le pronom allemand die-ser en quelque sorte retourné. Je reconnais, en effet, dans le démonstratif si-tas, appelé ordinairement pronom emphatique, d’abord le thème composé sya, ensuite le thème simple ïî ta, l’un employé seulement, en sanscrit, comme sujet, l’autre usité seulement comme régime.
§ 358. Déclinaison du thème sya, en lithuanien et en ancien slave.
Le thème sia (venant de sja), qui forme la première partie du pronom lithuanien précité, a, ainsi que le féminin correspondant, sa déclinaison complète, qui suit en général celle de jis (§ 28a). Le nominatif masculin est sis (pour sja-s, comme dàlgis pour dalgja-s)-, le nominatif féminin est si1, auquel on peut comparer le gothique si (pour sja, en vieux haut-allemand sût2). Au datif masculin, l’archaïque sid-mui correspondrait à une forme sanscrite sya-smâi; au nominatif pluriel, le féminin sios supposerait en sanscrit syâs, et au locatif pluriel le féminin siô-sè demanderait syâ-su : mais les formes en question manquent en sanscrit.
L’ancien slave a le thème masculin-neutre sjo, qui représente le sanscrit (thème masculin) et le sia lithuanien. Mais en vertu des lois phoniques de l’ancien slave, sjo devient partout se (pour sje, § q2: nous avons, par exemple, au datif singulier masculin-neutre, se-mu en regard de to-mu, venant du thème to; au génitif, se-go, au locatif, se-mï, en regard de to-go, to-mï.
' Comparez ti-dessus, p. i56, note 1.
2 Voyez S 356.
PRONOMS DÉMONSTRATIFS. S 358. 319


(l’est avec le thème jo, féminin ja (= sanscrit ya, ya)', que le pronom en question s’accorde le mieux dans sa déclinaison : il y a cette différence seulement que jo ne rejette pas son j devant la voyelle e (comparez, par exemple, je-go et se-go), et quau nominatif féminin il ne contracte pas ja en i.
Je fais suivre la déclinaison complète de sï, si, se «hic, hæc, hocji, pour qu’on la puisse comparer à celle de i,ja,je (§ 282):
Singulier.
|
Masculin. |
Féminin. |
Neutre. | |
|
Nominatif....... |
CL sP |
ch si |
CE se |
|
Accusatif........ |
CL SÏ |
CE se | |
|
Instrumental..... |
CHML si-mi |
CEhfi sej-uh |
chml si-mï |
|
Datif........... |
C£M0\f sc-mu |
CEH sej |
CEMOtf se-wm |
|
Génitif.......... |
ctro se-go |
ceia seja-h |
ccro se-go |
|
Locatif......... |
CEML se-mï |
CEÎi se] |
CEML se-mï. |
|
Duel. | |||
|
Nominatif-accusatif. |
cura sija |
CH si |
CH si |
|
Instrumental-datif. |
CllAVd si-ma |
CHMd si-ma |
CHMd si-ma |
|
Génitif-locatif..... |
Ctto sej-u |
C£IO sej-u |
CEK) sej-u. |
|
Pluriel. | |||
|
Nominatif....... |
CH si |
CHIA sija-h |
CH si |
|
Accusatif........ |
CHIA stja-n |
CHIA sija-n |
CH si |
|
Instrumental..... |
CHMH si-mi |
CHMH si-mi |
CHMH si-mi |
|
Datif........... |
cha\2 si-mü |
CHMS si-mü |
CHM2 si-mü |
|
Génitif.......... |
CHXS si-chü |
CHXX si-chü |
CHXS si-chü |
|
Locatif......... |
CHX2 si-chü |
CHXX si-chü |
CHXS si-chü. |
320 PRONOMS.


Remarque. — Examen d’une objection de Schleieher. — On peut s’étonner de voir, dans le pronom démonstratif en question, le ê lithuanien représenter le s sanscrit du thème sya. Mais il est probable que la semi-voyelle u y, qui est devenue un i en lithuanien, a exercé dans cette langue une influence euphonique sur la sifflante précédente, et quelle a changé le s ordinaire en un s aspiré. Un changement du même genre a lieu en lette, même à l’intérieur du mot, tandis que le lithuanien, dans le corps des mots, conserve son ancien s. Comparez le futur lette bûêu' au futur lithuanien busiu, où la seconde syllabe représente la forme sanscrite syâm. Mais là où en lithuanien le s du futur est seulement suivi d’un i ou n est suivi d’aucune voyelle, le lette a également un s pur; exemples : bus «il sera», büsim (lithuanien busime) «nous serons». De même, on a, d’une part, en lette, dôsu «je donnerai» en regard du lithuanien diïsiu et du sanscrit dâsydmi, mais, d’un autre côté, do-s «il donnera», dô-stm «nous donnerons», en regard du lithuanien dus, dû-sime et du sanscrit dasyati, dâ-sydmns. Le lette présente aussi un s au lieu d’un s sanscrit dans le pronom démonstratif en question, même devant l’t simple du nominatif singulier, où la voyelle du sanscrit syas est tombée : on a donc sis, comme en lithuanien, en regard du sanscrit sya-s; au datif sam, venant de sia-m, en regard du lithuanien sia-m et d’une forme sanscrite sya-smâi qui n’existe pas, mais què nous supposons ici d’après l’analogie d autres pronoms.
11 est vrai que, hormis ce pronom démonstratif, il n’y a pas, dans les idiomes lettes, d’autre mot présentant un s aspiré en regard d’un s pur sanscrit (ou, en d’autres termes, en regard de s dental). Mais on comprendra sans peine pourquoi nous n’avons pas d’autres exemples, si l’on songe qu’en sanscrit, sauf le thème pronominal sya, il y a très-peu de mots commençant par ^ sy2 : je ne trouve que trois racines verbales avec
genres, sej-u est pour sjej^u, qui lui-même est pour sjoj-u. Rapprochez dvoju -sanscrit dvây-ôs, et voyez ce qui a été dit plus haut (S 973) de la déclinaison pronominale.
1 Schleieher (Grammaire lithuanienne, p. 228) nous apprend qu’il a constate
l’existence de cette forme dans des livres anciens, ainsi que dans la prononciation populaire. L’orthographe ordinaire est su. Le son i, en lette, est représenté habituellement par sch, avec un s barré. Cette sifflante aspirée remplace aussi, comme le s lithuanien (qu’on écrit sz), le deuxième CT s du nom de nombre sanscrit 5JCT in «six», en lette seii, en lithuanien éeéi. ^
2 Voyez le Dictionnaire de Wilsoix, 9' édit.on, p. g5g.
PHONOMS DÉMONSTRATIFS. S 358. 3âi


ces deux lettres initiales, et aucune, que je sache, n’a laissé de trace dans les langues letto-slaves.
je crois donc pouvoir soutenir, contrairement à l’opinion exprimée par Schleicher', qu’aucune loi phonique ne nous empêche de rapprocher du thème sanscrit sya le pronom lithuanien en question. Essayer de le ramener au thème interrogatif sanscrit ki, comme le fait Schleicher, me paraît beaucoup plus difficile. Ce savant appuie son opinion sur la comparaison du gothique, où le thème primitif Ici a donné le pronom démonstratif ht : c’est un rapprochement que j’ai déjà fait dans la première édition de cet ouvrage (S 396). Mais si un k sanscrit a pour représentant ordinaire en gothique un h, il ne s’ensuit pas qu’un k sanscrit corresponde à un s en lette, ou à un s en slave ; partout où ces deux sifflantes sont d origine gutturale, le sanscrit nous présente, pour consonne correspondante soit un sr s (venant d’un ancien k, S 21"), soit une gutturale molle, principalement ç h. Comme exemple de cette dernière lettre, citons hrd et hrdaya cœur 7! correspondant au lithuanien èirdis, au lette sirds, au slave cp”A.i.iJE sr&dize. Il faut remarquer, en outre, qu’on ne peut attendre en sanscrit, comme correspondant au lithuanien et au lette si-s «hic», qu un théine pronominal en ya \ En effet, la déclinaison pronominale, en lithuanien et eu lette, ,.e s’écarte pas au féminin de la déclinaison ordinaire; celle de k s’accorde complètement3 avec les substantifs féminins dont le thème correspond à un thème sanscrit finissant en ?rr yâ (S 92 "). Il me paraît, par conséquent, tout à fait impossible, au point de vue grammatical, de rapprocher notre pronom démonstratif du thème interrogatif sanscrit ki et du thème démonstratif gothique ht.
En slave, il n’y a pas lieu d’assimiler la déclinaison complète du pronom en question (voyez ci-dessus, p. 819) à celle des thèmes en i. Cette ressemblance se présente seulement aux cas du masculin4 ou les thèmes en jo prennent l’aspect des thèmes en i, par la suppression de leur voyelle finale et la vocalisation du j en i ou en t, t; et, en outre, aux cas où la déclinaison pronominale ne s’écarte pas de la déclinaison substantive ou de celle
1 Mémoires de philologie comparée, publiés par Kuhn et Schleicher, 1.1, p. 48.
» Le nominatif masculin êis pourrait seul donner lieu à une double explication; considéré à part., on pourrait le rapporter à un thème si.
3 II faut excepter le nominatif si, qu’on peut rapprocher des nominatifs féminins en i mentionnés au 8 1 a 1.
4 II n’y a pas de thèmes neutres en i, ni parmi les substantifs, ni parmi les adjectifs.
PRONOMS.


des adjectifs simples. Il est donc impossible de reconnaître la vraie forme du pronom en question d’après la seule inspection du nominatif-accusatif st «■hic, hune », comme il serait impossible de décider si lconï « equus, equum » vient d’un thème en i ou en jo.
Au datif, à l’instrumental et au locatif, se-mu, si-mï, se-mï s’accordent avec ce-mu «cui?», ci-mi, ce-mt. Il y a toutefois, sous le rapport étymologique , la différence suivante : dans les trois dernières formes, 1 i est primitif et répond à i’i du thème interrogatif sanscrit Ici; quant à Ye, il est une altération de cet i. Au contraire, dans les trois formes citées en premier lieu, fi est sorti d’un j; quant à l’e, il provient d’un o, avec suppression du j qui précédait *. Le k du thème interrogatif sanscrit ki ne pouvait guère devenir, en ancien slave, que H c ou que iji’, lettres qui d’ailleurs ne représentent jamais un s ou un ^ stj sanscrit.
Il est vrai qu’à l’intérieur des mots les lois phoniques du slave exigent qu’un C s (== sanscrit ^ s) se change en tu s, quand il est ou était suivi du son représenté en sanscrit par y 3. Mais il ne s’ensuit pas que le changement doive avoir lieu aussi au commencement des mots. Il y a, en effet, dans beaucoup d’idiomes, des modifications phoniques qui se produisent exclusivement à l’intérieur ou à la fin des mots. C’est ainsi que le sanscrit, qui a une grande propension pour le s, et qui a changé très-souvent en è le son d’un s pur, évite, au contraire, presque partout au commencement des mots ce même son s (§ 21 b). De même, dans notre pronom, lequel est le seul mot qui, en ancien slave, ait primitivement commencé par sj = sanscrit sy, la semi-voyelle n’a pas modifié la sifflante précédente.
S 359. Pronoms composés renfermant le thème tya, en lithuanien.
Nous avons mentionné plus haut (§ 35^) le lithuanien si-ta-s, dont la seconde partie est identique à celle du grec a.ût6-s et du
1 C’est la présence de ce j qui a produit anciennement le changement de l’o en e.
, i Voyez SS 92358 et i4.
3 Par exemple dans pié-jun «j’écris», qui fait à la deuxième personne piè-e-ii (venant de pii-je-ii); à l’aoriste, au contraire, on a pit-o-chü, à l’infinitif pis-a-ti. La racine, en sanscrit, est pii «écraser» et probablement aussi, à l’origine, «enfoncer» (de là, en ancien perse, le sens de «écrire»). Cette racine sanscrite a changé son s dental en à à cause de la voyelle radicale i, de même que dans ui «brûler» le i provient de la présence de Vu (comparez S aib). Aucune des langues de 1 Europe ne prend part à cette loi phonique, qui est d’une époque relativement moderne.
PRONOMS DÉMONSTRATIFS. S 359. 323


sanscrit Tfrî êtd (§ 3 A A). Mais on trouve aussi en lithuanien, à la fin d’un pronom composé, le thème démonstratifW tya (formé de ta + ya). 11 est renfermé, selon moi, dans pâtis [pat’s) «ipse», <|ui doit se décomposer ainsi : pa-tis; tis est pour tps, venant de tjas,'comme lobis «richesse» est pour lôbjis, venant de lôbjas (S 135). Le « lithuanien se change toujours en c (prononce?.tcli) devant deux voyelles, excepté devant ie : on a donc au datil pacui-m, au locatif pacia-mè, à l’instrumental paciù ou pati-mï, pati-m. Au génitif, on s’attendrait à trouver pacio, d’après l’analogie de siô et kurio «cujus»; mais il fait pâtes, d’après l’analo-uie de pentes (§ 193). Le génitif féminin paews s’accorde toutefois avec sios et avec les génitifs analogues des thèmes féminins en a (= sanscrit ^TT a).
Quant à la première partie de pa-tis, j’y crois reconnaître le thème sanscrit sva, svê, d’où vient svaydrn «ipse». Le s
initial s’est perdu et le v s’est durci en p, de même qu’en prâ-crit çfBf tvam «toi» est devenu xrf^f parti, et que le sanscrit ^rrc svdsâr, svdsr «sœur» a donné pên dans la langue des Tsiganes. Il y a même, en ce qui concerne le pronom sva, une ressemblance directe entre l’idiome qui vient d’être cité et le lithuanien, car devient en tsigane pe, qui fait au nomi
natif singulier pe-s et à l’accusatif pluriel pe-n 1. Je fais encore observer qu’en celtique, dans le dialecte irlandais, p représente quelquefois le groupe primitif sv : du moins je ne doute pas que piuthar (venant de piusthar, comparez le gothique svistar) « sœur » ne doive être rapproché du terme équivalent en sanscrit. L’albanais qui, dans ce mot, a perdu également le s initial, a durci le v suivant en m ; il a fait fiàrps2. Après ce qui 358

•m

vient d’être dit, il n’est sans doute pas nécessaire de réfuter l’hypothèse émise par Schleicher d’après laquelle le pronom lithuanien patïs serait dérivé du substantif pâtis «seigneur» : si les deux mots-étaient originairement identiques, le pronom path, selon toute apparence, ne présenterait point les particularités de la déclinaison des pronoms en a~.
Au féminin, la déclinaison des pronoms îitnuaniens n a point de forme qui lui soit propre : patï «ipsa» s accorde absolument avec pati «domina, liera ». Aussi Ruhig3 donne-t-il au nominatif pati tout à la fois le sens de «ipsa» et celui de «uxor»h.
que le lette, dans le même mot, a également perdu le s initial et que la semi-voyelle suivante s’est durcie en m. Je crois du moins que le letle rnâse (qu’on écrit mahse) doit être regardé comme une altération de swâse; il complète en quelque sorte le lithuanien sesîi, génitif sesèr-s (S ikU). Le r final de cette petite classe de mots a entièrement disparu en lette ; on a, par exemple, de mate « mère » le génitif singulier et le nominatif pluriel mûtes (voyez Rosenberger, Théorie des formes de la langue lette, p. èo)'.
1 Grammaire lithuanienne, § 91.
» Le nominatif pluriel pâtys (= pâtis) fait exception : il est analogue à gènlys (S a3o). Le lette toutefois, même à ce cas, suit la déclinaison subslantive des thèmes en ja et fait paii (par euphonie pour patji, comme on a leisi «Lithuaniens», venant du thème leitjf , nominatif singulier Uitis); d’après l’analogie de éiê, on s’attendrait à avoir pacte.
3 Voyez Mielcke, p. 69.
4 Si la signification primitive de pari-*, pat’-s était «ille» et non «ipse», et celle de pati «ilia» et non «ipsa», et si ces expressions ne s’employaient qu’en parlant de personnages distingués, on concevrait qu’un mot signifiant d’abord «dominas» ou «domina» eût pu prendre l’apparence d’un pronom. Mais ce qui est presque impossible à comprendre, c’est qu’on ait pu rendre «ego ipse» ou «nos ipsi» par es pats, mês pasi, dont le sens littéral, dans cette hypothèse, eût été «ego dominus, nos do-mini». Encore moins aurait-on dit tamî paàâ laikâ «eo ipso tempore». Le sens de «dominus» se concilierait à la rigueur avec le composé pat-büéana «indépendance» ; mais les deux éléments que je reconnais dans ce mot sont pat «soi» et la racine bu — sanscrit bu «être».

PRONOMS DÉMONSTRATIFS, S 360.
325
LE THEME PRONOMINAL I.

S 36o. Le thème i en sanscrit.
Nous arrivons à un thème pronominal qui consiste simplement en une voyelle : i. Dans les langues germaniques, ce pronom signifie «il»; en sanscrit et en zend, il veut dire «celui-ci». Dans ces deux derniers idiomes, i n’a pas laissé de déclinaison; il n’en reste que des dérivés adverbiaux, tels que itas
«d’ici»1; iha (venant de i-da), en zend idd, lira
«ici» 359 360; TfH iti, en zend iia, en latin ita «ainsi»; iddnîrn «maintenant», formé comme tadarâm «alors»; it-tdm «ainsi» qui a pour thème le neutre it. Ce neutre it (par euphonie id) est sorti de l’usage dans le sanscrit classique, mais il se trouve encore dans les Védas comme particule affirmative ou explétive. Je reconnais le même neutre dans la seconde partie du mol cêt «si» {ca + it), et du mot net «pour que... ne ... pas» (na + it)-, en zend, nous retrouvons nêt sous la forme nôid (§ 33), mais il signifie simplement «ne ... pas». Le même changement de signification a eu lieu pour l’allemand nieht, qui aujourd’hui veut dire uniquement «ne... pas», quoiqu’il se compose aussi de deux éléments, dont le premier est la particule négative et le second un substantif signifiant «chose»361. De la racine pronominale * viennent encore Haras «l’autre» (avec le suffixe comparatif), dont l’accusatif üara-m coïncide avec le latin iterum; tàrsa «tel» (§ h 15); ^31?^ iyât « autant ».
Malgré ces nombreux dérivés, qui ont survécu à la déclinaison du pronom en question, le thème i n’a pas été aperçu par

326

les grammairiens de l’Inde, et je crois l’avoir amené le premier à la lumière Les grammairiens indiens donnent, pour quelques-uns des mots précités, des étymologies bizarres; ils font venir iti « ainsi » de i « aller » ; Itara-s « l’autre » de i k désirer2 » ; ou bien ils ont recours à ïddm «hoc», ce qui est moins éloigné de la vérité, quoiqu’il ne soit pas possible de comprendre comment de idam, considéré comme thème, peut dériver à laide d’un suffixe tas la forme itas .■ on devrait avoir alors iricMtas ou idntas.
S 361. Le thème i et ses dérivés en latin.
Le thème pronominal i subsiste en latin dans le nominatif masculin i-s et dans le neutre i-d3. Il y faut ajouter les formes archaïques i-m, i-bus, le datif i-bî (S 177) employé adverbialement dans le sens locatif, et peut-être 1 ablatif immo (venant de i-stnô'), auquel devrait correspondre en sanscrit une forme i-sma-t.
Quant aux formes qui appartiennent a la première et a la seconde déclinaison, comme ea, eum, je crois aujourd hui qu elles se rattachent au thème relatif sanscrit ^a4. Ce thème a pris également le sens démonstratif dans l’advérbe ja-m « déjà », littéralement « en ce temps». En osque, le pronom dont il est question a partout un i et non un e : ainsi a 1 accusatif masculin, en regard du sanscrit ya-m et du latin eu-m, nous trouvons la forme ion-k, qui contient l’enclitique k; à l’accusatif neutre, en regard du sanscrit ya-t, nous avons io-k3. A côté de ces formes, nous 362 363 364 365 366
PRONOMS DÉMONSTRATIFS.


.327
361.
trouvons en osque, comme rejeton du thème i et comme pendant du sanscrit it (§ 36o) et du latin ici, la forme id-ik, dont le second i n’est qu’une voyelle de liaison destinée à porter le k enclitique1. Au nominatif féminin, nous avons iù-k en regard du sanscrit yâ et du latin ea, venant de ia (pour ja). En latin, le datif-ablatif pluriel archaïque eâ-bus, si on le fait venir de ia-bus (pour jcî-bus), s’accorde parfaitement avec le sanscrit ya-Byas. Au datif singulier, et s’explique au masculin comme venant de pi1, et au féminin (où l’on trouve aussi eœ) comme venant de jai. Le génitif ê-jus a été rapporté par moi, dans la première édition de cet ouvrage, au thème pronominal i; mais comme e-jus est également usité pour les trois genres et que le pronom latin en question n’a emprunté aucun autre cas féminin au thème i, j’aime mieux maintenant rapporter ejus au pronom relatif iï y a, féminin *IT yâ. J’admets, par conséquent, que la voyelle finale du thème est tombée, que la semi-voyelle y s est vocalisée en ï, puis en ë, lequel e est devenu long par position. Au masculin et au neutre, ê-jus correspondrait donc au sanscrit ya-sya, au féminin à yd-syâs3.
1 Comparez le masculin iz-ik (— is-ilt). Voyez Mommsen, Études osques, p. 60 ut. suiv.
2 Comparez Mi, venant de Moi (S 177).
» Corssen signale (Annales de philologie et do pédagogie, LXVIII, p. a5a) les formes œius, mi, œorum, qui se trouvent dans quelques inscriptions (Orelli, 2866, 3g, 3927). Dans wim on pourrait expliquer IV, comme Te" dans la forme ordinaire «/«*, par l’influence rétroactive du j. Mais les formes mi, œorum ne se prêtent pas à cette explication. Si des formes de même sorte devaient se rencontrer sur d’autres inscriptions d’une antiquité incontestable, et si tout soupçon de fausse leçon se trouvait ainsi écarté, il faudrait admettre en effet que Te de êjus était primitivement long. On pourrait alors être tenté de séparer le Üième mo ou êS, féminin œà ou êâ, non-seulement du sanscrit J i, mais de üT ya et de Tosque io, pour rapprocher les formes en question du thème démonstratif Ç5T êvd (venant de aivd). C’est le thème qui, en zend, sert à marquer le nombre «uns (S 3o8), comme nous avons en osque un pronom démonstratif qui répond, sous le rapport de la forme, au sanscrit Ska«mi» (voyez Mommsen, Les dialectes de l’Italie méridionale, p. 366). La suppression du
328 PRONOMS.


Comme l’écriture, pas plus en osque qu’en latin, ne distingue la semi-voyelle j de la voyelle i, il est impossible de dire si l’accusatif osque était jon-k ou Ïon-L Mais si Ye des formes latines comme etm, eô, eÔrum provient d’un j, par l’intermédiaire d’un C je crois pouvoir en rapprocher la formation du verbe eo : en effet, ce verbe, qui est seul de son espèce, paraît devoir être rapporté à la racine sanscrite <51 yâ « aller», et non, comme je
l’ai cru autrefois, à la racine T * (même sens) ’ *» or nous vo''ons le y initial vocalisé en i dans iens = sanscrit yân, et en 9 dans
ëuntem = sanscrit yântam.
S 362. Le thème i, en gothique.
En gothique, le thème pronominal i a conservé au masculin et au neutre sa déclinaison complète. Nous la faisons suivre, en mettant entre parenthèses les formes sanscrites correspondantes, telles quelles ont dû exister à l’époque où le thème * était encore déclinable en sanscrit.
MASCULIN.
Singulier.
Pluriel.
|
Sanscrit. |
Gothique. |
Sanscrit. |
Gothique. | |
|
Nominatif. . . . |
• • • (*-*) |
i-s |
{ay-as) |
ei-s |
|
Accusatif. . • • • |
... (*-?») |
i-na |
(*-«) |
i-ns |
|
Datif........ |
. . . (i-smâiy |
i-mma |
(i-Vycui) |
i-m |
|
Génitif....... |
i-s |
(i-êâm) |
i-sc. |
dans devenant en latin «f, n’aurait rien d’étonnant (compare, Gnœu», venant de Gnm^ ^ nous deyrions avoir au pluriel ï-mus, ï-tù, (compare, le sanscrit i-màs, le grec h™). et non î-mus, i-tis. La J
en », devant une consonne, ressemble à la contraction une le m yâ du poten sanscrit a éprouvée dans quelques subjonctifs latins (S 676)• ott ( étymologiques, ri» édition, 1.1, p. eo3) admet ausst la possib.hté de la parenté de
eo avec çfàyiïmi. b
» Compare, amû-émâi, venant de amü, S 21 .
3 Compare, amû-sya, venant de amü, d’où l’on peut conclure que tous les pro-

PHONOMS DÉMONSTRATIFS. S 363.
329
Singulier.
Pluriel.

Sanscrit.
Nominatif-accusatif, i-t '
Gothique.
i-ta
Sanscrit.
(î-n-i)
Gothique.
ij-a.
§ 363. Féminin du thème i, en gothique.
Quoique, dans la déclinaison substantive, la voyelle i, en gothique aussi bien qu’en sanscrit, en zend, en grec et en latin, ne soit pas, comme voyelle finale, exclusivement réservée aux thèmes masculins, mais qu’elle puisse terminer également les thèmes féminins, cependant le pronom i a senti le besoin d’élargir son thème aux cas où, sans cet élargissement, le féminin aurait été exactement semblable au masculin2. 11 ne faut pas s’en étonner : dans les pronoms de la troisième personne, la distinction des genres a une importance toute particulière et le même mot ne doit pas signifier à la fois «il» et «elle». Au nominatif singulier, le féminin, en gothique, va jusqu’à emprunter un tout autre thème et oppose si «elle» à is «il». Le vieux haut-allemand, allant encore plus loin dans cette voie, emploie le pronom siu (S 35 A) à tous les cas du féminin où le gothique se contente d’élargir le thème i. L’élargissement en question consiste dans la voyelle {A) qui, de toute antiquité, sert à caractériser le féminin, mais qui, en gothique, est devenue 6 (g ggj t y: on a donc ijô, venant de i +ô, avec transformation euphonique de i en ij, comme dans les formes de pluriel neutre
noms, quelle que soit la voyelle finale du thème, ont leur génitif en sya ou, par euphonie, en éya{% aib).
i Voyez S 36o et, pour le suffixe casuel, Si 55 et suiv.
» L’accusatif singulier féminin, ayant perdu absolument toute flexion casuelle, se distinguerait par là même de l’accusatif masculin; mais à l'origine , d a du avoir une flexion; on s’explique, par conséquent, qu’il y ait eu besoin de le distinguer de
la forme masculine. ..... ........
330 PRONOMS,


ij-a, ihrij-a (§ a3a). A l’accusatif dénué de flexion, le thème ijô "devient ija, attendu que les voyelles finales sont les plus sujettes à s’abréger; au nominatif-accusatif pluriel, nous avons ijôs1. Le datif pluriel féminin se confond avec le masculin-neutre , si, comme le donne à supposer le vieux haut-allemand, il fait im. Tous les cas qui ont une flexion spéciale pour le féminin viennent du thème primitif; on a, par conséquent, i-sos, i-sai, génitif pluriel i-sô, en regard de i-s, i-mma, i-sê.
§ S64. Le thème i, en grec.
Si le nominatif singulier du pronom réfléchi, en grec, était <, et non (comme le disent les grammairiens grecs) on pourrait le rattacher au thème pronominal en question; mais si i est la vraie leçon , il appartient probablement367 368 au thème sanscrit sm, svê, d’où vient soaydm «ipse» (§ 3Ai), et il est de même famille que oS, ol, Ü et que o?»*, etc. ce dernier venant du thème a<pi. De même que dans <r?< nous avons un « au lieu de l’o que faisait attendre l’a primitif, de même nous avons 1 pour g. Il faut remarquer que, même en sanscrit, on trouve à côté de sva une forme affaiblie svi, à laquelle je crois pouvoir rattacher la particule interrogative f^svit, formée comme et üt. Une autre circonstance qui nous porte à croire que ï appartient à l’ancien thème réfléchi, c’est qu’il na pas le signe casuel du nominatif, non plus que les deux autres pronoms à genre invariable (êyei, oé); au contraire, s’il appartenait au
PRONOMS DÉMONSTRATIFS. S 365. 331


thème t, nous aurions très-vraisomblablement au nominatif masculin une forme identique au latin et au gothique is1. Le datif îv vient se ranger, par sa désinence, à côté des pronoms à genre invariable (ê(xîv, idv), et peut, par conséquent, etre également attribué au pronom réfléchi. Quant à l’accusatif ïv, si on le considérait à part, rien n’empêcherait de l’identifier avec le latin im et le gothique ma2.
% 365. La particule inséparable t en grec. — Comparaison avec la particule ei en gothique.
La particule inséparable », qui vient s’ajouter, avec un sens démonstratif, aux pronoms [oCroeri, aiv/t'i, èxsivoaî, ixetveuvi, etc.), est peut-être le reste d’un adverbe de lieu dérivé du thème démonstratif ^ ». En effet, elle signifie «ici» ou «là» et pourrait, par conséquent, être de même famille que le sanscrit T^i-hd (zend i-da) «ici» ou que le zend i-tra (même sens). En ce qui concerne la suppression du suffixe et l’allongement de la voyelle du thème, on pourrait rapprocher les formes grecques comme Se/xvû (pour Ssi'xvuOi), où la désinence personnelle 6t a été supprimée et où l’on a allongé, par compensation, la voyelle précédente. Mais on peut encore expliquer autrement la particule grecque en question : on y peut voir un pronom démonstratif qui a perdu ses désinences casuelles ; l’allongement de 1’» du thème serait alors une compensation pour la perte des désinences 3.
1 A moins qu’on ne regarde la forme donnée par les grammairiens grecs comme un neutre.
» Comparez Harlung, Des cas, p. 116 et suiv. Max Schmidt, De pronomme grwco et latino, p. ta et suiv. Kühner, Grammaire grecque, p. 385.
» Dans le dialecte védique, on trouve fréquemment le neutre t't (S 3Go), comme particule presque explétive ou servant simplement à renforcer le sens; le mot précédent garde toutefois son accent. G’esl surtout aux pronoms que s ajoute cette particule. Voyez Bohllingk et Roth, Dictionnaire sanscrit, au mot <^ tW.
PRONOMS.

332

' Le golhique a de même un î enclitique (qu’il écrit ei, S 70), lequel vient s’appuyer à d’autres pronoms ; mais c’est pour leur donner une signification relative et non pour renforcer leur valeur démonstrative. Ainsi isei, venant de is + ei, signifie «qui», et sei, venant de si + ei, signifie « quæ ». La combinaison la plus fréquente a lieu avec 1 article : saet, soei, thatei «qui, quss, quod » ; thisei, féminin thisôsei « cujus n, et ainsi pour tous les cas.
11 n’v a que le génitif pluriel féminin tliisôei pour lequel nous n’ayons pas conservé d’exemple Si la relation, au lieu de concerner la troisième personne, concerne la première ou la deuxième, et s’appuie sur tk ou sur thu, et Ion a iket, thuei; car le pronom relatif, en gothique, éprouve le besoin de s incorporer le pronom de la personne à laquelle il se rapporte, et comme il est lui—même devenu indéclinable, il laisse au pronom précédent le soin de marquer la relation casuelle, tandis qu’il absorbe la signification de son compagnon dans la sienne. Employé seul, et a le sens de la conjonction «que» et peut être comparé au latin quod et au relatif neutre yat en sanscrit. Je ne doute pas d’ailleurs que le gothique et n appartienne par son origine au thème relatif sanscrit et zend y a; on trouve, dans la grammaire gothique, beaucoup d’autres exemples d’un y a sanscrit devenu ei (= î), par exemple le nominatif singulier andeis, venant du thème andja (§ i35). Puisque la forme et le sens se prêtent également à cette explication, il est inutile de recourir à l’hypothèse de Grimm, qui suppose que ei est parent avec is
«il»2.
1 Grimm, Grammaire allemande, t. III, p. 15.
2 On pourrait, il est vrai, admettre une parenté lointaine, si l’on fait dériver le thème relatif ya du thème démonstratif t. Mais puisque sa, ta, ma, na sont des thèmes primitifs, pourquoi n’en serait-il pas de même pour ya?
PRONOMS DÉMONSTRATIFS. S 366.

332

LE THÈME PRONOMINAL A,
$ 366. Le thème « et ses dérivés.
Nous retournons au pronom sanscrit idârn «hoc», pour examiner les thèmes, usités seulement à certains cas, qui servent à compléter sa déclinaison. Le plus simple et le plus répandu est %a, dont nous avons les cas suivants : a-smâi «huic», a-smdt «bôc», a-smîn «in hôc»; au duel : â-Byârn; au pluriel : ê-Bis (comparez les formes védiques comme ds'vê-Bis, § 219), ê-Byds, ê-sam, ê-stl Ces cas sont formés de a exactement comme te-Byas, tê-sdrn, tê-sü de ta; Va du thème s’est mêlé avec un i> comme à beaucoup de cas de la déclinaison substantive. II n’est donc pas nécessaire de poser un thème spécial è, puisque ce thème ê n’est pas autre chose que le thème a élargi. Le nominatif aydm vient de ê+am, comme svaydm «ipse» de svê (pour sva) + am (§ 34i). Du thème a viennent encore les adverbesâ-tra «ici» et a-tds «d’ici».
Avec a-tds paraît s’accorder, pour le thème comme pour le suffixe, l’albanais aSd « donc » i : ce rapprochement est d’autant plus vraisemblable que l’albanais a conservé le thème a comme pronom de la troisième personne, soit sous la forme a, soit affaibli en e2.
En celtique, dans le dialecte irlandais, a est employé comme thème démonstratif dans l’adverbe de temps a-nochd «noctu», littéralement «hâc nocte». Cette expression est en quelque sorte l’antithèse du sanscrit adya «aujourd’hui, en ce jour», dont la syllabe finale renferme, selon moi, le reste d’un substantif signifiant «jour» (dyô, divâ, divas ou divan)3.
' Voyez mou mémoire Sur l’albanais, p. 38. .
* On a, par exempte, l’accusatif s «hune» (ibidem, p. ai).
3 Wilson ( Dictionnaire sanscrit) explique cet adverbe comme une formation irrégulière de iddm «hoc». '
PRONOMS.

334

En ossète, nous reconnaissons clairement le même thème pronominal dansa-bon «aujourd’hui», dont la seconde partie, employée isolément, signifie «jour». Dans cette syllabe bon, je vois un reste du thème sanscrit divan «jour», avec perte de la première syllabe et durcissement du v en b, comme dans le zend et le latin bis pour le sanscrit dvis « deux fois ».
Le thème démonstratif a n’ayant laissé qu’un petit nombre de rejetons dans les langues de l’Europe, je ne dois pas omettre de rappeler qu’en irlandais a est employé aussi comme génitif du pronom de la troisième personne; mais, dans cette position, il a été regardé ordinairement comme un pronom possessif1. 11 tient au masculin la place du sanscrit a-syâ, au féminin celle de a-syâ's, dont le s final est joint en irlandais, sous la forme d’un /t. au mot suivant, si celui-ci commence par une voyelle; exemple: a hathair «ejus (au féminin) pater», pour ah athair = sanscrit a-syâs (par euphonie asyàfi) pita. On joint de même au mot suivant la nasale du génitif pluriel (n ou, devant les labiales, m); on dit, par exemple, a nathair «eorum pater» pour an athair2.
S 367. Féminin du thème a.
Du thème démonstratif ^ a pouvait sortir un thème féminin i (§ i 19 et suiv.-); le nominatif singulier féminin XH^iydm peut donc s’expliquer comme étant pour î + am3. Toutefois, comme rien, suivant les lois phoniques du sanscrit, ne s’oppose à ce qu’un i bref combiné avec am donne iyâm, nous ne saurions décider si le féminin de notre pronom dérive du thème masculin a ou s’il appartient au thème i. La première hypothèse est celle
1 C’est aussi l’opinion adoptée par Zeuss (Grammaltsa eeltica, p. 344 et suiv. ).
2 Voyez mon mémoire Sur les langues celtiques, p. 37 et suiv. Comparez O’Do-novan. Grammaire irlandaise, p. i3o.
3 La syllabe am est, comme on l’a vu, une désinence fort usitée dans la déclinaison pronominale. Quant au changement de l’t en iy, voyez Abrégé de la grammaire sanscrite, S 5n
PRONOMS DÉMONSTRATIFS. S 368.

335

qUe je préfère, parce qu’elle rattache aydm et son féminin iydm à la même origine, et parce qu’il n’y a pas d’exemple, dans toute la déclinaison masculine et neutre, du thème i employé hors de composition.
Le gothique ija «eam» ne doit pas, selon moi, etre rapproché du sanscrit iydm, où am est une simple terminaison du nominatif. On a vu plus haut (§ 363) comment le gothique est arrivé, par une voie qui lui est propre, au thème élargi i/o.
I.ES THÈMES PRONOMINAUX MA ET NA.
S 368. Le pronom composé ima.
En zend, •qqt^aydm est devenu aêm (§ 4a ) et yn*^iydm est devenu & îm. Le neutre iddm est remplacé par irndd, venant du thème ima, lequel sert à compléter en sanscrit la déclinaison de iddm : il fournit, entre autres, 1 accusatif masculin imdm, féminin imam, en zend imëm, imahm. Faut-il en rapprocher le latin archaïque emem pour eundem, ou devons-nous, avec Max Schmidt1, y voir un redoublement de em (pour tm)? Il ne serait pas surprenant que le thème ima, qui, en sanscrit, est surtout réservé à l’accusatif2, fût également demeuré au même cas en latin. Je regarde imd comme la réunion de deux thèmes pronominaux (S i o5), savoir i et ma; ce dernier n’est pas usité en sanscrit comme mot simple 9 îïiuis il c?st très-probablement de même famille que le grec [aiv, qui, des lors, serait lui-même parent avec l’ancien latin emem.
S 369. Le pronom composé am.
Nous venons de voir que le theme ima s est formé par la com-
1 De pronomine grœco et latino, p. 11.
a Au singulier, on ne trouve imâ qu’à l’accusatif (imam); au pluriel, nous avons U* nominatif imétd l’accusatif imtin ; au duel, le nominatif-accusatif imïïu.
336 PRONOMS.


binaison de i et de ma; le thème ’STC and, qui, comme imd, sert à compléter la déclinaison de icldm, se compose pareillement, selon moi, de deux éléments. Le premier est le thème pronominal a; le second est un thème démonstratif na qui n’est pas usité en sanscrit et en zend, sinon en composition, mais qui, en pâli, a une partie de sa déclinaison b Clough, dans sa Grammaire pâlie, donne les cas auxquels ce pronom est usité comme des formes secondaires du thème ta, de même qu’en sanscrit on trouve à côté de plusieurs cas du pronom composé êtâ un pronom dénué d’accent qui a, comme dernier élément, na au heu de ta369.
Nous mettons ici le pronom simple pâli en regard du pronom composé sanscrit.
MASCULIN.
Pluriel.
|
Sanscrit. |
Pâli. |
|
été |
, A A te, ne |
|
élan, ênân tê, né | |
|
étais A.A'lr ete oyas |
têHi, nêlii, ou têhi, nêlù |
|
êtêHyas |
Comme l’instrumental. |
|
êlê'êâm |
têsaii, nêsaii ‘ |
|
été’éu |
têsu, nêsu. |
Singulier.
Sanscrit. Pâli.
Nominatif, êêd sô
Accusatif.. êtâm, ênam tan, mil Instrum.. • êlêha,cnêna tena, nena Datif. . . . êtdsmài 3.........
Génitif. . . êtàsya tassa, mssa
Locatif.. . êtàsmin lasmin ,msnmo\ tamhi, namhi
i i) a, entre autres, le nominatif-accusatif neutre, que nous écrivons nan et non nam, attendu qu’un m final, en pâli et en pràerit, devient anousvâra (SS 9 et 10), à moins que te mot suivait ne commence par une vojelle ( Burnouf et Lassen, Essai suite pâli, p. 81 et suiv.). Un n final, en pâli, se change également en anousvâra ou disparaît tout à fait. — Au féminin, le thème na devient, par élargissement, no; mais
cet d est abrégé à l’accusatif R" nan <t eam ».
3 Comparez, en zend, le génitif féminin ainanhâo, qui suppose une
forme sanscrite ênasyâa.
> Les cas qui manquent sont remplacés par le génitif.
4 Ou tésdnan, rmânaü, l’ancien génitif, après suppression de la nasale, étant considéré comme thème, et servant à former un nouveau génitif, d’après l’analogie de la déclinaison ordinaire.
FÉMININ.
êtas tâ, nâ, ou tâyô, nâyô êtâs, ênâs tâ, nâ, ou tâyô, nâyô
clâbis tâbi, nâbi, ou tâhi, nabi
êtabyas .................
êtâbyas Comme l’instrumental.
êtasâm tâsah, tasanüii
êtasu tâsu.

PRONOMS DÉMONSTRATIFS.
369.
337
NEUTRE.
Singulier.
Sanscrit. Pâli.
Nominatif, état tan, naii
Accusatif.. état, ênal tan, nan Le reste comme au masculin.
Pluriel.
Sanscrit. Pâli.
ètîini tâni, mni ctani,ênàni tâni, nani, ou te, ne.

*
Nominatif, êêâ sa
Accusatif.. êtiïm,ênâm tan, nan Instrum... êtâyâ, ênayâ taya, naya
Datif. . - • êtâsyâi ..........
Ablatif. . . êtâsyâs tassa, tissa
Génitif. . . êtâsyâs tassa, lissa
Locatif. . . êtâsyâm lassait, tissah
Remarque. - Anciennes formes pronominales conservées en pâli. - La forme du génitif pâli tissâ ressemble d’une manière frappante, quoique fortuite, au gothique thisôs; l’une et l’autre langue ont affaibli l’ancien a en i. Le mot pâli est toutefois moins bien conservé que le mot gothique, car 1 a perdu le s final, ce qui le place sur la même ligne que le vieux haut-allemand, où le gothique thi-sôs est. devenu dë-ra (S 356). Le pâli a perdu, a la fin des mots, tous les a sans exception. La forme plus ancienne tassa (venant par assimilation de tasyâ) manque dans la grammaire de Glough, mais elle a été constatée par Burnouf et Lassen, qui, au contraire, nont pas tissâ, mais qui donnent son analogue imissâ3. Ctough cite, en outre, tissâya et tassâtâya. Le premier contient une double désinence, la terminaison du génitif pronominal et la désinence ordinaire du génitif. Quan a tassâtâya, on peut le diviser ainsi : tassât-âya, et regarder la premi re partie comme un ancien ablatif3; ou bien, on peut le diviser de cette façon : tassâ-tâya, en sorte que le thème féminin tâ serait contenu deux fois dans 370 369
338 PRONOMS.


ce mot, d’abord avec la désinence du génitif pronominal et ensuite avec celle du génitif ordinaire.
La forme imamhâ, citée par Burnouf etLassen1 comme un instrumental féminin irrégulier, est probablement un ancien ablatif. On sait que ce cas touche de près, par sa signification, à l’instrumental. Ce qui nous porte à reconnaître dans imamhâ un ablatif, c’est la présence du pronom annexe sma : si notre explication est fondée, le mot pâli est mieux conservé, sous un certain rapport, que les formes zendes comme avanhàd, carie
pronom annexe sma, devenu par métatbèse inha, a gardé en pâli son m, au lieu que le n de avanhâd est une lettre complémentaire purement euphonique (S 56’). Le t final de l’ablatif manque à imamhâ; mais il devait tomber, d’après une loi constamment appliquée en pâli, ainsi qu’on a pu le voir déjà par le masculin.
S 370. Mots composés renfermant le thème na.
Les conjonctions latines nam et ënim me paraissent être des accusatifs féminins correspondant, l’un au pâli «t nah, 1 autre au sanscrit TçWfJnâmK L’accusatif masculin du pronom en question doit avoir en latin un 0 ou un ü comme représentant de l’a sanscrit : je crois reconnaître cet accusatif masculin dans nunc, qu’on peut rapprocher de tune et de hune, et qui signifierait «en ce [temps]» 3.
L’ombrien et l’osque ont conservé différentes formes du même pronom êna. Nous avons en ombrien ene, me, enem, eno, mm, enu, enu-h, inu-k, enumek, inumek11. Toutes ces formes, qui se
1 Essai sur le pâli, p. 117.
2 Voyez S 369. — J’ai fait pour la première fois ce rapprochement dans ma Recension de la grammaire sanscrite de Forster ( Annales de Heidelberg, 1818 ). J avais déjà reconnu alors la nature composée du pronom sanscrit êna, quoique ne sachant pas encore que le pronom simple s’était conservé en pâli.
3 Si l’on ne regarde pas tune et nunc comme des accusatifs, il faudra rapprocher ne du grec vint. Tune répondra à revint. [Une autre hypothèse au sujet de tme sera
donnée au S 420. Comparez aussi S 35i. Tr.]
^ Voyez Àufrecht et Kirchhoff, Monuments de la langue ombrienne, pp. i3b et 160. Je crois qu’il faut diviser les deux dernières formes de cette façon : enum-e-k, imm-e-h. L’enclitique k, qui est souvent jointe aux pronoms démonstratifs, s’est fait
PRONOMS DEMONSTRATIFS. 8 370.

339

rapportent à un thème end, enü, eino, signifient «et», ce qui n’a rien de surprenant si l’on songe que le sanscrit c'a «et» a également une origine pronominale. En osque, la même conjonction se présente à nous sous la forme inim.
Le témoignage de l’ombrien et de l’osque prouve suffisamment la présence du thème êna dans les langues de l’Italie. Nous avons, au surplus, en latin le mot ûnus (forme archaïque oino-sj qui se rapporte à la même origine (§ 3o8). Je ne puis donc admettre l’explication proposée par Pott1 et par Kuhn2, d’après laquelle nam se référerait au sanscrit nâma (nominatif-accusatif du thème nâman «nom»), quoique je sois loin de vouloir nier que ce mot se dépouille souvent de sa signification fondamentale et prend, en sanscrit, la valeur d’une particule interrogative 3.
Contre l’étymologie de ënim on pourrait objecter qu’un ë latin ne correspond pas à un ê (= ai) sanscrit4. Je rappellerai à ce sujet ce que j’ai dit de l’e du grec êxarepos = sanscrit êkatard-s (S 3o8). Si l?on voulait toutefois séparer ënim du thème sanscrit Tjsr êna et des conjonctions ombriennes et osques, je ratta-précéderici d’une voyelle euphonique de liaison (S 36i). Je ne peux admettre la division en enume-k, inume-h, parce que je ne saurais voir dans me ni une désinence casuelle, ni une particule annexe (S 200). Je divise de même esum-c-k, venant du thème démonstratif eso, eau, que je rapproche du sanscrit êéd.
1 Recherches étymologiques, 1” édition, 1.1, p. i83, et t. II, p. i5i.
2 Journal de philologie comparée, tome IV, pages 375 et suiv. Kuhn, en cet endroit, m’attribue par erreur l’opinion que le latin mm serait parent du sanscrit n&ma,
•’ Voyez mon Glossaire sanscrit, au mot nâma, et Kuhn, endroit cité. Il faut ajouter toutefois que nâma ainsi employé est ordinairement précédé d’un autre mot interrogatif. — Si l’explication donnée par Pott et Kuhn était fondée, j’aimerais mieux supposer que le sanscrit et le latin sont arrivés séparément et d’une façon indépendante À transformer un substantif signifiant «nom» en particule interrogative et en conjonction. Il est à peine nécessaire d’ajouter que le latin nâm daterait néanmoins d’une période où l’d n’était pas encore devenu â (S 4).
4 Voyez S 9, remarque.

340

cherais le mot latin au thème sanscrit and (§ 372)'. 11 ne faut pas s’étonner devoir un pronom donner naissance à une conjonction signifiant «car» : le même fait a lieu pour l’allemand denn2 et pour le latin quip-pe, venant de quid-pe. La seconde partie de ce dernier mot est la même qui se retrouve dans nempe, venant de nam-pe (comparez § 6). Le sanscrit kinca « car », par euphonie pour kim-ca, peut être considéré en quelque sorte comme le modèle de quippe, car il se compose de l’interrogatif kim squid?» et de ca, qui signifie ordinairement «et», mais qui sert ici à dépouiller kim de sa valeur interrogative. Celte enclitique ca est identique avec le latin que, qui enlève de même au pronom quisque sa force interrogative. Or, la syllabe pe, dans quippe, est originairement identique avec que; elle se trouve avec cette forme dans le même rapport que l’éolien &ép.ns avec quinque.
Nous avons un i dans enim au lieu de l’a qui se trouve dans nam; mais il suffit de rappeler à ce sujet les verbes comme contingo, venant de tango (§ 6), ou le pâli tissâ à côté de tassâ (S 36g). Le même affaiblissement de la voyelle a lieu dans le grec vlv et ulv, ainsi que dans la préposition inséparable f*J ni « en bas »s, qui est au thème pronominal na ce que le pronom interrogatif neutre ki-m est au masculin ka.
Le thème démonstratif na se montre aussi à nous avec un u; c’est ainsi qu’à côté du thème ka nous avons les adverbes ké-tas «d’où?» et ëfR kü-lra «où?». En sanscrit, «J nu est une particule interrogative, de laquelle on peut rapprocher le latin num et le grec vv : ce dernier est identique avec «J nu, non-
1 Ii est vrai que le thème ana et ses dérivés antara et anyâ ont ordinairement conservé leur a initial en latin.
2 L’allemand denn «car» représente l’accusatif singulier thana, du pronom démonstratif sa. — Tr.
5 De ni vient le vieux haut-allemand ni-dar, allemand moderne nieder «en bas» (S 295).
PRONOMS DÉMONSTRATIFS. $ 371. 341



seulement pour la forme, mais encore en partie pour le sens 1. Le sens démonstratif s’est au contraire conservé dans vw « maintenant», dans le gothique nu (même sens), le vieux haut-allemand nu, nû, le vieux norrois nu, nuna et l’allemand moderne nun2. Je rapporte aussi au même thème démonstratif le gothique nauh et l’allemand moderne noch «encore»3, qui peuvent se traduire par «en ce'[temps]»; le latin ad-huc, qui a le même sens, se contente également d’exprimer l’idée démonstrative et sous-entend celle de temps. Le gothique na-uh est formé de la même façon que tha-uh, c’est-à-dire qu’il contient l’enclitique uli, dont nous parlerons plus loin (§ 3p5).
S 371. Dérivés du thème na. — Origine des particules négatives.
A la particule négative sanscrite na répondent en gothique ni, en ancien slave ne ou ni, en borussien ni, en lithuanien ne, en grec vn ; ce dernier n’est usité qu’au commencement des composés comme vrixepcas, vnxriStfs. En latin, si l’on fait abstraction de la conjonction nê, cette particule négative ne paraît également que comme préfixe, sous la forme ne ou ni (riefas, nefan-dum, neque, nefunus, nequeo, nisi, nihil)*. Dans non la particule
1 Comparez Hartung, Particules grecques, t. II, p. 99.
2 Voyez Grimm, Grammaire allemande, t. III, p. a4g. — Peut-être le dernier v de vSv est-il pour un ancien p, et provient-il du pronom annexe srna, dont la perle aurait été compensée par l’allongement de la voyelle précédente. On pourrait alors rapprocher vvv du locatif pâli nasrmn ou namhi, et le changement de l’a en v appartiendrait a la période où la langue grecque avait déjà une existence indépendante : il s’expliquerait par l’influence do la liquide, comme dans tjôv. Remarquons à ce sujet que les mots grecs cités au § 7, qui ont changé un ancien a en v, ont tous un v avant ou après cette voyelle. Quant à l’allemand moderne nun, il est probable qu’il a perdu une voyelle finale, en sorte qu’on y peut voir la répétition de nu ou qu’on peut le rapprocher du vieux norrois nuna. En moyen haut-allemand, nous avons mon (à côté de «d, mo), et il y a eu sans doute aussi des formes de ce genre en vieux haut-allemand.
3 Voyez Grimm, Grammaire allemande, III, p. a5o.
4 Comme le na sanscrit, ne et ni sont ordinairement brefs en latin ; là où la voyelle

342

négative est probablement contenue deux fois : je regarde nô-n comme étant pour no-ne, avec le changement habituel de l’a primitif en o. Dans l’archaïque nc-nu la particule négative en question se trouve probablement aussi deux fois.
Quant à la conjonction nê, il est possible que son n initial soit l’altération d’un ancien m; nê correspondrait alors à la particule.prohibitive mâ en sanscrit, uv en gré?, mi en arménien. La permutation des deux nasales a pu être amenée par la parenté de signification des deux particules.
Le zend, au lieu de la particule négative na, se sert de nôid (§ 36o), qui correspond au mot sanscrit nêt, venant de na-it (littéralement «non hoc»). En ancien perse, la négation est exprimée par naiy, qui se compose des mêmes éléments, mais avec suppression de la dentale finale (§ 86, 2). En lithuanien, la particule négative est nei1, que je rapporte à la même origine, en admettant également la perte d’une dentale à la fin du mot2.
Dans le dialecte védique, ? m a aussi le sens de « sicut » ; je vois dans ce fait une preuve de l’origine pronominale de cette particule3. Je ne crois pas qu’il faille admettre une origine différente pour na signifiant «non» et pour na signifiant «sicut», si éloignées que puissent paraître, à première vue, ces deux acceptions. Puisque l'affirmation est marquée par une expression pronominale, par i-ta en latin, par td-'tâ en sanscrit, par jai en
\ . . . . „ t
est longue, une cause particulière a occasionné cet allongement : ainsi netno est une
forme contractée pour ne-homo.
1 On écrit ordinairement ney. La diphthongue lithuanienne ei, ou plutôt sa forme primitive ai, correspond au sanscrit ê (S a6, 5).
3 Nei signifie me ... pas»; nei répété équivaut pour le sens au français «ni». En zend, « ni... ni» est exprimé par nôid ... naidla; ce dernier mot se compose de na + ida, littéralement « non ici ».
3 J’ai déjà exprimé cette idée dans ma recension du Rig-vedœ tpecimen de Rosen (Annales de critique scientifique, i83o, p. q55).
PRONOMS DÉMONSTRATIFS. S 371.

343

gothique1, le contraire de l’affirmation doit pouvoir s’exprimer par un mot qui formera avec elle la même antithèse que «illud» avec «hoc». Le motna, en supposant qu’il ait cette origine, ne sera donc pas à proprement parler une négation, mais un pronom servant à marquer l’éloignement; et, en effet, de ce qu’on me refuse une qualité ou un objet, il ne s’ensuit pas qu’on supprime ou qu’on nie cette qualité ou cet objet : on l’éloigne de mon voisinage ou de ma personnalité, ou bien l’on me place d’un côté et l’idée désignée de l’autre, en montrant la séparation des deux termes.
La plupart des mots qui, en sanscrit, signifient «celui-ci» veulent dire aussi «celui-là» : c’est l’esprit qui supplée le lieu plus ou moins éloigné, car la seule notion véritablement exprimée par les pronoms est celle de la personnalité 2. La particule négative a (l’a privatif en grec) est également identique avec un thème démonstratif (§ 366). La particule prohibitive *TT »»« = (iti vient se placer auprès du thème ma (§ 368); enfin la négation grecque où peut aussi, comme il sera montré plus tard, être rapportée à un thème démonstratif, il faut encore considérer que ne en latin a, comme na dans les Védas, une double acception : placé après un mot, il est interrogatif; devant un mot (iiefas, neque, nequeo, nihil ), il est négatif. Quant au sanscrit na, nous ajouterons que, combiné avec lui-même et chaque fois allongé, il forme le mot nânâ qui signifie «beaucoup, de beaucoup de sortes», littéralement « ceci et cela»3. Mentionnons enfin la particule interrogative et affirmative dont
la première partie nû est un allongement de nu (§ 370), et
1 Voyez S 385.
*■ L’auteur répond ici à l’objection qu’on pourrait tirer des mots comme énam en sanscrit, non en pâli (8 36g), qui n’impliquent pas nécessairement l’idée d’éloignement. — Tr. ■ ' ■
3 Cette expression est indéclinable et ne s’emploie qu’au commencement des composés. ij?


344
PRONOMS.
dont le second terme nous présente notre thème pronominal na *.

S 372, 1. Déclinaison du thème composé ana. —L’article an en irlandais.
Nous retournons au thème composé W*f and (§ 36g). L’instrumental masculin-neutre de ce pronom est en sanscrit anê'na, en zend «)» ana (% 158); l’instrumental féminin est -41 «W anâyâ, en slave ouot* onojuh (S 266); le génitif-locatif duel des trois genres est en sanscrit andyôs, en slave ohomj onoju (§ 2 73). En lithuanien, anà-s ou ans signifie te celui-là»; le féminin est anà. En slave, nous avons le pronom onü, ona, ono. A la différence du sanscrit et du zend, le lithuanien et le slave ont la déclinaison complète, qui est analogue, en lithuanien, à celle de tas, ta, en slave, à celle de tz tu, Td ta, to to (§ 34g). A ce pronom appartiennent aussi, si je ne me trompe, le latin an, le grec iv et la particule interrogative gothique an 371 372.
Dans les dialectes gadhéliques du celtique, ce pronom démonstratif est devenu l’article. Il a conservé en cette qualité, dans l’irlandais, de remarquables restes de son ancien système de déclinaison373; ils ont été longtemps méconnus, parce que dans l’écriture on a joint les désinences de l’article au commencement du mot suivant. Mais en rétablissant la vraie orthographe, on constate que l’article féminin, quand il est suivi d’un mot commençant par une voyelle, prend un h final aux mêmes cas où les langues congénères ont un s dans leur flexion. Au génitif pluriel, un n répond en irlandais à un m sanscrit : ce « également a été joint dans l’orthographe usuelle au mot sui-
PRONOMS DÉMONSTRATIFS. S 372

, 2.
345

vant '.Je mets ici en regard la déclinaison de an oigh « la vierge » et celle du lithuanien anà «ilia»; je fais précéder entre parenthèses les formes qu’on devrait s’attendre à trouver en sanscrit, si le pronom en question avait dans cette langue sa déclinaison complète.
Singulier.
|
Sanscrit. |
Lithuanien. |
Irlandais. | |
|
Nominatif. . |
. (anâ) |
ana |
an oigh |
|
Génitif. . . . . |
. (ana-syâs) |
anos |
nah oigh |
|
Datif...... |
. (ana-syâi) |
anat |
do-n oigh |
|
Accusatif. . . |
(anâm) |
anah |
m oigh. |
|
Pluriel. | |||
|
Nominatif. . |
. (ams) |
anos |
nah ogha |
|
Génitif. . . . . |
. (anâsâm) |
anu |
nan ogh |
|
Datif...... |
. ( anâ-fiyas ) |
anô-mm |
do-nah ogaibh |
|
Accusatif. . . |
. (unâs) |
anàs |
nah ogha. |
§ 372, 2. Le thème composé ana, en arménien.
Nous avons déjà reconnu (S 3àa) dans le premier membre du composé arménien in-qn «lui-même» une forme congénère du thème sanscrit and. Mais ce in est employé aussi comme pronom annexe après d’autres pronoms démonstratifs, notamment dans unju suin «hic, idem» et dans ses analogues duin, min. Le pronom annexe a alors sa déclinaison complète, quoique le signe casuel puisse manquer à certains cas; au datif et au génitif singuliers, l’absence de la flexion casuelle est de règle, comme pour les thèmes substantifs en n; le nominatif et l’accusatif singuliers doivent également rester sans désinence casuelle. 11 est impor- 374
PRONOMS.

3/46

tant de faire observer qu’à l’instrumental et au datif-génitif pluriels nous avons un nu u au lieu d’un i; je regarde la forme un comme moins affaiblie que in374.
Je donne ici comme modèle la déclinaison complète de ‘iinjh nuin « celui-là » :
Singulier. Pluriel.
Nominatif. . . min no-q-in ou min-q4
Accusatif. . . . s-nuin s-nuin-s ou s-no-s-in
Instrumental., now-im-b ou now-in no-q-im bqouno-q-um-bq '
Datif....... nm-in11 no-i-un-i ou no-i-un
Génitif...... nor-in no-i-un-i ou no-i-un
Ablatif...... 5 . . • • no-i-un-i.
S 372, 3. Le pronom annexe a, en arménien.
Un autre pronom annexe qui concourt, en arménien, a la déclinaison des pronoms démonstratifs, c’est a, que je crois pouvoir identifier avec le thème démonstratif sanscrit a (S 366). Mais l’enclitique arménienne a perdu tous ses cas, excepté l’instrumental singulier et pluriel; exemple : sow-av «par celui-ci», so^-avq6 «par ceux-ci». Sans ces deux formes d’instrumental, on pourrait être tenté de rapporter à la désinence casuelle du pronom principal l’a des ablatifs pluriels comme nozanê et des génitifs singuliers comme nora (SS 183\ A, et 188). Ce qui
1 Comparez akun-q «oculi», akun-8 «oculos», venant du thème akan ($S 926 et
937,3). N _ ' ;
2 Dang no-q-in c’est le premier pronom, dans nuin-q c'est le pronom annexe qui a la désinence casuelle.
3 On devrait s’attendre à avoir nowq-imb, nowq-umbq. (Voyez la note 6.)
4 Pour nom-in. De la lettre m servant de désinence au datif rapprochez le sanscrit s mai, le vieux haut-allemand mu, le moyen haut-allemand m (S i83 *, û).
3 Les pronoms démonstratifs composés avec in n’ont pas de forme spéciale poui l’ablatif singulier.
6 On a soq- pour sowq-, comme plus haut noq- pour nowq- : la désinence est mutilée è cause de la surcharge amenée par là composition.
PRONOMS DÉMONSTRATIFS. S 372


347
4.
prouve aussi que cet a est un pronom annexe, ce sont les nominatifs pluriels comme noq-a : en effet, c’est seulement à la fin des mots qu’un s primitif (= sanscrit ^s) se change en q. Je rapporte enfin au pronom annexe a l’a final des nominatifs singuliers sa khic s?, da «ille » et na (même sens); devant l’a du pronom annexe, les thèmes so, do et no ont perdu leur o, de même qu’au datif nous avons nm-a au lieu de no-m-a.
Voici la déclinaison du pronom na (pour n-a, venant de no-a); sa et da (pour so-a, do-a) se déclinent de même :
|
Singulier. |
Pluriel. | |
|
Nominatif. . . |
n’-a |
noq-a |
|
Accusatif. . .. |
s-n’-a |
s-nos-a |
|
Instrumental.. |
now-av |
noq-avq |
|
Datif....... |
nm-a |
noi-a |
|
Ablatif...... |
nm-a-nê |
noi-a-nê |
|
Génitif...... |
nor-a |
noi-a. |
S 37a, 4. L’enclitique ik, en arménien. — Origine des thèmes aiso, uido, aino.
Une troisième enclitique jouant son rôle, en arménien?, dans la déclinaison des pronoms démonstratifs, c’est ftl{ ik, qui n’èsl pas adjoint nécessairement, mais qui peut s’ajouter à volonté à certains cas des adjectifs démonstratifs ais «hic33, aid «ille», ain (même sens, mais pour les objets les-jflus éloignés). On trouve cettè enclitique au datif, au génitif et à l’instrumental singuliers, au nominatif, â l’accusatif, au datif et au génitif pluriels. Je regarde IV de ik cômme une simple voyelle de liaison servant à l’adjonction de la consonne. Le même fait a lieu en osque (S 361), et je regarde le k de l’enclitique arménienne comme identique avec le k, c des formes osques iz-i-k, jon-k, jù-k, et des formes ombriennes er-e-k «hic», esu-k, eizu-c «hune33, ainsi qu’avec le c des formes latines hi-c, hui-c, htm-c, hô-c (S 3g A ).
PKONOMS.


348

Je fais suivre la déclinaison complète de l’arménien uyu ais « hic», dont le thème aiso correspond exactement au zend aisa, au sanscrit xrq êsd et à l’osque eiso 1.
Singulier. Pluriel.
Nominatif. .. ais aisq ou aisoq-i-k
Accusatif. . . . s-ais s-aisos-i-k
Instrumental.. aisu ou aisov-i-k aisoq-ivq ou aisoq-imbq3
Datif....... aism ou aism-i-k aisz ou aisoi-i-k
Ablatif...... aism-anè aisz ou aisi-anè
Génitif...... aisr ou aisr-i-k aisz ou aisoi-i-k.
Les thèmes aido et aino (nominatif aid et ain) sont fléchis de même. Le premier sert à désigner les objets d’un moindre, le second les objets d’un plus grand éloignement. Mais si aiso répond au sanscrit êsd, au zend aisa, de son côté, aido doit, comme l’a reconnu F. Windischmann, représenter le sanscrit êta, le zend aita; enfin, ain (thème aino) se rapportera au thème sanscrit êna (venant de aino). Cette concordance est trop évidente pour que nous puissions accepter l’explication donnée par les grammaires arméniennes : dans le s de ais «hic», elles croient retrouver le s de es «je», et dans le rq- d de aid «ille», elles voient le d de q.ni. du «tu». Il est vrai que s, d et n sont employés comme suffixes pour désigner la première, la deuxième et la troisième personne, et il est incontestable qu’ils représentent alors des thèmes de pronoms personnels3. Mais il ne s’ensuit pas h
1 Voyez S 344 et comparez F. Windischmann, Eléments de l’arménien, p. 35.
s Aisoq-imbq contient évidemment l’enclitique in; comparez r.oq-vnbq (S 37a, a). Aisoq-ivq me paraît avoir perdu le n du pronom annexe; si l’on n’àdmettait pas cette explication, il faudrait supposer pour ce seul cas une enclitique », qu’on pourrait rapprocher du thème sanscrit 5 »' (S 360).
3 Petermann (Grammaire arménienne, p. îqS et suiv.) cite comme exemple hair-s, qui signifie à la fois «pater ego» et «pater meus». Mais ce n’est pas épater meus», c’est «pater mei» qu’il faut traduire. Dans «pater ego» le pro-
PRONOMS DEMONSTRATIFS. § 372, h. 349


que dans ais «hic» le s soit pris au pronom de la première personne , ni que dans aid « ille » le d provienne de celui de la seconde l. Gomme conséquence d’un tel principe, il faudrait dire qu’il n’y a pas en arménien un seul vrai pronom démonstratif. On pourrait, d’après la même méthode, rapporter l’origine du sanscrit ima «hic» au pronom de la première personne et celle de ta «hic, ille» au pronom de la seconde personne (thème singulier tva). Ajoutons enfin qu’il serait surprenant qu’on ne pût exprimer en arménien des idées aussi simples que «ici»; (as-t), «d’ici» (as-ti) et «tant» (ais-qan), sans y faire entrer l’idée du «moi».
Dans les pronoms sa, suin, da, duin, na, nuin je crois reconnaître des formes mutilées pour aiso, aisuin, aido, aiduin, aino, ainuin : la surcharge causée par l’annexion des enclitiques a et in aura occasionné la perte de la syllabe initiale2. Rappelons a ce sujet qu’en ancien perse le thème démonstratif aisa perd en composition sa diphthongue ai, et que la forme mutilée sa (ou, avec affaiblissement de la voyelle, si) devient alors une enclitique; exemple : hacâ avada-sa «inde hic» ou «inde ille»3. En persan moderne, s n’est employé comme enclitique que pour marquer la relation du génitif : il s’attache au mot précédent a
nom annexe marque la relation du nominatif, dans «pater mei» celle du génitif. Scbrôder ( Thésaurus, p. g5) cite sais «hoc meum», dais «iilud menm»-, nais «islud meum», sai-d «hoc tuum», sai-n «hoc istius», etc. mais dans ces formes, le pronom annexe doit être entendu comme exprimant la relation' du génitif (tovto èpov, etc.).
1 La seule raison donnée par les grammaires arméniennes, c’est que le pronom «je» désigne la personne la plus rapprochée de celui qui parle, et le pronom «tu» une personne moins éloignée que «il».
3 L’arménien »w sa, unju suin, ne peut venir du sanscrit sa «celui-ci, celui-la, il», car un a initial devient toujours un h en arménien.
3 On ne trouve pas eu ancien perse la forme complète aiia, mais seulement le neutre aita.~ sanscrit état, zend aitad. Hors de composition, le masculin est remplacé par huva = sanscrit s va (S 34a).

350

l’aide d’un e, qui fait l’oflice d’une voyelle de liaison ; exemple : dil-e-8 « cor ejus»375.
Aucune loi phonique ne nous empêcherait de rapporter la partie initiale des composés da, duin au thème sanscrit ta (§ 343); mais outre que cette dérivation serait contraire à l’analogie qui relie da, duin avec sa, suin et na, nuin, il faut considérer que le thème simple do, s’il existait en arménien, y aurait sans doute laissé des adverbes pronominaux, de même que le thème ta a formé en sanscrit td-tra «là», td-tas «de là», ta-tâ «ainsi», ta-du «alors»; or, nous ne trouvons pas, en arménien, d’adverbe pronominal commençant par un d, non plus que par un s ou un n. Tous les adverbes de cette sorte commencent par ai s, aid ou a,in. Nous reviendrons sur ce sujet (§§ 420 et 421).
§ 878. Prépositions dérivées du thème composé ana.
Puisque la préposition latine inter est évidemment identique avec le sanscrit antdr et le gothique undar (§§ 293 et 9q4), et puisque l’i est un affaiblissement très-ordinaire de l’a, il convient aussi de rapporter les prépositions in, en latin, et êv, en grec, au thème démonstratif ana. On pourrait, il est vrai, rattacher in et êv au thème pronominal X *'» «'Ôa correspondrait au zend MQi^ iiïa «ici», avec insertion d’une nasale inorganique, comme, par exemple, dans dfyupw, ambo, comparés au sanscrit ubâù et au slave oba. Mais je crois actuellement que le n de in, èv appartient au thème2. Le s de sis (venant de êvs) me paraît être le reste du suffixe ers, qui marque la direction vers un endroit (comparez les adverbes mitre, àXXo.<rs); ou peut citer comme
PRONOMS DÉMONSTRATIFS. S 374. 351


exemples de mutilations analogues sl-s pour êtr-tri, S6s pour $o$t, wpos pour ns pot i. Si cette explication est fondée, nous voyons pourquoi sis sert spécialement à marquer le mouvement vers un lieu : il s’oppose à èv de la même façon qu’en allemand hin est opposé à hier, avec cette seule différence que les deux expressions grecques ne peuvent plus s’enip’oyer seules, mais ont besoin d’être suivies d’un mot marquant le lieu du mouvement ou du repos, à peu près comme un article dont le sens se perd dans celui de son substantif.
Le thème pronominal dont nous nous occupons s’est mieux conservé dans la préposition âvd, qu’on peut rapprocher du gothique ana et de l’allemand un. kva s’oppose à xard qui est également d’origine pronominale (§§ to5 et toi5) h
S 874. Dérivés du thème ana. — Les pronoms anyà et antara.
Combiné avec le relatif^ ya, le thème and donne anyd; avec le suffixe comparatif «TC; tara, il fait antara;
l’une et l’autre expression signifie «alius»2. L’a final de ana a été supprimé : la forme régulière eût été ana-ya, ana-tara3. En gothique, nous trouvons comme pronom correspondant anthar (même sens), dont le thème est anthara; en lithuanien, antrà-s d’autre, le second»; en latin, alter, avec changement de n en l (S 20). La même permutation de lettre s’observe dans alius et
' Voyez mon mémoire Sur quelques thèmes démonstratifs et sur leur rap, avec différentes prépositions et conjonctions, p. 9 etsuiv.
» Antara n’est employé dans ce sens qu’à la fin des composés; il est pris alors substantivement. Exemple : grâmântara (grdma-antara), littéralement «un autre parmi les villages». On dit, au contraire, anya-grdma «un autre village».
3 Les grammairiens indiens ont méconnu la vraie origine de ces pronoms. Ils rapportent anyà à la racine an «vivre» ; la nature composée de ce mot leur a échappé, aussi bien que celle de tya, sya. Quant à antara, ils le font dériver de anta « fin » : la formation irrégulière de ces mots les a induits en erreur. Remarquons d’ailleurs que antara, quoique originairement un comparatif, peut s’employe;\ ainsi que {tara, en parlant de plus de deux objets (S 999).



.'5 T) 2
dans le gothique alja', qui correspondent à nmjâ-s. Le
grec ak\os a opéré l’assimilation du j à la consonne précédente (S 19); il en est de même pour le prâcrit 'W aima et le vieux haut-allemand ailes « autrement». La forme anyd s’est, au contraire, bien conservée, quoique avec une certaine modification du sens, dans le grec svtoi, qu’on peut rapprocher du nominatif pluriel sanscrit et zend anyê «alii». De évio vient èviots «quelquefois», qui est formé comme aAAore, èndalois. En ancien slave, hn2 inü signifie «alius»; le thème, qui est ino, a perdu le y du pronom sanscrit et zend anya. Le nominatif au féminin est MNd ma, au neutre hno ino.
§ 3y5. Les pronoms dpara et para'.
Outre les mots anyd, antara et itara, le sanscrit a encore deux expressions signifiant «autre», à savoir dpara et xn;para.
Apara vient peut-être de la préposition dpa «de», qui elle-même semble se rattacher au thème démonstratif ^ a. Nous avons déjà rapproché (S 35o) de dpara le gothique et vieux haut-allemand afar3, l’allemand aber, dont le sens primitif se montre encore clairement dans abermals « derechef », aberglauben « superstition », aberwitz « démence » 4. En vieux haut-allemand, afar signifie aussi «de nouveau»; on peut rapprocher de cette acception celle du latin iterum, qui correspond au sanscrit TgfK^itara-s «l’autre».
répara, qui est plus usité que dpara, en dérive par aphérèse.
• ■ ■ \ ■ .■■■■■
I On a, par exemple, en gothique, alja-kunds «alienigenus», aljai vaihtai «ali» res», alju-thrô «aliunde» (S i83", 2). Le nominatif, selon moi, a dù être aljis, et non alis (S i35).
3 L’auteur n’a pas encore épuisé les dérivés du thème pronominal na. Les pronoms üpara et pdra, quoique d’origine différente, Se trouvent placés ici à côté de anyd et de antara, à cause de la similitude de leur signification. — Tr.
3 Avec/ au lieu de p, en vertu de la loi de substitution de consonnes (S 87, 1).
II Littéralement « une autre fois, une autre croyance, une autre raison ».
...... -itiiiwmiumhim,,,,


PRONOMS DÉMONSTRATIFS. S 375. 353
Au nombre des rejetons qu’il a pu laisser dans les langues de l’Europe, je serais tenté de mettre le latin perendie, qui s’expliquerait bien par «l’autre jour» : il est vrai que perendie, au lieu de signifier «demain», comme on devrait s’y attendre, a pris le sens de «l’autre jour» [en partant de demain]; mais il arrive souvent que l’usage fait signifier à un mot plus que n’expriment les éléments dont il est composé. Dans la première partie de perendie je reconnais un accusatif adverbial, avec n pour m, comme dans eundem. Au contraire, dans le sanscrit parê-dyw «demain», paré a l’air d’être un locatif376, tandis que le second membre du composé, si on y voit une contraction pour divas, est un accusatif. Le peren latin se trouve encore dans perendinus, permdino, perendinatio, dont le dernier membre se rattache à une autre dénomination sanscrite du «jour», savoir dîna.
Il y a encore un autre mot dans lequel je crois reconnaître les deux expressions f^sp^divas et para réunies : c’est ves-per,
ves-perus, en grec ienrépa; en sanscrit, divas-para signi
fierait, si l’on prend para comme substantif neutre, «diei extre-mum». Nous avons une expression sanscrite quia cette signification et où para figure comme premier membre du composé : c’est parâhna ( venant de para + ahna «jour»)2. En conséquence, vesper serait pour dives-per; cette mutilation ne serait pas plus surprenante que celle de fç^dvis «deux fois» qui devient bis.
Une autre trace de ipara «l’autre», en latin, seraitper-eger3 et peregrinus, si l’on rapporte au pronom para la première partie per, qui ne s’explique pas bien ici comme préposition.
1 Je crois que c’est là une illusion et que IV de parêdyus et d’autres composés du même genre (S 35a ) est un élargissement de l’a final du thème : à plusieurs cas de la déclinaison, nous avons observé un élargissement analogue.
1 Parâhna signifie «la dernière partie du jour» (voyez le Glossaire sanscrit); il est opposé à pûrvâhna «la première partie du jour».
5 Pour per-ayer; on devrait s’attendre à une forme per-iyer (S 6).
n.
a 3,
PHONOMS.

35ù

i
Pereger signifierait donc «étant dans un autre pays» (comme le vieux haut-allemand eli-lmti)' et peregrinus «originaire d’un autre pays ».
Citons encore ici perperus, qui contient peut-etre un redoublement de parus = pdra-s; ce qui est mauvais ou injuste serait appelé «l’autre»2, comme étant opposé à ce qui est bon et équitable. Dans le grec isép-nspos la signification primitive aurait pris une direction plus spéciale. 11 reste enfin a mentionner la particule usép, qui est plutôt employée comme pronom que comme préposition. Un mot dont la signification première était «l’autre» semble naturellement appelé à renforcer le pronom relatif; c’est ainsi qu’en français on a les locutions nous autres, vous autres, et qu’en allemand wenn anders «si toutefois» est plus énergique que le simple wenn «si» 3.
g 376. Pronoms dérivés du thème na.
Le gothique jains (thème jaina) «celui-là», le grec xeïvos, êxsTvos (éolien xvvos), le dorien rtivos et le borussien tans «il» (thème tana ou, avec le redoublement de la liquide, tanna, tenna, terne) renferment dans leur dernière partie le thème pronominal na dont il a été question plus haut (§369 etsuiv.).
Le dorien «n-os a allongé la voyelle de l’article, comme ont 376
PRONOMS DÉMONSTRATIFS. S 377.

355

l'ail aussi -tttkUos et tijwxj (S 35a); le même rapport qui existe entre tijvos et to se retrouve entre xvvos et le thème interrogatif ko. Au contraire, xüvoe, au lieu d’allonger la voyelle, 1 a amincie en s et y a mêlé un t ; un mélange analogue a eu lieu dans le composé sanscrit êna (8 369). Quant à êxstvos, il est pour xcïvos comme épov pour pov.
Dans le gothique jain(a)s « celui-là », il s est mele un i au thème relatif sanscrit v* ya. Si, dans les langues germaniques, il y avait, comme en slave, un j prosthétique pouvant se placer devant les anciennes voyelles initiales376, jains viendrait se ranger à côté de êna, comme une forme exactement identique; mais
nous avons déjà vu (8 308) que le représentant de êna, en gothique, c’est le nom de nombre ains (thème aina).
Mentionnons encore ici le grec AriVa (thème Seiv). J’y vois un pluriel neutre, que l’usage a détourné de son sens propre. Il y a entre Ssîva et le thème 10 le même rapport qu’entre xeï-vos et le thème xo ( d’où viennent x6ts , xérepov) ; la ténue primitive s’est amollie dans Ssîva. comme dans la particule «Je*(§ 35o). Je ne crois pas, cependant, que le v de doive être rapporté au pronom annexe q na; j’y vois plutôt, comme dans T*t>, dont il sera question plus loin, et comme dans beaucoup de mots de la déclinaison faible des langues germaniques (§ 1 As), un complément purement phonétique.
THÈMK PRONOMINAL VA.
8 377. Le thème composé ava.
H a déjà été question plusieurs fois du thème démonstratif zend «»j> ava «celui-ci». Il nous fournit une preuve nouvelle et intéressante d’un principe très-important pour 1 histoire des
1 Comparez, par exeùlple, l’ancien slave KCiWl» jestnt au sanscrit HIM4 as)ni et au lithuanien esmi «je suisn (S 99®).
2 3 .

356

langues, à savoir que les pronoms et les vraies prépositions ont la même origine. En effet, le sanscrit, qui n’a plus le pronom ava, nous présente une préposition ava marquant la sortie d’un lieu ou un mouvement de haut en bas. Ainsi, ava-plu, ava-tar (racine 71 tr) signifient «sauter en bas, descendre». De la nature pronominale de ava on peut conclure que le sens primitif de ces mots a dû être «venir» ou «sauter vers ce [lieu]».
En slave, ava s’est régulièrement transformé en ovo (§ 92“), lequel signifie «celui-ci» ou «celui-là»; son nominatif féminin ova est presque identique avec le nominatif féminin zend 377»<377 ava.
C’est à ce thème pronominal que se rattache le œtî de aMs (§ 344), qui a vocalisé le s en v après la suppression de là voyelle finale. Employé hors de composition, ce thème montre le mieux sa nature pronominale dans avôi «ici», qu’il n’est pas nécessaire de regarder comme étant pour rien ne s’op
pose à ce que le thème au prenne le suffixe locatif, à l’exemple des autres thèmes pronominaux. Comme formation analogue à ev6tx, nous pourrions nous attendre à trouver avOct, qui correspondrait pour le thème, le suffixe et le sens, au zend «<$«»« ava-d'a. Mais le grec nous présente seulement le mot êvrotvOd. (pour êvôavôa, voyez §344), c’est-à-dire avOa composé avec Ma.. Il en est de même pour,l’adverbe ablatif otùôev, qui ne s’est conservé que dans le composé ivTevdev. La forme dépourvue de flexion a8, dont le sens n’est nullement en opposition avec son origine pronominale, a probablement perdu sa désinence casuelle ou quelque autre suffixe. Si la forme primitive était le neutre avr ou aôS, la suppression de la dentale finale n’a rien que de conforme aux lois phoniques du grec (8 86, a). Peut-être au est-il un reste de aôôts ou de aSre : ce dernier adverbe est de même formation que les adverbes pronominaux Tére, &ts, ©ère, quoique, à l’égard du sens, il ait pris une nuance différente.
PRONOMS DÉMONSTRATIFS. S 37 8-379.

357

§ 378. Dérivés du thème ma.
Combiné avec le suffixe comparatif, le thème aû (§ 377) nous donne aôrdp «mais»; c’est ainsi que dpara «alius» donne en vieux haut-allemand afar «mais, de nouveau», en allemand moderne aber «mais». Par la conservation de l’ancien a, le suffixe de avrdp l’emporte sur le suffixe ordinaire repos et correspond exactement au tar sanscrit de antar (S 293). Dans le latin au-tem, formé comme i-tem, nous avons un suffixe qui répond au w tara des adverbes sanscrits ka-tam «comment?», it-tdm «ainsi» (S 4a5). Je regarde au-t comme une mutilation pour au-tî, de même que u-t est pour u-tî (S 4a5). Quant à la syllabe au de aufugio, aufero, je ne vois pas de raison suffisante pour m’écarter de l’opinion ordinaire, qui y voit un amollissement de abK Au contraire, dans la forme épique avepûoj, il semble bien que la particule ava, qui en sanscrit joue le rôle d’une préposition inséparable (§ 377), se soit conservée2; on a vu plus haut que la préposition sanscrite est une forme sœur du thème démonstratif zend ava; le av de avspvv et la particule grecque aS remonteraient donc à une origine commune.
S 379. Particules grecques dérivées du thème ava. — La négation où.
Je rapporte aussi au thème démonstratif zend ava et slave ovo3 le grec o2v, dont l’emploi dénote clairement une origine prono- 377
ancien slave, OV «.
358 PRONOMS.

.siïsa

minale 1 et dont la désinence est celle de l’accusatif masculin ou du nominatif-accusatif neutre. Remarquons que le thème pronominal zend ava forme son nominatif-accusatif singulier neutre, non pas par un |g d, comme d’autres thèmes pronominaux en a, mais par un m : cela nous donne une forme avëm2, qui se contracte irrégulièrement en aum3. En sanscrit, l’accusatif masculin et le nominatif-accusatif neutre seraient avam ; le second a est supprimé dans le grec ow ainsi que dans la syllabe av de uù-Oi, aù -t6s et d’autres formes analogues; le premier a, au contraire, est représenté par l’o, comme dans fiovs (§ ia3). |
Conformément à ce qui a été dit plus haut (§871) sur l’ori- I
gine des particules négatives, nous rapportons également au thème pronominal ava la négatio'n où. Ov est à ovx4 ce que le préfixe latin ne est à me. De même que le latin nec est pour neque, je vois dans ovx une forme mutilée pour oixl ou, avec j substitution de l’aspirée à la ténue, oùyj. Peut-être ce xi est-il de même origine que le thème pronominal sanscrit ci, qui également s’emploie comme enclitique (§ 385 et suiv.). Il y a le même rapport entre 1% ci et l’enclitique ^ca (= que, en latin) qu’entre le neutre ki-m «quoi?» et son masculin ^ka-s «qui?». Si donc la syllabe xt, dans ovxi, est parente avec le ci indien, elle l’est aussi avec le que du latin neque.
§ 38o. Dérivés du thème ava. — La conjonction gothique auh, en allemand moderne auch.
\
11 nous reste à indiquer un rejeton du thème pronominal ava dans les langues germaniques. Je veux parler de l’allemand amh,
1 Voyez Hartung, Particules grecques, t. II, p. 3 et suiv.
3 Sur Pi, voyez S 3o.
1 On aurait dû s’attendre à avoir aum (S àa). — La forme aum sert en même temps pour Paccusatif masculin, qui, sans contraction, eut fait avëm. (Voyez Bur-nouf, Yaç.na, notes, p. 5.) ,
4 Oiïx, à cause de sa consonne finale, est employé devant les voyelles.
PRONOMS DÉMONSTRATIFS. S 380.

359

dont la valeur démonstrative paraît clairement dans les phrases comme : er ist blind und auch lahm « il est aveugle et aussi perclus». Le rôle de auch, dans cette phrase, est d’annoncer une nouvelle qualité qui vient s’adjoindre à la première; c’est comme si l’on disait : * il est aveugle et ceci : perclus». Audi remplit ici pour un seul mot le même office rempli par la conjonction dass «que» pour tout un membre de phrase; en effet, quand je chs : icli will nichl dass er homme «je ne veux pas qu’il vienne», la conjonction dass exprime d’une façon générale l’objet de ma volonté, que viennent déterminer ensuite les mots er homme; en d’autres termes, dass est le complément grammatical et er homme le complément logique1.
En vieux haut-allemand, auh (qu’on écrit aussi ouh, ouc, etc.) a encore d’autres significations, telles que «car, mais». Ces sens conviennent très-bien à un dérivé pronominal, comme le prouvent les mots demi, aber, sondera 2. En gothique, auk signifie surtout «car». Si, dans tous les dialectes germaniques, auch avait uniquement le sens « aussi », on pourrait songer à une parenté avec le gothique aukan «augmenter»3. Mais quel rapport y a-t-il entre « augmenter » et un mol pouvant signifier «car, mais»? Les notions verbales et les racines verbales sont d’ailleurs les dernières que je voulusse appeler à mon secours pour expliquer une conjonction4. Toutes les vraies conjonctions dérivent de pronoms (S io5); c’est un principe que dès mes premiers écrits
1 La conjonction dass est originairement identique avec le neutre du pronom dur. C’est seulement en allemand moderne qu’on a commencé à distinguer par l’orthographe le pronom de la conjonction. Au reste, l’exemple allemand donné par l’auteur pourrait aussi bien être remplacé par un exemple grec, latin, anglais ou français : dans les phrases comme olS’ Szi..., scio quod... (Plaute), I know that. ...jc sais que. .., ôVi, quod, that, que sont d’anciens pronoms neutres. — Tr.
* Voyez Graff, Dictionnaire du vieux haut-allemand, I, col. îao.
;i Comparez le sanscrit ûh «assembler», d’où vient samâlfa «foule».
1 L’étymologie aukan, repoussée ici par l'auteur, est proposée par J. Grimm, dans sa Grammaire allemande, III, p. 37A. —Tr.
PRONOMS.

360

j’ai essayé de démontrer1. Quant à la gutturale finale du gothique auk et de l’allemand auch, je crois actuellement qu’il y faut reconnaître la même particule annexe que nous avons déjà trouvée dans les accusatifs mi~k, thu-k, si-k (§ 3a6, remarque), et qui convient à tous les autres cas aussi bien qu a 1 accusatif.
§ 381. Origine du thème mm. — Le thème simple va et ses dérivés.
Quelle est l’étymologie du thème composé ava? c’est le thème démonstratif a (§ 366) qui en forme le premier membre; le second est un thème va qui, hors de composition, a presque disparu. Je rapporte à ce thème 1 adverbe vat~ «comme», quon trouve combiné avec des substantifs ; exemples : matr-vat « comme une mère», putra-vat «comme un fils». J y rapporte, en outre, la conjonction vâ «ou», qui s’emploie comme enclitique de la même manière que le latin ve, lequel est probablement d origine identique3. Enfin au même thème se rattache, selon moi, la préposition inséparable vi, dont l’t est 1 affaiblissement d un ancien a, comme dans la préposition ni, venant du theme démonstratif na (§ 370).
Combiné avec d’autres thèmes pronominaux, le thème va se trouve dans les adverbes déjà mentionnés (§ 3o8) êvd, êvam «ainsi», dans le thème zend aiva «un», dans le sanscrit
iva «comme » et, à ce que je crois, dans sdrva «chaque», pluriel sdrvê «tous».
Dans sa première partie, sdr-va renferme peut-être le thème démonstratif sa. On a vu que le thème sa n’est guère employé
1 Annalesde Heidelberg, 1818, p. ^73.
1 Vat est, quant à sa forme, un nominatif-accusatif neutre. Je crois reconnaître cet adverbe, employé comme préfixe, dans vat-tara «année», littéralement «ce qui va d’une façon égale». Comparez le mot tamà «année», littéralement «celle qui est
égale». . ' . . «ri
3 Comme préfixe, vd se trouve dans vànara «singe», si l’explication de Wilson
« comme un homme» est fondée.

361

qu’au nominatif masculin et féminin : on en peut conclure qu’il a une force démonstrative plus énergique que ta, qui le remplace aux cas obliques et au neutre. Sa paraît donc bien convenir pour former, en combinaison avec va, une expression signifiant kchaque». Il a, d’ailleurs, à lui seul, ce sens dans les adverbes sà-dâ, sa-nâ «toujours, en tout [temps]», qui s’opposent à ta-da « alors, en ce [temps]». Je regarde le r de sdr-va comme un complément de même espèce que dans êtdr-hi «maintenant » et kdr-hi « quand?» '. Le h de ces deux mots est le reste d’un «f et la syllabe dï est une forme sœur du grec 8-i (§ 2 3); en conséquence, si l’on fait abstraction du premier pronom ê, êtdrhi répondra au grec t69t et kdrhi à ts66t, venant de x68i. En gothique, nous trouvons les adverbes tha-r «ici-même»378 379 et hva-r «où?»380, qui ont perdu la syllabe hi ou <R de leur prototype indien. Mentionnons encore le composé hvar-jis « lequel ? », dont ie dernier membre appartient au thème relatif sanscrit ^ ya (8 289 et suiv.). En lithuanien, l’adverbe kitur (M-tur) «ailleurs» présente la même formation que les adverbes locatifs gothiques en r. On peut comparer enfin au sanscrit sarva le vieux haut-allemand sâr «omnino», en allemand moderne sehr «très».
THÈME PRONOMINAL YA.
S 382. Le thème relatif ya, en sanscrit, en grec et en arménien.
Nous passons au pronom relatif, dont le thème, en sanscrit et en zend, est ya, féminin yâ. Il a déjà été question plusieurs fois des ramifications de ce pronom dans les langues de l’Europe.
“1


PRONOMS.
En nrec, yas, yâ, yat est devenu £>s, ri, 81. Certains dialectes grecs remplacent le pronom relatif par l’article; mais il n’en faudrait pas conclure que le pronom relatif et l’article soient de même origine : c’est ainsi qu’en allemand welcher «lequel» peut être remplacé par le démonstratif der, qui a un thème absolument différent. On ne saurait douter que le thème relatif ait appartenu de toute antiquité au grec, quand on voit que dans Homère il est d’un emploi très - fréquent, et qu’aux dérivés démonstratifs comme toctos, totos, ryX/xos , ■vîiy.os viennent s’opposer les expressions relatives oaos, oîos, rjXixc;, fjfios. La comparaison du sanscrit et d’autres idiomes congénères prouve d’ailleurs que les deux thèmes en question sont d’origine différente 2.
11 a déjà été question (§ 188) du thème relatif arménien npn oro (nominatif or). Je suppose que le de, y a aura été remplacé par un r. On a vu que les liquides et les semi-voyelles permutent fréquemment entre elles (§ 20) : il y a des exemples, en arménien, d’un l représentant un primitif3; or, les deux lettres l et r sont presque identiques dans toute la famille des langues indo-européennes. L’o initial de oro est, selon moi, une voyelle prosthétique. En général, l’arménien évite d’avoir un r au commencement des mots : ou bien il lui fait subir une métathèse, ou bien il le fait précéder d’une voyelle4.-
1 Sur le y, représenté en grec par l’esprit rude, voyez S 19.
2 L’auteur combat, dans ce passage, l’opinion de Butlmann, qui rapporte os et 0 à un même thème primitif (Grammaire grecque développée, S 75, rem. 4).— Tr.
3 Voyez S ao, et comparez avec la racine sanscrite yug «unir» l’arménien /Xfr/ l\el (pour luiel) «unir», lui «joug».
4 Bottiger (Journal de la Société orientale allemande, t. IV, p. 354 ) reconnaît de même une proslhèse dans Irpuluip erang, qu’il rapproche du sanscrit râhga «couleur», dont la racine rai'ig «colorer» a donné aussi, en sanscrit, raklâ «rouge» et râga «rougeur». Je rattache à ce dernier mot l’arménien nptulf orak «couleur» et 0 rakanel «se colorer»; la substitution de la ténue à la moyenne primitive n’a rien de rare en arménien.


363
§ 383. Le thème ya, en zend, en lithuanien, en slave et en gothique.
En zend, le thème ya est à la fois relatif et démonstratif : on trouve notamment l’accusatif ç,iX~ y*m plusieurs fois employé
11 en est de même en lithuanien, où jis (par euphonie pour jas, voyez § 135) signifie «il». L’accusatif est jih1. Le datif jam
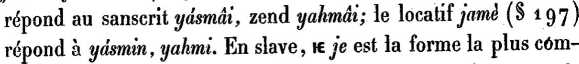
Au nominatif singulier féminin, ja (dans raate ja-se «laquelle») répond à la forme sanscrite et zende yâ. Le nominatif masculin i (S 289) a supprimé la voyelle du thème et vocalisé 1 ej.
En gothique, la particule relative ei (= i)2 a fait subir au thème les mêmes modifications que le nominatif slave i. Mais il existe, en gothique, d’autres rejetons du thème relatif qui sont mieux conservés. Citons d’abord la conjonction ja-bai « si », qui ne diffère du sanscrit irfif yd-di «si» que par le suffixe.
Remarque. — Conjonctions signifiant «si», dérivées du thème relatif. — Le gothique ja-bai «si» nous amène â parler des conjonctions ayant le même sens en sanscrit, en lithuanien et en grec, et dérivées également du thème relatif. Nous commençons par examiner le suffixe du gothique ja-bai.
Bai est une variété de ba, que nous trouvons dans le composé thauh-jaba. De jabai, jaba on peut rapprocher la particule iba, ibai, qui a ordinairement le sens interrogatif, et qui est dérivée du thème pronominal i\ Je
1 Dans le lithuanien jis, jià, l’t provient de l’influence euphonique du j. Au contraire, dans le zend yim, l’i a une autre cause, car on a aussi dû» pour dim (S 3/i3) et drugim pour drugém, de drug (sorte de démon femelle).
a Sur cette particule, voyez § 365.
:l Voyez mon mémoire Sur quelques thèmes démonstratifs, p. i5, et Gralf, Dictionnaire vieux haut-allemand (I, col. 76), qui adopte mon explication, mais qui

dans le sens de «hune» (§ 287, 3).
plète qui, au singulier masculin et neutre, se soit conservée
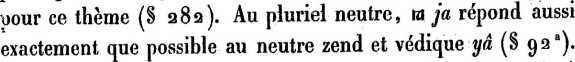
36?, PRONOMS.


soupçonne que le sulïixe ba n’est pas sans rapport avec ia syllabe ar va dans iva «comme», êvà et êvâ-m «ainsi», ou, ce qui revient à peu près au même, avec l’enclitique ôir^ vat «comme» (S 38i). La même explication nous rend compte de la syllabe ba1 qui termine les adverbes gothiques dérivés d’adjectifs. Le durcissement du v en b ne doit pas nous surprendre.
En bengalais, tous les v sanscrits sont prononcés comme des b. En allemand modërne, beaucoup de b ont pris la place d anciens v. En lithuanien, le v du sanscrit iva «comme» s’est changé enp‘.
La conjonction sanscrite y Mi «si» est composée du theme y a et
d’un suffixe di qui est probablement un amollissement pour ti (comparez »f?T {-ti «ainsi», îrirT à-ti «au-dessus»). Nous avons vu plus haut que ce même suffixe ti se change en f& d'i dans a-di «sur, vers». Le prâcrit sTJ gaï (§ 19) a complètement rejeté la dentale, et il en est de même pour le lithuanien jey (jei).
Nous sommes, pour ainsi dire, amenés de la sorte au grec si, dont la parenté avec notre thème relatif me paraît aujourd hui à peu près hors de
désigne à tort ces thèmes pronominaux comme des adverbes de lieu. — Le gothique iba, en se combinant avec la particule négative ni, prend le même sens quej-aba; on a donc niba (pour ni-iba, comme nist «il n’est pas» pour ni isf), qui signifie «si... ne... pas». De même, en sanscrit, ia particule it prend le sens de «nisi» en se combinant avec na (S 36o).
1 Je dis ba et non aba, car le premier a appartient au thème adjectif : c’est pour cette raison que les thèmes en u font uba et non v-aba ; quant aux thèmes en ja, la plupart suppriment leur voyelle finale et font i-ba, au lieu de ja-ba. Exemples : frôda-ba «d’une façon intelligente», venant de Jrôda (nominatif Jrêths)-, hardu-ba ' «durement», venant de hardu; andaugi-ba «publiquement», venant, Comme je crois, du thème substantif andaugja (nominatif andaugi) «visage». Nous trouvons la forme pleine en ja dans gabaurja-ba «volontiers».
* Comparez S 359. Le changement du t> en p, opéré par le lithuanien, nous permet d’expliquer les adverbes pronominaux finissant en ipô ou ip. Je les rapporte au sanscrit ^sr iva, qui également est toujours placé après le mot qu’il déterarine (rTëj^ ^ôt tad iva «comme cela»). Comparez, en lithuanien, tatpô oataip «ainsi» (littéralement «comme ceci»), pour ta -t* ipô ; kaipô ou kaip «comment?» ; kitaipô, kttaip, et àntraipô, àntraip «autrement». On pourrait aussi diviser les adverbes en question de cette autre manière : tai-pô, hai-pô. Il faudrait alors considérer lai, kai comme des neutres (S 157), et supposer que l’i de «va s’est perdu en lithuanien. Mais je préfère la première explication, qui peut s’appliquer aussi au gothique hvaiva «comment?» (pour hva+iva). Ici le gothique n’aurait pas opéré le changement du v en b.
PRONOM RELATIF. $ 384.

365

doute : le seul fait qui pourrait soulever quelque difficulté, c'est la disparition de la semi-voyelle initiale; mais nous avons déjà dû admettre la même suppression quand nous avons rapproché le védique yusmê'«vous» de
l’éolien ôftftes. En ce qui concerne la perte de la dentale, on peut comparer le grec Çépst — sanscrit bàrati «il porte».
S 384. Particules dérivées du thème ya. en gothique, en lithuanien et en latin.
Un autre dérivé du thème relatif ya, en gothique, c’est la particule jau, qui a le sens interrogatif de la particule latine an *. Je regarde jau comme le très-proche parent de jaba2. On vient de voir (§ 383, remarque) que jaba est pour java; je suppose que java s’est contracté en jau, comiAele thème thiva «valet» a donné le nominatif thius et l’accusatif thiu. Mais si l’on ne veut pas reporter la formation de jau jusqu’à l’époque où l’on disait encore java, je rapprocherai le latin aufugio, aufero, pour abfugio, abfero.
Le lithuanien possède aussi une particule jan qui est de même origine que le mot gothique, au moins en ce qui concerne le thème; elle signifie «déjà», littéralement «en ce [temps]», et elle rappelle, par conséquent, le latin jam (§ 361). Peut-être Vu de la forme lithuanienne provient-il de la nasale (§ 18); jam et jau n’en seraient alors que plus rapprochés : jam serait h jau ce que le sanscrit dbûvam (aoriste) est au lithuanien buwaü «j’étais ».
Au latin jam et au lithuanien jau vient s’associer encore le gothique ju «maintenant, déjà», dont l’w est sorti d’un ancien a, comme celui de la particule nu «maintenant» (§ 370). Combiné avec than, ii donne l’adverbe juthan «déjà». Ce fait nous fournit une preuve nouvelle que ju n’a aucun rapport avec le sanscrit
dyu «jour», car il faudrait alors que le pronom démonstratif
1 En sanscrit, yàdi signifie tantôt «si», tantôt «an».
2 On a, de même, en lithuanien, taip «ainsi» A côté de taipO.
36(5 PRONOMS. |


fût placé le premier : au lieu de juthan, on aurait lluinju ou liiaju, comme on a, en latin hodie, en vieux haut-allemand Idutu, en sanscrit a-dyâ, et, en grec, arfnspov. j
^ |
§ 385. Particules affirmatives dérivées du thème ya, en gothique.
Pour épuiser, en gothique, les restes du thème relatif sanscrit, il nous faut encore mentionner les particules affirmatives ja,jai (§ 371) et le copulatif jah «et, aussi».
La forme ja peut être considérée comme un neutre analogue à l’interrogatif liva «quoi?» et, comme lui, dénué de flexion.
La forme plus usitée jai est sortie de ja; nous avons déjà vu (§ i 58)que Y a, en sanscrit, a également une propension à se changer en diphthongue par l’adjonction d’un ». Jai acquiert de la sorte une apparence de flexion qui le fait ressembler au seul neutre pronominal qui existe en lithuanien, savoir tai.
Le h final de la particule copulative jah est identique avec le que latin et avec le ^ ca sanscrit : toutes ces enclitiques viennent du thème interrogatif ha, que nous allons examiner de plus près dans les paragraphes suivants.
THÈME PRONOMINAL KA.
g 386. Le thème interrogatif ka, en sanscrit, en zend et en lithuanien.
Il y a, en sanscrit, trois thèmes interrogatifs, ka, ku, h, contenant chacun unexautre des trois voyelles fondamentales.
Les deux derniers peuvent être considérés comme des affaiblissements du thème ka, qui est le plus usité.;Nbrnbles examinerons successivement, en commençant par le thème qui a la voyelle la plus pesante (§ 6 et suiv.). ; : : '
De ka dérive toute la déclinaison masculine et, neutre, à l’exception du nominatif-accusatif singulier neutre, fis^km. Mais le neutre kat, qui, dans le sanscrit classique, n’est plus em-
PRONOM INTERROGATIF. § 387.

367

ployé comme mot isolé, et auquel se rapporte la forme latine quod, n’est pas difficile à reconnaître dans la particule interrogative qffgïî kac-cit (par euphonie, pour kat-cit); on le retrouve aussi comme préfixe dans des expressions telles que ■SRgp^kad-ndvan1 «un mauvais chemin», littéralement «quel chemin ! ». Il v a encore d’autres expressions interrogatives qu’on met de la sorte à la tête d’un composé, pour donner une idée fâcheuse ou méprisable d’une personne ou dune chose; j ai déjà attire ailleurs l’attention sur ce fait2 : ma conjecture à l’égard de kat s’est trouvée complètement vérifiée depuis par le zend, où ^ kad est le neutre ordinaire de l’interrogatif3. Du thème masculin-neutre Ica vient, en sanscrit et en zend, le thème féminin kâ, qui est dépourvu de flexion au nominatif singulier (S 187).
Parmi les langues de l’Europe, c’est le lithuanien qui se rapproche le plus du sanscrit et du zend, car le nominatif masculin km, en lithuanien, est absolument identique au ^ km sanscrit; il est même mieux conservé, car son s se maintient invariablement dans toutes les positions, au lieu que le km sanscrit devient kaK, ko ou ka, selon la nature de la lettre initiale du mot qui suit ou selon qu’il est placé devant une pause 4.
S 387. Le thème ka, en grec et en latin.
En regard du thème interrogatif ka que nous trouvons en
1 Kad, par euphonie pour kat (S 93*)-
2 Annonces savantes de Gttttingue, 1821, p. 35a. Wilson rattache, an contraire, d’après les grammairiens indiens, la particule interrogative kaècit, ainsi que kadr adfoan et les composés analogues, à un mot kat pour hui «mauvais». Il semble que le rapport des préfixes kat et leu avec le thème interrogatif ait entièrement échappé aux grammairiens de l’Indé. -
3 On trouve aussi kat, dans le dialecte védique, comme interrogatif neutre; mais alors il est toujours pris substantivement. Il est usité, en outre, comme particule interrogative , au lieu des formes ordinaires kùn et kaécil.
4 Voyez Su. Sur le nominatif zend kné en combinaison avec nû «homme» on avec le pronom de la deuxième personne, voyez S 135, remarque 3.
368 PHONOMS.


sanscrit, en zend et en lithuanien, nous devons nous attendre à trouver en grec un thème xo (§ 116) : xo s’est conservé, en effet, dans le dialecte ionien; mais, par le changement si fréquent de la gutturale en labiale, xo, dans la langue ordinaire, est devenu ©0. Comme thème déclinable, xo ou ©0 a été remplacé par tis; mais il en reste des adverbes et des pronoms dérivés, tels que xire, tsôts, xâs, ©«?, xotepos, tsérspos (comparez «WÇ^katard-s «lequel des deux?»), xétros, ■aio-os, xoîos, ©oïos, qui attestent suffisamment la présence d’un ancien pronom x6s, xtf, xi. ,
C’est au même thème que se rapportent, en latin, les cas du pronom interrogatif et relatif qui appartiennent a la seconde déclinaison, à savoir : quod (= védiqpe kat, zend kad), quô, et, au pluriel, qui, quorum, quôs. Quant à Yæ que nous avons au pluriel neutre et au nominatif singulier léminin, je le regarde comme un affaiblissement de l’d long qui se trouvait primitivement dans ces deux formes (§§ a3i et 118); cest ainsi qu’en sanscrit les thèmes féminins en â changent, au vocatif singulier, cette voyelle eh ê = ai (S 206), et qu’en beaucoup d’autres endroits la grammaire sanscrite nous présente ê comme le remplaçant de l’d.
A l’accusatif pluriel féminin, le latin quôs est presque identique avec le sanscrit kâs, et, au génitif, quâ-rum représente parfaitement ka-sâmK
Sur la déclinaison toute semblable de hœ-c, voyez § 3g4.
S 388. Le thème ka, dans les langues germaniques et slaves.
En gothique, la loi de substitution des consonnes exigeait le changement de la ténue en aspirée : le k du thème interrogatif est donc devenu un h, et un v euphonique est venu se placer à son côté (§86, i); du groupe hv, le v seul est demeuré dans l’allemand moderne wer «qui?». Le nominatif masculin, en go-
PRONOM INTERROGATIF. § 389. 369


thique, est hva-s; c’est, grâce à son monosyllabisme, la seule forme qui ait gardé, dans cette langue, l’a du thème devant le signe casuel (§ i35). Pour la même raison, le nominatif singulier féminin hvô (= sanscrit kâ) a gardé la longue primitive (S 118)1. Le neutre hva a perdu son signe casuel. Le signe du neutre s’est maintenu, au contraire, dans l’ancien saxon Imat (jwat) et dans le vieux haut-allemand huaz; il faut considérer ces formes comme des restes de huata, huaza : grâce à l’a final qui, à une époque plus ancienne, avait été adjoint à la dentale, celle-ci a pu être conservée2. Le vrai thème masculin-neutre3, en ancien saxon et en vieux haut-allemand, est huia = hwia ou hœja; de là, en ancien saxon, le nominatif singulier masculin huie, l’accusatif huën, le datif huëmu, le génitif hues; en vieux haut-allemand, huer, huën (huënan), huëmu, hues, instrumental huiu (§ 160). Le pronom annexe qui s’adjoint aux adjectifs forts (S 287 et suiv.) est venu s’ajouter ici au pronom.
L’ancien slave peut décliner le pronom interrogatif de deux manières : d’après tü, ta, to (§ 3 Zi g ), ou en combinaison avec le pronom annexe des adjectifs déterminés (§ 284). Décliné de cette dernière façon, il fait au nominatif KXiii kii-j, kata ka-ja, kok Ao-/e4; décliné seul, il fait kü5, ka, ko.
§ 389. Le thème interrogatif ku et ses dérivés, en sanscrit, en zend et en latin.
Nous passons au thème interrogatif ^ ku, qui est, comme nous l’avons dit (§ 386), l’une des formes secondaires de ka.
' Il en est de même pour s6 = sanscrit sa.
5 Voyez SS 86, a \ et 155.
3 C’est-à-dire ie thème déclinable. — Tr.
4 Voyez la déclinaison complète dans Miklosich, Théorie des formes, a' édition, page 70.
5 Kü n’est usité qu’en combinaison avec le thème démonstratif annexe to (K2TO kü-to); mais la signification reste la même.
h.
a 4

<170

A leu se rattachent les adverbes kü-tra « où ? », Icû-tas «d’où?». kû-hct « où ? » 1 et peut-être aussi kvà « où ? » 2. En zend, nous avons ku'tra «où?», km «où?» et kuta «comment?». Ce dernier ferait supposer en sanscrit un adverbe, kiiiâ (§ h y 5 ) ; mais le terme usité dans le sens de «comment?» est «hwj*i kaidm.
Ku est aussi employé en sanscrit comme préfixe, dans un sens péjoratif; exemple : kutanu «ayant un corps contre
fait», littéralement «ayant quel corps»; c’est un surnom du génie Kouvéra. En zend, on trouve aussi ku comme préfixe devant des verbes; il signifie alors «quelqu’un» et il sert à donner plus de force à la négation nôid, dont le verbe est accompagné. C’est ainsi que nous lisons au commencement du Vendi-dad : ç4>j nôid kudad «non quisquam creavit» (pour
«creasset»).
En latin, on pourrait rattacher au thème ku le génitif cu-jus et le datif cu-i, qui appartiennent en quelque sorte à la quatrième déclinaison, de même que les forme» archaïques quojus, quoi, venant du thème quô = «fi ha, appartiennent à la seconde. Il ne serait donc pas nécessaire de regarder cujus et cui comme des altérations pour quo-jus, quo-i, puisque le thème eu, ainsi qu’il ressort du sanscrit et du zend, est aussi bien usité que le thème quô. Cujus, cui, cujas ou cujatis pourraient en être sortis et avoir coexisté à côté de quojus, quoi, quojas, comme quid, venant du thème qui, existe à côté de quod, venant de quô. Mais si l’on considère qu’en sanscrit toute la déclinaison du pronom interrogatif, à l’exception de la seule forme kim, vient du thème ka (= latin quô)-, si l’on obserye que toute la déclinaison lithuanienne vient de ka et toute la déclinaison gothique de hva; si l’on prend garde enfin que le thème ag ku n’a laissé dans les langues de l’Europe aucun rejeton incontestable, il paraîtra
1 Usité seulement dans le dialecte védique.
4 Si nous supposons que leva se divise en ku-a, et non en k’-va.
PRONOM INTERROGATIF. S 3811.

371

plus vraisemblable de supposer que cujus, cui proviennent de quojus, quoi, par la suppression de l’o et le changement du v en u1. 11 existe, en sanscrit, des exemples nombreux de la syllabe
va
contractée en u1, et même en latin nous voyons quatio devenir
cutio (concutio), et loquor, sequor3 faire locutus, secutus.
On ne peut douter que le latin uter et les autres expressions interrogatives et relatives commençant par u (ubi, unde, uti, ut) n’aient perdu une gutturale initiale. 11 existe d’autres exemples d’une suppression de ce genre : ainsi amo répond au sanscrit ctiW^JlRt kâmàyâmi «j’aime», et nosco, nascor sont pour gnosco, gnascor. La forme plus complète cubi, cunde s’est conservée dans les composés ali-cubi, ali-cunde11. Les adverbes unquam, usquam, tispiam, usque ont éprouvé la même mutilation. Tous ces mots renferment le pronom interrogatif. Il est vrai qu’ils ont cessé d’être eux-mêmes des interrogatifs ; mais il en est de même pour quisquam, quispiam et quisque; on verra plus loin (§ 3q4) que c’est le second membre du composé qui est cause de ce changement de signification. Par la mutilation de la syllabe eu (venant de quô) en u. uter et les autres mots précités rappellent ce qui est arrivé en allemand pour le pronom interrogatif wer, lequel a perdu la consonne initiale et n’a conservé que l’élément euphonique qui était venu s’y adjoindre (-8 86, î). On pourrait soutenir, il est vrai, que l’« de uter et des autres expressions interrogatives commençant par u n’a rien de commun avec le v euphonique du thème quô, mais qu’il est un affaiblissement de 381 382 383 384

m

l’a primitif de gi ka; que, par exemple, uter est une altération de sfRTCyT ka tarda, le k s’étant perdu et l’a changé en u. Mais s’il n’est pas rare de voir un a indien représenté en latin par un u, cela n’à pourtant lieu ordinairement que devant des liquides ou devant un s final; le a de katara-s, suivant les lois
phoniques du latin, serait resté a, ou plus vraisemblablement se serait changé en ô, comme dans Kérepos, ou bien encore il serait devenu ë ou ï.
§ 390. Le thème interrogatif Ici.
Le thème interrogatif ki est plus riche en dérivés que le précédent, en sanscrit aussi bien que dans les autres langues indo-européennes. C’est de ce thème que vient le nominatif-accusatif neutre kim «quoi?» dont il a déjà été plusieurs fois question. Le thème ki offre, en effet, cette particularité unique, qu’il prend un m au nominatif-accusatif neutre, au lieu que les autres neutres en i présentent leur thème à l’état nu, le m restant réservé aux seuls thèmes substantifs et adjectifs en a (§ i5a). On devait donc s’attendre à avoir une forme ki ou, d’après la déclinaison pronominale, kit. Cette dernière forme a dû exister dans le principe; on n’en peut guère douter, si l’on rapproche les neutres et f^cït1, ainsi que le zend igp(g ciel2 et le latin quid. Dans le dialecte védique, il y a aussi un nominatif masculin kis, qui est l’analogue du latin qui*; mais l’expression védique n’est employée qu’en composition avec les particules négatives na et mâ : na-kis signifie « nemo », littéralement «non aliquis»; quant à mâ-kis (en zend mâ-êis, voyez § 399), il a le sens prohibitif «ne quis»3.
1 Voyez S * 54.
* Nous trouvons ëd employé avec le sens du neutre kad dans cette phrase du Vendidad-Sâdé (manuscrit lithographié, p. 80) : Vf»*!» ?•“»» Çlf; cid avad vaéô «quel [estj ce mot?».
3 Dans le dialecte védique, le sens propre de kis «quelqu’un» se perd après la

PRONOM INTERROGATIF. S 391.
373
S 391.
Dérivés du thème ki. — Ki changé en hi.

Parmi les dérivés du thème interrogatif ki, nous citerons kîilfsa «cui similis? »1 ; khjat « quotas », dans les cas forts kïyani (nominatif masculin klyân, accusatif kiyantam).
On peut encore rapporter au thème ki la particule hi « car », par une substitution de jî h à k dont nous avons un exemple dans hrd « cœur » et hnldya (même sens) = latin cor, grec xvp et xapSia. Le passage du sens interrogatif au sens démonstratif est le même que dans le grec y dp, qui est l’analogue, quant a la formation, du gothique Iwar, thar et du sanscrit kar-hi (§ 381)2. Le hi sanscrit se retrouve peut-être encore dans W%hyas "hier», que je crois devoir décomposer en hi + as, littéralement «ce jour-là ». En effet, s’il est encore possible de démêler les éléments constitutifs des mots qui signifient «hier, aujourd’hui, demain», on doit s’attendre à y trouver, d’une part, des pronoms et, de l’autre, des désignations du jour. Je suppose donc que le as de hy-as est un reste très-amoindri de divas «jour», de même que, dans le mot allemand heuer «cette année»3, la syllabe er nous cache le mot jahr (gothique jêr) «année» (en zendyârë, même
particule prohibitive mâ; il en résulte que md-kis ne signifie rien de plus que ma employé tout seul. Exemples : mâ kir no duritâya d'âyîh ( Rig-véda, mandatai, hymne 1A 7, vers 5) «ne nous tiens pas dans le malheur» (racine fy «tenir»). La phrase équivaut à : mâ nô duritâya ddytli. Kis se rapporte ici au mot «tu» renfermé dans le verbe, et l’on pourrait traduire littéralement : «tu aliquis» ou «iste tu» (comparez le sanscrit sa tmm «iste tu»). Il n’y a donc pas, selon moi, de raison pour admettre, comme le fait Benfey dans son Glossaire du Sâma-véda(p. A6), un adverbe kir, dont le r serait le reste du suffixe locatif tra.
1 VoyezSAt5.
3 \é et Sëïvu nous ont déjà présenté des exemples de l’amollissement de la tenue en moyenne (SS 35o et 376).
3 Comparez le moyen haut-allemand hiure pour hiu-jâru. Rapprochez aussi le latin homw, qu’il faut décomposer en h’-or-nus ou peut-être en ho-r-nm. Voyez S 396.
PHONOMS.

ÔJÜ

sens). Dans Je grec /fiés, le x tient la place du î| h sanscrit; le S- est une addition purement phonétique (§ 16). Dans hm, venant de ltesi (comparez hes-ternus, en sanscrit hyas-tam-s), on reconnaît plus aisément l’élément démonstratif, à cause de la présence, en latin, du pronom lii-c. L’allemand gestern « hier », en gothique gistra ’, a un g-au lieu de l’ancienne aspirée, en vertu de la loi de substitution des consonnes.
S 092. Adverbes de temps renfermant le thème interrogatif.
On vient de voir que l’adverbe hy-as «hier» peut s’expliquer comme venant du thème interrogatif ki (altéré en hi) et de as, débris du mot divas «jour». L’adverbe svas, qui veut dire «demain», a conservé le mot divas sous une forme plus complète, si nous avons raison de le décomposer en s-vas. On sait que tient d’ordinaire la place de la gutturale ténue (§ ai1); s-vas est donc pour k-vas. La ténue s’est conservée dans le latin crûs (S 20 ). Nous pouvons regarder le s initial de svas comme le reste du thème ka, U ou ku, avec suppression de la voyelle et changement dii sens interrogatif en sens démonstratif. Le mot svas signifiera par conséquent «ce jour-là» (le pronom marquant ici la direction en avant); vas, pour divas, sera un accusatif neutre, comme dyus dans les adverbes pûrvê-dyus «hier» (littéralement «le jour d’avant»), parê-dyus «demain» (littéralement «le jour d’après»)385 386. \
On pourrait aussi décomposer svas en sv-as et reconnaître dans la première partie le thème ku (§ 389), avec le change-
PRONOM INTERROGATIF. » 3‘J:2. 375


ment obligé de Yu en v et l’affaiblissement du k en s1. L’accord qui existe entre le sanscrit svas et le latin crûs prouve que la mutilation de ce mot composé appartient à la période la plus ancienne de notre famille de langues; mais il est singulier qu’il 11e se soit conservé dans aucun autre idiome européen, tandis (jue pour l’expression « hier » il y a concordance évidente entre le sanscrit, le grec, le latin et les idiomes germaniques.
Pour montrer combien les adverbes de temps sont sujets à se contracter, par suite de leur fréquent emploi, au point que les éléments dont ils sont composés deviennent presque méconnaissables, je mentionnerai encore ici l’adverbe parut «dans la dernière année », littéralement «dans l’autre année». On reconnaît aisément para comme premier membre du composé ; il reste ut, qui désigne «l’année», et qui est une contraction pour val, lequel est lui-même pour vatsâ. Pott387 388 en rapproche, non sans raison, le grec vsépvat, dont le <7, s’il n’est pas une altération pour un t, représente le s de vatsd; l’albanais ut-vjej «cette année »389 a, au contraire, perdu la sifflante et conservé le t.
La désignation de l’année est plus difficile à distinguer dans le sanscrit parâri. Je crois que cette expression adverbiale, qui signifie «dans l’antépénultième année», est pour para-ari ou para-âri; l’année se dit en zend yârë ( thème yâr), et je suppose que c’est ce terme, privé de son y initial, qui est renfermé dans parâri (pour para-yâri); IV final est le signe du locatif. Ce mot, après tout, ne présente pas une contraction plus forte que le vieux haut-allemand hiu-ru « dans cette année » \ pour hiu-jâru (§§ 391 et 396).

376
PRONOMS.
S 3g3. Dérivés du thème M, en zend et en latin.
En zend, le thème Ici a donné le neutre cid, qui n’est pas autre chose que ki-d, dont le k s’est affaibli en c (§ 390). Nous avons, en outre, kaya, qui est un nominatif pluriel masculin, avec gouna de l’t radical *.
En latin, le thème ki a donné l’adverbe qui-a, qui est un ancien pluriel neutre2. Nous avons, en outre, le pluriel masculin quês (archaïque)3, le génitif pluriel qui-um11 et enfin l’adverbe qui, au moins là où il exprime la relation de l’ablatif5.
Nous allons montrer (§ 39à) que le pronom latin hic suit partout l’analogie de qui, avec lequel il est étroitement apparenté. Mais il ne faudrait pas appliquer à l’adverbe hî-c «ici» ce que nous venons de dire de l’adverbe qui. Tandis que quî est un ancien ablatif, hî-c est un locatif quant au sens et un datif quant à la forme®. Hî-c est pour hoi-c, comme illî, istî sont pour illoi, istoi (§ 177)» et illî-c, istî-c pour illoi-c, istoi-c.
Dans les nominatifs iïli-c, isti-c, le second i est probablement un affaiblissement pour un ancien 0, u ou e = sanscrit a.
1 Comparez tes nominatifs zends comme yâtav-a, venant de yâtu (S a3a). Toutefois, j’ai conçu quelques doutes sur l’explication de kaya, depuis que j’ai vu dans les Védas le génitif kdyasya d’un thème interrogatif kàya (Rig-véda, I, 37, 8). — On rencontre encore dans les manuscrits zends une forme kya, qui est peut-être un pluriel neutre sans gouna. Il serait formé comme les neutres grecs tpl-a, ISpi-a, les neutres latins tri-a, mari-a, et les neutres gothiques thrij-a «trois» (par euphonie pour thri-a), ij-a «ils» (venant du thème » «il»). Mais ce qui me rend la forme zende kya suspecte, c’est qu’on s’attendrait à avoir nujy kya (S Irj).
4 Max Schmidt, Depronomine grœco et latino, p. 36.
3 Voyez S 228 b. La forme correspondante, en sanscrit, serait kayas.
4 Plaute, Trinvmmus, II, 4, i33.
5 Ou de l’instrumental, ce qui revient au même, puisque l’ablatif, en latin, cumule toujours les fonctions de l’instrumental.
4 Le datif et le locatif, en latin, sont souvent confondus: ainsi les adverbes de lieu i-bi, u-bi ont la désinence du datif (comparez ti-bi = sanscrit tü-Vyam «à toi»).

y


PRONOM INTERROGATIF. § 394.
377
S 3 (j 4. Dérivés du thème ki, en latin : le pronom hic. — Changement du sens interrogatif en sens démonstratif.

Le pronom hic est, par son origine, identique avec quis, qui : on n’en saurait douter, quand on voit qu’il participe à la déclinaison mixte de quis, qui1, et que toutes les particularités et anomalies de l’un se retrouvent chez l’autre. Nous citerons seulement le féminin hæ-c, ainsi que le pluriel neutre de même forme (S 387). Il est vrai qu’il n’y a pas, à côté de hæ-c, une forme féminine secondaire hâ-c, pour faire le pendant de aliqua, siqua, etc. mais cela vient de ce que hœc n’est pas employé comme dernier membre d’un mot composé. En effet, 1 amincissement de quœ en quâ résulte de la surcharge produite par la composition; si quis, ne quis, quoique dans 1 écriture on les puisse détacher l’un de l’autre et que dans le discours on les sépare quelquefois par un mot, n’en forment pas moins, quand ils sont l’un près de l’autre, un véritable composé analogue au sanscrit makis, ndkis (8 390) et au zend ^(u'macis, ae'PXH naiéis.
La substitution de l’aspirée à la ténue, dans hi-c, est contraire aux lois phoniques ordinaires du latin390 391. Mais on peut croire que le c qui est venu s’ajouter à la fin du pronom n’est pas étranger à cette modification, si l’on considère que ci-s et ci-tra ont conservé leur c initial, quoiqu’ils aient également le sens démonstratif et soient dérivés aussi du thème ki392. On con-

378

çoit sans peine que cic, cœc, coc aient paru désagréables à l’oreille ; c’est pour une raison analogue que le sanscrit, au lieu de redoubler les gutturales, met des palatales dans la syllabe réduplicative. Nous avons, par exemple, cakara «il fit» au lieu de kakâra; gahi «tue» au lieu de kaki (racine han).
Le c final de lii-c est un reste de la syllabe ce, qui se trouve, par conséquent, combinée avec elle-même dans hicce; cette syllabe ce, qui devient pe dans quip-pe (pour quidr-pe), est une autre forme de que, dont elle ne diffère que par l’absence de la lettre purement euphonique v. Or, les syllabes que, pe, quam, piatn, quoiqu’elles soient elles-mêmes d’origine interrogative, ont pour propriété de dépouiller de sa valeur interrogative le pronom quis auquel elles viennent se joindre; il en est de même pour le c de hic, lequel devrait se trouver à tous les cas de ce pronom et s’y trouvait peut-être à l’origine. Au neutre hoc, le signe casuel a été sacrifié, évidemment parce que hode était d’une prononciation trop dure.
§ 395. Dérivés du thème interrogatif, en gothique. — L’enclitique uh.
De même que le c de hic, hœc, hoc, la syllabe enclitique uh a pour effet, en gothique, de supprimer le sens interrogatif du pronom auquel elle est jointe. Cette syllabe uh, par son origine, est identique au c de hic ou au que de quisque1. Hvasuh (par euphonie pour hvasuh> §86,5) signifie exactement la même chose que quisque, et uh placé après un verbe a le sens de la conjonction «et»; exemples : gangith quithiduh «ite diciteque» (Marc, XVI, 7), jah bigêtun ina quêthunuh «et invenerunt eum dixe-runtque» (Jean, VI, 95). 11 est probable que la force copula-êos et de Sà8i. On sait d’ailleurs qu’un ancien ï bref final est presque toujours supprimé en latin.
1 Voyez Grimm, Graminaire.allemande, 111, p. a3, où l’identité de uh et du latin que est expliquée pour la première fois.
PRONOM INTERROGATIF. S 395.

379

tivc de jah «et» réside principalement dans l’enclitique uh (mutilée en h), et que le thème relatif qui précède est employé simplement comme soutien de cette particule; c’est ainsi qu’en sanscrit la particule va sou» (comparez le latin ve), qui doit toujours être placée après un mot, se fait précéder, quand elle doit commencer un membre de phrase, de tff^yddi «si» ou de dta « alors », lesquels perdent alors leur signification propre ; le même fait a lieu en latin pour sive. Quant à la mutilation de uh en h, elle est de règle après les mots monosyllabiques terminés par une voyelle; exemples : hvô-h squæque», sva-h « ainsi », ni-li « ni » b Ces trois mots ont identiquement le même sens et la même formation que les mots latins hœ-c, st-c, ne-c. Le gothique n’a d’ailleurs plus conscience de la présence de la particule uh dans ces expressions ; les éléments qui les composent appartiennent à une époque trop ancienne et ils se sont trop amalgamés pour présenter encore à l’esprit une signification distincte.
Grimm2 explique avec raison uh comme une métathèse pour hu; hu lui-même représente le thème interrogatif hva (§ 388), soit que Vu doive être considéré comme la vocalisation du v, soit qu’il y faille voir un affaiblissement de l’a. Mais on peut aussi arriver directement du thème primitif ka au gothique uh, sans passer par l’intermédiaire spécialement germanique hva; en effet, le thème ka a fourni une enclitique signifiant set», que nous trouvons sous la forme ca3 en sanscrit et en zend4, sous la forme que en latin. Aucune de ces langues n’a gardé la conscience de la parenté de cette particule avec le thème interroga-
1 11 faudrait excepter nauh «encore» et thauh «cependant» (S 370), si en effet ces mots doivent être décomposés en na-uh, thû-uh, et non en nau-h, thau-h.
* Grammaire allemande, lit, p. 33.
3 Voyez S 370. Au sujet de 6 pour h, comparez S îù.
4 La même enclitique se trouve en ancien perse, sous la forme cd, avec l’allongement obligé de l’a final.

380
PRONOMS.
lif. Nous pouvons supposer que la même enclitique s’est conservée aussi en gothique, sous la forme hu, devenue plus tard uli.

S 396. Dérivés du thème Ici daus les langues germaniques.
Gomme représentant du thème interrogatif sanscrit hi, lequel en latin devient qui, hi et ci, nous trouvons en gothique le thème démonstratif hi; mais ainsi que le latin ci, dont il diffère seulement par la substitution obligée de 1 aspirée a la ténue, il n a laissé que peu de rejetons. Ce sont le datif himma et 1 accusatif hina, ainsi que l’accusatif neutre adverbial hita. Toutes ces formes ne se sont conservées que dans des expressions servant à désigner le temps : himma et hita veulent dire «maintenant», himma daga «en ce jour, aujourdhui», hina dag «ce jour». Nous avons, en outre, comme dérivés de hi, les adverbes hi-dre «ici» (avec mouvement), hêr «ici» (sans mouvement)1, et hir renfermé dans le composé hir-i «viens ici» (duel hir-jats, pluriel hir-jith)2.
C’est à l’accusatif gothique hina que se rapporte l’allemand moderne hin, qui tient la place d’une préposition dans les composés comme hingehen «adiré», mais dont le sens primitif est « [ad] hune » ou « [ad] ilium [locum] ». Au lieu du datif gothique himma, le vieux haut-allemand emploie l’instrumental hiu (§160),
' Vê, dans hêr, est irrégulier; en ce qui concerne le )• de hé et de hir, compare/ thar et hvar (S B91).
2 J’ai cru autrefois reconnaître la racine sanscrite i «aller» dans ce verbe, dont il n’est pas resté, en gothique, d’autres formes, et qui paraît seulement, comme on vient de le voir, aux trois nombres de la seconde personne de l’impératif, en composition avec l’adverbe hir. Mais je crois aujourd’hui qu’il vaut mieux l’identifier avec la racine sanscrite tjt yd, qui veut dire également «aller». C’est au duel hir-ja-ts «venez tous deux ici » qu’elle paraît le plus clairement : l’d sanscrit a été abrégé en a (S 6g, 1)1 sans quoi nous aurions hir-jô-ts ou hir-jê-ts (S 69, 2 ). Au pluriel hir-ji-th, las est affaibli, comme d’ordinaire, en t devant un th final. Au singulier, je regarde Vi de hir-i comme une contraction pour ja; comparez l’accusatif han «exercitum» du thème harja.
PRONOM INTERROGATIF. § 397.

381

qui s’est conservé dans hiu-tu «aujourd’hui» (pour hiu-tagu) et dans le moyen haut-allemand hiure1 « cette année » ( pour hiu-jâru)393 394; ce sont, en allemand moderne, heute et heuer (§391). Nous trouvons enfin, en composition avec naht «nuit», le vieux haut-allemand hînaht «cette nuit» (moyen haut-allemand Mnaht et hînte, allemand moderne heunt395 396). Je regarde avec Grimm hi comme le reste d’un accusatif féminin hia, la suppression de l’a ayant amené, par compensation, l’allongement de l’t.
Il faut donc admettre qu’au féminin le thème hi s’est élargi en hia. Nous voyons de même, en gothique, le thème i (§ 363) faire à l’accusatif féminin ija (par euphonie pour ia). Quant au nominatif, il a dû être hiu (comparez siu, dont l’accusatif est sia)'-1. En anglo-saxon et en ancien frison nous observons un élargissement analogue du thème hi, qui signifie «il» dans ces langues. Ainsi, en ancien frison, le nominatif féminin est hiu « ea », l’accusatif hia « eam » ; en anglo-saxon, les formes correspondantes sont hëo et hi (pour hia).
â 397. Le thème Ici, en arménien.
Je crois pouvoir rapporter aussi au thème interrogatif sanscrit hi le thème arménien i «qui?»397 : je suppose que la gutturale initiale a été supprimée, comme cela est arrivé, par exemple, pour le latin u-bi, mde, uter398, pour l’allemand wer (S 388) et pour l’arménien uAuuun. antar, thème antara «forêt» (en sans-
;> m PRONOMS. j


|
cii, kântàra). Le thème /» i est d’une haute importance pour l’étude de la déclinaison arménienne; en effet, comme il est j monosyllabique, il a dû garder sa voyelle *. Le génitif est kc ê-r, \ avec gouna de l’t (§ i83", 4). Peut-être, en arménien, dans la déclinaison des pronoms démonstratifs et interrogatifs, le r final du génitif singulier tient-il la place d’un ancien s-2. On pourrait alors rapprocher les génitifs sanscrits comme dvê-s « de la brebis »
(dvê-r devant une lettre sonore). L’ablatif du thème interrogatif en question a perdu, en outre, la voyelle qui suivait la gutturale initiale : il fait mê, et, avec la préposition i qui précède les ablatifs, imê(S i83% 4). L’instrumental fait régulièrement i-v.
Dans l’indéclinable neutre /&£ inc « quoi?» 3 je reconnais une forme mutilée pour le sanscrit kîn-cit, par euphonie
pour kim-cit. Il y a cette différence qu’en sanscrit la particule enclitique cit retire au mot km « quoi ?» sa force interrogative, pour ne laisser au composé klncit que le sen6 de «aliquid», au lieu qu’en arménien la vertu interrogative subsiste. Du reste, l’enclitique cit, malgré sa désinence casuelle neutre (comparez le latin qui-d), est considérée en sanscrit comme indéclinable : on la joint au masculin et au féminin comme au neutre (kds-cit, kâ-cit), et non-seulement au nominatif, mais à tous les cas. 399 400 401
PRONOM INTERROGATIF, s 398.

383

S 3q8. Le thème interrogatif ka, en arménien.
H est extrêmement probable que n o «qui » a également perdu une gutturale initiale, et qu’il est pour une ancienne forme ko1. La déclinaison de ce pronom s’est conservée en entier, à l’exception de l’instrumental singulier et pluriel. Toutefois, la plupart des cas ont pour thème nu u ou nj ui : de nu u viennent le datif u-m, l’ablatif u-mê (avec la préposition, li-u-mê) ou, avec deux m, u-mmê402 403 ; de nj ni viennent le génitif ui-r et le pluriel tout entier : nominatif ui-q, accusatif s-ui-s, ablatif-génitif ui-i. Mais d’où provient le thème nj ui? Je crois pouvoir le rapporter au thème védique kâya, qui ne nous a été conservé qu’au génitif kdya-sya, mais qui a dû avoir à l’origine sa déclinaison complète404 405. Je ne pense pas que pour le thème u (venant de ku ou qu) il faille recourir en sanscrit au thème secondaire ku (§ 389); l’ua pu sortir d’un ancien a, comme dans warasu «sanglier» = sanscrit varâhalt. Au lieu d’un u, nous trouvons un 0 au nominatif singulier et à l’accusatif [n 0, yn s-o), ce qui fait rentrer en quelque sorte ces deux cas dans la troisième déclinaison de Petermann (mard «homme», du thème mardo), avec cette seule différence que le thème interrogatif, étant monosyllabique, ne peut supprimer sa voyelle finale.
11 est difficile de dire quelque chose de plausible sur le tjjw des formes secondaires n^ ow, yn>\_ §-ow, qu’on trouve à côté
PRONOMS.

.Wi

de o, s-o. Ce w ne peut être regardé comme faisant partie du thème, puisqu’on ne le rencontre à aucun autre cas. Si c’est un signe de nominatif, il faudrait rapprocher ce signe, unique en son genre, de la désinence du nominatif en zend.' On sait, en effet, que les thèmes zends en a se terminent au nominatif en ^ ô, lequel équivaut à au (§ 56b).
S 399. Enclitiques dérivées du thème interrogatif. —
Les enclitiques cit, ca, c'ana.
On a vu plus haut (§ 390) que les composés sanscrits *Hfdu^ makis, ndkis deviennent en zend macis,
naicis; ce changement du k en c tient probablement a ce que le c, étant une lettre plus molle et plus faible que .e k, convient mieux aux formes composées, déjà assez pesantes par elles-mêmes. La particule enclitique sanscrite cit (au lieu de kit, §390) s’explique de la même façon : elle est d’un usage plus étendu en zend qu’en sanscrit, et se trouve entre autres après le mot J)»?») katara «uter», en sorte que nous avons un nominatif masculin katarascid qui correspond, pour
le sens comme pour la formation, au latin uterque (pour cuterque) et au gothique hvatharuh. En sanscrit, comme en zend, cit retire sa valeur interrogative à l’expression qui précède; nous avons, par exemple, kdscit «quelqu’un», küdaéit «à quelque époque», katdncit «de quelque façon», kvacit «quelque part», qu’on peut comparer avec ka-s «qui'?», kadâ «quand?», katam «comment?», kvà «où?».
De même que le thème ci est sorti de ki, l’enclitique ^ ca, qui signifie « et, mais, cependant », est sortie du thème principal ka; il y a donc altération plus forte pour le sanscrit ca comparé à ka que pour le latin que comparé au thème quô. Le ca sanscrit, en se combinant avec na, forme encore une autre enclitique : cana; cette dernière particule s’emploie ordinairement,
PRONOM INTERROGATIF. % 400. 385


sinon toujours, dans les phrases négatives, comme la particule hun en gothique : na kâscand signifie «nullus», na kaddcand «nunquam», na katdncand «nullo modo». On peut donc considérer l’annexe na comme étant elle-même une négation et comme servant à renforcer la négation non enclitique. Ce même cand nous fournit une explication satisfaisante pour le gothique km : en effet, ’à moins que l’u de hun ne soit la vocalisation du v de lwa-s, il ne peut venir que dun ancien a; le changement de l’a en u peut s’expliquer soit par 1 influence de la liquide qui suit, soit par la nécessité d’alléger le poids de la voyelle, à cause de la surcharge produite par la présence de l’enclitique.
S Aoo. Dérivés du thème interrogatif ki, en vieux norrois. — Changement du sens positif en sens négatif.
Les expressions qui s’emploient d’ordinaire dans les phrases négatives-finissent par se ressentir de ce voisinage, de sorte qu’elles deviennent elles-mêmes des négations, même en 1 absence de la négation véritable. C’est ainsi que le mot français rien, même employé seul, signifie «nihil», et que le mot allemand kein, qui est pour le vieux haut-allemand nih-ein «nul-lus », exprime aujourd’hui une négation, quoiqu’il ait perdu précisément son élément négatif. On peut donc supposer qu en vieux norrois les expressions qui ont un ki ou un gi enclitique406 étaient primitivement précédées d’une particule négative; mais dans la langue telle qu’elle est venue jusqu’à nous, l’enclitique en question est négative par elle-même. On a, par exemple, cmgi « nullus », einskis «nullius», mangi « nemo », manskis « ne-minis», vaetki «nihil». Je regarde cette particule comme appartenant à l’antique et nombreuse famille du thème interrogatif ki : si nous n’avons pas ici la substitution ordinaire de l’aspirée à la 1 Grimtn, Grammaire allemande, Ilï, p. 33 et suiv.
i.
a 5
PRONOMS.

386
ténue, cela vient sans doute de l’appui que le mot précédent a prêté à l’enclitique, qui a conservé la ténue après s (S 91, 1) et l’a changée en moyenne après les voyelles et après un n.
S 4oi. Le thème interrogatif ki, devenu n en grec. —
Les particules re et xai.
11 reste à mentionner le pronom interrogatif grec ris, rivos et le pronom indéfini ris, rivés. Je ne doute pas que tous deux ne soient de même origine et ne se rapportent aux thèmes ki et ci, lesquels, en sanscrit et en zend, nont pas seulement le sens interrogatif, mais quelquefois aussi le sens indéfini. En grec, l’ancien thème en 1 s’est élargi par l’addition d’un v; en ce qui concerne le r, nv est avec ki, ci et le latin qui dans le meme rapport que rétrtroipss avec catvaras (venant de katvurns) et quatuor, ou que rsévre avec pdnca (venant de panka'j et quinque. Je ne crois pas toutefois que le r grec soit sorti du c, mais je le regarde comme dérivé immédiatement du k primitif : en effet, le c est postérieur à la séparation des idiomes; il n’y en a pas trace dans les langues classiques et il a seulement commencé à se montrer en italien, dans les mots où un c latin (= le k primitif) est suivi d’un e ou d’un i. Le changement de k en r n’est pas plus difficile à admettre que le changement de k en rs, que nous trouvons dans rsa au lieu de xo, dans rséjXTis au lieu de ■ortfyxe. L’altération du k en c, en sanscrit et en zend, nous aide à comprendre ce qui s’est passé en grec, puisque l’élément fondamental du c (prononcez te/*) est un t.
Si ris est sorti de xls et s’il est parent avec le latin quis et le sanscrit kis et ci-t, il faut admettre aussi la parenté de la particule ts avec que et avec le v? c’a correspondant (§ 399); la forme primitive de re était donc xe *. 406
PRONOM INTERROGATIF. S 402.

387
•« si »

Le grec xat se rapporte à la particule sanscrite (= ca + it) ’, ou plutôt à la forme primitive kait. La suppression du t final était obligée (S 86, 2406’). A l’égard du sens, il faut remarquer que la première partie de cêl, à savoir ca, a pour signification ordinaire «et»; or, nous voyons que le composé nêt (= na + it), qui veut dire en sanscrit « si ... ne ... pas », a uniquement en zend (où il se trouve sous la forme nôid) le sens de «ne ... pas», et que la forme correspondante «ei2, en lithuanien, a également sacrifié la signification du dernier membre du composé. Ces deux rapprochements nous aident à comprendre comment, des deux éléments renfermés dans Hat, le premier est seul resté significatif.
S 4o9.. De l’accentuation du pronom tis en grec.
La différence d’accentuation qui existe entre l’interrogatif ti's, rtvos et l’indéfini rts, rivés, vient, selon moi, de ce que l’interrogation exige une intonation plus énergique; or, elle l’est d’autant plus quelle est plus près du commencement du mot3. Tandis que rts interrogatif est accentué à tous les cas sur la syllabe initiale, rts indéfini laisse tomber l’accent sur la dési-' nence, non-seulement aux cas faibles, comme cela est de règle (S 13a, î), mais à toutes les formes polysyllabiques. C’est d’après le même principe que les indéfinis notés, moo-és se distinguent des interrogatifs motos, méaos", de même encore moré «une fois» et «réTe « quand ? ».
donc écartée. ( Voyez mon mémoire De l’influence des pronoms sur la formation des mots, p. 6,)
,406 Voyez S 36o.
'* Voyez S 371.
. 3 Voyez Système comparatif d’accentuation, S 36.
a5.

388
PRONOMS.
S 4o3. Dérivés du thème interrogatif, en ancien slave et en lithuanien. — Les enclitiques se et gi.

Mentionnons encore la particule enclitique ate se « mais » en ancien slave. Cette particule a le pouvoir de rendre au pronom h i « il » son ancienne signification relative (§ 282) : en effet, iiîke 1 -se signifie «qui». Peut-être se est-il identique avec le sanscrit ^ ca «et, mais, cependant» et avec le latin que; dans ce cas, se appartiendrait à la famille du thème interrogatif et aurait laissé s’affaiblir la ténue en moyenne, comme cela est arrivé pour le grec yap (S 391 ) ; à son tour, le g se serait changé en s, comme cela a lieu, par exemple, au vocatif singulier des thèmes en 0, tels que bogo «dieu», vocatif bose. Peut-être aussi la particule slave en question répond-elle à la particule sanscrite cil (venant de kit, § 390), qui a pour effet de retirer au pronom ka et à ses dérivés leur force interrogative (§ 397). Mais dans cette seconde hypothèse, comme dans la première, il faut admettre, avant d’arriver à la lettre:s, un amollissement de la ténue gutturale primitive en moyenne gutturale.
Cette moyenne s’est peut-être conservée dans l’enclitique lithuanienne gi, qu’on trouve après les expressions interrogatives et après les impératifs; exemples : kas-gi «qui donc?», féminin ka-gi; kam-gi (datif masculin) «pourquoi donc?», kame-gi (locatif) «où donc?», kur-gi (même sens), dük-gi «donne donc»407. De ces exemples on n’a pas le droit de conclure que le sens propre de gi soit «donc». Il est vrai cependant qu’on pourrait rapprocher gi de la particule sanscrite hi «donc» (S 391) et rapporter aussi à la même origine le slave *e se, dont l’e serait une altération pour un i primitif (§ 277).

PRONOMS POSSESSIFS. § UOU.
389
ADJECTIFS PRONOMINAUX DÉRIVÉS.

PRONOMS POSSESSIFS.
§ àok. Pronoms possessifs en ka, en sanscrit et en zend.
Des génitifs marna «de moi», tdva «de loi» dérivent, à i'aide du suffixe ka et avec allongement de la première voyelle, les pronoms sanscrits mâmakâ «meus», tâvakâ «tuus». D’un autre côté, au pluriel, nous avons les possessifs védiques asmaka «noster», yusmaka «vester », qui, comme nous l’avons déjà vu1, ont donné les génitifs pluriels asmakam «de nous», yusmàkam « de vous ». Peut-être, ainsi que le suppose Fr. Rosen, ces formes sont-elles dérivées des ablatifs asmât «nobis», yusmdt «vobis» avec suppréssion du t final et allongement, par compensation, de la voyelle qui précède. Il faut rappeler, à ce sujet, que le t du nominatif-accusatif singulier neutre des pronoms de la troisième personne, et de l’ablatif singulier et pluriel des pronoms de la première et de la deuxième personne, est traité par la langue comme s’il faisait partie du thème; ainsi, au commencement des composés, où l’on a d’ordinaire le thème à l’état nu, nous trouvons les ablatifs asmàt, yusmdt (% 11 2), et plusieurs mots dérivés ont pris pour point de départ ces mêmes formes, soit en conservant la dentale (§ 4o5), soit en la remplaçant par l’allongement de la voyelle précédente.
Au védique asmàka «noster» se rapporte le zend ahmâka, dont il reste l’instrumental pluriel ahmâkâis. Je ne connais pas d’exemple, en zend, du possessif de la première personne du singulier, ni de celui de la deuxième personne des trois nombres. En zend comme en sanscrit, on remplace d’ordinaire les pronoms possessifs par le génitif des pronoms personnels.
1 Voyez ci-dessus, pp. 375 et 287.

390
S ho5. Pronoms possessifs en îya, en sanscrit. — Le grec ïhos. — Les pronoms tsoïos, rofos, otos.

D’autres possessifs sont formés, en sanscrit, à l’aide du suffixe'fa îya : nous le voyons s’ajouter à l’ablatif singulier et pluriel des pronoms des deux premières personnes, au neutre tat de la troisième, ainsi qu’au thème sarva « tout ». L’a final de ce dernier est supprimé ; le t final des autres pronoms se change end. On a, par exemple : madïya «mon», tvadiya «ton», asma-diya «notre», yusmadîya «votre», tadîya «son», venant de mat, tvat, asmât, yusmdt, tat1.
Je crois reconnaître une formation analogue dans le grec i'Stos : en ce qui concerne la racine de ce mot, on peut admettre l’opinion de Hartung408 409, qui y voit le démonstratif i; la syllabe iS pourra être rapprochée alors de la syllabe il renfermée dans et cêt, ainsi que du pronom latin id. Mais je crois plutôt que ïSios est pour ïStos et appartient au pronom réfléchi (S 364); à l’égard du sens, il faut remarquer que le pronom sanscrit sva «suus» signifie aussi «proprius» et peut être employé pour la première et la seconde personne aussi bien que pour la troisième. 11 est vrai que nous n’avons pas conservé, pour le pronom sva, la déclinaison complète; il ne nous en reste que svaydm «ipse» et le prâcrit % sê (pour svê) «sui» (§ 34i). Mais tout porte à supposer que sva avait à l’origine sa déclinaison complète,' analogue à celle des pronoms des deux premières personnes; l’ablatif, qui serait VS^svat,a pu donner svadîya «suus» comme mal et tvat ont donné madïya «meus» et tvadiya «tuus». C’est cette forme svadîya que nous rapprochons
PRONOMS POSSESSIFS. S 406.

391

du grec tStos, pour tStoe, venant lui-même de aFtSios; nous avons de même iSpcôe «sueur», venant de crFiSpûs, en regard du sanscrit % svê'da «sueur» et de l’allemand schweiss.
A l’égard de la forme, sinon du sens, il y a aussi accord entre les possessifs sanscrits en 'fa îya et les pronoms corrélatifs ssoios, toios , oïos, qui ont peut-être perdu un S devant leur t ; tdîo-s, si l’on restitue cette lettre, correspond assez bien à tadiya-s, lequel a quelquefois une signification purement démonstrative.
S 4o6. Formation des pronoms possessifs en ancien slave, en lithuanien, en latin et en grec.
Les possessifs slaves se rapportent aux possessifs sanscrits en îya; mais ils n’ont pas l’î410 et ils ne conservent pas, avant le suffixe, le signe casuel d. Le sanscrit y a devait devenir en slave/o(§ 257), et jo devait s’altérer en k je ou en e (§ 92 k). C’est la forme je qui est la plus fréquente, et comme les possessifs slaves suivent la déclinaison pronominale, il y a identité entre la déclinaison de leur suffixe, aux trois genres, et celle du thème pronominal jo, féminin ja (S 382). La seule différence qu’il y ait se trouve au nominatif-accusatif masculin, où le pronom contracte la syllabe jo en i; au contraire. les thèmes possessifs laissent leur y (ii) invariable, ce qui serait impossible avec le thème monosyllabique jo. Exemple : avoh mo-j «meus, meum» en regard de h i. Pour tous les autres cas, il y a accord : comparez, par exemple, le génitif masculin et neutre mo-jego «mei» avec je-go «hujus», le locatif mo-jemï «in me» avec je-mï «in hoc», le datif mo-imu «meo» avec i-mu «huic». Pareillement, les féminins comme mo~ja «mea» suivent l’analogie déjà «hæc»; on a, par exemple, le génitif mokia nio-jejan « meæ » semblable

392

àjejaii «hujus» (féminin). De même quemo-j, mo-ja, mo-je correspondent au sanscrit mad-iya-s, mad-iyâ, mad-îya-m \ de même tvo-j, tvo-ja, tvo-je correspondent à tmd-î'ya-s, tvad-iyâ, tvad-iya-m. Le pronom slave de la troisième personne du singulier svo-j, sva-ja, svo-je suppose, comme le grec ïSioe (s’il est pour ’iSios), une forme sanscrite svadîya.
On voit que les possessifs slaves sont un héritage de la plus ancienne période de la langue, et qu’ils sont, en quelque sorte, la continuation des possessifs sanscrits. En effet, si la langue slave les avait formés d’une façon indépendante2, nous y devrions trouver les mêmes altérations qu’a subies le thème des pronoms personnels. Les possessifs seraient donc très-probablement, au nominatif masculin, menj ou münj, tebj ou tobj, sebj ou sobj : il n’y a pas un seul cas des pronoms personnels qui fasse attendre une forme moj, encore moins des formes tvoj, svoj.
Au contraire, en lithuanien, on voit que les possessifs mâna-s, tâwa-s, sâwa-s sont de création nouvelle, car ils sont en accord avec la forme spéciale qu’ont prise les pronoms personnels aux cas obliques (§§ 33o, 341).
En latin, mëus est probablement pour meus, venant de maius : la forme correspondante, en sanscrit, si elle existait, serait maya-s, qui viendrait du thème secondaire % mê (pour mai)3, avec a comme suffixe dérivatif. Tuus (thème tuô, venant de tvô) et suus (thème suô, venant de svë) sont identiques avec les thèmes sanscrits tva et sva, qui sont à la fois personnels et possessifs (§§ 326 et 341)4.
1 Sauf ce point que tes possessifs sanscrits suivent la déclinaison ordinaire : s’ils suivaient la déclinaison pronominale, nous aurions, par exemple, au datif masculin-neutre, mad-îyaimâi(comparez ydsmâi ttà quia) en regard du slave mo-jemu. a C’est-à-dire si elle les avait tirés de ses pronoms personnels. — Tr.
3 Voyez S 3a6.
4 C’est seulement dans les Védas que tva est employé comme pronom possessif. Comparez Abrégé de la grammaire sanscrite, 3” édition, S a64.
PRONOMS POSSESSIFS. S 407.

393

En grec, êfiis, ar6s, 6s ont ie même thème que éfxov, éftot, croü, aoi, oS, oï; de son côté, le possessif a-Cpôs, a<pn, afyàv est l’image exacte du sanscrit sva-s, svâ, sva-m. Dès le plus ancien temps de la langue, nous avons ici un exemple d’un pronom possessif dépourvu de tout suffixe destiné à exprimer la possession : car sva, par sa forme, est un pronom personnel; ainsi qu’on l’a déjà fait remarquer, il est le thème de svaydm «ipse» (S 34i).
Au pluriel et au duel, le grec et le latin se distinguent du reste de la famille par cette particularité qu’ils forment leurs possessifs à l’aide du suffixe comparatif : la langue oppose la personne ou les personnes qui possèdent à celles qui ne possèdent pas, et elle crée de la sorte un dualisme que le suffixé comparatif, quand il est ajouté aux pronoms, a pour fonction d’exprimer.
§ £07. Formation des pronoms possessifs du pluriel, en lithuanien et en ancien slave. — Pronom possessif formé du thème interrogatif, en ancien slave et en latin.
Les possessifs du pluriel, en lithuanien, sont musiskis «notre», jusiékis «votre». Le thème de ces possessifs se termine en kia (S 135) et il rappelle les possessifs. sanscrits comme asmaka, yusmâka. La syllabe si, dans mvrsi-skis, ju-si-ékis, n’est certainement pas sans rapport avec ie pronom annexe sma (§ 335); quant à la lettre s qui précédé le k, je la prends pour une prosthèse euphonique, comme dans les adjectifs tels que tvy-riska-s «viril», dëwiska-s «divin» (§ 95a).
L’ancien slave forme, à ce qu’il semble, les possessifs du pluriel Hduik nasï «notre», buuu. vasï «votre» (thème naêjo, msjo) du génitif pluriel du pronom personnel (na-sü, va-sû, § 248); le suffixe est le même que dans les thèmes mojo, tvojo, svojo. En ce qui concerne le .changement de la lettre s de na-sü, va-sü en
PRONOMS.

m

m s, on peut comparer la désinence de la deuxième personne du singulier du présent si, venant de si (§92 ‘).
Le féminin fait au nominatif misa, vasa (pour nasja, vasja, S 92 k) et le neutre nase, vase. A l’exception du nominatif féminin singulier, la déclinaison est celle de sï, si, se (S 358); on a, par conséquent, au génitif masculin-neutre, nasego, va-sego; au féminin, nasejah, vaiejah (§ 271).
Par le suffixe jo = sanscrit ya, le pronom interrogatif, en ancien slave, donne également naissance à un possessif : mhh ci-j, Mina ci-ja, Mine ci-je «cujus, cuja, cujum»411.
H y a identité de sens et parenté, quant au suffixe, entre le mot slave en question et l’adjectif interrogatif latin cu-jus (thème cu-jô, féminin cu-ja), dont la seconde syllabe n’a rien de commun avec la désinence jus du génitif cu-jus «de qui ?» (§ 189).
§ 4o8. Formation des pronoms possessifs, dans les langues germaniques.
Les possessifs germaniques tiennent de la façon la plus intime aux génitifs des pronoms personnels. Le thème est le même pour les uns et pour les autres (S 34o, remarque). Si l’on admet, que les génitifs pluriels unsava, isvara sont, comme les génitifs latins nostri, vestri, nostrum, vestrum, et les génitifs sanscrits asmakam, yusmakam, d’origine possessive, on pourra considérer le r comme un affaiblissement du d sanscrit de asmadîya « notre », yusmadiya «votre»2. Quant aux génitifs duels unkara, inqvara, et aux thèmes possessifs de même forme, dont le nominatif singulier masculin est unkar, inqvar, on a montré précédemment
PRONOMS CORRÉLATIFS. S 409.

395

(§ 169) qu’ils ne sont pas autre chose au fond qu’une variété du pluriel; leur r n’a donc pas besoin d’une explication spéciale.
Si l’on suppose que les génitifs singuliers meina, theina, seina sont également sortis des thèmes possessifs de même forme, il faudra admettre que ces derniers ont changé en n le d de madi'ya, tvndïya; il y a, en effet, des exemples assez nombreux de permutations entre moyennes et nasales du même organe.
L’explication qui vient d’être proposée ne saurait d ailleurs être infirmée en rien par la présence, en allemand moderne, d’un adjectif possessif qui, à une époque encore récente, s est formé du génitif d’un pronom personnel. Nous voulons parler du possessif ihr qui signifie à la fois sejus [feminæ] proprius » et «eorum» ou «earum proprius» : ce possessif inorganique, dont les anciens dialectes n’offrent aucune trace, doit son origine au génitif singulier féminin et au génitif pluriel des trois genres du pronom de la troisième personne1. Mais on conçoit aisément que ce fait ne prouve rien pour les anciens possessifs faisant partie du fonds primitif de la langue : tout ce qu’on est en droit de conclure de cette formation, c’est que les idiomes peuvent être conduits à tirer certains adjectifs possessifs du génitif des pronoms personnels.
PRONOMS CORRÉLATIFS.
S 409. Les pronoms sanscrits en vant. — Formes correspondantes en latin.
Aux corrélatifs grecs us6-aos, ri-aos, 6-aos correspondent, pour la signification, sinon pour la forme, des pronoms sanscrits
’ L’auteur veut parler du pronom gothique ta, si, ita, qui fait au génitif singulier féminin isos et au génitif pluriel tae, kô, isé. En vieux haut-allemand, le génitif singulier est ira, le génitif pluriel (pour les trois genres) trd. E11 moyen haut-allemand, les deux formes sont devenues ir. — Tr.
PRONOMS.

3%

et zends ayant vaut1 comme suffixe dérivatif. Si le thème primitif est terminé en a, cet a s’allonge devant le suffixe412 413; peut-être le thème n’était-il d’abord autre que le neutre (§ kok) et l’allongement de la voyelle est-il destiné à compenser la suppression de la dentale finale. On a donc : WTW^tavant, nominatif masculin tâvân «tco-os»; avant, nominatif masculin yâvân «oeros».
Le thème interrogatif ha, ou le neutre disparu kat, ferait attendre une forme kâvant, qui serait le prototype du latin quantus, et avec laquelle celui-ci serait dans le même rapport que tantm avec rTFPr^ taxant.
Dans les mots tantus, quantus, comme dans malo (pour mavolo), le latin a supprimé toute une syllabe, mais il a élargi le thème extérieurement, comme fait, par exemple, le pâli, quand des formes participiales en ant il tire des formes en anta 414. En conséquence, tantus est une contraction de tâvantm, qui lui-même est une forme élargie de tâvans. La quantité primitive de l’a de quantus, tantus ne peut être constatée; mais, selon toute apparence, cet a était une longue, .car un ancien a bref se serait probablement changé en ë ou en ô. C’est ce qui est arrivé pour tôt, quot, qui correspondent à îrfïï tâti, ^if?f kati, sur lesquels nous reviendrons plus loin.
8 h îo. Les pronoms sanscrits myant. — Formes correspondantes en zend.
On vient de voir que le corrélatif kâvant, dérivé du thème interrogatif ka, manque en sanscrit : il est remplacé par klyant, dérivé du thème ki. On peut rapprocher de Myant le pronom iyant «autant de», dérivé du thème démonstratif i. Je suppose que klyant et Iyant sont des formes mutilées pour kîvant et îvant,
PRONOMS CORRELATIFS. S Ail.

397

le v ayant été supprimé, ce qui a amené, d’après les lois phoniques ordinaires, le changement de 1’* précédent en iyJ.
Le zend confirme jusqu’à un certain point cette hypothèse : il a conservé, dans la forme interrogative en question, le suffixe plein vont; mais il a supprimé l’i du thème et amolli le k en (u é. Nous avons donc, au nominatif masculin, a»£»(u cvahs, a 1 accusatif cvantëm?, au neutre cvad Au relatif
sanscrit yavant répond, en zend, y avant, dont je n’ai
d’ailleurs rencontré que le neutre yavad et le féminin yavaiti11. Le zend n’a pas, à ce qu’il semble, l’adjectif lavant, qui serait le corrélatif naturel des deux expressions précitées; il le remplace par avavant, dérivé du thème démonstratif ava, et par
pavant, dérivé du thème a. Au lieu de faire au nominatif masculin avarié, d’après l’analogie de cvahs «combien?» et de twitvam «semblable à toi», avant fait pu»» avâo (§ i38).
8 An. Pronoms et adverbes corrélatifs, en lithuanien.
En lithuanien, le suffixe en question vant s’est altéré, à ce qu’il semble, en linta, c’est-à-dire que le v s’est changé en l (§ ao) et que le thème s’est élargi extérieurement par l’addition d’une voyelle (§ Aoq). Ces deux mêmes modifications se retrouvent en latin dans le suffixe lentô de opulentô, virulente (§ 957), 415 416 417 418 419 420
PRONOMS.


où le 1 tient également la place d’un ancien v et où le thème s’est pareillement élargi. Il n’y a d’ailleurs qu’une seule forme lithuanienne de ce genre : c’est kellnta-s1 «le quantième». A cette forme se rattachent les thèmes këleta (nominatif kêlct-s) et kêla «combien?»2. Je reconnais dans le suffixe leta, la, une mutilation pour le sanscrit vaut (forme faible vat). Il faut, selon toute apparence, rapporter également ici l’adverbe kô-l «combien longtemps, combien loin?»3 et le démonstratif të-l «si longtemps, si lom» = sanscrit tà-vat «si longtemps». Je regarde ces adverbes lithuaniens, ainsi que les adverbes sanscrits correspondants, comme des accusatifs neutres; l’a final (comparez géra «bonum», S i53) a'disparu dans kôl, tôl. Les adverbes Im-lei, tô-lei (même sens) supposent des thèmes en lia (§ 92k) ou peut-être simplement en la : ce sont des datifs féminins, comme les adverbes en ai h)-
§ 419. Pronoms corrélatifs -ahaos, -chaos, Ô<ros, en grec.
En prenant pour point de départ de nos comparaisons (§ 4 09) les pronoms corrélatifs -zshaos, -chaos, oaos, nous n’avons pas voulu dire que le suffixe grec ao fût identique avec le suffixe sanscrit vaut. Ce n’est pas que le changement de t en a, non plus que l’élargissement du thème par l’addition d’un 0, me paraissent impossibles; mais comme nous avons en sanscrit des
1 Voyez le Glossaire de Sehloicher. Ruhig écrit kôlinla-s.
! Këla est seulement employé au pluriel : nominatif këli, féminin kêlôt. Kêlets qui, suivant Ruliig, ne s’emploie qu’aveedes noms d’êtres vivants, est construit avec le génitif pluriel ; exemple : kêlets waikü «combien d’enfants», kêlets arkiiü «combien de chevaux». Je ne crois pas qu’il faille rapporter spécialement à la forme faible sanscrite les suffixes lithuaniens dont il est question, car je tiens la distinction en (ormes fortes et faibles pour postérieure à la séparation des idiomes.
3 II a aussi le sens relatif «si long que, jusqu’à ce que». (Voyez le Dictionnaire de Nesselmaiin, p. aoà.) C’est ainsi que nous avons en sanscrit, la forme adverbiale ijS-vat «combien loin, combien longtemps» à côté de la forme adjective yiï-vant. neutre yiï-val «combien».
PRONOMS CORRELATIFS. S 413.

399

voyelles longues (yâvat, tavat), il serait étonnant que la longue ne se fût pas conservée en grec : ajoutons encore que la suppression des premières lettres de la syllabe vaut ne pouvait guère avoir lieu sans compensation dans la syllabe précédente. Une forme toxtos pourrait donc être regardée comme identique avec le sanscrit tavant, mais non pas la forme 16<ros.
Je suppose que la syllabe cros nous représente l’ancien thème sva « suus » : nous avons en zend des mots comme iriéva
«tiers», catrusva «quart», qui sont analogues, pour
le sens comme pour la formation, au grec èuos, macros. En effet, le pronom sva-s qui, employé comme mot indépendant, a donné en grec &s et <r(p6s, ne pouvait guère devenir en composition que cros. Si donc l’on rapproche m6-aos des mots zends précités, le sens propre de ce composé sera «quelle partie?», ou, en le prenant comme un composé possessif, «ayant quelle partie?». De là au sens de «combien?» la distance n’est pas très-grande1.
S 4i3. Les pronoms corrélatifs -rijftos, rjpos; les adverbes récas, êus.
On a vu plus haut (§ 35a) qu’on peut rapprocher des adjectifs sanscrits tavant, y avant les mots grecs râpos, ijf/zos. Nous avons, de plus, en sanscrit, les adverbes tavat, yâvat2 que je crois également retrouver en grec. Tavat a, entre autres significations, celles de «maintenant, en ce temps»; yâvat celles de «combien longtemps, pendant, combien souvent, jusque, que». La première signification de yâvat se trouve, par exemple, dans ce vers3 :
' Rapprochez aussi l’adjectif toos, dont le sens primitif a dû être «si grand» et, par suite, «égal». Je l’ai fait venir autrefois du thème démonstratif i; mais comme il a le digamma, je préfère aujourd’hui le rapporter au thème réfléchi svi (S 364 ). Comparez Pott, Recherches étymologiques, ire édition, I, p. 272.
s Ce sont d’anciens accusatifs neutres de tiïvant, ytfvant.
3 Nala, chant V, vers 33.
PRONOMS.

400

yâvacca mê dariéyanti prânâ dêhê sucismitê tâvat tvayi Bavisyâmi satyam êtad bravîmi tê.
Quarn diuque mei constabunt spirilus in corpore, sereno «risu prædita! tam diu tecum ero; veritatem hanc dico libi. «
Il arrive souvent qu’un seul et même mot se scinde en plusieurs formes différentes, dont chacune représente l’une des significations qui étaient réunies dans la forme primitive. On peut donc admettre que tsus et 'dus soient identiques avec tâvat et yàvat, le digamma qui, dans TJ/ftos, fytos, s’est durci en m, étant tombé ici comme d’habitude, et la quantité des deux voyelles ayant été intervertie : sus pour fi(F)os, téus pour tv(F)os. Peut-être aussi que la première syllabe s’est abrégée sous l’influence de la voyelle suivante, et que cet affaiblissement, joint à la perte du digamma, a été compensé par l’allongement de la seconde syllabe. Il ne serait pas impossible enfin que les adverbes ordinaires en as1 eussent influé par leur exemple sur Sus, rêus. On a, d’ailleurs, à côté de téus, tsius, dus, sius les formes tsîos, eîos.
S k\U. Les pronoms corrélatifs lcâti, tati, yàti, en sanscrit, et quot, tôt, en latin.
Des thèmes pronominaux ha, ta et ya, le sanscrit dérive, à l’aide du suffixe fTT ii, les expressions kdti «combien?», tdti «tant» et ydti (relatif) «autant», Kdti et taii rappellent aussitôt les formes latines quot et tôt, qui ont perdu leur i final, comme l’ont perdu aussi les désinences personnelles dès verbes. Mais la forme complète s’est conservée en composition avec dem, die, dianus : nous avons, en effet, totï-dem (qui ne vient pas de tot-itidem), quotî-die, quotî-dianus. Vî long, dans quotî-die et son dérivé quotî-dianus, est inorganique : peut-être est-il le résultat d’une erreur, quoti ayant été pris pour un ablatif.
1 Sur la formation de ces adverbes, voyez S i83 ”, i.
PRONOMS CORRÉLATIFS. S Al5.

A 01

Les mots latins quot, tôt sont indéclinables ; déjà, en sanscrit, kdti, tâti, yati ont au nominatif-accusatif la flexion du singulier neutre (c’est-à-dire qu’en réalité ils n’ont point de flexion), tandis qu’aux autres cas ils présentent les désinences régulières du pluriel. Nous avons observé le même fait (S 3i3) pour les noms de nombre de «cinq» à «dix», qui, en grec et en latin, sont devenus indéclinables, tandis qu’en-sanscrit ils ont gardé encore une partie de leur déclinaison.
En zend, on trouve fréquemment kati après le pluriel masculin du pronom relatif : il a alors la désinence régulière du pluriel; exemple : &A yài katayô «quicunque».
S Aïo. Les pronoms corrélatifs en drsa (tàdréa). — Les pronoms grecs en Àixos (rrjXtKns).
Presque tous les pronoms se combinent, en sanscrit, avec les adjectifs drs', drsa et drkéa. Ces adjectifs, qui dérivent de la racine dars, drs' « voir », signifient « qui a l’air de, semblable à » ; mais comme ils ne sont jamais employés hors des composés en question, ils ont pris tout à fait le caractère de suffixes dérivatifs. Les voyelles finales des thèmes pronominaux (y compris les thèmes composés asmâ, yusmâ) s’allongent devant cette espèce de suffixe, probablement pour compenser la perte d’un t (S AoA); exemples : tâ-drs (nominatif tâdfn) ou lâ-dfs'à ou tâ-drksa «huic similis, talis»; kî-drs, kî-drs'a, kî-drksa « quali s ? » ; yâ-dfû, yâ-drs'a, yâ-dfksa «qualis» (relatif); mâ-dré’, mâ-dfia, mâ-dfksa « mihi similis » ; asmâ-àfs, asmâ-dréa, asmâ-drksa « nobis similis » ; yusmâ-dré, yusmâ-drs'a, yusmâ-dfksa «vobis similis». La forme primitive était sans doute tad-dfs. tad-dfsa, tad-drksa, kid-drs, yad-dfs, mad-dfs, etc. Du thème démonstratif i, ou plutôt du neutre it, qui n’est usité qu’en composition, vient îdrs'a « talis » ; du thème démonstratif sa, qui ne s’emploie qu’au nominatif, vient sadrs qui devrait, d’après son origine, signifier «huic
n.
a 6

m

similis», mais qui est pris dans le sens général de «similis». Remarquons que l’on dit sadrs' et non sâdrs, quoique nous ayons tâ-drs, yâ-drs; cela vient évidemment de ce que ce composé renferme le thème sa, et non le neutre inusité sat. Il n’est donc pas nécessaire d’admettre avec les grammairiens indiens que sadrs est une forme mutilée pour sama-drs.
Les langues de l’Europe ont changé le u en l '■. De cette façon -Xtxos est devenu si différent du verbe Sépxco, que la parenté originaire de ces deux formes nous aurait sans doute échappé à jamais, sans la comparaison du sanscrit. Il ne faudrait pas cependant regarder l’< de -Xtxos comme venant du r de drsa : r est, comme on l’a vu (§ 1), le reste de la syllabe ar, et c’est l’a de cette syllabe qui s’est affaibli en t, tandis que le r a disparu. Nous avons aussi en grec des mots présentant une forme qui correspond au sanscrit drs (nominatif drk ) : ce sont »1X«£ et
Par une coïncidence assez remarquable, nous trouvons en prâcrit les formes târisa, tâdisa, qui se rapprochent beaucoup du dorien tSX/xos. Le prâcrit kêrisa rappelle de très-près l’interrogatif ©nX/xos; mais il ne faut pas oublier que le prâcrit est ici l’altération d’un *421 422, au lieu que ©t?Xixo« est pour ©aX/xos; l’un vient donc du sanscrit kîdréar-s, tandis que l’autre suppose une ancienne forme kâdrsa-s, à laquelle, comme nous allons le voir, se rapporte aussi le gothique hvêkiks.

PRONOMS CORRÉLATIFS. S 416.
403
S 416. Les pronoms gothiques en leiks (hvêleiks). Les adjectifs allemands en lich.

Dans le mot hvêleiks (thème hvêleika), qui vient d’être cité, et auquel se rapporte l’allemand moderne welcher «lequel», le gothique a fidèlement conservé l’ancienne voyelle longue; nous avons vu, en effet (§ 6q, 2), que ïê est l’une des deux formes qu’a prises, en gothique, l’d long primitif. En regard de hvêleiks nous trouvons, au lieu du démonstratif thêleiks, une forme sva-leiks, qui a donné naissance à l’allemand moderne solcher «tel». Mais l’anglo-saxon et le,vieux norrois ont gardé les formes thylic, thvîlikr1, qui répondent au grec tvai'xos et au sanscrit tâdfs'a-s. Le gothique leiks «semblable» paraît encore dans d’autres combinaisons qui ne sont pas de la même antiquité, mais il n’est jamais employé comme mot simple; on le remplace par ga-leiks, qui a donné l’allemand moderne gleich (venant de ge-leich) « semblable ». Dans analeiks423 424 (le moderne âhnlich «ressemblant »), ana, selon moi, n’est pas une préposition, mais un pronom, et répond au thème démonstratif ana, qu’on trouve à la fois en sanscrit et en lithuanien (S 379); le sens de ana-leiks sera donc «ressemblant à celui-ci». De même, dans les autres composés gothiques425, le premier membre exprime plus ou moins une idée pronominale; ce sont anthar-leïkei * diversité», qui suppose un adjectif antliar-leiks 426 ; samaleikô « ïaa>s », qui suppose un adjectif sama-leik(a)-s (en grec èfirpat*')427; ibna-leiks «égal», dont le

404

sens propre serait «ayant l’air d’être égal»; mma-leiks «différent ».
En allemand, la syllabe lich, qui représente le gothique leiks, a pris une extension beaucoup plus considérable : dans les mots comme jàhrlich «annuel», jâmmerlich «lamentable», glücklich « heureux », schmerzlich « douloureux » *, lich a revêtu le caractère d’un véritable suffixe.
Parmi les mots gothiques en leiks cités plus haut, nous avons vu que hvêleiks et svaleiks ont donné à l’allemand moderne welcher « lequel » et solcher « tel » : on remarquera que dans ces deux anciens composés, IV de leiks s’est perdu. Au contraire, dans l’allemand gleich «égal», l’ancien * (§ 70) est régulièrement représenté par ei. L’anglo-saxon lie et l’anglais like semblent nous présenter le terme simple ; mais il y faut voir probablement un reste du gothique galeiks, qui se sera complètement dépouillé de son préfixe.
§ 417. Identité du suffixe gothique leiks et du grec Aixos.
On pourrait objecter contre l’identité du suffixe gothique leika et du grec ><xos, que l’ancienne ténue aurait dû se changer en aspirée, suivant la loi de substitution des consonnes germaniques. Mais nous avons vu précédemment (§ 89) que cette loi souffre des exceptions; je rappelle notamment la parenté du gothique slêpa et du vieux haut-allemand insuepiu avec le sanscrit svdpimi, le latin sopio et le grec ihtvos, quoiqu’on dût s’attendre à trouver une aspirée dans les langues germaniques. Une autre objection pourrait être tirée de la longueur de 1’*
nids «égal, ressemblant», et au grec ôp6-s. Le thème gothique s’est élargi par l’addition d’un n. 11 existe, en outre, un adjecti f »ums ( thème tuma ) « quelqu’un », qui a changé l’ancien a en », comme il arrive fréquemment devant une liquide; mais il n’a pas pris de «.
1 Voyez dans Graff (Dictionnaire vieux haut-allemand, II, col. 1 o5) les compositions de ce genre, en vieux haut-allemand.
PRONOMS CORRÉLATIFS. S 418. 405


dans le suffixe germanique428. Mais la forme primitive étant darkn (§§ 1 et 21 “), on comprend sans peine que la suppression de r ait amené, par compensation, l’allongement de la voyelle précédente. Le germanique est, à cet égard, plus près de la forme primitive que le grec et le prâcrit2.
§ 4i8. Les pronoms slaves en Uko et en ko.
En ancien slave comme en grec, le suffixe que nous étudions s’est conservé sous, la forme hko ; le nominatif fait au masculin likü (S 267), au neutre liko. Nous avons donc tolikü «talis, tan-tus», toliko «taie, tantum» = grec t^AUos, tvXUov, prâcrit târisô, târisah, sanscrit tâdrs'as, tâdfsam. De même, on a kolikü, koliko «qualis, quale, quantus, quantum?» = grec nsvXUos, ■zsyh'xov, prâcrit kêrisô, kêrisah, sanscrit kîdrsas, ktdréam. Enfin, nous avons jelikü, jeliko (relatif) = grec rfklxos, iJA/xot», prâcrit yârisô, yârisah, sanscrit yâdrsas, yâdrsam. En ce qui concerne ce dernier pronom, il faut remarquer que le thème je3, dont le sens habituel est « il », a conservé ici (bien qu il ne soit pas accompagné de l’enclitique «tse se) son ancienne signification relative.
Dobrowsky4 regarde tk comme le suffixe et fait de l une lettre qui est venue s’insérer dans le mot. Mais il aurait sans doute attribué plus de valeur à cette lettre, s’il avait songé â rapprocher le slave liko du grec hxos.
Une différence entre le slave et les langues congénères, c’est que, devant le suffixe liko, la voyelle finale du pronom primitif ne s’allonge pas; pour faire pendant au grec t»jAIxos, au sanscrit

406

lâdfm-s, au pràcrit târisô, on devrait s’attendre à trouver, au lieu de lolikü, une forme taliku, car a est, en slave, la longue de 1 ’o (§ 92a). Mais on ne s’étonnera pas que, dans le cours des siècles, une altération de ce genre se soit produite, si l’on songe que l’action du temps se fait principalement sentir sur les voyelles.
Il existe toutefois, en slave, certaines formes à signification analogue, où la longue s’est conservée; mais le suffixe a perdu sa syllabe li. Exemples : tuks takü (thème tako'j «talis», kakü « quaiis ? », jakü «qualis» (relatif); féminin : taka, kaka, jaka; neutre : tako, kako, jako. Les trois dernières formes (qui sont identiques avec le thème masculin-neutre) sont employées également comme adverbes, dans le sens de «sic, quomodo?, sicut». On pourrait être tenté de voir dans la syllabe ko le thème de l’interrogatif, en sorte que ka-kü contiendrait deux fois le même thème; mais alors nous devrions avoir un masculin to-kü, ko-kü, je-kü, un féminin to-ka et un neutre to-ko, sans compter que l’interrogatif suit toujours la déclinaison définie et fait, par conséquent, au nominatif kü-j, ka-ja, ko-je. Je préfère donc m’en tenir à l’explication précédente.
§ 419. Les pronoms lithuaniens en ks (tôks). — Les pronoms latins en lis ( talis).
Si nous admettons que les corrélatifs slaves takü, kakü, jakü sont des formes mutilées pour talikü, kalikü, jalikü, il faudra aussi regarder les formes lithuaniennes tôks «talis», kôks «qua-lis» (pour toleis, kakis, thème tôkia, kakia) comme des mutilations de tôliks, koliks. La rencontre du premier de ces mots avec l’ancien suédois tockin1 ne serait donc pas fortuite.
Le suffixe latin li dans tâlis, quâlis présente une mutilation
1 Voyez Grimm, Grammaire allemande, 111, p. 4g. Outre tockin, le suédois a aussi les formes tolik et tolkin.
ADVERBES PRONOMINAUX. S 420. 407


du genre opposé : nous voyons que le latin a conservé le commencement du mot, ainsi que la longue du thème pronominal; mais il a perd429' la dernière syllabe de tâdrsa, rqXîxos, ou bien, si l’on veut, la gutturale de ÏÏTÇJ tâdfk, rjXtx-s (§ 4i5). La parenté semble d’ailleurs indubitable; elle a frappé Vossius, qui identifiait déjà tâlis avec raXlxos429.
ADVERBES PRONOMINAUX.
S 4-a o. Adverbes de lieu en Ira et en ha. — Formes correspondantes en zend, eu grec, en latin, en ancien slave et en arménien.
On forme en sanscrit des adverbes de lieu à l’mde du suffixe Ira, qui vient se joindre immédiatement au vrai thème2 ; exemples : d-tra « ici », td-tra « là », amû-tra « là-bas », ku-tra « où ?», yaAra « où» (relatif). En zend, tra devient Ira (S 4 7); exemples : i-tra «ici», ava-lra «là-bas», ya-tra «où». Il est probable que cette syllabe tra est une contraction du suffixe comparatif tara. La désinence est peut-être celle de l’instrumental (§ 395).
A ces adverbes se rapportent les adverbes pronominaux latins ci-tra et ul-tra, sauf la différence du cas et du genre. Les adverbes gothiques en thrâ, qui sont d’anciens ablatifs (§ 183 “, 2), renferment également le même suffixe. On peut comparer notamment tha-thrô «de là» avec ?nt td-tra «là»; hvathrô «dou?» avec kütra «où?»; aljathrô «aliunde» avec anydtra
«alibi».
D’autres adverbes de lieu sont formés en zend a laide du suffixe Mg^da, qui, en sanscrit, s’est altéré en ha (§ 93). Les
PRONOMS.

408

seuls mois sanscrits qui le renferment sont : i-ha «ici», kû-ha «où?» (védique) et la préposition sahd «avec»1. La forme grecque correspondante est 3-a que nous trouvons dans ‘évBa, êviavda. (SS 878 et 877). Peut-être faut-il y joindre ers, qui marque la direction vers un endroit, à moins que o-e ne vienne plutôt du suffixe tra, qui aurait alors perdu son r et affaibli son t en s. En gothique, le suffixe dit est devenu th ou d-, dans les formes comme hva-th ou hva-d «quo?», alja-th ««XXotre», jain-d (pour jaina-d) « êustas ». Il y a identité complète entre la conjonction ith «mais, si, donc», le zend nQ^ida et le sanscrit ihd. L’ancien slave a conservé plus exactement la signification locative du suffixe en question : nous le trouvons, sous la forme de (S 92e), dans les adverbes de lieu kü-de «où?» et ini-de «ailleurs». Le premier se rapporte au védique kûha, dont il vient d’être parlé, ou plutôt à une forme primitive kuda ou kada430 431 432. Avec les prépositions, au lieu de de, nous trouvons la forme as dü; je crois du moins reconnaître notre suffixe dans les prépositions po-dü « sous », na-dü « sur » et prê-dü « devant » (§1001).
Bien que les adverbes latins unde, alicunde et inde aient le sens de l’ablatif et non celui du locatif433, ils pourraient être consi-
ADVERBES PRONOMINAUX. S 420.

/i09

dérés comme renfermant le même suffixe. Inde serait regardé comme dérivé du thème pronominal i, avec insertion d’une nasale, ou bien il viendrait de in — sanscrit and (S 3 73). Quant a unde1, ali-cmde, aliunde2, il faudrait nécessairement admettre l’insertion euphonique d’un n, comme nous avons celle d’un m dans ambo (% 273). Mais il se présente encore deux autres explications de ces formes adverbiales : la syllabe de dans mue, unde, etc. peut, comme on l’a admis dans la première édition de cet ouvrage, être rapprochée du suffixe sanscrit cHî tes (§ bu i), en sorte que inde répondrait (toujours avec insertion d’un n euphonique) au sanscrit itds «d’ici»; ou bien, comme l’admet Ritschl, la syllabe finale de ces adverbes peut être regardée comme identique avec la préposition dê, et l’abréviation de ê en ë. s’expliquerait par la surcharge résultant de la composition. Dans cette dernière hypothèse, le n de inde, unde, etc. tiendrait la place de la lettre m qui termine les adverbes à sens ablatif, comme illim, istim3.
Max Schmidt4 regarde cette terminaison im comme une altération pour la désinence in, que nous trouvons, en sanscrit, au locatif pronominal, et il admet un changement du sens locatif en sens ablatif. Je ne saurais partager cette opinion, attendu que je regarde le n des locatifs sanscrits tels que tdsmin comme un complément d’époque relativement récente (§ 343), et que, d’autre part, je ne connais pas d’exemple, en latin, d’un n final changé en tn : en effet, le m des noms de nombre cardinaux
* Pour cunde (S 38g). Si i'explication indiquée est juste, undfe répondrait au védique fett-Ja «où?», venant de ku-dk.
3 II n’est pas probable que aliunde doive se diviser en ali-unde. Je ne crois pas non plus qu’il faille diviser aliubi en ali-ubi; je les fais venir directement du thème aliô (avec u pour 0).
3 Vovez Gorssen, Nouvelles Annales de philologie et de pédagogie, tome LXVII1, page a56.
1 De pronomine grceco et latine.

MO

comme septem, qu’on cite ordinairement en exemple, ne correspond pas à la lettre n des mots comme saptdn, mais bien à la lettre m des noms de nombre ordinaux comme saptamd1. Je tiens IV de la classe d’adverbes en question pour un affaiblissement de l’df du thème, qui lui-même occupe la place d’un a primitif434 435; quant à la lettre m, je la regarde comme un reste du pronom annexe srna (comparez les datifs allemands dem, ihm), après lequel la vraie désinence casuelle a été supprimée (§ 351). On peut donc prendre les formes en i-mpour de vrais ablatifs, et admettre qu’après le m il y avait d’abord un ô, et plus anciennement encore, la syllabe o-d. Les formes hin-c, illin-c, istin-c s’expliqueront dès lors comme venant de lii-mo, illi-mo, isti-mo, avec addition du c enclitique. D’après le même principe, au lieu de faire de tun-c l’analogue de hun-c, on pourra le prendre pour un ablatif à signification locative; tune sera pour tur-mo-c, qui lui-même est pour tu-mod-c (comparez le sanscrit tâ-smâ-t).
Je retourne aux formes zendes en dk, pour faire observer que je crois avoir découvert aussi en arménien quelques restes de cette classe d’adverbes; l’ancienne signification locative s’y est conservée, mais la voyelle finale du thème ainsi que celle du suffixe ont été supprimées436. Tel est l’arménien «Æhj. an-d «ibi, illic», que je fais dériver du thème aino (nominatif ain) «celui-là »437, la dernière partie de la diphthongue ai ayant été supprimée. On trouve une mutilation du même genre dans l’adverbe
ADVERBES PRONOMINAUX. S 421.

411

iuuui ast «ici» qui s’emploie pour les objets rapprochés. J’y reconnais le thème aiso «celui-ci» (= sanscrit êsd, § 879, 4), dont le nominatif est ais : dans ast, nous avons comme suffixe un t au lieu du d, à cause de la lettre s qui précède.
S 421. Les adverbes de Heu en tas. — Formes correspondantes en latin, en grec, en ancien slave et en arménien.
Le suffixe sanscrit tas, qui s’ajoute aux thèmes substantifs comme aux thèmes pronominaux, forme des adverbes exprimant l’éloignement d’un lieu et tenant souvent la place d’un ablatif. 11 y a d’ailleurs une parenté entre le suffixe tas et le caractère de l’ablatif : on peut admettre que le t de l’ablatif s’est élargi en tas, ou bien que c’est tas qui, à l’ablatif, s’est abrégé en t. En latin, tas devient tus : il y a identité, quant au suffixe, entre smrga-tds «du ciel» et cœli-tus.
Par une substitution de l’aspirée sonore à la ténueï, tas devient d'as dans a-das «en bas, sous» (§ aq3); à ce suffixe das se rattache le suffixe 6sv438 439, dans les adverbes comme vsà-Oev, t6-6sv, 6-6sv, dont la traduction sanscrite est kû-tas, târ-tas, yâ-tas. En combinaison avec des prépositions, le suffixe grec a conservé l’ancienne ténue, ainsi que la sifflante finale; exemples : êvrés, êKTés, qu’on‘peut comparer au latin intus, subtus. Le suffixe dans êvT6s a le sens locatif, comme quelquefois tas en sanscrit (§ i83a, 3).
En slave, le suffixe d'as devient Aoy du; devant ce suffixe du, les thèmes pronominaux prennent un son nasal (§ 99*) qui n’a peut-être pas été sans influence sur le changement de la ténue en moyenne. Exemples : K^Aoy kuhdu «d’où?», t^aov tuhdu

m

«de là-bas», wh^jundu « où »( relatif ), ce dernier avec changement du sens ablatif en sens locatif.
Les lois phoniques du slave, appliquées dans leur rigueur, exigeraient as du, et non AOif du : la semi-voyelle ü est, en effet, le représentant ordinaire de la désinence sanscrite as. Nous avons, par exemple, vlükü = sanscrit vfkas (§ a55); de même, les datifs pluriels en mü répondent aux datifs sanscrits en liyas. Il y a, de fait, en regard de l’adverbe sanscrit dtas «d’ici» une préposition slave otx atü «de»1. Mais l’analogie des datifs slaves comme vlüku «lupo» a pu réagir sur la classe adverbiale en question et lui donner l’apparence de datifs2.
En arménien, le suffixe sanscrit tas a pris la forme ti; il pa-laît le plus clairement dans as-ti «d’ici» pour atsti, venant du theme aiso, et dans luiiuiji an-ti « de là-bas », venant du thème aino3. Dans nLumfi usli «d’où?», le s me semble être une lettre euphonique amenée par la fréquence du groupe st4. Cet adverbe appartient certainement au thème interrogatif u (venant de ku,
§ 398), et il est probable que usti, dépouillé de son sens interrogatif et devenu en quelque sorte un suffixe formatif, se trouve contenu dans quelques autres adverbes répondant à la question « unde ». J’explique de cette façon ast-ust « d’ici » (pour asti-ustï), aidr-ust «illinc, istinc»5 (venant du thème aida = inscrit êtd6),
La préposition slave a perdu la signification pronominale qu’elle devait à son thème, et elle n’a conservé que le sens exprimé par son suffixe, qui marque l’éloignement. La même chose est arrivée pour l’ombrien tu, to «de» (S aoo) ; je crois, en effet, que cette préposition a perdu une voyelle initiale, comme le ti prâcril et pâli, qui est pour {-ti «ainsi» (S tiaô). '
1 Sur un fait analogue en lithuanien, voyez S àaa.
3 Comparez ce qui a été dit plus haut (S àao) des adverbes eut et and.
Comparez la seconde personne du singulier des prétérits gothiques comme saisâ-s-t « tu semas», pour saisô-t.
La forme, unique en son genre, aidi (même sens) appartient au même theme et parait avoir renoncé au t du suffixe ti, pour éviter le groupe dt, c Voyez S 372, h. *
ADVERBES PRONOMINAUX. S 422.

413

uin-ust (même sens, du thème aino ~ sanscrit êna), and-ust (même sens)1. Tous les autres adverbes de la même sorte se font précéder, comme les ablatifs (S i83 % A), de la préposition i, qui devient j fi devant les voyelles; exemples : ibazust «de loin», venant de pmg bai (en sanscrit vahis ou bahis «extra, foras»); jug^um K-aüust « aliunde » ; fi-erknust «cœlitus»440 441.
Si l’adverbe interrogatif usti « d’où ? » est contenu comme enclitique dépourvue de signification dans les formations en ust, on peut en rapprocher les locutions allemandes anders-woher «aliunde», anderswo «alibi», où le pronom interrogatif remplace les cas adverbiaux disparus de anderer. En effet, dans ces locutions, wo et woher sont privés de leur sens interrogatif ou relatif, et expriment simplement le rapport ablatif ou locatif442.
S 422. Les adverbes de temps en dâ. — Formes correspondantes en grec, en slave et en lithuanien.
Le suffixe dâ forme en sanscrit des adverbes de temps; exemples : kada «quand?», tada «alors», yadâ «lorsque», êkadd «une fois», sadd «toujours». Ce dernier vient du thème démonstratif sa (§ 345), qui a formé, avec la même nuance de signification, l’adjectif sdrva «chaque» (§ 381).
Peut-être faut-il rattacher au suffixe dâ le suffixe grec ts, qui aurait alors, d’une façon irrégulière, changé la moyenne en

/i1/i

ténue, comme cela a lieu régulièrement dans les langues germaniques (S 87, 1).
En slave, dâ est représenté par gda, que je décompose en g-da : je crois, en effet, que g-da est an dérivé du thème interrogatif, dont le sens primitif a dû être «quand?» ou «une fois». Ce dérivé n’est plus employé qu’en composition, et la ténue gutturale s’est amollie en moyenne, à cause du d qui suit. Devenu un suffixe, gda s’est de nouveau combiné avec le thème interrogatif, et a donné kogda (ou kügda) «quand?», qui est formé comme togda (ou tügda) «alors». A côté de inogda «dans un autre temps», on trouve dans certains manuscrits la leçon uns Ad inüda, qui représente plus exactement le sanscrit anya-dd. De même, à côté de Kr&<\jegda «ots» , on a le simple kaa jeda = sanscrit yada l.
En lithuanien, ka-dà «quand?» et ta-dà «alors» s’accordent très-bien avec le sanscrit ka-dâ, ta-da. Une formation analogue est wisa-dà «toujours»; l’adverbe sanscrit correspondant serait vis'va-dd (de visva «tout, chacun»), qui n’est pas usité. Le suffixe du est devenu susceptible, en lithuanien, d’une sorte de déclinaison, d’après l’analogie des thèmes féminins ou masculins en a. Nous avons, par exemple, à côté de ng-kadà «jamais»443 444 (en sanscrit na kadd-cit) le génitif féminin nêkados, le datif nê-kadal, et l’instrumental masculin pluriel në-kadals. A côté de ta-dà, ka-dà nous avons ta-dal, ka-dal. Du thème démonstratif ana dérive l’adverbe de temps an-daî, pour ana-dai445. La voyelle finale de kadà, tadà peut aussi être supprimée : on a alors kad, lad, dont le premier est employé comme conjonction dans le sens de « que » et « si ».
ADVERBES PRONOMINAUX. S A23-A2h.

A15

S A23. Autres adverbes de temps en dâ. — Origine de ce suffixe.
Le suffixe dâ s’unit en sanscrit avec mm, dans lequel on peut voir l’accusatif d’un thème pronominal féminin nî. Nous avons, en effet, le droit de supposer que le thème masculin-neutre na (§ B69), à côté du féminin ordinaire nâ, a eu un féminin nî (§ 119)- On obtient, de la sorte, les adverbes tadânîm «alors» et iddnîrn « maintenant » 1.
Je serais porté à reconnaître un reste de cette classe d’adverbes dans le grec ij-Sn «maintenant, bientôt». Le second n représenterait la sanscrit (§ 4); quant à IV initial, je le rapporterais au thème relatif y a (S 38a), en sorte que tf-Sn serait pour ya-da, avec changement du sens relatif en sens démonstratif (comme dans le latin ja-m, § 361) et avec suppression de la semi-voyelle initiale446 447. En ce qui concerne l’allongement de la voyelle grecque initiale, on peut rapprocher ftwap, comparé au sanscrit ydkrt (venant de yakart) et au latin jëcur.
En latin, on doit peut-être rapporter à cette classe de mots l’adverbe qmndô, qui répondrait alors au sanscrit kada et au lithuanien kadà448.
En ce qui concerne l’origine du suffixe dâ, l’hypothèse qui se présente le plus naturellement est celle*d’une mutilation de divâ «de jour», La syllabe iv aurait été expulsée, comme ev dans le latin nolo (pour nevolo).
§ AaA. Les adverbes de temps •rouvbta, Trçvbta, rjvixa.
Si l’on excepte les adverbes latins dônec, dônicum, dênique (§ 35a), il n’y a rien dans les autres langues indo-européennes

416

qui ressemble aux corrélatifs grecs mi-vlxat, Tri-vixa, rj-vifxa. Buttmann incline à voir dans ixa l’accusatif d’un mot î'ç, qu’il rapproche du latin vix, vices1. Je crois aussi que ces formations renferment l’accusatif d’un substantif; mais je divise de cette façon : 'srti-vtxa, et non •siriv-ixa.. Nous avons ainsi de vrais composés, dont le premier membre présente le thème à l’état nu, soit qu’on fasse de vsn, tri, n des thèmes féminins, soit qu’on y reconnaisse, comme plus haut dans tfjfios (S 352), des allongements du thème masculin-neutre. Cette dernière supposition est la plus vraisemblable, car quand un pronom ou un adjectif figure comme premier membre d’un composé, il paraît ordinairement sous la forme du thème masculin-neutre, ou, ce qui revient au même, du thème dépouillé de tout signe indiquant le genre2. Il faut toutefois considérer ici cette circonstance particulière que le second membre du composé est un substantif féminin : je suppose, du moins, que vix a appartient, par son origine, au sanscrit nié (venant de nikj «nuit», dont l’accusatif nisarn, transporté en grec, donnerait nécessairement vixa3. A côté de niéam nous avons encore en sanscrit la forme naktam, qui est un ancien a' usatif employé adverbialement4. Ce qui est advenu pour le sanscrit naktam, qui n’est plus usité que comme adverbe, a pu arriver en grec pour vixct. De même donc que les expressions comme tadâ contiennent le mot «jour» (S Aq3), je suppose que les adverbes comme tv.vixa. contiennent la désignation de la nuit : les uns et les autres sont devenus à la longue, et après que le sens étymologique se fut effacé, des
1 Lexilogus, II, p. 337.
s Voyez § 11 a et suiv.
3 Je retrouve le même accusatif dans le sanscrit anisam «éternellement)!, littéralement «sans nuit».
4 On le trouve, par exemple, dans le composé inorganique naktar^èara «rôdeur de nuit». [Le composé est inorganique parce que le premier membre a une flexion casuelle. — Tr.]
ADVERBES PRONOMINAUX. S A25.

/il 7

adverbes marquant le temps d’une façon générale. C’est ainsi que l’adverbe adyd «aujourd’hui, en ce jour» est arrivé à signifier «maintenant, actuellement».
Si œkbut est formé de la même manière que invixa, il faut le regarder comme étant pour afay-vixa, ce qu’admet aussi Butt-mann, qui l’explique par aÙTtjv ïxa. La syllabe yv aurait disparu comme ev dans le latin nolo, pour nevolo. ou iv dans le suffixe sanscrit dû, pour dkà. Mais si l’on admet que tyvUa. ne soit pas une forme mutilée449, on pourra le faire venir de t>ïvos. Gette dernière opinion nous paraît la moins probable, car il n’y a point de formes tsÿvo?, fivos à côté de -ayvtxa et de ÿvi'xa.
§ /ta.'). Adverbes de manière en tam, iâ et ti. — Formes correspondantes en latin, en zend et en arménien.
Les suffixes tam et iâ forment, en sanscrit, des adverbes marquant le genre et la manière. Le suffixe tam ne paraît que dans ka-tdm «comment?» et it-'tdm «ainsi». On en a déjà rapproché précédemment le suffixe latin tem dans i-tem et au-tem (§ B78). A /« répond le latin ta dans ita et aliuta — sanscrit anyd'tâ «d’une autre manière». Nous avons, en outre, les adverbes sanscrits tdtâ « ainsi », ydtâ « comme » (relatif) et sarvdiâ « de toute façon ».
Le suffixe ti a la même signification que tam et ta; il forme en sanscrit un seul dérivé adverbial, à savoir iti «ainsi», qui vient du thème pronominal i. 11 n’a d’analogue que la préposition d/t2 «sur», venant du thème pronominal a. En zend, nous avons l’adverbe uiti «ainsi» (pour uti, § &i), venant du thème démonstratif u, qui a donné au sanscrit la préposition u-t «sur, en haut» (§1002).
/,18 PRONOMS.


Le suffixe qui a formé le latin utî (pour cu-lï) est sans doute de la même famille, mais j’aime mieux le rapporter à là qu’à lï, attendu qu’un i bref final est supprimé en latin, ou bien changé en c. Si utî est pour nid, on peut le comparer au védique ha-tâ «comment??) et au zend kiir-ta (même sens). Quant à l’affaiblissement de l’a en î, il est le même que dans yu-nî-mds pour yu-nâ-mas (§6). L’abréviation de Yi dans utïnam et utïque tient à la surcharge produite par les particules ajoutées. Le rapport de itï-dem avec ita s’explique de la même manière. En zend, nous avons ita, kuta avec un a bref, en vertu d’une loi générale, qui veut qu’un â final soit abrégé à la fin des mots polysyllabiques (S 11,8).
Je regardé le suffixe sanscrit tam comme un ancien accusatif neutre, et le suffixe tâ comme un instrumental formé à la façon des instrumentaux védiques et «ends (§ i58). Tous deux ont la pour thème.

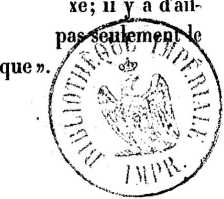
Je reviens encore une fois au suffixe fïî li, de iti « ainsi » et âti « sur », pour faire remarquer que la dernière de ces formes se retrouve, à ce que je crois, dans l’adverbe arménien ™/» ti « très ». Si cette explication est fondée, le suffixe seul s’est conservé, comme dans la forme pâlie et prâcrite h «ainsi»1. Nous avons de même, en persan, la conjonction b tâ «que», laquelle, du sanscrit ya-tâ, a conservé uniquement le su leurs accord pour la signification, car ydtâ n’a sens relatif «comme»-, il signifie aussi «
1 Au lien de üi (S 4 a i ).
FIN DU DEUXIÈME VOLUME.

Introduction
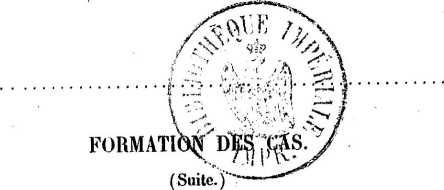
Pages.
i
DUEL.
NOMINATIF-ACCUSATIF-VOCATIF.
S aoG. Le nominalit-accusalif-vocatif duel en sanscrit........
S 207. La désinence sanscrite Au; la désinence zende âo.....
S ao8. La désinence védique à; ia désinence zende A ou a. . . ■
S 209. L’e en grec, Vu en lithuanien, désinences du duel----
S 210. Duel des thèmes en i et en w , en sanscrit et en zend.. S 211. Duel des thèmes en » et en u, en lithuanien et en grec. S 2 i 2. Le duel neutre, en sanscrit et en zend.............
S 213. Le duel féminin, en sanscrit et en zend....................... 7
$ 214. Duel féminin, en lithuanien et en ancien slave. —Tableau comparatif
du nominatif-accusa'iif-vocatif duel......................... 9
INSTRUMENT AL-DATJF-ABUÀT1F.
S 915. I. La désinence sanscrite Vyâm et scs congénères byam et hyam. — La
désinence arménienne il............................... 11
S 915, a. La désinence sanscrile Vyas. — Formes correspondantes en zend, J en latin, en lithuanien, en gothique, en ombrien et en arménien. . • 1 h
% 916. La désinence sanscrite Bit. — Formes correspondantes en zend, en lithuanien et en arménien. — Exemples d’un ancien s devenu^, q
en arménien.......................................... 19
8 217. De la désinence ®i, <p>v en grec............................. 91
S a 18. Combinaison de la désinence (pt, <piv avec les thèmes terminés par une

420 TABLE DES MATIÈRES.
Pages.

consonne. — Comparaison avec le sanscrit................... a 6
g 2 ! 9. Combinaison des désinences sanscrites byâm, bis, byas avec les thèmes
en a. — Origine de la désinence dis à l’instrumental pluriel...... a5
S 3 20. Comparaison de l’instrumental pluriel en prâcrit, en lithuanien, en
zend et en ancien perse avec l’instrumental sanscrit............. 26
§ 221. Combinaison de la désinence zende lya avec les thèmes en a. — Comparaison avec le grec................................... 28
S 222. Instrumental duel en lithuanien et en ancien slave............... 39
§ 223. Origine des désinences Vis, Vyam, byâm, litjus.................. 3o
S 22/1. Tableau comparatif de l’inslrumental-datif-ablatif duel............ 3i
GÉNITIF-LOCATIF.
S 225. Le génitif-locatif duel en sanscrit, en zend et en ancien slave. — Le
génitif duel en lithuanien............................... 3a
PLURIEL.
NOMINATIF-VOCATIF.
S 226. Thèmes terminés par une consonne. — Nominatif arménien....... 36
S 237. Nominatifs sanscrits end». — Formes correspondantes en gothique et
en lithuanien. .................................... • ■ • 37
5 228". Terminaison pronominale prenant en grec et en latin la place de la
terminaison ordinaire.................................. 38
8 aa8b. Formes latines archaïques en et», en es et en is. — Formes osques et ombriennes. — Thèmes primitivement terminés par a en lithuanien, en slave et en vieux haut-allemand.................... 60
8 229. Nominatifs védiques en âsas, — Formes analogues en zend et en ancien perse......................... 63
S 23o. Renforcement de la voyelle finale dans les thèmes en » et en u. — Nominatifs latins en ês................. 46
S a3i. Nominatif pluriel des thèmes neutres, en zend, en gothique, en grec
et en latin. ....................... 67
S 23a. Nominatif pluriel des thèmes neutres terminés par u, en zend et en
vieux haut-allemand. ........... 69
S 233. Nominatif pluriel des thèmes terminés par ai, en.zend. ........ 5o
S 236. Nominatif pluriel des thèmes neutres, en sanscrit................ 5i
S 235. Tableau comparatif du nominatif-vocatif pluriel................. 53
ACCUSATIF.
S 236. De la terminaison ns de l’accusatif........................... 54
S 287,1. La désinence de l’accusatif pluriel as, en sanscrit et en grec...... 59

TABLE DES MATIÈRES. 421
Fages.
S 238. Désinences <î, as et s, en zend.............................. 66
S 23g. Désinences an, an» et è'us, en zend........................... 67
Démarque. — Des formes védiques en fis...................... 68
S s4o. La désinence du pluriel du, en persan moderne, vient d’un ancien accusatif masculin...................................... 69
§ 2h 1. La désinence du pluriel hâ, en persan moderne, vient d’un ancien pluriel neutre. — Comparaison des pluriels neutres en haut-allemand.............................................. 7°
82 4a. Tableau comparatif de l’accusatif pluriel....................... 7 «
INSTRUMENTAL.
S 243. Tableau oomparatif de l'instrumental......................... 70

DATIF-ABLATIF.
S 244. Des formes latines en fo. — Tableau comparatif du datif et de l’ablatif. 78
Débarqué. — Des formes osques en ûis et en oit................ 76
GÉNITIF.
S-a45. Désinence du génitif pluriel. ............................... 78
S 246, Insertion d’un n euphonique devant la désinence du génitif pluriel, en
sanscrit et en zend..................................... 76
S 247. Génitif pluriel des, thèmes zends en i, î et «.................... 76
S 248. Génitif pronominal.— Du génitif latin en mm.................. 77
S s4g. Tableau comparatif du génitif............................... 80
LOCATIF.
S a5o. Caractère du locatif pluriel. — Le datif grec en 01 est un ancien locatif. 81
$’*.5l.; Datif grec en ois, an...................................... 82
$ 252. Datif grec en eau......................................... 82
S 2,53. Locatif pluriel en lithuanien................................. 84
8 *54. Tableau comparatif du locatif pluriel en sanscrit, en zend et en litbua-. nien, et du datif pluriel en grec.......................... 85
RÉCAPITULATION.
S 2 55. Tableau général de la déclinaison dans les langues indo-européennes.. 86
Remarque 1. — L’iusertion d’un » euphonique n’a pas lieu à l’instru
mental des thèmes en a, en zend et en ancien perse............ 93
Remarque 2. — Formes de génitifs raessapiens en Ai............. 98

422
TABLE DES MATIÈRES.
LA DÉCLINAISON EN ANCIEN SLAVE.
Pages.

S a56. Nécessité de rechercher la vraie forme du thème................. i s3
§ 257. Thèmes masculins et neutres en 0.... .'.................... ... 12/1
S 258. Thèmes en jo. 125
S 259. Triple origine des thèmes en jo.............................. 126
S 260. Thèmes féminins en a. — Thèmes masculins en 1................ 137
S 26». Thèmes féminins en i et en ü............................... 127
S 26s. Thèmes masculins en ü................................... 129
S 263. Insertion d’un j devant Vu final du thème...................... i3i
S 264. Thèmes terminés par une consonne : thèmes en n, », 1............. 132
S 265. Thèmes en r........................................... 135
SINGULIER.
S 266. Formation du nominatif, de l’accusatif et de l’instrumental......... 136
S 267. Formation du datif et du locatif............................. 137
S 268. Datif et locatif des thèmes féminins en a et en ja, des thèmes en i, en
jo et en jü........................................... 138
S 26g. Formation du génitif. — Origine de la désinence pronominale go. ... i3g
S 270. Génitif des thèmes en 0, en ü et en i......................... 14o
S 2 71. Génitif des thèmes féminins en a............................ 141
S 272. Vocatif............................................... iis
DUEL.
S 273. Les trois cas du duel, en ancien slave......................... 143
PLURIEL.
S 274. Nominatif-vocatif pluriel................................... i45
S 276. Accusatif pluriel. ............................... 146
S 276. Instrumental pluriel des thèmes en 0 et en jo.................... 147
S277. Instrumental pluriel en mi. — Datif pluriel..................... 147
S 278. Génitif pluriel.........................»................ 14g
S 279. Locatif pluriel. ......................................... i5o
ADJECTIFS.
DÉCLINAISON DES ADJECTIFS.
S 280. Adjectifs à déclinaison pronominale.......................... i5a
§281. Cause de la double déclinaison des adjectifs en allemand........... i53


Pages.
S 282. Origine de la déclinaison déterminée en lithuanien et en ancien slave.
— Déclinaison du pronom/®............................. *55
§ 283. La déclinaison déterminée en lithuanien.......... ‘®7
, S 28i. La déclinaison déterminée en ancien slave...................... 1 '"'9
8 a85. La déclinaison déterminée dans les dialectes slaves modernes........ i63
S 286. Double déclinaison adjective dans les langues germaniques. — Examen
de l’opinion de J. Griinm................................ ‘63
S 987. Déclinaison des adjectifs forts dans les langues germaniques......... 166
8 988. Thèmes adjectifs en a, en gothique........................... 1®i)
8 28g. Le pronom interrogatif gothique hvar-jis....................... ‘7®
8 290. Tableau comparatif de la déclinaison du gothique hvar-jis et du sans-
critÿfls............................................. *7®
DEGRES DE COMPARAISON.
§ 291. Les suffixes tara et tama................................... *7J
8 299. Le suffixe comparatif tara ajouté aux pronoms................... <77
S 993. Le suffixe comparatif tara ajouté aux prépositions, en sanscrit et en
latin............................................... 17**
S 29/1. Le suffixe comparatif tara ajouté aux prépositions dans les langues ger- .
S 295. Autres exemples de prépositions et d’adverbes germaniques pourvus du
suffixe comparatif tara............... ‘8‘
S 296. Le suffixe superlatif tama, en gothique........................ ‘83
S 297. Le suffixe comparatif tara, en lithuanien et eu slave............. ‘85
8 298 *. Comparatif et superlalif en iyas, iéta......•••••••............ 1
Remarque. — Exemples d’accumulation de suffixes en latin, en grec et
en persan.................. ‘88
S298b. Comparatif et superlatif en yas,i\a.......................... ‘89
S 299. Déclinaison des comparatifs en iyas........................... ‘9°
8 3oo. Formes correspondant eu zend et en grec aux comparatifs et superlatifs
sanscrits en (ydn, ista.................................. 19 ‘
S Soi. Formes correspondant en gothique aux comparatifs et superlatifs sanscrits en îydn, téta. .................................... 19,r>
Remarque. — Comparatifs adverbiaux en fs, en gothique.......... 190
S3o9. Comparatifs gothiques en is.fsan............................ ’9(i
S 3o3. Comparatifs gothiques en âs, ôs-an...................... *9®
8 3o4. Jonction des suffixes du comparatif et du superlatif au thème positif,
en gothique......................................... 199
S 3o5, 1. Comparatif masculin et neutre, en ancien slave................ 200
S 3o5, 2. Comparatif féminin, en ancien slave. — Déclinaison déterminée du
comparalif............................ 203
S 3o5, 3. Le superlatif dans les langues slaves........................ 20,1
/i24 TABLE DES MATIÈRES.


Pages.
S3ofi. Le comparatif en lithuanien et en borussien..................... aoi
S 807 Le superlatif en lithuanien. — Comparatifs et superlatifs adverbiaux,
en lithuanien, on horussien et en gothique................... ao5
S3o7b. Le comparatif, en arménien............................... aoG
NOMS DE NOMBRE.
NOMBRES CARDINAUX.
S 3o8. Le nombre «un»........................................
Remarque. — Composés germaniques renfermant le nom de nombre
a o y
2l3
216
219
221
aai
226
327
aa8
239
a3o
s3i
93a
«un». — Termes signifiant «demi, entier»..................
S 3og. Le nom de nombre «deux»................-...............
S 310. Le nom de nombre «trois». — Origine de ce nom...............
S 3it. Origine du nom de nombre «quatre».........................
S 3ia. Le nom de nombre «quatre»...............................
§ 3i3. Le nom de nombre «cinq». —• Origine de ce nom...............
§ 31 i. Le nom de nombre «six»..................................
§ 315. Le nom de nombre « sept».................................
S 3i6. Le nom de nombre «huit».................................
S 317. Le nom de nombre «neuf»...........*....................
S 3i8. Le nom de nombre «dix». — Origine de ce nom................
S 319. Les noms de nombre de «onze» à «dix-neuf»...................
Remarque. — Comparaison des nombres de «onze» à «dix-neuf» et des nombres de «un 1 à «neuf». — Altérations du nom de nombre
«dix» comme membre d’un composé..................... • • *33
S 3ao. Les noms de nombre de «vingt» d «cent»..................■ • - • a38
Remarque. — Formation des noms de nombre de «vingt» à «cent». —
Le nom de nombre «mille».............................. 2^9
NOMS DF, NOMBRE ORDINAUX.
S 3a 1. Le mot «premier» dans les langues indo-européennes. — Suffixes servant à former le» noms de nombre ordinaux.................. a43
S 3 a a. Suite des noms de nombre ordinaux.......................... 267
S 3a3. Féminin des noms de nombre ordinaux. — Noms de nombre ordinaux
en arménien................. ........................ 269
S 3aù. Les adverbes numéraux on sanscrit, en grec, en latin et en lithuanien. a51 S 325.- Adverbes sanscrits en dd comparés avec les adverbes grecs en %<t..... a53
S3a6.
S 397. S 3s8. S 339. S 33o. S 331.
S 33a. S 333.
S 334. S 335.
S 336.
S 337. S 338.
S 33g.
S 34o.
S 341. $ 342.
S 343. S 344. S 345. S 346.

TABLE DES MATIÈRES.
425

PREMIÈRE ET DEUXIEME PERSONNES.
Thèmes et déclinaison des pronoms personnels.................. a55
Remarque. — Le nominatif du pronom de la première personne..... 367
Les pronoms personnels en grec et en gothique.................. a58
Les pronoms personnels en latin............................. s5^
Formes sanscrites secondaires mé, tè. — Leur origine............. 360
Les pronoms personnels en lithuanien, en ancien slave et en arménien. 961 Pourquoi le pronom de la première personne a un autre thème au pluriel qu’au singulier.................................... ag3
Pluriel du pronom de la première personne en sanscrit et en grec. ... 264 Origine du thème pluriel et du thème duel du pronom de la première
personne................................... a65
Thème pluriel et duel du pronom de la seconde personne.......... 267
Les nominatifs pluriels mès,jüs, en lithuanien; veis, jus, en gothique;
voir, ihr, en allemand.......... agg
Origine des formes secondaires sanscrites ne», vas, nâu, vâm, et du
duel yu-vâm....... ................................... 3gg
Les pronoms nôs, vos, en latin................ 270
Les formes secondaires du duel nâu, vâm, en sanscrit. —Les formes
grecques vSi, aQâi.....................................
Pluriel et duel des pronoms des deux premières personnes, en ancien
Pluriel des pronoms des deux premières personnes, en arménien..... 274
Remarque.— Pronoms possessifs servant de génitifs aux pronoms personnels. ............... 2gg
PRONOMS DE LA TROISIÈME PERSONNE.
LE THEME PRONOMINAL SVA.
Le thème sva et ses dérivés en sanscrit, en zend, en grec, en latin, en
germanique et en slave. ................................ a8g
Différentes formes du thème sva en zend. — Le pronom sva en armc-nien. — Tableau comparatif de la déclinaison de ce pronom...... 391
LES THÈMES PRONOMINAUX TA ET SA.
Le thème <0 et ses dérivés................................. ag4
Pronoms renfermant le thème ta, en sanscrit, en zend et en grec..... 396
Lo thème pronominal sa................................... 997
Le pluriel ol, al, en grec.................................. 999

426
TABLE DES MATIÈRES.
Page».
S 347. Absence du signe casuel au nominatif sa, en sanscrit. — Fait identique
en grec et en gothique................................. 3 99
S 348. Explication du fait exposé dans le paragraphe précédent........... 3oo
§ 34g. Tableau comparatif de la déclinaison du thème pronominal la....... 3o 1
§ 35o. Dérivés du thème pronominal ta. — Changement du t initial en d... 3o6
§ 351. Autres dérivés du thème pronominal ta....................... 3o7
S 35a. Autres dérivés du thème pronominal ta....................... 3o8
S 353, Les thèmes dérivés tya et sya, en sanscrit et en gothique........... 3u
§354. Le thème dérivé sija, en vieux haut-allemand................... 3,2
S 355. Déclinaison du thème tya, en vieux haut-allemand............... 313

§356. Tableau comparatif de la déclinaison du thème tya, en sanscrit et en
vieux haut-allemand................................... 31
Remarque 1. — L’article en vieux haut-allemand et en vieux frison.. . 315
Remarque 2. — Le thème sya en zend, les thèmes sya et tya en ancien
................ 3l7
perse.........................*......... 1
S 357. Pronoms composés renfermant les thèmes tya et sya,, en vieux bautral-
lemand et en lithuanien................................ 317
S 358. Déclinaison du thème sya, en lithuanien et en ancien slave......... 3i8
Remarque. — Examen d’une objection de Sclile.cher.............. 3ao
S 35g. Pronoms composés renfermant le thème tya, en lithuanien......... 3ai
LE THÈME PRONOMINAL 1.
S 36o. § 36i. S 36a. S 363. §364. §365.
Le thème », en sanscrit...................................
Le thème i et ses dérivés, en latin...........................
Le thème », en gothique..................................
Féminin du thème », en gothique............................
Le thème », en grec.................................... ..
La particule inséparable t, en grec. — Comparaison avec la particule et',
en gothique...................................;.....
3a5
3a6
3a8
3ag
33o
33 a
LE THÈME PRONOMINAL A.
§ 366. Le thème a et ses dérivés..................
S 367. Féminin du thème a. ....................
333
334
LES THÈMES PRONOMINAUX MA ET SA-
§368. Le pronom composé »'ma...................................
§ 36g. Le pronom composé .................................*
Remarque. — Anciennes formes pronominales conservées en pâli.....
§ 370. Mots composés renfermant le thème ........................ • ■
S 87». Dérivés du thème m. — Origine des particules négatives..-----• • • *
§373, 1. Déclinaison du thème composé ana. — L’article an, en irlandais... S87a, s. Le thème composé ana, en arménien......• • • - • < • • * ■ '•'> ■ • • • '
335
335
337
338 341
344
345


Pages.
S 372, 3. Le pronom annexe a, en arménien........................ 346
S 372, 4. L’enclitique ik, en arménien. — Origine des thèmes aiso, aido, aino. 347
S 87.3. Prépositions dérivées du thème composé ana.................... 35o
S 374. Dérivés du thème ana. — Les pronoms anyâ et antara............ 351
S 075. Les pronoms âpara et para......... 352
S 376. Pronoms dérivés du thème na............................... 354
THÈME PRONOMINAL VA.
S 377. Le thème composé ....................................... 355
S378. Dérivés du thème ara.................................... 357
S 379. Particules grecques dérivées du thème ava. — La négation oO....... 357
S 38o. Dérivés du thème ava. — La conjonction gothique auh, en allemand
moderne auch........................................ 358
S 38 t. Origine du thème ara. — Le thème simple va et ses dérivés........ 36o
THÈME PRONOMINAL YA.
§382. Le thème relatif ya, en sanscrit, en grec et en arménien........... 3ôt
S 383. Le thème ya, en zend, en lithuanien, en slave et en gothique....... 363
Remarque. —■ Conjonctions signifiant «sia, dérivées du thème relatif.. 363 S 384. Particules dérivées du thème ya, en gothique, en lithuanien et en latin. 365 S 385. Particules affirmatives dérivées du thème ya, en gothique.......... 366
THÈME PRONOMINAL KA.
S 386. Le thème interrogatif ha, en sanscrit, en zend et en lithuanien......366
S 387. Le thème ha, en grec et en latin......... 367
S 388. Le thème ha, dans les langues germaniques et slaves.............. 368
S 389. Le thème interrogatif feu et ses dérivés, en sanscrit, en zend et en latin. 36g
S 390. Le thème interrogatif hi.................. 37a
S 391. Dérivés du thème hi. — Ki changé en Ai...................... 373
S 392. Adverbes de temps renfermant le thème interrogatif.............. 874
S 393. Dérivés du thème hi, en zend et en latin...................... 376
S 3g4. Dérivés du thème hi, en latin : le pronom hic. — Changement du sens
interrogatif en sens démonstratif....................«...... 377
. S 3g5. Dérivés du thème interrogatif, en gothique. — L’enclitique uh...... 378
S 3g6. Dérivés du thème hi, dans les langues germaniques............... 38o
S 397. Le thème Ai, en arménien................................. 38i
S 398. Le thème interrogatif fca, ëft arménien.................... 383
S 399. Enclitiques dérivées Ju thème interrogatif. — Les enclitiques cit, ca,
èana........................^...................... 384
S 4oo. Dérivés du thème interrogatif hi, en vieux norrois. — Changement du
S 4oi. Le thèmé interrogatif hi, devenu ti en grec. — Les particules te et xai. 386
sens positif en sens négatif............................... 385
A28 TABLE DES MATIÈRES.


Pages.
S Û02. De l'accentuation du pronom ris en grec....................... 387
S 6o3. Dérivés du thème interrogatif, en ancien slave et en lithuanien. — Les
enclitiques ie et gi.................................... 388
ADJECTIFS PRONOMINAUX DÉRIVÉS.
PRONOMS POSSESSIFS.
S 4o4. Pronoms possessifs en ha, en sanscrit et en zend................. 38g
S Ao5. Pronoms possessifs en îya, en sanscrit. — Le grec lêios. Les pronoms 'aaïos, roîos, olos................................ 3go
$4o6. Formation des pronoms possessifs, en ancien slave, en lithuanien, en
latin et en grec....................................... 3g 1
S 407. Formation des pronoms possessifs du pluriel, en lithuanien et en ancien slave. — Pronom possessif formé du thème interrogatif, en
ancien slave et en latin................................. 3g3
S 4o8. Formation des pronoms possessifs, dans les langues germaniques..... 3g4
PRONOMS CORRÉLATIFS.
3g5
3g6
397
3g8
399
S 4og. Les pronoms sanscrits en vant. — Formes correspondantes en latin...
S Aio. Les pronoms sanscrits en yant. — Formes correspondantes en zend...
S 411. Pronoms et adverbes corrélatifs, en lithuanien..................
S 4ia. Pronoms corrélatifs ■adaos, tèaos, Saos, en grec................
S 4i3. Les pronoms corrélatifs ràfvos, rtyot-, les adverbes réoss, sas........
400
401
403
404
405
4o6.
S 414. Les pronoms corrélatifs kàti, tàti, ydti, en sanscrit, et quut, tôt, en
latin............................................. ■ •
S 415. Les pronoms corrélatifs en elria ( tâdria). —• Les pronoms grecs en Xixos
(tiiXlxôs). ,..........-.................... • •
S 4i6. Les pronoms gothiques en fcifca (hvèleiks). — Les adjectifs allemands
en/tel*..............................................
S 417. Identité.du suffixe gothique, leilis et du grec Xixot.................
S 4i8. Les pronoms slaves eti liko et en ko. .........................
8 419. Les pronoms litliuaniens en ks ( tôks ). — Les pronoms latins ch lia (tdli*)...............................................
ADVERBES PRONOMINAUX,
S 4ao. Adverbes de lieu en ira et en ha.— Formes correspondantes en zend,
en grec, en latin, en ancien slave et en arménien. ...... • A07
S 4ai. Les adverbes de lieu en ta», — Formes correspondantes en latin, en
grec, en ancien slave et en arménien....................... Ai 1
S Aaa. Les adverbes de temps en dâ. — Formes correspondantes en grec, en
slave et en lithuanien......................... . 4»3

Pages.
S /iis3. Autres adverbes de temps en dd. — Origine de ce suffixe.......... hi5
S A2h. Les adverbes de temps «lyplm, rnvlxa, fivlxa................... Al5
S 425. Adverbes de manière en tam, tâ et ti. — Formes correspondantes en
latin, en zend et çp arménien............................ 417
(fis DE LA TABLE- DGS MATIÈRES.
\ "*T.
\ '• ~ - ^ ~ /.

V
Les Indous et les Iraniens sont les seuls peuples qui se soient donné le nom d’Aryas. C’est par extension qu’on a appliqué ce nom à la famille tout entière, ainsi qu’à l’idiome dont les langues indo-européennes sont sorties.
Pour montrer que la langue indo-européenne n’est pas une pure conception idéale, mais qu’on peut, jusqu’à un certain point, la reconstruire, M. Schleicher s’est récemment complu à écrire un apologue dans cotte
.langue antékistorique. Il a pris soin de ne mettre dans ce morceau, d’ailleurs très-court, que des mots et des flexions grammaticales dont le témoignage des différentes langues de la famille atteste l’antiquité et permet de conjecturer la forme. Il va sans dire que ce texte, qui s’appuie sur nos connaissances actuelles, devra sans doute aux éditeurs futurs plus d’une amélioration. (Voir les Mémoires de philologie comparée publiés par Kuhn et Schleicher, tome V, page 206. — Comparez aussi Fick, Vocabulaire de là langue indo-germanique. Gœttingue, 1868.) 1;.
G est ce qui explique la régularité des lois phoniques.
8 Notamment dans ces dernières années, il a été publié sur ce sujet de remarquables travaux par MM. du Bois-Reymond, Brücke, Helmholtz et
ü .
Nous ne voulons pas dire que certains suffixes ne proviennent pas de racines attributives; mais ce ne sont ni les plus nombreux, ni les plus an
ciens.
Ce n’est pas ici le lieu (l’insister sur le rôle que les suffixes .!/», nu, a jouent dans ces verbes : nous y reviendrons en traitant de la conjugaison.
Ce sont les mots que M. Bopp appelle mots-racines (8 ni).
n.
Voyez Kuhn dans son Journal, tome XV, pages hûo et suiv.
5 Voyez Schleicher, Compendium de la grammaire comparée des langues indo-germaniques (a" édition), § a43.
Forme védique.
Voyez § 2i5, 1 et suiv. M. Pott, dans ses Recherches étymologiques (2° édition, I, page 58g), fait venir cette syllabe bhi de la préposition abhi trversn ; mais il reste alors à expliquer abhi. Au contraire, M. Bopp, avec plus de vraisemblance, voit dans la préposition abhi un cas du thème pronominal a.
Page aa5 du manuscrit lithographié.
1 Comparez Anquetil, Zend-Avesta, II, 175. Les deux génies qu’Anquelil appelle Khordad et Amerdad sont mis tous les deux au duel, de la même façon que dans les Védas nous avons des composés copulatifs comme pitarâ-mâtarâ «père et mère», mot à mot ©avéps-puTépe, la désinence de chacun des deux mots exprimant la somme produite par leur répnion (S 97 a). _
Au lieu de htirvâoécd, il faut lire haurvdoddd (Westergaard, Zondavesta, p. 66,11); >» au est pour » a, à cause de l’épenthèse (S <16). La forme complète du nom de ce génie est haurvatât, c'est-à-dire «l'intégrité». De cette forme sont venus d’abord haurvat (à l’instrumental-datif-ahlatif duel haurvudbya) et ensuite, avec suppression du suffixe entier, haurva — sanscrit sdrva. Le thème amërëlât, qui signifie, d’après son étymologie, «immortalité», abrège ff&Mjtfnment l’a de la syllabe finale : on a, par exemple, à l’mslrumcntol-datif-ablati^&fRèrètadiÿa, comme on a vu plus haut amërètaldoi-éâ. Au contraire, l’accusatif singulier présente la forme dans sa pureté : amërUâtëm. Quant à leur suffixe dérivatif, les noms de ces deux divinités correspondent
Par exemple, Vendidad-Sâdé, p. 23 : haurvata amërêlâta
«les deux Haurvats et Amertats?) ; p. i36, dva nara a deux hommes». En général, la terminaison en d paraît bornée à ce dialecte (S 3t) qui allonge à la fin des mots les a, mémo ceux qui étaient primitivement brefs. Les exemples en â qui appartiennent i ce dialecte ne prouvent, par conséquent, rien pour la vraie forme du duel zend.
Sur duyê, correspondant au sanscrit dvê, voyez S 43.
J Voyez Bumouf, Yaçna, p. A97.
La forme sanscrite correspondante est vâsu-n-i, avec n euphonique. Le zend ne connaît pas cette'inserlion d’un n (S 133 ).
! Voyez sur cette forme S 207. .
Voyez SS ? et 109*, 6.
Comparez te védique taviiâ « fort» et tâviéî « force». Le zend tsv(M est également employé comme substantif abstrait: Burnouf ( Yaçna, notes, p. 1Û9, remarque 37) te traduit par «énergie». La racine est tu, qui signifie en sanscrit «croître», en zend «pouvoir». Comparez entre autres te gallois tyv-u «croître». — On trouve encore, | comme duel féminin se rapportant aux deux génies précités, le mot utayûitî, dont Ê je ne sais pas le sens,' mais dont le thème, très-vraisemblablement, finit aussi en I ( long. '
Avec en: maibyâcâ. Ces formes sont empruntées au dialecte particulier (S 3i) qui allonge les voyelles finales brèves. Le m final a été supprimé, comme dans la désinence duelle bya. Bcnfey qui, le premier, a attiré l’attention sur cette forme intéressante, admet que maibyâ, à cause de sa voyelle finale longue, est peut-être une forme de duel (Éclaircissements pour servir à l’étude du zend, dans les Annonces savantes de Gcettingue, i85o). Mais maibyâ est beaucoup plus près du singulier sans-i crit mâhyam que du duel âvabyâm.
I Quant à la forme maibyâ, où Spiegel (dans les Études indiennes de Weber, 1, | p. 307) croit voir le sanscrit mâhyam, j’en fais, au contraire, un datif pluriel. Je I suppose que la désinence sanscrite Vyam de gçqtzpr asmàb'yam a été remplacée par ) la désinence ordinaire du datif, et que le thème asmd a perdu la syllabe as. C’est ; par suite de la même suppression de la syllabe as qu’en persan moderne nous avons ■ le pluriel mâ «nous». Je ne crois pas, en effet, que ce pluriel ait été formé du singulier men «je» (= sanscrit mâm «moi», à l’accusatif) ; je pense qu’il se rapporte à l’ancien thème sanscrit asmd, comme le persan êumâ «vous» se réfère au thème sanscrit yu-êmâ, avec suppression de la première syllabe et insertion d’une voyelle de liaison (S 334). Comparez Benfoy, ouvrage cité, p. 11 et suiv. s Petermann, Grammaire arménienne, pp. 63, ao5, a33.
Avec l'enclitique éa «et» nous avons byai-ia (§ i35, remarque 3).
5 De là vient majus, par la suppression du g.
Vovez Sclileicher, Grammaire lithuanienne, p. 175.
Vient de bâl}ü «bras», mais a pris une signification différente. a Vo arménien tient ta place de t’n sanscrit. Comparez S 183 \ t.
ii. n
Voir tome ï, p. &oa, note 3. . .
3 La racine êâs signifie en sanscrit «commander, instruire, punira, et 1 arménien sast (thème sasti) a, suivant Aucher, le sens de «réprimande, correction, châtiment)^ •
Au lieu de 1. » on trouve aussi >/ j», qui a le même son que i_ quand celui-ci a la valeur d’une consonne. Après n 0 l’on met q w, parce.que nu. exprime le son u. (Voyez Petermann, Grammaire arménienne, p. 55 et suiv.) La même chose a lieu à l’instrumental singulier. , i . '
! Il en est de même pour le 9 z venant de 5^ y.
Le génitif, par sa signification, touche d’ailleurs de, si près au datif qu’il n’}
aurait rien eu de surprenant à ce que les deux cas se fussent quelquefois confondus.
C’est ainsi qu’en grec, au duel, te génitif a pris la désinence du datif, et qu’en s arménien, au pluriel, il emprunte celle du datif-ablatif (S 2i5, a).
| 25 Iliade, XXI, vers 295. On trouve dans la Grammaire grecque de Thiersdh
I (5 182 ) une collection d’exemples des divers emplois de Çiv, <pi. — Tr.
; s Odyssée, X, vers 2h8.
| 30 Odyssée, V, vers i5t.
Comparez Buttmann, Grammaire grecque développée, I, p. ao5. [Buttmann considère évvn&iv comme un adverbe et rapproche les locutions és adpiov, ês aZ6is.
~Tr‘] ^
Ouvrage cite, I, p. ao5. [Les mots comme orr/le6ptv. ôpscpi, vavtpi n’ayant point de désinence avant (pi, non plus que les mots de formation analogue, comme oOpavoOt, ÏStiSev, il n’y a aucune raison, dit Buttmann, pour en mettre une à fiiri-Çi. — Tr.]
La forme ê-bis n’aurait pas donné dis, mais ayis, car é, qui est pour a + i, ne peut se réunir en diplithongue, ou plutôt en triphtlionguc, avec un i suivant.
Je ne regarde pas le védique nadydis comme une mutilation pour ««-di-b'is, car après la suppression du V on aurait eu ttadis; c’est, selon moi, un instrumental ordinaire formé d’un thème élargi nadyn. -
La voyelle o qui précède la désinence duelle tv a donc la même raison d être que celle qui précède le suffixe possessif sut, que nous avons déjà rapproché ailleurs du suffixe sanscrit vant Evt a dû être primitivement FevT, et la voyelle de liaison, insérée à cause du digamma après les thèmes terminés par une consonne, s’esl ensuite étendue à la troisième déclinaison tout entière et est restée même après la chute du digamma. C’est ainsi qu’on a 'tsvp-6-ets, qui est formé comme 'tsvpoïv, venant de 'Cfvp-o-ïv; au contraire, tupà-ets est formé comme Ttîpoiv, venant de rvpo-tv.
Ou burënbya. C’est ainsi que nous avons (Vendidad-Sâdé, page 9)
“«iliii^bërëfënbya; une autre leçon donne toutefois bërësanbya (Burnouf, Yaçna, . ^35aP Dans la première édition, j’ai rapporté à tort ce participe à la racine VM «briller». Nériosengh traduit par mahattara «très-grand», ce qui nous conduit à rapprocher le mot zend du sanscrit nrUnt (forme faible wW) .«grand», littéralement «grandissant». C’est l’explication donnée par Burnouf.
Remarquez que le participe présent renferme, au cas dont il vient -’etre question ainsi qu’au datif-ablatif plùriel, la nasale | n qui d’ordinaire ne s’emploie qu’à la fin des mots, ou bien devant les voyelles et devant les semi-voyelles » y et » t> (S 60). Peut-être est-ce la parenté étroite du b avec le v qui fait qu’on préfère ici le 1 au g.
Voyez S ai5, a.
Voyez S 218.
Voyez S 31 •
Voyez ci-dessus, 1.1, p. 329, note 2.
“ Anquetil traduit «dans ce monde». C’est Burnouf ( Yaçna, notes, p. 1 aa ) qui a le premier reconnu un locatif duel dans ces formes.
Sur l’o qui suit le b, voyez § 3a.
Je rite les formes âkmen-s, dùkter-s d’après Schleichor (Grammaire lithua-
> - iUsjri, . i
, ■ ! . *
Comme il y a beaucoup d’autres cas où 5 « s’élargit en ^ é, et comme c’est
Voyez Peter, dans te Journal littéraire de Halle, i8As, p. 67, et comparez Aufrecht et Kirchhoff, Monuments de la langue ombrienne, p. i63.et suiv.
8 Voyez l’puvrage cité (p. » 13), où le passage suivant de la Table de Bantium ( ligne a 5 J : pas ex aiscen ligis scriftas set, est traduit : « quæ ex hisce iegibus scripte sunt».
Voyez Burnouf, Yaçna, notes, p. 73 etsuiv.
Dans tes autres compositions de ce genre, l’a du nombre «dix» s’est affaibli en u (eresun « trente», qarasun « quarante », etc. ) ; on peut comparer sous ce rapport le gothique taihun «dix», thème taihrni. Dans le q de q-san «vingt» je reconnais avec Windischmann (ouvrage cité, p. 3a) le durcissement d’un » (comparez S,aa6); il représente, par conséquent, le a du thème sanscrit dva (par affaiblissement dvi). Toutefois, je ne voudrais pas faire dériver directement q-san du sanscrit vinsdti crois que les noms de nombre composés dont nous parlons sont de formation arménienne, c’est-à-dire qu'ils contiennent l’arménien tasan «dix», avec suppression de la syllabe initiale et addition au thème d’un ». C’est ainsi qu’en allemand on doit à do nouvelles formations les composés comme zwanzig, dreissig (S 3ao, remarque). Si l’on admet que le q de q-san « vingt» représente un ancien v, on pourra rendre compte d’un autre nom de nombre, en apparence très-singulier, erkurq «deux»;
nous voyons dans le ^ h un ancien v transforme en gutturale. Si Ion rétablit 1e r et
si l’on regarde r comme un affaiblissement de d (comme dans le tahitien rua «deux»
comparé au malais et au nouvees>zéelandais dûa, et comme dans le latin mendies,
17“), on arrive au thème edvu avec e prosthétique (Si 83 L, 1 ). Quant à la voyelle n du thème erku, j’y reconnais l’affaiblissement de l’a sanscrit de dva (S 183 h, 2 ).
Si simple que paraisse ce principe, il n’en a pas moins été très-difficile d’arriver à cet égard à une complète certitude. Bnrnouf avait déjà indiqué la forme du pluriel neutre pour les thèmes en a et il avait établi d’excellentes comparaisons avec le go-
Dans te thème pëéa je reconnais un mot de ta même famille que te sanscrit paiêât (ablatif d’un adjectif quî n’existe plus, paééa) «derrière, après»; ta syllabe lia dans paééa est sans doute ta même que nous trouvons dans ucéa «haut» et ntéa «bas» (de ut «en haut» et ni «en bas»). Comparez avisai le persan pe* «post, deinde», te hihuanien pas «auprès»,pasleui «après», le latin post, posteras, et l albanais pas «après». — Spiegel, se conformant à la tradition parse, explique au contraire pëéô par «coupable» (Vendidad, fargards ê et i5).
s Comparez SS s>3i et 56".
Voyez S 5611.
Voyez Bnrnouf, Yaena. noies, p. 76.
Voyez S a3i. ,
Voyez S 929.
VoyezS 228*. Sur tes formes latines archaïques en eis, es, voyez S 22811 j sur les formes d’adjectif lithuaniens comme gen «boni», voyez S 928b.
Védique diïnâ, S 2*34.
3 Voyez S 135, not j. ■
8 Voyez §226.
Voyez S 23a.
“ Ou pitsv-ô, voyez S a3o, où il est question aussi des formes analogues dans les Védas.
Ou tanv-6. '
111 Ou matfav-a.
On attendrait plutôt gay-ô, gav-ai-éa «bovesque», ou gâv-ô, gâv-aé-ca; mais nous avons ^ gëu, (Vendidad-Sâdé, p. a53) construit avec les neutres pronominaux tâ «ilia», yâ «quæ» (S a3i, note).
Bové-s vient du thème élargi bovi, voyez S aa6.
Voyez S a3o.
1 Voyez S a3i. ....
6 Les thèmes en ar forment les cas du pluriel, sauf le génitif, de thèmes en ru; exemples : brôthrju-», dauhtrju-s, d’après l’analogie de sunju-B. h vois dans la syllabe ru une simple transposition pour ar, avec affaiblissement de 1 n en w. .
s VoyezSa33.
Voyez Petermann, Grammaire arménienne, p. 101.
Inscription deBéhistoun, I, 79.
1 Ibidem, II, 3t.
Ibidem, I, 8.
’ Ibidem, I; 3g, 53; III, e5 ; IV, 9, 27.
1 Ibidem, I, 85.
“ Ibidem, I, 88,89.
Ibidem, III, 84, 85.
Revue pour servir à la connaissance de l’Orient, VI, p. 5A8.
2 Burnouf, Yaçna, notes, pages 6 et 7.
3 Yaçna, chap. ix; Burnouf, Études sur les textes zends, p. 188 et suiv.
Comparez Lassen (ouvrage cité), lequel traduit littéralement gâum yim éugdü-sayanëm par «regionem qiiam Çugdhæ situm». Mais il est certain que si le latin avait un article, il serait ici à sa place pour traduire yim. Je traduis, en me servant de l’article grec et en faisant du composé iugdlô-éayana un nom de pays : « regionem ixiv Sugctô-éayanam (creavi)n. Le zend gava epavs» (accusatit gâum, venant de gavëm) est du masculin : c’est pourquoi nous avons yim ktdm. Burnouf ( Yaçna, notes, p. 55) traduit le passage en question : «secundum locorumque provincia-rumque excellentissimum ordinavi ego qui (snm) Miura multiscius, terramin qua Çugdlia jacet».
Comparez S a36, et voyez Régnier, Journal asiatique, 1856, p. 269, n'“ 3o, 34.
4 Grammaire sanscrite développée, p. 807.
III, vers 12,92(1.
C’est ainsi qu’en espagnol le pluriel tout entier a la terminaison de l’accusatil
latin.
Voyez Oppert, Système phonique de l’ancien perse, p. 33.
Ou paSav-ô ; avec va : pa4vaé-ca, paiavai-ca.
Ou tanav-â, ou tanû-s; avec ca : tanvai-Sa, etc.
De gàv-as, comme au singulier gâm de gâv-am, S îaa.
Ou âjrîtay-ô, ou âfritî-s ; avec va : âfrity-ai-Sa, elc.
6 Le sanscrit pas ferait attendre {•»{» gâo (S 56 b). Mais la forme gdn-t vient du thème fort sanscrit rit ’gdu, par la simple adjonction d’un s comme signe casuel, ainsi que nous le voyons pour aiaunî-s venant de aiauni, S a38.
8 Bovê-s, du thème élargi bovi, S aa6.
7 Avec Sa : vâé-ai-Sa, S 135, remarque 3.
Voyez S a36.
8 Voyez S a3g, remarque. .
,0 Voyez S a3g. . ,
11 = duhitrî-s, venant de duhitar changé en duhttri, par m'étathèse et affaiblissement de la voyelle. (Comparez S a 3g, remarque.) : ’
12 Pour l’arménien, voyez S ai6. '
Voyez Hartung, Des Cas, p. 262.
Voyez S i43,2.
, voyez SS 4i et i35, remarque 3.
1 Voyez-S at5,2.
» Quoique nous ne le trouvions pas employé dans les textes anciens à tous les cas, j’ai choisi le thème masculin peeu, à cause de sa ressemblance avec >»»« pàiu. Vn cru pouvoir mettre ici par analogie le datif pecu-bus au lieu de la forme affaiblie peci-but.
VoyezS 226.
1 VoyezS 3i.
Sur j ail lieu de s, voyez S a i b. ' •
On a vu plus haut (S‘ aa8 *) une particularité du nominatif pluriel pronominal passer, en grec et en latin, dans la déclinaison des substantifs et des adjectifs.
5 Le * osque, du moins au milieu des mois, est un * prononcé mollement. ( Atif-recht et Kirclihoff, Monuments de la langue ombrienne, p. 107, note. )
Buttmann, Grammaire grecque développée, S 116, remarque 6. — On Voit que la désinence ordinaire ois, aïs (01-s, aïs) est une mutilation pour ot-at, ai-ai, et se trouve d’accord avec la troisième déclinaison. Il n’est donc pas nécessaire, pour l’expliquer, de recourir à l’instrumental mutilé âit (S a 19 ), auquel j’avais d'abord pensé, parce que le datif grec est employé aussi comme instrumental..
Journal de philologie comparée^, p. 118.
1 Ahrens, II, a3o. On peut regarder l’a ou l’e de àvSpdaaiv ou àvëpéaaiv comme appartenant au thème, le sanscrit no»97 «homme» étant représenté en grec par avsp, venant de dvap. Voyez S a5i.
Je restitue cette forme dont je ne connais pas d’exemple dans les textes zends.
(j.
L’ancien perse a iuvâ, uvd, avec l’allongement ordinaire de l’a final. La désinence uvd est une mutilation pour hmâ, et l’u est une voyelle euphonique que l’ancien perse insère habituellement pour empêcher les semi-voyelles » et y d’être immédiatement précédées d’une consonne (il ne fait d’exception que pour h devant y). C’est en vertu de la même loi que le thème prpnominal sanscrit sua (d’où vient, comme on l’a dit plus haut, la désinence du locatif pluriel) fait en ancien perse huva, et que tvam «toi» fait tuvam. Benfey (Glossaire du Sâma-Véda, p. 70) reconnaît dans l’d de la désinence . perse suvâ, uvd (pour huvâ) et dans l’a de la désinence zende éva, hva, une postposition ; il fonde cette opinion sur la comparaison du dialecte védique, où les locatifs sont parfois suivis de la préposition OT d. Je me suis déjà prononcé ailleurs (Bulletin mensuel de l’Académie de Berlin, mars 1868, p. 14 4 ) contre cette explication. Je'ne puis admettre davantage que le locatif singulier dahyauvd «dans le pays» (Benfey, ouvrage cité, p. 85, lit dahyuvâ) représente un locatif védique en û suivi delà préposition d. Je regarde cet d comme le signe casuel ; c’est probablement la désinence du locatif féminin, dont la forme complète, conservée en sanscrit, est dm (S soa ).
L’a dans cette forme n’est pas, comme on l’admet communément, une voyelle de liaison : il vient d’une métathèse analogue à éSpaxov pour iSapxov ot, en sanscrit, drakiyiïmi«jeverrai» pourdarkfydmi(Grammairesanscrite,S34104); ■aarpdai (comparez réjpxai) est donc pour •aarapat (comparez téaaapai). La voyelle a s’est conservée au datif, au lieu qu’elle s’est affaiblie en s dans •aaxépa, •aaxépes, etc. On en peut dire autant du datif dpvdai, où nous voyons reparaître (hors de sa place, il est vrai) la voyelle qui se trouvait primitivement entre le p et le v, ainsi que cela ressort des formes congénères pjjr, dpifr, II en est de même pour dvSpdtri au lieu de irnp-tu, qu’on peut comparer au sanscrit nr-étt, pour ttar-éu.
Comparez les formes analogues usirôhva et ksapohva, qui
Je n’ai pas d’exemple pour le locatif des thèmes zends en t; mais il ne peut qu’être analogue à celui des thèmes en u.
9 Comparez dâmahvtf, de daman.
Thème mardo (S t83\ î) = sanscrit marte, grec (3poià. Le sanscrit maria
«homme» (usité surtout dans le dialecte védique) a conservé la forme pleine de la racine; il se distingue en outre de mrtâ «mort» par l’accentuation, quoique le substantif et le participe soient originairement identiques.
Thème warasu = sanscrit varâhd.
1 Sur l’article préfixe de l’accusatif arménien, au singulier et au pluriel, voyez
237.
Mommsen,p. 80 etsuiv. Stier, Journal do Kuhn, VI, p. i43.
Quoique les mots arméniens soient tous, comme on l’a fait remarquer (§ i83b, i), masculins quant à leur flexion, ils n’ont cependant que des désinences casuelles,qui, dans les langues congénères, appartiennent en commun au masculin et au féminin : c’est pourquoi nous avons pu placer ici le thème d?i «serpent» (= sanscrit ihi, masculin) à côté de mots féminins des autres langues..,,
Contentons-nous d'indiquer ici les cas des thèmes masculins en i qui s'écartent
du paradigme féminin : de agni «feu* viennent l’instrumental singulier agni-n-â et
l’accusatif pluriel agni-n. Au contraire, pâti «maître», sdlci «ami» font à l’instru
mental pàly-â, fiüy-â, S 158.
L'instrumental singulier arménien, et, dans la plupart des déclinaisons, l’instrumental singulier lithuanien et slave, sont formés d’après un autre principe; mais nous les avons mentionnés ici à cause du remarquable rapport de parenté qu’ils ont entre eux (S t83 *, A). , ■
Voyez la note sur Qepowtotv, à la page iog.
2 Fijanda-m, du thème élargi Jtjanda.
L’o du datif ohs-ôm et du génitif ohsôn-ô a été allongé, probablement par analogie avec les formes féminines comme gêbô-m, gebô-n-ô, du thème gèbâ «don»
voyez p. 98).
Voyez S at5, a. -
De dster-s, yoyei 8 a a 6. Pour le latin mdtré-s, voye* le mémo paragraphe. Sur les formes gothiques comme dmthlrju-s; voyez S a35.
L’a final est long dans le dialecte de la seconde partie du Aaçna (S 188); la longue primitive est conservée aussi devant la particule ta.
Un exemple fera mieux comprendre ta pensée de Fauteur. Pour un Français qui forme du singulier cheval le pluriel chevaux, les syllabes al, aux font l’impression de flexions. Mais la comparaison avec caballut conduit à un autre résultat : elle démontre que al, au appartiennent au thème, et que la désinence du pluriel consiste uniquement dans la lettre x. — Tr. '
* Dans certains dialectes l'ancien a s’est conservé, par exemple en Slovène devant toutes les flexions commençant par un m, dans les trois nombres : ainsi, tulam «par le carquois». Le thème de ce mot répond au sanscrit lûna (même sens). Voyez S ao et Glossaire sanscrit, éd. 1847, p. tft6.
En écrivant le thème, je n’ai pas égard à la règle euphonique du S 92124 ; je mets, par exemple, srüdïzjo comme thème de Cp2Atl)£ nüdize «cœur» (nominatif-accusatif), quoique cette dernière forme ne soit pas autre chose que le thème modiGé d’après cette règle euphonique, en d’autres termes le thème sans flexion. C’est ainsi qu’en sanscrit vâc est donné comme le thème, quoique le é ne puisse se trouver à la fin d’un mot, et qu’il doive se changer en fc, comme au nominatif vâk, qui n’est pas autre chose, en réalité, que le thème.
hutitutioiws linguw slavicw veteris dialecti, p. 46g.
Voyez § t5i. En général, ces deux mots latins se déclinent comme en sanscrit les thèmes monosyllabiques féminins en u : nous faisons abstraction des cas qui viennent d’un thème élargi par l’addition d’un t, comme sues, grue-s (S ââô), sui-bus, grui-bns.
Sur le recul de l’accent dans les cas forts en lithuanien, voyez S 13s, 3.
9
Pour tes formes plus rares, voyez Miklosich, Théorie des formes, a0 édition, p. i4, i5. Le génitif en Oif u, dont il n’y a pas d’exemples pour sünii, se rencontre * pour d’autres thèmes appartenant à la déclinaison en ü.
Miklosich (ouvrage cité, p. 1A ) donne â rabü evaletn (thèmeraèo) la déclinaison d’un thème en 0, et un peu plus loin ( p. a 5 ) celle cpii répond dans les cas précités 4 ta déclinaison sanscrite en «. Au contraire, dans la première édition (p. 1), il fléchit _ «liait uniquement d’après la déclinaison en o.
9-
Ouvrage cité, page 468.
En j comprenant tes changements de i en e oui, auxquels sont soumis tes thèmes primitivement terminés en i. (Voyez la déclinaison du thème naiti, S a55.)
Pareille chose a lieu pour les formes grecques de même origine.
! l’ar exemple le génitif dêks-e et delà, le datif dcles-i et dêlu.
Miklosich, ouvrage cité, p. 58.
C’est proprement un participe passif qui répond au zend dd-ta «créé, fait»; 1 devrait donner en sanscrit M-tâ, mais il fait irrégulièrement hitd (S a3 ).
a Voyez S ia5, et, en ce qui concerne les participes présents en ancien slave, S 783, en tenant compte de la loi phonique mentionnée 8 92135. Au nominatif-accu-saiif-vocatif singulier neutre nous avons, par exemple, chvalan « laudans » (Miklosich, ouvrage cité,, p. 36) qui répoud aux formes comme telan. Le génitif du participe devrait faire chmhnt-e, mais on a chvalanita, par métathèse pour chvahntia, qui lui-même est pour chvalantja (S 9a135 à la fin ).
Comparez S i6», et, pour L’arménien, S i83\ h.
Théorie des formes du slave ecclésiastique, p. a35.
J Grammaire comparée des langues slaves, p. 61.
II y a aussi en ancien slave une'forme de génitif pronominal en to, à savoir HLCO tiso «cujus?» (neutre), qu’on écrit aussi teso. Mais je ne saurais plus attribuer à cette forme la même importance que dans la première édition de cet ouvrage, depuis que j’ai vu par les écrits grammaticaux de Miklosich (Grammaire comparée des langues slaves, III, p. 67 etsuiv.) que tiso, teso peuvent devenir des thèmes; en effet, on y peut encore ajouter la désinence go {cùo-go, teso-go ), et. il en dérive les datifs et locatifs bïso-mu, teso-mu, bïso-mï, ceso-mï, en opposition avec les formes plus simples tï-mu, te-mï. On peut, par conséquent, considérer cïso comme un thème pronominal composé, à la façon de bïto rquidn, qui n’est usité qu’au nominatif et à l’accusatif. De même que le second membre de celte fc me cïto, laquelle est composée, mais dénuée de flexion, répond au thème grec to et au thème sanscrit ta, on pourrait rapprocher so du thème sanscrit sa (S 345) et du thème grec ô. Ou bien encore on pourrait supposer que le s de bïso, teso provient d’un ancien t, de sorte quà 1 origine les thèmes neutres cïto et 'cïso auraient été identiques.
Le A du génitif pourrait encore être expliqué d’une autre manière. Il se pourrait qu’une nasale inorganique se fût insérée devant le s de la desinence, comme
C’est en même temps le vocatif, si l’on fait abstraction du recul de l’accent qui a lieu en sanscrit (S ao4).
s Sur la désinence ma, voyei S 923. Le 15 é précédent, qui est pour l’o du thème, paraît seulement dans la déclinaison pronominale, à laquelle se conforment aussi les mots qui signifient «deux# et «tous deux*. Au contraire, en zend, on trouve la diph-thongue yç* ai ou aV ài dans tous les thèmes masculins-neutres en a (8 921).
C’est seulement dans la déclinaison pronominale que les thèmes masculins-neutres en 0 et les thèmes féminins en a ont au génitif-locatif duel o/'-u. Les thèmes substantifs et adjectifs en 0, a, suppriment cette voyelle devant la désinence casuelle; exemples : vlàk’-u «les deux loups», pour le sanscrit vrkay-ôs, le zend vihrkay-6; vï-dov’-u «les deux veuves», pour le sanscrit vichvay-As (S 925).
Iî faut rappeler ici que 21 correspond d’ordinaire, sous le rapport étymologique, à un 3«sanscrit (S 92e).
Voyez des exemples dans Miklosich, Grammaire comparée des langues slaves, p. 15 et suiv.
.143. C’est par la Grammaire comparée de Miklosich que j’ai appris à connaître ces formes, dont je n’ai pu parler dans la première édition de mon ouvrage.
Formé comme gostij-u. On a ij au lieu d’un simple;', d’après le même principe qu’en ancien perse et en pâli (comparez S aoa).
La désinence casuelle est perdue comme avec les vrais thèmes en iexemples : gostij, noêtij, venant de gostij-ü, noètij-il.
Voyez Miklosich, ouvrage cité, p. 51.
Au sujet de X représentant* uns ou un é primitif, voyez S 92 e.
C’est ie u y a relatif sanscrit. On peut comparer l’empioi de y a en zend, où it joue le rôle d’un article (S a37 ). De même, en albanais, l’article suffixe présente au féminin un rapport frappant avec les adjectifs déterminés en ancien slave ; rapprochez, par exemple, ypua-jn « la femme » de l’ancien slave dobra-ja « bona n ( S a 8 3 ) ; à cette dernière forme répondent les formes fortes comme halb-iu edimidia», en vieux haut-allemand. (Voyez mon mémoire Sur l’albanais, p. 58.)
Gerâm-jame «in bono», au lieu de geramè-jame. A prendre les choses à Sa rigueur, gerâm n’a aucune terminaison, puisque le m est un reste du pronom annexe
On trouve aussi dobrun-jun, venant de dobrnjun-jun. (Miklosich, ibidem.) s On a aussi, sans adoucissement, dnhrii-imn.
t848. Pages 960 et suiv.
- Grirtirn, Grammaire allemande, IV, p. •I'jFk
Voyez S a55.
5 Voyez S 1 As.
La diphthongue gothique et répond à l’t sanscrit. (Voyez S 70.)
Devenue e en vieux haut-allemand; on ne peut dire si cet e est long ou brel (Grimm, Grammaire allemande, I, p, De la comparaison du gothique il
ressort seulement que, comme contraction de la diphthongue ai, il a dû être long à l’origine.
s An sujet du datif gothique blindai, en vieux haut-allemand blindéru, voyez» a88.
Voyez S a 48. Il n’est question ici que des pronoms gothiques simples, pourvus de formes différentes pour les trois genres.
Avec é pour i.
Le thème simple manvu donnerait, d’après la déclinaison pronominale, le datif manvu-mma, et non rnanv-amma, comme le suppose Grimm (Grammaire allemande, I, p. 731); de même, hardu donnerait hardu-mma, et non hardv-amma. En effet, partout où nous trouvons un a devant les désinences mma, na du datif pronominal et de l’accusatif, cet a appartient au thème ( tha-mma = sanscrit td-smâi «à celui-ci», hva-mma — kà-smâi, borussien ka-smu «a qui») : un datif hardva-mma 11e pourrait donc venir que d’un thème hardva. Au contraire, hardu-mma est formé comme le sanscrit atnû-émdi (par euphonie pour amursmâi) «à celui-là». Von der Gabelentz et Lobe ,(p. 7 6 ), pour expliquer les formes comme tnanvjamma, manvjana, admettent que l’« de manvu s’est changé en i; mais alors' on aurait au datif manv 1-mma et à l’accusatif manvi-na, comme on a i-mma «à lui», i-na «lui». Ajoutons qn’il n’y a pas de thèmes adjectifs en i, car les thèmes dé la deuxième déclinaison forte de Grimm sont terminés en ja : pour prendre un exemple, le thème midja (nominatif midji-s, venant de midja-s) correspond au thème sanscrit mâi’ya, au latin media. Si donc dans la première déclinaison adjective de Grimm le datif blind’-a-mma et l’accusatif blind’-a-na sont pour bUnd’-ja-mma, blind’-jama, dans la seconde, où
' déjà le thème primitif finit en ja, midj’-a-mma, midj’-a-na seront pour midj’-ja-mma, midÿ-ja-na, qui viennent eux-mêmes de midja-ja-mma, midja-ja-na.
Voyez S 387.
II est toujours suivi de mais : filaus mais «de beaucoup plus», par exemple Deuxième aux Corinthiens, VII, i3.
Comparez llii-sô, S a48.
Sans pronom annexe : manvu.
Par exemple tatrfutra-s «hujus filins», kim-artam «enjus causât».
a On ne saurait considérer comme flexion le changement de ko en kü, lequel es produit par l’influence rétroactive de Pi (S a84), par exemple à l’instrumental singulier, KUMMt kü-imï (pour ko-imî).
* Voyez Grimm, Grammaire allemande, 1, p. 799, d Von der Ga een z Lobe, Grammaire de la langue gothique, p. 84.
990. Tableau comparatif de la déclinaison du gothique hvar-jis et du sanscrit y as.
Je fais suivre la déclinaison complète de l’interrogatif gothique
1 Pour les cas dont il nous reste des exemples, voyez Scliutze, Glossaire gothique, aux mots hvarjis, hvàrjizüh et ainhvarjizuh. .
s II n’y a pas d’exemple de cette dernière forme; mais les formes analogues pcr-niellent de la supposer avec une grande vraisemblance.
E11 combinaison avec l'enclitique uh, qui supprime son u après une voyelle, on1 a hvar-jammê-h pour hvar-jamma-h; à l’accusatif limr-janô-h pour hvar-janarh; au nominatif-accusatif féminin hvar-jô-h pour hvar-ja, et au neutre hvar-jatâ-h pour hvar-jata-h. Le même principe est suivi par hva-s «qui?» devant les enclitiques h ou htm : hvammê-h, hvammé-hun, hvanô-h; même observation pour ain» «un» devant htm : ainummê-hun pour ainamma-hun, ainô-hun pour aina-hun. Il faut remarquer à ce sujet que l’<S et IV sont les représentants réguliers de l’d long qui manque en gothique (S 69) : l’allongement en question a pour objet, selon moi, de fortiGer la première partie du composé, pour l’aider à porter l’en,clitique. C’est ainsi qu’en lithuanien les formes réfléchies des verbes allongent leur voyelle finale devant le pronom annexe (S 476); tukô-s «il se tourne» est avec suka «il tourne» dans le même rapport que le gothique ainô-hun avec aina «una, unam». Quant à l’u du datif ainummê-hun comparé à l’a de ainamma, il s’explique par les lois ordinaires de l’affaiblissement des voyelles (comparez, par exemple, les formes latines comme insulsus, S 7) : en effet, le renforcement de la syllabe finale ne pouvait empêcher la langue d’éprouver plus tard le besoin d’alléger une autre partie du mot.
a En zend yâ, venant de ya-a.
Le mot simple serait jô, en analogie avec thô.
Nous avons dans le participe présent sant (nominatif vërëhra-fané) une formation analogue à celle de nfa-sôid s qu’il frappe»; la racine san (en sanscrit
(tan) a supprimé sa consonne finale et l’« qui reste a été traité comme s’il était la voyelle caractéristique de la première et de la sixième classe (S 109 ", 1 ).
Grimnr, Grammaire allemande; III, p. 583.
O11 trouve aussi septinta+s.
Quand j’ai traité ce sujet pour la première fois (Annales de Heidelberg, 1818, p. 48o), j’ai pris l’i pour une voyelle de liaison et j’ai divisé ainsi : obri-ter. Mais comme la préposition ob se rattache au sanscrit abi avers», on pourrait aussi diviser : obi-ter, et voir dans obi la forme primitive de la préposition. Comparez le dérivé sanscrit ab'i-tas, composé de àbi et du suffixe tas. On ne saurait toutefois ecarter absolument l’explication ordinaire, qui fait venir cet adverbe de ob et de fier, d’autant plus que nous avons dans obviant un composé de ce genre.
1 En zend antarë (844), auquel on peut joindre son analogue niitarë b dehors» (Burnouf, Yaçna, préface, p. 99), venant de la préposition sanscrite ni s «hors» : la forme sanscrite, si elle existait, serait niitar.
Comparez ni, pari, pratî pour ni, pari, prali, dans certains composés. Il arrive souvent que les formations qui ne suivent pas la voie tout à fait habituelle et qui ne s’expliquent pas par de nombreux analogues, sont mal interprétées par les grammairiens indiens. Ainsi Wilson, d’après l’autorité de témoignages indigènes, explique antâr par dnta «fin» et rd «atteindre», tandis que l'analogue, prâtar est expliqué par pra et at «aller». Je ne veux pas contester la parenté de anta «fin» et antâr «entre», car ils se rapportent tous tes deux à l'idee d’espace ; mais s ils sont de même famille, il faut les considérer comme des formes sœurs, et non faire de l’une le rejeton de l’autre.
ta.
Au lieu de ia forme thar, qu’ou devait s’attendre à trouver d’après la loi de
substitution des consonnes, nous avons dar et tar. (Voir à ce sujet § 91, 1 et 3.)
Grammaire allemande, III, p. 260.
La formation de cet instrumental serait analogue à la formation zende (S 158) etàcelle dugérondif en a y a (S 88 7); tra serait donc pour fT^T tard. Comparez les formes comme ryTOT^T matméya-trd « inter homines».
5 On traduisait autrefois cette proposition par «dans», quoiqu’il n’existe aucun
Grimm (Grammaire allemande, t. II, p. i5a) divise aft-uma, et met aussi
dans d’autres formations du même genre ie t ou ses représentants du côté du primitif. Mais il n’est pas douteux pour moi que le mot aftuma est formé de la préposition af, comme le sanscrit ut-lamâ-s « le plus hauts est formé de ut.
Voyez S 298 ", remarque. •
De sri se forment les adjectifs sri-mat «heureux, excellent» etérila (même sens), le comparatif sréyâns (forme faible éréyas) «melior» et le superlatif Méia «opti-mus» viennent de l’un ou de l’autre de ces adjectifs. Sur la suppression des suffixes du thème positif devant les suffixes de gradation, voyez S 298 *.
a La forme sanscrite est pratamâ'.
Grimm, Grammaire allemande, 11, p. 15s.
Le borussien anfar-n (accusatif antm-n) signifie aussi bien «autre» que «deuxième».
Compareï tes formes archaïques tnajâsibus, meliôsibos dans Feslus.
On appelle suffixes taddhita ceux qui s’adjoignent à des mots déjà formés, par
opposition aux suffixes qui, en s’ajoutant immédiatement à la racine, forment les mots primitifs. 1 '
Observations sur les mots zmds et sanscrits Vahista et Vasichtha, p. sa.
Grammaire grecque développée, 867, remarque 3, note.
8 Grammaire allemande, III, p. 65A. •
II y faut joindre l’adjectif dâkéa, qui s’emploie seulement dans le sens figure ttaplus, liabilis, reclus, probus», mais qui est évidemment de même famille.
Nouvelles Annales de philologie et de pédagogie, 1. LXVIII, p. aA5.
Voyez Système comparatif d’accentuation, p. 4a.
Sur fe recul do l’accent dans les comparatifs et superlatifs de la deuxième formation, en sanscrit et en grec, voyez S io4 •, remarque a, et Système comparatil d’accentuation, S »4.
Racine prî, suffixe a, avec changement euphonique de 1t en iy ; comparez S aoa.
Le superlatif biï-y-îéta a un y euphonique devant le suffixe superlatif conservé intégralement (S 43).
Racine gyd «vieillir».
4 Vojez Benfey, Glossaire du Sâma-véda, s. v. nava, et Grammaire sanscrite développée, p. 928.
Par son ê, qui provient d’un redoublement (= <1 + a, S 69, a), èt-ei-ma appartient au prétérit.
Cette suppression complète de la sifflante s’explique par la répulsion que le groupe va inspire au grec, excepté dans quelques formes dialectales, comme ai6evs-, c’est pour la même raison que nous avons -£iiv en regard du thème sanscrit hansa, en gothique gansa, en latin amer.
a Voyez8 lit).
a Voyez S 38. -
On aurait pu s’attendre aussi à avoir màhyasi (S 298 b).
De là l'instrumental Uraaéd-yéhya. (Voyez Burnouf, Eludes sur les le.vies zends,
p. ai9.) _
5 Par euplionie pour valut (= sanscrit visu). (Voyez S 3a.)
Voyez S 19.
Par exemple ÇsCx-eri-î pour le sanscrit yük-U-s «union», au lieu que nous avons Çsox-to-s = sanscrit yuk-tâ-s «lié».
Le positif est (Buttmann, Grammaire grecque développée, S 67, remarque 3 ). C’est du reste le seul comparatif de cette espèce.
i3
De même ma-jor pour mag-ior, ftet-{av pour fiey^jav, S 3oo.
* Thème mikila; comparez psyaAo. Le k est conforme à la loi de substitution des consonnes (S 87, 1). L’a primitif s’est affaibli en i.
Voyez Grimm, Grammaire allemande, III, p. 58g et suiv. C’est dans les An
nales de critique, scientifique (1827, p. 76a ) que j’ai montré pour la première fois la présence en gothique de comparatifs adverbiaux en is. Grimm a reievé un certain nombre d’autres exemples, qu’il explique comme moi, après avoir d’abord considéré une partie de ces formes comme des génitifs (Grammaire allemande, III, p. 88).
i3.
Voyez S 69, 1.
Comparez le sanscrit b<ya» «fortius», venant de bâlavcmt ou balin (S ago").
n’y a qu’un petit nombre de comparatifs, principalement ceux dont le positif est inusité, qui suivent l’analogie do bolij, féminin bolUi, neutre bolje.
Grimm a déjà indiqué cette analogie (Grammaire allemande, III, p. 655,note).
Mais il s’arrête à une autre explication et rapproche êsnts du latin issmus (comparez
3298").
s Voyes la première édition de cet ouvrage, S 3o6.
Voyez mon mémoire Sur la langue des Borussicns, p. a3.
Voyez Schleicher, ouvrage cité, p. i48. Ruliig et Mieicke écrivent gerâuias, gcràusa.
a II faut diviserde cette façon : massa-is. Au lieu de tout»,on s’attendraità trouver toûla-is, du thème adjectif toûla, nominatif-accusatif neutre touîa-nemultum» (voyez mon mémoire Sur la langue des Borussiens, p. a3 et suiv.). La racine est peut-être rf tu «grandir», d’où vient le védique tuvi «beaucoup».
Comparez Pctermann, Grammaire arménienne, p. i48.
Voyez S i83\ i. ,
C’est au nominatif guin et non au thème g uni que vient se préposer cet a. Le thème positif, qui forme le premier membre du composé, est mis au nominatif; il supprime quelquefois la voyelle de sa dernière syllabe.
Le thème est imastuno, par mutilation imastno.
3 Le thème contracté est basma, pour basuma (comparez le sanscrit bahu «beaucoup»). _
Voyez Petelmann, Grammaire arménienne, p. iipetsniv.
Bhagavad-Gitâ, II, ai. .
s En lithuanien et en slave, te pronom interrogatif combiné avec une particule négative préfixée prend la signification «aliquis»; exemple : lithuanien Mas «non aliquis, nemo», ancien slave ni-kü et nt-kü-to (même sens). . .
La diphlhongue sanscrite «' se prononçait ai à l’époque de' la séparation des idiomes (S a, remarque). En conséquence, si le nom de nombre grec est identique avec le démonstratif prr êna, Ve représente seulement le premier élément de la
Voyez Glossaire sanscrit, éd. 1847, p. 067.
5 Comparez les formes grecques comme pel^eo, venant de peilova.
Le féminin smî, comme pronom annexe, a perdu son m en sanscrit (S «74);
La forme étant monosyllabique, on devrait s’attendre à avoir tvô (S ss3i). Au génitif masculin-neutre, je supposerais tvi-sê, d’après l’analogie de tht-çe «borum», venant de tha; ou tvakê, d’après l’analogie des adjectifs forts (S 287); ou Iv’-é, d’après la déclinaison ordinaire. Mais au Heu de ces formes on trouve «duorum» rendu par tvaddjê, d’où il ressort qu’au temps d’Ulfilas le génitif du thème tva n’était plus en usage. La forme tvaddj’-é appartient à un thème tvaddja (comparez harj’-é, venant de harja); tvaddja semble être un nom de nombre ordinal (comparez le sanscrit dvi-tiya pour dva-tîya) qui s’est introduit parmi les nombres cardinaux. Si l’on rejette les deux d, dont l’un est d’ailleurs inutile, on a, par suite de la vocalisation du j, le vieux haut-allemand zueiô (zœeiâ), dans Isidore zueijâ, comme on a fior venant de fidvâr. La forme forte zueiérâ répondrait à une forme gothique tvad-djaisê : je ne saurais souscrire à l’opinion de Grimm qui suppose en gothique des formes tvaijê et tvaiaisê. Le norrois, changeant la moyenne dentale contre la gutturale, dit tveggja pour le gothique tvaddjê. A l’accusatif pluriel féminin, on trouve en gothique tveihnâs à côté de tvâs, ce qui suppose un thème masculin-neutre tveih-na, féminin tvcihnô. C’est à tveihna que se rapporte, en vieux haut-allemand, le nominatif-accusatif zwênê, avec perte de h. Le féminin, en vieux haut-allemand, est exempt de ce surcroît; il fait au nominatif-accusatif zwô ou, par abréviation, zwa
Grimm, Grammaire allemande, l. II,p. 956.
8 Voyez S 77, et comparez Ai'o (qu’011 écrit aussi diu) «valet», génitif diwe-s (thème dtwti).
VoyezS3io. *
Comparez mon mémoire Sur les noms de nombre, dans le Recueil de l’Académie de Berlin, 1833. Je ne crois pas qu’on puisse, pour l’explication étymologique des noms de nombre, tirer des arguments de leur représentation graphique. A l’époque où ont été iuventés les chiffres, la signification originaire des noms de nombre était déjà trop obscurcie pour avoir pu guider les créateurs des signes figurés. Si les Égyptiens représentent le nombre «quatre» par le chiffre «un» plus le chiffre «trois», c’est là, selon moi, une rencontre fortuite entre l’écriture et le langage (voyez Lepsius, Deux dissertations de grammaire comparée, p. 90). Les Perses figurent «quatre» par lechiffre «deux» répété; «quatorze» secrit 1 •
Voyez Miklosich, Théorie des formes (a’ édition), p. kg, où sont énumérées les formes irrégulières. Le nominatif masculin-féminin a une forme secondaire cetür-e, qui vient du thème non élargi par l’adjonction d’une voyelle, et répond au grec i&o-tjap-gjf et au masculin sanscrit batvffr-as.
Comparez le nom de nombre ordinal cetvriilü «quatrième». '
Penki est la forme du masculin, pènkios celle du féminin; ils sont entre eux dans le même rapport que keturi et kéturiôs (S 31 a ). La même observation s’applique aux nombres «six, sept, huit, neuf»; nous donnerons seulement le masculin.
On le trouve toujours non fléchi ; le thème décliné aurait probablement le complément inorganique i, comme fidvôri, et comme en vieux haut-allemand les noms de nombre de «six» à «dix». En gothique, saihs «six», sibun «sept», ahtau «huit» et taihun «dix» ne nous sont connus que par des exemples non fléchis, conséquemment privés de l’i inorganique. Pour niun «neuf» nous trouvons le génitif niun-ê, qui, à la vérité, pourrait venir aussi d’un thème niun ou niuna, mais qui, comme je n’en doute pas, a muni pour thème.
Le thème esl panti et est fléchi comme noili (S a55). lia les désinences du singulier, en sorte qu’on doit considérer ce nom de nombre comme un collectif féminin, auquel le nom de l’objet compté vient se joindre, au même cas comme apposition. La même observation s’applique aux noms de nombre de «six» à «dix». En comparant l’ancien slave panti au sanscrit pniican, on remarque que la première partie du mot sanscrit esl la seule qui se retrouve en slave; la syllabe fi est un suffixe dérivatif, comme dans les thèmes êcsli «six», devanli «neuf» et desaiiti «dix»; c’est le même suffixe que nous avons dans les nombres multiplicatifs sanscrits viiiiil «vingt», «o&t'« soixante», etc.
il.
Compare» Lepsius, Deux Dissertations de grammaire comparée, p. 115.
a En ce qui concerne te h arménien tenant la place d’un p, comparez, par exemple, taira père».
Sur l’expulsion d’une voyelle médiale dans la deuxième série de cas, et sur la suppression de la voyelle finale dans la première série, voyez S a3y, 3.
if>.
Dééimtis est un collectif féminin singulier, comme en grec le motééxas, et il se construit avec le nom de l’objet compté au génitif. Il est formé à l’aide du suffixe abs
trait ti (S 841 ). Il en est de même du slave desantt et des autres nombres cardinaux simples, à partir de nATk pantl.
Dans son écrit intitulé : Deux Dissertations de grammaire comparée, p. ia3.
Da serait donc pour dva, lequel est, comme nous l’avons vu plus haut (S 3oçi), la vraie forme du thème.
Voyez Lepsius, écrit cité, p. 116. Je fais, par conséquent, de dàéan un composé collectif dans le sens de «deux pentades».
Le m du latin de-ce-m n’a rien de commun avec le n final de dttian : il provient, comme le tn de scpjtc-vi et dè novc-w, du suffixe ordinal.
Me-tasan est pour mi-tasan. Le second a de tasan est conservé en composition, an lieu qu’il a été supprimé dans le mot simple (fosn). Ces composés arméniens possèdent à la fois la déclinaison du singulier et celle du pluriel; ils élargissent leur thème en n par l’addition d’un », et font, par exemple, à l’instrumental singulier mê-tasani-v, à l’instrumental pluriel me-tasani-vq. A partir de «dix-sept», on msere ev ou ni. u «et» entre le plus petit nombre et ton «dix»; exemple : evtnevtasnou evinulasn «dix-sept». Ce mode d’expression peut même être employé à partir de
«onze».
Venant de wênô-diku.
11 n’y a pas d’exemple de ce nom de nombre que j’ai rétabli par conjecture.
Venant de tridecim.
* D’accord avec Benfey (Lexique des racines grecques, II, p. a 13), je regarde tpu comme une forme mutilée pour tpeïs; la surcharge amenée par la composition a elo évidemment la cause de cette mutilation.
La conservation du d vient évidemment de ce que le premier nombre finissait par un r, qui s’est assimüé au d suivant. Il est vrai que ce premier d n’ex.ste plus en indoustani, mais on le retrouve en bengali et en prâcrit, où nous avons cauddo; d’ordinaire le bengali change le d de daêa en r et supprime la seconde consonne; exemples : êaâro «onze», bâro «douze», téro «treize».
a Cette forme mérite une attention particulière, en ce qu’elle se rapproche ent ore plus que les autres du Uka lithuanien et du lif germanique. La forme bengal.e est solo.
Les noms de nombre zends en sata se rencontrent ordinairement à l’accusatif singulier (éatèw), de sorte qu’on pourrait admettre aussi bien sat comme thème. Mais le nominatif singulier panéa sutërn «cinquante», qu’on trouve au septième chapitre du Yendidad, prouve bien que le thème est sata et qu’il appartient au neutre. De Ksvasti «soixante», haptditi «soixante-dix», navaiti «quatre-vingt-dix», on a les accusatifs lisvastîm, haptârtî/n, navaitim. Toutefois, au douzième chapitre du Vendi-dad, on trouve à l’accusatif vliaiti, ce qui est peut-être une forme de duel neutre pour viiaiti « deux dizaines» (S aïo). Mais si cette hypothèse n’est pas fondée, il faudra considérer vîèaiti comme un singulier neutre. Ajoutons qu il est surprenant que cet t final nous ait été conservé dans efxari, viginti, au lieu qu’à toutes les autres dizaines on ne trouve pas d’t final en grec ni en latin.
a Ce nombre et le suivant sont des formations nouvelles, dans lesquelles on a fait entrer abusivement le nom de nombre ordinal. On devait s’attendre à avoir eirliixotnct, ôxif^Kovtct, comme on a, en effet, l’ionien ôyStbxovnx. Dans éi/cinjKovTa, les deux v ont été Séparés à tort, ou bien le second v de è-vev représente le h final du thème
Comparez Pott, Recherches étymologiques (1” édition), Ii,p. 217. Suivant les lois phoniques ordinaires du sanscrit, une dentale suivie d’un s se change en c; mais c'est là une règle de date plus récente que les composés dont nous nous occupons, qui sont antérieurs à la formation de la palatale é (S a 1 *). Il ne faudrait d ailleurs pas supposer que la syllabe da de (dcijéati se soit changée en n ou n sans transition; elle sera d’abord devenue nu, dont il n’est resté que la nasale. Nous devrions donc admettre pour une époque très-ancienne des formes comme dvi-nakati, et c est ce nu qu’il faudrait rapprocher de la syllabe ru dans le prâcrit bdralm «douze».
Au sujet de l’a tenant la place de l’S, voyez § ô. La voyelle qui précède le p a
16
Miklosich, Théorie des formes, a* édition, p. 83.
3 Voyez Schleieher, Théorie des formes, p. 190.
Exemples : noite-mü, nosle-chü, mile-mi, noitï-ma, noitï-mi. Sur le principe qui préside à ces changements, voyez S 377.
Si l’on ne considère que la forme, les accusatifs pluriels sanscrils asmXn, yvs-mâht nousfftyfius », et, dans le dialecte védique, les nominatifs pluriels asmé', yuimé' sont des m||i|îm8 (SS a36 et 33a ).
s II y a cette différence entre les pronoms ahdm, tvam , et les autres nominatifs pronominaux en am comme aÿ-dmécèlui-ci», iy dm «celle-ci» (S 366), svay-âm «ipse» (S 34i), vay-dm «nous» (S 33i), yû-y-dm «vous» (§ 33b), que dans ces derniers l’n appartient à la désinence, tandis que dans ahu-m, tva-m, il fait partie du thème. Le vrai signe casuel est m, qui est peut-être de même origine qné le m du neutre dans la déclinaison ordinaire et dans ki-n 1 «quoi?». Devant ce m on insère encore un a quand le thème ne se termine pas par celte voyelle. Un fait analogue a lieu dans lu conjugaison : à la première personne du singulier des formes secondaires, on a, d’une part, la désinence tn, par exemple dans dbm-a-m «je portais» (è®ep-o-v),
Voyez Fr. Windischmann, Sankara, p. 73 et suiv. et Benfey, Glossaire du
Sâma-véda, p. 206. ' '•••
5 Rapprochez aussi le pluriel mûnga «nous», dont la première partie est un reste de l’accusatif sanscrit asmêii «nous».
Voyez mon mémoire Sur la parenté des langues malayo-polynésiennes avec les idiomes indo-européens, p. 12, 79 et suiv. 83, 108 et suiv.
Iliade, VIII, 37. .
La longueur de H dans meî, lut peut s’expliquer par la fusion de F* renfermé dans mê, *«<?(= mai, mi) avec i’i du locatif. En regard de sut, on devrait avoir en sanscrit svay-i : cette forme a dû exister, en effet, à l’époque où le pronom réfléchi sanscrit était encore déclinable. [L’auteur admet plus loin la possibilité d’une autre origine pour les génitifs met, tuî, sut. Voir S 3fto, remarque. Tr.]
Comparez fructi-bus ponr /i'in'(u-fc«*.
Voyez, par exemple, Rosen, Rigvedm specimen, t83o,p. 26. a De son côté, le datif a très-fréquemment, en sanscrit, le sens d’un génitif. ,
C’est ce qui a lieu très-souvent en arménien, par exemple dans le thème numéral wian «neuf» (8 3»7).
s Voyez S aa6.
Comparez q-tan «vingt», où la dentale initiale est tombée de la même façon.
Mémoires de l’Académie de Berlin, 1896, p. i3A.
On a vu (S 166) que le thème gothique misa ou mti est une mctathèse pour
L’auteur veut montrer comment nâu a pu passer du sens de «moi» mis au duel au sens de « moi et toi, moi et lui ». — Tr.
Vâu est pour tvâu, de même que nous avons â-và'm «moi [et] toi» (S 330) pour â-tvâu, et yu-vfân «toi [et] toi77 (S 33fi) pour yu-tvau.
Venant de tFo), comme crtî de -rtf (SS 19 et 31\ 1 ).
C’est vai, oÇiiïï qui est ta forme primitive, et non va, trÇà (pour va, oÇip). Comparez les possessifs vahepos, oQahepot.
* ïh pronomine grdeco et latino, p.' 94. Schmidt croit devoir admettre que la désinence neutre 1 est venue se surajouter à la désinence masculine va, aÇ>a. Mais c’est là une hypothèse superflue, car nous venons de voir que le vrai thème est vu, a<pa.
Comme exemple d’un 1 représentant un a primitif, nous citerons l’éolien ’alavpes = sanscrit éatvXrai (dans la langue ordinaire téaaapes).
Bultmann, Lexiloguf , I, p. 5a.,
Sur ta désinence casuelle £ , au lieu du g i ordinaire, voyez S a 15, 2.
Le l appartient évidemment au nombre «deux» (thème tya). En lithuanien,le nombre «deux» est exprimé & tbns les cas. En cè qui concerne le thème, compare*
le nominatif pluriel vei-a. .■•■■■■ \ . <<
* Voyez S 339. On devrait, d’après l’analogieries cas obliques, s’attend*;* i*wr né, ou bien encore mé d’après l’analogie du nominatif pluriel. Par l’amefflasental
Voyez S 335; Sur le thème secondaire Usma on üsama, qui n’est usité qu’aux cas obliques', voyez S \83 \ 9, et Brockhaus,Index du Vendidad-Sâdé, p. a5o et suiv.
2 Pour la forme ^ vë, voyez S 3t. .
3 Voyez S 167, et, eiï çé qui concerne la désinence, 8 34o, page 980, note 9.
Si l’expfication que nous proposons ici était fondée, il faudrait renoncer au rapprochement que nous avons fait précédemment (S 327) entre meina, theina, seina et les génitifs sanscrit et zend mdma, mana «de moi».
s Cette explication de <rà-s me paraît plus vraisemblable que celle qui fait venir aâ-s de oüv.
Comme pluriel de mêrâ «meus», térâ «tuus», nous avons hamârâ «noster», tumhârd «vesler». Remarquez l’accord qui existe entre le suffixe formatif râ et le suffixe gothique ra dans umara, isvara, duel unkara, inqvara. De plus, il y a mé-lathèse dans l’une et l’autre langue : de même que l’indoustani tumhârd est pour tnhmârâ, venant de tüsmdrd, de même, dans le gothique unkara, unsara, inqvara, la nasale a été transposée (S 167 etsuiv.).
Voyez Poil, Recherches étymologiques, i" édition, t. II, p. 637-
i C’est l’hypothèse de Butlmann, Grammaire grecque développée, 5 79, 5.
1 Par ces derniers mots, l’auteur entend un pronom qui ne soit pas possessif Les pronoms possessifs sont des «adjectifs pronominaux» (S ho h ). — Tr.
1 On trouve aussi x)N) sê. Voyez S 55. A ces formes je crois pouvoir ajouter l’accusatif hanm, qui n’est pas seulement employé comme préposition dans le sens de «avec» (S 101 h), mais encore comme pronom personnel réfléchi, dans le sens de «semetipsum». Voyez, par exemple, Vendidad, fargard xix, verset 69 (éd. Spiegel), où nous avons: vShu-manô hanm railwayêiti «Vôhu-manô se souille». Spiegel traduit comme si hanm était la préposition et il sous-entend le pronom réfléchi. 11 est vrai que, dans certains passages, hanm raxtuoayêiti semble signifier simplement «il souille»; mais le verbe doit être pris dans le sens causatif, et il faut traduire : «il fait se souiller». De même, l’expression hanm raitwtm (fargard xix, verset ho) doit
Comparez le zend hâté pour hvatâ,
Voyez Glossaire sanscrit, éd. 18/17, p.
Sur IV = a, voyez S 6(>, a.
Rapprochez, en zend, les instrumentaux des noms polysyllabiques (8i58), avec l’a desquels nous avons comparé l’u des instrumentaux en vieux haut-allemand (S 160). — Je'ne voudrais pas considérer le gothique sva (ancien haut-allemand sâ) comme un neutre, d’après l’analogie de hva «quoi?», parce que le pronom réfléchi auquel je le rapporte ne fait point, à l’origine, la distinction des genres.
• '9-
Schroder ( Thésaurus, p. g5) donne iur comme pronom possessif.
3 La syllabe me représente le sanscrit smât (S 183", h).
Aucher, Dictionnaire abrégé. C’est un composé possessif(S 976), car S-jfu lin (thème lini, par contraction \ni, instrumental lni-v) signifie «naissance» (racine gan «engendrer, mettre aü monde»).
Voyez S 341.
Voyez S i5g.
La contraction de qoan en qen vient évidemment de ce que la désinence casuelle forme, à elle seule, une syllabe. Sur la désinence ablative ê après un thème terminé par une consonne, voyez S 183 *, tl.
Appelés par les grammairiens de l’Inde avyayîblidva.
Comparez vjet, vjerir «année», vjsràép «qui dure Tannée», avec le sanscrit valsa-1, vatsarâ-s «année». (Voyez mon mémoire Sur l’albanais, page a et remarque 56.) Le mot simple pour «jour» est She.
1 Sô vient de sas, d’après une règle phonique d’une application générale eu sanscrit, par le changement de s en u et la contraction de a u en 0 (S 3).
En supposant que asâù ait pour thème asti, avec la gradation du vriddhi. Cette hypothèse tire de la vraisemblance de la comparaison du thème des cas obliques amu, lequel est terminé également par un u (S i56); elle est appuyée, en outre, par le pâli, où nous avons au nominatif asu, sans vriddhi. .
Voyez S i5g.
Voyez S i65.
•1 Voyez S 170.
Voyez S 173.
Voyez S 267. .
8 Voyez S i83*, 3.
On pourrait aussi s’attendre à trouver woy-"f lanhê, f tainlie, d’après
l’analogie de km»* anhê et ainhê, qu’on trouve assez fréquemment à côté
de M (venant du thème a). (Voyez SS I> 1 et 56\) •
Voyez S 269. \
e Voyez SS 178 et 197. '•
Voyez S 267.
Voyez S i55 etsuiv.
14 Voyez S 157.
Comme le to grec, le io slave et les neutres pronominaux analogues s’expliquent par la suppression d’une dentale finale, tandis que les formes substantives et adjec-
tives en 0 (à l’exception des, thèmes en », comme nebo, venant de nebes) ont perdu
une nasale qui s’est conservée en grec. (Voyez S 92 ".) ,
Voyez S 17A. .
Voyez S 966. .
Voyez S 174.
Voyez S 175.
Voyez SS 971 et 975.
Voyez S aoa.
Forme védique, voyez S 308.
* Voyez S s a». ,
» On pourrait s’attendre à trouver la-m-àwa-m, d’après l’analogie de ptna-m. Mais les thèmes pronominaux et le thème numéral dwa changent leur a final (= slave 0) en è (qu’on écrit ordinairement ie) devant le m de la désinence casuelle; ils s’accordent en cela avec l’ancien slave, qui substitue dans cette classe de mots un * ê A l’o des thèmes substantifs et adjectifs en 0 (S 973).
111 Voyez S 373.
Voyez S 373. v
Voyez S sia.
" Voyez S 978. •
Voyez § a34.
a Voyez S a3i.
Voyez S aa8“.
Comparez la forme ânnhanm rvhnrumn (S 56b), sanscrit, tisâm, du
thème â. En zend, les thèmes polysyllabiques abrègent l’a féminin au génitif pluriel; on a, par conséquent, en regard du sanscrit êtàsâm ttharum» la forme aitanhanm (S 56*) et non aitâonlianm.
Voyez S 375.
La forme thaim a pénétré des autres genres dans le féminin, pour lequel on aurait dû s’attendre à trouver thôm : au masculin-neutre la diphthongue ai a, au contraire, sa raison d’être.
La forme THX2 téchü, au locatif comme au génitif, a pénétré des autres genres dans le féminin, qui devrait faire ta-chü, d’après l’analogie du locatif des substantifs comme vidova-chü (§ 379). De même, à l’instrumental et au datif, les formes tê-mi, Ul-tnii ont pris la place du féminin la-mi, ta-mü. A l’instrumental pluriel masculin-neutre, tê-mi s’accorde avec les instrumentaux védiques comme Asvé-Vis (S 319) et
30
Sur la forme neutre daz, soyez S 356, remarque 1.
Dim est la forme employée par Notker.
a L’instrumental tyâ ne se trouve pas dans les inscriptions qui nous ont été conservées. Mais lyâ serait conforme à vasnd «par volonté» du thème vaina, ainsi qu aux instrumentaux védiques et lends dont il a été question au S 158, avec d = « + «■ -Sur tya employé comme article en ancien perse, voyez S 937, 3.
Dans Tatien, Aie; même forme en vieux saxon. Ce nominatif Aie est privé de signe casuel et correspond au thème sanscrit tya. Le signe du nominatif peut être supprimé aussi dans le dialecte védique et le s initial de *ya peut se changer en i sous l’influence euphonique de la voyelle finale du mot précédent ( compares S a i )•
a Ce dernier dans le diaiècte védique, S a3/i.
s Ce dernier serait, comme on vient de le dire, la forme régulière en ancien perse.
Voyez 5 35â.
C’est aussi la forme usitée en moyen haut-allemand.
Dans une période plus ancienne, la consonne finale a dû être encore suivie d’une voyelle, comme en gothique au neutre pronominal (tha-ta, i-ta). Autrement,
la consonne n’aurait pu se maintenir (S 86, 2b).
Grammaire allemande, I, p. 792.
3 II est difficile de dire si l’e de cette forme provient de Pi ou de l’a. Dans le premier cas, il faudrait, suivant l’orthographe de Grimrn, écrire e (thet). Ce qui me paraît certain, c’est que cette forme ne se rattache pas au sanscrit tat et au gothique tliata, niais au sanscrit tyat.
Pour thi-s, venant de ihji-s.
L’allongement est occasionné par l’accent , comme dans l’allemand moderne liege (prononcez %) «jaceo» , en vieux haut-allemand ligu, en moyen haut-allemand lige. De même, en lithuanien, un a ou un e s’allongent sous l’influence de l’accent.
D’après l’analogie de den. Voyez S 356.
Voyez ta déclinaison de ce thème au S a8a.
a Comparez konï ttequus, equum», du thème konjo.
Dans sijun, sejun et tes formes analogues, l’i ou t’e qui précède le J est, selon moi, purement euphonique : il sert à empêcher la combinaison immédiate de la sifflante et de la semi-voyelle. Un fait analogue a lieu dans la déclinaison des thèmes en i; comparez, par exemple, les formes comme gostij-u, noétij-u (S 3^3), noitij-un (voyez ci-dessus,*11, p. too) et gostij-e (S 97/1). An génitif-locatif duel des trois
Voyez Annales de critique scientifique, i836,p. 3u. — Aux exemples mentionnés ci-dessus, on pourrait encore joindre la syllabe pen, dans bolapen «ciel», comparée au sanscrit svàr (même sens). .
- Voyez mon mémoire Sur l’albanais et ses allinités, p. 78. Remarquons encore
a 1 .
Après un comparatif, itâs remplit aussi le rôle d’un ablatif.
Littéralement «près de ce» avec l’idée de lieu sous-entendue.
2 Nieht vient de ni-miht, en gothique ni-vaihle.
Annales de Heidelberg, 1818, p. 47 2 ■
Voyez le Dictionnaire sanscrit de Wilson.
:l Pour les dérivés adverbiaux i-terum, i-Utrn, i-ta, voyez SS 36o et Aa5.
L’auteur s’écarte ici de l’opinion qu’il a exprimée dans la première édition de la Grammaire comparée. Il rapportait les formes comme eum à un thème eit, plus anciennement Ü, forme du thème pronominal i par l’addition d’un S inorganique, et transporté de la sorte dë la troisième dans la deuxième déclinaison. — Tr.
Jo-lc est pour iod-h, le d ne pouvant se maintenir devant le h ( Mommsen, Les dialectes de l’Italie méridionale, p. 26/1 ).
II n’y a d’exemples que pour l’accusatif; mais il est probable que le nominatil
était semblable (Grirnm, Grammaire allemande, 1.1, p. 785), à moins qu’il ne dérivât du nominatif singulier si, et ne fit sjâs ou sijâs. *
La conclusion n’est pas rigoureusement nécessaire, car nous trouvons 1 espn rude au commencement de certains mots qui, à l’origine, commençaient par une voyelle pure. Comparez, par exemple, èxérepos avec ^JTrTpT êlmtarâ-s. De sou côté, la leçon î ne nous conduit pas nécessairement au thème ^ i, car un « initiai a quelquefois absolument disparu en grec.
Essai sur le pâli, p. 117- ■
2 En sanscrit, cet ablatif a dû être tasyât, et, plus anciennement encore, tasmyat.
Comparez les formes zendés comme avanhââ. «ex hâc* (S 180).
La syllabe longue a été abrégée et vice versa.
Comparez Hartung, Des particules de la langue grecque, II, p. 96. Hartung décompose le mot comme moi, mais il voit dans nam le sanscrit nâman «nom».
* Noyez J, Grimm, Grammaire allemande, III, p. 756.
Comparez mon mémoire Sur les langues celtiques, p. 33-33 et p. 8a.
Le même fait a eu lieu pour les noms de nombre dont le llième finit en sanscrit par un n ( excepté pdAian, au sujet duquel je renvoie au S 313 ) ; ce n a été joint en irlandais au mot suivant, quand celui-ci exprime l’objet compté (voyez le mémoire cité, p. a3). Devant une labiale, au fieu de n on met un m.
11 en est dfe même pour le t et le m qui sont les enclitiques de la deuxième et de la première personne; exemples : dil-e-t «cor tuir, dil-e-m «cormei».
5 La nature pronominale du latin in ressort encore clairement dans indu; quant à iv-Ba. év-Osv, ils expriment les relations marquées par le locatif et l’ablatif.
Devenu en allemand moderne elmd «misérable». — fr. — ,
= Il y a en allemand des locutions où ander est employé par euphémisme au heu d'un mot triste ou fâcheux. Mir wird ander* «je me trouve autrement», p’ès^à-dire «je me trouve mal»; leh UtterbaU was anders gesagt «j’allais dire autre chose» (quelque chose de désagréable). Ce sont peut-être ces locutions qui opt conduit 1 au-
teùr à rapprocher perperam de pâra. — Tr. -
Rapprochez aussi, en grec, l’emploi de fflw, qui semble quelquefois former pléonasme Oh; observe des faits ; analogues en sanscrit 'Ainsi dans-ùn f. assage du Nala (I, Wi) nous trouvons laiphrase suivante :'«Ni parmi!les dieux,mi parmi es
Yakshas, ni parmi les oUWs hommeSyiinéitellê beauté n’a étéjamais vue ni cèle ree jusqu’à présent». Ici les hommes sont; oppcisés. A toutle reste des êtres comme» es autres». '• \ ...... “ '
». Sans cet amollissement, affero, venant de abfero, serait identique avec affero,
venant de adfero; le besoin d’éviter cette équivoque a p i déterminer le changement en question. On sait, d’ailleurs, qu’il y a entre le b et l’« une affinité particulière : nous avons un exemple du changement inverse dans bis, dont le b représente Tu de duo. Une fois que, pour éviter la confusion, au fut sorti de ab, au a pu s’introduire dans des mots (comme aufugio) où il n’avait pas la même raison d être.
2 Comparez Benary, Annales de critique scientifique, 183o, p. 76A.
3 Après là suppression de la voyelle finale, nous aurions, en zend, h- au et, en
Les grammairiens indiens admettent sans nécessité, pour ces deux adverbes, un suffixe rhi; ils divisent donc : étii-rhi, hd-rhi.
En allemand moderne dar, qui se trouve, par exemple, dans immerdar « toujours» , darbringen «offrir», darstellen «représenter». ,
■’ Comparez, en allemand moderne, war-um «pourquoi?», wor-aut «d’où?».
Je m’écarte sur ce point de l’opinion que j’avais exprimée autrefois dans mon
mémoire De l’influence des pronoms sur la formation des mots, p. 3.
Ainsi vat «parler» fait au participe passé uktd.
Racine sanscrite saé «suivre».
Je ne crois pas qu’il faille diviser ainsi : alic-ubi, alic-unde, et admettre comme premier membre du composé le mot aliqui. Les adverbes en question renferment simplement le mot ali (forme mutilée pour aliS), qui est aussi le premier membre du composé ali-qtiis.
a 4.
Si l’on fait abstraction de la syllabe dérivative tra, la syllabe initiale gis représente assez bien le sanscrit hyas. On trouve gistra-dagis dans Ulfilas (Matthieu, VI, 3o); mais il y signifie «demain». [C’est probablement une erreur du traducteur gothique. — Tr.]
Voyez S 352. Les grammairiens indiens admettent pour ces formations un suffixe dérivatif Myus, qu’ils n’expliquent pas autrement.
Cet affaiblissement s’expliquerait par la surcharge résultant de la composition et par le fréquent emploi du mot.
a Recherches étymologiques (t" édition), p. 108.
Comparez S 345.
1 En allemand moderne, hcuer.
O11 vient de voir (SS 387, 389,390 ) que quis emprunte ses cas à deux et peut-être à trois thèmes différents. Le même fait a lieu pour hi-c : rapprochez, par exemple, hi-c de qui, hujtu de eujus, hos de quos. — Tr.
s On a eu plus haut (S 391) un exemple du même fait, en sanscrit, pour la particule hi dérivée du même thème interrogatif ki.
Ci-tra est formé comme ul-tra, qui vient de «Me, olle, avec suppression de le. Ci-e est formé comme ul-s, dont le » est peut-être de même origine que le suffixe locatif 0i en grec, (œd-0/ etc.). On peut comparer, à ce sujet, le rapport de
Le moyen haut-allemand hiure suppose, en vieux haut-allemand, hiuru.
3 Comparez aussi le latin homus, qui, selon toute apparence, renferme également un pronom démonstratif accouplé au même nom de l’année dont le zend yârë nous a prouvé l’antiquité (S 3g 1).
Pour heint.
Voyez S 354. '
6 Ce thème n’est pas usité au nominatif singulier; le pluriel manque complètement. ’
Voyez 5 apa. Comparez Pelermann, Grammaire arménienne, p. 178.
C’est ce qui est arrivé aussi pour le thème démonstratif i en gothique. On peut comparer avec le nominatif arménien i (que nous restituons par hypothèse) et avec l’accusatif réellement employé s-i ( S a 3 7,3) le gothique i-s, i-na. Au datif, nous avons en arménien i-m, en gothique i-mma (vieux haut-allemand i-mu). Rapprochez aussi les formes gothiques hi-na «eum», hi-mma ttei» qui sont parentes, non-seulement par la flexion, mais encore par le thème.
Voyez SS 188 et 872, 3. Si cette hypothèse était fondée, le génitif êr aurait éprouvé le même changement que la troisième personne de l’imparfait Up «r « R était», que nous avons rapprochée du védique âs, du zend as et du dorien (S 183 b, s )■ Comparez aussi la deuxième personne té/i éir avec le sanscrit ftxis (devant une lettre sonore ïïsir).
Pelermann, Grammaire arménienne, p. 173. Gotie forme est unique eu son genre.
n se prononce aujourd’hui vo (S i83\ a). IL ne faudrait pas inférer de cette prononciation une parenté spéciale avec le gothique kva-s, car le v du mot gothique doit uniquement sa présence â la gutturale qui précède (S 86, 1), au lieu qu’en arménien un n 0 initial se prononce toujours vo.
Si le redoublement de m a une raison d’être étymologique, il doit s’expliquer par le groupe m dont le s a été assimilé. Comparez les datifs gothiques hva-rrma, humma (S 170).
-1 Voyez S 393.
Dixième déclinaison de Schrüder. Voyez ci-dessus, p. 87.
Mon ancienne conjecture sur la parenté de ts avec le thème de l’article se trouve
Voyez Je Dictionnaire de Nesselmann, aux mots kas et gi.
On trouve aussi tadîya employé daus le sens de son primitif tat. Voyez Slenzlcr, Raghouvança, I, 8t, et Brockhaus, Pâtalipoutra, vers a. Un exemple du sens possessif est donné Raghouvança, II, a8.
Des cas, p. 117.
Cet », comme nous l’avons dit (S 998 '’), est probablement inorganique.
Voyez Kopitar, Glagolita, p. 59; sur le thème Si, voyez S 269. a Comparez ce qui a été dit plus haut (S 319, remarque) du changement-d’un d primitif en r. Nous avons, de même, en indoustani, précisément pour les pronoms dont il est question ici, ies formes mira «meus», mtri«mean, au lieu deuyq nia-diya, ir-TUrr madîyâ. Les mêmes formes mira, miri se retrouvent dans la langue des Tsiganes (Annales de critique scientifique, 1836, p. 3lo).
Vat dans les cas faibles (S iag).
Eu zend, l’d s’est de nouveau abrégé, comme il arrive très-souvent pour les voyelles zendes dans l’avant-dcrnière syllabe. _
Voyez ci-dessus, page 109, note 5.
Cette conjecture a été confirmée depuis par les Védas, où nous trouvons en effet les pronoms kîvant, liant. L’i est allongé dans ces formes comme l’a dans yiïvant,
tiïvant. Je ne doute pas qu’à une époque plus ancienne il n’y ait eu également un pronom kàvant.
On a, par exemplej dans le Vendidad-Sâdé (p. 229) :
<{!»>>)$ âvantëm paiéaita frvânëm «après combien de temps?».
3 Cette dernière forme est souvent employée adverbialement; exemple : y»»n
cvaijl antarè narèus «parmi combien d’hommes?» (Vendidad-Sâdé,
page 3o).
Le premier est employé assez fréquemment; le second ne m’est connu que par
un passage que discute Burnouf dans son Commentaire »ur le Yaçna ( note A, p. 13);
le manuscrit lithographié présente la leçon fautive avaiti, au lieu de yavaiti.
L’accord remarquable qui existe sur ce point entre les différentes langues de l’Europe ne prouve pas qu’elles n’aient point opéré ce changement d’une façon indépendante les unes des autres. On sait que les lettres d, l et r permutent entre elles très-fréquemment (S 17") : ces permutations ont lieu surtout dans les formes composées. C’est le lieu de rappeler que le nombre «dix», comme dernier membre d’un composé, affaiblit son d initial en l ou en r dans plusieurs langues de l’Europe et de l’Asie (S 319, remarque).
Hol'er, De prâb-ita dinkctn, p. 39.-
Grimm, Grammaire allemande, III, p. 49.
1 Le motne se rencontre pas, mais son existence est attestée par l’adverbe analeikô.
Il faut excepter man-leika (thème man-leikan) «image», littéralement «semblable à un homme», liuba-leiles «aimable» et vaira-leikô (adverbe) «virilement».
Comparez, pour le sens, le sanscrit unyd-dfsa-s «semblable à un autre, d’autre sorte». Le mot sanscrit, transporté en gothique, serait alja-leiks, dont nous avons conservé l’adverbe aljaleikôs «èrépus».
Le simple sama (thème saman) signifie «le même», et répond au sanscrit sa-
2O.
La diphthongue ei représente, en gothique, un i long (S 70 ).
1 Nous reviendrons plus tard sur ces formes germaniques, qui peuvent encore s’expliquer d’une autre manière (Sg8i).
■’ Par euphonie pour jo. *
* ïmlilntionea lingual slavicw, p. 344.
Sur les formes en lis, venant de thèmes substantifs, voyez 8 9/10; sur les formes comme ag-i-lis, fae-i-lin, S g3g.
» L’auteur dit le vrai thème, pour le distinguer des formes telles-que tat, aemàt , qui sont souvent traitées comme si elles étaient le thème, quoiqu elles renferment une désinence (SS 11 a, ho4 et 415). — Tr.
En zend, had'a; en ancien perse, hadd «ici» (S îoiâ), — Le primitif s’est conservé dans te védique vihâdâ «partout», lequel a allongé la voyelle du suffixe.
On devrait s’attendre à trouver en gothique un d en regard du a sanscrit et du
. 3- grec (S 87, 1) ; mais à la fin des mots, après une voyelle, le th est préféré au d
(SS 91,3 et 4). \ ,
Quoique le thème hu, qui est une forme affaiblie du thème ha, existât déjà dans la période où le sanscrit et le zend ne faisaient qu’une seule langue, je le regarde cependant comme d’origine relativement récente, et comme postérieur à l’époque où les idiomes de l’Europe se sont séparés de ceux de l’Asie. Je considère donc le slave X ü, partout où nous le trouvons dans le thème interrogatif, comme un affaiblissement de P« sanscrit et lithuanien (S 389). Sur le X ü slave tenant la place d’un « sanscrit, voyez S 9a °.
Comparez S i83", 3.
Voyez SS 3i5 et 3ai.
a C’est l’explication donnée par Aufrecht, dans le Journal de Kuhn (t. I, p. 85). Mais le m est, selon Aufrecht, un reste de la désinence dative b'yam, que nous trouvons avec le sens locatif dans ibi, ubi. 11 cite, à l’appui de son opinion, les formes ombriennes en mem, mm, me,fem, pour lesquelles nous avons proposé une autre origine (S aoo).
C’est ce qui est arrivé aussi, comme on l’a vu plus haut (page io8), pour le gothique jain-d e illic n.
1 Voyez S 379, à.
La même substitution a lieu dans les désinences dvé, dvam, à la seconde personne plurielle du moyen. Ces formes dvê, dbam dérivent du thème pronominal de la seconde personne tvn.
Sur v tenant la place de s, voyez S 97.
Cette ferme me paraît dérivée du thème précité (S 4ao) and «illîc», comme si, eu sanscrit, à côté de l’adverbe ihd «ici», il y avait un ablatif adverbial ih-alas «d’ici».
En sanscrit, svarga-tâs, de svarga «ciel». Le thème arménien b-p/frf, erkni, contracté de erkini, nominatif erkin, me paraît être de la même famille que svarga. Le groupe sv a disparu et le thème s’est élargi par l'addition d’un suffixe mi, qui est peut-être un affaiblissement du suffixe dérivatif que nous trouvons en sanscrit sous la forme ma.
On a vu précédemment (§S 183*, a, et 4ao) que le gothique marque ces rapports par les adverbes aljathrd «aliunde» et aljath «alibi».
Le sens n’est pas le même qu’en sanscrit. Dobrowsky (p. 43a) traduit jeda par «num, numquid». Miklosich (Lexique, p. aoi) le traduit par «f«f» et par «ne».
Comparez nê-kas «aucun».
An lieu de l’orthographe ai, on trouve aussi "y.
Ce dernier vient de l’adverbe védique idtC qui lui-même signifie «maintenant ». Les grammairiens indiens, pour expliquer ces mots, admettent un suffixe diîtiim.
a II est vrai qu’on s’attendrait plutôt à trouver l’esprit rude (S 19).
Au sujet de l'insertion de la nasale, comparez S h90.
Comparez C. G. Schmidt, Qumtiorm grammatical de prœpositionibus graicix,
page 49-
La même préposition se retrouve dans le latin at-avus. Voyez Annales de critique scientifique, 183o., page 792.