
Grammaire comparée des langues indo-européennes. Tome 3 / par M. François Bopp ; traduite sur la seconde éd. par M. [...]
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
Bopp, Franz (1791 -1867). Auteur du texte. Grammaire comparée des langues indo-européennes. Tome 3 / par M. François Bopp ; traduite sur la seconde éd. par M. Michel Bréal,... ; registre détaillé rédigé par M. Francis Meunier. 1866-1875.
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le cadre d'une publication académique ou scientifique est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source des contenus telle que précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus générant directement des revenus : publication vendue (à l'exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit payant, un support à vocation promotionnelle etc.
CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE 2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :
- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.
- des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter utilisation.commerciale@bnf.fr.

DES
LANGUES INDO-EUROPÉENNES
’si-, !'<
LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET C%
BOULEVARD SAINT-GERMAIH, N° 77.
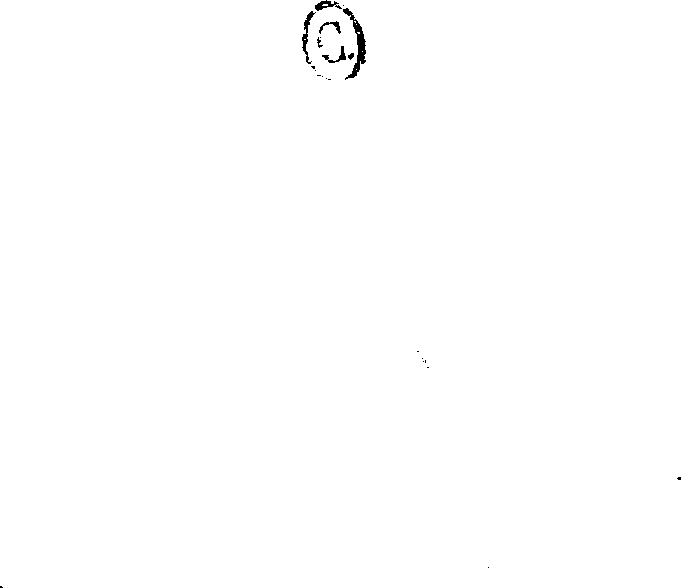
DES
COMPRENANT
LE SANSCRIT, LE ZEND, L’ARMÉNIEN LE GREC, LE LATIN, LE LITHUANIEN, L’ANCIEN SLAVE LE GOTHIQUE ET L’ALLEMAND
TRADUITE
SUR LA DEUXIÈME ÉDITION
ET PRÉCÉDÉE D’INTRODUCTIONS
PAR M. MICHEL BRÉAL
PROFESSEUR DE GRAMMAIRE COMPARÉE AU COLLEGE DE FRANCE
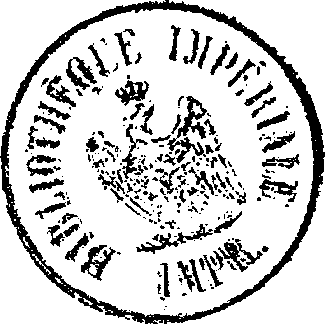
TOME III
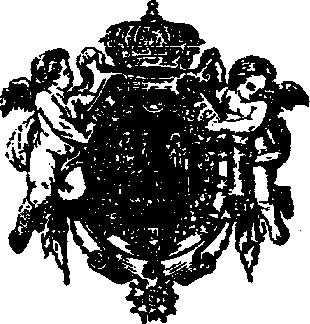
M DCCC LXIX
Avant de donner un aperçu du présent volume, qui est tout entier consacré à l’étude du verbe, nous demandons la permission de revenir au tome précédent, et de reprendre notre analyse au point où nous l’avons laissée. De bienveillants critiques m’ont engagé à donner plus de développement à ces résumés : c’est une invitation à laquelle je me conforme avec plaisir. Toutefois, comme il faut rester dans les limites d’une introduction, nous bornerons notre examen à un certain nombre de points essentiels.
Depuis l'achèvement du second volume de cette traduction, l’auteur de la Grammaire comparée a cessé de vivre. Nous n’avons pas attendu ce moment pour faire la part de la critique en parlant de son œuvre; nous continuerons dans le même esprit de respectueuse franchise, certain qu aucun lecteur ne pourra se méprendre sur nos intentions.
LA. DÉCLINAISON SLAVE.
Après avoir traité de la formation des cas dans les langues indo-européennes, M. Bopp nous donne un chapitre spécial sur la déclinaison en ancien slave *. Pour s’ex-1 S 266-279.
A
pliquer cette irrégularité, qui peut étonner le lecteur, il laut se reporter à la première édition. Dans le premier fascicule, qui finissait avec la formation des cas, le slave ne figure pas encore au nombre des idiomes étudiés par
I auteur. Pendant l’intervalle qui sépara la première livraison de la seconde, M. Bopp, pour combler cette lacune, dépouilla les ouvrages de Dobrowsky et de Kopitar1, et, pour faire entrer les langues slaves en ligne avec le reste de la famille, il prit le parti de leur consacrer un chapitre spécial en tête du deuxième fascicule. Bien que, dans la seconde édition, le slave soit mis, dès le début de l’ouvrage, en regard des autres idiomes, M. Bopp n’a point supprimé les paragraphes qu’ii avait autrefois composés.
II a craint, sans doute, de déranger l’ordonnance de son livre. Mais il a senti, en outre, que ce morceau avait son unité et présentait un intérêt à part.
En effet, nous y voyons de la manière la plus claire quelles différences existent entre les théories suggérées par 1 étude particulière d’un idiome et les enseignements que fournit la grammaire comparative. Bopp tire de Dobrowsky sa connaissance de l’esclavon; il lui emprunte tous ses exemples. Mais il est en désaccord avec lui dès qu il s agit de les expliquer. Les désinences casuelles ont 1 air de n’être pas les mêmes chez les deux écrivains, et il arrive souvent que Bopp conclut à l’absence de toute ter-
minaison là où 1 auteur slave, d’accord avec l’instinct de ses compatriotes, avait cru clairement sentir la présence d’une flexion grammaticale. Il est bon de montrer la cause de cette divergence, qui ne tient point aux auteurs, mais uniquement à la méthode. Un tel examen sera d’autant plus utile que le grec et le latin nous présentent, pour peu que nous y fassions attention, des faits absolument identiques.
Rappelons d’abord que l’ancien slave a subi les effets d’une loi phonique extrêmement rigoureuse, d’après laquelle toutes les consonnes qui se trouvaient primitivement à la fin des mots ont dû être supprimées2. Ainsi mâtar (rmèreu (grec fiiffrvp, latin mater) est représenté au nominatif par mati; nabhas <t nuage » (grec vétpos) fait au nominatif-accusatif nebo. Ce n’est pas que les idiomes slaves, tels qu’ils existent aujourd’hui, ne puissent supporter une consonne finale : ils les souffrent, au contraire, fort bien, et ils ne témoignent d’aversion pour aucune. Mais ce sont, pour employer l’expression de Bopp2, des consonnes de la seconde génération, c’est-à-dire des consonnes qui se trouvaient d’abord comprises dans le corps du mot, et qui ne sont arrivées à en occuper la fin qu’a-près que les finales primitives eurent été rongées. On comprend aisément quels ravages une pareille loi a dû exercer sur les désinences grammaticales : beaucoup ont
disparu absolument. Mais l’esprit des peuples slaves, comme celui de toute la race indo-européenne, était tellement habitué aux flexions, qu’il crut en apercevoir dans certaines parties du mot qui, à l’origine, n’avaient nullement ce caractère. Ainsi l’adjectif novü, nova, novo, qui correspond au latin novu-s, nova, novu-m, au sanscrit navals, navâ, nava-m, parut avoir encore sa flexion, quoique en réalité Yü du masculin et l’o du neutre soient la voyelle finale du thème. Mais comme il suffisait que l’instinct grammatical du peuple slave crût reconnaître en ces lettres des exposants de relations casuelles pour qu’effectivement elles le devinssent dans l’usage, une déclinaison d’origine secondai! *e se substitua à la flexion primitive. Derrière l’ancienne désinence usée par le temps ou arrachée par l’action des lois phoniques, il en repoussa une autre prise srr la substance du thème.
On devme dès lors le désaccord qui va s’établir entre la grammaire slave et la grammaire comparée. Dans l'ü final de vlükü c lupus ■», Dobrowsky voit l’exposant du nominatif, tandis que Bopp, rapprochant vlükü du sanscrit vrïka-s, conclut que le s, signe du nominatif, est tombé, et que la final du thème s’est affaibli en u. Dans les thèmes en jo, correspondant aux mots grecs comme âyio-s, aux mots latins comme soem-s, l’action des lois phoniques a été encore plus loin : le thème sinjo trcæruleusw s’est altéré au nominatif masculin en sinï et au neutre en sine; mais cette différence de Yï et de Ye suffit à l’esclavon pour
JL
distinguer les deux genres. Dès lors, la grammaire slave appelle l’ï et Ye des désinences, tandis que l’analyse scientifique constate que le thème sinjo a perdu sa flexion, et
qu’il a subi, au masculin et au neutre, deux contractions différentes1.
D’un autre côté, il est facile de concevoir quelle perturbation la même loi a jetée dans la déclinaison des thèmes terminés par une consonne. Outre que le nominatif mati cf mère* est privé de sa désinence, il a perdu aussi le r qui la précédait. Mais ce r reparaît au génitif matere, au datif materi, grâce à la voyelle dont il est suivi et à l’abri de laquelle il s’est conservé. Il en est de même pour le s de nebo (= sanscrit nabhas ce nuage*) : cette lettre reparaît au génitif nebese, au datif mbesi. Que fait Dobrowsky? Partant de l’idée que les cas obliques se tirent du nominatif, il regarde les lettres r, s comme des additions appartenant au mécanisme de la déclinaison, et divisant les mots de cette manière : mai-er-e, neb-es-e, il appelle les syllabes er, es des <raugments*3 4 5.
Ces rapprochements sont instructifs, parce qu’ils nous montrent que la connaissance pratique d’une langue peut très-bien s’unir à l’entière ignorance de sa structure intime. L’instinct même du peuple n’est pas toujours un guide infaillible, ou plutôt il n’a d’autorité décisive que pour l’usage actuel d’un idiome. Ce qui fait que le peuple est un assez mauvais juge en grammaire, dès qu’il s’agit de se prononcer sur les questions d’origine, c’est la facilité même avec laquelle il introduit un sens nouveau dans des formes qui ont été créées pour un autre emploi. Il ne connaît guère que le langage du jour, comme il interprète ses coutumes d’après ses idées présentes, et comme il altère les traditions du passé en y mêlant ses plus récents souvenirs.
Au lieu du slave, le lecteur n’aura point de peine à mettre ici le grec, le latin ou le français. Pour un Romain, Yu de mvw-s, novu-m semblait faire partie de la désinence. Ve final de mare, dulce faisait l’effet d’être le signe du neutre. Dans les prosodies latines qu’apprennent nos élèves, on divise les génitifs limants, generis de cette façon : hom-in-is, gen-eî-is, et l’on a inventé pour les syllabes in9 er le nom de écrément*. En français, ciel et cieu-æ, beau et belle présentent une flexion apparente qui s’est formée aux dépens de la partie autrefois invariable. Ces laits sont exactement semblables à ceux que nous venons de citer en slave, et les grammairiens latins ou français qui les ont expliqués n’ont guère montré plus de sens historique que Dobrowsky. Une telle rencontre prouve clairement que nous sommes exposés à nous tromper sur la cause des faits les plus simples et que nous courons le risque d’imaginer les théories les plus chimériques, du moment que nous bornons notre vue à un seul idiome, pris à un seul moment de son existence,
L’ADJECTIF.
Entre le substantif et l’adjectif, il n’y avait, dans le principe, aucune différence de forme. Comme le langage, pour marquer les personnes ou les objets, les désignait par leur qualité ou leur manière d’être la plus saillante, tous les substantifs ont commencé par être des adjectifs
pris substantivement. Dêva adieux a en sanscrit un comparatif et un superlatif; il signifie «le brillantMâlar, qui dans le sanscrit classique veut dire uniquement cria mèren, a dans les Védas un masculin avec l’acception de cccréateur». On sait avec quelle facilité, même dans nos idiomes modernes, nous faisons prendre tour à tour à un nom l’un ou l’autre rôle. Quand notre esprit, derrière la qualité mise en relief par le langage, va chercher une personne ou une chose, nous avons un substantif; mais si, s’arrêtant à la notion de la qualité, il néglige l’idée de l’objet auquel elle appartient, c’est un adjectif que nous employons. Une des applications les plus intéressantes de l'étymologie, c’est de retrouver comme adjectif dans une langue le terme qui est devenu substantif dans une autre. En mythologie surtout, ces comparaisons ont donné lieu à des découvertes remarquables.
Cependant, l’adjectif, dans la plupart de nos idiomes, s’est à la longue distingué du substantif non-seulement par la signification, mais encore par la forme. Comment une différence qui, à l’origine, résidait seulement dans notre esprit, a-t-elle fini par trouver son expression dans le langage ? Il ne sera pas hors de propos de nous rendre compte-de ce fait, car il nous montre aux prises (pour employer les termes philosophiques) la forme et la matière du langage, et il est curieux de voir comment une catégorie logique est devenue, d’une façon plus ou moins explicite, une catégorie grammaticale. Trois causes surtout ont produit ce résultat.
En premier lieu, un choix s’est fait instinctivement. L adjectif habituellement employé pour représenter un
objet perdit sa valeur qualificative et devint uniquement le nom de cet objet. Ainsi sétu/a, qui voulait dire crie brillante, mais qui servait à marquer le soleil, signifia «le soleil e; manu te intelligente devint le nom de l’homme. On perdit de vue l’épithète pour ne plus voir que l’être ou que la chose désignée, comme dans nos langues modernes nous savons très-bien faire abstraction du sens de certains noms communs, dès qu’ils sont employés comme noms propres. D’autres mots, au contraire, tels que lagku et léger nam tr nouveaux, qui ne furent spécialement attachés à aucun objet, gardèrent leur vertu qualificative, [lestés adjectifs, ils conservèrent deux facultés que les substantifs perdirent plus ou moins : celle de prendre tour à tour les trois genres et celle de s’élever au comparatif et au superlatif. L’altération phonique, en obscurcissant la signification des racines, contribua encore à séparer les deux classes de mots. L’Indou, dont la langue s’est moins modifiée, sent encore la parenté qui existe entre âçu cc rapides et açva cc cheval mais quel Grec se serait douté de l'affinité de àxvs et de Ïttkos ? Grâce à cette altération, grâce à l’emploi purement substantif qu’on fit de l’un des deux mots, ils parurent avoir appartenu de tout temps à deux catégories différentes.
En second lieu, les suffixes aidèrent à la distinction. H est vrai qu’un certain nombre sont employés indifféremment pour les deux classes de mots; mais d’autres, dès la période indo-européenne, commencent à être exclusivement réservés soit aux substantifs, soit aux adjectifs. Nous voyons bien, par exemple, que le suffixe ti a tout à la fois donné au latin des adjectifs comme fortis, îristis, milis, et
des substantifs comme pestis,fu$tis, vestis. Mais dans toutes les langues de la famille, grâce à un très-ancien travail de répartition, ira sert déjà à former les noms d’instrument ('&'kr}x-Tpo-v, ras-tru-m) et est exclusivement attribué aux substantifs. La grammaire comparée nous fait quelquefois assister à ce classement. Dans le dialecte védique, -as forme encore des adjectifs comme tar-as te pénétrante, ap-as et actifs l; mais en sanscrit classique, en grec, en latin, as ne donne plus guère que des substantifs, la plupart du genre neutre, tels que man-as, (lév-os, gen-m2.
Nous ne parlons ici que des suffixes les plus anciens, car ceux qui sont d’un âge plus moderne, et qui ordinairement ont été formés par la réunion de plusieurs suffixes primitifs, ont pu dès l’abord être destinés à l’une ou à l’autre classe de mots. Plus les langues avancent en âge, plus elles cherchent à marquer extérieurement cette séparation. Quelquefois le thème de l’une des deux sortes de mots est élargi. Ainsi le latin, qui a des substantifs comme fructus, manus, n a plus d’adjectifs de cette espèce : il les a fait passer dans la troisième déclinaison, en adjoignant un i à Vu final du thème. En regard du sanscrit laghu-s cc léger », du grec éXa^u-s, le latin a le(g)vi-s; en regard de tanu-s « mince •» , de |3pa^v-s tr court •n, il a lenui-s, hre{g)vi-s3.
En troisième lieu, un pronom vint se joindre à l’adjectif. Il faut croire que c’est là un procédé assez naturel à
1 Comparez îe latin opus.
Le suffixe as forme aussi des substantifs masculins et féminins (§981 et suiv.).
Peut-être est-ce la difficulté de décliner le neutre qui a été la cause de cet élargissement du thème.
l’esprit humain, car plusieurs idiomes y ont recouru d’une manière tout à fait indépendante; mais ils ne sont pas allés tous également loin dans cette voie, et avant d’examiner les formes où la cohésion est entière, nous ferons bien de considérer celles qui nous présentent une soudure moins intime.
C’est en zend que la construction dont nous voulons parler est le plus apparente. L’adjectif, comme pour resserrer le lien qui doit l’attacher au substantif précédent, se fait accompagner du pronom relatif. On dira, par exemple : «le serpent venimeuxd, asîm yim vîsavantëm «serpentent quem veneniferum*6. De même, en ancien perse, « l’armée séditieuse v se dit Mra hya hamitriya « exer-citus qui seditiosus v, et à l’accusatif : kâram tyam hami-triyam «exercitum quem seditiosum*.
Une adjonction plus étroite s’observe en ancien slave et en lithuanien. Le pronom, qui est toujours postposé, fait corps avec l’adjectif. Toutefois, l’union nest point necessaire et l’adjectif peut aussi s’employer seul. Nous avons donc pour les adjectifs une double déclinaison, l’une qu on appelle déterminée ou complexe, l’autre qui porte le nom d’indéterminée ou simple. En ancien slave, par exemple, l’adjectif féminin doblja te vaillante * fait à l’accusatif singulier dobljun et à l’accusatif pluriel dobljan; avec le pronom annexe, il fait dobljun-jun et dobljan-jan. La compo-sitiru n’est pas toujours aussi facile à reconnaître : des contractions se sont opérées entre l’adjectif et le pronom,
de sorte que la forme complexe se distingue seulement par une ou deux lettres delà forme simple. Ainsi, au masculin, le nominatif indéterminé est doblï, le nominatif déterminé, dobli-j. Les langues modernes sont encore allées plus loin. En russe, l’instrumental déterminé dobrü-m (ancien slave dobrü-imi) ne révèle plus la presence du pronom annexe que par l’adoucissement de l’w.
A peu près au même degré que l’ancien slave et le lithuanien se trouvent les langues germaniques. L’adjectif peut être employé, soit à l’état simple, soit avec un pronom qui lui est incorporé. De là la double déclinaison des adjectifs en allemand. Tandis qu’on dit, par exemple, avec l’article défini : der blinde mann, dm grü/ne laub, il faut dire, quand l’article manque : blinder mann, grünes laub. Cette double déclinaison, qui existe déjà en gothique, est due au même pronom ya que contiennent en ancien slave les formes comme dobljun-jun ou dobli-j7. Mais il y a cette différence entre l’ancien slave et l’allemand que ce dernier idiome a réglé d’une manière beaucoup plus stricte l’usage de la forme pronominale. Le principe, c’est qu’il faut éviter le double emploi. Comme l’article défini der, die, dm renferme déjà lui-même le pronom annexe ya, on met sous la forme simple l’adjectif dont il est suivi (der gute vater), Quand, au contraire, l’adjectif est employé sans article, ou quand il est précédé d’un pronom simple comme ein, mein, dein, sein, il paraît sous la forme pronominale {guter vater, mein guter vater)2.
Le plus haut point de cohésion a été atteint par les langues slaves modernes : l’adjectif composé a presque partout remplacé en prose l’adjectif simple1. Mais comme, d’un autre côté, la présence du pronom annexe ne se révèle plus guère que par quelques modifications phoniques, ces idiomes ont l’air de posséder une déclinaison spéciale pour les adjectifs.
C’est à M. Bopp que revient le mérite d’avoir analysé tous ces faits2. Avant lui, la double déclinaison des adjectifs allemands était regardée comme une singularité inexplicable, ou était expliquée d’une façon très-défectueuse. Jacob Grimm, dans sa Grammaire allemande, regarde blinder comme la forme la plus ancienne et la plus simple : aussi l’a-t-il appelée la forme forte, nom qui lui est resté3. Bopp lui-même n’a pas trouvé du premier coup la vraie explication. Dans la recension qui! donna, en 1827, de que. Les pronoms ein, meut, dein, sein ne sont simples qu’au nominatif : les cas obliques renferment le pronom annexe ya. Aussi, par une nouvelle application de la même règle, l’adjectif reparait-il sous la forme simple dans les cas obliques {meines guten vaters et non meines gutes vaters).
1 Ce dernier n’est plus guère usité que comme attribut, c’est-h-dire dans le même emploi où l’allemand se sert de l’adjectif privé de flexion.
a En lithuanien, où la forme complexe de l’adjectif est encore très-transparente, la présence du pronom a été reconnue dès le xvne siècle. Voyez sur ce sujet Benfey, Histoire de la linguistique et de la philologie orientale en Allemagne, depuis le commencement de ce siècle et avec un coup d’œil sur les temps antérieurs (Munich, 1869), p. A89. — Nous profitons de la première occasion qui se présente pour signaler cet excellent ouvrage, qui sera bientôt entre les mains de tous les linguistes. Nous y avons nous-même fait plusieurs emprunts dans le* cours de cette introduction.
3 Grammaire allemande, I (V édition), p. 097. Comparez IV, p. /i6o, fi09 et 582.
la Grammaire allemande de J. Grimrn1, il regarde encore les formes blinder, grünes, non comme renfermant effectivement un pronom, mais comme portant simplement une désinence pronominale : en d’autres termes, il suppose que par une extension dont plusieurs idiomes nous présentent des exemples,, les adjectifs ont été fléchis sur le modèle des pronoms *8 9. C’est l’étude du slave et du lithuanien qui a suggéré à M. Bopp la véritable solution.
Au reste, tous les problèmes qui se rattachent à cette double déclinaison germanique ne sont pas éclaircis. Pour ne citer que deux points encore incertains, le n qui caractérise la forme faible (gothique blindan) a donné lieu aux hypothèses les plus diverses, et l’on s’est demandé si ce n ne serait pas lui-même le débris d’un pronom annexe10. D’un autre côté, notre auteur laisse planer un certain doute sur la manière dont, selon lui, se déclinait la forme forte : l’adjectif et le pronom portaient-ils l’un et l’autre la flexion, comme en slave et en lithuanien, ou bien le pronom annexe se fléchissait-il seul ? Les formes les plus anciennes sont déjà trop contractées pour qu’il
ait été possible jusqu’à présent d’arriver une certitude.
à cet égard à
LUS DEGRES DE COMPARAISON.
* C’est à l’occasion des adjectifs que M. Bopp traite des degrés de comparaison. S’il avait voulu suivre un ordre rigoureux, il aurait dû joindre cette étude au chapitre de la formation des mots; en effet, le comparatif et le superlatif se marquent à l’aide de suffixes qui ne sont nullement réservés aux adjectifs, mais qui s’ajoutent aussi, par exemple, aux pronoms et aux adverbes. Mais comme l’auteur évite de déranger sans nécessité les habitudes reçues, il a mieux aimé conserver à ces formations la place qu’elles ont de tout temps occupée dans nos grammaires.
Une certaine confusion, due à une théorie défectueuse, règne dans ce chapitre. Nous rappellerons donc très-briè vement les faits, pour pouvoir ensuite mieux expliquer en quoi notre auteur nous paraît les avoir faussement interprétés.
Les langues anciennes possédaient plus d’une manière d’exprimer le comparatif : c’est ainsi qu’en grec nous avons ï/Sicov et yXvjtvTSpos. Dans vTrep, comparé à 67ro, nous découvrons les restes d’une troisième forme. Ramenés à leurs types les plus anciens, les suffixes du comparatif sont : i° ray qui n’a subsisté que dans un petit nombre de mots. Nous avons, par exemple, en sanscrit, avara et inférieur apara «c postérieure; en grec, imép; en latin, superus, inferus; en gothique, unsar « notre e, izvar <r votre e. Comme on le voit, ce sont ou des adjectifs indiquant une situation dans l’espace, ou des pronoms, c’est-à-dire des
mots appartenant aux couches les plus profondes du langage1. Il est probable que c’est la brièveté du suffixe va, ainsi me son sens trop peu déterminé (car il a encore d’autres emplois que de marquer le comparatif), qui l’ont fait sortir de l’usage courant. Mais il n’a pas pour cela disparu : nous allons le retrouver comme partie intégrante du suffixe lara, qui l’a remplacé. z0 tara. On a, par exemple, le sanscrit katara ec lequel des deu x ? *, autara trintérieure,punyatara trplus pur*; le grec 'tàâT&pos, xov-(pOTSpos ; le latin uter, noster, dexter; le gothique hvathar a lequel des deux?*, anthar tr l’autre*. 3° yans, que nous trouvons dans le sanscrit hhûyans trplus nombreux*, le grec ffSloôv, le latin suavius, le gothique mais «plus*11 12 13.
Au superlatif, la variété des suffixes est encore plus grande. Nous avons : i° ta, qui s’est conservé dans les noms de nombre ordinaux. En grec, 'üSp&TOs, Tprros, Séxajos; en latin, quartus, quintus; en gothique, saihstan te sixième *, ahtudan te huitième*. Le sanscrit a altéré le t en ths : ca-
turtha « quatrième». 9° ma. Ea sanscrit, avama ce le plus bas », saptama « septième », daçama « dixième » ; en grec, ^pofios, 'dëSopLOS; en latin, summus (pour supmus^, inji-mus, minimus, primus, decim/us; en gothique, frunian tt premier d, auhuman « supérieure. 3° tama. Lest la reunion des deux précédents. En sanscrit, kalama « lequel?» (en parlant de plusieurs), punyatama ce le plus pur »; en latin, optimus, ultimus, mac-simus *; en gothique, aftuman «le dernier». Au lieu de combiner ensemble les suffixes ta et ma, le grec a redoublé ta, et a créé de cette maniéré son suffixe tolto : yXmivmos. k° ista. En sanscrit, mahishtha «le plus grand », garishtha «le plus lourd»; en grec, fis-yi&los, xoLXtdlos*, en gothique, hauhista «le plus haut». Ce suffixe ista est la réunion du suffixe comparatif yans avec le précité ta2. Le latin n a point gardé ista, ou plutôt, enchérissant sur les idiomes congeneres, il a combiné avec is (contraction de ius) son suffixe tumô, timo. De cette façon il a obtenu les formes comme docti$-simu-s, felicis-
simu-s.
Nous arrêtons ici cette exposition sommaire, renvoyant pour la preuve de ces rapprochements à l’ouvrage de Bopp. L’erreur où ce maître nous paraît etre tombé, ça été de regarder tava et tama comme les suffixes primitifs, dont seraient dérivés par mutilation ta, va et ma. Nous croyons,
1 Pour le changement de timus en simus, voyez Schleicher, Compendium, S i57d. Le s s’est à son tour assimilé à un r ou un t précédent : veter-rirnu-s (pour veter-simu-s), facil-Umu-s (pour facil-sirnu-s).
2 Yans est un suffixe primaire, c’est-à-dire que dans les plus anciennes formations il se joint, non au thème, mais immédiatement à la racine. De là les mutilations apparentes signalées au § aà8a. 11 en est de même pour le suffixe superlatif ista.
au contraire, que les formes les plus courtes sont aussi les plus anciennes. Le besoin de précision, joint au besoin non moins naturel à l’homme d’exagérer sa pensée, ou de fortifier et de rajeunir des expressions que l’usage avait affaiblies, fit que l’on combina entre eux ces différents suffixes. Le grec t<xt os, le latin issimus, ainsi que les formes redondantes comme interior, en latin, nêdishthatmna cfle plus voisina, en sanscrit, aftumist <rle dernier», en gothique, sont des exemples très-clairs de ces sortes d’accumulations. Plus enclin par la pente de son esprit et par le cours de ses études à admettre des mutilations de formes autrefois complètes que des combinaisons dues à un instinct de perfectionnement, l’auteur de la Mammaire comparée a interverti l’ordre véritable : il croit que le latin superus a perdu la partie initiale de son suffixe (pour supterus), et que le ma du sanscrit pancama et cinquième» est pourpancatama. Allant plus loin encore dans cette voie, M. Bopp fait dériver tama d’un ancien tarama, le grec tcl-tos d’un ancien TapOTOs, et il suppose que l’origine commune de toutes ces formes est la racine tar, qui veut dire tr aller au delà, surpasser». Nous resterons fidèles à la méthode habituelle de notre auteur, en renonçant à voir une racine verbale dans ces antiques suffixes, et en expliquant les syllabes formatives ra, ta, ma comme des éléments pronominaux analogues à ceux qui servent à former tant d’autres noms14. Ce sont ces éléments qui, en se combinant entre eux, ont donné les suffixes plus compliqués et plus modernes tara, tama, ista, tolto, issimë, qui ne sont point
1 La théorie de Bopp a été d’abord contestée par Pott, dans son ouvrage intitulé Die quinare und vigesimatc Zâhlmethode ( 18/47). p. 216.
m.
tous du même temps, et qui nous montrent le langage réunissant les mêmes syllabes à plusieurs reprises et de diverses façons.
O
H est intéressant d’étudier ce travail de dépérissement et de rénovation. Tandis que le suffixe superlatif tama est resté vivant en latin, il est à peu près complètement sorti du grec. D’un autre côté, au lieu que le grec tspo n’a pas cessé, concurremment avec tov, de faire partie de l’organisme de la langue, et en fait encore partie aujourd’hui, le latin ter a été de bonne heure étouffé par le suffixe ior. Dans les textes les plus anciens où nous puissions observer la langue latine, ter ne subsiste que pour un certain nombre de vieux comparatifs dont la formation appartient à une période antérieure et dont le nombre ne s’augmente plus!.
Si l’on fait abstraction de la théorie dont il vient d’être question, le chapitre que nous analysons offre beaucoup d’observations justes et curieuses. Il présentera surtout de l’intérêt aux latinistes et aux germanistes. C’est à Bopp qu’on doit cette explication si ingénieuse de la syllabe is dans ista, issimus : de nouvelles recherches n’ont fait que la confirmer. M. Benfey a relevé en sanscrit les formes pâpîyastara «plus méchante, pmishtama, « très-digne de louanges, surabhisktama «très-odorantt>, qui présentent la même composition. En grec, nous avons XaXMepos, <ip(<Jlepo$; en latin, magister, minister, sinister2. C’est aussi 14
M. Bopp qui le premier a reconnu des comparatifs dans les mots latins comme uter, alter, ceteri, iterum. C’est lui enfin qui nous a fait apercevoir d’anciens comparatifs dans ces adverbes plus, mugis, dont se servent encore nos idiomes modernes pour exprimer les degrés de comparaison, et qui sont comme les derniers survivants d’espèces

Une autre question est de savoir quel a été le sens primitif des suflixes de gradation. M. Bopp ne s’explique point sur ce sujet; toutefois, en proposant son étymologie de la racine tar efsurpasser*, il nous donne à penser qu’il regarde la signification relative comme la plus ancienne. Mais i! ne faudrait point nous laisser tromper par le rôle qu’ont pris, en nos idiomes cultivés, le comparatif et le superlatif une fois placés dans la phrase et accompagnés de régimes. Il est plus probable que la signification absolue (c’est le terme employé par nos grammaires) a précédé la signification relative, et que le rôle primordial de ces suffixes m, ta. ma était simplement d’insister sur l’idée marquée par le thème. On peut même supposer que la différence entre le comparatif et le superlatif, quoique certainement antérieure à la séparation de nos idiomes, est d’origine secondaire : apa-ra, apanma servaient peut-être uniquement à marquer un plus grand éloignement que apa, et c’est grâce au progrès du langage qu’ils se sont d’abord distingués l’un de l’autre et qu’ils ont ensuite exprimé l’éloignement, non plus en lui-même, mais par rapport à d’autres objets.
LES NOMS DE NOMBRE.
L’identité des noms de nombre dans toutes les langues aryennes est un des faits qui ont été le plus tôt et le plus souvent mis en lumière : il faut convenir qu'il ne pouvait guère échapper même à l’observation la plus superficielle.
Aujourd’hui encore, quoique nous ayons, pour démontrer la parenté de nos idiomes, des preuves plus délicates et, au fond, plus convaincantes, cette identité n’en mérite pas moins de fixer l’attention de f historien et du linguiste. Pour ne citer qu’un exemple, l’accord de toutes les langues de la famille jusqu’à cent, leur désaccord à partir de cent, excepté pour le sanscrit et le zend, qui continuent la communauté jusqu’à mille, nous font apercevoir du premier coup la situation respective de ces idiomes.
Aux yeux du grammairien, l’identité des noms de nombre, tout en demeurant évidente, soulève cependant quelques difficultés de détail. Les modifications éprouvées par ces mots semblent parfois déroger aux lois ordinaires de la phonétique15. On a peine, pour quelques-uns d’entre eux, à se représenter la forme primordiale. Devenus de bonne heure l’expression courante d’une idée abstraite, ayant pour la plupart subi de fortes contractions, ces mots, dont le sens étymologique était oublié, offraient plus de
1 Nous citerons, par exemple, le latin sex et le sanscrit shash, le gothique fidvôr et ie sanscrit catv aras. Sur le « final des noms de nombre sanscrits comme saptan> asktan, mwanf daçan, voyez Ascoîi, Di un gruppo di desinenze indo-europee, dans les Mémoires de l’Institut lombard (1868). Des comparaisons de M. Ascoli il résulte que ce n tient la place d’tm ancien m.
caution des changements qu ds ont subis pour en tirer des lois applicables au reste du vocabulaire.
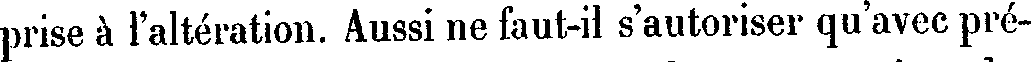
Malgré ces difficultés, M. Bopp ria pas craint d’examiner rorigine de quelques noms de nombre, moins pour arriver à une solution que pour montrer dans quelle voie il faut chercher à résoudre le problème. Il dit avec raison que les représentations figurées ne peuvent nous fournir aucun renseignement. En effet, des siècles séparent le temps où les noms de nombre furent prononcés pour la première fois de l’époque où les chiffres furent inventés, et la signification des anciens termes était déjà trop obscurcie pour avoir pu diriger les auteurs des signes graphiques. Il reste donc la seule décomposition des mots : M. Bopp y applique sa merveilleuse pénétration. Bapprochant, par exemple, le déclinaison du nombre k quatre a de la déclinaison du nombre te trois u, il fait ressortir la ressemblance frappante qui existe à certains cas entre ces deux mots K On est donc amené à penser que l’expression du nombre trois est renfermée dans celle du nombre quatre. S’il en était ainsi, il serait littéralement exact de dire que nos ancêtres ne surent compter que jusqu’à trois, et que dès le nombre quatre ils ont recouru à une addition (1 + 3). A son tour, cinq contiendrait quatre2. Ges étymologies 15
peuvent sembler subtiles ; mais si l’on pense au prodigieux frottement qu’ont dû subir les noms de nombre, si
Fou songe, par exemple, au français onze, douze, où la syllabe ze représente le latin decem, les hypothèses de notre auteur ne paraîtront pas d’une hardiesse excessive. Parce que l’homme n’a plus conscience de la raison qu’il a déposée dans les choses, les choses n’en ont pas moins leur raison.
Nous ne voulons pas dire que tous les noms de nombre doivent leur origine au même procédé. Il est probable que le mot daçan ffdixn renferme la même racine qui se trouve dans SiKrvXos. D’autres noms ont pu être d’abord des termes signifiant crtroupe, assemblage, amasi>, et le langage, en les rangeant dans un certain ordre, leur aura imposé la signification d’un nombre déterminé. C’est ainsi que, dans notre nomenclature militaire, les mots compagnie, bataillon, régiment, brigade, division sont subordonnés les uns aux autres de la façon la plus rigoureuse, sans que rien, dans la signification étymologique de ces mots, dût faire assigner nécessairement à aucun d’eux une place plutôt qu’une autre.
À partir de onze, l’étude devient plus aisée, la composition des mots nous étant, grâce à leur signification, indiquée par avance. Mais sans cette nécessité intrinsèque, il eût été difficile de reconnaître des contractions quelquefois étonnantes. Dans le sanscrit trinçat « trente v, la dizaine (daçat ou daçati) n’est guère représentée que par sa seconde syllabe, tandis que dans shashti a soixante v il ne reste que la dernière. Dans le sanscrit çatam cent n, il ne subsiste qu’une faible partie du mot entier qui est daça-
daçatam ce dix fois dixn; une fois le produit obtenu, le langage a effacé la multiplication1.
Quelques paragraphes sont ensuite consacrés par l’auteur aux nombres ordinaux. Mieux que toute autre partie du vocabulaire, les nombres ordinaux nous montrent le continuel travail de restauration et de redressement auquel sont soumis les idiomes. La plupart des langues indoeuropéennes ont refait à plusieurs reprises cette classe de mots. Comme il importe à la clarté du discours que le nombre ordinal rappelle par sa forme le nombre cardinal dont il est tiré, et comme, sous l’action des lois phoniques , ces deux termes sont quelquefois altérés de telle façon qu’ils deviennent étrangers l’un à l’autre, l’instinct populaire rétablit l’accord et remédie au défaut de symétrie en créant des expressions nouvelles. C’est ainsi qu en français moderne quint, dîme, qui étaient les représentants naturels de quintus, decimus, mais dont la ressemblance avec cinq, dix était ou effacée ou trop peu explicite, ont été remplacés par cinquième, dixième. La même reconstruction avait déjà eu lieu dans les langues anciennes. Il ne faut donc point essayer, comme s’y efforce notre auteur, de ramener à une forme commune le latin oclâvus et le sanscrit ashtama-s2. Ces mots n ont point le même suffixe et la grammaire comparée doit ici reconnaître des dérivations différentes.
1 Le gothique a consciencieusement rétabli le mot entier : taihun-taihund rrcent ».
* Voyez tome lt, page *2 45.
LES PRONOMS. ,
Quand on remonte jusqu’aux premiers temps du langage, la différence entre les pronoms personnels et les pronoms démonstratifs s’efface. En effet, le geste, qui était le commentaire naturel de la parole, servait à faire comprendre si l’homme se désignait lui-même, ou s’il voulait parler de celui à qui s’adressait sa voix, ou s’il pensait à quelque personne ou à quelque objet éloigné. Il ne faut donc pas s’étonner de retrouver parmi les pronoms démonstratifs les mêmes racines que l’usage a également affectées aux pronoms personnels. La syllabe ma, qui désigne le moi, fait partie intégrante du thème composé i-ma cf celui-ci tî. La syllabe a, que Bopp reconnaît avec raison dans le nominatif a-ha-m « je*, fournit aussi le premier élément de a-ya-m « ille *» 16-
Gependant, il faut que la distinction entre les pronoms personnels et les pronoms démonstratifs, sans être primitive, soit fort ancienne, car elle s’est traduite par une différence très-caractéristique, à laquelle participent tous nos idiomes. Les pronoms «moi, toi^ ne prennent point la marque du genre, soit que le langage ait jugé inutile de distinguer le sexe en des pronoms qui supposent la présence de la personne désignée, soit que la flexion de ces pronoms ait déjà été arrêtée en ses traits principaux avant la création du féminin. Quant au pronom personnel de la troisième personne, c’est-à-dire au pronom réfléchi cr soi n, il se dispense également de l’expression du genre : il a pu d’autant plus aisément s’en passer, qu’employé toujours aux cas indirects, il figure seulement dans des phrases où l’action fait retour sur un sujet déjà connu.
La déclinaison des pronoms offre un certain nombre de particularités qui n’ont pas encore trouvé toutes une explication satisfaisante. L’une des plus remarquables, c’est l’addition du thème pronominal sma, qui a lieu régulièrement en sanscrit et en zend à certains cas des pronoms de la troisième personne. Ainsi le pronom ta fait au datif tar-smâi, au locatif ta-smin, à l’ablatif ta-smât. Nous avons déjà ici un exemple de la facilité avec laquelle les thèmes pronominaux se juxtaposent et se soudent entre eux.
Dans les pronoms de la première et de la seconde personne, le thème sma figure aux cas du pluriel, et sa présence en ces mots doit être très-ancienne, car elle est attestée par le grec17, par le gothique et le lithuanien2. On lira avec intérêt les ingénieux paragraphes où M. Bopp, analysant les pronoms a^smê «nousu, yu-shmê crvousn, donne de la présence du thème sma une raison toute logique et philosophique. C’est que le moi, selon Bopp, ne
peut pas avoir de pluriel : quand je dis tt nous a , j’exprime une idée qui comprend à la fois le moi et un nombre indéterminé d’autres individus qui ne sont pas moi. Le pronom a-smê est donc un composé copulatif signifiant <f moi [et] eux n18. Notre auteur se rencontre ici avec Apollonius Dyscole, qui, traitant du pronom, avait fait des observations analogues sur la compréhension logique des mots et nous fl et (r vous a2.
Arrêtons-nous quelques instants aux agglutinations pronominales. Elles ne se font pas toutes de la meme façon. Ou bien, ce sont des thèmes non fléchis qui se soudent ensemble, et le dernier seul prend les flexions casuelles : c’est ce que nous venons de voir pour les pronoms a-smê, iju-shmê. Ainsi sont formés en sanscrit les thèmes composés a-na, i-ma, ê-la, ê-ka3; en grec, clv-to-s; en latin, û-nu-s (archaïque oi-no-s'j. C’est la composition la plus ancienne et la plus organique. Ou bien, les deux pronoms, simplement juxtaposés, se déclinent l’un et l’autre : tel est, en grec, le pronom vstis; en latin, le pronom quisquis. Ou enfin, le premier membre du composé se fléchit, et le
second, qui est traité comme une particule enclitique, reste invariable. G est ce que nous trouvons, par exemple, dans le sanscrit kaç-cit, kaç-cana, dans le grec ô-^s, dans le latin i-dm.(pour ü-dem), qui-dam, qui-cunque, hi-c, quis-que.
Ces trois sortes de composés représentent trois états successifs de la langue. On voit quelquefois un même pronom passer de l’un à l’autre. Le grec 6Ss pouvait encore fléchir son second terme au temps d’Homère et d’Àlcée, comme le prouvent le datif toï$S&gi et le génitif tSjvSsojv. Le latin hi-e déclinait anciennement les deux thèmes pronominaux dont il est composé, si nous en croyons la forme heicei conservée sur une inscription1. Ces mots nous montrent comment la vie grammaticale se retire peu à peu du second terme : privé de l’accent, ne faisant d’ailleurs que répéter les désinences du premier pronom, il perd une déclinaison qui paraît superflue, et il descend alors à l’état de simple enclitique.
A côté de ces formations, il faut mentionner les irrégularités et les bizarreries du langage. On ne peut guère expliquer le latin is-te que comme un composé dont le premier membre est un nominatif masculin pétrifié19 20. Tandis que le pronom ipse, au temps de Scipion l’Africain et de Plaute, fléchissait sa première partie et laissait la se-
coude invariablele latin classique a fait passer la flexion à la fin.
C’est le besoin de donner plus de corps à ces mots, joint au désir de montrer plus expressément les objets en accumulant les racines indicatives, qui a fait creer tant de pronoms composés. On sait combien les idiomes modernes sont allés loin.dans cette voie : il suffit de citer l’italien stesso, le français celui-ci. Dans notre mot même, on découvre plus de thèmes pronominaux qu il ne contient de lettres. Les langues anciennes, sans avoir porté l’agglutination aussi loin, ont pourtant donné des mots comme toctovtos, TtfXtKOVTOs, quicutique, qui ne le cedent guère à ces exemples. C’est ce penchant des pronoms à s’attirer les uns les autres qui a, suivant une théorie tres-vraisemblable, produit les génitifs et datifs latins comme ülius, illi, dont pendant longtemps on na su donner aucune explication plausible2. Mais l’exemple le plus curieux est sans doute le pronom de la première personne cfjett, en latin ego, en sanscrit aham : dans ce pronom, que la philosophie se plaisait, il y a trente ans, à proclamer un mot indécomposable et irréductible, 1 analyse philologique a découvert trois racines différentes3.
Nous dirons maintenant quelques mots des divers thèmes
1 Opéra, Jadis, consiliis reque eapse bem méritas (Festus, au mot reque).
— Eampseanum (Plaute, Aul. V, 7).
2 Voyez la théorie exposée par M. Fr. Meunier dans les Mémoires de la
Société de linguistique de Paris, I, p. ih.
3 Aham, pour agham, se compose : i° du thème démonstratif a; a0 du thème gha, qui existe en sanscrit comme enclitique et qui a fourni au grec lu particule yè\ 3° de m, désinence du nominatif dans les pronoms (comparez Iva-tn, a-ya-m. i-da-m).
général
pronominaux que Fauteur a réunis sous le litre de : (c Pronoms de la troisième personne b1.
La première et la seconde personne n ont point de thème spécial pour marquer l’action réfléchie; on trouve, par exemple, le même accusatif dans cette phrase « il me regarde * et dans cette autre ce je me regarde*. Au contraire, à la troisième personne, ce n’est point le même pronom qui est employé comme régime dans «je le regarde* et dans «il se regarde*. La raison de cette différence est facile à comprendre : pour celui qui parle, il n’existe qu’une seule première et qu’une seule seconde personne. Au contraire, le domaine de la troisième personne est sans limites, et il importe à la clarté du discours que parmi les nombreux thèmes de la troisième personne, il y en ait un qui soit spécialement employé quand il s’agit de marquer le retour de Faction sur le sujet. Ce pronom est si nécessaire que les langues qui Font perdu, comme l’anglais21 22, ou qui Font rendu indéclinable, comme le sanscrit, ont du le remplacer soit par une circonlocution ( him-self), soit par un substantif (âtman ce esprit, âme*).
Quelques idiomes emploient sva comme le pronom réfléchi par excellence, de sorte qu’il signifie tour à tour «moi-même, toi-même, soi-même*. Le grec savroC, par exemple, dont la partie initiale è n’est pas autre chose que le thème sva, peut avoir ces trois significations23. En an-
ci en slave, éitim san veut dire «je m honorer, quoique la traduction littérale soit cchonoro se^; de meme, citesi san (f tu t’honores v, littéralement cr honoras se^. Il est difficile de décider si le pronom sva a eu dès l’origine cette aptitude générale à représenter toutes les personnes, ou si c’est par une sorte d’abus qu’il a pénétre de la troisième dans la seconde et dans la première. On verra plus loin les conséquences que notre auteur a tix*ees de ces faits
pour l’explication du passif latin \
Si la différence entre les pronoms personnels et les pronoms démonstratifs s efface quand on remonte le cours des Ages, à plus forte raison devons-nous regarder comme d’origine secondaire les distinctions que 1 usage a établies entre les pronoms démonstratifs, interrogatifs, relatifs et indéfinis. Les thèmes pronominaux avaient dans le principe une signification indéterminée qui les rendait tous également propres à remplir tour à tour ces différentes fonctions. C’est petit à petit, à mesure que le langage s’est fixé, et grâce à une syntaxe plus savante, que la spécialité des pronoms a commencé à se dessiner. L’étude des suffixes nous ramène à une période où ka, ya, na, ta étaient synonymes. Les pronoms composés ont gardé aussi quelque chose de cet état flottant du langage. Tandis que le thème ka, employé seul, sert à l’interrogation, nous voyons que dans le composé êkn k un m il figure avec un sens affirmatif. Ainsi qu’il arrive souvent, le compose nous a conserve
l’acception la plus ancienne.
Une des tâches de la grammaire comparée sera de re
t
voyez S 476 et suîv.
chercher à quelle époque la spécialité de la fonction a commencé pour les pronoms. II n en est qu un dont on puisse affirmer avec certitude qu il avait reçu un emploi distinct dès avant la séparation des idiomes aryens : nous voulons parler du thème précité ka, auquel, dans toute la famille, est dévolue la fonction interrogative. Pour tous les autres, le doute est permis. M. Bopp parait supposer que le thème ya avait dès la période indo-européenne le rôle de pronom relatif que nous lui voyons en sanscrit. Mais si l’on examine les dérivés du thème ya, dont la plupart sont purement démonstratifs1, si Ton songe qu’en latin et en gothique la fonction du pronom relatif a été imposée par surcroît au thème ka, si l’on prend garde enfin à l’emploi du pronom ya dans les textes védiques24 25, on est amené à penser que la spécialité de la fonction ne remonte pas pour ce thème aux temps reculés où M. Bopp a cru pouvoir la fixer. L’exemple de l’allemand, qui emploie der dans le même sens que welcher, montre avec quelle facilité une langue peut infuser la signification relative dans un thème pronominal quelconque26.
Rien n’est plus naturel que de rencontrer comme article dans une langue le même mot qui est pronom démons-
tratif dans une autre. Ainsi le thème la cr celui-ci n, qui a fourni la seconde partie de clv-tos et de is-le, est devenu l’article en grec et en gothique. Le thème composé ma, qui a donné à l’irlandais son article an tr le n, conserve sa qualité de pronom en sanscrit et dans les idiomes letto-slaves. La création de l’article est due au môme besoin de montrer les objets qui avait fait inventer d’abord les suffixes et les désinences, et qui a poussé quelques idiomes à incorporer un pronom aux adjectifs. De même que les désinences ont perdu petit à petit leur signification démonstrative pour n’avoir plus qu’une valeur logique, de même aussi l’article : grâce au progrès de la syntaxe, il n’a plus guère servi qu’à l’agencement de la phrase et à la perspective grammaticale.
Parmi les pronoms démonstratifs proprement dits, les langues, arrivées à une certaine culture, font ordinairement un choix, et emploient les uns pour désigner les objets rapprochés, les autres pour marquer ce qui est situé au loin. Il est clair que cette distinction, qui appartient surtout à la langue écrite, n’a rien de primitif. A l’origine, les thèmes qui voulaient dire c? celui-civ pouvaient signifier aussi « celui-là v. La véritable fonction des pronoms, dit M. Bopp, est de désigner une personne ou une chose : c’est l’esprit qui supplée le lieu plus ou moins éloigné.
Cette remarque conduit M. Bopp à 1 une de ses explications les plus ingénieuses et les plus profondes. H s’agit de rendre compte de la négation. Dans la plupart des langues de la famille, la négation est exprimée par la
syllabe na1 : or, cette même syllabe a d’autres fois une valeur purement démonstrative. Elle entre en composition dans les pronoms ana « celui-ci 77, êna (mênfie sens)2; et si nous remontons jusqu’aux textes védiques, nous trouvons une particule na qui est employée avec le sens démonstratif ou relatif, pour signifier rtde même que, comme377. Partant de ces observations, fauteur n’hésite point à rattacher la négation à la racine pronominale na. Puisque l’affirmation est partout marquée par une expression pronominale, par i-ta en latin, par ta-thâ en sanscrit, par ja ou jai en gothique, le contraire de l’affirmation doit pouvoir s’exprimer à l’aide d’un mot qui formera avec elle la même antithèse qu’en latin classique crillud» avec «hoc 77. Na ne sera donc pas, à proprement parler, une négation, mais un pronom servant à marquer l’éloignement. Et, en effet, de ce qu’on me refuse une qualité, il ne s’ensuit pas qu’on supprime cette qualité : on se contente de l’éloigner de mon voisinage ou de ma personne4. Si, en outre, nous songeons que le geste était l’accompagnement obligé de toute racine pronominale, nous par-
1 Sanscrit na, latin ne (nëfas, nëqueo), gothique ni, ancien slave ne ou ni, grec vïj (vrfxepeaç, vrjxrfirfs). Le latin non est une abréviation de nœnum, pour ne otnum; l’allemand nicht est la réunion de deux mots qui sont encore séparés en gothique : ni vaiht rrnon quelque chose».
,2 ^ c/itt correspond le latin oino-s (plus tard unu-s), le grec oïxnj (Tas au jeu), le gothique ain-s (run». Nous trouvons aussi le thème pronominal na dans le grec èneï-vos.
3 En latin, nam est au thème na ce que quam, tam, jam sont aux thèmes ha, ta, y a.
4 On peut comparer, dans nos langues modernes, les locutions comme ; «Loin de moi la pensée.. . », ou : «loin de songer à... ». Ces tours équivalent à des négations.
c.
iu.
viendrons à comprendre comment la particule na a pu
prendre le sens qui lui est resté27.
Ainsi tombe la ligne de démarcation qu a priori on serait tenté de supposer entre les mots affirmatifs et négatifs. Les particules grecques où et prt (= sanscrit ma), 1 a privatif se rattachent également à des thèmes pronominaux.
A vrai dire, on eût été en droit de s etonner, si le langage dans son enfance avait trouvé un signe spécial pour 1 idee absolue de la négation, quand la plus savante et la plus abstraite de toutes les langues, l’algèbre, pour marquer les quantités négatives, a recouru à un signe qui, pris en lui-même, ne marque pas autre chose que lidée positive
de retrancher. ; Ç i
Si du sens des pronoms nous passons à leur forme, nous trouvons également matière à nombreuses observations. M. Bopp a montré, par exemple, qu’à côté du thème interrogatif ha, il existe deux thèmes secondaires ki et ku, dont au moins le premier a laissé des dérivés dans les langues de l’Europe. En latin, la déclinaison de quô (= sanscrit ka), devenue défective, s’est complétée a l’aide du thème qui (= sanscrit ki) : c’est ainsi qu’à côté du génitif pluriel quorum nous avons le datif-ablatif quibus, et à côté de l’accusatif féminin quam, le masculin quem. Cette double déclinaison apparaît encore mieux dès qu’on y joint les adverbes, les prépositions et les conjonctions qui en sont comme des fragments détachés : ainsi la conjonc-
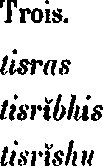
tion quum est le masculin de quamx, quia est le pluriel neutre de quid.
L’observation de notre auteur aurait pu être généralisée : la plupart des thèmes pronominaux se présentent à nous sous une triple forme, cest-à-dire qu’ils ont tour à tour les voyelles a, i et u. A côté du thème ta, il a dû exister un thème secondaire ti, auquel se rapportent les formes latines aur-tem et i-tem; à côté de na, nous avons ni qui a donné nem~pe, et nu qui est resté en sanscrit comme particule interrogative, et dont peuvent être rapprochés le grec vv et vvv. Cette faculté de transformation de la voyelle est un des traits qui distinguent les racines pronominales des racines verbales2.
Nous n avons pas l’intention de passer en revue tous les thèmes de la troisième personne. Leur grand nombre a été la cause principale de la richesse et de la flexibilité de nos idiomes, car ils se retrouvent à peu près tous comme suffixes, et, en se combinant entre eux, ils ont permis de multiplier presque a 1 infini les dérivés d’une racine. De plus, ils ont donné naissance à ces innombrables particules qui sont comme les jointures du discours, et auxquelles nos langues doivent le mouvement, la souplesse et la force de leur syntaxe.
Nous passons maintenant à' la classe des mots que
La préposition cum est originairement identique avec la conjonction
quum : le propre de ce mot est de marquer la concomitance. Suivi d’un
verbe, il signifie «en même temps que»; devant un nom, il veut dire «avec».
* f tbème ma> nous av«ns une forme mi dans ïe sanscrit ami-
sham y amîhkis, et une forme mu dans anrnm, amûni.
c.
i\l. Bopp appelle er adjectifs pronominaux^. Le propre des pronoms, selon la définition de notre auteur, étant de désigner des personnes ou des choses, les mots tels quemeus, tuus, suus, talis, tantm, ô<tos, 'tàoïos ne peuvent être des pronoms, mais seulement des adjectifs pronominaux. En tête de cette classe, on trouve les adjectifs possessifs. De même que nos idiomes ont remanié à plusieurs fois leurs noms de nombre ordinaux pour les maintenir d’accord avec les nombres cardinaux, de même ils ont refait les adjectifs possessifs pour les tenir, autant que possible, en ligne avec les pronoms personnels. Il ne faut donc pas plus chercher à rapprocher meus de ê(ios que du slave mo-j. Mais à défaut des mots eux-mêmes, on peut comparer les modes de formation : on arrive, sur ce point, à des observations intéressantes.
L’une des plus importantes, c’est l’échange constant et réciproque qui existe dans toutes les langues entre l’adjectif possessif et le génitif du pronom personnel ou démonstratif. Tantôt nous voyons, comme en latin, que le pronom personnel, ayant perdu son génitif, emprunte simplement la forme qui lui manque à l’adjectif possessif correspondant; ainsi meî n’est pas autre chose que le génitif de meus, noslrî celui de noster, et nostrum (formé comme deum, cœlicolum) est le génitif pluriel du même mot. D’autres fois, c’est l’adjectif possessif au neutre ou privé de flexion qui sert de génitif au pronom personnel : tels sont asmâkam ce de nous* (littéralement et nôtres), yushmâkam ce de voustî (littéralement et vôtres) en sanscrit, meina cc de moi «n (littéralement et mon tî) , unsara ce de nous \ (littéralement et nôtres) en gothique. ’
Mais nous avons aussi des exemples de l’échange inverse, et le génitif des pronoms personnels ou démonstratifs peut donner naissance à un adjectif possessif. C’est ce qui a eu lieu pour le français leur et pour le latin eu-jus9 cuja, cujum. Nulle part cet emprunt n’est aussi curieux à étudier que dans les langues germaniques. On sait qu’en allemand et en anglais le pronom possessif n’est pas le même si c’est d’un homme ou d’une femme que je parle, que dans le premier cas, par exemple, et son habit * se dira sein kleid, his cloth, mais, dans le second, ihr kleid, lier cloth. Cette faculté, qui à première vue semble une invention des langues germaniques, s’explique très-bien du moment qu'on sait que ces pronoms possessifs proviennent d’anciens génitifs du pronom (fil, elle*».
Le chapitre que nous analysons se termine par un certain nombre de rapprochements où l’on ne reconnaît pas toujours le coup d’œil habituellement si sur et si juste de notre auteur. Quand, par exemple, il l’etrouve dans le grec tifklms le sanscrit tddriça crteK, quand il identifie tuvunt et Ttjfiogy tadîya et toios, quand il pense découvrir dans l’adverbe Trivinc/L le substantif sanscrit nie
O
cr nuit h, nous devons convenir qu’il dépasse les bornes de la méthode comparative. Mais au temps où M. Bopp avait présenté pour la première fois ces rapprochements, on n apercevait pas encore assez clairement la limite que la science nouvelle devait se détendre de franchir.
LE VERBE.
LA. RACINE ET LE THEME VERBAL.
eH*
Le verbe est la partie de nos idiomes la plus anciennement développée et celle où ils présentent les ressemblances les plus frappantes et le parallélisme le plus con-inu. La conjugaison est, en outre, une des deux pièces essentielles de notre mécanisme grammatical. On ne peut donc pas s’étonner que M. Bopp ait, de tout temps, montré pour l’étude du verbe une sorte de prédilection. Il en avait /ait le sujet de son premier écrit; il y a consacré plus du quart de sa Grammaire comparée. Ce sont, sauf quelques défaillances, les chapitres les plus remarquables de l’ouvrage : sur certains points, il ne reste rien à ajouter
aux explications de notre auteur1.
Réduit à sa forme la plus simple, le verbe se compose de deux racines juxtaposées : l’une attributive, comme ad (t manger n, bhâ ce briller n; l’autre pronominale, comme nia crjeD, ta «ilSoit que la seconde syllabe, étant dépourvue de l’accent tonique, ait pour cette raison affaibli sa voyelle, soit que nous ayons devant nous un theme secondaire28 29 30 31, ma est remplacé par mi et ta par li. Ainsi ont été formés ad-mi crje mange v, bhâ-li « il briller. Ce verbe
présente donc la même combinaison de racines que le nom. On se rappelle, en effet, que les mots comme ducs, pXdys renferment une racine attributive suivie d’une racine pronominale (sæ). Mais le rapport entre les deux termes n’est pas le même : si nous appliquions à cette syntaxe intérieure les dénominations que l’analyse logique nous a rendues familières, nous dirions que dans ducs le pronom démonstratif est construit en apposition avec l’idée de conducteur, tandis que dans bhâ-ti le pronom est sujet et bhd attribut.
Tous les verbes ne présentent point une construction aussi simple, de même que tous les substantifs ne sont point des mots-racinesQuand on considère des verbes comme SiSo-fxev, Sslx-vv-fxev , Sda-vct-fisv, (pevy-o-fisv, tU7T—To—fisv, Sax-vo-fisv, Xctfxê-dvo-fxev, et qu’on les compare aux racines So, Six, Sol[x, (pvy, tw, Sax, Àa£, on s’assure que différentes syllabes peuvent s’insérer entre la désinence et la racine verbale, qui elle-même peut être redoublée, ou renforcée, ou nasalisée. Ces modifications donnent lieu à une distinction importante : celle de la racine et du thème verbal. A côté de <pvy nous avons un theme (pevyo ou (psvys, à côté de Xa£ on a Aajxëavo ou ’k&fiScLVQ, à coté de oajx nous trouvons Sctfivtf ou Sccfivoc, à coté de So Ion obtient StSw ou SiSo. Tandis que la racine demeure toujours la même, le thème, c’est-à-dire la partie du verbe qui reste après qu’on a retranché les désinences personnelles, varie selon les temps, les modes, et même quelquefois selon les personnes2.
1 Voyez S 111.
A 1 optatif, par exemple, nous avons pour thème fisvyoi, au subjonctif
Les modifications et insertions dont nous venons de parler n’ont pas lieu à tous les temps, mais seulement au présent et à l’imparfait. On est convenu d’appeler ces temps cries temps spéciaux», par opposition aux «temps généraux n, où ces modifications et insertions manquent.
Les grammairiens indous ont divisé tous les verbes en dix classes, d’après la forme que prend le thème dans les temps spéciaux. Ainsi, pour donner une idée de cette division, les verbes qui, comme Awr, <pvy en grec, renforcent leur voyelle radicale et insèrent une voyelle devant les désinences (Aswr-o-fAsr, (pevy-o-(isv), composent la première classe; les verbes qui, comme ôp-vv-fisv, Ssik-vv-fxsv, intercalent la syllabe nu entre la désinence et la racine, ont été placés dans la cinquième classe; ceux qui prennent un redoublement, comme Tids-pe-v, StSo-pev, appartiennent à la troisième; ceux qui adjoignent immédiatement la désinence à la racine, comme ecr-f/iv, <pa-fiév, constituent la seconde. Il faut se reporter au premier volume de la Grammaire comparée (S 109a) pour trouver le détail de cette classification, qui peut s’appliquer, avec de légers changements, à toutes les autres langues de la famille. Les modifications et insertions qui servent de critérium ont été nommées pour cette raison les caractéristiques des classes.
Notre auteur, en reproduisant cette division, se montre le disciple des Indous. Mais concurremment avec celle-ci, M. Bopp en établit une autre qui est son œuvre propre,
(psvya ou Çsvyrj, à l’imparfait èÇevyo ou è<pevye, à l’aoriste ê(pvyo ou è<pvye. Au présent singulier, nous avons SfS&J, au présent pluriel et duel et qui a le mérite de pénétrer plus profondément dans l’organisme de nos idiomes. Gomme la classification des Indous, elle s’applique seulement aux temps spéciaux, car dans les temps généraux la conjugaison de tous les verbes est la même. Nous exposerons brièvement en quoi elle consiste, et pour être plus clair, nous emprunterons autant que possible nos exemples à la langue grecque.
Sur un certain nombre de points, les verbes grecs se divisent nettement en deux catégories. Premièrement à l'optatif.* A côté des formes (pép-o-fisv, (p&vy-o-fisv, TU7r-To-jxet% SâK-vo-fjLsv, XocpL&-divo-fxev, nous avons les optatifs
(pép-0-L-[ieV, TV7T-TO-l-flSV, §<XK-VO-i-(XSV^ XoL[l€-&VO-l-fA£V,
qui se distinguent seulement de la personne correspondante de l’indicatif par l’addition d’un «. Au contraire, les verbes comme èa-fiév, Tide-fiev, SiSo-çiev, ïc/la-fiev prennent à l’optatif, non pas seulement un <, mais la syllabe trf : é(<r)-«7-jxeî>, Ti6s-(rj-fisv, SiSo-irj-pzv, idla-irf-fiev. II ne faudrait point croire que cette différence soit particulière au grec : on la retrouve, exactement pareille, en sanscrit, où bhar-a-i-ma «que nous portions * correspond à (pép-o-t-fisv et (fys-yâ-ma «que nous soyons?) à è{cr)-iy-pzv* Les mêmes verbes qui diffèrent de la sorte à l’optatif se séparent également à l’impératif, comme on peut s’en assurer en comparant <pip-e, Sâx-vs, tutt-ts à h-Qt, StSte-OiÔfAvv-Oi, et le sanscrit bkar-a, «porte!* à ê-dhi «sois!*, yung-dhi «joins!*. Une troisième différence non moins marquée se trouvait au subjonctif; tandis que <pep&),
1 ÀXU, &vct<r<T, ïkrfQi, hihoô&t poi nXéos èad'kàv.
Odyssée, III, 38o.
Àe/ir« ont partout au subjonctif un w ou un lancien subjonctif de Ifisv est ibftsv. Mais le temps a fini par effacer cette différence, en grec comme en sanscrit. Enfin il existe un quatrième point sur lequel ces verbes se séparent : c’est qu’à certains temps, par exemple au présent de l’indicatif, les verbes comme (psvyco ont un theme invariable devant les désinences du singulier, au pluriel et du duel, tandis que les verbes comme Tiôrffu ne présentent pas le même thème au singulier qu’aux deux autres nombres. Tandis qu’on dit, par exemple, (pevyoy et (psv-yofisv, nous avons sïfit et ijisv, MSeofii et SiSofiev, Ssixvvfii et Ssixpvfi&vî et de même en sanscrit, tandis quon dit bhara-si « tu portes et bhara-tha « vous portez r>, nous avons é-wii crje vais■» et i-wuis ou i-tnosi nous allons^. Comme on le voit par l’accord du sanscrit et du grec, toutes ces différences remontent à la période indo-européenne : des avant la séparation de nos idiomes, les verbes comme (pevyto s’éloignaient sur au moins quatre points essentiels des verbes comme StSœfit1.
Ce sont là les faits qui ont amené M. Bopp à établir deux conjugaisons principales (haupt-conjugationen). Dans la première, il place les verbes comme (pevyv, Aaft&mo, TU7rîco; dans la seconde, ceux comme sipJ, rtOïïfM, SeU-vvfu* Ainsi que le doit faire une bonne classification, celle de notre auteur s’applique à plusieurs caractères qui
a
1 Les optatifs dits attiques, comme (ptXotyv, Ttpwyv, Zyhtlijv, semblent contredire cette classification. Mais e’est là très-probablement une flexion moderne, imitée de la conjugaison en fit, pour éviter une contraction excessive. U est difficile de croire que les verbes comme ttfiaa,
qui sont les.plus récents de tous, puisqu’ils répondent a la dixième classe sanscrite, soient restés à l’optatif plus archaïques que les autres.
^3
ter
$
h
(sauf les altérations apportées par le temps) se retrouvent constamment ensemble et ne vont point l’un sans l’autre. Ce qui prouve, en outre, que cette division est conforme à la nature des choses, c’est que la séparation en deux conjugaisons principales, qui avait déjà lieu dès la période indo-européenne, s’est encore élargie dans la suite des siècles, et que de nouveaux caractères distinctifs sont venus s’ajouter à ceux qui existaient d’abord. En grec, par exemple, les verbes de la première conjugaison principale se distinguent à l’indicatif présent de ceux de la seconde. On a, d’une part, (pépca, et de l’autre T/d#pu, (pépsts et tidrfs, (pépet et tiûtfai.
C’est là, il est vrai, une différence secondaire et de date relativement récente, car en sanscrit tous les verbes sans exception ont à l’indicatif présent les désinences mi,, si, ti. Mais ce n’en est pas moins une confirmation de la théorie de notre auteur. On en peut dire autant des différences qui se sont introduites à l’infinitif (ndévcu, Àvem) et au participe (rideis, Àvcw). Les grammairiens grecs, qui ont divisé leurs verbes en deux catégories, et qui les ont désignées d’après la première personne de l’indicatif présentée sont donc rencontrés avec les linguistes modernes, ou plutôt M. Bopp, s’appuyant sur un ensemble de faits en grande partie inconnus à l’antiquité classique, a confirmé, approfondi la division qu’une observation nécessairement incomplète avait fait établir. À la première conjugaison principale de Bopp correspondent les verbes en œ, à la seconde conjugaison principale, les verbes en pu1.
Le sanscrit également a ajouté des différences nouvelles à celles qui exis-
Mais il ne suffit point de tracer une classification : autant que possible il .faut en indiquer le principe. Ici la théorie de Bopp ne va pas aussi loin qu’on pourrait le désirer. Pourquoi les verbes comme Çsvyc*.), tv7i7go, X&fx,-ne se conjuguent-ils pas comme eijx/, 7Idyfu ? II est facile de constater que les premiers font précéder la désinence personnelle d’une voyelle 0 ou s (= sanscrit a), qui tantôt constitue à elle seule la caractéristique (Xéy-o-fxsv, Ç>sp-s-ts), tantôt en est la partie finale (Sax-vo-fiev,
C est cette voyelle qui est l’occasion d’une partie des différences que nous avons signalées. Mais elle 11e saurait les expliquer toutes, au moins en dernier ressort, et il est nécessaire de faire intervenir une autre cause, dont M. Bopp a généralement tenu trop peu de compte, savoir l’accentuation.
Pour ne pas allonger outre mesure cette exposition, nous dirons en peu de mots que les verbes de la seconde conjugaison disposent de 1 accent tonique avec une certaine liberté, de sorte que nous le trouvons tantôt sur la désinence, tantôt sur 1 une des syllabes du thème verbal. Nous avons, par exemple, en sanscrit, ë-mi crje vais 15 et i-mds (r nous allons 15. Le changement de voyelle est le résultat de ce déplacement de l’accent, car il est dans la nature du langage de renforcer les syllabes qui reçoivent le ton et
iaient entre les deux conjugaisons dans ia période indo-européenne : à la troisième personne plurielle du moyen, les verbes de la première se terminent en ante y tandis que ceux de la seconde ont perdu le n et font atê (comparez bkarante et dvishatêj. Au participe moyen, les verbes de la première conjugaison prennent le suffixe mâna, tandis que ceux de la seconde ont ana. Le grec est resté étranger à ces distinctions : il a Çép-o-vrat et ride-vrai, <psp-à-(ÀSvos et ridé-pevos.
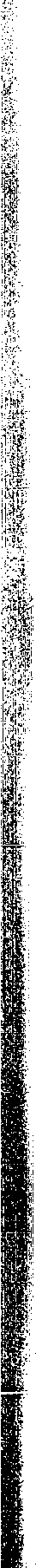
d’affaiblir celles qui en sont privées. Au contraire, les verbes de la première conjugaison n’ont jamais l’accent sur la désinence : ïo ou Ys (= sanscrit a'j constitue une limite que l’accent tonique ne dépasse point. Aussi le thème reste-t-il le même à toutes les personnes et ne subit-il ni renforcement, ni affaiblissement. On ne peut guère douter que les verbes comme eîf« ne soient d une formation plus ancienne que les verbes comme (pspco, et cette instabilité de l’accent est la marque d’une époque où l’union entre la désinence et la racine n’était pas encore également étroite à toutes les personnes.
Le grec ne présente plus qu’une image imparfaite de ces variations. Une loi générale a fait reculer l’accent sur la pénultième ou l’antépénultième; mais les effets de l’ancienne accentuation ont survécu. C’est pour cette raison que nous avons eï*xt et iftsv, Setnvvfu et Ssikvv(jl$v, Sdft-vtyftt et SocfivSfiepl. Les différences qu’on remarque à 1 optatif sont dues également à la place autrefois occupée par 1 accent tonique (comparez bhârêma cc que nous portions^ et dvish-yâ-ma cc que nous haïssions u), et il est permis de conjecturer que tous les autres faits qui séparent les verbes de la première conjugaison de ceux de la seconde, se ramèneront, en dernière analyse, à la même cause.
C est à M. Benfey qu’appartient le mérite d’avoir mis en lumière le rôle que l’accent tonique joue dans la con-jugaison32 33. Au temps où M. Bopp donna une forme définitive à sa théorie du verbe, les lois de l’accentuation sanscrite étaient encore inconnues. Aussi attribue-t-il à des raisons d’équilibre les changements phoniques qu’on observe dans ê'-mi et i-mas, dans bi-bhar-mi et bi-bhn-mas. Mie st une ce désinence légères, devant laquelle le thème verbal i se renforce; mas est une crdésinence pesantes devant laquelle bhar s’affaiblit. Mais si aux noms de désinences légères et pesantes on substitue ceux de te primitivement atones a et de « primitivement accentuées r>, les observations de notre auteur conservent toute leur justesse1.
S’il fallait une preuve nouvelle que les verbes en fit appartiennent à un âge plus reculé que les verbes en , on la trouverait dans ce fait que ceux-ci envahissent peu à peu la place des autres. Déjà dans les Védas les verbes de la seconde conjugaison sont les moins nombreux; en grec, ils ne forment plus qu’un petit groupe; en latin, on ne peut guère citer que quelques formes, comme es-t, da-t, fer-t; il en est de même en gothique et en ancien slave, où nous avons, par exemple, is-t « il est^, slave jes-ti (même sens)34 35. La première conjugaison, plus uniforme, plus facile, finit par évincer ou par absorber la seconde. Quand elle ne peut se substituer tout entière à l’autre, elle lui impose une partie de ses formes. Le verbe grec
Sstxvvfxt ce montrera appartient encore à la seconde conjugaison; mais il a déjà un subjonctif Setxvvw et un optatif Ssixvvoifit qui sont de la première
En établissant à côté des dix classes distinguées par les grammairiens indous sa division en deux conjugaisons principales, M. Bopp a donc eu le mérite de placer une classification historique en regard d’une division uniquement fondée sur l’analyse. Mais il est allé encore plus loin : il s’est demandé d’où provenaient ces éléments adventices comme a, ya, nu, nd, qui aux temps spéciaux viennent s’insérer entre la racine et la désinence, et il a réussi à montrer que ce problème, devant lequel un esprit moins intrépide aurait reculé, pouvait être résolu.
Nous avons vu plus haut que les verbes les plus simples se composent d’une racine attributive suivie d’une racine pronominale. Mais au lieu d’une racine comme bhar cr porter s, budh cr savoir s dhnsh te oser s, le premier terme peut |aussi bien être un thème, c’est-à-dire une racine combinée avec un suffixe, comme bhara reporteurs, bôdha ce intelligent, intelligences, dhrishnu ce hardi s. On aura alors des formes verbales telles que bhara-ti ce il portes, bâdha-ti ce il sait s, dhrïshm-mas ce nous osons s. Il en est de même en latin. Par exemple, la racine spak revoirs a donné le verbe specere (dans ad-spicere, con-spicere} ; mais de spec viennent aussi le thème spec-to (nominatif speetns), qui a
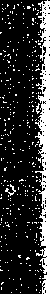
Tout récemment, M. Guillaume Scherer, dans un livre plein de vues hardies, a supposé que les verbes en co étaient les plus anciens. Il nous a été impossible de nous rendre aux raisons qu’il donne (Zur Geschichte der deuischen Sprache, p. 173 et suiv.).
donné spectare, et le thème speculô (nominatif spéculum), qui a fait speculari1.
Les grammairiens indous ont très-bien observé ces diverses formations; mais ils se proposaient de faire l’anatomie de leur langue, et ils ne songeaient nullement à en être les historiens. S’agit-il d’expliquer bhara-ti, bédha-ti. dhnshnu-mas ? Ils supposent que la racine bhar a inséré un a devant la désinence (bliar-a-ti), que la racine budh a fait de même et qu’elle a, en outre, renforcé sa voyelle ( bôdh-a-ti), que la racine dhrïsh a intercalé la syllabe nu devant sa flexion (dhrtshHfm-mas). En un mot, ils attribuent au mécanisme de la conjugaison des syllabes et des modifications phoniques qui appartiennent au thème. C’est l’ordre systématique, c’est l’extrême précision de la grammaire indienne qui nous font illusion; mais, au fond, l’erreur est la même que si nous disions que la racine spec peut se conjuguer en latin d’après trois classa différentes, et faire au présent de l’indicatif specio, speao ou speculor.
On peut objecter que spectare, speculari gardent les syllabes ta, ula à tous les temps, au lieu que les caractéristiques sanscrites apparaissent seulement au présent et à l’imparfait. L’objection n’a pas manqué d’être faite : M. Pott36 37, partant de cette idée que le présent et l’impar-lait sont destinés à marquer une action qui se prolonge, a voulu .voir dans les caractéristiques l’expression de la durée. Entre ë(pevyov et e(pvyov, entre ëk&ij£<zvov et IXa&*>, il y aurait donc une différence originaire de signification. Notre auteur répond à cette théorie par des arguments aussi nombreux que concluants1. Comment croire que des signes si différents aient tous servi au même usage ? Il n’est pas exact de dire que le présent marque la durée : c’est l’action qu’il exprime. Quant à la durée, elle est sous-entendue par l’esprit, si le sens général de la phrase ou si la nature intrinsèque de l’action la réclament. En sanscrit, il a toujours été impossible de découvrir une différence de signification entre l’aoriste et l’imparfait. II en est de même pour l’ancienne langue grecque2 : la différence que certains auteurs plus modernes ont pu mettre entre èTvyyctvov et ëjvyov, entre ëXenrov et ëXmov, est le fait d’un idiome cultivé et discipliné qui ne veut perdre aucun moyen de parier à l’esprit et qui ne veut laisser oisive aucune différence de forme.
D’où vient, cependant, que hors du présent et de l’imparfait les caractéristiques disparaissent, et que nous ne les trouvions, par exemple, ni au futur, ni au parfait? M. Bopp fait remarquer que ces temps ont à porter déjà soit un verbe auxiliaire, soit un redoublement, et que le langage a voulu éviter sans doute des formes trop pesantes. H aurait pu ajouter que nous trouvons encore
1 Voyez S 5i 1, remarque 3.
3 Voyez, sur ce sujet, l’article de M. Thurot, dans les Mémoires de lu Société de linguistique de Paris, I, p. au
a
m.
quelques traces des caractéristiques dans les temps généraux : c est ainsi qu’Homère nous présente les formes StSw-cretv, StSdjaofxev^ qui ont gardé au futur le redoublement de la racine 38.
On peut donc, avec M. Bopp2, diviser tous les verbes, selon leur provenance, en deux grandes catégories : les uns venant immédiatement de la racine, soit simple (classe 2), soit redoublée (classe 3); par exemple, Ttdy-fjLt.
Ce sont les seuls qui, à prendre les choses dans leur rigueur, méritent le nom de verbes primitifs. Les autres sont formés d’un thème nominal, et ils devraient déjà être appelés verbes dérivés, si l’instinct'grammatical, s’emparant des suffixes, ne les avait à la longue rendus mobiles, et n’en avait pas fait librement usage pour enrichir et varier la conjugaison.
Telle est la théorie de notre auteur, et la seule objection que nous songerons à lui faire, c’est de s’en être écarté deux fois sans motif. Renonçant aux idées qui l’ont guidé pour les autres classes de verbes, M. Bopp explique les verbes de la quatrième classe (mh-ya-ti cr il lie*) et ceux de la dixième (bôdha-yar-li il fait savoir *) par l’insertion d’un verbe auxiliaire i cfaller* ou î crdésirer*3. Le suffixe ya n’étant pas moins usité que les suffixes a et nu, on est en droit de demander à M. Bopp pourquoi il devient ici infidèle à ses propres idées. Mais nous aurons l’occasion de revenir sur ce prétendu verbe auxiliaire, qui reparaîtra
encore plusieurs fois dans les explications de notre auteur l.
LES DÉSINENCES PERSONNELLES.
Ce sont les désinences personnelles qui constituent le verbe. Partout où elles manquent, à l’infinitif, au participe, nous avons devant nous des formes nominales, non des formes verbales. Il est vrai que ces désinences peuvent s'émousser et même disparaître avec le temps. Elles manquent presque partout aujourd’hui en anglais, et elles font déjà défaut à certaines personnes du parfait sanscrit. Mais là où elles ont existé dans le principe, la signification verbale survit à la destruction du signe matériel, et il arrive souvent que notre esprit croit encore reconnaître la désinence là où elle a péri depuis longtemps2.
Nous avons déjà parlé des pronoms ma te je tî et ta «il* qui forment la première et la troisième personne3. Le pronom tva crtu*, qui présentait une plus large surface à
Une fois introduit par M. Bopp dans la théorie de la conjugaison, ce verbe auxiliaire s y est installé si fortement quon le retrouve chez la plupart des philologues. Tout récemment encore, il a reparu chez M. Curtius (De la Chronologie dans la formation des langues indo-européennes) et chez M. Max Müller (La Stratification du langage). [Ces deux opuscules viennent d’être
traduits en français et forment le premier fascicule de la Bibliothèque de 1 École des hautes études. ]
U n y a plus de désinence personnelle dans les formes grecques comme Atie, éAue, êXtara, éAvcre, AéAt/xa, XéXvxe.
3 Au sujet du pronom la, on peut observer que Je verbe, dans les langues mdo-européennes, s’abstient de marquer la différence des genres, soit”qne cette distinction n’ait pas encore existé au temps où furent créées les formes verbales, soit que le langage y ait renoncé, pour ne point surcharger le
l’altération phonique, et qui d’ailleurs risquait de se confondre avec le pronom ta, a subi d’assez fortes modifications.
Au pluriel et au duel, nous trouvons des désinences qui ne rappellent en rien les pronoms restés usités comme mots indépendants pour signifier ce nous, vous^. Mais il faut se rappeler que le langage avait sans doute plus d’une manière d’exprimer des idées aussi complexes; Selon l’explication la plus vraisemblable, la désinence védique masi vent dire <c moi [et] toi vl. De même, on peut supposer que la forme la plus ancienne de la seconde personne a été tvasi te toi [et] toir, quoique dès la période indo-européenne cette désinence semble avoir déjà perdu son i final. Au sujet de la troisième personne, les hypothèses les plus diverses ont été présentées. M. Bopp suppose que le n de bharanti crils portent^ est l’expression symbolique de la pluralité2; selon M. Pott, anti se compose des deux thèmes démonstratifs ana + ti. M. Ascoli a proposé une autre explication : bharanti serait un participe signifiant <tportante; comme dans le latin amamini, nous aurions ici une forme nominale ayant pris place au milieu de la conjugaison.
Parallèlement à l’actif, nous trouvons une série de désinences dont le propre est de marquer le retour de faction sur le sujet : ce sont les désinences de la voix moyenne. Elles ont fourni la matière d’une des plus
1 Le pronom tva n-toi» se serait altéré en si comme à la seconde personne du singulier bhara-si <rlu portes».
4 Voyez SS g 3 fi 0( 7i f> 8. m
belles découvertes de M. Bopp. Aussi nous y arrêterons-nous un instant.
Dès son premier ouvrage, notre auteur reconnut l’identité du moyen sanscrit et grec, et il rattacha à la même formation les débris du passif gothique. Mais il n’était pas aussi facile de dire quelle était l’origine de cette série de désinences. Quand on les compare à celles de l’actif, on voit qu’à la plupart des personnes elles s’en distinguent seulement par un certain élargissement du son. Ainsi bharati cril porter fait au moyen bharatê; (pépei (pour (pe-pscri, qui lui-même est pour (piper*) fait au moyen (pipera*. De même, le pluriel bharanti, en grec (pépovcn (pour pepovcr*, (pipovr*), correspond à un moyen bharantêy en grec (pépovrcu. M. Bopp se contenta d’abord de faire remarquer le changement de T* en a*. Un savant que nous avons déjà souvent cité, M. Pott, supposa que cet élargissement du son était peut-être destiné à représenter d’une manière symbolique l’action soufferte par le sujet1. Le moindre inconvénient d’opinions de ce genre, qui reposent uniquement sur une impression, c’est de ne pouvoir être ni démontrées, ni réfutées. L’expérience a prouvé qu’en dehors de la dissection des formes grammaticales il n’y a point de progrès possible pour notre science.
La vraie solution fut présentée simultanément et d’une laçon indépendante parM. Bopp et parM. AdalbertKuhn39 40 41.
Elle peut se résumer en ces termes : Les désinences du moyen contiennent deux fois le pronom personnel, une fois comme sujet, une autre fois comme régime. L’élargissement du son ainsi que la signification réfléchie ont leur raison d’être toute naturelle, du moment qu’on sait que bharalê est pour bharatati ou bharatâli1, et que (fiéps-rocf est pour (pspsraTt. Mais, d’un autre côté, on conçoit * aisément que le langage ait éprouvé le besoin d’alléger des formes aussi pesantes2 : le procédé une fois trouvé, on l’abrégea le plus qu’on put et l’on chercha plutôt à le dissimuler qu’à l’accuser.
Toutes les désinences du moyen n ont pas été analysées par M. Bopp avec un égal bonheur. Quelques-unes sont encore obscures aujourd’hui3. Au pluriel et au duel, où l’actif a déjà lui-même des flexions composées et contractées, il est difficile de distinguer parmi ce conflit d’éléments pronominaux quels sont ceux qui ont survécu.
habita (1837). Il est juste d’ajouter que Bopp avait préparé cette découverte par un passage de sa Gi'ammatica critica linguœ sanscrilœ (1882),
5 3oid. — M. Kuhn a de nouveau traité la question des désinences moyennes dans son Joumat, XV, p. 4oi.
1 Voyez S ^73.
2 Les contractions sont surtout fréquentes lorsque deux syllabes consécutives commencent par la même lettre. C’est la raison qui a fait disparaître le redoublement dans la plupart des verbes jalins et germaniques : on a, par exemple, ccpi pour cecipi, hielt pour le gothique haihald rrje tins». De même HtoutpfohâtrjwXos est pour KwpcpbohàaujKaXos. rérpaxi’tov pour te~ TpaSpa^pov, et en latin nutriæ, stipendinm pour milriiriæ, slipipendium.
3 Voir, sur ce sujet, l’article précité de M. Kuhn et un travail de
!V1. Misleli dans le même volume du Journal. Il y faut joindre le mémoire déjà mentionné de M. Bcnfey : Ueber cinigc Plumlbitdnnfjcn des indogentm-nischen Vcrbum, p. 3q et suiv. 1
Une autre découverte de M. Bopp concerne la création d un nouveau moyen en slave et en latin.
Nous avons déjà dit, à propos du pronom sm «soi*, (pie l’ancien slave l’emploie à toutes les personnes pour former des verbes réfléchis. On a, par exemple, cUun san «je m’honorer, éïtesi sait ce tu t’honores*, éüelï san «il - s’honore *. Mais l’agglutination du régime pronominal au verbe est un fait si naturel qu’en différents dialectes letto-slaves il n’a pas manqué de se produire. En lithuanien, par exemple, le pronom réfléchi, dont il ne reste que la lettre initiale s, est soudé au verbe actif. Ainsi wadina signifie « il nomme * et ivadinas cc il se nomme * ; ivadhmle cfvous nommez* et ivadinatës «vous vous nommez*. Du reste, quoique dans ces formes l’agglutination soit complète, le lithuanien sent encore la présence du pronom réfléchi, et il peut, dans certaines constructions, le placer avant le verbe.
Le latin, qui a perdu également l’ancienne voix moyenne, semble l’avoir remplacée de la même manière. Le s et le r qui terminent les formes comme lœtor, lœtaris, lœtatur, ont tout l’air d’appartenir au pronom réfléchi1 : les voyelles i, u qui précèdent le s ou le r servent à la jonction du pronom. D’après cette explication, lœto-r est pour Iœio-se, lœlar-i-s pour lœtas-se, lœtat-u-r pour iœ taise. M. Bopp veut analyser de la même manière toutes'les formes du passif latin : il se demande quels sont les éléments contenus dans lœtamur, lœter, lœtabar. Mass peut-être est-il juste de laisser une certaine place à l’analogie : le
1 Sur le changement de s en r, voyez S na. Gomme exemples de s changé en r à la fin du mot, on peut citer arbor, honor, major, robur.
procédé une fois trouvé, il a pu être étendu instinctivement à toute la conjugaison1.
Notre famille de langues, qui a su se donner une voix réfléchie, et qui, l’ayant perdue, a su la remplacer par une autre de formation nouvelle, paraît avoir éprouvé beaucoup plus de difficulté à marquer le passif. C’est en empruntant les formes du moyen et en les confisquant à son profit que le passif a fini par trouver une expression. Même dans nos idiomes modernes, où le passif est habituellement marqué par un verbe auxiliaire et un participe, nous recourons encore souvent à la forme réfléchie. H suffit de rappeler des locutions comme : « Cette écriture se lit bien. Ces événements se sont vite oubliés, t If en a été de même dans les langues anciennes. Le grec Xsys-tou , le latin dicitur, l’italien dicesi nous montrent donc le langage exprimant trois lois, à bien des siècles de distance, le passif par le moyen42 43. Les seuls idiomes qui soient parvenus à créer quelques formes appartenant en propre au passif sont le sanscrit et le grec; mais c’est par des caractéristiques insérées dans le corps du mot à la suite (le la racine, et non par des désinences spéciales, quils y ont réussi44.
H nous reste à dire quelques mots sur la double forme sous laquelle les désinences se présentent dans la conjugaison. Tantôt elles sont relativement intactes et pleines, tantôt elles sont mutilées ou émoussées. Quand on rapproche, par exemple, le présent de l’indicatif et l’imparfait, on s’aperçoit sans peine que les désinences de ce dernier temps sont moins complètes. En regard de :
bhârâmi, nous avons dbharam; bhdrasi, cibhüvüs ;
bhdraü, dbharat;
et à la troisième personne du pluriel, en regard de bhdranti, nous trouvons dbharan. Cette différence, sans être primitive, est pourtant fort ancienne, car elle se retrouve à la fois en sanscrit, en zend, en grec et en slave, et elle a laissé des traces en latin et en gothique.
M. Bopp a très-bien expliqué ce phénomène, qui est dft à une cause tout extérieure et matérielle. L’augment, en venant s’ajouter au verbe, surcharge la partie initiale du mot, de sorte que la partie finale s’est allégée. Il ne faut pas perdre de vue d’ailleurs que l’augment, à l’origine, attirait l’accent tonique sur la première syllabe,
comme il le lait encore en sanscrit. G est pour ces motifs que l’imparfait âdvish-ma <c nous haïssions » a une désinence moins complète que le présent dvish-masi et nous haïssons ». L’optatif prend également les désinences émoussées, ou, comme notre auteur les appelle, les désinences secondaires. Mais c’est à cause de la caractéristique^ ou i qu’il introduit dans le corps du verbe1. Il n’est donc pas exact, comme on le fait dans nos grammaires, de regarder les temps à désinences secondaires comme dérivés des autres, ni de supposer que cette différence dans la flexion impliquait par elle-même une différence dans le sens.
Les langues, en vieillissant, ont perdu ce juste sentiment de l’équilibre. Ainsi le latin, sauf à la première personne du singulier, efface toute distinction et introduit partout les mêmes désinences. D’un autre côté, tandis que le gothique, à la première personne du pluriel, met tantôt m et tantôt ma, le vieux haut-allemand nous présente partout la désinence mes. Cette uniformité n’est pas la preuve d’une plus grande antiquité ou d’un meilleur état de conservation : elle atteste, au contraire, les retouches faites par un âge postérieur, qui confond ce que l’ancienne langue avait distingué, ou qui restitue, par un besoin de symétrie, ce que les siècles précédents avaient laissé perdre. M. Bopp, sur ce point, n’a pas toujours été exempt d’erreur. Il suppose, par exemple, que l’arménien
4 1 II est vrai qii en grec, à la première personne du singulier, nous avons
la désinence primaire (u (fiépoipi); mais c’est là, selon toute apparence, une flexion rétablie après coup, comme le donne à penser, entre autres indices, la forme moyenne Çepoipyi* : en effet, si l’optatif avait les dési-
’ nonces primaires, nous devrions avoir (pépoif/at (SS et 689).
a pris une existence indépendante avant que la première personne ait fait la distinction des désinences primaires et secondaires1 ; mais une distinction qui existe en zend n’a pas dû être étrangère à l’arménien. H est bien plus vraisemblable de penser que ce dialecte, modifié et renouvelé sur tant de points, s’est donné à tous les temps une désinence uniforme. Par une illusion analogue, notre auteur croit reconnaître le sanscrit mas ou masi dans le vieux haut-allemand mês, quoique la longueur de \e, non moins que l’absence de Ys en gothique, dussent faire soupçonner une formation moderne2.
LES TEMPS ET LES MODES.
«Le langage, dit M. Bopp, n’a pas besoin d’un exposant spécial pour marquer le présent : celui-ci est « suffisamment indiqué du moment qu’il ny a point de « signe exprimant le passé ou le futur, n Le présent se l'orme donc par l’adjonction des désinences personnelles à la racine ou au thème verbal.
De quel signe nos idiomes se sont-ils servis pour exprimer le passé? Ils en possèdent deux : laugment et le redoublement. Les pages consacrées par M. Bopp à laugment sont au nombre des plus profondes qu il ait écrites. Non qu’il présente du premier coup l’explication la plus vraisemblable : sa première hypothèse, c’est que l’a de l augment est identique avec l’a privatif. Le passé aurait été marqué par la négation du présent. Quelle que soit
1 Vovez S h ho.
*> •
2 Ibidem. — Sur relie désinence mês, voyez Kuhn, dans son Journal. XVIII, p. 338.
la valeur de cette supposition, l’auteur, pour la justifier, entre dans une série de considérations sur la nature nécessairement incomplète et imparfaite du langage, qui ne sauraient être assez méditées, et qui s’adressent autant au philosophe qu’au grammairien1. Puis, il donne de l’augment une seconde explication beaucoup moins cherchée que la première, et que les progrès faits depuis dans la connaissance de la langue sanscrite ont rendue de plus en plus probable.
Il faut, selon toute apparence, voir dans l’augment une particule signifiant irjadis, autrefois*, qui, dans le principe, était indépendante, mais qui finit par faire corps avec le verbe. Cette particule a ou a provient sans doute du thème démonstratif a, que nous avons rencontré parmi les pronoms : abharat «■ il portait* vient donc de a ou â bharati fri! porte autrefois*. Les textes sanscrits nous présentent deux particules, sma et purâ, qui sont restées indépendantes, et qui, construites avec un présent, lui donnent pareillement le sens du passé2.
On vient de voir que c’est l’augment qui a fait prendre à l’imparfait et à l’aoriste les désinences secondaires. Ces désinences, à leur tour, rendirent l’augment moins nécessaire. Nous constatons, en effet, qu’il manque souvent dans la langue homérique, dans le dialecte védique et en zend.
/
1 Voyez S 537 et la Remarque au même paragraphe.
2 Benfey, Kurze Sanskritgrammatik, S i55. Sur la forme A, que nous retrouvons dans ^fxeAAoj», ï/8urdp/r, voyez Kuhn, dans les Beiirâge de Kuhn et Schleicher, III, p. 463. En sanscrit, les particules a et ât existent à tétai indépendant; mais elles ont pris d’autres significations.
L’augmeut se trouve à trois temps du verbe45. En s’ajoutant à ia racine, il a donné l’aoriste second. En se plaçant devant le thème revêtu des caractéristiques, il a fourni l’imparfait. En venant se joindre à la racine combinée avec le verbe substantif, il donne naissance à l’aoriste premier. Ce dernier temps, quoique le plus récent des trois, existait dès la période aryenne, car nous lé trouvons en sanscrit, en grec et en slave. Etant plus facile à former, il empiète petit à petit sur l’aoriste second, et il a même fini, en grec moderne comme en slave, par prendre entièrement sa place46 47.
Le second signe dont se servirent nos idiomes pour marquer le prétérit, c’est le redoublement. Tandis que l’augment est un élément étranger qui est venu s’ajouter au verbe, le redoublement n’est pas autre chose que la racine répétée. Toutefois, cette répétition n’a lieu d’une façon complète que dans un petit nombre de formes : par exemple aux aoristes grecs yyayov, «wpope, et aux aoristes sanscrits âididam trje priais (racine îd), âpipam cejobtinsu (racine dp)48. La plupart du temps, c’est seulement une partie de la racine qui figure dans le redouble-
ment : lud cr pousser n, bhar « porter n, stlui ce être debout v> , au lieu de faire au parfait tud-lôd-a, bhar-bltdr-a, stha-slbâu, ont donné lu-tôd-a, ba-bhdr-a, la-s (h du K Tous nos idiomes n’ont pas simplifié le redoublement de la même manière; quelquefois des dialectes voisins, comme le latin et le grec, le sanscrit et le zend, le gothique et le vieux haut-allemand, présentent à cet égard des différences sensibles2. Mais partout nous voyons le même effort pour dissimuler et pour atténuer ce qtie le redoublement en lui-même avait d’un peu surabondant et d’un peu lourd.
Il ne faudrait point croire que le redoublement ait eu, dans le principe, une signification très-nettement définie. Moyen d’imitation, procédé instinctif qu’on trouve dans toutes les familles de langues, il pouvait marquer la fréquence ou le surcroît d’énergie de l’action : c’est le rôle qu’il a dans les intensifs sanscrits et dans les verbes grecs comme yapyoUpw, fioLppLOLipœ, jSafiébuW. D’autres fois, il a servi à marquer le désir : aussi le voyons-nous figurer au désidératif sanscrit et zend. Quelquefois les verbes prennent le redoublement au présent et à l’imparfait sans que la signification soit pour cela sensiblement modifiée : rappelons seulement les verbes sanscrits de la troisième classe, comme dadâmi crje donner,, bibharmicr je porter, et en grec SlSwpa, nfypvfw. Le langage, en se fixant, attribua 45
un usage constant et distinct à ce signe d abord facultalii et indéterminé. Tous les verbes, à un certain temps de leur conjugaison, prirent le redoublement, qui marqua
l’accomplisse nient de l’action.
Le prétérit redoublé ou parfait est un des chapitres les plus difficiles de la grammaire de nos idiomes. M. Bopp, admirable sur le prétérit germanique, a présenté au sujet du parfait grec et latin des vues assez peu exactes. Nous nous y arrêterons donc un instant, moins pour mettre en avant de nouvelles explications, que pour essayer d’introduire un certain ordre parmi les faits à étudier.
Le parfait grec offre la trace de nombreux remaniements. Les formes les plus anciennes sont très-pix)bable~ ment celles où la voyelle radicale change, selon quelle est suivie des désinences du singulier ou de celles du pluriel et du duel. Tel est, par exemple, le parfait olSa, qui fait au pluriel ïSpsv. Nous avons aussi ëoixct, qui lait au duel sÏxtov. Comme on le voit, le pluriel et le duel joignent immédiatement les désinences à la racine. Cette jonction immédiate a subsisté à toutes les personnes du moyen : XéXeypat, yeypdfifisdcc, XéXvcxOov. En second lieu, nous trouvons des formes actives qui gardent partout leur a et qui ont aux trois nombres la même voyelle ou diphthongue radicale. Tels sont : xéroxa, rsToxafiev, tsâpeuya, '&s@svyoiTOV. Troisièmement, certains verbes aspirent la consonne devant l’a. Ainsi 'üsXsxù) fait tffs-Tiksyjx,, Xéyùô faitetXoyjx,rpsTtw fait TS7po(pcc. Quatrièmement, et ce sont selon toute vraisemblance les formes les plus récentes, un x est inséré devant l’a; exemples : XiXvxa, &p0apxa, ttfs<piXwa.
Il ri est pas impossible d’entrevoir la cause de ces remaniements. « C’est un fait qu’il faut avoir présent à l’es-reprit, dit Guillaume de Humboldt, que l’idée, pour se * manifester, a toujours une difficulté à surmonter : cette ce difficulté, c’est le son, et la lutte n’est pas toujours heu» ce reuse au même degré, n Au prétérit redoublé, la difficulté dont parle Guillaume de Humboldt provient du redoublement. Quoique nos idiomes aient cherché à l’alléger le plus qu’il leur était possible, le poids de cette syllabe nouvelle était trop grand pour qu’à la partie opposée du mot la flexion ne s’en ressentît pas. Il fallut, pour l’empêcher de tomber, le secours d’une voyelle de liaison a, et c’est sans doute au singulier, dont ies désinences, dépourvues de l’accent tonique, étaient le plus menacées, que cette voyelle s’introduisit d’abord. Au contraire, le moyen, dont les désinences portaient primitivement l’accent, n’eut jamais besoin de cet appui. Nous ne pouvons donc approuver M. Bopp quand il suppose que Tsrvrilai a supprimé un a (T£TV7raTû«), ni quand il admet la même suppression dans iî-[iev, sïk-tqv, ou quand il penche à croire que le changement de voyelle dans oîîa, ïS[xsv n’est point primitif49.
L’âge relativement moderne des parfaits comme 'Gfé-7rXej(a, ë(p8apxa ressort déjà de cette circonstance que dans Homère ils sont encore d’une extrême rareté2. Ces formes, jusqu’à présent, n’ont point trouvé d’explication
complètement satisfaisante. Il ne faut donc pas s’étonner si M. Bopp, qui venait le premier, a hésité sur ce sujet. Il suppose que '#s7rXs%a est pour ^sèiik^x-xcL ; dans s(p6apxcc^ 'tàstpCkyxciL, il voit des formes composées renfermant le verbe auxiliaire «être», quoique à l’appui du changement de (T en x il ne puisse invoquer que des analogies tirées du slave et du zend1. Loin de rien prouver contre la méthode comparative, ces tâtonnements nous montrent que le linguiste le plus habile marche à l’aventure, dès qu’il n’a plus à sa disposition, pour l’éclairer et pour le mettre sur la voie, un certain nombre d’idiomes allant de pair et se complétant l’un l’autre.
Si le parfait grec n’a pas porté bonheur à M. Bopp, s’il a été encore moins heureux avec le parfait latin, sur lequel nous reviendrons bientôt, en revanche, le prétérit germanique rappelle une de ses plus belles découvertes. On sait que les verbes allemands se divisent en deux grandes catégories, suivant qu’ils forment leur parfait par le changement de la voyelle radicale, ou selon qu’ils adjoignent simplement au thème verbal la syllabe te. A la première espèce appartiennent, par exemple, ich halte «je tiens», ich hielt cr je tins» ; ich beisse cr je mords », ich biss ccje mordis»; ich bindc cr je lie», ich band cr je liai». Comme exemple de la seconde catégorie, il suffit de citer ich suche «je cherche», ich suchte <rje cherchai»50 51. Pendant longtemps, on considéra les premiers comme des verbes irréguliers, quoiqu’il ne fût pas difficile de voir que des lois présidaient à ces prétendues anomalies. Jacob Grimm montra d’abord que c’était là fancienne formation du verbe germanique, et que ces changements de voyelle, qui s’étendent aux dérivés nominaux1, constituent le ressort essentiel de la grammaire allemande. Dans les prétérits comme suchte, il vit au contraire des formations modernes, et il les appela les « prétérits faibles v7 par opposition aux trprétérits forts» qui n’ont besoin d’aucune adjonction extérieure. Allant plus loin, il crut reconnaître dans le changement de la voyelle (ahlaut) un organisme primitif destiné à marquer le changement de sens, par un accord entre le son et l’idée aussi ancien que la parole humaine. Comme Yabîaut ou apophonie déploie d’autant plus de variété, comme les verbes forts deviennent d’autant plus nombreux qu’on remonte plus haut dans l’histoire des idiomes germaniques, le caractère primordial du phénomène paraissait incontestable aux yeux de Grimm.
C’est cette théorie que Bopp combattit au nom de la grammaire comparative. Il montra que dans les prétérits cités par Grimm, le changement de la voyelle n’était nullement destiné à marquer le passé. Si, en regard du présent ieh halte, nous avons le parfait ich hielt, la modification intérieure provient d’une contraction entre la syllabe ré-duplicative et la syllabe radicale : en vieux haut-allemand,
lecteur n aura point de peine à en trouver de pareils tirés de l’anglais ou des autres dialectes germaniques.
1 Nous avons, par exemple, les substantifs ; die birule * la ceinture*, das band «-le lienr>. der bund «d'alliance*.
la forme du parfait est hi-alt, et en gothique hai-hald. Ce n’est pas le changement de voyelle, mais l’ancien redoublement qui a donné à l’allemand hielt la signification de parfait, comme il Ta donnée aussi au latin cêpi[pour cecipi) et au sanscrit sêdima v nous nous assîmes n (pour sasadima)1. Si, d’un autre côté, en regard du présent ich beisse, nous trouvons le parfait ich biss, il n’est pas exact de dire que le prétérit a changé la voyelle radicale : c’est, au contraire, le présent qui a renforcé cette voyeiie, comme fait en grec le présent 'tidOw pour la racine ^0, et en sanscrit le présent tvêshâmiz je brille u pour la racine tvish52 53. Si enfin le présent ich binde correspond à un parfait ich band, il est impossible de soutenir que l’opposition de lï et de Ya soit destinée à marquer la différence du présent et du passé. En effet, on voit clairement, par la comparaison du sanscrit bandh (rlier*, que Y a est la voyelle radicale : dans toute la conjugaison du verbe gothique, cet a s’est affaibli en i ou en u, excepté au singulier du prétérit, dont les formes, grâce à leur monosyllabisme, ont gardé la voyelle primitive54.
Quoique sur bien des points le phénomène de l’apophonie présente encore des obscurités, les remarques de M. Bopp sont d’une importance capitale pour l’explication
mécanique des idiomes 55. Ii est permis d’espérer quelles trouveront des applications même hors du cercle des langues indo-européennes, et que notamment en ce qui concerne les idiomes sémitiques, elles serviront d’avertissement et de modèle aux linguistes. Elles font voir comment des changements de pure forme peuvent devenir significatifs, et comment un certain nombre de faits sans lien réel peuvent être instinctivement assemblés en système. Il n’est pas douteux que les dialectes germaniques ont su tirer parti d’un changement de son auquel le reste de la famille s’est à peu près montré indifférent; il est certain qu’ils l’ont fait tourner à l’avantage de la pensée, et qu’aujourd’hui, la plupart des désinences s’étant émoussées ou perdues, le redoublement ayant disparu, l’apophonie est devenue pour les verbes forts la marque distinctive du prétérit. L’Allemand qui dit : du singst te tu chantes a, du sangst ce tu chantas a ; l’Anglais qui conjugue : I gel tr j’obtiens / got ce j’obtins a croient sentir dans le changement de la voyelle Impression du passé. Mais c’est là un de ces faits dont nous parlions en commençant, qui prouvent que le sentiment grammatical d’un peuple peut se trouver en désaccord avec l’histoire de son langage2.
M. Bopp termine son étude sur le parfait germanique par un certain nombre de paragraphes consacrés au prétérit faible. Cette forme, qui existe déjà en gothique et qui n a pas cesse de se multiplier aux dépens du prétérit fort, avait été justement analysée par notre auteur dès son premier ouvrage. Disons seulement ici que les parlaits gothiques comme sôki-dêdtm « nous cherchâmes» (en allemand moderne, voir mck-ten, en anglais we sough-t) sont composés par l’adjonction du même verbe auxiliaire qui, à l’état indépendant, est devenu en anglais I do, I didK
Nous passons maintenant au futur. Tandis que nos idiomes ont l’augment et le redoublement pour exprimer le prétérit, ils ont du recourir à un verbe auxiliaire pour marquer l’idée du futur. Le grec Sœ-aet, le sanscrit dâ-syali cril donnera*», le lithuanien dü-s (même sens) sont formés par la réunion du verbe « être » à la racine dâ.
Si nous décomposons dâ-syati en ses éléments constitutifs, nous obtenons les quatre parties suivantes : dd-as-ya-lL As, comme nous venons de le dire, est la racine du verbe «être». Mais quelle est l’origine de la syllabe ya? M. Bopp y croit reconnaître la racine î « désirera ou % « aller». Il suppose que ce verbe pouvait originairement se joindre à toutes les racines, et qu’on avait d’abord des futurs comme dâ-ya-ti « il donnera », littéralement « il désire donner^ ou «il va donner». Plus tard, le futur du verbe substantif as {as-ya-ti) aurait servi à former tous les autres futurs2. Nous ne pouvons suivre notre auteur sur ce point, non plus que sur tous ceux où il fait intervenir cette racine icfaller» ou î rdésirer». Le verbe î «désirer» appar- 56
tient en propre à la langue de l’Inde56. Quant à la racine i « aller d, pour admettre quelle ait pris, avant la séparation de nos idiomes, le rôle dun verbe auxiliaiie, il faudrait d’autres exemples que le latin amatum iri. D après l’hypothèse de M. Bopp, les futurs comme Msyati, qui existaient déjà dans la période indo-européenne, renfermeraient, abritées sous une même desinence personne*^, jusqu’à trois racines verbales. Ce nest point dune façon aussi explicite que le langage, selon nous, a marqué l’idée d’avenir. Quand on voit l’allemand employer à volonté ich homme dans le sens de <rje viens d et dans celui de «je viendrai n2, il n’est point difficile de comprendre que la signification du futur ait pu s’attacher à une forme particulière du présent. Nous pensons donc, avec M. Schleichei, que as-yarli est le présent du verbe as conjugué d’après la quatrième classe3.
Nos grammaires grecques, en parlant dun futur pie-mier et dun futur second, peuvent donner à penser que ce sont deux temps de formation différente, comme les deux aoristes. Mais il nen est point ainsi, lousles verbes sans exception ont pris i auxiliaire : la diversité vient de ce que les uns se sont incorporé la forme complète asyali, tandis que d'autres prennent la forme aphérésée syati. Les premiers ont donné les futurs en soja, e/w, ew, 5), comme yusvéoô, <r1s\éù) (par contraction fi£vS>, 57
Les autres ont fourni : i° les futurs doriens en ato), comme ^pay-eriopes, 'tipoXent-aiw ; â° par le changement de Yi en e (comparez 'croAtcs, 'Gto'Àsos), les futurs attiques comme (psvy-créopcu, 'ZtfAeu-o’ioj&a* ; 3° par la suppression du j (comparez -crXéov pour 'tôléjov), les futurs ordinaires, tels que Sé-(TùJ, 'iïpdy-crw1.
Nous serons très-bref sur la conjugaison latine, qui, par certains côtés, ressemble déjà à celle du verbe dans nos langues modernes. Des différences comme le grec en fait entre <pépw et £(pepov, entre XctpSavo), èXdpëavov et è'Xaéor, étaient trop fines pour l’oreille et pour l’esprit des Italiotes. lis aimèrent mieux charger de l’expression du passé un verbe auxiliaire signifiant cr être d, qu’ils soudèrent au thème du verbe principal. Ainsi furent formés les imparfaits comme mndbam, monêbam, kgêbam, audiê-bam. Nous retrouvons le même auxiliaire dans les futurs comme amârbo, monê-bo, et dans les parfaits comme amâ-vi, audî-vi, mon-ui. C’est un autre auxiliaire que nous avons dans amâ-rem, monê-rem, lege-rem (pour amâ-sem, monê-sem, kgi-sem), dans les parfaits comme vec-si, mî-$i9 ainsi que dans les futurs archaïques comme fac-so, accep-so. Là ne s'arrête point le procédé de composition : les parfaits amâvi, monui, vexi, mîsi produisent à leur tour des formes comme amdveram, momiero, vexerim, On
voit quel rôle capital les verbes as et bhû jouent en latin. Les seuls temps simples sont le présent (indicatif, impé- 58
ratif et subjonctif), les futurs comme legarn, audiam, et les parfaits comme momordi, tetigi, lêgi, fïdiK
M. Bopp a très-bien vu tous ces faits. Mais par un souvenir, cette fois inopportun, du sanscrit, il veut reconnaître dans vec-sî, scrip-sî des aoristes formés comme avalc-shi trje parlaiu, akship-shi «je jetais, et pour ne pas scinder le parfait latin en plusieurs temps, il est amené à voir aussi dans momordi, tetigi, lêgi, fïdi, non des parfaits, mais des aoristes59 60. Un assez bon nombre de paragraphes sont consacrés à cette thèse qui oblige notre auteur aux suppositions les plus invraisemblables. Ne craignons pas d’avouer que l’explication du parfait latin est une des erreurs de M. Bopp et un point faible de son ouvrage61.
Nous arrivons aux modes. L’idée du mode, étrangère à la science indienne, nous vient de l’antiquité classique : elle a été suggérée aux grammairiens grecs, non pas tant par la réflexion philosophique que par l’observation et le maniement pratique de leur langue. En effet, parmi tou^ les idiomes de la famille, le grec a donné au verbe le développement le plus riche et le plus symétrique; tandis qu’en sanscrit les modes autres que l’indicatif ne sont guère usités qu’au présent, le grec a doté la plupart de ses temps d’un impératif, d’un subjonctif et d’un optatif.
Sans doute la langue hellénique n’a pas inventé ces formations : elles ont existé dès une période antérieure, puisque nous en trouvons dans le dialecte védique les restes, ou plutôt les rudiments non développés. Mais le grec a eu le mérite de conserver, de multiplier ces formes, et de les étendre régulièrement à tous les verbes.
Si Ton fait abstraction de l’indicatif, les modes ayant appartenu à toute la famille sont au nombre de trois : l’impératif, le subjonctif et l’optatif ou potentiel.
L’impératif n’a point d’exposant spécial qui le fasse reconnaître comme un mode à part : il se distingue seulement de l’indicatif par ses désinences.
Le subjonctif a pour caractère particulier un a (grec o ou s) qui vient se placer entre la désinence et le thème verbal. Ainsi les racines han tr tuer m, kit ce penser v, dont le présent de l’indicatif est hartr-ti, éikêt-ti, font au subjonctif han-a-ti, cikêt-a-ti. Nous avons de même dans Homère, à côté de l’indicatif ï[iev «rnous allons tî, le subjonctif fofisv kallonsv. Les formes êSofuu crje mangerais, 'nsioficu <rje boirai r>, qui ont pris le sens de futurs, sont en réalité d’anciens subjonctifs. Les verbes sanscrits et grecs que nous venons de citer sont de ceux qui, à l’indicatif, n’insèrent point un a (grec o ou e) devant la désinence : en d’autres termes, des verbes de la seconde conjugaison principale 62. Ceux de la première ont fondu la voyelle modale avec la voyelle de la caractéristique, et ont produit de la sorte cet d (grec co ou y) que noua trouvons ordinairement au subjonctif. En regard du grec <pépn}s^ <péprf, (pépœm, le sanscrit nous donne bharàsi, bhiirdti, bharânti.
Le potentiel ou optatif1 a pour exposant la voyelle yâ^. Avec infiniment de tact et de pénétration, M. Bopp rappelle le futur, qui a pour exposant la syllabe ya, et il conclut que le potentiel est formé du futur d’après le même principe que le subjonctif l’est du présent3 : vue profonde, si nous l’interprétons dans son vrai sens, et qui éclaire d’un jour inattendu l’histoire de notre système grammatical. Quand on étudie cette histoire, comme l’a fait récemment M, George Curtius, on ne peut s’empêcher d’admirer la simplicité des moyens avec lesquels a été créée la conjugaison indo-européenne4. Ce mécanisme si compliqué en apparence se meut à l’aide de quatre ou cinq rouages. L’augmeni, le redoublement, le verbe auxiliaire as, ont suffi pour former les temps : les suffixes a et ya ont donné les modes. Pour comprendre qu’avec des ressources aussi faibles on ait pu composer un système aussi savant, il faut songer que la conjugaison est le produit d’une longue suite de siècles, et que l’altération phonique, en changeant l’aspect des éléments mis en œuvre,
1 Nos grammaires sanscrites donnent le nom de potentiel au même mode qui, dans les grammaires grecques, s’appelle optatif. Nous en faisons ici expressément l’observation, parce que le lecteur pourrait être induit en erreur par le chapitre de Bopp intitulé : Potentiel, optatif, subjonctif Ce titre a l’inconvénient de réunir ce qui est dissemblable et de présenter sous un double nom ce qui est identique.
4 Cette syllabe yâ se contracte souvent en i ou en i. Voyez ci-dessus, page lxi.
* Voyez S 716.
4 La chronologie dans la formation des langues indo-européennes, page 80 de la traduction française.
a permis de recourir plusieurs fois, et pour des usages différents, à la même matière première.
Le chapitre consacré par M. Bopp à l’étude des modes est extrêmement instructif. Nous y voyons avec quelle fidélité les langues conservent parfois les anciennes formes et avec quelle habileté elles les approprient à de nouvelles fonctions. L’ancien potentiel se retrouve comme subjonctif en gothique, tandis qu’en slave il a pris le rôle d’un impératif; en latin, il a prêté à la fois des formes au subjonctif {amem, âmes, amet) et au futur (dicem, dices, dicet; faciem, faciès, faciet63 ). L’ancien subjonctif a prêté en sanscrit des personnes à l’impératif. En présence de cette élasticité de la signification, il est assez difficile de dire quels étaient à l’origine le sens et l’emploi du subjonctif et du potentiel. Ce qui est sûr, c’est qu’il faut se garder d’attribuer aux premiers temps du langage les procédés grammaticaux des idiomes cultivés : ce ne sera donc pas à la syntaxe que nous demanderons l’explication de deux modes qui existaient longtemps avant que l’homme ait eu l’idée de subordonner une proposition à une autre. Le subjonctif et l’optatif ont dû être employés d’abord dans des phrases indépendantes et qui se suffisaient à elles-mêmes : tandis que l’indicatif exprime le fait comme réel et positif, ils le présentaient sans doute comme simplement possible ou comme souhaitable.
LES VERBES DERIVES.
Sous ce titre, M. Bopp passe en revue diverses formations du verbe sanscrit, qu’il retrouve avec plus ou moins de certitude dans les langues congénères.
i° Verbes dénominatifs. — En premier lieu, à cause de leur nombre et de leur importance, nous placerons les verbes dénominatifs, cest-à-dire dérivés d’un nom, soit substantif, soit adjectif. Toutes les langues forment des verbes de cette sorte : c’est ainsi qu’en français de règle, mesure y grand, cher, nous avons fait régler, mesurer y grandir y chérir. En latin, de regnum, vestis, clams, viennent regnarey vestire, clarere. En grec, de (popos, rSrjXos, '&oipr}Vy ont été tirés (popéoô, Tiftaca, SrfkoM, 'tsoifiedvca.
Le sanscrit dispose de différents moyens pour former ses verbes dénominatifs. Mais de beaucoup le plus usité, c’est le suffixe y a qui vient s’ajouter au thème nominal. Ainsi kumâra «r enfanta donne kumdra-ya-ti ce il fait i’en-fant, il joue i'; sukha et bonheurs donne sukha-ya-ti ce il réjouit^. En grec, le suffixe ya devait prendre la forme jo ou je; mais on a vu que le j, qui n’a pas de signe spécial dans l’écriture grecque, se cache dans la prononciation sous des formes très-diverses. Ainsi les thèmes /xeAav, tex-jxapy èfouSy àpnayy xypvx, suivis du suffixe jo ou je, ont donné les verbes peXcdvù), rex/xa/pw, eknilod, àp7rà&w, xypvcrtTù). Après les thèmes finissant par une voyelle, le j est tombé : ainsi se sont produits les verbes contractes comme (popêco, Jifxdcv, SvXooo (pour (popé-jo), Ttfid-jœy iïyfkà-jo)).
Mais ce n’est là que le premier degré et comme le préam-
bule de ia formation des verbes dénominatifs. Au bout d’un certain temps, l’instinct populaire, se saisissant du procédé, l’étend et le généralise. Il est bien vrai que les premiers verbes en qu’ait possédés la langue grecque sont dus à des thèmes en tS, comme êkmS, èptS. Mais il est venu un moment où le langage, guidé par l’analogie, a créé librement des verbes en tiw avec des thèmes de toute espèce; tels sont : , dxovrtfo, xvviÇco,
'iïoXsfiiÇôt). Dès lors, le simple accident phonique qui a changé en ? le groupe Sj, ouvre à la langue grecque une source inépuisable de richesses, car les verbes en peuvent se multiplier indéfiniment, et à leur tour ils donnent naissance à des noms de toute sorte, tels que les substantifs en tapos, wjxot,
La même observation pourrait se répéter pour les verbes en aivce. Les premiers qu’ait eus la langue grecque venaient de thèmes en av, comme (uskav, 'Gfotfmv. Mais à l imitation de (xsAouW, on a fait AeuxaiVca, yXvxatvo), B'epftalvcd. Un idiome est d’autant plus riche qu’il manie plus librement ces syllabes formatives, d’autant plus varié qu’il en possède davantage, d’autant plus parfait qu’il réussit mieux à répartir entre ces formations des nuances de signification différentes. Il serait intéressant de comparer à cet égard les langues de notre famille. On verrait, par exemple, que les ressources du latin sont déjà plus bornées que celles du grec, car il ne crée plus que des verbes en are, ère, îre, c’est-à-dire des verbes contractes.
1 Ces suffixes sont devenus si mobiles que nous avons pu les emprunter à fa langue grecque : nous disons autoriser, artiste, christianisme.
On peut reprocher à l’ouvrage de M. Bopp de ne pas nous faire assez voir cet affranchissement des suffixes. Non-seulement l’auteur néglige de le faire ressortir, mais ii a l’air souvent de le nier. Il faut lire, par exemple, l’étonnante explication qu’il présente des verbes en l, ou les singulières difficultés qu’il oppose à la généralisation des verbes en cuva 64 65. Admirablement perspicace pour découvrir les causes les plus menues et les commencements les plus obscurs des formes grammaticales, il semble quelquefois n’avoir point d’yeux pour leur entier épanouissement. A ce défaut vient se joindre le désir de retrouver en sanscrit le prototype de formations purement grecques ou latines. Regardant le suffixe aya comme indépendant dès l’origine, il cherche à y rattacher directement les formes en ot&w66; bien plus, il voudrait en tirer les verbes latins comme fumigare, mitigare, par un durcissement de j en g dont le latin ne présente aucun exemple67.
Aussi bien que le grec et le latin, le sanscrit a rendu certains suffixes indépendante, Ainsi les noms neutres en as, comme tapas cc pénitence ^y'nmnas «r respect m, ont donné naissance à des verbes tapas-ya-ü te il fait pénitence r>, na~ mas-ya-ti «il respecter. Puis, d’après l’analogie de ceux-ci, le sanscrit a formé des dénominatifs en asya, sya> qui ont ordinairement la signification désidérative. De madhu ce miel » vient un verbe madhv-asyati « il désire du miel v, de aeva «cheval» vient açvar-syati «telle désire l’étalon». M. Bopp, dans ces verbes, croit reconnaître la racine as crêtre» suivie de l’auxiliaire î et désirer» \ Attribuant à ces formations sanscrites un âge très-reculé, notre auteur en rapproche les verbes latins comme laces sers, capessere, ainsi que les désidératifs tels que atticissare, grœcissare68 69. C’est méconnaître la part d’initiative qu’il faut laisser à chaque idiome et mêler les créations d’âges très-différents. Heureusement nous retrouvons le coup d’œil du linguiste dans d’autres paragraphes : citons notamment ceux où il explique l’origine d’une sorte de passif nouveau que le gothique s’est donné70.
2° Causatif ou causal. — On appelle ainsi une formation sanscrite qui donne à entendre que le sujet fait faire l’action marquée par la racine. Tandis que bâdhati signifie cril sait», le causatif bâdhayati veut dire <ril fait savoir». Les grammairiens indiens expliquent bâdhayati comme venant directement de la racine âwdA, par le moyen du gouna et de la caractéristique aya. Mais il est plus probable qu’il faut appliquer à ces formes la même méthode de décomposition qu’aux verbes dénominatifs, dont ils ne
sont au fond qu une variété. Bôdhayati se divisera donc en bôdha-yor-ti.
Y avait-il déjà un suffixe indépendant aya, servant à former des verbes causatifs, au temps où le sanscrit, le grec, le latin, le gothique, le slave vivaient encore confondus en un seul idiome? M. Bopp n’en doute point, et il voit, par exemple, des causatifs dans les verbes latins necare, sedare, terrere, torrere, sopire, qu’il rattache sans intermédiaire aux racines naç cc mourir n, sad ce s’asseoira, iras cc trembler tî , tarsh te se desséchera, svap cc dormir 77. De même, il voit dans les verbes allemands setzen cc coucher 77, legen cc placer 77, senken et abaisser r>, trànken ce abreuver 7) les causatifs, à la façon sanscrite, de sitzen ccêtre assise, liegen ccêtre couché 7», sinken cc tomber 77, trinken cc boire 77.
Quelque séduisants que ces rapprochements puissent paraître, on fera peut-être bien de les accueillir avec précaution. Il se pourrait aussi bien que ces verbes fussent dérivés de substantifs ou d’adjectifs qui ont disparu. Si nous n’avions en grec les mots Çiépos et on aurait le même droit de regarder (popêco (— bhârayami) et oyéee (= vâhayâmi) comme les causatifs de (pépeo (= bharâmi) et de ê)(0û (=■* vahâmi). Parmi les verbes latins cités par M. Bopp, il en est un qui est certainement un dénominatif : needre vient de nex comme judicâre de judex. Les verbes allemands trànken, legen, setzen sont sans contredit aussi près des substantifs trank cc boisson v, hge cc situation 77, salz cc l’action de poser 77 que des verbes trinken, liegen, sitzen, Si l’on songe à la grande quantité de verbes dénominatifs sans primitif connu qui existent en latin et en go-
thique, on ne voit pas pourquoi une explication spéciale serait donnée pour cinq ou six verbes, par ce seul motif qu’on les peut rapprocher de causatifs sanscrits1. A plus forte raison devons-nous repousser des rapprochements qu’interdisent les lois phoniques, comme celui de plôro avec le sanscritplâmyâmi «je fais couler», ou encore celui des verbes lithuaniens en inu avec les causatifs sanscrits en aya2.
Le causal a été longtemps un favori de la philologie comparative : on ne croyait pouvoir y rapporter assez de verbes. Les racines sanscrites finissant par un â prennent devant aya un p : ainsi sthâ <rêtre debout» fait au causatif slhd-payâmi «je fais tenir debout». Quelle est l’origine de cette lettre p Ÿ il est difficile de le dire. Peut-être le verbe g'îpayâmi «je protège», dérivé du substantif gôpa «pasteur, protecteur», et quelques autres semblables, ont-ils servi de modèles à cette formation. Quoi qu’il en soit, le causatif en -payâmiest d’origine récente, comme le prouve déjà cette circonstance, qui n’a point échappé à M. Bopp3, que le zend n’y participe point. On est d’autant plus étonné de voir notre auteur reconnaître cette formation en lithuanien, en slave, en grec, en latin. II voit, par exemple, un causatif de cette espèce dans le verbe latin rapio, et (par le changement de p en c) dans jacio, doceo4.
3° Passif, désidéralif, intensif. — Nous réunissons ces
' Léo Meyer pai-att pencher vers la même opinion dans son récent ouvrage : Die gothùche Sprache (Berlin, 1869), S 39,3.
2 Voyez S 7kh et suiv.
? Voyez § 760.
4 Voyez 7A7, 768, 768.
ni.
trois formations, qui appartiennent en propre au verbe sanscrit et zenci.
Le passif est marqué en sanscrit par ia syllabe ya, qui reçoit l’accent tonique, et qui vient se placer après la racine : les désinences personnelles sont celles du moyen. Ainsi vas ce habillera, budh « savoirs, qui lont au moyen vas-tê (fil s’habillea, bôdh-a-tê (cil sait a, ont pour passif vas-ya-tê ce il est habillé a, budh-yâ-tê (fil est su*». Dans cette syllabe ya, nous reconnaissons le suffixe tja qui figure aussi avec le sens passif dans les participes guh-ya k devant être caché a, pac-ya «devant être cuit a. C’est là certainement l’emploi le plus moderne de ce suffixe y a qui a été tant de fois appelé à concourir à la conjugaison. Aussi nous est-il difficile de croire qu’il faille voir un passif, à la manière sanscrite, dans le latin morm\jloy et dans le gothique uskija «enascorfl.
Le désidératif se forme par l’addition du verbe auxiliaire as « être*», qui vient se joindre à la racine redoublée. Ainsi grid « savoir a fait £i$nâsâmi « je désire savoir a. M. Bopp en rapproche le grec ytyvdxrxù) et le latin (jfjnosco. «La «gutturale, dit-il, n’est très-probablement, dans ces «formes, qu’un accompagnement euphonique de la sif-« liante 1 a. Mais les verbes grecs comme ytyvéaxto, @i-§pé<txùû, (p&cntœ, j3X<w<7K<w, et les verbes latins comme (^gjnosco, suesco, profiviscor, apiscor, qui n’ont leur <jx , sc que dans les temps spéciaux, doivent bien plutôt être rapprochés des verbes sanscrits gacchâmif yacéhâmi (pour gas-kdmi, yaskâmi), lesquels renoncent également à leur sk
Vovez S 7b i.
«. •
hors du présent et de l’imparfait71. C’est au chapitre des caractéristiques, et non à celui des verbes dérivés, qu’on se serait attendu à trouver ces formes.
L’intensif prend aussi le redoublement, auquel il donne le plus de poids qu’il lui est possible. Ainsi vie et entrer n fait vêvêçmi et j’entre avec force, j’entre souvent n ; lup * couper» fait lâlôpmi crje coupe beaucoup, je déchirer. Les verbes grecs ou latins que cite notre auteur, comme 'zsat-ttcHXXw , SouSolXX'ji) , 'usapjpatvco, gurgulio, n’ont avec ces formations sanscrites qu’une ressemblance lointaine. Le redoublement, à lui seul, ne suffit point pour établir la parenté, car il appartient à cette classe de faits grammaticaux qui se produisent chez tous les peuples, et qu’un philologue a spirituellement appelés des anthropismes. Il faut donc renvoyer ces formations à la grammaire spéciale de chaque idiome.
On voit que le chapitre du verbe se termine comme celui du pronom. Au delà d’une certaine limite chronologique, les ressemblances cessent ou ne sont plus dues qu’à des rencontres fortuites. La structure du verbe apparaît comme identique dans toutes les langues indoeuropéennes aussi longtemps qu’on étudie la racine, les désinences, les caractéristiques des classes, les temps et les modes primitifs; mais si l’on pousse jusqu’aux formations secondaires et jusqu’aux verbes dérivés, les analogies deviennent plus rares et finissent par s’évanouir. Rien, au fond, n’est plus naturel, et le devoir de la science sera de
LXXX1V INTRODUCTION.
tracer nettement cette limite. Deux familles sorties d’une même origine, mais éloignées et isolées l’une de l’autre, auront en commun non les souvenirs d’hier, mais seulement la mémoire des anciens jours.
Clarens, le 23 septembre 1869.
Michel Bréal.
DES
LE VERBE.
NOTIONS PRÉLIMINAIRES.
S Uù 6. Des voix. — L’actif et ie moyen en sanscrit. —
Le moyen en gothique.
Le sanscrit a deux formes pour l’actif. La première, qui a le sens transitif, c’est-à-dire qui marque une action s’exerçant au dehors, est appelée par les grammairiens indiens parasmâi-padam1, c’est-à-dire «la forme [s’appliquant] à l’étranger». L’autre est nommée âtmanê-padam2, c’est à savoir «la forme [s’appliquant] à soi-même» : son sens propre est de marquer l’action réfléchie ou intransitive; elle sert aussi à indiquer que l’acte se fait au profit du sujet ou se trouve avec celui-ci dans quelque relation étroite. Ainsi M signifie «donner»; mais à
1 pârasmài est le datif de pàra « l’autre ». '
* Âtmànê est le datif du mot âtmân «âme». Ce nom remplace souvent,
aux cas obliques, les pronoms personnels des trois personnes et des trois nombres : c’est toutefois la troisième personne qu’il désigne le plus fréquemment; on a vu qu’il en est de même pour le pronom soa. Ajoutons que âtmân est toujours employé au singulier, même quand il marque le pluriel ou le duel. Dans les langues sémitiques, le mot signifiant «âme» est employé d’une façon analogue; mais il faut qu’il prenne . encore le suffixe du pronom de la personne qu’on vent désigner. On dit, par exemple, en arabe, à la troisième personne , nafm-hu «-se», littéralement «ani-mam sui ».
ni.
i
i.
i
i
i
i
r
k
Fâtmanêpadam, dû, combiné avec ia préposition â9 veut dire
«sibi dare» ou, en d’autres termes, «prendre». Le causatif j
£
darêâyâmi signifie « faire voir, montrer» : avec les désinences de i Fâtmanêpadam, il prend le sens de «se montrer». Les verbes si « être couché », «s « être assis » x, mud « se réjouir », rue « briller, plaire, se réjouir», sont usités seulement à Fatmanêpadam; yâc «demander, prier» a les deux formes, mais la forme réfléchie est la plus fréquente, car c’est d’ordinaire pour son propre profit qu’on demande et qu’on prie. Mais, en général, la langue sanscrite, telle quelle est parvenue jusqu’à nous, dispose des deux formes d’une façon assez arbitraire : c’est le plus petit nombre des verbes qui a gardé Fune et l’autre voix; encore est-il rare que la signification propre de chacune ressorte alors bien clairement.
Parmi les langues congénères, le zend, le grec et le gothique ont seuls conservé cette ancienne forme réfléchie. J’ai démontré, il y a longtemps, que le passif gothique est identique, quant à son origine, avec le moyen sanscrit et grec2. Depuis lors,
J. Grimm a attiré l’attention sur deux expressions restées inaperçues avant lui et qui sont d’une grande importance, car elles nous ont conservé la forme moyenne avec le sens actif. Ulfilas traduit deux fois xara&tro par atsteîgadau et une fois pva-doflùt par hmsjadau. A ces exemples sont venus se joindre depuis : uf-ktmnanda « yrétrovrai », faianda « vitupérant », gavasjada undiva-nein « êpSv<rriTou âfyOapcriav », vaurkjada « ipyot^erat », ustiuhada KxaTepycL^eTai » et Uugandau « yoLftno-drùxrav »3. Dans la pre-
1 Le verbe ii fait à ta troisième personne du singulier, au présent de l’indicatif, ééîe = xsrtcu. De même, as fait %stê = ..
3 Système de conjugaison de la langue sanscrite, page 122 et suiv. Comparez Vocalisme, page 70 et suiy. et Grimm, Grammaire allemande, 1,1 o5o. Il sera question plus loin de quelques restes de la forme réfléchie en ancien slave et peut-être aussi en latin. ;
* Voyez l’édition d’Ulfilas de Von der Gabelçntz et Lobe, pages 187 et as5.
mière édition de sa Grammaire allemande1, Jacob Grimrn explique avec raison atsteigadau et lausjadau comme des impératifs ; mais il supposait alors chez le traducteur gothique une erreur qui lui aurait fait rendre les expressions grecques par des formes du passif. Je ne vois pas ce qui aurait pu induire Ulfilas à traduire par un passif le moyen pvadaBcà et encore moins l’actif kolta&chcâ. Son texte lui présentait bien d’autres occasions de confondre le moyen grec avec le passif. Dans la seconde édition de sa Grammaire72 73, J. Grimm se pose cette question : «Aurions-«nous ici un moyen gothique de la troisième conjugaison ?» II n’est pas douteux pour moi que ces formes appartiennent en effet au moyen. Mais je ne puis, comme le fait cette fois J. Grimm, y voir des subjonctifs, car il faudrait qu’elles eussent lï qui caractérise ce mode74. Le subjonctif moyen ne peut pas, pour se distinguer du subjonctif passif, renoncer à un signe qui est précisément l’exposant modal. Je n’hésite donc pas à reconnaître dans atsteigadau et lausjadau, ainsi que dans liugandau « yapuad-Twaav», des impératifs moyens : ils s’accordent parfaitement avec les impératifs moyens en sanscrit, comme Bàr-a-tâm «qu’il porte, qu’il soutienne», Bâr-a-ntâm «qu’ils portent, qu’ils soutiennent». Le gothique au est ici avec le sanscrit âm dans le même rapport qu’à la première personne du subjonctif actif sijau «que je sois» avec le sanscrit syâm. L’ancien m s’est résolu en u et a formé une diphthongue avec Va précédent.
Il est vrai que, si Ton ne consultait que la forme, atsteigadau, lausjadau et liugandau pourraient aussi bien être des passifs : il est probable que si Ulfilas avait eu à exprimer l’idée qu’il soit délivré », il aurait également mis lausjadau. Mais je ne crois pas
w
a
que la traduction de la Bible lui ait fourni une occasion d’employer l’impératif passif.
Nous avons déjà fait observer 1 que les formes gothiques üu~ haith. svignjaith et bairaith sont des troisièmes personnes de subjonctif moyen. Bairaith correspond au sanscrit Baréta (venant de Baraita)* au grec (pépotro, au zend baratta.
S 497. Le passif, en sanscrit et en zend.
En grec et en gothique, la forme moyenne a été transportée au passif, en sorte que passif et moyen sont complètement identiques, excepté, pour le grec, à l’aoriste et au futur. Au contraire, en sanscrit et en zend, le passif, tout en employant les désinences plus pesantes du moyen, présente dans les temps spéciaux (§ ioqa) une différence essentielle : il adjoint à la racine la syllabe ya 2 et il supprime les syllabes caractéristiques et les particularités de toute sorte qui distinguent, aux deux formes de l’actif, les diverses classes de verbes. En grec, Setx-vv-Tai est à la fois un passif et un moyen : au contraire, en sanscrit, ci-nu-tê'(de ci «assembler») ne peut être qu’un moyen, car le passif fait cî-yâ-tè. En grec, SiSq-tcu, to-1 a-rai sont à la fois passifs et moyens ; mais les formes sanscrites congénères dat-tê'z, tis'(,a-tê sont seulement des moyens; leur passif est dî-yâtê, stî-yâtê^.
Comme le passif, en sanscrit et en zend, supprime les particularités des classes et comme il se forme immédiatement de la racine, il peut être mis sur la même ligne que le causatif, le désidéra tif et l’intensif, c’est-à-dire les verbes dérivés. Aussi en traiterons-nous quand nous nous occuperons de ces verbes. Le 75 76 77 78
• NOTIONS PRÉLIMINAIRES. S 428. 5
moyen, au contraire, pourra être étudié en même temps que la forme transitive de l’actif, car il ne s’en distingue presque jamais que par l’élargissement des désinences personnelles.
S k ù8. Les modes et les temps.
Les modes sont en sanscrit au nombre de cinq, si l’on y veut comprendre l’indicatif. Celui-ci, à proprement parler, n’exprime que de simples relations temporelles et non des relations modales; on peut donc dire que ce qui le constitue comme mode, c’est l’absence de toute notion modale. Viennent ensuite le potentiel, l’impératif, le précatif et le conditionnel. Il y a, en outre, dans les Védas, des restes d’un mode qui répond, par son principe de formation, au subjonctif grec : les grammairiens indiens l’appellent lêl1. Les mêmes modes, y compris le subjonctif ou lêt, existent en zenA, hormis peut-être le conditionnel, que je n’y ai pu découvrir. Ce dernier mode, qui est dans un rapport intime avec le futur, est rare aussi en sanscrit.
L’infinitif et les participes sont des formations nominales.
L’indicatif a six temps, savoir : un présent, trois prétérits et deux futurs. Les prétérits répondent, quant à leur forme, à l’imparfait, à l’aoriste et au parfait grecs. À l’égard de la signification, le sanscrit, tel qu’il nous est parvenu, les confond presque toujours. Aussi, dans ma Grammaire sanscrite, leur ai-je donné des noms qui se rapportent uniquement à leur forme. Je les ai appelés : le prétérit augmenté uniforme2, le prétérit augmenté multiforme, le prétérit redoublé. Les deux futurs se confondent
1 Les grammairiens de l’Inde désignent les temps et les modes par des voyelles qui, pour les temps principaux, sont encadrées entre ^ l et ^ t, et, pour les temps secondaires, entre l et ^ ». Ils obtiennent ainsi les noms suivants : lat, Ht, lut, lyt, Ut, lôt; ion, lin, liiii, Irh. Voyez Colebrooke, Grammaire sanscrite, pages i3a et 181.
2 Nous employons indifféremment, dans notre traduction, les mots prétérit ang-mmté ou prétérit à augmenta — Tr.
également dans l’usage. Je leur ai donné des noms qui rappellent leur composition : j’appelle le premier, qui répond au futur grec et lithuanien, futur à auxiliaire 79 ; le second, futur à participe , parce que le premier terme dont il est composé correspond au participe latin en turus. Je n’ai pas rencontré jusqu’à présent en zend le futur à participe; mais tous les autres temps dont il vient d’être question sont usités dans cette langue.
Les modes autres que l’indicatif n’ont chacun en sanscrit et
à
en zend qu’un seul temps. 11 faut remarquer toutefois que le potentiel et le précatif sont entre eux dans le même rapport qu’en grec l’optatif présent et l’optatif aoriste second : aussi Pânini comprend-il ces deux formes modales sous le nom commun de fin. De plus, le potentiel peut être employé pour exprimer le désir et la prière exactement comme le précatif2.
Dans les Védas, on trouve encore la trace d’un certain développement donné aux modes, qui n’y sont pas bornés, comme dans le sanscrit classique, à un seul temps; d’après ces restes, on peut conclure que, si les langues de l’Europe l’emportent sur le sanscrit et le zend par la variété de temps que présentent les divers modes, elles doivent au moins le principe de cette fécondité à une période antérieure à leur existence indépendante.
S ^29. Les nombres. — Les langues indo-européennes ne distinguent
pas les genres dans le verbe.
Dans la plupart des idiomes qui font l’objet de nos comparaisons, le verbe a trois nombres. En latin, toutefois, le verbe, aussi bien que le nom, a perdu le duel. Au contraire, le plus ancien des dialectes germaniques, le gothique, a conservé le duel pour le verbe, quoiqu’il l’ait perdu dans la déclinaison. L’ancien
slave80 avait, et le lithuanien possède encore à l’heure qu’il est, le duel pour le nom comme pour le verbe. Le pâli et le pràcrit qui, à d’autres égards, sont si près du sanscrit, ont perdu le duel : par cette lacune de leur grammaire, comme par la perte de la voix moyenne, ils sont sur la même ligne que le latin.
A la différence des langues sémitiques, le verbe indo-européen, dans ses désinences personnelles, ne fait pas la distinction des genres. Gela ne doit pas nous étonner si nous songeons que les pronoms des deux premières personnes, même employés comme mots indépendants, s’abstiennent de faire cette distinction. Au contraire, dans les langues sémitiques, il ny a que la première personne, soit dans le verbe, soit dans le pronom isolé, qui ne spécifie pas les genres ; la deuxième et la troisième personne distinguent toujours le féminin du masculin, que le pronom forme un mot à part ou qu’il soit combine avec le verbe 3.
S ûSo. Division des temps et des modes eu deux classes, d’après les flexions personnelles.
Si l’on considère les flexions personnelles, on est conduit a diviser les temps et les modes en deux classes, dont lune présente des désinences plus pleines, l’autre des désinences plus émoussées. C’est surtout en sanscrit, en zend et en grec que cette division est très-visible. A la première classe appartiennent les temps qu’en grec on appelle temps principaux, savoir : le présent, le futur et le parfait (ou prétérit redoublé); les désinences de ce dernier temps ont toutefois éprouvé, en sanscrit comme en zend et en grec, de fortes mutilations, qui ont évi—
demnient pour cause ia surcharge produite par le redoublement. A la seconde classe appartiennent les prétérits augmentés; de plus, en sanscrit et en zend, tous les modes autres que l’indicatif, à l’exception du présent du subjonctif et des flexions de l’impératif qui appartiennent en propre à ce mode1. En grec, le subjonctif a également les désinences pleines. Au contraire, l’optatif, qui répond au potentiel sanscrit, a comme lui les désinences émoussées. Le (u de Tvnloipt est inorganique; la forme primitive était tutzIoiv^,
S 431. Restes de cette division en iatin.
En latin, cette division est encore visible à la première personne, quoique le rapport qui existait, à l’origine, entre les deux sortes de flexions se trouve renversé. Aux temps et aux modes qui avaient autrefois la flexion plus pleine mi, la désinence a disparu complètement3. Au contraire, là où il y avait la désinence émoussée m, ce ni s’est maintenu. Nous avons donc, d’une part, amo, amabo; mais, d’un autre côté, amabam, eram, sim, amem, comme en sanscrit â-Üavam et asam «j’étais», syâm « que je sois », kâmâyêyam « que j’aime ».
A la deuxième et à la troisième personne, toutes les désinences sont devenues semblables, l’t des formes primaires s’étant perdu; on a, par conséquent,legis{i), legit(i), legunt(i), comme on avait déjà legas, légat, legant.
S 43a. Restes de cette division en gothique.
En gothique, cette ancienne division en désinences pleines et
1 Les flexions appartenant en propre à l’impératif sont plus voisines des désinences pleines que des désinences émoussées.
* C’est ce que prouvent la conjugaison en fu (èiëoiyv) et la forme moyenne tu-7i1ot(iyv, qui vient de ivifioiv. [Si rtnloiyu était primitif, te moyen devrait être TvTfloi[tai. — Tr.]
1 Excepté dans les deux verbes mm et inquam.
en désinences émoussées se manifeste surtout de la manière suivante. Les terminaisons ti et nti des formes primaires ont conservé leur dentale, grâce à la voyelle qui venait après; mais IV s’est perdu. Au contraire, dans les formes secondaires, le t, n’étant protégé par rien, est tombé, comme en grec. On a donc, d’une part, bair-i-th «il porte», en regard de Bâr-a-ti;
bair-a-nd*ils portent», en regard de hâr-a-nü, en grec
(pép-o-vu. Mais, d’un autre côté, on a bairai «qu’il porte», en regard de bdr-ê-t (venant de Barak), en grec Çépoi.
A la première personne du singulier, la désinence pleine nu a complètement disparu, comme en latin81. Au contraire, le m final des formes secondaires, s’il ne s’est pas maintenu sans changement, comme en latin, a du moins laissé à sa place un représentant : il s’est vocalisé en u (8 i 8). En regard du sanscrit üâr-â-mi, on a donc bair-a «je porte»; mais en regard de lidr-êy-am, orna bair-a-u (venant de bairam pour batraîm) «que je porte». Le rapport de ces deux formes entre elles peut se comparer à celui de fero avec feram.
A la deuxième personne du singulier, en gothique comme en latin, les formes primaires et les formes secondaires sont devenues semblables, les premières ayant perdu leur i final, les autres en ayant été privées dès l’époque où les langues germaniques se séparèrent de leurs sœurs de l’Asie. On a, par conséquent, bair-i-s «tu portes» eu regard du sanscrit Bâr-a-si, et bair-ai-s «que tu portes» en regard de Bdr-ês, fer-â-s, (pép-ots,
S *33. Restes de cette division en ancien slave.
En ancien slave, les formes secondaires du singulier mi du sacrifier leur consonne finale (8 92“). Il en résulte que l’impératif slave, qui correspond au potentiel sanscrit , à l’optatif grec, au subjonctif latin et germanique, a sa seconde et sa troisième personne du singulier terminées par la voyelle i, qui est la caractéristique du mode; de même, à l’aoriste, la deuxième personne est semblable à la troisième, le 5 et le t étant tombés. Au contraire, les formes primaires ont très-bien conservé les désinences tint si ou cm si, tl tï, atl unit ou atl antï.
Nous allons à présent examiner en détail la forme et l’origine des désinences personnelles.
DÉSINENCES PERSONNELLES.
PREMIÈRE PERSONNE.
S 434. La première personne de l’actif et du moyen, en sanscrit,
• en zend, en grec et en latin.
Au singulier comme au pluriel, la première personne est primitivement caractérisée par un m. Au duel, dans la forme transitive de l’actif, ce m a été amolli en v82. Nous avons déjà observé le même changement de m en v dans le pronom vaydm «nous», pour M^mayam (S 331).
L’expression complète de la première personne du singulier, dans les formes primaires de l’actif transitif, est mi; en sanscrit et en zend, cette désinence mi appartient à tous les verbes sans exception. En grec, le futur l’a absolument perdue2; le présent, abstraction faite de quelques formes dialectales, ne l’a conservée que dans les verbes qui correspondent à la seconde con-
I
..........H"""."**»'82"*8 ■ 1
fc
;
£
j
jugaison en sanscrit1. Les autres verbes grecs ont tout à fait supprimé la désinence personnelle. En effet, leur <y, ainsi que Fo latin de toutes les conjugaisons, représente Vâ sanscrit, par exemple, dans bod-â-mi s je sais», tud-a-mi «je pousse»; or, cet â nappartient ni à la désinence personnelle, ni à la racine: cest la caractéristique de la classe. 11 s’allonge à la première personne, en vertu dune loi générale qui veut que, devant un m ou un v suivis d’une voyelle, les caractéristiques consistant en un a ou se terminant par un a lui fassent subir un allongement; cest pour cette raison que nous avons bô’d-â-mi «je sais», bô'd-â-vas «nous savons tous deux», bodJ-â-mas «nous savons», en regard de bô'cT-a-si «tu sais», bô’cf-a-ti «il sait», bod-a-tas «vous savez tous deux», bod-a-ta$ «ils savent tous deux», hod-a-ta «vous savez», hod-a-nti «ils savent».'Le grec ne prend point part à cet allongement : il a, par exemple, <pép-o-fie$ en regard du sanscrit bâr-â-mas. Mais il est possible qu’au singulier on ait eu primitivement (^ép-co-pu en regard de Mr-â-mi : on pourrait alors admettre qu’au pluriel et au duel 83 84 85 V& a été abrégé, à cause de la surcharge causée par des désinences plus pesantes; et de fait, il y a le meme rapport entre la forme supposée (pép-cà-pu et (pép-o-ptev ou Qép-o-piou, qu’entre SiSot-pu et S/So-ptev ou SiSo-pcu. Si pourtant (ce que je suis moins porté à admettre) on regarde (Çép-o-fii comme la forme primitive, Rallongement de Vo devra être considéré comme une compensation pour la perte de la désinence.
La désinence moyenne et passive |}xcu appartient à toutes les classes de verbes : c’est une preuve de plus qu’à 1 actif ils ont dû tous avoir anciennement la désinence pt. Le grec, pour la première personne du moyen et du passif, l’emporte sur ses frères de l’Asie, qui ont perdu le m dans toutes leurs formes, tant primaires que secondaires. Comparez, par exemple, le sanscrit Bâr-ê au grec (pip-o-pat. Si donc d’un côté le sanscrit Bar-â-mi nous sert à restituer l’ancienne forme de (pépw, à son tour le grec (pép-o-fxat nous permet de ramener Bdr-i à son type primitif Bar-â-mê ou Bar-a-mê.
S 435. La désinence mi en lithuanien.
On voit par ce qui précède comment les différents idiomes de la famille que nous étudions peuvent s’éclairer et se compléter l’un l’autre : même parmi les mieux conservés, il n’en est aucun dont l’organisme nous soit parvenu intact. Tandis que la désinence fiat est encore en plein usage chez les Grecs d’aujourd’hui, la forme sanscrite correspondante était déjà détruite à l’époque où furent composés les Védas. D’un autre côté, dans les poèmes homériques, tous les futurs et la plupart des formes de présent ont déjà perdu la désinence fit que le sanscrit, aux temps correspondants, a partout conservée, et qui existe encore à l’heure qu’il est, en lithuanien, dans un grand nombre de présents. On a, par exemple :
i. ' l.
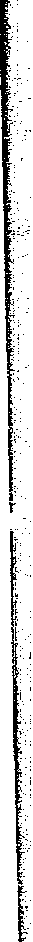
|
Lithuanien. |
Sanscrit. |
Grec. |
|
esmx rrje suis* |
demi |
èfift(, elpt |
|
etmt «je vais» |
A* • emi * |
sïftt |
|
diïtni rr je donne » |
dddâmi | |
|
demi «rje place» |
dââdmi |
riâijfit |
|
slowmi «je suis debout* |
tüiâini |
fallait |
|
edmi «je dévore» 1 |
âdmi a je mange* |
1 L'allongement, dans ce verbe et dans la plupart des suivants, est occasionné par l'accent. Comparez 5 9e \
Sanscrit. Grec.
m~êîdâmi1 «je m’assieds* .... gddâmi ffje dis* . .. .
kal'pmjâmi «je fais* " - . . .
Lithuanien.
sedmi ff je suis assis * ffêdrni ff je chante » gelbmi tt j’aide » sergmi «je garder sâügmi ffje conserve* mëgmi ffje dors » Uhni ffje laisse*
rinâcmi ffje sépare*
S 436, i. Examen des verbes lithuaniens en mi. — La désinence lithuanienne w.
Dans les verbes lithuaniens qui viennent d’être cités, la désinence mi se joint immédiatement à la racine, comme dans les verbes sanscrits de la deuxième, troisième et septième classe 3. Les formes esmi, eimi et êdmi appartiennent évidemment à la deuxième classe sanscrite. Le verbe êdmi fait, à la première personne du pluriel, éd-me — sanscrit ad-mâs, à la deuxième personne du pluriel es-te = sanscrit at-tâ, à la troisième personne du singulier ês-t = sanscrit dMt4. Au duel, éd-wa, és-ta s’accorde avec le sanscrit ad-vâs, at-tas. Dü-mi «je donne» (pour düd-tm = sanscrit dddâmi, grec StS&fju) et de-mi «je place » (pour dëd-mi = sanscrit dâiami, grec TiOnpt) appartiennent à la troisième classe sanscrite : la mutilation qu’ils éprouvent dans leur syllabe radicale est de même nature que celle que subissent, en sanscrit, les verbes dâ et da devant les désinences pesantes du duel et du pluriel5, ainsi que dans les temps spéciaux du moyen (S 481).
1 Racine sad, avec le préfixe ni.
* Je rapporte à cette racine le gothique halp «aider» (hilpa, halp, hnlpum).
*
3 Voyez S 109*, 3.
4 Comparez le latin es-ùs «vous mangez» et l’archaïque es-t «il mange»- A la troisième personne du singulier, l’t final s’est conservé, en lithuanien, dans és-ti «il est», ei-ti (comparez le dorien el-T* )x « il va», dû’s-ti «il donne». Les autres verbes lithuaniens en mi ont perdu Vi final de la troisième personne (voyez Mielcke, Grammaire lithuanienne, page i3û et suiv. et Scbleicher, page a5o etsuiv. ).
5 On a, par exemple, dnd-vâs «nous donnons tous deux», dad*-mm «nous don-
Stow-mi «je suis debout» qui, par le sens et par la racine, correspond au sanscrit tiêtâ-mi, appartient, sans aucun doute, à la dixième classe sanscrite ou forme causative. Il a perdu au singulier (deuxième personne stow-i, troisième personne sléw] la caractéristique de sa classe; mais elle reparaît au duel et au pluriel sous la forme d’un i 1 : duel stow-i-wa, stow-i-ta, pluriel stow-i-m, stow-i-t (pour stowime, stowite). Il y a aussi, à côté de stow-mi, une forme stowju (ou stoju^, aoriste stôwêjau.
De même que stow-mi, je rapporte à la dixième classe ou forme causative tous les autres verbes en mi qui, au duel et au pluriel, ne joignent pas, comme es-mx, ei-mi, êd-mi, leurs désinences immédiatement à la racine. Je rattache, par exemple, sêdmi (pour sëd-i-mi) «je m’assieds», duel séd-i-wa, pluriel sêd-i-me, aoriste sedejau, au sanscrit sâd-âyâ-mi et au latin sedeo (§ 109% 6). A côté de raudoju, que j’ai rapproché du causatif sanscrit râdâyâmi, il y a aussi une forme raudmi; mais je doute qu’ on trouve un duel et un pluriel analogues.
La conjugaison ordinaire, en lithuanien, nous présente la désinence « à la première personne du singulier. Je regarde cet 11 comme la vocalisation d’un m (§ 18) : devant cet u, comme devant IV de la deuxième personne, les verbes de la première conjugaison (suivant la division de Mielcke) suppriment la voyelle a, qui est la caractéristique de la classe. On a, par exemple, suk’-ù «je tourne», suk’-i «tu tournes», en opposition avec suk-à2 «il tourne», sùk-a-wa «nous tournons tous deux», siik-a-la « vous tournez tous deux » 3, suk-n-me « nous tournons »,
»
nonsn; dad'-vàs rïious plaçons tous deux», dad-mm «nous plaçons», au Heu de dadâ-vas, dadâ-mas ; dada-va*, dadâ-mm.
1 Voyez Mielcke, Grammaire lithuanienne, page i3/i. ■
3 Suk-à n’a pas de désinence personnelle.
* 3 La troisième personne du duel et du pluriel est remplacée, dans les verbes
lithuaniens, par la troisième personne du singulier.
mk-a-te «vous tournez». Dans la troisième et la quatrième conjugaison de Mielcke, qui, à l’égard du présent, peuvent être considérées comme n’en formant qu’une seule, la voyelle de la classe se réunit à la désinence personnelle u et i, et forme avec elle une diphthongue : on a, par exemple, laikaü «je tiens», laikaî «tu tiens» = laik-a-û (venant de laik-a-m), laik-a-i.
8 436, a. La désinence mi en ancien slave.
En ancien slave, mi est la forme la mieux conservée de la désinence qui nous occupe. Elle se trouve dans imamï «j’ai», et dans un petit nombre de verbes se rapportant à la deuxième et à la troisième classe sanscrites (§ 109% 3). Ce sont ie<m jes-mï «je suis » = as-mi; taA\k ja-mü1 «je mange » = àd-mi; K'éau» vê-mï «je sais» = vê’d-mi; aaau» da-mï «je donne» (pour dad-mï) — dâdâmi.
Dans la conjugaison ordinaire, l’ancien slave, à l’exception de ima-mï «j’ai»86 87, a complètement renoncé à IV de la désinence mi. De plus, il a affaibli le m en n (S 92a); exemple : Eepji berun «j’assemble». L’« renfermé dans la syllabe finale a un représente le caractère de la classe ; il est originairement identique avec Ve des autres personnes (ber-e-si, ber-e-U ), comme en grec l’o de (pép-o-ficv est identique avec Ve de (pép-e-re, (pép-e-rov. Je divise donc ainsi : ber-w-h, comme en sanscrit Ëâr-â-mi (§ 434). Au contraire, le slovène a partout conservé l’ancien m de la première personne; exemples : plet-e-m «je tresse», gor-i-m «je brûle», dêl-a-m «je travaille».
S £36. 3. Restes de la désinence mi en gothique et en vieux haut-allemand.
En gothique, le seul verbe qui ait conservé le signe personnel m, cest i-m «je suis» (en sanscrit âs-mi); c’est aussi le seul verbe qui, comme les verbes sanscrits delà deuxième classe, joigne immédiatement les désinences à la racine (î-s «tu es», is-t «il est»); encore ne le fait-il qu’au singulier.
En vieux haut-allemand, quelques verbes qui, en sanscrit, appartiennent à la troisième classe, ont renoncé au redoublement et sont entrés de la sorte dans la deuxième classe. Ils ont également conservé le m ou, à sa place, le n de la première personne1. Tels sont : to-m, tua-m, tua-n, ancien saxon dâ-m «je fais» — sanscrit dada-mi «je place88 89; (gd-m)90, gâ-n «je vais» -sanscrit gdgâ-mi, grec j3/Sv/uu; (s£d-m), stâ-n «je suis debout» = sanscrit tis\â-mi91, grec Mv-pu. Ont encore conservé le signe personnel m ou m tous les verbes qui ont contracté en â ou en ê le caractère aya de la dixième classe sanscrite92; exemples : pët-o-m, bêt-ô-n «je prie»; sak-ê-m, sagh-ê-m, sag-ê-n «je dis». Je crois que, dans ces verbes et dans les verbes analogues, le signe personnel a été conservé grâce à la voyelle longue qui précède , car elle a plus de force qu’une brève, pour porter la désinence : dans la première conjugaison faible, on a ner-ju «je soutiens?) et non nerju-m ou nerju-n; de même, dans toutes les conjugaisons fortes on a u et non Ur-m ou u-n1. Un fait analogue se présente en sanscrit, où les verbes de la cinquième classe, dont le caractère est nu, ne prennent, à la seconde personne de l’impératif, la désinence personnelle hi que si la racine se termine par une consonne (S 451).
Les formes bi-m, pt-m, bi-n, pi-n ^je suis?? sont seules de leur espèce. C’est aussi le seul verbe qui ait conservé en haut-allemand moderne le signe de la première personne. Il doit probablement ce privilège à sa nature monosyllabique : peut-être aussi l’usage extrêmement fréquent du verbe substantif n est-il pas étranger au maintien de la désinence. Je crois toutefois que si le vieux haut-allemand bim, bin avait aussi complètement préservé le corps de sa racine que le pluriel bir-u-mês93 94, nous aurions eu une première personne du singulier bir~u, et non bîr-u-m ou bir-u-n.
S A36, A. Restes de la désinence mi en arménien.
En arménien, tous les verbes sans exception ont conservé le m de la désinence primaire mi; mais ils ont complètement perdu K.final. L’arménien se trouve donc, à cet égard, sur la même ligne que le persan moderne, le slovène, l’irlandais; il surpasse, par son état de conservation, les langues classiques, les langues germaniques et le plus grand nombre des langues slaves. Exemples : uuutT ta-m «je donne» = sanscrit dddâ-mi; q^anT
J 8
ga-m kje viens» = gdgâ-mi ^je vais»-, vieux haut-allemand (gw-m), ga-n; tytriutT ke-a-m «je vis» = gw-â-mi; p-hpluT be-r-e-m «je porte» = Bdr-â-mi, deuxième personne ber-e-s ~ Bâr-a-si.
S /i37. Expression de la première personne, dans les formes secondaires.
Dans les formes secondaires, en sanscrit et en zend, l’expression de la première personne du singulier est m9 et non mi (§ 43o). En latin, cette désinence émoussée s’est partout conservée, au lieu que la désinence pleine s’est perdue (§ 431), En grec, un m final devient v : on a donc ëtysp-o-v en regard du sanscrit dBar-a-m, êSi'Soj-v et ëSù>~v en regard de ddadâ-m et ddâ-m, SiSo-trjv et So-iyv en regard de dad’-yâm et dê~yasam. À l’aoriste premier, le grec a perdu tout à fait le signe personnel; comparez, par exemple, éSetÇa avec ddilcsam. Mais du
moyen êSst^àtfirtv on est autorisé à inférer une ancienne forme sSsi^av et, plus anciennement encore, ëSet^ag.. En ce qui concerne le gothique, qui change le m en u, voyez § 43s. L’arménien a gardé le m au présent du subjonctif; il le supprime partout ailleurs, notamment à l’imparfait, à l’aoriste et au futur
(S i83\ 9).
Remarque. — A euphonique inséré, en sanscrit, devant le m des formes secondaires. — Nous avons divisé plus haut âBaram et ê(pspov de cette façon : àBar-a-m, ê(p$p~o-v. Il faut ajouter ici que, suivant les grammairiens indiens, la désinence complète de la première personne du singulier, dans les formes secondaires, nest pas m> mais am : âBaram serait donc pour âbarâm, venant de â&ar-a-am, et il y aurait élision du premier a, qui est le caractère de la classe95. On trouve, en effet, dans certaines formes, la désinence am, sans que f a puisse être attribué au caractère de la classe : ainsi le verbe i «aller» fait ay-am « j’allais». et non âi-m; bru «parler» fait âhrav-am ou âbruv-am «je parlais», et non âbrô-m; les verbes qui prennent
dans les temps spéciaux les syllabes nu et u comme caractères de la cinquième et de la huitième classe, font navam, avant, et non no-m, 6-m, comme on pommait s’y attendre d’après leur présent en no-mi, o-mi; exemples : âslrnava?n rrje répandais», pluriel âstrmma «nous répandions», en regard du grec è&làpvûv, êoflàpvvpLëv. Mais il faut observer que la seconde personne, en sanscrit, a simplement un s, la troisième personne simplement un t pour désinences; on a, par exemple, âstr-no-s, astr-no-t en regard du grec ê&làp-vv-s t è</}àp-vv-(r). Remarquons encore que le grec, h la première personne, a simplement un v. On peut conclure de ces faits que ïa de âstrnavam s’est irrégulièrement introduit de la première conjugaison dans la deuxième, de même qu’en grec nous avons èarlôp-vv-o-v à côté de èolàpvij-v, et èu'lôpvv-s1 à côté de è&làpvô. Ce sont surtout les verbes qui joignent immédiatement les désinences personnelles à une racine finissant par vune consonne qui auront favorisé l’introduction d un a k la première personne; au présent vê'dmi «je sais» il eût été impossible d’opposer un imparfait âvêdin : il fallait donc bien, ou que le caractère personnel tombât tout à fait, comme cela est arrivé à la deuxième et à la troisième personne96 97, ou bien qu’on empruntât le secours d’une voyelle de liaison. C’est ainsi que, dans la déclinaison, les thèmes terminés par une consonne prennent am à l’accusatif au lieu de m; mais il est arrivé aussi pour cette désinence ce que nous venons de constater pour le signe de la première personne : le am de l’accusatif se retrouve avec des thèmes finissant par une voyelle, comme naiîs et brû, qui font nav-am et bruv-am, au lieu de nâum, brâm, comme le feraient attendre le grec vav-v et ô@pv-v. Quoi qu’il en soit, cet a s’esl si solidement installé dans les formes secondaires, à la première personne, qu’on pourrait établir, en théorie comme en pratique, la règle suivante : tn final se fait précéder d'un a, quand il na pas déjà devant lui un a ou un â, soit appartenant à la racine, soit représentant le caractère de la classe ou du mode. Nous avons donc, d’une part, âbar-a~m rrje portais», âdadâ-m «je donnais», âyâ-m «j’allais» (racine yâ), âyu-nâ-m «je liais»98, dadya-m «que je donne»; et, d’un autre côté : âstr-
nav-am rrje répandais», au lieu de âstr-no-m; liar-êy-am reque je porte» (8 43), au lieu de b'arêm; tütêy-am «que je sois debout», au lieu de tütêm \ .
S 438. Restes de m, désinence des formes secondaires, en gothique et en lithuanien.
En gothique, comme on l*a déjà fait remarquer (§ 43a), le m des formes secondaires s’est résolu en u. Le vieux haut-allemand a complètement perdu cette désinence, excepté dans un seul exemple qui nous présente l’ancien m, et non, comme le gothique, le m altéré en u; c’est le mot lirnem « que j’apprenne », dans Kéro.
En lithuanien, la forme émoussée m s’est altérée en u, comme la forme pleine mi : nous avons donc buwaü qui correspond à l’aoriste sanscrit d-Bûvam «je fus», comme d’autre part, au présent, on a laikaû «je tiens», venant d’une ancienne forme fat-kam pour laikamL
En ce qui concerne le slave, nous renvoyons le lecteur aux §§ 433 et 566.
S 439. Origine de la désinence de la première personne.
H nous reste à nous demander quelle est l’origine de la désinence de la première personne. Je regarde mi comme un affaiblissement de la syllabe ma, qui est le thème, en sanscrit et en zend, des cas obliques du pronom de la première personne. H y a le même rapport entre la syllabe mi, dans dâdâmi, et sa forme originaire ma, qu’entre Pi du latin abjieio et Pa de jacio (§ 6). Dans les formes secondaires, par un nouvel affaiblissement, mi est devenu m.
L’accord remarquable qui règne entre toutes les langues indo-
1 Cette forme tiétém s’accorderait plus exactement avec tûtes, tüiét, tû\éma> tiéteta.
européennes prouve que la division en formes primaires et en formes secondaires appartient à un âge très-reculé. Je 11e crois pas cependant qu’il faille la faire remonter jusqu’à cette période primitive ou l’organisme grammatical, dans la fleur de la jeunesse, n’avait encore rien perdu de son intégrité; je pense plutôt que les désinences se sont émoussées à la longue, et que la cause de cet affaiblissement a été le besoin dalléger le verbe, quand le commencement du mot se chargeait d’une syllabe additionnelle (comme aux prétérits à augment), ou quand une insertion se faisait à fintérieur (comme au potentiel ou optatif). Les désinences émoussées se sont donc produites petit à petit; nous voyons, en effet, que ie latin a encore partout mus et le grec peu (plus anciennement fjtes), tandis que mas, en sanscrit, n’est resté qu’aux formes primaires; encore s’y est-il fréquemment mutilé en ma, c’est-à-dire qu’il a pris la forme qui est de règle pour les désinences secondâmes. On a, par exemple, Bdr-â-ma$, sarp-a-mas, et quelquefois Bdr-â-ma, sdrp-â-ma, en regard du grec (pép-o-pss, èpir-o-fies, du latin fer-i-mus, serp-i-mu$ (s 109% t); et r on a toujours dBar-â-ma en regard de êfyép-o-ferebamus, toujours as-ma en regard de $(o)-iizs. erâmus, toujours âadya-ma en regard de StSot'v-fiss, toujours üêiêma en regard de stêmus.
H est plus difficile d’expliquer l’origine de la désinence mas. On pourrait admettre quelle se décompose en m-as : m serait alors le thème et os la désinence du nominatif pluriel. En effet, mas finit comme pddas, pt£$ comme *&6Ses, et les désinences * personnelles expriment toujours la relation que sert à marquer le nominatif. Mais il se peut aussi que le s de mas soit de même provenance que le s du zend yûs «vous »du sanscrit nas, vas et du latin nés, vôs*. De même que nous avons expliqué
1 Pour yûsuw. Voyez $ 835.
5 Voyez SS 336 et 337.
plus haut a-smê' comme un composé copulatif signifiant «je [et] ils y>1, ad-mds voudrait dire proprement «je [et] ils mangent »99 100.
Quant à la désinence védique masi, en zend mahi, on peut voir dans si une forme à la fois affaiblie et mutilée de sma101; ou bien encore, on peut regarder masi comme étant pour masê, qui lui-même se rattacherait au nominatif védique asmê* (pour mas-mêy1 : dans cette hypothèse, la première partie de la dipli-thongue ê (= a + i) aurait été supprimée, et le pronom masmê aurait rejeté son s cond m, tandis qu’à l’état isolé il a perdu le m initial.
Remarque. — De la désinence grecque fisv. — Examen d’une objection de Pott et de Curtius102. — Je regarde le v de la désinence fiev comme sorti d’un ancien s. On a de même la forme rjv <ril était» en regard du dorieii rjs et du védique as (S 53o). Rapprochez aussi le suffixe -dev == sanscrit -tas, latin -tus103. L’affaiblissement d’un « en « n’a en lui-même rien de
plus surprenant que celui d’un s en r\ qui a lieu si fréquemment et si ré* o-ulièrement en sanscrit, ainsi que dans certains dialectes grecs (S aa) et dans plusieurs formes grammaticales des langues congénères.
Quant à la désinence sanscrite ma, usitée dans les formes secondaires, mais employée aussi quelquefois au présent, je la regarde comme une mutilation pour mas (§ 43 q). Cette mutilation n’a eu lieu très-probablement qu’après la séparation des idiomes indo-européens; elle sest généralisée en ancien perse, où le s final, apres un a ou un a, disparaît dans toutes les désinences.
Pott2 propose pour,la désinence grecque pev une autre explication, à laquelle s’est rangé G. Gurtius3. Selon ces deux savants, mas est devenu fiss en grec; quant à ftev, il représenterait le sanscrit ma, auquel serait venue s’ajouter postérieurement une nasale complémentaire. Mais on peut demander pourquoi la même nasale n est pas venue s’ajouter aussi à d’autres désinences finissant par une voyelle, par exemple à Ye du vocatif des noms de la deuxième déclinaison (S aôê), ou à le du duel (S 209). Remarquons en outre que le v de psv s’y trouve a demeure fixe, et non pas seulement devant une voyelle, comme le v ephelkysticon.
Pott cite à l’appui de son opinion les impératifs doriens comme Xeyàv-Tût», 'GfoiovvTco, àitOTtffâvTù} ; mais il est au moins aussi vraisemblable d’expliquer la désinence pt<û comme une mutilation pour vtcov que de regarder vtcov comme un élargissement de vtûj, car le dorien, quand il s’écarte des autres dialectes, ne présente pas toujours la forme la plus ancienne.
Pott objecte que le changement d’un s en v est difficile à comprendre au point de vue physiologique, car quoique tous les deux soient des dentales, ils présentent des sons très-différents. Mais la différence est encore plus grande entre une muette et la nasale du même organe, et cependant, en sanscrit, une muette finale se change en la nasale du même organe quand elle est placée devant une nasale : ainsi alistat mârdhi *ril était à la tête* devient alistan mûrdhL En latin, nous avons de même somnus pour sopnus,
comme 'crarépa (= sanscrit pitàram, latin patrem). Nous avons déjà eu souvent l’occasion de faire observer que les consonnes finales sont les plus sujettes à être affaiblies ou supprimées.
1 Le n est une liquide comme le r.
2 Recherches étymologiques, Ie édition, II, page 3o6 et suiv.
3 Formation des temps et des modes, page 27.
et en grec aspvàs pour cre€vôs. En lithuanien et en slave, nous trouvons le changement contraire d’un n en d> quoiqu’il ne soit occasionné par aucune lettre voisine : ainsi le sanscrit mvan «neuf» devient en lithuanien dewynl, en ancien slave devaiilï (S 317). De même, en grec, le n du suffixe ïPT^wian., latin men, devient un t (o-vopaT — "rFFT^ naman, nomen). Je crois aussi que la désinence védique tana, à la deuxième personne du pluriel, est pour tata : cette dernière forme n’est pas autre chose, selon moi, que la répétition de la désinence ordinaire ta1.
S hko. La première personne du pluriel en vieux haut-allemand, en gothique, en lithuanien, en ancien slave et en arménien.
En vieux haut-allemand, la première personne du pluriel présente la flexion très-complète mês, aux formes secondaires comme aux formes primaires, c’est-à-dire au subjonctif comme à l’indicatif. Le gothique présente simplement un m dans les formes primaires, tandis qu’il a ma dans les formes secondaires.
Le lithuanien a partout me, le slovène mo, l’ancien slave a\% tnü. Exemples : lithuanien stowi-me «nous nous tenons debout», slovène dêla-mo «nous travaillons», ancien slave ra<v\3 ja-mu «nous mangeons» ad-mâs, Mittî vê-mü «nous savons»
vid-mds. En ancien slave, au lieu d’un S ü, on aurait pu s’attendre à trouver un € e ou un 0 0 en regard de l’a sanscrit (§ 9 a *); je crois que l’ü est dû à l’influence de la lettre s qui se trouvait primitivement à la fin de cette forme 104 105.
11 est plus difficile d’expliquer ¥ê long du vieux haut-allemand. Peut-être, comme le conjecture Graff106, la désinence mês se rapporle-t-elle à la désinence masi, qui est particulière au
dialecte védique. Il faudrait alors admettre ou bien que la suppression de 1V final a été compensée par l’allongement de la voyelle précédente\ ou bien que Yi a passé dune syllabe dans 1 autre2. On peut s’étonner de voir qu’en gothique la désinence pleine mas est représentée simplement par m, au lieu que le ^ma des formes secondaires s’est conservé intact; nous avons, par exemple, bair-a-m «ferimus» en regard du sanscrit Mr-â-mns, et bair-ai-ma «feramus» en regard de Bâr-ê-ma. Cette différence vient probablement de ce que les voyelles qui précèdent la désinence, étant plus pleines au subjonctif qua l’indicatif3, sont plus capables de supporter le poids de la flexion. Le prétérit gothique nous fournit l’exemple d’un fait analogue : les seules racines qui aient conservé la syllabe réduplicative sont celles qui renferment une voyelle longue. Remarquez qu’au prétérit redoublé, où le sanscrit nous présente la désinence ma, et non mas, le gothique a simplement un m; comparez, par exemple, bund-u-m « nous liâmes » à haband-i-nuL Ici le gothique
supprime Va final parce que la voyelle précédente est brève.
En arménien, la désinence sanscrite mas devient i/g mq ; mais cette forme mq ne s’est conservée complètement qu’au présent de l’indicatif et du subjonctif. Partout ailleurs, on a supprimé le m, c’est-à-dire la partie essentielle de la désinence;
J représente la lettre finale s (§ 216) du sanscrit mas ; comme ce ^ q se trouve à tous les temps et à tous les modes, on doit conclure que l’arménien se réfère à une époque où la langue n avait pas encore fait la distinction, à la première per-
1 Dans celle hypothèse, mes sérail pour mas, de même qu’en gothique e représente l’d long sanscrit (S 69, 2). En vieux haut-allemand, on trouve aussi quelques exemples d’un ê tenant la place de l’d; par exemple, gê-t «il vas, de la racine gâ.
2 Comparez S 448. Dans les désinences, en vieux haut-allemand, ai devient ê (s79)-
(qui s’écrit ei) au subjonctif prétérit. Exemples :
5 diau subjonctif présent , î hatr-ai~ma, bêr-ei-ma*
sonne du pluriel, entre les formes pleines et les formes émoussées. Nous avons, par exemple, sir-e-mq «amamus», sir-ize-mq amenuisa (§ i83b, 9) et, d’autre part, sir-êa-q «amabamus», sir-eza-q « amavimus », sir-eszu-q * amabimus ».
§ 441. La première personne du duel, en sanscrit, en lithuanien,
en ancien slave et en gothique.
Comme au pluriel nous avons eu mas et ma, au duel, le sanscrit a vas dans les formes primaires et va dans les formes secondaires. Cette différence entre le duel et le pluriel est jusqu à un certain point fortuite, car, ainsi qu’on Fa déjà fait remarquer (§ 434), le v du duel est l’altération d’un m; toutefois, la distinction en question remonte à une haute antiquité, et elle a dû s’opérer avant que le germanique, le lithuanien et le slave eussent pris une existence individuelle, car dans toutes ces langues nous retrouvons la lettres. Le lithuanien a partout wa, l’ancien slave B* vê.
Le gothique nous présente trois formes. La plus complète se trouve au subjonctif, où bair-ai-va est avec Mr-ê-va dans le meme rapport qu’au pluriel bair-ai-ma avec hâr-ê-ma.
Si le subjonctif a mieux conservé la désinence duelle, c’est évidemment, comme au pluriel, grâce à la diphthongue précédente, qui s’est trouvée assez forte pour porter la syllabe va. Au contraire, le présent de l’indicatif avait probablement un a bref en regard de 1 à long du sanscrit Üdr-â-vas1 ; le v ayant, en outre, été supprimé, on a eu baira(v)a$ et, par la fusion des deux a, hai-ros 107 108. Reste le prétérit de l’indicatif, où nous ne pouvons avoir
us, car il a pour voyelle de liaison u, et non a : mais u-va est également impossible, puisque la désinence duelle va ne subsiste, comme la désinence plurielle ma, qu’après une diphthongue ou une voyelle longue. Nous devrions donc avoir u-v, qui ferait pendant au pluriel u-m. Mais v, à la fin des mots, se vocalise en u, quand il est précédé d’une voyelle brève : c’est ainsi que le thème thiva fait thiu «servum» (pour thiv). Les deux u en se combinant ont donc dû donner un û, et je regarde, en effet, comme long Tu de magu «nous pouvons tous deux», et de siju a nous sommes tous deux», que j’écris magû, siju (pour magu-u, siju~u, venant de mag-u-v, sij-u-p) L Si cependant, contrairement à mon opinion, ïu de cette désinence n’est pas long, on pourrait supposer qu’il s’est abrégé dans la suite des temps. Autrement, il faudrait le regarder comme une voyelle de liaison analogue à celle de mag-u-ts, mag-u-m, etc. ou il faudrait expliquer magu, siju comme venant de magva, sijva. Mais outre que cette dernière forme serait impossible à prononcer, l’adjonction immédiate de la désinence personnelle à la racine me paraît inadmissible, car elle n’a lieu ni à la seconde personne du duel, ni à aucune personne du pluriel, et elle est contraire a 1 ancienne formation de ce temps.
Je ne connais, en zend, aucun exemple de la première personne du duel.
S 44a. Tableau comparatif de la première personne des trois nombres.
Il sera traité à part des désinences du moyen. Je fais suivre ici un tableau comparatif de la première personne, dans la voix active transitive.
^1 Ce sont les seuls exemples de la forme en question qui nous aient été conservés. D'accord avec Grimm, je regarde magu, siju comme des prétérits, quoiqu'ils aient le sens du présent. En effet, mag est fléchi, dans les trois nombres, comme un prétérit. Il en est de même pour le verbe substantif au duel et au pluriel.
SINGULIER.
|
Sanscrit. |
Zend, |
Grec. |
Latin |
|
ttêlâmi • |
kistâmi |
ïcflrfiiL |
■StO |
|
deulâmi2 |
dad'âmi |
hihcotii |
do |
|
dsmi 4 |
ahtni |
SfCpt/ |
sum |
|
hdrâmi5 |
barâmi |
Çépù) |
fmjo |
|
vâhâtni * |
vasâmi • |
veho | |
|
tüjêyam |
i&laiïjv |
stem | |
|
dadyam |
daidyahm9 |
fahofyv |
dem |
Germanique l. Lithuanien. Ane. siave.
|
stâm |
st.fwmi |
slajun |
|
? • » • * * • |
llV 1 avmi |
damï |
|
im |
esmi |
jesmï |
|
baira |
« « • • * |
beruii |
|
viga8 |
IVCZU |
vesuri m |
1 Stâm et stâmês appartiennent au vieux haut-allemand ; les autres formes sont gothiques.
2 En arménien, atutj* ta-m.
3 Voyez S 39.
4 En arménien, em.
5 En arménien, ber-e-m.
4 «J’assemble», mdyrêman « fardeau ». Voyez Miklosich, Hadices, p. A.
7 Je crois que ë/co appartient à la racine vah « transportera : en effet, si 6%oç
(pour Fd%os) esl- de niême famille que è'^«, il s’ensuit que êyjœ est pour Fé%u et qu’il répond à vâhâmi et à veho. Le sens «transportera parait encore assez clairement dans les composés , èvéyco, etc. La racine sanscrite vah a, d’ail
leurs, aussi le sens de « porter », d’où l’on arrive aisément à celui de «posséder». ïl semble que le grec, dans là conjugaison de ce verbe, ait mêlé deux racines d’origine différente, à savoir = cS1| vah et {a%n ) —= ^ sah «supporter»; nous avons dans <rye la même mé ta thèse de la voyelle radicale que dans fiéÇXrjKa, venant de la racine |3aA. Si, contrairement à cette explication, on regarde et a%ÿ-aoù comme appartenant à la même racine, il faut admettre que est pour cré^co, et qu’il a perdu le a initial. Mais on ne devrait pas pour cela regarder l’esprit rude de é'£w et des formes analogues comme le représentant du <r, car le déplacement de l’aspiration suffit pour en rendre compte (S ioAa).
8 Viga ne s’emploie qu’en combinaison avec la préposition ga : ga-viga «je secoue», ga-vag «je secouai». Quant à vag-ja «je remue», il se rapporte à la forme causative vâhâyâmi (S 109% 6). 11 en est de même du lithuanien wâzôju «je me transporte» (S 99“).
9 La forme daitfyanm, qui se trouve au commencement du Vendidad, appartient à la racine sanscrite du «poser», et non à la racine dâ «donner», G’estce qui ressort du sens du contexte, qui exige l’idée de «faire, créer»; le verbe sanscrit àa a la même signification, sinon à l’état simple, du moins combiné avec la particule t». Je
PREMIÈRE PERSONNE. S kà± 29
Sanscrit. Zend. Grec. Latin. Germanique. Lithuanien. Ane, slave.
(a)syâm hyahm? è(<r)tyv stem sijau ...........
bârêyam ........(fpépoiv)1 feram bairau ...........
dvaham avasëm* eï%pv vehebam ................ . .
DUEL.
tûtâvas ..............................stowiwa stajevê
dadvâs ............. '................. duwa date
barâvas .......................bairôs .....berevê
vahâvas .......................vigôs wezawa vesevê
barêva ............... ........bairaiva5 .....berêvê4
vàliêua .......................vigaiva ..... vesêvê
âvahdva .........................................
*
|
iistânms tüîâmmih dadmâs6 dadmàsi |
histâmahi |
fol ap.es |
PLURIEL. stâmus |
stâmês |
stowime stajemü |
|
dadëmaki |
htbopes |
damus |
düme damü | ||
|
barmnas7 bdrâmasi |
barântaki |
(fiépopes |
ferimus |
hairam | |
|
vâMmas • vâhdmasi t\s\êma |
< ■ * f • » * < vasâmahi |
écopes |
vehimus |
vigam |
wezame vesemü |
|
» kistaima |
ierratypes stêmrn | ||||
|
dadyama |
daidyâma |
BiBotypes |
dêtnus | ||
|
barêma |
baraima |
(pépotpes fermai*, |
bairaima |
.....berêmü | |
|
vâhêma |
vasaima |
é%pipe$ |
vehâmus |
vigaima |
.....vesêinü |
|
dvahâma |
axas&ma ? |
stoppes |
vehebamus | ||
crois toutefois que le verbe dd « donner n ferait également dmdyanm, car le y change ordinairement le à précédent en Æ 1 Voyez % 43o. a Ou vasëm.
3 Vovez S hhi.
4 Voyez S 93°.
5 Forme védique; voyez S h3i).
6 En arménien, tnstnQr tfl-wuj.
‘ En arménien, ber-e-mq.
DEUXIÈME PERSONNE.
8 kk§. Formes diverses de la désinence de la deuxième personne.
Le thème pronominal sanscrit tva, en se combinant avec les thèmes verbaux, s’est scinde en différentes formes. Ou bien let est resté invariable, ou il est devenu, par la substitution de Tas-pirée à la ténue, un i ou un d', ou il s est altéré en s (comparez le grec cru). Tantôt le v s’est maintenu, tantôt il a été supprimé. Quant à la voyelle a, ou elle est restée invariable, ou bien elle s’est affaiblie en i, ou enfin elle a disparu tout à lait.
C’est au moyen que la forme pronominale s’est le mieux con- ! servée, dans les désinences sva, dvê, dvam : sva se trouve au singulier de l’impératif, dvê au pluriel des formes primaires, dvam au pluriel des formes secondaires. Mais comme nous traiterons dans un chapitre spécial des désinences du moyen, nous passons tout de suite à la forme active transitive.
Le v du thème tva ne s’y est complètement conservé nulle part; mais je crois en reconnaître une trace dans l’aspiration du t. Nous trouvons, en effet, un t, au lieu d’un t, au duel et au pluriel des formes primaires, et aux trois nombres du prétérit redoublé. Au contraire, les formes secondaires, qui ont en général des désinences plus émoussées, présentent au pluriel et au duel la ténue pure; on peut comparer, par exemple, tiétê-ta «que vous soyez debout» avec tUfa-ia «vous êtes debout», et, au duel, tiétê-tam «que vous soyez debout tous deux» avec tUju-ias «vous etes debout tous deux». On voit par là qu’en sanscrit les aspirées sont plus pesantes que les ténues et les moyennes, ce qui s explique aisément, puisque les aspirées sont la réunion d’une tenue ou d une moyenne avec un h parfaitement perceptible à 1 oreille (S 12). Dans cette aspiration qui suit le t, je crois reconnaître un reste du v de tvam.
$ Mi h. Origine de ces formes diverses.
On voit par les exemples qui viennent d’être cités que la désinence pleine de la deuxième personne du présent est tas au duel et ta au pluriel. Mais en étudiant le substantif (§ 206), nous avons vu que le duel doit son origine à un renforcement des désinences plurielles : or, les désinences personnelles, étant des pronoms, sont dans le rapport le plus étroit avec le nom. On pourrait donc admettre que la deuxième personne du pluriel, dans le verbe, a d’abord été tas ; de cette forme tas serait dérivée la désinence duelle tâs; dans le cours du temps, le pluriel tas aurait perdu son s et le duel tâs aurait abrégé son â. Remarquons que déjà à la première personne le s de mas ne tient plus très-solidement, car on trouve fréquemment ma, même dans les formes primaires. Si tas est, en effet, la désinence primitive de la deuxième personne du pluriel, elle s’accorde parfaitement avec le latin tis; en même temps se trouverait confirmée la conjecture de Thiersch1, qui a été amené par des observations sur l’hiatus à supposer que dans Homère, au lieu de re, la désinence du pluriel était Tes, en analogie avec la première personne (£5.
Il reste à examiner quelle est l’origine de la lettre s qui termine tas : sans aucun doute, elle est identique avec le 5 de mas. En conséquence, ou il faut diviser de cette façon : ï-as, et regarder as comme la désinence du nominatif pluriel; ou bien, il faut diviser ainsi : ia~s, et expliquer le s comme un reste du pronom annexe sma (§ 335)109 110. Si cette dernière hypothèse est la vraie, on pourrait admettre que le ni de sma s’est conservé dans la désinence duelle tam des formes secondaires,
on sorte que sma aurait été mutilé de deux manières différentes, ayant subi une fois la suppression de son m et une autre fois celle de s.
Mais il se présente encore une autre explication pour le m de tam, quelle que soit d’ailleurs, parmi les deux hypothèses précédentes, celle qu’on préfère pour la désinence tas. Comme ce sont ordinairement les formes primaires qui, en s’émoussant, ont donné naissance aux formes secondaires, on peut supposer que la lettre sourde m provient d’un s : c’est ainsi qu’en grec, même dans les formes primaires, nous avons rov en regard de tas, et, à la première personne, psv en regard de mas, de même, en prâcrit, l’ancienne désinence casuelle fà^èisest devenue f|f Inri (§ 97)* Par une application du même principe, on peut supposer que la désinence WPT dans la déclinaison
duelle, est primitivement sortie du pluriel Uyas par un simple allongement de la voyellé (S 315), et que plus tard le s final s’est altéré en ni. 111
tas1 : rapprochez bair-a-ts de Bàr-a-ias, en grec Ç>ép-s-
tov, et, dautre part, bair-ai-ts de b'àr-ê-tam, en grec
(pép—Ot—TQV.
Le slave a dû supprimer la consonne finale de la désinence en question (S 99 ffi). Le lithuanien, sans y être obligé, la également rejetée. Tous deux font ta, qui correspond a la fois au tas sanscrit des formes primaires et au tam des formes secondaires. Comparez le slave AdCTa das-ta (§ io3), le lithuanien düs-ta «vous donnez tous deux», au sanscrit dat-tds, au grec StSo-Tov, et, d autre part, AdAHTd dad~i-ta «que vous donniez tous deux», au sanscrit \dad-yâ-tam, au grec StSo-fa-top; rapprochez encore le lithuanien düd-ô~t~a 2 «vous donnâtes tous deux» du sanscrit âdâ-tam et du grec sSo-rov.
S 446. Deuxième personne du pluriel.
Je 11e connais pas d exemple, en zend, de la deuxième personne du duel. Le pluriel est, comme en sanscrit, ta dans les formes primaires 3, et «ç» ta dans les formes secondaires. En giec, en slave et en lithuanien, nous avons partout re, te, te. Le latin a partout fis (§444), excepté à l’impératif, où tis a été affaibli en te. Le gothique présente toujours un th, avec suppression de la voyelle finale; mais ce th ne doit, selon moi, ni être
1 La même suppression de Va a Heu au nominatif singulier des thèmes en a : comparez vuî/s au sanscrit vrhan et au lithuanien wiîkas.
3 Le lithuanien traite dùd comme étant la racine. Vô de l'aoriste est donc simplement une voyelle de liaison qui correspond à Va du sanscrit âbud'-a-tam « vous sûtes tous deux».
3 Oh pourrait expliquer, en zend, l'aspiration du i i comme provenant d’un v ont il était primitivement suivi, et qui, quoique disparu, se ferait encore sentir de cette façon, on a vu, en effet (S 67), que les semi-voyeües peuvent changer un t precedent en aspirée. Mais comme nous trouvons également un i en sanscrit, ou la même oi phonique n'existe pas, je préfère appliquer aux deux langues l’explication donnée
« essus (S 443), el voir dans le h que renferme l'aspirée i le représentant effectif ne 1 ancien t».
3
ni.
identifié avec le t sanscrit et zend des formes primaires, ni expliqué par Tellet ordinaire de la loi de substitution des consonnes. Je crois plutôt que la désinence gothique, avant la perte de la voyelle finale, était da; on a vu que dans les désinences grammaticales et dans les suffixes, le gothique met volontiers un à entre deux voyelles, au lieu d’un t primitif; or, après la suppression de la voyelle finale, ce A se change ordinairement en th (§ 91, 3 et 4).
Envieux haut-allemand, nous trouvons un t, que je rapporte également à ce d gothique; la substitution de consonnes particulière au vieux haut-allemand (§ 87, a) a ramené ici la ténue primitive. C’est ainsi que nous avons wëg-a-t «vous remuez» en regard du latin veh-i-tis, du grec sy-z-Ts, du lithuanien wez-a-te, de T ancien slave K€3CT£ ves-e-te, du sanscrit vdh-a-'ta, du zend vas-a-ta; la forme gothique est vigith, pour vigid, venant ïui-méme de vig-a-d
S hh']. Deuxième personne du singulier, en sanscrit, en zend
et en ancien slave.
Nous passons au singulier. En sanscrit, les formes primaires ont la désinence si, les formes secondaires un simple Dans certaines positions, si se change en si (§ 31 b).
En zend, le sanscrit si est resté, au lieu que si devient jgy hi (§ 53). On a, par exemple, bavahi «tu es», en
regard du sanscrit fiâvasi; aki (même sens) en regard du
sanscrit dsi (pour as-si); et, d’autre part, kërënûisi
«tu fais» en regard de kpiosi*. Dans les formes se
condaires, la sifflante finale, en se combinant avec un * a précédent, donne en zend un ^ ô; avec un m â précédent, elle donne pu âo; la sifflante est conservée après les autres voyelles. 112
Ainsi l’on a, par exemple, frmrâvayô «tu parlas»
(littéralement «tu fis entendre») en regard du sanscrit prâ-érâvayas; mais nous avons .igLAe mrnns « tu parlas » , qui suppose la forme sanscrite dbrôs112.
Parmi les langues de l’Europe, c’est l’ancien slave qui a le mieux conservé la désinence des formes primaires si ou si : les verbes qui s’adjoignent immédiatement les désinences personnelles (§ A36, 9) ont si; tous les autres verbes prennent si2. On peut comparer :
Sanscrit,
Ancien slave
KCM jesi «es»
AdCM dasi3 ftdasn racw jasi credis*
K'BCM vêsi rr no vis tir
nmcilJH pijesi <rbibis»
CHKUJH sijeêi frquiescis»
CAVËKUJlt smêjesi (ca sah) rr rides * K’ËfêiUH vêjeêi frfiasw 3Ndi£tfJH majeêi crnovisti» ’ 3\HK6UJM sivesi rr vivis T>
HdACUlH padeêi creadis»
Emma veseêi «vehis» nc^cuiu peceèi n-coquisr TpACCUiM trahseêi (ca sah) rrtremis» A^pcujH deresi «■ excoria s r
^iftf dsi
dâdâsi
jzfm ,usi
vêlsi
pivasi4
^ se si (moyen). smâyasê5
Hstuai
vasi
^rnrrflr gânasi 6 gtvasi
pddy asê «tu vas» mhmi pàcasi wfil tràsasi
Wrftr dpiasi rr laceras «
Au lieu de âbvôs, le sanscrit fait d’une manière irrégulière àbravîs.
2 Sur la cause euphonique de cette différence, voyez $ 9a*.
1 Voyez S 636, 2.
4 Comparez flHBO pivo «bière».
5 Forme moyenne qui est remplacée en slave par le pronom réfléchi postposé.
Ce verbe est fléchi d après la neuvième classe (S 109*, 5), mais avec suppression irrégulière du h de la racine ghâ.
7 La vraie racine est dar (d’après les grammairiens indiens ^ dr); ÏÏTT nâ (par euphonie pour nâ) est la caractéristique de la neuvième classe. Voyez S 109", 5.
3.
;
WJÜÜHBI0!!
36 DÉSINENCES PERSONNELLES.
Ancien slave. Sanscrit.
npOUJMUJH prosisi «precaris» prccâsi trinlerrogas» 1
n^AtUUH pundiêi «peîlis» R) pâdàyasi2
BOVÀHUIH budisi «expergefacis» ^TWïfW bôddyasi.
§448. Deuxième personne du singulier, en lithuanien, en grec, en borussien et en vieux haut-allemand.
Le lithuanien a conservé la désinence pleine si dans quelques-uns des verbes dont la première personne se termine en mi, notamment dans ei-si «tu vas», gêlb-si «tu aides», serg-si «tu gardes », sâug-si (meme sens), mëg-si « tu dors »3. Tous les autres verbes n’ont conservé de la désinence si que la voyelle4, devant laquelle, comme on l'a déjà fait remarquer (§ 436, i), le caractère de la classe est supprimé dans la première et la deuxième conjugaison de Mielcke; on a, par conséquent, wei-i, en regard du slave ves-e-si, du sanscrit vdli-a-si, du gothique vig-i-s, du grec 6%-fa-s.
La forme ë^-si-s et les formes analogues doivent s’expliquer, selon moi, par une métathèse qui a fait passer dans la syllabe précédente Yt de la désinence organique en; ë%-st~s est donc pour Rappelons ici une métathèse analogue dans les
féminins comme yevéretpa, Tépeiva (S 119)» dans les comparatifs dfÀsi'voôv, ysiptûv, et dans les verbes comme (iaivo(xou, y&lp® (§ 109% â). La désinence organique at ne s’est conservée invariable que dans le dorien êa-ari, auquel correspondent le sans-
Ti* . .....
1 Rapprochez la forme zende »4>uia£)gg përëéahi. En russe, s-prositj signifie « interroger».
8 Forme causale de pad «aller». Je crois que le latin petto appartient à la même racine, avec changement de d en l (S 17) et assimilation du y qui suivait (comparez dcAAos, venant de <&jos, 819). Cej serait un reste du caractère causatif WX aya,
3 Schleicher, Grammaire lithuanienne, p. z5a et suiv.
4 L'orthographe essi «tu es» est fautive.
cril âsi (avec perte de la consonne radicale s) et le borussien as-sai, as-sei. es-sei et as-se.
En borussien, la désinence de la deuxième personne du singulier s’est maintenue d une façon très-complète. Non-seulement le verbe substantif précité, mais presque tous les verbes pour lesquels il nous reste des exemples de la deuxième personne, présentent Tune ou l’autre des désinences qui viennent d’être mentionnées. La forme pure si se trouve dans giw-a-sil «tu vis», lequel est plus près du sanscrit gïv-a-si que le slave îkmbcum siv-e-si. La désinence la plus fréquente est soi, qui rappelle le grec <r cet, le sanscrit % se (venant de sai, § 2), le gothique sa; mais je crois que la terminaison borussienne doit s’expliquer par le penchant particulier de cet idiome pour les diphthongues : c’est ainsi qu’à la première personne du singulier le verbe substantif fait asmai, ce qui lui donne l’aspect d’un moyen. Le borussien asmai est plus près que le lithuanien esmi du lette es-mu, dont Vu est, selon moi, l’affaiblissement de Va de la désinence borussienne mai; rappelons, à ce sujet, le rapport qui existe entre le vieux haut-allemand ru (dans dëru, S 356) et le gothique sai (= sanscrit syâi), au datif féminin de certains pronoms 113 114.
Nous retournons au lithuanien pour faire observer qu’à la deuxième personne du singulier, dans les formes secondaires, nous trouvons un i en regard de la désinence sanscrite s; exemple : sukaî «tu tournas», pour suka-s. Je regarde aujourd’hui cet i comme une vocalisation ou comme un remplaçant de s (§ i&7). L’ancien slave a dû supprimer le s final des formes secondaires (§92“); exemple : B€3w vesi «transporte», en regard du sanscrit vâhê-s «que tu transportes» (S 99 e), du zend vasôi-s, du grec ëxpi-s, du latin vehê-s, du gothique vigai-s, du vieux haut-allemand wëgê-s.
Au sujet du présent, en vieux haut-allemand, il faut encore remarquer qu’au lieu d’un simple « il a aussi quelquefois st; cette dernière forme a prévalu en moyen haut-allemand et en allemand moderne. Exemples : bis-t «tu es», à coté de bis — sanscrit bdv-a-si; luos-t «tu fais», à côté de tuos = sanscrit dddâ-si, grec TtOn-s; stas-t «tu es debout» (dans Notker) pour le sanscrit tista-si, le grec i</) tj-$ ; gas-t, gês-t, geis-t « tu vas », à côté de gâ-s = sanscrit gdgâ-s,, grec fifëv-s; bîutis-t «tu offres», à côté de piuti-s — sanscrit bod-a-si, venant de baud-a-si ( § 2 ). Je regarde ce t comme un débris du pronom de la deuxième personne, lequel a conservé ici l’ancienne ténue, grâce à la lettre s qui précède (§ 91, 1). On trouve assez souvent le pronom complet tu ajoute, comme pronom annexe, après le signe personnel s ; exemples : bis-tu « tu es », ginnis-tu « tu commences », scades-tu «tu nuis»1. *
S Uhÿ. La deuxième personne en arménien.
L arménien a sy non-seulement dans les formes secondaires où il représente le s sanscrit, mais dans les formes primaires où il est pour le sanscrit si» Comparez c-s « lu es » avec le sanscrit d-si, en latin e-s, en gothique i-s; utuju tas*tu donnes» avec le sans-
1 Voyez GrafF, Dictionnaire du vieux haut-allemand, t. V, col, 80.
crit dddâ-si, en grec SiScj-s, en latin da-s; quoi ga-s «tu viens» avec le sanscrit gâgâ-si, en vieux haut-allemand gâ-s, en grec ftiên-s (§ ia3); pkptru ber-e-s a tu portes» avec le sanscrit Mr-a-si, en gothique bair-i-s, en vieux haut-allemand bir-i-s. Pour les formes secondaires, comparezftghru lies (venant de iyesj «que tu sois» avec le sanscrit syâs, le latin siês, le grec è{a)lns (§ 183 b, â); muijiru taze-s (venant de dayes) «dabis» avec le sanscrit dêya-s « que tu donnes », le grec Soins.
Au lieu de s, dans les formes secondaires, on trouve aussi p r, notamment a l’imparfait, aux deux aoristes et facultativement au futur1. Comme exemple de la seconde forme de Faoriste, nous citerons kl^ftp ekir a tu vins»2, pour le sanscrit dgâ-s, le grec e6?s. Si l’impératif présent prohibitif (c’est-à-dire précédé de mî = sanscrit ma, grec pu/) est originairement identique, comme le suppose Petermann3, avec le présent de l’indicatif sanscrit, nous avons un r comme représentant de la désinence primaire su Mais il se pourrait aussi que cet impératif précédé de mi correspondît à l’imparfait : on sait, en effet, qu’en sanscrit l’imparfait ainsi quo Faoriste, précédés de la particule mâ, sont souvent employés à la place de l’impératif présent; ils peuvent alors etre privés de Faugment. Exemple : mâ Bar-a-s «ne porte pas», qui correspond parfaitement, abstraction faite du changement de s final en r, à l’arménien mi ber-e-r (même sens), bi ce rapprochement est fondé, berer serait pour e-berer (en grec efàpes). Pour tous ses verbes, l’arménien aurait gardé dans cette construction un imparfait simple4.
Dans le futur arménien, nous avons reconnu (S i83b, a) le précatif sanscrit et l’aoriste de l’optatif grec. Sur l’imparfait, voyez le même paragraphe.
2 U® dans ekir, est ie substitut du g de ga-m. Voyez Petermann, Grammaire arménienne, p. a3â.
* Grammaire arménienne, p. igi. -
attributifs contient le verbe
1 On a déjà vu que l’imparfait ordinaire des verbes substantif.
Au pluriel, la deuxième personne de tous les temps et de tous les modes est exprimée par^t q; devant cette lettre, b e s’allonge et a s’élargit par l’addition d’un j i. Peut-être ce q est-il sorti d’un s, comme celui de la première personne (§ 44o); ber-ê-q «vous portez » serait alors pour ber-e-tq, et celui-ci pour ber-e-ts ; comparez les pluriels latins en tis ( fer-tîs), les duels sanscrits en tas (Mr-a-ias) et les duels gothiques en ts (bair-a-ts). L’allongement ou l’élargissement de la voyelle précédente serait alors une compensation pour la perte du signe personnel. Mais si le q de ber-ê-q « vous portez », npuuy^ ors-ai-q « vous chassez »1 et des formes analogues est la vraie expression du rapport personnel, il faut l’expliquer par le v du thème tva115, de même que le pronom simple de la deuxième personne a donné en arménien, aux cas obliques, les thèmes qe, qo (§ 34o). Rappelons à ce sujet les désinences dm et dbam du moyen sanscrit : ber-ê-q «vous portez» répondrait au sanscrit tiar-a-dvê, et l’impératif prohibitif mi ber-ê-q «ne portez pas » à nul bar-a-dvam.
S /i5o. La désinence dï à la deuxième personne du singulier
de l’impératif sanscrit.
Il nous reste à examiner deux désinences de la seconde personne du singulier, qui ne sont employées chacune que dans un seul temps : ce sont, en sanscrit, di et ta. La première se trouve à l’impératif de fa seconde conjugaison principale, laquelle répond à la conjugaison grecque en pt. La désinence ta se trouve au parfait redoublé de tous les verbes.
A côté de di, nous avons fç hi, qui est une forme moins pleine de la même terminaison. Dans le sanscrit ordinaire, di ne se trouve qu après une consonne ; exemples : ad-di « mange », vid-di «sache», vag-di ' « parle v, yung-di «unis». Les voyelles
1 Première personne ovs-a-mq.
- Voyez S a 2 6.
n étant pas assez fortes pour porter la désinence pleine après elles, il ne reste du /que l’aspiration L Exemples : M-hî « brille ». pâ-hi «gouverne». Il n’est pas douteux que di nait cte dabord la désinence usitée pour tous les verbes : on le pouvait déjà supposer par la comparaison du grec, où l’on n’a pas seulement îcr-0*, Ké>cp(xx-0i, âvôôx-Oi, 'æéitsHJ-Qi, mais encore <pa-6i\ t-0i, cr7?-0f, etc. Le sanscrit présente d’ailleurs des exemples assez nombreux d’aspirées dont il n’est resté que le h (§ 23), et dans les dialectes plus récents, tels que le pâli et le prâcrit, on trouve souvent un h là où le sanscrit a un d, un g ou un Aussi avais-je déjà émis dans mes premiers écrits3 l’idée que ce n’est pas, comme on l’admettait jusqu’alors, la désinence hi qui se renforce et devient di après une consonne, mais au contraire d'i qui s’affaiblit en hi après une voyelle. Mon hypothèse a été depuis justifiée par le dialecte védique, où l’on trouve déjà, à la vérité, la forme mutilée hi, mais où la désinence di se combine cependant encore quelquefois avec une voyelle; on a, par exem pie S sru-d'i «écoute», qui correspond parfaitement au grec xXv6t. De son coté, le zend est venu confirmer le même fait, car il a partout di ou di, et non si, comme il faudrait s’y attendre, si la forme hi avait déjà existé au moment ou le zend s est séparé du sanscrit5 ; exemples : stûidi « loue », en regard du sanscrit stuhî; kërënûidi «fais», en regard du sanscrit kpiu, qui a entièrement perdu sa désinence personnelle; ias-di «donne» (par euphonie pour dad-dt), en regard du sanscrit dehic\ 116 115 117 118 119 120
S 451. Deuxième personne de l'impératif, en sanscrit et en grec.
La conservation plus ou moins complète de la désinence f%| rfï dépend, comme on vient de le voir, du plus ou moins de vigueur de la partie antérieure du mot. Une autre preuve de ce fait nous est fournie par les verbes de la cinquième classe, dont la caractéristique est nu (§ ioga, 4). Quand cette syllabe nu s’appuie sur une consonne précédente, le verbe présente la forme mutilée H; exemple: âpnu-M «obtiens», de la racine dp (comparez ad-ipiscor). Mais quand nu est précédé d’une voyelle, la consonne n à elle seule n’est pas assez forte pour porter la désinence hi; exemple : ci-nu « assemble », de la racine ci. Ici le sanscrit se rencontre avec le grec, où les verbes de la même classe sont également dépourvus, à l’impératif, de la désinence personnelle; exemple : Setxvv. Mais la rencontre en question est fortuite, car le grec et le sanscrit ne sont arrivés, chacun de son côté, à cette forme mutilée qu’après la séparation des idiomes indo-européens; on peut même dire que Setxvv n’est pas absolument dénué de flexion, car il a un v long qui renferme encore, selon moi, Yi de la désinence^; c’est ainsi qu’à l’optatif nous avons Sauttvro1, venant de Satvuno. Il n’est donc pas nécessaire de rapporter Selx-vû à la conjugaison en a et d’y voir une contraction pour Sstx-vvs; de même, rtOet ne vient pas de ti'Qss, mais de rtOen, avec suppression du t, comme runlei de rvnlsn2 ; de même encore tain (pour iV7jj) vient de î<r7a(0)i. Il est vrai que SiSov est pour Si'Soe ; mais nous avons encore dans Pindare StSoi, qui s’explique très-bien par la forme St'So(6)i3.
reconnais un impératif aoriste de la cinquième formation sanscrite ; il répond, par conséquent, au grec àâ-Bt.
1 Iliade, XXIV, vers 665.
2 Comparez des faits analogues en espagnol, où nous avons, par exemple, à la deuxième personne du pluriel, canlais, venant du latin c uni ali».
;t Le rapport de SîSot avec StSov n'est pas le meme que celui de ivnlotai, tu** $ h5a. Suppression de la désinence à la deuxième personne de l'impératif,
en sanscrit et en grec.
De même que le ^ u de la cinquième classe, quand il n’est pas précédé de deux consonnes, est devenu incapable de porter la désinence personnelle di ou hi, de même Y a bref de la première conjugaison principale est trop faible pour servir de support, en sanscrit et en zend, à la désinence en question; il semble qu’il l’ait déjà perdue dès l’époque la plus reculée, car elle manque aussi à la conjugaison correspondante en grec, c’est-à-dire aux verbes en et elle fait absolument défaut en latin et dans les langues germaniques. Les verbes forts, dans ces derniers idiomes, perdent en outre le caractère de la classe; exemple : vig (pour viga), en regard du sanscrit ^ vah—a? du zend vas ci? du latin veh-e, du grec e^-s.
S 453. La désinence du parfait sanscrit ta.
Nous passons à la désinence ta qui, comme nous lavons déjà dit (§ 45o), appartient en propre au prétérit redoublé. En zend, je ne connais pas d’exemple certain de cette désinence dans les formes redoublées; mais je ne doute pas qu’elle n’ait également été d’un usage général dans cet idiome. Il y a un passage du Yaçna1 où l’expression fra-dadâîa ne peut guère
signifier autre chose que «tu donnas», et doit correspondre au sanscrit pm-dadâta (§ 39); en effet, cette forme ne peut être la seconde personne du pluriel, car il faudrait fm-dasta2,
Tsloiatt avec tvts'Iovgi, TvitfovGct, Eu effet, dans ces dernieres formes, 11 remplace une nasale, comme dans péXctts, pour fiéXâf (venant de péXavs). Dans la langue ordinaire, cette nasale s’est résolue en o; mais elle peut aussi devenir un comme on le voit encore par itOeîs (pour nQévs). Au contraire, dans Stèou et Slêot, il n’y a jïas eu altération d’une ancienne nasale.
1 Vendidad-Sâdé, p. 311.
2 Pour frmlaêia (S 38).
avec suppression de Yâ de la racine, comme en sanscrit et comme à la première personne plurielle dadëmaM (§ 3o).
Parmi les langues de l’Europe, c’est le gothique qui se rapproche le plus du sanscrit, car, à la deuxième personne du singulier, il a un t comme désinence dans ses prétérits simples (appelés aussi prétérits forts). Ce t n’a pas été touché par la loi de substitution des sons, parce qu’il est toujours précédé d’une autre consonne (§91, 1); autrement nous devrions nous attendre a trouver en gothique un th, c’est-à-dire le représentant habituel du t sanscrit. Il ne faut pas oublier, en effet, que le i sanscrit est une lettre d’origine relativement récente (§ 12), qui tient ordinairement la place d’un ^ t, c’est-à-dire de la lettre à laquelle le grec oppose un t et le gothique un th.
Il est vrai qu’en grec la désinence correspondant au ^ ta sanscrit est 0a, par exemple dans »îcr0a, oïcrQa. Mais on ne doit pas se laisser tromper par une identité qui n’est qu’apparente : ce S-est dû à la présence du a précédent, comme on peut s’en assurer par la comparaison du passif et du moyen, où tous les t des désinences personnelles se changent en 3-, quand ils sont précédés d’un o-1. Il reste à expliquer d’où provient ce er. Dans et ol<70a, je crois qu’il appartient à la racine2, et qu’il faut diviser ces mots ainsi : 0<7-0a, olcr-6a (pour oiS-Qa). Le premier correspond au parfait sanscrit as-i-ia « tu es assis » 3 et est sans doute lui-meme un parfait4. Le second correspond au sanscrit vêi-ia
1 Par exemple dans (pépeaBs, ê@êpsofle, ÇepérrOaj^ SîSoaOov, êStêô'rOyv (S h'jh). Quand le £■ grec n’est pas le résultat d’une modification phonique particulière à cette langue, il correspond au sanscrit, et non au ^ t (S 16).
2 Je retire l’explication que j’ai donnée autrefois de ce a dans les Annales de littérature orientale, p.
3 Sans la voyelle de liaison, nous devrions nous attendre à avoir iïs-ia} qui existe peut-être dans le dialecte védique. La première personne ya, pour correspond au sanscrit «je suis assise.
4 Si pourtant l’on voulait voir dans %aQa un imparfait, on pourrait en rapprocher
l’imparfait moyen Astas,
(pour vêd-ta) «tu sais», au gothique vais-t (pour vait-t, § 102) et au zend vais-ta. Ainsi qu’on peut le constater par la
comparaison du sanscrit avec les autres langues de la famille, la racine vid présente dès les temps les plus anciens cette double particularité, quelle a les désinences du parfait redoublé sans prendre le redoublement et tout en ayant le sens d’un présent; on peut rapprocher la première personne vê'da (et non vivêda)
kje sais» du grec oiSa (pour FoiSa), du gothique mit et du zend
midit.
Quant à ëÇtja-Ba et aux formes dialectales comme (py}<r-Ba, uûiia-êoc, elcr-Oa, è8é\rj(T~Qa, x\aioi<r-8a, il semble que la désinence 6a s’y soit introduite par abus : ni le temps, ni le mode n’appelaient cette désinence. Peut-être est-ce l’exemple de 1)<r-6* et de oîa-Ba qui a fait que cette terminaison est venue se surajouter au cr, qui à lui seul exprimait déjà la seconde personne. Thiersch propose une autre explication 1 : il regarde Bot. comme une désinence adverbiale, qui serait venue se joindre a cri abrégé en <r. Il faudrait alors rapprocher ce Ba du suffixe sanscrit ha (venant de dh), du suffixe zend da, et du Ba de ëvBa, svtavBct (§ h20). Mais alors on devra admettre aussi que dans les formes comme riBtja-Ba, ïja-Ba, le thème pronominal auquel appartenait ce suffixe121 122 123 s’est perdu, et que l’adverbe s’est totalement dépouillé de sa signification.
8 454. La désinence du parfait st en gothique et en vieux haut-allemand.
En gothique, les racines finissant par une voyelle insèrent encore un s euphonique devant la désinence personnelle t; le seul exemple qui nous reste est saisô-s-t3 « tu semas », de la ra-
cine sô. De même, la racine vô (= sanscrit vâ) «souffler» a dû faire probablement vaivâ-s-t (= sanscrit vavâ-ia). Peut-être ce s a-t-il été introduit par suite d’une fausse analogie avec les nombreux verbes forts terminés par une dentale, lesquels changent cette dentale en s devant le t de la seconde personne (§ 102); c est ainsi que nous avons bans-t « tu lias » en regard du sanscrit babànd-i-ia, gaigrôs-t1 «tu pleuras» en regard du sanscrit ca~ krând-i-ta.
Le vieux haut-allemand n’a conservé le signe personnel que dans les prétérits ayant le sens d’un présent. Il y en a douze124 125 126 127 128, parmi lesquels weiz «je sais, il sait», dont la deuxième personne wm-t répond au gothique vais-t et au zend vais ta,
S A55. Tableau comparatif de la deuxième personne.
Nous faisons suivre le tableau comparatif de la deuxième personne des trois nombres, dans la forme active transitive :
|
Sanscrit, |
Zend. |
Grec. |
|
ast129 |
aki |
è(Tffl |
|
tistasi |
histahi |
ïarfijs |
|
dâdâsi 130 |
dad'âhi |
Z(Bù)S |
|
barasi131 |
harahi |
pépsts |
|
vâha&i |
vasahi * |
éyets |
SINGULIER.
Latin. Gothique. Lithuanien.
|
es |
is est11 |
|
stâs |
V.h.-a. StâS StÔWl |
|
das |
.......dûdt |
|
fin' |
bairis .... |
|
vehis |
vigis weû |
Ancien slave.
jesi
stajesi
dasi
beresi
veseêi
|
Sanscrit. |
Zend. |
Grec. |
Latin. |
Gothique. |
Lithuanien. Ancien slave. |
|
(ajsyâs |
hyâo |
è(a)b}S |
siês |
sijais1 | |
|
dadyds |
daidyâo |
httolrjs |
dès |
« | |
|
barês |
barôis |
Çépots |
feras3 |
haïrais | |
|
vâhês • |
vasois * |
éxpts |
vehâs |
vigais |
• |
|
âvakas • |
avasô • |
eî%es |
vehebâs | ||
|
êdV |
asdi?6 |
taBt | |||
|
viddi |
visdif7 • |
tadi | |||
|
dêM* |
dasdi9 | ||||
|
srudt10 |
ukvdt | ||||
|
va ha • |
vasa |
éXe |
vehe |
vig | |
|
A' •! asita |
âonhita?11 vaQct 12 | ||||
|
veûa |
vaiêta?13 |
oïaôa, |
. vaist | ||
|
tutodita |
, staistaustli | ||||
|
bibedila |
. baist | ||||
I Sij constitue le thème, a est la voyelle de la classe et i l’expression modale. Nous reviendrons sur ces différents points.
8 Voyez S 92 \
3 Voyez S 692.
4 Voyez S 9 2 m.
5 Venant de ad-di, qui lui-même est pour as-du
0 En regard du primitif ad-di (devenu édV), on peut supposer en zend une forme os-di. Comparez le zend dm-di, venant de dad-di (S 10a).
7 Voyez S 102.
8 Venant de dad-di, pour dadâ-hi, qui lui-même est pour dadâ-dï.
9 Voyez S 102.
10 Forme védique (S 45o).
II Le manuscrit lithographié donneJradadaiâ avec Fa final long; mais celte forme se trouve dans la partie du Yaçna qui allonge les voyelles finales. Quant à la forme donktia, dont il n’existe pau d’exemple, j’ai cru pouvoir la supposer d’après l’analogie dejradaddta; nous avons la troisième personne âonha — dsa (S 56b). La deuxième personne, en sanscrit, est iïsita.
** Voyez S 453.
13 Voyez SS 102 et 453.
14 La racine gothique staut a partout le gouna et a ainsi sauvé le redoublement. Le t final tient la place d’un d, en vertu de la loi de substitution des consonnes. Quant au î initial, il s’est maintenu intact, grâce à la lettre $ qui précède, et qui est peut-être le reste d’une préposition (= sanscrit sam, slave su). Voyez 891,1. [L’auteur rapproche le gothique staul « pousser» du sanscrit tud (même sens). — Tr.]
DUEL.
|
Sanscrit. tistatas 9 bdralas vâhatas « bârêtam vâhêtam • dvahatam |
Zend. histatô ?1 baratof vasaîô ? 9 |
Grec, ïtriarov (pépsrov 8%ST0V (pépoirov ê%plTOV efysTOv |
Latin. |
Gothique. bairats vigats bairalts vigaits |
Lithuanien. stowita wezata |
Ancien slave, stajeta bereta veseta • berêta vesêta * |
|
PLURIEL. | ||||||
|
tütata « |
histaîa |
terioLTS |
stâtis |
V.h.-a. stât stdwite |
stajete | |
|
bâraîa |
barata |
<pépsre |
bairith134 |
berete | ||
|
vâkaia • |
vasata » |
vehitîs |
vigith |
wezate |
vesete • | |
|
liste ta |
Installa |
îalairjTS |
stêtis |
stajete | ||
|
dadyata |
daidyâta |
bthotVfTS |
dêtis |
* * * « * • * |
dîikite |
dadite |
|
baréta |
baraita |
(pépotrs |
ferâlis |
bairaith |
berête | |
|
vâhêta • |
vasaita » |
é%otTe |
vehâtis |
vigaith |
wêêlcite |
vesete U |
|
âvahata • |
avasata • |
et^ere |
vehebâtls | |||
TROISIEME PERSONNE.
§ 456. Origine de ia troisième personne. — La troisième personne
du singulier, en grec.
C’est du thème pronominal Vf ta (§ 343) que vient la désinence de la troisième personne. Dans les formes primaires, Y a de ta s est affaibli en i, et dans les formes secondaires , il est tombé tout à fait, comme à la première et à la deuxième personne. En sanscrit et en zend, le t n’a subi aucune modification, excepté dans la seule désinence plurielle us (S 46s) : il diffère,
à cet égard, du t de tva «toi», que nous avons vu, à la deuxième personne, devenir tour à tour t, de t s.
II en est autrement en grec : excepté dans quelques formes dialectales et dans le seul verbe èart = sanscrit wfèî asti, zend 4ç»j»4» asti, le grec a partout changé le t en <r* Aussi StS&crt ressemble-t-il p1 us à la deuxième personne sanscrite clddâsi qu’à la troisième dddâti, et il se confondrait avec la deuxième personne (<W5W), si cette dernière n’avait pas perdu Pi qui lui revenait de droit dans le principe. La forme (pépst est pour (pép-$-n (= sanscrit Bâr-a-tï), comme l’impératif t (Ou pour t/0sti , SiSot pour SlSàdi (§ 451); nous avons de même en prâcrit b'anaï ttdi-cit», à côté de Banadi1. Dans les formes secondaires, la dentale finale devait tomber, en vertu d’une loi phonique de la langue grecque : la même loi existe en prâcrit2, en gothique (§ 86, 2b) et en slave (§ 92®) : aussi e%oi est-il plus près du prâcrit vahê, du gothique vigai et du slave E€3W vesi que du sanscrit vdhêt, du
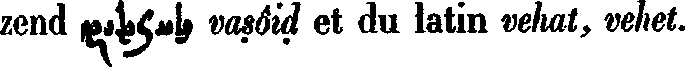
S 457. Troisième personne du singulier, en ancien slave, en lithuanien et en gothique.
Tandis que la dentale finale des formes secondaires n’a résisté à l’action du temps qu’en sanscrit, en zend et en latin, la désinence pleine tî des formes primaires n’a presque partout perdu que IV; la dentale subsiste encore à l’heure qu’il est en allemand et en russe. L’ancien slave a même conservé quelque chose de IV, sous la forme d’un i* ï (S 92b). On peut comparer :
1 A la deuxième personne de l’impératif, le prâcrit fait Banaï «parle» (Urvasî, éd. Lenz, p. 67 ), pour b'anahi, venant de banadi. Cette forme coïncide très-bien avec les formes grecques comme tide(r)t, ê(So(ô)t.
2 En prâcrit, toutes les consonnes, excepté i’anousvâra (S 9), doivent tomber à la fin d’un mot.
u
m.
Ancien slave.
t€CTh jes-tï rrestr, raCTL jas-îï135 crédit* E'fcCTb vês-tï ffsoit* AdCTL das-tï rrdat* K€3€TL ves-e-lï « vehi
Sanscrit.
^rftrî as-ti
ât-ti
vet-îi
4^Tffî dâdâ-ti * «tçffl vâh-a-ti.
è
En lithuanien, la conjugaison ordinaire a perdu ia marque de la troisième personne dans les trois nombres. On a, par exemple, wêz-a- en regard du slave ves-c-tï et du sanscrit vah-a-ti; de même au duel et au pluriel. 11 n’y a que les verbes qui ont sauvé, à la première personne, la désinence mi (§ 435), qui aient conservé en partie, à la troisième, la désinence pleine ti ou le t; cette désinence se joint immédiatement a ia racine. Exemples : êsti «il est», düsti ou dust2 «il donne», est «il mange» (en parlant des animaux), gest «il chante», dest «il place», mégt «il dort», sâugt «il conserve», gelbt «il aide», sêrgt «il surveille», lékt «il laisse». Cette désinence du singulier sert aussi pour le duel et le pluriel.
En gothique, à l’exception de üt « il est », ou l’ancienne ténue s’est conservée sous la protection de la lettre s qui précédé, le t, dans les formes primaires, s’est partout changé en th. Mais ce th ne doit pas s’expliquer par la loi de substitution des consonnes; il est le remplaçant euphonique d’un d, comme à la deuxième personne du pluriel; en effet, le gothique préfère, pour la fin des mots, un th au d (S pi, 3 et 4). Le d s’est, au contraire, maintenu dans la désinence da du moyen et du passif3. De ce d est sorti le t du vieux haut-allemand, par une substitution qui a ramené la dentale à sa forme primitive.
S 458. Désinence de la troisième personne du pluriel, en sanscriL
et en grec.
Comme signe de la pluralité, un n est inséré devant la désinence ti ou t. Nous avons rapproché plus haut (§ â36) ce n de celui de l’accusatif pluriel. Après le n, la moyenne (§ 457) s’est maintenue en gothique, nd étant un groupe que cette langue affectionne : comparez sind «ils sont» avec sdnti, hënti, sunt et (a^evvL Le sanscrit observe pour ce n le même principe que pour le m de la première personne des formes secondaires (§ 437, remarque), c’est-à-dire qu’il insère un a devant n, partout où celui-ci n’est pas déjà précédé d’un a ou dun a. Nous avons bien, par exemple, sans aucune insertion de voyelle euphonique, Bdr-a-nti «ils portent», tisia-nti «ils sont debout», Bâ-nti «ils brillent»1, parce qu’ici nti est précédé soit d’un a représentant le caractère de la classe, soit d’un a ou â radical; mais ci «assembler» fait ci-nv—dnti, et non ri-nu-ntl; i «aller» fait y~dnti, et non î-nti2.
Ainsi s’explique la désinence grecque ô<7<, venant de avrt, dans SsiHvv-àat, ï-ixai, T*0e-ocri, SiS6-ôuti- en effet, il serait difficile d’admettre qu’une rencontre si frappante fût fortuite. Quoiqu’aucun dialecte ne nous ait conservé les formes Tiôéavrt, StSêavTt, tavTt, SetxvvavTt, Ta long de nOéàai, etc. prouve bien
1 Comparez, en grec, Çép-o-vu, fola-vu, <pa-vn.
* Les grammairiens indiens posent partout anti comme étant la désinence des formes primaires, et an comme étant celle des formes secondaires. Ils sont, par conséquent, obligés d'admettre que devant Tu de cette désinence on rejette, dans la première conjugaison principale, l'a qui représente la caractéristique de la classe : ainsi Uàranti est, selon eux, pour Uardnti, venant de Uar-a-anti. Mais les langues congénères ne justifient pas cette explication, car si l’on admet que i’o de <pép-o-vu est identique avec celui de (pép-o-pss, et que l’a du gothique bair-a-nd est identique avec celui de bair-a-m, il faut sans doute voir aussi dans l’a du sanscrit Uàranti une lettre de même origine que l’d long de Uàr-â-mas et Va bref de bàr-n-fa. ( Comparez S ^87, remarque.) qu’un v a été supprimé, comme dans ïaTâtm et rervipâtri; quant h la désinence o-z, elle est, comme partout à la troisième personne, pour ti. C’est Seixvvâcrt et tâurt, parmi les exemples cités, qui sont les plus conformes au type primitif; au contraire, dans TiOêâeri et SiSoôuri, il n’y avait pas la même raison pour insérer un a euphonique, car Y s de tiQéâm et l’o de SiS6â<rt tiennent la place d’un â ou d’un a sanscrit1 ; le dorien nous a conservé les formes plus anciennes rtOévTt, SiSévrt (comparez ëvri = lïfsfî sânti «ils sont»), G’est l’analogie de Sstxvvâtri. ïœcri qui aura entraîné tlOéôuri, StSâôurt, dont la vovelle radicale a été traitée comme si elle n’était pas sortie d’un ancien a. Il en est de même pour les formes ioniennes ialêôûji, souri.
% 459. Allégement de la désinence nti, nie, en sanscrit et en grec.
Les verbes sanscrits de la troisième classe (§ 109% 3) sont portés à alléger le poids des désinences, à cause de la surcharge qui, dans les temps spéciaux, est produite par le redoublement. Ils sacrifient donc le n de la troisième personne du pluriel, et quand ils ont un â long à la fin de la racine, ils l’abrègent; exemples : ddda-ti «ils donnent», dddh-ti «ils pla
cent», gdha-ti «ils abandonnent». Mais il n’est pas douteux qu a une époque plus ancienne ces verbes n’aient fait da-da-nti, dadh-nti, gaha-nti; les formes doriennes SiSo-vti , tiÔê-int ont mieux conservé, à cet égard, le type primitif. Le zend également a maintenu la nasale dans les verbes redoublés, car nous avons, dans le Vendidad-Sâdé2, dadëntê «ils
1 est pour le sanscrit dàdiïmi et Stêoopi pour dàddmi. Les deux verbes sanscrits ont dû faire primitivement, à la troisième personne du pluriel, dada-nti, da-dâ-nti, ou, en abrégeant Ta, dada-nti, dada-nti.
2 Manuscrit lithographié, p. si3. Mais le zend connaît aussi la suppression de la
nasale : c’est ce que démontre la forme éenhaiti «ils enseignent» = sanscrit
éâsati, de la racine sas. Cette racine suit l’analogie des verbes redoublés, probablement à cause des deux sifflantes. En zend, la nasale insérée devant le h
donnent» (?), ce qui est peut-être une leçon fautive pour dadënti. Mais si la leçon’ est correcte, le moyen dadëntê n’en témoigne pas moins de l’existence d’un transitif dadënti Au contraire, le sanscrit supprime au moyen la nasale du pluriel, non-seulement dans les verbes redoublés, mais dans toute la seconde conjugaison principale (celle qui répond à la conjugaison grecque en mi) : la cause de cette suppression est le poids plus considérable des désinences du moyen. On a, par exemple, en regard du transitif ci-nv-ânti, le moyen ci-nv-âtê (pour ci-nv-antê). C’est encore là une altération du système primitif, car le grec conserve au moyen et au passif, avec plus de ténacité encore qu’à l’actif, la nasale exprimant le pluriel; non-seulement nous avons (pép-o-vTai en regard du sanscrit Bâr-a-ntê, mais encore SiSq-vtoii, TtOe-vrou en regard de dâdatê, dddatê.
Cependant, le grec a allégé d’une autre manière le poids trop grand des désinences du moyen : là où nous devrions nous attendre à avoir avrai, il met simplement vrctt. En regard de Setxvu-âart (venant de Setxvu-avri), nous avons Sewvu-vrou, et non Ssixvj-oivTou. Le sanscrit str-m-âtê et le grec c/lop-vu-vrat se complètent ainsi l’un l’autre, car l’un a sauvé Va et l’autre la nasale. La suppression de l’a dans criqo-vu-(ol)vt<xt ressemble à celle de l’j? à l’optatif, où nous avons $t$ot{itjvy et non, ce qui eût été trop pesant, StSoirliwv. Au contraire, le dialecte ionien, à la troisième personne du pluriel, a sacrifié le v et sauvé l’a : il s’accorde parfaitement, à cet égard, avec le sanscrit, quoique l’un et l’autre idiome aient opéré cet allégement d’une façon indépendante ; on peut comparer l’ionien <r1op-vv-a(v)7cu au sanscrit slr-nv-a,(n)tê. Il n’est donc pas nécessaire d’admettre que l’a de zrmavarai soit la vocalisation du v de /urénavvrat ; ménau-viai et a pu contribuer à la suppression du n de nti. Au sujet de ç e, tenant la piaœ d'un â ou d'un n, voyez S 3i. Sur la racine en question, comparez Brockhaus, Glossaire du Vendidad-Sâdé, p. 398.
'ssenav-oLTou sont lun et lautre des formes mutilées pour le primitif 'tàe'imv-ctv'Tcu.
S 46o, i. La désinence de la troisième personne du pluriel
en ancien slave.
A la désinence sanscrite anh correspondent, en ancien slave, ati. antï ou ati. uhtï : dhtï se trouve seulement avec les verbes qui s’adjoignent immédiatement les flexions personnelles (excepté le verbe substantif); nous avons, par exemple, e^aati. vêd-ahü kils savent» = sanscrit vid-ânti, maatl jad-ahtï «ils mangent» = sanscrit acL~ânti, a^AATL dad-ahtï1 «ils donnent» — sanscrit dâd-ati, venant de dad-anti, qui lui-même est pour dadâ~nti. L’a renfermé dans ati. anü est simplement une voyelle de liaison ; on devrait donc, à la rigueur, diviser ainsi : vêd-a-htï, jad-a-iiiï, dad-a-hü. Le verbe substantif fait catl suhtï (pour cs-u-ntï), avec u comme voyelle de liaison 2.
Au contraire, Yu de la conjugaison ordinaire représente la caractéristique de la classe : ainsi Yu de BC3ATi. ves-u-ntï répond à l’a du sanscrit vàh-a-nti et du gothique vig-a-nd, à Yu du latin veh-u-nt et à Yo du grec
S 46o, 9. La troisième personne du pluriel en arménien.
De la désinence nti, en arménien, il ne s’est conservé que lû# • tzjrptâi bernwi «ils portent» (pour le sanscrit Mr-a-nti, le zend bar-ë-nti) se trouve domTsur la même ligne que les formes allemandes trag-e-n «portent», bind-e-n «lient»3. De même, à
1 Je divise dad-antï, et non dada-nUparce que le slave, au présent, traite dad comme étant la racine et ne sent plus que Ad da est une syllabe réduplicative.
2 Comparez, en latin, «-«-ut (pour cs-u-nî) = sanscrit (a)s-a-nii. On a, de plus, en latin s-u-mus (pour es-u-mm) en regard du sanscrit s-mas (pour as-mas).
3 Comparez, en géorgien, les troisièmes personnes du pluriel comme »-gam~e-n «ils mangent» == sanscrit gâm-a-tUë Le laze, dont la grammaire a été étudiée d'abord par O. ïîosen, a conservé Va (devenu e en géorgien) : nous avons, dans
la troisième personne du singulier, l’arménien a perdu, dans les formes spéciales, la désinence ti; en compensation, il allonge un e ou un a précédent. On a, par exemple, ber-ê «il porte5?, mujj tai (prononcez ta136} «il donne», gai (prononcez gâ) «il va ». .
H 461. Désinence de la troisième personne du pluriel, dans les formes secondaires, en sanscrit, en grec, en zend et en gothique.
Dans les formes secondaires, la désinence plurielle nti ou anti a perdu sa voyelle finale, comme cela est arrivé, dans les mêmes formes, au singulier, pour les désinences ti, si, mi. En sanscrit, une fois la voyelle disparue, le caractère personnel t devait tomber aussi, par suite de cette loi, fatale à beaucoup de désinences, qui s’oppose à la présence simultanée de deux consonnes à la fin d’un mot (S 94). Le grec, qui ne souffre pas même un t seul comme lettre finale, a déjà perdu le signe personnel au singulier. Si donc ë$ep-e est moins bien conservé tpie dBar-a-t, les deux langues sont arrivées, pour le pluriel styep-Q-v = dBar-a-n, à un même degré d'altération. La concor-
ia conjugaison négative, des formes comme tor-a-n «descendant» — sanscrit târ~a-nti «transgrediunlur». A la deuxième personne du pluriel, le laze a tar-a-t pour le sanscrit târ-a-'ta. Mais le laze, comme le géorgien, emploie aussi la même forme à la première personne, ce qui empêche de reconnaître tout de suite la ressemblance avec le sanscrit. En effet, c’est sur la première personne que l’attention se dirige d’abord. Nous observons dans les langues germaniques un fait analogue à celui que nous venons de mentionner en laze. En vieux saxon et en anglo-saxon, la première et la troisième personne du pluriel sont remplacées, au présent, par la deuxième : ainsi bind-a-d, bind-a-dk ne signifient pas seulement «ligatis», mais encore « ligamus r> et «ligant». Il est vrai qu’on pourrait proposer aussi une autre explication : on pourrait considérer bindad, bindadh comme étant pour bindand, bindandh, et en faire la troisième personne du pluriel, qui se serait étendue par abus à la première et à la deuxième. Quoi qu’il en soit, il est certain que les désinences d, dh ne conviennent pas à la première personne et sont empruntées d’ailleurs. Voyez rtisn mémoire Sut les membres caucasiques de la famille indo-européenne, page h.
1 Voyez ci-dessus, t. 1M, p. 4o3, note 1.
dance est encore plus parfaite pour tfa-av = sanscrit âs-an « ils étaient », et pour les aoristes comme ëSst^av — sanscrit àdiksan «ils montrèrent». La sifflante paraît avoir empêché Y a de s'altérer en o, car d'après les lois ordinaires de la langue, nous devrions nous attendre à avoir tfcrov, comme ëtpspov, ou bien ijo-ev comme (pépotev. C’est aussi un ë que nous trouvons en zend, dans les formes comme anhën «ils étaient?*, barayën
«qu’ils portent» *=(pépoiev. On voit par cet exemple que le zend ne supporte pas non plus le groupe ni à la fin des mots, quoiqu’il ne proscrive pas absolument la présence simultanée de deux consonnes finales3.
Nous avons vu (§ 86, 3) que le gothique a perdu toutes les dentales qui terminaient les mots dans une période antérieure. Il a bien, par exemple, à l’indicatif présent, la forme bair-a-nd, qui correspond au sanscrit hàr-a-nü et au grec (pép-o-vu ; mais au subjonctif, en regard du grec <pépotev(t), du zend barayën(t), nous ne pouvons nous attendre à trouver une forme bairaind ou bairaiand : c’est bair-ai-na que fait le gothique, soit par méta-thèse pour bairat-an, soit par l'adjonction d’un a inorganique après le n final (comparez S 149).
S 46â. Troisième personne du pluriel au parfait gothique et sanscrit. — La désinence anli ou an changée en us? en sanscrit.
Au prétérit gothique, la désinence est un; exemple : haihaitm «ils appelèrent». On peut comparer cette forme un avec le an qu’ on trouve, dans le dialecte d’Alexandrie, au lieu de avrt, aat (ëyv&xav, eïpnxav). De son côté, le sanscrit a mutilé la désinence anti, au prétérit redoublé, quoique ce temps ait droit aux formes primaires; mais le poids de la syllabe rédunlicative a 136 fait changer anti en us. Le s de cette forme est sans aucun doute raffaihlissement du t; quant à la voyelle u, il est difficile de dire si c est la vocalisation de la nasale136 ou l’affaiblissement de Y a de anti
Us tient aussi, en sanscrit, la place de an. i° Au potentiel; exemple : Bdrê-y-us137 138, en regard du zend baray-ën, du grec Çé-pot-sv. s° Au premier prétérit augmenté des racines rédupliea-tives; exemples : ddadus «ils pOS8?6îit 55 ^ puui âdadan), âdadus «ils donnèrent» (pour âdadan). Ces exemples montrent que us est plus léger que an. 3° Au premier prétérit augmenté des racines de la deuxième classe finissant en â; mais ici, us est facultatif et l’on trouve aussi â-n; exemple : dyus ou âyân «ils allèrent», de la racine yâ. h° Dans quelques formations du prétérit multiforme; exemple dsrâusus «ils entendirent».
S 463. Désinence de la troisième personne du pluriel, dans les formes secondaires, en ancien slave et en arménien. — La troisième personne du pluriel en latin.
En ancien slave, dans les formes secondaires, nous avons a ah ou fa un au lieu de la désinence sanscrite an. a ah s’emploie après un c s ou un in ê, fa un après toutes les autres consonnes; exemples : iuuia jasah «ils mangèrent», AdiiiA dasah «ils donnèrent», npusccA privesah «ils amenèrent» (racine ved), T€K/ï> tek-u-h « ils coururent » 139.
Le latin supporte très-bien le groupe ni à la fin d?un mot : aussi a-t-il conservé la désinence en question mieux que tous les autres idiomes de la famille. On peut comparer erant avec le sanscrit â’san, le grec titrav, le zend anhën et l’arménien
4^5# êin1.
De même qu’à l’imparfait, l’arménien a conservé dans toutes les autres formes secondaires le n de la troisième personne du pluriel.
S Ô6Ô. Troisième personne du duel.
Au duel, le sanscrit a tas dans les formes primaires et tâm dans les formes secondaires. A tas répond, en grec, tov (§ 97); exemple : (pép-s-rov = Bâr-a-tas et ils portent tous deux». Quant à la désinence tâm, elle a donné lieu, en grec, à deux formes, trtv et tgûv 2. C’est rtjv qui est la plus fréquente : wv est borné à l’impératif. On peut comparer êtpsp-é-Ttjv avec âBar-a-tâm; tyep-ol-Tnv avec Bâr-ê-tâm; êSstH-crd-Ttiv avec ddik-sa-tâm; Tuais, à l’impératif, on a (psp-é-tcjv = Bâr-a-tâm.
De ce remarquable accord avec le sanscrit il ressort que la différence entre la désinence tov, d’une part, et les désinences tî;v, toi», de l’autre, appartient à une haute antiquité, et que ce n’est pas, comme l’a supposé Buttmann3, un perfectionnement introduit par la prose moderne. Il est vrai que le texte d’Homère présente quatre fois rov au lieu de tjtv4; mais on pourrait, si l’on s’en rapportait à la langue homérique, dire aussi que l’augment est de date récente, car il est fréquemment même rôle que l’a du sanscrit àsan et l’a du grec rjffav (S Ô58), c’est-à-dire qu’il sert à l’adjonction de la désinence.
1 Ce dernier est pour é»in, lequel est lui-même pour êsim.
2 Sur la double représentation de Vâ sanscrit, en grec, voyez $ h.
3 Grammaire grecque développée, S 87, remarque 2.
4 Dans trois endroits, le mètre a pu occasionner ce changement.
supprimé dans l’épopée; cependant, l’augment appartient en commun au grec et au sanscrit.
En zend, la forme primaire est tô1, qui est la représentation régulière du tas sanscrit; dans les formes secondaires, nous devrions avoir tanni; mais je n’ai pas encore rencontré d’exemple de cette forme.
En gothique, la troisième personne du duel s’est perdue. L’ancien slave présente Td ta, pour les formes primaires comme pour les formes secondaires. Ainsi K€3€Td veseta ttils transportent tous deux» répond au sanscrit 4 g 3^ vàlmtas, et K€30CTd vesosta «ils transportèrent tous deux» à dvâktâm (par eupho
nie pour avâkitâm, § 543).
Au sujet de l’origine des lettres s et m qui terminent les désinences TO tas et «TT^ tâm, je me contente de renvoyer à ce qui a été dit pour les désinences^f^tas et c&j^tam de la deuxième personne (S 444).
S 465. Tableau comparatif de la troisième personne.
Nous faisons suivre le tableau comparatif de la troisième personne dans les trois nombres :
|
SINGULIER. | |||||
|
Sanscrit. |
Zetuî. |
Grec. |
Latin. |
Gothique. Lithuanien. |
Ancien slave. |
|
àsti* |
asti |
è</H |
est |
ist esti |
jestï |
|
lülati |
histaiti |
ï</lœvt |
stat |
V.h.-a. stât stôw |
stajetï |
|
dâdâtP |
dadàiti |
dat |
.......âiïsti |
dastï | |
|
âtti |
. est |
itith est |
jastï |
1 Un exemple de cette l’orme se trouve dans le Yaçna (Yendidad-Sâdé, p. 48) : staumi maigëmca vârêmca yâ te këhrpëm vaKsaijato barêsnus paiti gairmmm «je célébré le nuage et la ploie, qui font grandir ton corps sur les hauteurs des montagnes». Vàftsayatô est, comme l’a reconnu Burnouf, le causatif de la racine sanscrite vaks «grandir». En sanscrit, nous aurions vakéâyatas.
56 En arménien, £é,
3 En arménien, utuy toi (prononcez td, % 46o, a ).
|
Sanscrit. |
Zenù. |
Grec. |
Latin. |
Gothique. |
Lithuanien. Ancien slave. |
|
hârati1 |
baraiti |
<pépe(r)t* |
fert3 |
bairith | |
|
vâkati 9 |
vasaiti » |
éKe(T)‘ |
vehit |
vigith |
weza vesetï • |
|
(ajsyât4 |
siet |
sijat | |||
|
J | |||||
|
tütêt |
histoid 9 |
stet |
***■•* 99 stty | ||
|
dadydt |
daidyâd |
àihohj |
det |
• | |
|
Mrêt |
baroid |
pot |
ferat |
bairai | |
|
âvahat |
avasad • * |
sïvs |
vekebat |
DUEL.
|
(a)stas tistatas bârêtâm Bâratâm |
été P5 histato |
è&'lôv ïtflarov (pspofotjv Çepérœv | |||
|
HiCniEt. |
• | ||||
|
sânli6 |
hënti |
(a)svré |
sunt |
sind 7 |
......süntï |
|
tütanti |
histënti |
talàin’i |
stant |
v.b.-a.stant . | |
|
dàdati8 |
dadënti9 |
h&ÔVTl |
dant | ||
|
Mranti10 |
barënti |
(dépovTt |
ferunt |
bairand . |
......berüntï |
|
vdkanti * |
vasënti « |
êxpvTi |
vekunt |
vtgand . |
9 |
|
tûtêyus11 |
histayën |
lalaïev |
stent | ||
|
It ï A bareyus |
barayën |
(pépotsv |
ferant | ||
|
jî f 12 asan âbaran |
anhën abarën |
rjerctv épepov |
erant |
bairaina . |
1 En arménien, berê.
2 Voyez S 456.
3 Avec adjonction immédiate de la désinence, comme dans le sanscrit bibartt ( troisième classe).
4 En arménien, izê (S i83**, a).
* Voyez S 464.
6 En arménien, tâi en.
7 Gomme au singulier (S 467).
8 Voyez S 459.
® Voyez S 459.
10 En arménien, ber en.
11 Voyez S 46a.
12 En arménien, êîn.
DÉSINENCES DÜ MOYEN* 3 466. Voyelles finales des désinences moyennes.
Au moyen, en regard du grec ai, nous trouvons la diph-thongue ê en sanscrit et en zend. C’est là un de ces cas peu nombreux où le grec représente par ai ¥ê (== a + t) des deux langues de l’Asie : on a vu, en effet (S 9, remarque), que le premier élément de cette diphthongue devient ordinairement en grec un s ou un 0.
Le gothique a perdu IV de la diphthongue ai : à la troisième personne, au lieu de dai (= grec rai, sanscrit tê), il fait da; à la deuxième personne, il présente la désinence sa (par euphonie
pour sa, § 86, 5), venant de sai; à la troisième personne du pluriel, il a nda au lieu de ndai. La première personne du singulier et la première et la deuxième personne du pluriel ont péri; elles sont remplacées par la troisième. Un fait analogue a lieu en allemand moderne, où la forme sind, qui convient seulement a la troisième personne du pluriel, a pénétré par abus dans la première. On ne savait autrefois comment expliquer l'a qui précède la désinence personnelle, par exemple dans hait-a-sa «vocaris», hait-a-da «vocatur», et en regard duquel on trouvait un i dans haitis ctvocas», hailith «vocat». Cette énigme est, je crois, résolue, si l’on considère que tous les verbes gothiques à forme forte correspondent aux verbes sanscrits de la première et de la quatrième classe (S 109% 1); IV de haitis, hattith est 1 affaiblissement d’un ancien a, causé par l’influence dun s ou d’un th final (S 67). Au médio-passif, il n’y avait point la même raison de modifier la voyelle caractéristique.
S 46y. Première personne du singulier moyen, en sanscrit et en zend.
A la première personne du singulier, dans les formes pri-
maires comme dans les formes secondaires, le sanscrit et le zend ont perdu la consonne pronominale (m). Avec elle a disparu aussi, dans la première conjugaison principale, la caractéristique de la classe (a)1. Au lieu de bôd-â-mê, nous avons donc botté «je sais».
|
On ppnf |
comparer : | ||
|
Sanscrit. |
Zend. |
Grec. |
Gothique. |
|
ir f A bar-e |
&)**) bair-ê140 yjyalaj bar-a-hê yyjataj bar-ai-tê |
<pép~o~fiai | |
|
t A bar-a-se |
(<pép-s~(Tcti) Ç>épYf |
bair-a-sa « | |
|
bâr-a-tè |
<pép-£-rat |
bair-a-da | |
|
b'âr-a-ntê |
(fiép-O-VTOU |
bair-a-nda. |
S 468. Voyelles finales du moyen, en gothique.
Nous avons vu (§ 466) qu’en gothique la diphthongue finale ê (= a + i) s’affaiblit en a. Le même fait a lieu en sanscrit et en zend, mais seulement dans les formes secondaires. En grec, au lieu d’un a nous trouvons un o. On peut comparer êtpép-e-vo avec le sanscrit dfiar-a-ta, le zend abar-a-ta; et,
ail pluriel, ktyép-o-vTo avec Mar-a-nta, abar-
a-nta. On voit que les formes sanscrites et zendes ressemblent d’une manière frappante aux formes gothiques précitées bair-a-(la, bair-a-nda. Mais il n’en faudrait pas conclure, comme je l’ai fait autrefois 1, que les formes primaires du gothique doivent être rapportées aux formes secondaires du sanscrit, que, par exemple, bair-a-da, bair-a-nda correspondent à diïar-a-ta, <War-a-nia, et non à Bdr-a-tè, bdr-a-niê.
Au subjonctif gothique, nous trouvons la désinence au, dont il est difficile de rendre compte. En regard du sanscrit Bâr-ê-ta, du zend bar-ai-ta, du grec (pép-oi-ro, nous avons bair-ai-dau; au pluriel, en regard de (pép-oi-vTo144 145, nous avons balr-ai-ndau; à la deuxième personne du singulier, en regard de cp$p-ot-{ajo, nous trouvons bair-ai-sau. Il n’est pas probable que cette diph-thongue au doive s’expliquer par l’addition inorganique d’un u, car les idiomes, avec le temps, abrègent leurs formes grammaticales plutôt qu’ils ne les élargissent. Je crois donc que cette désinence au provient de l’impératif, où elle avait sa place légitime (§ 4â6), et que les formes d’impératif comme bair-a-dau «ferto», bair-a-ndau «feruntow 146 ont donné par analogie au subjonctif ses formes bair-ai-dau, bair-ai-ndau; une fois introduit au subjonctif, au a pénétré aussi à la seconde personne du singulier bair-ai-sau (au lieu de bair-ai-sa). Ce dernier fait ne doit pas surprendre dans le médio-passif gothique, si Ton songe qu’il avait préparé les voies à la confusion, en remplaçant par
tout la première et la deuxième perso
sonne du pluriel, ainsi que
la première personne du singulier, par la troisième.
§ 469. Deuxième personne du singulier moyen, dans les formes secondaires, en sanscrit, en zend et en grec.
Dans les formes secondaires, la deuxième personne du singulier, en sanscrit, ne suit pas l’analogie de la troisième et de la première personne. Puisque la troisième personne, dans les formes secondaires du moyen, oppose U aa tê des formes primaires et au t de l’actif transitif, nous devrions nous attendre à trouver sa opposé à sê et à s, Mais au lieu de la désinence sa} nous avons tas; exemples : âbôi-a-tâs «tu sus», bô'd'-ê-tâs «que tu saches». Mais à côté de tâs il a dû exister primitivement une forme sa : c’est ce que prouve non-seulement le grec, où nous avons iSiSo-cro, Stâoi-o-o, qui correspondent très-bien à êStSo-ro, <S/<5oi-to, mais encore le zend, où l’on trouve «gy }ia et sa dans des positions où le sanscrit devrait nous présenter sa. Le 4P h zend est le représentant régulier d’un ^ s sanscrit (§ 53); quant à sa, on le trouve après les voyelles qui, en sanscrit, exigent le changement de s en s (§ 21 h)r Devant la désinence ha vient s’insérer un w (S 56a) : ainsi s’explique la forme passive usasayanha, «tu fus engendré»147, que j’ai déjà discutée
dans mon premier essai sur le zend1. Je n’ai pu trouver depuis une seconde forme de la même sorte ; mais Burnouf2 a reconnu encore un aoriste moyen urûrtidusa « tu grandis », sur
lequel nous reviendrons plus tard. Nous nous contentons ici de constater l’existence de la désinence sa, dont le s s’explique par l’influence euphonique de Yu précédent.
§470. Explication de la désinence sanscrite tas. — La désinence grecque (irjv. — Les impératifs en tût. — Le pronom personnel est contenu deux fois dans les désinences du moyen.
Nous revenons à la désinence sanscrite tas, qui est évidemment en rapport avec la désinence ta de l’actif (§ 453). Il est vraisemblable que ce ta avait anciennement une plus grande extension au singulier; la forme iâ-s en sera dérivée, par l’allongement de la voyelle et par l’addition d’un s, lequel, comme on l’a déjà fait observer ailleurs 3, sert probablement lui-même à marquer la deuxième personne. S’il en est ainsi, nous aurions deux fois le signe personnel, une fois pour désigner l’agent et l’autre fois pour indiquer celui pour qui ou sur qui se fait l’action. Dans âdat-tâ-s «tu donnas à toi??4, tâ signifierait «tu» et s «à toi», ou vice versa. S’il en est ainsi, et si le v final du grec èStSiyivv (dorien êSiSSpav) n’est pas une addition inorganique de date récente, mais, au contraire, un élément significatif et un reste de la période primitive, il faudra aussi reconnaître dans cette forme la double expression de la première personne. En effet, èSiSàyLttv signifie proprement «mihi dedi» : je suppose que le v exprime le moi comme agissant (comme sujet), et (dorien ftâ) le moi comme souffrant (comme ré-
1 Annales de critique scientifique, i83i, p. 376. 5 Yaçna, notes, p. 33.
1 Grammatita ciitica Unguœ sanscrit/p. S 3o 1 A.
4 C’est-à-dire «lu pris».
5
m.
gime). Ce qui est certain, c’est que nous avons dans py-v ({xâ-v} une formation tout à fait analogue au sanscrit iâ-s.
Un autre exemple nous est fourni, pour la deuxième et la troisième personne, par la désinence védique cTT?T tâ-t : l’expression de la deuxième et de la troisième personne s’y trouve renfermée deux fois. A la deuxième personne, je regarde tât comme une forme mutilée pour ivâ-t, venant du thème tva, lequel a perdu sont?1. A la troisième personne, tât renferme deux fois le thème démonstratif ta (§ 456), une fois avec l’allongement de l’a et l’autre fois mutilé comme dans les formes secondaires de l’actif transitif. Je regarde, par conséquent, cette curieuse désinence tât comme ayant appartenu originairement au moyen. Pânini148 149 l’explique autrement: il en fait un équivalent des désinences tu et hi de l’impératif transitif, en ajoutant qu’on l’emploie dans les bénédictions, comme Savân gîvatât «que le seigneur vive»150. Il est vrai que la racinegîv, dans le sanscrit ordinaire, n’est pas usitée au moyen, et la même difficulté se présente peut-être pour d’autres verbes employés avec la désinence tât. Mais cette désinence peut provenir d’une époque où tous les verbes avaient encore un moyen. C’est surtout dans les bénédictions, où l’on exprime un souhait au profit de quelqu’un, que le moyen est à sa place.
Quoi qu’il en soit, la désinence tât est de la plus haute antiquité, car elle se retrouve en osque, sous la forme tte-d151 152, dans les impératifs comme licitu-d (pour liceto), estu~d (pour esto,
La désinence w de l’impératif grec (fispéTco est elle-même un ancien moyen, comme on peut le voir par la comparaison du pluriel Çep-6-vTù>v, qui s’accorde parfaitement avec le moyen sanscrit Bâr-a-ntâm L Je ne crois pas qu’on puisse identifier <pep-6-vio)v avec le transitif Bâr-a-ntu : ce serait la seule fois, dans toute la grammaire grecque, qu’un u sanscrit serait représenté par <y, sans compter qu’il faudrait supposer l’addition dune nasale inorganique. On pourrait plutôt, en rapprochant Çispérco du moyen Bâr-a-tâm, admettre qu’une nasale s’est perdue, comme dans ëSzifyx — ^ddikêam. Mais je préfère aujourd’hui identifier (pepércj avec le védique Bâratât, car la suppression du r était obligée, au lieu que celle de la nasale serait fortuite et arbitraire. Entre (pep-é-Tv et Bâr-a-tât le rapport est le même qu’entre èS/Sa et âdadât, entre ëSa et diât.
En latin, la désinence védique tât est représentée par la désinence tô, que nous trouvons à la deuxième et à la troisième personne du temps appelé vulgairement impératif futur2; ainsi vwito (venant de guivito) «qu’il vive» répond à gîv-a-tât
(même sens); à la deuxième personne, vivito correspond, quant a sa désinence, au védique pra-yacc-a~tât «donne»3. La suppression du t final n’était pas obligée en latin ; mais ce qui prouve que le latin supprime quelquefois une dentale finale, c’est l’exemple des ablatifs eno (plus anciennement o-d= sanscrit â-t, zend d-d). À la troisième personne du pluriel, les formes latines en nto peuvent nous faire supposer des formes védiques en niât : veh-u-nto, par exemple, aurait pour pendant
Kuhn avait déjà attribué une origine passive aux formes osques en question, dans son écrit intitulé Conjugatio in fu, linguæ samcritœ ratione habita, p. s6, note.
1 Le rapport entre ces deux formes est exactement le même qu’entre le duel tfrec Ç>£p-é-Tù)v et le duel sanscrit b'âr-a-tàm.
2 Les formes amato, amalote, arnmto sont attribuées, dans la Grammaire latine de Zumpt, à l’impératif futur. — Tr.
3 Rig-véda, mandata I, hymne xlviu , vers f>.
une forme vah-a-ntât. Dans cette hypothèse, on pourrai!, rapporter au même modèle les formes grecques comme êx~6-vTù)v, dont le v final s’expliquerait comme un v ephelkysticon, devenu à la. longue partie intégrante de la désinence.
S 471. Première personne du singulier moyen, dans les formes
secondaires, en sanscrit.
En sanscrit, la troisième personne du singulier, dans les formes secondaires, étant terminée en ta, la première personne, d’après le même principe, devrait faire ma; en regard du grec Çepofanv (dorien (pspotyûiv), nous devrions donc avoir Mrêma. II faut, en effet, que cette forme, qui cependant n’est pas la plus ancienne, ait existé pendant un certain temps en sanscrit. Mais dans la langue telle quelle nous est parvenue, le ni est tombé, comme il est tombé partout au singulier du moyen : au lieu de Bârê(m)a, nous avons Bârê-y-a, avec le même y euphonique que nous trouvons inséré, à l’actif et au moyen du potentiel, devant toutes les désinences personnelles commençant par une voyelle (§ 43). Dans les formes chargées de l’augment, cette désinence déjà très-mutilée a se change, par un nouvel affaiblissement, en i; exemple : âstr-nv-i «sternebam» pour astr-nv-a, qui lui-même est pour asîr-uu^tna. Une forme plus ancienne encore serait astr-nu-mâm, qui correspondrait au dorien eV7op-vv-fiâv.
S 479. Diphthongue finale ê des désinences du pluriel et du duel,
en sanscrit et en zend.
Nous retournons aux formes primaires, pour faire remarquer une différence entre les désinences sanscrites en ê et les désinences grecques en a<. En sanscrit, ce ne sont pas seulement les personnes terminées par i à l’actif transitif qui prennent ê au moyen; toutes les personnes, sans exception, ont cette
diphthongue finale ê, comme on peut le voir par le tableau suivant : '
|
SISGULiËit. |
DUEL. |
l’LUJUEL. |
|
(m)ê = fiai |
vahê » |
tnaliê = ps$x |
|
sê — aat |
A* A ate |
dvê |
|
tê = rat |
A* A ate |
ntê ou ate— vrai, areu (S 459). |
Le zend, autant qu’on en peut juger par les formes qui nous restent, suit l’analogie du sanscrit; ajoutons seulement ici que la première personne du pluriel est maide ou, sans aspiration, maidê, ce qui prouve que le sanscrit ma/iê vient d’une ancienne forme mactê (S 9 3). Le grec (ie6a a également conservé la dentale aspirée; mais il a perdu son i final, ce qui le fait ressembler aux formes précitées (S 466) du gothique.
Dans les formes secondaires, le sanscrit mahê perd le premier élément de la diphthongue ê, ce qui donne mahi. Au contraire, la première personne plurielle de l’impératif, qui recherche les désinences les plus pleines, fait mahâi. De même, au duel, à côté de vakê, nous avons les désinences vahi et vahâL Le zend, même dans les formes secondaires, conserve la désinence pleine maùB; du moins trouvons-nous au potentiel Mt-
dyôimaicFê «que nous voyions» 153.
S 478. Explication des désinences moyennes qui ont la diphthongue finale ai en grec.
De ce que toutes les formes primaires du moyen se terminent, en sanscrit, par ê, je* ne veux pas conclure que tous ces ê proviennent de la même origine. Examinons d’abord les personnes auxquelles correspond, à l’actif transitif, un i, et, au moyen grec, un a*. Je suis très-porté à croire que ces désinences
ont perdu une consonne entre les deux éléments de la diph— thongue l, à savoir un m à la première, un s à la deuxième, un t à la troisième personne. Ainsi (m)ê, pat sera pour mami; sê, aou pour sasi; tê, rat pour tati Rappelons que nous avons vu plus haut (S 456) (fiépet venir de Çspsrt, le prâcrit tiandi sortir de Banadi et l’espagnol cantais de cantatis; de même, en grec, le moyen riitfsaat est devenu, par une nouvelle contraction, tiW»?, et, en sanscrit, mê s’est mutilé en ê. Dans ce ê, l’ex
pression de la première personne est donc contenue deux fois : a est pour ma et î est pour mu De même encore, à la troisième personne du parfait redoublé, la désinence en sanscrit est ê, au lieu qu’en grec nous avons gardé rat (pour tati). Le dialecte védique, poussant encore plus loin la mutilation de certaines formes, nous fournit un présent sdy-ê2 «il est couché», au lieu de la forme ordinaire s&-tê3 = xstrat. Il y a encore, dans les Védas, d’autres exemples de mutilation des désinences du moyen : ainsi âduhra «mulserunt» pour dduh-rata, duh-am «mulgeat» pour dug-dain, qui lui-même est pour duh-tâm4.
Si donc, comme il est très-vraisemblable, nous devons ramener les désinences sanscrites (m)ê, sê, tê et les désinences grecques pat, arai, rat à d’anciennes formes mami, sasi, tati, ou peut-être mâmi, sâsi, tati5, quel est, des deux pronoms, celui qui est sujet et celui qui est régime ? Faut-il traduire le sanscrit dat~sa(s)i, le grecStSo(ra(o)i par «dans tibi tu» ou par «dans tu tibi»? En adoptant la première hypothèse, nous aurons les deux idées rangées selon le même ordre que dans les formes StSo<r8s, SiSo&Oov, etc. qui seront analysées plus loin (S &*]&). Mais alors
1 C’est aussi l’opinion de Kuhn. Ouvrage cité, p. s5 et suiv.
3 Par euphonie pour sê-é.
3 L’accentuation, dans ce mot, est irrégulière : on devrait avoir éèté'. Voyez Système comparatif d’accentuation, p. toi.
4 Pânini, AUI, i, k\. .
6 Comparez la longue dans tas, tâ-t, ftâ-v (S ^70).
nous devrons constater un fait assez singulier : comme la seconde consonne est tombée, la première, qui dans le principe appartenait au pronom régime, a été instinctivement rapportée au pronom sujet, car il est plus facile, dans une forme comme StSo-de sous-entendre «mihi» que «ego»; d’ailleurs, l’analogie, peut-être trompeuse, de SiSa^fu fait qu involontairement on croit reconnaître le même (i dans $t'So-(ica. On n’aurait pas le droit d’invoquer ce sentiment irréfléchi pour dire qu’en effet le (jl appartient au sujet; l’histoire des idiomes prouve par de nombreux exemples que l’instinct populaire n’est pas infaillible. Je citerai ici un cas qui se rapproche beaucoup du nôtre. Dans les formes redoublées, la seconde syllabe est sujette à être mutilée et à perdre sa consonne initiale : il arrive alors que la première syllabe semble être la syllabe radicale. L’Allemand qui prononce aujourd’hui les mots ich hielt «je tins», croit que le h initial de ce prétérit est bien le même que celui du présent ich halte «je tiens»; mais, comme l’a reconnu d’abord J. Grimm1, la syllabe ht de hielt doit au redoublement sa présence au commencement du mot. En vieux haut-allemand, nous avons hialt, pour hi(Ii)alt, et en gothique haihald; le second A, qui est le h radical, a disparu des dialectes modernes. De même, dans le sanscrit têpimâ2 «nous brûlâmes», le t appartient, selon moi, au redoublement : la forme complète serait tatapima, d’où sont venus taapima, tâpima, têpimâ. De même encore, dans le slave damï «je donne» et dans le lithuanien dümi (même sens), la première syllabe est réduplicative et la syllabe radicale a entièrement disparu. Nous reviendrons plus tard sur ces faits. 154 155
S k'jh. Explication des désinences moyennes qui n’ont point la diphthongue finale ai en grec.
Nous passons maintenant aux personnes du moyen qui ont la diphthongue ê en sanscrit, sans avoir ou en grec. Dans le pluriel dvê, désinence de la deuxième personne, je crois reconnaître un nominatif pronominal (§ 228*); de même que le thème ta fait au nominatif pluriel ta-i, je regarde dvê comme étant pour dva-i, et je vois dans le thème dva une altération pour Iva. Les désinences duelles âtê, âtê me paraissent être des duels neutres, analogues à tê «hæc duo». Le Tap^dbam des formes secondaires se termine comme les pronoms yû-y-dm s vous», vay-dm «nous». Les désinences duelles âtâm, âtâm sont à dvam, en ce qui concerne leurs lettres finales, ce que âu (venant de as) est a asl, et elles ont leurs analogues dans les pronoms âvâm «nous deux», yuvâm «vous deux» (§ 336).
Dans leur partie initiale, â-tê, âtê, WHTTH âtâm, âtâm me paraissent être des formes mutilées pour tâiê, tâtê, tâtâm, tâtâm2 : c'est ainsi que nous avons vu plus haut (§ 673), dans le dialecte védique, à la troisième personne du singulier de l’impératif, âm au lieu de tâm. Aux syllabes (f)<L (t)â, qui marquent le pronom régime, répond le g des formes grecques S&q-g-Qov, SiSq-g-Oov, êStSo-G-6ov, êSiSô-G-Owv : le g tient ici la place d’un t (§ 99); quant au 6 suivant, il provient également d’un t, le 6 aimant à se combiner en grec avec une aspirée précédente ou avec un cr. Si l’on place StSo-G-Bov en regard du sanscrit dad’fyâ-tê, on voit que chacune de ces deux formes a conservé de la forme primitive la partie qui manque a l’autre : le grec a gardé la consonne (<r), le sanscrit la voyelle («) du pronom régime. A la deuxième personne du pluriel, le sans-
1 Voyoz$2o6.
2 Voy<>z Kuhn, ouvrage rili;,p. 3i.
«
crit a perdu à la fois l’un et l’autre élément de ce pronom ; mais je crois qu’avant les formes comme Mr-a-dvê, dBar-a-dvam, le sanscrit a dû avoir des formes Bar-a-d-dbê, aEar-a-d-dvam = Ç>ép-e-<j-8e, ê(pép-e-v-6e. En effet, une dentale est volontiers supprimée devant tv ou do : ainsi, au gérondif, au lieu de dat-tva « ayant donné», Bit-tocU ayant fendu», on trouve plus ordinairement da-tvâ, Bi-tod; à la seconde formation de l’aoriste, la deuxième personne du moyen fait tantôt -id-dbam (venant de is-imm), tantôt -i-dvam; enfin, à la deuxième personne du singulier de l’impératif, devant la désinence di, un s radical se change en d, mais ce d peut être supprimé. La racine sas «commander» fait, par exemple, sâd-di et sa-di; la racine as «être» fait ê-dî au lieu de ad-di qui IuLmeme est pour as—di. Le même rapport qui existe entre ê-di et le grec Ïcr-Qi se retrouve entre Bâradvê (pour Baraddvê) et (pépsaBz; il y a seulement cette différence que, dans (pépsaBs, le 6 grec ne représente pas, comme dans un d sanscrit2, mais qu’il provient dun t qui s est aspiré par le contact du cr précédent. Quant à l’impératif (psps-<T0<y, qui est composé de la même manière, je crois qu’il est une formation d’un âge plus récent; (pspdrcj, quoique originairement un moyen (§ 470), ayant été employé dans le sens transitif, la langue créa un médio-passif d’après l’analogie de (pépsa-Bs, <ps-peaBov, (pepéaBœv.
g 476. Autre explication des désinences moyennes.
Cherchons maintenant à résumer ce qui vient d être expose sur l’origine des désinences du moyen. Nous avons dit qu’elles renfermaient deux fois le pronom personnel. En effet, le grec ê(ps-pépvv, le sanscrit aBaratâs et le védique Bâratât contiennent visiblement deux fois la même expression pronominale. U était
1 Je suppose que la forme ê-iia été précédée de d-dV, dont l’a se sera affaibli en e.
1 Voyez S îfi.
d’ailleurs naturel que le langage, ayant à représenter des idées telles que «je me donne, je me réjouis», prêtât également une expression à l’idée du moi sujet et à celle du moi régime, et qu’il empruntât cette double expression à un seul et même thème pronominal.
Au demeurant, si nous laissons de côté ê<pep6p.rjv, nous pouvons proposer encore une autre explication pour les formes grecques comme (pépscrOs et les formes sanscrites comme ïïdralvê. Au lieu de regarder le a de <péps<x9s comme le remplaçant d’un ancien t, on peut supposer qu’il est un reste du thème sva; on a vu (S 341) que sva, quoique étant le pronom réfléchi de la troisième personne, est employé aussi pour la première et pour la deuxième. En sanscrit, devant les désinences ivê et dbam, un s doit nécessairement tomber ou doit se changer en d : nous arrivons donc de la sorte aux formes fidra(d)dvê, dBara(d)iïvam (§ 474). Quant au duel MrêU, il ne faudrait plus, comme nous l’avons fait plus haut, le rapporter à un primitif Varatâtê, mais à une forme Barasâtê, qui viendrait elle-même de barasvatê.
En adoptant cette seconde explication, il faudrait aussi modifier ce qui a été dit des désinences [m)ê, tê, pou, t eu, car il est vraisemblable qu’un seul et même principe a dû présider à la formation de toutes les désinences du moyen. La première personne (m)ê, pou ne viendrait donc pas de mami, mais de masi ou masvi; la troisième personne tê ne viendrait pas de tati, mais de tasi ou tasvL Quant à la deuxième personne sê, elle se rapporterait toujours à un primitif sasi; mais le second s appartiendrait au pronom réfléchi sva, et non au pronom de la deuxième personne. C’est aussi au pronom réfléchi qu’il faudrait attribuer le s de aBaratâs. Quant à la désinence pmv, dans ê<psp6(inv, elle resterait seule de son espèce, et elle devrait s’expliquer comme une formation de date relativement récente 1.
1 Remarquons que dans cette seconde hypothèse le pronom «va, quoique jouant
$ /jyG. Formation du moyen et du passif, dans les langues letto-slaves,
par l’adjonction du pronom réfléchi.
Dans un de mes premiers écritsl, j’ai émis l’idée que le r du passif latin pouvait bien devoir son origine au pronom réfléchi. Cette explication me parait aujourd’hui de beaucoup préférable à une autre explication également proposée par moi, qui ferait venir ce r du verbe substantif; le lithuanien et le slave, que ie n’avais pas fait entrer à cette époque dans le cercle de mes études comparatives, nous présentent un exemple incontesté du même procédé. Ce n’est pourtant pas une raison pour aflirmer que cette formation à l’aide du pronom réfléchi soit la formation primitive, et que le moyen, en grec, en sanscrit et en zend, renferme aussi le pronom réfléchi. Je crois plutôt que, en slave comme en latin, le pronom réfléchi n’a appartenu d’abord qu’à la troisième personne, et qu’il a envahi petit à petit les deux autres, où il a pris la place des pronoms spéciaux de la seconde et de la première personne.
En ancien slave, pour donner au verbe le sens réfléchi ou passif, on le fait suivre de l’accusatif du pronom réfléchi; exemple : m.T<¥> ca cïtuh sah shonoror», mltcuih ca éïieêi sah «hono-raris», mltctu ca cïtett sah «honoratur»2. En bohémien, le pronom se peut précéder ou suivre le verbe ; mais comme expression du passif, il n’est guère employé qu’avec la troisième personne3. En lithuanien, les verbes ainsi combinés avec le pronom ont seulement le sens réfléchi; mais il y a, entre le lithuanien et
toujours le rôle de pronom régime, se trouverait tantôt placé le premier, comme dans <pépecr6e} bâra(d)dvé, et tantôt le second, comme dans la désinence te (pour to«, tasvi). — Tr.
1 Inséré dans les Annales de littérature orientale. Londres, 1820.
2 Voyez Dobrowsky, p. 5hb. Kopitar, Glagolita, p. 6ô, XVII. A l’exemple de Miklosich, je sépare le pronom réfléchi du verbe. .
3 Dobrowsky, Système développé de la langue bohémienne, p. 182.
le latin, cette ressemblance que le pronom a l’air d’être soudé au verbe, de manière à ne plus former avec lui qu’un seul mot, et que ce n’est pas un cas déterminé du pronom réfléchi, mais seulement sa consonne initiale, qui s’adjoint au verbe156. Devant cette annexe, la plupart des voyelles filiales éprouvent un renforcement, comme pour être plus en mesure de porter ce poids additionnel 157 158 : ainsi u devient û; i et e deviennent ë; au duel, wa et ta se changent en wô et en 0; il n’y a que Va de la troisième personne qui reste invariable. Nous faisons suivre le tableau du présent wadinüs 159 «je me nomme v, et nous mettons en regard la forme simple à signification transitive :
SINGULIER.
i. wadinu wadinus a. wadinl wadines 3. wadina wadtnas
duel.
wadhmwa wadlnawôs wadlnata wadltiatôs Comme au singulier.
PLURIEL.
wadlname wadlnamês wadlnate madvmtës Comme au singulier.
S 677. Formation analogue du passif latin.
A ces formations ressemble d’une manière frappante le passif latin, avec cette différence seulement que le latin a absolument perdu la conscience de la nature composée de son passif. Ce qui lait que le lithuanien sent encore la présence du pronom réfléchi, c’est que celui-ci est resté mobile et qu’il peut, dans certains cas (§476), être placé avant le verbe. II n’en est pas de même en latin. L’identité d’origine du suffixe passif et du pronom réfléchi a encore ete obscurcie, en latin, par le changement, d’ailleurs si fréquent, de 5 en r.
Aux personnes finissant par une consonne, le v pour s’adjoindre avait besoin dune voyelle de liaison : c’est ainsi que nous avons amat-u-r, amant-u-r, où probablement Vu a été employé, de préférence aux autres voyelles, à cause de la liquide. Dans les formes d impératif comme amato-r, amanto~rf la voyelle de liaison n était pas nécessaire. Dans amamur, le 5 de amamus a disparu devant le pronom réfléchi : on n’en sera pas surpris, si l’on songe que le s ne sert pas à désigner la personne (§ 43g), et qu’en sanscrit le verbe actif, dans les formes secondaires, quelquefois meme dans les formes primaires, a sacrifié ce s. L altération est plus forte dans aïiievf avfiab(ivf (ifïiavery où le caractère personnel (m) a disparu; mais il était impossible de prononcer amemr, amabamr, amaremr, et l’on ne pouvait non plus intercaler un 11, car amemur, amabamur, nmaremur demeuraient réservés pour le pluriel.
Dans amaris, amerts, il y a peut-être métathèse pour amasir, amesir, ou bien, ce qui me paraît plus vraisemblable, le s s’est changé en r, ainsi qu’il arrive si souvent entre deux voyelles (S 22), et le pronom réfléchi a alors conservé son s, au lieu de le changer en r, comme dans anwtur. C’est ainsi qu’au comparatif nous avons les neutres en ms à côté des masculins en ior (S 298®). Partout ou le suffixe, au lieu de se changer en r, est resté s, la voyelle de liaison est *, et non «!. 156
À l’impératif singulier ama-re, le pronom réfléchi a gardé sa voyelle : si Ton remplace re par l’ancienne forme se, on retrouve l’accusatif du pronom réfléchi. Une autre explication, qui me paraît moins vraisemblable, consisterait à détacher l’impératif amare du reste de la conjugaison passive, et à voir dans re un vestige de l’ancienne terminaison de l’impératif; re serait alors le représentant de la désinence ao en grec, ^ sva en sanscrit. *4)» ha en zend (§721).
S 478. Origine des formes latines comme amamini.
On voit, du premier coup d’œil, que la deuxième personne du pluriel amamini na rien de commun avec les autres personnes du passif : aussi peut-on être surpris à bon droit que cette forme amamini ait figuré si longtemps dans les paradigmes de la grammaire latine, sans que personne se soit jamais demandé d’où et comment elle s’y est introduite. Il est vrai que l’ancienne méthode grammaticale, en observant les faits, laissait de côté la recherche des causes et que jamais on n’avait songé à établir, entre le grec et le latin, une comparaison suivie et approfondie. Je crois avoir été le premier à poser la question *, et je répète avec confiance l’explication que j’ai autrefois donnée. Amamini est, selon moi, un nominatif pluriel masculin du participe passif : amamini est donc pour amamini estis, comme on a en grec têtvfÂfxévoi e<W. Le suffixe latin est minus, et répond au grec (isva-s et au sanscrit mâna-s. Mais ces participes sont sortis, en latin, de l’usage ordinaire, et mini est resté seulement à la deuxième personne du pluriel, où il demeure comme pétrifié : il final : nous voyons qu’en grec cet i a partout disparu, excepté dans la seule forme iaei. Je ne parle pas des formes secondaires qui avaient déjà perdu cette voyelle avant la séparation des idiomes, ce qui n’empèche pas qu’on dit en latin amabam, ameiis.
1 Système de conjugaison de la langue sanscrite, 1816, p. to5 etsuiv.
a pris de la sorte, dans l’usage, l’apparence d’une personne verbale; le souvenir de sa nature nominale s’étant perdu, il est devenu insensible à la différence des genres et a renoncé à Fauxiliaire estis. Si l’on avait dit, au féminin, amaminœ, et, au neutre, amamina, nous aurions été dispensés de chercher pour amamini une explication que la langue nous aurait fournie d’elle-même.
Il ne sera pas hors de propos de rappeler ici un fait analogue en sanscrit. Le verbe dâ «donner» a un futur dâtd «il donnera ». Mais dâtd est le nominatif du thème masculin clâtdr1 «dator» : le sens propre de ce futur est donc «daturus [est]». Quoique dâtdr ait un féminin dâtn 2, c’est toujours dâtd que nous trouvons au futur singulier, que le sujet soit masculin, féminin ou neutre. Au pluriel, c’est encore le masculin dûtdras qui sert pour les trois genres : comme substantif, il signifie «datores»; et, employé comme personne verbale, il équivaut à «dabunt». De même dâtdrâu au duel. Le sanscrit procède donc de la même manière que le latin : il y a même ici cette singularité de plus, que dâtd, dâtdr as, dâtdrâu sont restés usités dans la langue comme substantifs. Mais le sanscrit, tel qu’il nous est parvenu, ayant perdu la faculté de disposer librement de ces formes comme de participes futurs, cette circonstance seule a suffi pour que data' signifiant «dabii» cessât de distinguer les genres et contractât toute 1 apparence d’une personne verbale ordinaire.
On peut rapprocher des formes latines comme amamini les
qui ont perdu un i après le m. Let i s est conservé dans terminus, si l’on voit dans ce mot le participe passif de la racine sanscrite tar, if «dépasser»3. Une
1 Voyez S \ hL
2 Comparez les féminins latins en Irî-c (S 119).
3 Voyez mon livre intitulé Vocalisme, p. 17/i.
formation de participe moyen nous est fournie par le mot fe-mina « celle qui enfante », dont la racine fê se retrouve dans fétus, fetura et fecundus. II est peut-être permis d’ajouter à ces exemples le mot gemini, dans lequel je crois voir une forme mutilée pour genmini ou genimini k ceux qui sont nés ensemble ».
S /179. Origine des formes latines en mino.
Dans la vieille langue latine, nous trouvons à la deuxième et à la troisième personne du singulier de l’impératif une désinence mino que je regarde comme un nominatif singulier privé de signe casuel; par l’absence de flexion, ce nominatif est devenu semblable au thème. Tels sont : fa-mino prœfamino 2, an-testamim 3, denuntiamino 4, proftemino 5, progredimino 6, fruimino7.
Quant aux formes en minor, qu’on attribuait autrefois à la deuxième personne du pluriel de l’impératif futurvelles reposent sur de fausses lectures8.
1 Festus, qui cite cette forme, l’explique par dicito : cette interprétation est équivoque, car elle peut faire supposer aussi bien la deuxième que la troisième personne.
3 Caton, De re rustiea.
3 Loi des XII Tables. *
4 Voyez la Revue pour la science historique du droit, t. XV, p. 2/18.
h Table d’Héraclée. ( Corpus Insaiptwmm latinamm, n° 206.)
6 Plaute, Pxeudolw, III, 2,70 :
Si quo hic spectabit, eo tu spécial» simul;
Si quo hic gradielur, paritf-r progredimino.
' Sur une inscription, dans Gruter : h eum agrwn net habeto mve fruimino. ( Corpus Imcriptionum latinarum, n° 199.)
8 Voyez Madvig, Opuscula academica altéra, p. 239 et suiv. — Nous avons sur les Tables eugubines des nominatifs masculins pluriels comme subator, screhitor (= subacti, scripti), desquels j’avais autrefois rapproché ces formes. Le r représente ici le s des nominatifs pluriels comme (Uvâs, en sanscrit, et comme vulfôs, en gothique. On a vu (S 228 ") que les nominatifs latins comme domiui sont formés d’après la déclinaison pronominale. Sur le changement de s en r, voyez S 22.
EFFET DU POIDS DES DÉSINENCES.
$ 48o. Effet «la poids des désinences sur la partie antérieure du verbe. —
Le verbe substantif as.
En sanscrit, en zend et en grec, le poids des désinences personnelles exerce sur la racine ou sur la syllabe caractéristique de la classe des effets très-sensibles et trés-étendus, quoique longtemps ignorés 160. Il arrive, par exemple, que devant les désinences légères, la partie antérieure du verbe s’élargit et que ces élargissements manquent devant les désinences pesantes. Ou bien certains verbes irréguliers ne conservent le corps entier de la racine que devant les désinences légères; devant les désinences pesantes, la racine subit des mutilations.
Comme exemple de ce dernier fait nous citerons d’abord la racine «être»; elle ne conserve son a que devant les dé
sinences légères : devant les désinences pesantes, elle rejette son a moins qu’il ne fasse corps avec l’augment. On a donc, dune part, asmi «je suis», mais, de l’autre, smas «nous sommes», sia «vous êtes», sdnti «ils sont». On peut prouver toutefois que ces mutilations sont postérieures à la séparation des idiomes, car le grec conserve le devant les désinences
pesantes : en regard de smas, sia, sim, stas, il a sapés, salé, êalévy éa16v. Le lithuanien et le slave sont, comme le grec, mieux conservés que le sanscrite On peut comparer :
G est en recherchant tes causes de l’apophonie, ou changement de la voyelle radicale dans tes verbes germaniques, que j’ai été amené d’abord à constater celle sene intéressante de phénomènes. Voyez tes Annales de crilique scientifique, 1837, p. et suiv. et Vocalisme, p. i3 et suiv.
G
ni.
SINGULIER.
|
Sanscrit. |
Grec. |
Lithuanien. |
Ancien slave. | |
|
cis-mi |
èfl-fl*1 |
es-ml |
t€CA\b jes-mï | |
|
t *2 0-81 |
èa-Gi |
es-ï |
K CH je-si | |
|
âs-ti |
■L . • es-ti |
l€CTL jes-tï | ||
|
DUEL. | ||||
|
s-vas |
• **«•*■ |
es-wa |
KCB1î jes-vê | |
|
s-tas |
èa-ràv |
es-ta |
t€CTd ks-ta | |
|
s-tas |
èa-rôv |
c. au singul. |
ICCTd jes-ta | |
|
PLURIEL. | ||||
|
s-mas |
èff-pés |
es-me |
l€CMS jes-mü | |
|
s-ta |
èer-ré |
es-te |
l€CT€ jes-te | |
|
s-ânti |
(aj-swi |
c. au singul. |
CifvTli s-u-ntï. | |
Remarque. ■— Irrégularités du .verbe substantif as, en latin, en grec et en gothique. — C’est par la troisième personne du pluriel, où nous avons la désinence anti, qui de toutes est la plus pesante, que la suppression de la voyelle radicale aura commencé. Peut-être même avait-elle déjà eu lieu, pour cette personne, avant la séparation des idiomes, car il est difficile d’attribuer au hasard l’accord qui existe sur ce point entre toutes les langues indo-européennes. Le slave lui-même, qui conserve son je partout (jes-mü, jes-te, jes-vê, jes-ta). fait, à la troisième personne du pluriel, suhlï; de même le latin, qui fait à la deuxième personne estis, présente sunt à la
troisième.
Au contraire, à la première personne sumus, la perte de Ve appartient h la période latine. Il en est de même pour sum (au lieu de esum), où la suppression de Ye n’est pas justifiée par la présence d’une terminaison pesante. Aussi la forme sum n’a-t-elle pas d’analogue dans les autres idiomes indo-européens. Une fois que âsmi eut perdu en latin sa voyelle initiale et sa voyelle finale, l’insertion d’une voyelle euphonique devint 160
nécessaire : la présence de la liquide fit donner la préférence à IV Cet u est resté aussi au pluriel, où s-mus parut trop dur, quoique le groupe sm ne soit pas impossible à prononcer. On peut remarquer qu’en général le iatîn a évité de joindre immédiatement la désinence mus à une racine finissant par une consonne : ainsi il a vol-u-mus k côté de vul-tis, vul-t; fer-i-mus à côté de fer-tis, fer-s, fer-t; ed-i-mm à côté de es-tis, ê-s, es-t (sanscrit (id-nuts, at-lâf âl-sij ât-ti).
En grec, si la troisième personne du pluriel èvri est, comme je le crois, pour (j-svti ( zend h-ënti ). elle na absolument gardé que la désinence ; le même fait est arrivé en sanscrit, à la deuxième personne du moyen sê, pour (i(s)-sê.
Nous n’avons pas fait entrer le gothique dans nos comparaisons, quoique le singulier i-m , i-s, is-t réponde bien à âs-tni, à-si, âs-ti; mais au duel et au pluriel, excepté pour la troisième personne siiul, le gothique a eu recours à une racine secondaire sij, qui prend les désinences du prétérit. Nous avons donc au pluriel sij-u~m, sij-u-th, et au duel sij-û160, sij-u-ts. Cette racine sij se rattache au potentiel sanscrit syâ-m, avec changement de sy
(= sj)en «y-
$ 481. Effet du poids des désinences sur les verbes de la troisième classe.
— Le verbe dâ «-donner»?.
Le poids des désinences exerce son effet sur toutes les racines sanscrites de la troisième classe2 qui finissent par â : comme elles sont déjà surchargées par la syllabe réduplicative, elles ne conservent leur à que devant les désinences légères ; devant les désinences pesantes, elles le suppriment entièrement, ou eDes l’abrègent, ou bien elles le changent en î3.
Les racines dâ «donner» et dâ «poser» suppriment leur â devant les désinences pesantes. Il faut, je crois, excepter la troisième personne du pluriel, où je divise de cette façon : ddda-ti et non ddd-ati; en effet, la forme primitive a été induhitable- 161
84
ment dadâ-nti. Or, de cette forme on a bien pu faire dada-nti (avec un a bref), qui lui-même, par un nouvel allégement, est devenu dâda-ti. Mais il eût été impossible de supprimer la voyelle radicale, car on aurait eu dad-nti.
Le grec se contente d’abréger la voyelle longue devant les désinences pesantes : de StSa>9 TtStj, lcr1à9 il fait ScSo, rtÛe, larlâ.
En latin, en lithuanien et en slave, le poids des désinences personnelles n’exerce plus aucun effet sur la syllabe précédente. Le latin dâ a, de plus, abrégé l’ancienne voyelle longue, et il a perdu la syllabe réduplicative. Au contraire, le lithuanien et le slave ont gardé le redoublement ; mais ils ont partout supprimé la voyelle radicale, ce qui n’arrive en sanscrit que devant les désinences pesantes. Si l’on tient compte, en outre, de cette circonstance que le d disparaît, en ancien slave et en lithuanien, devant les désinences commençant par un m ou un s, et qu’il se change en s devant un t1, on ne sera pas surpris que le redoublement soit devenu presque impossible à constater sans le secours de l’analyse comparative. Nous avons, par exemple, à la première personne, durai (pour dûr-d’-mi), auml dam% (pour da-d’-mï) ; les éléments les plus importants ayant été éliminés de ces formes, la syllabe réduplicative a pris l’apparence de la syllabe radicale. Il n’en est pas moins certain que dans dümi, damï, les syllabes dû, da sont identiquement les mêmes que dans dü-s-ti, da-s-tï (pour du-d-ti, da-d-iïj; ce sont, par conséquent, les syllabes réduplicatives. On peut comparer :
SINGULIER»
|
Sanscrit. |
Zend. |
Grec. |
Lithuanien. |
Aocmi slave. |
Latin. |
|
diidâ-mi |
dada-mi |
diï(d)-vii |
da(d)-mï |
do | |
|
dàdâ-si |
dadudii |
dëd-i |
da{d)-si |
da~s | |
|
dàdâ-ti |
Jaddi-ti |
S/eSw-tï |
dës-ti |
das-iï |
da-t |
1 Voyez S io3. Le lithuanien perd également le d devant les désinences commençant par w.
DUEL.
Latin.
Sanscrit. Zend. Grec. Lithuanien. Ancien slave.
dad-vâs1 ............... dü(d)-wa da(d)-ve
dat-his das-lô ?162 163 164 165 166 StSo-roi» dus-ta das-ta
dat-tâs daé-to? S/So-ror c. ausingul. das-ta
PLURIEL.
diï(d)-me da(d)-mü da-mus
diïs-te das-te da-tis
c. au singul. dad-ahtï da-nt.
En grec, le poids des désinences a étendu son action plus loin qu’en sanscrit, en ce sens que les aoristes ëdtjv et ëS&v, qui n’ont pas la syllabe réduplicative, n’en abrègent pas moins la voyelle radicale au duel et au pluriel. Au contraire, ëalrtv (dorien ëalâtv) demeure insensible au poids des désinences, comme les aoristes de forme analogue en sanscrit.
Si nous prenons pour exemple la racine dâ, nous voyons bien qu’au premier prétérit augmenté (qui répond à l’imparfait grec) elle fait âdadâ-m (= è$t$oo-v) au singulier, et âdad-ma (comparez êSiSo-ptev) au pluriel; mais au deuxième prétérit aug-
monté (aoriste grec) elle fait au singulier âdâ-m (=s§œ-v) et au pluriel âdâ-ma, en regard de êSo-y&s1. La différence sera rendue sensible par le tableau suivant :
SINGULIER.
|
âdadâ-m |
èhfàcû-v |
|
âdadârs |
èûîhùj-s |
|
Madâ-t |
èZiàta-(t) |
|
Adâ-m |
éSco-r |
|
Adâ-s |
êhù)-ç |
|
àdâ-t |
éhw-fc) |
DUEL.
|
âdad-va | |
|
âdat-tam |
èhfâo-Tov |
|
(uîat-tâm |
èàûiô-T>)v |
|
Adâ-va | |
|
Adâ-tam |
é§o-iw |
|
âdâ-lâm |
sSÛ-T YfV |
l’LURIEL.
|
Adcid-ma | |
|
Adat-ta |
sîL'So-ts |
|
Adad-us2 |
èhtôo-v* |
|
Adâ-ma |
êào-ues 1 |
|
Adâ-ta |
éSo-Te |
|
Ad-us |
éSo-t». |
S hS*2. Autres verbes de la troisième classe : affaiblissement d’un â
radical en t, devant les désinences pesantes. — Affaiblissement de iVf
en i dans la syllabe réduplicative.
Les racines sanscrites lia «abandonner», ha «aller» et ma «mesurer»4 affaiblissent leur A en î devant la plupart des désinences pesantes; kâ «aller» et ma «mesurer» remplacent aussi par un i bref lu bref de la syllabe réduplicative. Nous avons donc gahî-mds « nous abandonnons » en regard de gâhâ-mi «j’abandonne»: mâ fait mtWr(venant de mimî-mê) «je mesuré», et au pluriel mmî-mAhê «nous mesurons».
Les racines stâ «être debout» et grâ «sentir» suivent une formation à part. II est probable qu’à l’origine elles abrégeaient leur « seulement devant les désinences pesantes : c’est ainsi qu’en grec nous avons tarlâitev à côté de ït/ïôttju ; mais cet â bref a fini par se communiquer à toutes les personnes, après quoi
1 D’après l’analogie de l’imparfait, on aurait dû attendre àdma.
2 Voyez S A 6a.
3 Forme épique etdorienne. Voyez Buttmann, Grammaire grecque développée, S 107, remarque la. — Tr.
4 La racine ha «abandonner» n’a que la forme active transitive; les deux autres racines ne sont usitées qu’au moyen.
tisiâmi, tis(asi, tisiati, nous avons, en zend, histâmi, histahi, his-taiti. Le grec obéit au même principe : à tisiâmi répond 'îahi[u, hgigrâmi xi'xpnfu. Le grec étend même ce changement aux verbes qui ne commencent point, comme les deux exemples précités, par deux consonnes.
ii a été traité comme Va non radical de la première et de la sixième classe1. Aussi les grammairiens indiens rangent-ils ces racines dans la première classe, quoiqu’elles aient une syllabe réduplicative.
Les verbes ayant une voyelle longue dans leur syllabe radicale l’abrègent ordinairement dans la syllabe réduplicative : c’est par le même besoin d’alléger le verbe que s’explique le* changement de Va en i dans tisiâmi,. gigrâmi168 169 170. En regard du sanscrit
Les verbes et ont ceci de particulier qu’ils
insèrent dans la syllabe réduplicative une nasale dont il n’y a pas trace dans la racine. Nous trouvons quelque chose d’analogue en sanscrit : ce sont les verbes intensifs, qui renforcent par toute sorte de moyens la syllabe réduplicative. Ainsi ils frappent du gouna les voyelles qui en sont susceptibles, ils répètent deux fois les racines finissant par une nasale, ils remplacent quelquefois par une nasale les liquides r et l; par exemple, gam « aller » fait gangarn3, cal «chanceler» fait cancal, car «aller» fait caàcur (pour cancar}. Je rapproche de ces derniers exemples , m'fmpvpi, que je regarde comme
étant pour '&Cfoiknp.t, mipTrptipt. On y peut joindre fiapSciivco, avec sa forme secondaire (comparez battus).
S 483. Effet du poids des désinences sur les verbes de la deuxième classe.
Les racines sanscrites de la deuxième classe n’ont pas à porter la charge d’une syllabe réduplicative1 ; elles peuvent donc garder un â final devant les désinences pesantes, qui ne manifestent leur présence que par le déplacement de l’accent (§ 481).
Mais ici encore le grec se montre plus sensible que le sanscrit à l’effet du poids des désinences. Il fait suivre à (dorien (patfjLt) l’analogie de tt/ltjpt. On peut comparer :
SINGULIER. DUEL. PLURIEL.
|
ItAf • oa-mi |
ps-fl t* |
le A / ba-vas |
••*••*»* |
le A f ba-mas |
<pà-(lés |
|
iTA* • ba-si |
tiâriâs |
Çà-ràv |
Bâ-tâ |
0a-ré | |
|
Ba-li |
Çâ-Ti |
Üâr-iÀS |
(fitX-TOV |
Ba-nti |
(pâ-vrî |
|
âBâ-m |
ê(pà-v m |
fft A aba-va |
âBâ-ma |
éÇà-pes | |
|
aba-s |
é(pâ~s |
âbrâ-tam |
éÇa-rov |
âBâ-ta |
éÇâ-re |
|
âüâ-t |
ë<pâ-(r) |
ri/A *a aba-tam |
èÇâ-Tïjv |
âBâr-n |
éÇa-v. |
Entre autres verbes sanscrits qui se conjuguent comme béni, on peut citer yâ «aller». Le grec h fit, littéralement «faire aller», a pris le sens causatif171 172 173 174. Tandis que h fit fait au pluriel te-fies, te-Te, le sanscrit yâ fait yâ-mds, yâ-tâ.
De la racine yâ, je crois devoir rapprocher aussi le grec tefiai\ qui a vocalisé le y en i et aminci ïâ en s. La grammaire grecque considère feptai comme le moyen de elfii ; mais ce dernier verbe dérive de la racine ^ % «aller» qui fait en sanscrit, au moyen, f^(Pour i-mê), iSS', i-tê) transportées en grec, ces formes donneraient fyw», ïtrat, h ai.
On vient de voir que l’effet du poids des désinences personnelles se fait plus sentir sur la syllabe précédente en grec qu’en sanscrit : on a vu notamment que des racines primitivement terminées par une voyelle longue abrègent, en grec, cette voyelle devant les désinences pesantes. On pourrait donc s’étonner de ce que rjfiat et xetpai conservent partout la longue rj et la diph-tkongue et. Il sera traité plus loin de xetptai (§ 487); quant à tj-pat, ce verbe a conservé sa longue parce que la racine était primitivement terminée par une consonne, à savoir un s : $<r-rai répond au sanscrit as-tê, rja-io à WTW o&-ta9 de la racine as «s’asseoir»1. Si le composé xdOtjytai fait, d’une part, xaOricT-to et, de l’autre, êxdOti-To, je crois que c’est là encore un phénomène qui tient à la loi d’équilibre : surchargé de l’augment, le verbe n’était plus assez fort pour porter le a.
§ 484. Autres verbes de la deuxième classe. —Le verbe sâs « commander».
La racine sanscrite Ufpjyds «commander, régner» se montre particulièrement sensible au poids des désinences personnelles : elle conserve bien son a long devant les désinences pesantes commençant par une semi-voyelle ou une nasale, c’est-à-dire par les consonnes les plus faibles ; mais elle change son â en i quand la désinence pesante commence par une autre consonne.
1 Au contraire, eï-<ra et les formes analogues appartiennent à la racine e<5, qui a donné le substantif éê-pa «siège». La racine correspondante, en sanscrit, est seul «s’asseoir». Voyez Pott, ouvrage cité, p. 378, et Kühner, Grammaire grecque, p* a4a. L’esprit rude de ÿpat est inorganique (c’est-à-dire qu’il n’est pas sorti d’un «) : il en est de même, par exemple, pour l’esprit rude de vSup, en sanscrit 3c[ udn. en latin muta.
Nous avons, par exemple, sâs-vâs «nous commandons tous deux», sâs-mâs «nous commandons», mais sisid «vous commandez». Devant les désinences légères, Xâ reste toujours : sâs-si «tu commandes», éas-ti «il commande». Ce changement de la voyelle nous annonce déjà ce qui se passe dans la conjugaison germanique, où nous avons binda «je lie», bindam «nous lions», bundum «nous liâmes», en regard des formes monosyllabiques band «je liai», bans-t «tu lias».
Remarque, — La racine sâs en ancien slave. — On peut regarder comme étant de la même famille que sâs <rcommander» la racine sans «dire» qui, à l’origine, était peut-être également de la deuxième classe et devait faire alors, à la troisième personne du singulier, sahs-ti. Je crois pouvoir rapprocher du sanscrit sans l’ancien slave CATM saii-ti n-il dit»; le s final de la racine se sera perdu. Cette forme est remarquable en ce qu’elle est la seule qui ait conservé, à la troisième personne du singulier, la désinence pleine TM ti
S ABS. Effet du poids des désinences sur les verbes de la neuvième classe :
affaiblissement de nâ en ni, devant les désinences pesantes. — Affaiblissement, en grec, de va en va.
Les verbes de la neuvième classe 175 176 suivent l’analogie des racines ha et mâ (§ 489), en ce sens qu’elles changent leur syllabe caractéristique nâ en ni, là où les racines précitées affaiblissent leur â radical en î. De son côté, le grec abrège dans ces verbes Vrj (dorien â) en à177.
On peut comparer
SIKGCLIBR.
'ftép-vâ-pt krî-na-si 'rtêp-vas kri-narti 'ûfép-vâ-^i
âh'î-nâ-m èitêp-và-v âkrî-nâ-s ènép-vas akrî-nâ-t èirép-voL-fc)
DUEL.
krî-nî-iâs 'vsép-va-rov krî-nî-tâs 'Gfép-và-TOV
âkrî-nî-va ........ .
âkrî-nî-tam ènép-vci-TOv âkri-nî-tâm èitsp-vâ-Tïjv
PLURIEL.
krî-nî-mâs 'zsép-và-p.ss krî-nî-iâ ^rép-va-rs krî-iiâ-nti180 ('zsép-vâ-vrt)
âkrî-nî-ma èirép-và^fies âkrî-nî-ta èirép-và-re âkrî-na-n (èirép-vz-v).
S /i86. Verbes sanscrits de la deuxième et de la troisième classe : renforcement de la voyelle radicale devant les désinences légères. — Fait analogue en grec.
Nous avons vu jusqu’ici que le poids des désinences se manifeste par un affaiblissement de la partie antérieure du verbe; mais il peut aussi se faire sentir d’une façon contraire, c’est-à-dire par un renforcement. C’est ce qui arrive pour les verbes sanscrits de la deuxième et de la troisième classe ayant une voyelle radicale susceptible du gouna181 : celte voyelle prend le
gouna (§ 96, 1) devant les désinences légères; elle reste pure devant les désinences pesantes.
Le grec obéit au même principe ; mais, excepté slpt, il n y a pas, en grec, de verbe à voyelle susceptible du gouna qui se conjugue comme les verbes sanscrits de la deuxième et de la troisième classe.
On peut comparer :
SINGULIER.
DUEL.
PLURIEL.
i-vâs1
i-nids ï-(ies
• ! f j
i-ta i-re
y-ânti i-âm (de I-avrt).
Af *
e-mi
est
e-tt
SÏ~(JLl
si-s sl-rt
t-tas
i-tds
t-TOV
Ï-TGV
On a déjà fait observer 483 ^ que le moyen t&ptcei appartient à une autre racine.
S 687. Exception au principe précédent. — Le verbe sî
«être couché, dormir».
La racine sî «être couché, dormir», qui appartient à la deuxième classe, fait exception au principe précédent. Quoique usitée seulement au moyen, dont les désinences, comme on verra (§ 4qâ), sont pesantes, elle a partout le gouna; il en est de même pour xslfiou, en grec. Nous avons donc xsï-crac —sê-sê, xsi-tou = s'ê-tê, et au pluriel xst-p&Oa — sê-mahê. De même quen grec xet est regardé comme la racine, on pourrait aussi prendre sê pour la racine du verbe sanscrit, car on ne trouve nulle part, dans la conjugaison, la syllabe sî. Il n’y a pas non plus de dérivé nous obligeant à admettre une racine sî plutôt que sêr que quand elles sont suivies d1 uuô seule consonne ; les voyelles longues ne ie prennent que quand elles se trouvent à la fin de la racine. Une voyelle longue, soit par nature, soit par position, ne peut prendre le gouna si elle est au milieu de la racine.
1 Remarquez le déplacement de l’accent occasionné par la différence de poids des désinences personnelles (S ^92). Voyez Système comparatif d’accentuation, S 66.
■! moins qu’on ne rapporte ici le mot sîtâ « froid », en tant que «engourdi, immobile».
Dans l’ancien slave nonofi po-koj «repos», la diphtbongue s’est modifiée de la même manière que dans le grec xo/n?, not-péi). Au contraire, dans hhia cijuh «quiesco»1, il y a eu un double affaiblissement : le k s’est amolli en m c sous l’influence euphonique de IV, et la diphtbongue amincie n’a conservé que son dernier élément. Il faut prendre garde que la forme primitive du thème n’est pas pokoj, mais bien po-kojo, qui a dû perdre sa voyelle finale au nominatif-accusatif dénué de flexion (S 267). Le thème pokojo répond très-bien au sanscrit sayd, qui signifie, comme adjectif, «couché, dormant», et, comme substantif, «sommeil».
$ 688. Verbes sanscrits de la cinquième et de la huitième classe : renforcement des caractéristiques nu, u, devant les désinences légères. — Comparaison avec le grec.
Devant les désinences légères, les racines de la cinquième et de la huitième classe renforcent leurs syllabes caractéristiques nu et u en nâ et en ô. Mais devant les désinences pesantes, elles gardent la voyelle u exempte du gouna.
Le grec obéit au même principe, avec cette différence qu’au lieu d’élargir v en ey, il allonge i’o. On peut comparer :
SINGULIER.
DUEL.
PLURIEL.
str-no-mi2 <x7ép“Vô-f« slr-nu-vâs3 ......... str-nu-mas &1 àp-vv-pss
str-no-èi <r7ôp~vüs str-nu-tds cr'Iôp-vv-rov str-nu-ta G'Iàp-vv-TS
str-no-ti crlàp-vv-Ti slr-nu-tâs </1àp-vv-rov str-nv-ànti aflàp-vv-wn
1 Voyez Kopitar, Glagolita, p. 86.
2 Les grammairiens indiens almettent une racine ^r[ sîr (cinquième classe) et une racine stf (neuvième classe), qui signifient toutes les deux «répandre». La vraie racine est star (= grec cr7op, latin ster). Voyez Vocalisme, p. i&7 et 179.
3 Voyez, au sujet du déplacement de l'accent, S 4 99, et Système comparatif d’accentuation, S 66.
SINGULIER. DUEL. PLURIEL.
âslr-nav-am èa'làp-vv-v asir-nu-va .........âstr-nu-ma èa16p-v%-p*$
âstr-m-s è<j7àp-vv-s aslr-nu-tam èa16p-vv-iov âstr-nu-ta ètrldp-vv-u
âstr-no-t êt/lôp-vv-(r) astr-nu-tâm èolop-vû-Tyv àstr~nv-an (ècr1àp-vv-v).
S h89. Renforcement de la voyelle radicale, dans les formes monosyllabiques du prétérit redoublé, en gothique et en vieux haut-allemand.
En sanscrit, le prétérit redoublé prend le gouna devant les désinences légères, et il rétablit la voyelle radicale pure devant les désinences pesantes. Dans les langues germaniques, l’augmentation du nombre des syllabes produit, au temps correspondant, le même effet qui est dû en sanscrit à l’augmentation du poids des désinences. Nous avons, par exemple, le gothique bail, le vieux haut-allemand beiz «je mordis, il mordit », en regard du sanscrit bibé’da «je fendis, il fendit ». A la deuxième personne, le gothique fait bais-t; au contraire, en vieux haut-allemand, nous avons biz-i (et non baiz-i), parce que le verbe s’est allongé d’une syllabe. Remarquons que la désinence gothique t est plus pesante que Yi du vieux haut-allemand : néanmoins bais-t a conservé l’ancien gouna et biz-i en a été privé, parce que l’un est monosyllabique et que l’autre ne l’est pas. Au pluriel et au duel, le gouna manque en gothique comme en vieux haut-allemand et en sanscrit1; nous avons, par exemple, le gothique bitum «nous mordîmes» en regard du vieux haut-allemand bi-zumês (même sens) et du sanscrit bibid-i-md «nous fendîmes». Au subjonctif du prétérit, le gouna manque absolument, les formes de ce temps étant partout polysyllabiques : nous avons, par exemple, en gothique, bitjau (et non baitjau); en vieux haut-allemand, bizi (et non bmi).
1 Les deux premiers idiomes le suppriment à cause de l'augmentation du nombre ■ v ^ r s ■ r t à cause du Paugmenialiort du poids des désinences.
§ k$o. Prétérits germaniques affaiblissant un a radical en u dans les formes
polysyllabiques. — Changement de Va en u dans le verbe sanscrit kar.
Dans la conjugaison germanique, 1 effet exercé sur la voyelle radicale par l’accroissement du nombre des syllabes se fait encore sentir d’une autre manière. Nous voulons parler des racines terminées par deux consonnes qui ont perdu le redoublement et qui ont gardé un a dans les formes monosyllabiques du prétérit : elles affaiblissent cet a en u dans les formes polysyllabiques182. Nous avons, par exemple, en vieux haut-allemand, à la première et à la troisième personne du singulier, bant «je liai, il lia»; mais la deuxième fait bunii (§ 7), et non banti. Au contraire,.en gothique, où la deuxième personne n’a qu’une syllabe, nous avons bans-t. Au duel, au pluriel et dans tout le subjonctif du prétérit, nous trouvons un u, en gothique comme envieux haut-allemand, parce que toutes ces formes allongent le verbe d’une syllabe; ainsi le gothique fait bundum «nous liâmes», bundjau «que je liasse», et le vieux haut-allemand
buntumês, bunii.
*
Si Vu ne se trouvait qu’à l’indicatif, on pourrait penser2 qu’il est dû, par une sorte d’assimilation, à l’influence de la syllabe suivante (bund-u-m, bund-ur-th, etc.). Mais à cette explication s’oppose, outre le subjonctif bundjau, le participe passif hund-an-s «lié».
De son côté, le sanscrit nous présente l’exemple, d’ailleurs «nique, d’un verbe qui emploie tour à tour a et u, comme les prétérits germaniques en question; c’est le verbe bar3 «faire». H n’emploie fa, dans les temps spéciaux, que devant les désinences légères (§ 492); il l’affaiblit en u devant les désinences pesantes, et, en général, dans toutes les formes où la seconde conjugaison exclut le gouna. Nous avons, par exemple, au singulier du présent de l’indicatif : kar-o-mi, kar-ô’-si, kar-o-ti, mais au duel kur-vds, kur-u-tâs, kur-u-tds, et au pluriel kur-mâs183, kur-u-tà, kur-v-dinii. De même, au potentiel : kur-yâm, kur-yâlsf etc. Quoique je ne doute pas qu'on n’ait dit d’abord kur-u-yâm, kur-u-yâs, je ne crois pas que le premier u soit dû à l’influence assimilatrice du second, car alors nous devrions aussi avoir tun-u-yâm, au lieu de tan-u-ydm. Une assimilation de ce genre serait sans exemple dans tout le système de la conjugaison et de la déclinaison sanscrites : au contraire, il est arrivé souvent qu’un u soit sorti d’un a par affaiblissement (§ 7); nous citerons, entre autres, les intensifs cancur et pampul, où Va des racines car « aller y> et pal « s’ouvrir v s’est affaibli en u par suite de la surcharge de la syllabe réduplicative.
Remarque 1. — Le changement de Va en u peut-ii s’expliquer par l’influence de la liquide suivante? — Comme tous les verbes gothiques qui, au prétérit, suivent l’analogie de band, ont une liquide pour avant-dernière consonne de la racine, et comme les liquides ont une affinité particulière avec la voyelle w, je ne veux pas nier que Vu ne soit dû en partie à leur influence. Mais il n’en reste pas moins vrai qu’il faut chercher dans la loi d’équilibre, et dans la différence de pesanteur des voyelles a et w, la cause qui fait que nous avons, d’une part, land, et, de l’autre, bundum, bundjau> bundans. S’il en était autrement, pourquoi le monosyllabe band aurait-il conservé l’ancien a? Pourquoi aurions-nous, en regard du gothique banst «tu lias», le vieux haut-allemand bunti (même sens)s, quand, au contraire, Va est resté dans la forme monosyllabique bant «je liai, il lia»?
On peut, de même, pour le changement du sanscrit bar en kur, attribuer
hjil* certaine part d’influence à la liquide; mais si uous avons, dans le même verbe, des formes avec kar et d’autres avec hur, c’est le poids des désinences qui seul peut rendre compte de ce partage. Hors des temps spéciaux , la racine kar supprime entièrement Va dans les formes qui recherchent un allégement, et le r se change alors en la voyelle r. Nous avons, par exemple, kr-tâ cr faità côté de k/ir-ium « faire ». La forme kr, qui résulte de cette mutilation , est donnée par les grammairiens indiens, suivant leur pratique constante, comme la forme primitive de la racine; mais j’ai essayé ailleurs de démontrer que celte théorie est en désaccord avec les faits1.
Remarque 2. — Pourquoi les verbes réduplicatifs, en gothique, n’affaiblissent-ils pas la voyelle radicale? — On peut se demander pourquoi l’a radical n’a pas été également changé en u au prétérit des verbes gothiques qui ont gardé l’ancien redoublement; pourquoi, par exempte, haihaîd «-je tinsn fait au pluriel haihaldum trnous tînmes», et non haihuldum. Ici, comme dans bundum, la racine a une liquide pour avant-dernière lettre, et l’on pourrait croire que la surcharge causée par le redoublement fut une raison de plus pour alléger la voyelle radicale. C’est ainsi qu’on a vu (S 481) qu’en sanscrit les racines réduplicatives (troisième classe) finissant par â affaiblissent ou suppriment cette voyelle devait les désinences pesantes, au lieu que les racines non réduplicatives de la deuxième classe n’éprouvent aucun amoindrissement. Mais le redoublement du prétérit gothique obéit a d’autres lois : ce sont seulement les racines les plus vigoureusement cons' tituées qui se trouvent de force à le porter. Aussi ne nous a-t-il été conserve que par deux sortes de verbes : î° ceux dont la racine renferme une voyelle longue ou une diphthongue, comme haihait aj’appelai» (présent : Imita), ana-atauk «il augmenta» (présent : am-aukith); 2° les racines renfermant un a (c’est-à-dire la plus pesante des voyelles brèves) placé devant deux consonnes; exemple : faifalth wil plia» (présent : fallhith)2. Dans ces conditions, la langue a éprouvé le besoin de laisser, après le redoublement, toute sa force à la racine, et elle a préservé Va de l’affaiblissement en w.
S 491. Double forme du gouna dans les verbes grecs ayant un 1 radical.
— Comparaison avec les langues germaniques. — Le parfait oZÔa.
Les verbes grecs ayant un t radical prennent et ou 01 dans
1 Voyez S t, et Vocalisme, remarque 1.
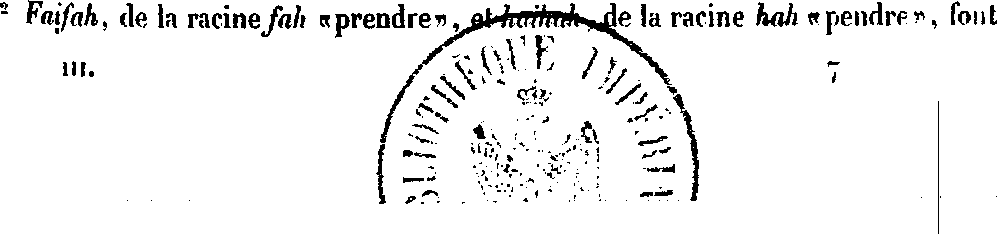
les formes frappées du gouna1. C’est la diphthongue oi, comme la plus pesante, qui se trouve au parfait 2. La racine Xiir (eXt-7toï>) fait donc Xsina au présent et 'ké'Komct au parfait; mû ($%i8ov) fait 'bereiÔùj au présent et 'usénoiOai. au parfait. Ce double gouna grec répond au double gouna gothique : ot correspond au gouna par a, si au gouna par i (S 27). II y a le même rapport entre 'zssiOoj et ^érrotOa qu’entre beita3, présent du verbe bit « mordre », et son prétérit bait4. Il semble donc que le grec aime aussi à renforcer la syllabe radicale, quand elle a à porter le redoublement.
À la différence du gothique, le parfait grec est devenu presque indifférent au poids des désinences. Un verbe qui s’v montre encore sensible, c’est olSa, qui répond au sanscrit vê'da s je sais» et au gothique vait (même sens)5; les trois verbes ont le sens du présent avec les désinences du prétérit redoublé. Toutefois, le verbe sanscrit, employé avec cette signification, a perdu le redoublement ; il en est de même du verbe grec, car le 01 de dïSa (pour FotSa) est simplement le gouna de Yt de la racine tS (FtS). On peut comparer :
|
Sanscrit. |
Gothique. |
Grec. |
|
vê'd~a |
vait |
oïh-a |
|
vetria |
vais-t |
ofo-da (S 453) |
|
vêtira |
vait |
ofS-e |
exception; mais, comme le montrent les dialectes congénères, ils paraissent avoir perdu une nasale. [En allemand moderne, fangen, hangen. — Tr.]
1 On ne trouve au que dans le seul verbe aida, où le gouna reste à tous les temps (S 26, a).
2 Pour la même raison, beaucoup de verbes qui ont un e au présent prennent un o au parfait. Le rapport qui existe entre AéAonra et Aefatû est analogue à celui de T£Tpotya et TpéÇ>eo.
3 Beita (prononces bîta) est l’orthographe gothique pour biita (S 37).
* Il y s, en outre, le même rapport entre tpéç>co et t érpofpa. qu’entre lisa a je re* cueille» et son prétérit las (S 6).
6 Encore en allemand moderne on dit au singulier : ich tveiss «je sais», mais an pluriel, wirwissen «nous savons».
Sanscrit. Gothique. Grec.
vid-vâ vit-u .......
vid-â-tus mt-u-ts Ïg-tov
vid-â-tm ..... ig-tov
vid~mu vil-u-m ïè-ftsv
v id-â-(ta) vit-u-th 4x-re vid-ùs (§ A63) vit-u-n Ïg-cl-gi.
Remarque. — Le duel et le pluriel de of Sa appartiennent-ils au présent ou au parfait? — La racine sanscrite vid a, en outre, un vrai présent, à savoir vê'dini, dont le pluriel vid~mâs, vit-iâ, vid-ânti aurait également fait en grec fS-per, Ïg-ts, Ïg-clgi (pour th-avrt, S 458); de son côté, le duel vit-tas^ vil-tàs ne pouvait guère donner autre chose que Ïg-tov , Ïg-tov. Il est même vrai de dire que les formes grecques ressemblent beaucoup plus à celles du présent sanscrit qu a celles du prétérit. Néanmoins, je ne crois pas que le duel et le pluriel de oïha doivent être rapportés au présent : ce qui donne a fS/xev l’apparence de ce temps (comparez sG-fiév), c’est la perte de la voyelle a qui se trouvait entre la racine et la désinence ; mais cet a pouvait d’autant plus aisément être supprimé qu’il n’est pas un élément essentiel du parfait. Il manque, entre autres exemples, dans étx-rov. qui est à éotxs ce que ÏgIov est à 61Se *.
S 492. Énumérai ion et tableau comparatif des désinences légères
et des désinences pesantes.
Après ce qui a été dit des lois de pesanteur, il est à peine nécessaire d’exposer quelles sont les désinences légères et quelles sont les désinences pesantes. A l’actif transitif, on voit au premier coup d’œil que les désinences du duel et du pluriel ont généralement plus de corps ou plus d’étendue que les désinences du singulier. Au moyen, déjà le singulier se range parmi les désinences pesantes : il est visible, en effet, que peu, <jcu, tû», ont plus d’ampleur que fu, <y(<), t 1; et de même, dans
1 On voit que étïxrov a rétabli la voyelle pure, en opposition avec éotxe où nous avons la voyelle frappée du gouna.
les formes secondaires, fiïjv, <ro9 to sont plus pesants que v,
<T’ . .
Il faut du reste considérer que plus dune désinence primitivement pesante s’est mutilée dans le cours du temps, sans que pour cela l’effet quelle avait d’abord produit sur la racine cessât d’exister. Nous voulons surtout parler ici du sanscrit : ainsi, à l’imparfait, la désinence du moyen âbihr-i (§ 471) est beaucoup plus faible que celle du transitif âbiBar-am, et si l’on considérait ces deux formes, telles que la langue nous les a conservées, on devrait plutôt s’attendre à avoir âbïbar-i et dhibr-am. De même, au parfait actif, la deuxième personne du pluriel a perdu, comme la première et la troisième du singulier, la vraie expression personnelle : il ne lui reste que la voyelle de liaison; néanmoins nous avons vida «vous savez» en regard du singulier vê'da «je sais, il sait».
A la deuxième personne plurielle des formes primaires, la désinence ta, quoique sans doute mutilée (§ 444), est encore plus pesante que le singulier si, car l’a est plus lourd que IV, et les aspirées sanscrites font entendre à l’oreille une ténue ou une moyenne suivie d’un h (§ 12 ).
Le grec a fidèlement maintenu la proportion entre les désinences pesantes et les désinences légères, c’est-à-dire que les terminaisons que nous considérons comme pesantes ont encore réellement plus de poids, dans la langue grecque telle quelle nous est parvenue, que les désinences qui, d’après notre théorie, doivent être regardées comme légères. La seule exception qu’on pourrait citer serait le rapport de tb à 0a, par exemple dans fcr-TS et ola-Bct184.
On peut comparer :
Désinences
Désinences pesantes.
|
mas |
ftes |
A e |
■ (XOLl |
vahê ftedov |
mahê {jlsOol |
|
ta |
Te |
sê |
aai |
aie adov |
dvê ads |
|
nti |
VTt |
tê |
TOU |
âtê a8ov |
ntê vr ou |
m V va ...... ma ftes a,P (mjv vaki pedov mahi ftsda
a s tam tov ta Te tas ao âtâm adov dvam aÔs
t (t) iâm tijv, toûv n{t) v(t) ta ro âtâm adrjv, adwv nta vro.
légères.
mi pu vas ... si a(t) tas tov
ti « TOV
DIVISIONS DE LA CONJUGAISON.
LES CARACTÉRISTIQUES.
§ /i()3. Répartition des dix classes de racines en deux conjugaisons
principales.
Les verbes sanscrits peuvent être divisés en deux conjugaisons principales. La première, sans être la plus ancienne, existait déjà avant la séparation des idiomes, et cest presque la seule qui soit représentée dans les langues de l’Europe. Elle comprend la grande majorité des verbes sanscrits, à savoir les classes i, 4, 6 et i o. Ce sont les classes de verbes qui, dans les temps spéciaux, adjoignent à la racine la voyelle a (classes t et 6), ou une syllabe finissant par a, savoir ya ou aya (classes h et to). Presque tous les verbes dérivés, et notamment tous les verbes dénominatifs, suivent cette conjugaison2.
La conjugaison correspondante en grec est celle des verbes en <y. 11 ne faudrait pourtant pas voir dans cet opposé au fxt des verbes comme le principal critérium de cette conju
gaison. Nous avons vu plus haut (§ &3/i) que (pépeo a du être anciennement (pép&pt (= sanscrit fir/r-d-mt), et que (pépst
1 Pour mâm, grec pjy (S A71).
2 Voyez S 109*.
ont été précédés, selon toute vraisemblance, des formes <pép-e-at, <pép~s~ri. Ce qui distingue plus essentiellement les veiibes comme Çtépw des verbes comme Tidypu, c’est que les premiers insèrent devant les désinences personnelles un o ou un e, ou une syllabe terminée par l’une de ces voyelles.
La deuxième conjugaison, en sanscrit comme en grec, comprend trois sortes de verbes :
i° Verbes combinant immédiatement les désinences personnelles avec la racine (classes 2, 3 et 7); exemples : ê-mi = s1-[At; dddâ-mi = Si'$gô-(xi; yunâg-mi «je joins», pluriel yuâg-mds «nous joignons»1 (il n’y a pas de verbe analogue en grec);
20 Verbes avec nu ou u, en grec vu ou y, pour syllabe intermédiaire (classes 5 et 8);
3° Verbes insérant la syllabe nâ (forme faible ««), en grec va (vy)t và (classe 9) 2.
Ces trois sortes de verbes sont soumises, en sanscrit comme en grec, à l’effet du poids des désinences personnelles, au lieu que la première conjugaison principale en est exempte. H sera question plus loin d’autres particularités qui appartiennent à la seconde conjugaison, en sanscrit et en grec, et qui la distinguent de la première.
S Aq/i. Subdivisions de la conjugaison en &?.
La première conjugaison principale comprend, en sanscrit, quatre classes de verbes. En grec, les subdivisions sont plus variées; mais ni dans l’un ni dans l’autre idiome elles ne concernent la flexion, qui reste toujours la même. Comme on conjugue <pé-p-o-jxer3, se conjuguent aussi tuw-to-/aev, ScU-vo-fASv, i£-dvo-(iev,
Voyez S 109% 3.
- Voyez S 109% 5.
Nous mettons le pluriel <pépopev plutôt que le singulier Ç>épco. parce que les éléments constitutifs de pépopev sont plus faciles à reconnaître.
Aa(j.&-avQ-fA£v, iziïpàuT-cro-{A£v9 $oLfx~d£,o-{jL£v, d)6-t^o-[xev. Peu importe donc pour la conjugaison que la caractéristique soit simplement la voyelle e ou o185, ou qu’elle consiste dans une syllabe se terminant par l’une de ces voyelles. Il en est de même en sanscrit, où les verbes avec a, y a et aya sont fléchis d’une manière identique.
Je ne crois pas cependant qu’il convienne de détacher la consonne de sa voyelle et qu’il faille dire, par exemple, que tMo-pev a pris d’une part un t et de l’autre une voyelle de liaison. Si nous voulons retracer le développement historique du langage, nous devons dire que la racine run s’est combinée avec la syllabe ts ou tû, comme Seat avec ve ou vo, et Aaë avec ave ou avo. L’adjonction d’une consonne nue ou d’une syllabe finissant par une consonne eût été très-difficile : jamais il n’a pu y avoir une forme Tvn-T-peu ou Sax-v-pev, Si l’on a raison de diviser Ssixvvfisv en Ssix-w-fiev, sans faire de v l’élément formatif et de 1’t> la voyelle de liaison, il n’y a pas de motif pour décomposer Tvnlopsv d’après un autre principe; ce qu’est la syllabe vu dans SetxvufjLev, la syllabe to l’est dans rMofiev. Pour la même cause, je ne puis approuver le nom de «verbes à voyelle de liaison» qu’on a proposé pour distinguer la conjugaison en « de la conjugaison en fu; car on pourrait appeler, au même titre, syllabes de liaison les syllabes vu, va dans Se/x-vu-fiev, Sdfi-va-fiev.
S 695. Origine des caractéristiques nâ, nu, u et âm.
II est presque impossible de dire quelque chose de certain sur l’origine des syllabes caractéristiques. Je crois que la plupart sont des pronoms dont le rôle est d’attacher à une personne ou à une chose l’action ou la qualité marquée in abstracto par la racine. Nous avons, par exemple, une racine exprimant l’idée
d’aimer : par l’adjonction d’une de ces syllabes, on désigne une personne qui aime. Cette personne, à son tour, est déterminée par la flexion, qui indique si c’est moi, toi ou lui qui aime.
En adoptant cette explication, on peut considérer la caractéristique de la neuvième classe sanscrite nâl (= grec va, vtj, va) comme un allongement du thème pronominal ^na{$ 369); nu (= grec w) sera un affaiblissement de nu,-comme on a, à côté du thème interrogatif kaf les formes secondaires ku et ki. Vu de la huitième classe est lui-même une mutilation pour nu : la raison de cette mutilation est aisée à reconnaître, car les racines, d’ailleurs en petit nombre, qui appartiennent à cette classe, finissent toutes par un n; exemple : tan-u-mâs, pour tan-nu-mas. La seule exception est la racine kr «faire»; mais le védique kr-no-mi et le zend kërë-nau-mi nous autorisent à croire que ce verbe avait originairement un n devant son u.
De «TT nâ paraît être venu, par métathèse, ân ; cette syllabe se combine encore avec la caractéristique a de la première et de la sixième classe, et passe alors dans la première conjugaison principale. On ne trouve d’ailleurs âna qu’à la seconde personne du singulier de l’impératif actif des verbes de la neuvième classe; exemple : as-ând «mange»186 187, qu’on peut comparera la première personne as-nam et à la troisième as'-mïtu. D’après cette forme as-ânà} on devrait s’attendre à avoir un présent as-ânâ-mi, as-âna-si, as-âna-ti188. Le dialecte védique ne nous a pas conservé de formes de ce genre ; mais ce n’est pas une raison pour affirmer quelles n’aient jamais existé, car le dialecte védique , malgré son caractère général d’archaïsme, est loin pourtant d’avoir conservé dans leur intégrité toutes les formes qui existaient avant la séparation des idiomes; pour ne citer qu’un exemple, ses premières personnes du moyen nous présentent la désinence me déjà mutilée en ê. Si toutefois, ce que j’ai peine à croire, le sanscrit a créé uniquement pour la seconde personne de l’impératif la caractéristique âna, le grec en a étendu et généralisé l’usage, car il est presque impossible de douter que les formes comme as-ând ne soient le type des formes grecques comme ï'i-ave, $dp8-avs. L’accord entre les deux langues ne pourrait guère être plus complet, car Yâ grec représente plus souvent Yâ long que 1« bref sanscrit. Au reste, l’ancienne longue s’est conservée dans ixavct)1,
$ 496. Les caractéristiques âna, nâ, nu et a, en arménien.
Les verbes arméniens en ane-m présentent une ressemblance frappante avec l’impératif sanscrit en âna et les verbes grecs en ava; je veux parler des verbes arméniens qui n’insèrent cette caractéristique que dans les temps spéciaux. Exemples : fapg-uAifiF harz-ane-m «j’interroge» (racine sanscrite prac «interroger?»), aoriste harzi; bek-ane-m «je brise» (sanscrit Barig «briser»), aoriste beki; bul-ane-m «je nourris» (sanscrit Bug «manger», présent Bundgmi, septième classe), aoriste bulj.
Une syllabe caractéristique plus rare que ane, c’est, en arménien, ne9 qui représente le nâ sanscrit, le vrj, va grec. On peut citer jutuniitriTtiar-ne-rn «je mêle»2, en grec xtp-wi-pu.
La, caractéristique sanscrite nu (cinquième classe), en grec w, est régulièrement et fréquemment employée en arménien;
1 On peut rapprocher txea, ixdvoo, lxvio\tm du sanscrit vUâmi (pour vikami}: l’idée commune est celle de mouvement. Voyez Pott, Recherches étymologiques (ire édition, 1.1, p. a68.)
3 La racine correspondante en sanscrit, fcar(ftr), signifie «tuer» quand elle est conjuguée d’après la neuvième classe (kir-niï-mi, venant de har-nà-vu ), répandre » quand elle est conjuguée d’après la sixième classe (kir-â-mi), et elle signifie aussi mêler r» quand elle est combinée avec la préposition sam (san-kirâmi).
exemple : ar-nu-m «je reçois» (aoriste art) = sanscrit r-nô'-mi (pour ar-no-mi). La racine sanscrite est ar, r «aller, se mouvoir, obtenir»1; le verbe correspondant, en grec, est 6pvupi.
11 est difficile de décider si les verbes arméniens de la troisième conjugaison qui adjoignent simplement un u (comme togum «je quitte»), appartiennent à la huitième classe sanscrite et ont perdu, comme celle-ci, un n, ou si cet u arménien est l’affaiblissement d’un a (§ i83b, 1). Dans ce dernier cas, la caractéristique a de la première et de la sixième classe sanscrite2 se serait conservée en arménien sous trois formes différentes, savoir a, e et u. Ve est le représentant le plus fréquent; nous le trouvons dans la première conjugaison : ber-e-m, ber-e-s = Bdr-â-mi, Bar-a-si. Va s’est maintenu dans la deuxième conjugaison : put-a-m «je me hâte» = sanscritpât-â-mi «je vais». Enfin Vu, par exemple, dans $en-u-m «j’abats [des bestiaux]» (aoriste sent;; comparez le sanscrit hân-mi «je tue» (deuxième
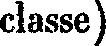
3
S 497. La caractéristique na, en sanscrit, en grec, en latin et dans les langues letto-slaves. — Verbes grecs en aim.
La caractéristique insérée dans les racines de la septième classe sanscrite a la forme na devant les désinences légères et n devant les désinences pesantes4; la racine Bid «fendre» fait, par exemple, Bi-nâ-d-mi «je fends» et Bi-n-d-mds «nous fendons».
1 Cette racine se çonjugue d'après la première, fa troisième et la cinquième classe. Pour le sens «obtenir», voyez le Dictionnaire sanscrit de Pétersbourg, sous le mot or.
2 Voyez S 109% 1.
3 En arménien, l'adjonction immédiate des désinences personnelles à une racine finissant par une consonne est impossible : il fallait donc que sen — sanscrit lum passât dans une autre conjugaison. Mais j’ai peine à croire que nous ayons ici un reste de la huitième classe sanscrite, laquelle comprend seulement huit verbes; il est plus probable que c'est une variété de la première classe, qui est très-nombreuse.
4 Voyez 8 109", 3.
Si la forme na est la plus ancienne, je serais très-disposé à croire que cette syllabe n’est pas autre chose que le nâ de la neuvième classe, qui s’est abrégé et qui a pénétré dans l’intérieur de la racine 189.
Dans les verbes grecs comme Aajv&dva, (xavÔdvco, les deux formes de la caractéristique sont réunies, car nous avons d’abord la syllabe av (pour na, § 496), et de plus la nasale s’est encore une fois insérée dans la racine : on peut comparer cette sorte d’épenthèse à celle que nous avons observée en zend (S 4i), où IV ou le y est répercuté dans la syllabe précédente.
On a déjà fait remarquer (§ 109% 5) que certains verbes comme Sax-vo-ytsv, TéfjL-vo-fxev affaiblissent l’a de la syllabe va (comparez Sdp-và-pev) en s ou en 0, ce qui les fait passer dans la conjugaison des verbes en oj. Le latin affaiblit de même Le caractéristique na en ni2; exemples : ster-ni-musy cer-ni-vms, sper-ni-mus, U-ni-mus, si-ni-mm. On peut comparer notamment ster-ni-mas avec $tr~nî-mâ$ ; mais il faudrait se garder
de voir dans le ni latin une abréviation du nî sanscrit (§ 485); K latin est ici l’affaiblissement d’un ancien a, comme dans veh-i-mus (pour veh-â-mm) 3.
En ancien slave, la septième classe est représentée par les verbes en ha nu-n, në-si, qui rejettent la caractéristique à l’aoriste; exemple : tliehagüb-nu-n ttpereo », deuxième personne güb-ne-si, aoriste güb-o-chu.
En lithuanien, nous avons quelques verbes en nu, pluriel na-me; mais ils sont très-peu nombreux et leur racine finit toujours par une voyelle4; exemple : gâu-nu j’obtiens », pluriel {fdu-na-me, aoriste gawaü, futur gdusiu.
On peut comparer :
|
Grec. |
Ancien slave. |
Lithuanien. |
Latin. |
Sanscrit. |
Arménien. |
|
Sdb£-Vû)-' |
güb-nu~h |
gâu-n’-u1 |
s ter-no-’ |
str-na-mi * * |
Uar-ne-m |
|
àâx-vet-s |
güb-ne-si |
gàu-n-i |
ster-nis |
stv-na-si * » |
Uav-nc-s |
|
hàK-V£-(r)i |
güb-ne-ft |
guu-na- |
ster-ni-t |
str-na-ti * ■ |
tiaf-nê-’ |
|
güb-ne-vê |
gdu-na-wa |
m A f 0 str-ni-vas | |||
|
hâx-ve-rov |
güb-ne-ta |
gâu-na-ta |
n * ' ' str-ni-iàs * * | ||
|
htXK-VS-TOV |
gub-ne-ia |
gâu-na-' |
« * « * * » f | • |
str-nî-tâs | |
|
<$âx-V0'(JL2V |
güb-ne-mü |
gâu-na-me |
ster-ni-mus |
str-nî-mâs • * |
Uar-ne-mq |
|
ààx-ve-re |
güb-ne-te |
gâu-na-te |
ster-ni-lis |
str-nî-tâ a * |
Uar-nè-q |
|
hâx-vo-vri |
güb-nu-iüï |
gàti-nctr’ |
ster-nu-nt |
str-nà-nti * • |
Uar-ne-n. |
S 498. Caractéristique Te, toen grec. — Verbes de même formation
en latin.
Gomment faut-il expliquer, en grec, les syllabes Te, to (tutt-To-jütev, Tü7T-re-Te), qui, hormis dans t/xtoj, di'tmw, dptÎT«y, se trouvent toujours après une labiale? Peut-être ce t est-il l’altération d’un v : nous avons déjà vu une muette sortir de la nasale de même organe, par exemple dans /3poT<5$, venant de fjLporis^ dans le lithuanien dewynï «neuf», pour nernjnl, et le slave devantï (même sens), pour nevahtl (S 317). Un exemple moins éloigné, c’est, en grec, le suffixe formatif par, auquel correspond, en sanscrit et dans les langues congénères, un suffixe finissant par n; comparez o-vouolt avec le sanscrit nâman, le latin nômin, le gothique naman et le slave imen. En sanscrit également on peut noter le changement d’un n en t : de la racine hm «tuer» vient le causatif gât-di/â-mi (pour hân-dyâ-mi).
Si donc le t de tu7t-to-(tev, xpvn-ro-psv tient la place d’un r, ces verbes appartiendront, comme les verbes en vo-fjlsv, ps-ts, a
1 Voyez S 436, t.
2 Au sujet de Taccent, voyez S 493, et Système comparatif d’accentuation , S f»6.
la neuvième classe1. Mais si ce t ne provient pas d’une altération, il faudra, conformément à 1 explication donnée plus haut (S /t95), rapporter les syllabes Te, to au thème pronominal to = sanscrit VT ta (§ 343).
Comme analogues de r/a-ra, le latin nous présente les verbes m-to, pec-to, plec-to, Jlec-to.
§ 499. Caractéristique ta, en lithuanien.
Le lithuanien nous présente aussi des verbes qui, aux formes spéciales, insèrent, comme tv7t1ù) en grec, un t suivi d’une voyelle entre la racine et la désinence personnelle. Tels sont : Mÿs-tu rj’erre» (par euphonie pour klÿd-tu, S io3), pluriel khjs-tn-me, aoriste klyd-au, futur kby-siu; plus-tu (pour plud-tu) «je nage», pluriel plûs-ta-me, aoristeplûd-au; los-tu «iascivio», pluriel los-ta-me, aoriste Us-an; mirs-tu «j’oublie», pluriel mirs-ta-me, aoriste mirs-aû; ils-tù «je me fatigue», pluriel lls-ta-me, aoriste ils-aü, futur U-siu. Après une gutturale, une labiale ou une liquide, on prépose encore un s euphonique devant le t2; exemples ; alk-stu «j ai faim », aoriste âlk-au; dyg-stu «je germe », aoriste dÿg-au; süp-stu «je m’affaiblis», aoristesilp-au; pra-kalb-atu «je commence à parler», aoriste pra-kaïb-au; pa-mil-stu «je commence à aimer», aoriste pa-mü-au; rhn-stu «je me calme», aoriste rim-aü; pa-twm-stu «je me gonfle», aoriste pa-twin-au; mir-êtu «je meurs», aoriste miriaû.
On prépose aussi, dans quelques verbes, un s euphonique (levant un t radical; exemples : kaistà «je m’échauffe», aoriste kaitaü, de la racine kait; gelstu «je jaunis», de la racine gelt. On ne peut donc pas compter ces verbes parmi ceux qui adjoignent un t à la racine, à moins qu’on n admette que le s de katstà soit la transformation euphonique du t radical.
‘ Voyez S 109 % 5.
* Sdileicher, Grammaire lithuanienne, p. 2/18,
S 5oo. Origine de la caractéristique a.
Je crois qu’il faut également attribuer une origine pronominale à cette voyelle a qui sert de caractéristique aux verbes de la première et de la sixième classe, et qui se retrouve en grec sous la forme o, e, dans les verbes comme i>, (pép-e-re.
C’est à tort, selon moi, qu’on l’appelle une voyelle de liaison. Aucune autre caractéristique ne se laisse ramener plus aisément à un thème pronominal; nous avons le thème a qui fait a-m& au datif, a-smât à l’ablatif, a-syd au génitif et a-smin au locatif (§ 366). L’a étant la plus pesante des trois voyelles fondamentales, c’est la moins propre à servir de voyelle de liaison.
Je ne crois pas, d’ailleurs, qu’on doive rapporter l’origine des voyelles euphoniques au temps reculé où les idiomes européens ne s’étaient pas encore détachés du sanscrit; c’est dans les périodes d’affaiblissement que les voyelles euphoniques se glissent entre deux consonnes pour faciliter la prononciation. Or, nous voyons que ce w a se retrouve dans toutes les langues indo-européennes : en gothique, nous avons a ou i, en grec o ou e, en ancien slave € e, en lithuanien a et en latin i1. On peut comparer le sanscritvdh-a-tas «vous transportez tous deux 7) au gothique vig-a-ts, au grec %-e-rov, à l’ancien slave E£3£T4 ves-e-ta, au lithuanien wêz-a-ta; et le sanscrit vdh~ a4a au grec ë%-e-Te, à l’ancien slave EC3£T€ ves-e-te, au lithuanien wez-a-te, au latin veh-i-tis, au gothique vig-i-th.
J1 en est tout autrement pour les voyelles de liaison. Ainsi l’i, la plus légère des voyelles fondamentales, s’insère au futur auxiliaire sanscrit : mais cet i ne se retrouve pas dans les langues congénères; aussi devrons-nous placer la date de son insertion après la séparation des idiomes. En zend, nous voyons certaines
t
Voyez S loya, i.
voyelles de liaison naître en quelque sorte sous nos yeux : on les voit s’introduire entre deux consonnes qui, à une époque plus ancienne, étaient encore jointes ensemble; mais, en pareil cas, ce n’est jamais un a, c’est un j ë (§ 3o) ou un i qui servent de voyelle euphonique. Ainsi dans us-ë-hista ou us-i-hista «lève-toi», une voyelle de liaison ë ou % a été insérée entre la préposition et le verbe; mais le sanscrit ne prend point part à cette insertion.
5 5oi. Origine des caractéristiques ya et aya. — La caractéristique ya
en latin et en lithuanien.
Dans les caractéristiques ^ya (quatrième classe) et aya (dixième classe), je crois quil faut voir des verbes auxiliaires1. La caractéristique Tf ya sert également pour le passif. Quand nous traiterons du passif, nous reviendrons sur ce sujet190 191.
Il a déjà été question 192 de la manière dont le ya sanscrit est représenté dans les langues germaniques, en grec, en latin et en lithuanien. Ajoutons ici que le latin, quand deux i se rencontrent, supprime l’un des deux; il fait cup-i-s, pour cup-ii-s, qui lui-même est pour cup-ji-s = sanscrit küp-ya-sù De même, il contracte deux i dans cup-i-t, cup-i-mus, cup-i-üs. Mais il n’y a pas contraction dans cup-io = sanscrit küp-yâ-mi, dans cup-iu-nt = kup-ya-nti.
En lithuanien, les verbes sanscrits de la quatrième classe sont représentés par ceux d’entre les verbes en ju ou en ia qui, à la première personne de l’aoriste, adjoignent immédiatement au à la racine. Il n’y en a qu’un petit nombre; leur racine est presque toujours terminée par d, ce qui fait qu’au présent ils ont di (par euphonie pour dj). Un exemple de racine Unissant par un b est gnybju «je pince » knybau1 ).
(aoriste
On peut comparer :
|
Sanscrit. |
Lithuanien. |
Gothique. |
Latin. |
|
lùb-yâ-mi2 |
gnyb-ju |
haf-ja- 3 |
cap-io- |
|
lub-ya-si |
gmfb-i |
kaf-ji-s |
cap-i-s |
|
luB-ya-ti |
gmjb-ja- |
haf-ji-th |
cap-l-t |
|
Ub-yâ-vas |
gnyb-ja-wa |
haf-jôs 4 | |
|
lub-ya-tas |
gnÿb-ja-ta |
haf-ja-ls | |
|
iùb-ya-tas |
guÿb-ja- | ||
|
tiib-yâ-inas |
gnÿb-ja-me |
haf-ja-m |
cap-i-mus |
|
Inb-ya-la |
gmjb-ja-te |
haf-ji-th |
cap-i-tis |
|
lüb-ya-nli |
gnyb-ja-’ |
haf-ja-nd |
cap-iu-nt. |
S 5oa. Du j dans les verbes comme bijuh, en ancien slave.
L’ancien slave possède un petit nombre de racines finissant par une voyelle, dont le présent est en uhju-h, je-êi, etc. On pourrait, comme il a été dit plus haut (§109% 2), ranger ces verbes dans la quatrième classe sanscrite. Miklosich5, au contraire, regarde le j comme une lettre euphonique insérée pour éviter l’hiatus; il divise ainsi : bi-j-uh «je frappe», bi-j-esi, etc. L’opinion qui me paraît maintenant la plus vraisemblable, cest que le j appartient à la racine; je divise : bij-u-h, bij-e-k, bij-e-tï ® d’après l’analogie des racines sanscrites en », comme n
> Voyez Kurschat, Mémoires pour servir à la connaissance de la langue htbua-
nieime, II, p. _ <
s «Je désire». Comparez le lalin lubet, libet, le gothique liubs «cher».
> Le gothique haf-ja, en allemand moderne hebe «je soulève», a la même racine que le laün copia. L’aspect différent des deus mots est dû à la substitution des consonnes (S 87, 1).
4 Venant de haf-ju-vas (S Uk 1).
5 Théorie des formes, S 163.
« Comparez Schleicher, Théorie des formes du slave ecclésiastique, p. 7^ el 39 ‘
? aller», pi (même sens), qui font riy-d-ti, piy-à-U1. D’après le même principe, le gothique forme du thème numéral thri et du thème pronominal * les pluriels neutres thrij-a, ij-a (§ aBa) et le génitif thrij-ê. Le pâli met partout T^iy, au lieu d’un simple y, devant les désinences casuelles commençant par une voyelle r§ 202). L’ancien slave fait de même dans les formes comme gostij-u (génitif-locatif duel), goslÿ-e (nominatif pluriel), pour gostj-u, gostj-e (§ 374). Il est donc naturel de supposer que dans bijuii, bijeü, le j représente 11 radical, et que 11 est un surcroît euphonique destiné à aider la prononciation.
Les formes de présent comme bij-u-ii, bij-e-êi, bij-e-d sont, è ce qu’il paraît, rarement employées en ancien slave; mais le témoignage des dialectes modernes nous autorise a affirmer leur existence 193 194. Je fais suivre le tableau du présent de la racine sanscrite ri (sixième classe) «aller», et je place en regard celui de l’ancien slave bi «frapper»195 :
SINGULIER.
DUEL.
PLURIEL.
Sanscrit. Ancien slave. riy-a-mi bij-u-n riy-â-si bij-e-êi
Sanscrit. Ancien slave. riy-a-üas bij-e-vê riy-à-las bij-e-ta riii-n-tns bii-e-id
Sanscrit. Ancien slave,
riy-a-vias bij-e-mü
riy-â-'ta bij-e-te
riy-â-nti bij-u-ntï.
S 5o3. Racines slaves en u, en ü et en ê.
Les racines slaves en u1 suivent la première classe sanscrite : elles frappent la voyelle radicale du gouna, de sorte que Yu devient ov, qui répond au sanscrit av. De même que nous avons eu dans la déclinaison (§ 2 7 4) sünov-e, en regard du sanscrit sûnâv-as «filii»196 197, de même nous avons slov-u-h «j’entends», slov-e-si «tu entends»; la racine sanscrite ^ sru «entendre», si elle était de la première classe, ferait s'rdv-â-mi, srdv-a-si, En grec, le verbe congénère xXvù) est de la sixième classe : d’après la première, il ferait xké& (pour xXéFcj), comme nous avons péoi (pour péFù)) en regard du sanscrit srâv-â-mi (racine sru «couler»). La racine sanscrite ru «résonner», qui fait au moyen rdv-êy râv-a-sê, et d’où dérive le substantif râva-s «bruit», a donné en slave le verbe pio rju «mugir», qui fait pcea rev-u-ii198 199, rev-e-si, etc. en slovène rev-e-m, rev-e-s.
Il y a des racines en si ü qui font au présent üjuh, üjcsi, etc. Nous avons, par exemple, msii*müjuh «je lave», mSKiim müj-es-i « tu laves », etc. Mais il faut considérer que si est pour ui : l’t contenu dans cette voyelle s’est élargi en ij, de sorte que müj-u-h, müj-e-si, müj-e-tï s’accordent avec les formes sanscrites comme riy-â-mi, riy-d-si, riy-â-ti. Il en est probablement de même pour le j des racines en n ê, telles que sêj-u-n «je sème », sêj-e-si, sêj-e-UK Cet ê est ordinairement, comme en sanscrit, la contraction de ai (S 92 e) : on peut donc supposer que Yi renfermé dans les formes comme sêj-u-n (plus anciennement saij-u-ii) a donné naissance au j. Si pourtant ce j était une insertion euphonique,
on pourrait le rapprocher du y qui est inséré, en sanscrit, entre l’ê du potentiel et les désinences commençant par une voyelle (S 689). Le j de snajuh «je sais» est dû peut-être à lana-logie des verbes en aju-h, aje-si, qui correspondent aux verbes sanscrits en ayâ-mi, aya-si (dixième classe).
§ 50A. Verbes de la dixième classe en ancien slave.
La dixième classe sanscrite *, à laquelle appartiennent tous les verbes causatifs et beaucoup de verbes dénominatifs, s’est scmdee dans 1 ancien slave en cinq groupes Le premier est formé par ceux qui ont aj-ü-h, aje-si, aje-tï, en regard du sanscrit ayâ-mi, aya-si, aya-ti3. Hors des formes spéciales, le sanscrit 1 énoncé a 1 a final de la caractéristique ayai le slave a simplement un a. Au supin, par exemple, nous avons rüd-a-iü en regard de l’infinitif sanscrit rôd-dy-i-ium4 «faire pleurer». On peut comparer cet a avec la, Yv et Ycj de la deuxième série de temps des verbes grecs en ocu, eew, ow (pour ajoj, sjv, o/co)5 : rapprochez, par exemple, les aoristes slaves comme psiAdxs rüd-a-chü des aoristes grecs comme êÇc6p~â-<ra, ê®t\-tj-craù.
Le deuxième groupe7 a changé, dans les formes spéciales, le ^ aya sanscrit en uk $e8; il contracte le ^\ay des formes générales en n ê (= ai). Cet ê répond donc à Yê de la deuxième conjugaison latine, à Yê vieux haut-aïlemand et à Yai gothique
1 Voyez S 109°, 6.
2 Nous faisons abstraction ici des verbes à conjugaison mixte (S 5o5).
3 V°yez la conjugaison complète du présent, 5 109% 6.
' L’t est une voyelle de liaison, comme dans rôd-ay-i-sya-mi.
A Voyez S 109“, 6.
" Au sujet du X eh slave tenant la place d’un s, voyez S 99fr.
7 Voyez Miklosich, S 193 et suiv.
8 Au lieu d’un e, nous trouvons toujours an u devant la nasale faible », à h pre
mière personne du singulier et à la troisième personne du pluriel ; et un a au participe présent, en admettant que A soit vraiment,=an (S 92a). Pour le./ de«/W*, hlêje-èi. voyez ce qui a été dit plus haut (S 5o3) de sëpn. sejesi. • • 116
de la troisième conjugaison faible, enfin à l’d prâcrit de la dixième classe et de la forme caasaiive \ Les infinitifs prâcrits comme cint-ê-duii (= sanscrit cint-âyd-tum) répondent aux supins slaves comme /KéA'Bts éel-ê-tü.
Le troisième groupe2 a contracté, dans les formes spéciales, aya en i. Il faut excepter la première personne du singulier, qui fait g* ju-h (= sanscrit nyâ-mi), la troisième personne du pluriel, qui fait ATt antï (pour jahü = sanscrit ayanti), et le participe présent qui fait, au nominatif singulier masculin, a ah (pour jan = sanscrit ayan). Le verbe ropi* gor-ju-n «ardeo», pris par Miklosich comme modèle de ce groupe, répond au sanscrit gâr-âyâ-mi, venant de la racine gar, gr «briller»3. Je fais suivre le présent complet du verbe slave :
Singulier. Duel. Pluriel.
gor-ju-h gor-i-vê gor-i-mù .
gor-i-êi gor-i-ta gor-i-te
gor-i-tï gor-i-ta gor-a-htï.
La contraction de aya en i peut se comparer à la contraction latine en î9 i, dans aud-î-s, audr-i-tf aud-î-mus, aud-î-tis, ou à la contraction deja en i dans les prétérits gothiques de la première conjugaison faible, tels que sat-i-da «je plaçai», littéralement «je fis asseoir»4, sat-d-ths (thème sat-i-da} «placé». Dans les formes générales, le ay sanscrit s’est contracté en ê, comme dans le deuxième groupe. On a, par exemple, l’aoriste gor-ê-chü, l’infinitif gor-ê-ti, le supin gor-ê-tü.
Le quatrième groupe5 contracte en i le aya sanscrit des formes
1 Voyez S 109“, 6.
2 Voyez Miklosich, S 198 et suiv.
3 La racinegar avait sans doute aussi, à l'origine, le sens de «brûler r. La forme gârâyâmi appartient à la dixième classe : peut-être est-ce un causatif.
* Voyez S 6s3.
5 Voyez Miklosich, S 207 et suiv.
spéciales, comme le ay des formes générales. Les exceptions sont les mêmes que dans le troisième groupe : on a donc XKdAkft chval-ju-h * je loue»1, clwal-i-si, chval-i-tï, chval-a-iitï; aoriste chval-i-chü; infinitif chval-i-ti; supin chval-i-tü.
Le cinquième groupe présente k je dans les formes spéciales (devant n, je devient ju onja), et a dans les formes générales2. Qn a donc opm or-jw^i «je laboure» (en latin aro, en grec dpow), or-je-êi, or-je-iï; au participe présent, opt* or-ja-ii; à l’aoriste, optixs or-a-chü; à l’infinitif, or-a-ti; au supin, or-a-tü. Cette classe de conjugaison s’accorde le mieux, au présent, avec les verbes gothiques de la première conjugaison faible, comme nas~ja, nas-ji-s, nas-ji-th, nas-ja-nd, participe présent nas-ja-nds. On peut également rapporter ici les verbes finissant par une voyelle3, comme plju «spuere» = sanscrit plu «couler»4. Plju a inséré devant son u radical un j inorganique5: il devient plïv devant les formes commençant par un a. Nous avons, par exemple, l’aoriste plïv-a-ch-ü, l’infinitif plïv-a-ti; au contraire, le présent est plju-ju-h, pljürjs-si, plju-je-ii (et non plju-j-uii, etc.). Quand la racine a*6 dê «faire » est conjuguée d’après cette classe, il faut diviser au présent dê-jur-ii, dê-je-si, dê-jc-tï, mais à l’aoriste dêj-a-chü.
1 Ce verbe se rapporte probablement à la racine sanscrite svar «briller» (comparez le substantif svàr «ciel»), qui s’est contractée en sur. Par un changement de sens analogue, nous avons en gothique le verbe has-ja «je loue», qui se rapporte à la racine sanscrite kâs «briller». Le sens propre est donc «faire briller».
* Le j des formes spéciales disparaît dans certaines positions, en vertu des lois phoniques de l’ancien slave. Nous avons, par exemple, pisûn (pour pisjun) «j’écris», de la racine pis. En sanscrit, pii signiüe «écraser»; de là, sans doute, le sens de «graver» : le verbe slave se rattache au causatif pês-ûyà-mi. L’expression perse signifiant «écrire» est empruntée à la même racine précédée de la préposition ni.
3 Ces verbes forment, chez Miklosich, le quatrième groupe de la cinquième conjugaison (8 a3A).
4 Cette racine a pris en slave, dans celte conjugaison, le sens causatif «faire couler».
5 Comparez plus haut (S 5o3) rju = sanscrit rit.
§ 5o5. Verbes slaves à métathèse ou à conjugaison mixte.
Quelques verbes à racine finissant par une liquide opèrent une métathèse. Dans les formes spéciales, ils suivent la première classe sanscrite, et ont e ou u (pour a) comme voyelle caractéristique1. Mais dans la seconde série de temps, ils font passer la voyelle radicale, sous la forme d’un a, du milieu à la fin de la racine. Telle est du moins l’explication que je crois la plus vraisemblable pour cette double série de formes : ber-u-h «j’assemble », ber-e-si, ber-e-tï, ber-e-vê, etc. (= sanscrit Bâr-â-mit Eâr-a-si, Bâr-a-ti, Mr-â-vas, etc.); et, d’autre part, l’aoriste bra-chu, l’infinitif hra-ti, le supin bra-tü. Des métathèses analogues ont lieu en grec et en latin, et Te cède pareillement la place à l’ancien a; exemples : en grec iSpotx-o-v, Spaxé5^ à côté de Sspxù), <$£p§s>2; en latin strâ-vi, strâ-tum, à côté de ster-no ( sanscrit star, str « répandre »). Comme ber-u-h se conjuguent, en ancien slave, der-u-h «je fends», der-e-si, etc. (= sanscrit dâr-â-mi, ddr-a-sif grec Sépct), gothique ga-taira, ga-tair-i-s), aoriste dra-chu; per-a-n «je foule», per-e-éi, etc. aoriste pra-chü; sen-u-h3 «je pousse», sen-e-êi, etc. aoriste gna-elm.
Mais si cette explication n’est pas fondée et si les verbes en question n’ont pas opéré de métathèse, les formes comme brachü, brati, bratü devront se diviser de cette façon : hr-a-chü, br-a-ti, br-a-tü (pour ber-a-chü, etc.), et il faudra admettre une conjugaison mixte. Va de br-a-chü devra alors être identifié avec la caractéristique sanscrite «y4, et, par conséquent, aussi avec Yâ
1 Vu devant ».
2 En sanscrit, la racine doré, dré (venant de dark) «voir» opère également la métathèse de av en ra; par exemple, au futur, drakéySmi pour davkâyâ'mi. H en est de même pour quelques autres racines renfermant un ar ou un r médian. Voyez Abrégé de la grammaire sanscrite, S 3à b.
3 Le s est le remplaçant euphonique d’un g (S 92 *).
'* A y est la caractéristique des temps généraux, aya celle des temps spéciaux.
de la première conjugaison latine (am-â-s, am-â-bo) et avec l’o gothique de salb-â> prétérit salb-ô-da. Il est certain que pour quelques verbes slaves on ne peut se dispenser d'admettre une conjugaison mixte. Ainsi le verbe sûs-u-n «je tette » (süs-e-si, süs-c-tï) a dans ses formes spéciales la caractéristique de la première ou de la sixième classe sanscrite1 ; mais par son aoriste süs-a-chü et par ses autres formes, il appartient à la dixième classe. On peut comparer, à cet égard, dans la conjugaison germanique, certains verbes irréguliers qui appartiennent, par leur présent et par les temps qui en dépendent, à la conjugaison forte (c’est-à-dire à la première classe sanscrite), et, par leur prétérit, à la conjugaison faible : ainsi le présent gothique bringa «j’apporte?» (racine brang) devrait faire au prétérit, d’après la conjugaison forte, brang; mais il fait brah-ta, c’est-à-dire qu’il s’adjoint, comme les verbes faibles, un verbe auxiliaire (S 620 et suiv.) signifiant «faire»200 201.
S 5o6. Verbes lithuaniens à conjugaison mixte. — Verbes lithuaniens
de la dixième classe.
En lithuanien, il y a beaucoup de verbes à conjugaison mixte, cest-à-dire appartenant par leurs temps spéciaux à la première classe sanscrite ou conjugaison forte des langues germaniques, et par leur aoriste à la dixième classe sanscrite ou conjugaison faible de l’allemand. Je veux parler des verbes qui, à la première personne du singulier, ont simplement un u après la consonne finale de la racine, et, au pluriel, a-me, mais qui terminent leur aoriste soit en ia-u, pluriel ê-me, soit en êja-u, pluriel êjë-me, soit en ôja-u, pluriel ojô-me. Exemples : mal-u «je mouds», aoriste mal-ia~û, pluriel mal-ê-me; zad-ù «je promets»1, aoriste zad-éja-u, pluriel zad-ejô-me, infinitif zad-ê-ti; ged-u «je chante [des cantiques] » 2, aoriste gêd-oja-u, pluriel gëd-ojô-me, futur gëd-6-siu. L’aoriste de ces verbes ferait attendre des présents en tu, ëju, ôju.
Abstraction faite de ces verbes à conjugaison mixte, la dixième classe ou forme causative s’est scindée en sept groupes au moins. Le premier, qui est le mieux conservé, comprend les verbes comme raud-oj-u, pluriel raud-oja-me3, aoriste raud-oja-u, futur raud-6-siu, infinitif raud-Ô-ti4. En lette, ïa qui précède le j reste bref : raud-aj-u «je pleure »5, pluriel raud-aja-m., prétérit raid-aja, pluriel raud-aja-m, futur raud-a-éu, infinitif raud-â-tK Ha des deux dernières formes et l’o des formes lithuaniennes analogues représente le WS^ay des temps généraux en sanscrit.
Le deuxième groupe a partout un ê, qui est probablement l’altération d’un à long7. Comme exemple, nous citerons klyd-eju «j’erre » 8, aoriste klydejaufutur klyd-ê-siu, infinitif Myd-ê-tL
Le troisième groupe ne s’éloigne du deuxième qu’au présent et au participe qui en dérive : il y contracte aya en u Exemple : mÿliu «j’aime», duel mÿl-i-wa, mÿl-i-ta, pluriel mÿl-i-me, myl-i-te, aoriste mÿl-eja-u, futur mÿl-c-siii, infinitif mÿl-e-ti.
1 En sanscrit, racine gad «parler», causatif gâdâyâmi.
2 Gédu se rattache comme zadù au causatif précité gâdâyâmi.
3 Voyez S ioga, 6.
4 Comparez, en slave, les verbes en aju-n (S 5o4). Au sujet de ta longue ô, en lithuanien, voyez ci-dessus, 1.1, p. 367, note 3.
5 En sanscrit rod-âyà-tni (pour raud-ayâ-tni) «je fais pleurer».
* On écrit raudaht; ah est pour â.
7 C’est ainsi que Vê de la racine dë «coucher» (première personne dé-mi) répond évidemment à Ta du sanscrit UT da «poser».
8 Le lithuanien a aussi le verbe klystu (venant de klyd-tu, S io3), qui a le même sens : aoriste klijdau. Klydéju est donc, en quelque sorte, la forme causative de klystu.
9 A la deuxième personne, nous avons klyd-éjei au lieu de klyd-éjai, à cause duj (S 93 k). Sauf cette différence, les aoristes en ëjau se conjuguent comme ceux en
Le quatrième groupe a au présent ju ou iu, au pluriel ja-me ou ta-nie, à l’aoriste ja-w ou tau, au pluriel jô-me ou iô-me; mais il forme le futur et l’infinitif immédiatement de la racine, peut-être par suite d’une mutilation. Exemples : lëp-jù1 «je commande», pluriel Up-ja-me, aoriste lëp-ja-ù, pluriel lép-jô-me, futur Up-$iu, infinitif lép-tL Rem-jit, «je soutiens » 2, pluriel rèm-ja-nic, aoriste rem-ja-ü, futur rèm-siu, infinitif rèm-tL Baudziù «je châtie»3 (par euphonie pour baudju), aoriste baadziaù, futur bau-siu, infinitif baus-ti. Plâvr-ju «je lave»4, aoriste plovo-iau, futur pldu-siu, infinitif plâu-tL
Le cinquième groupe contient des verbes en iju, aoriste ijau, futur i-siu, infinitif i-ti 5. Je regarde cet i, tant dans les formes spéciales que dans les formes générales, comme un affaiblissement de Ya initial de aya, '3RT «y. A ce groupe appartiennent zyw-iju «je rafraîchis» = sanscrit gîv-dyâ-mi «je fais vivre»; zwân-iju «je sonne [les cloches] » = sanscrit svan-dyâ-mi «je fais résonner»; lüb-iju «j’aime»6 = sanscrit loB-dyâ-mi (racine lui)) «j’invite à l’amour, j’excite ».
Le sixième groupe7 présente la caractéristique sanscrite aya sous cinq formes différentes, savoir : a8 à la première et à la deuxième personne du singulier du présent et au participe qui
1 Sanscrit lap «parier», causatif lâp-âyâ-mi.
a Comparez le sanscrit à-ram-ayâ-mi «je fais reposer». A la racine ram appartient aussi le lithuanien rhnttu «je me calme» (S /199). Au composé â-ram se rapporte le grec tipépa, ijpefios. Voyez Glossaire sanscrit, p. 387.
3 Signifie aussi, d'après Nesselmann (Dictionnaire, p. 334), «avertir, stimuler». U répond bien au causatif sanscrit bôd&yâmi (racine èutf « savoir») «je fais savoir».
4 Comparez le sanscrit pluv-âyâ-mi «je fais couler», causatif de la racine plu «couler», à laquelle appartient, entre autres, le grec ©Àu-rw. Voyez Glossaire sanscrit^. a3ù.
5 Voyez Kurschat, Mémoires pour servir à la connaissance de la langue lithuanienne, H,p. 199.
6 Pour la signification, voyez le Dictionnaire de Nesselmann.
7 C'est la deuxième conjugaison de Mielcke.
* Ainsi l’on a laik-aWi«je tiens», laik-a-t (8 k36, 1), lâik-a: laik-a-ns «tenant».
en dérive; ô dans les autres personnes du présent (lâik-ô-wa, ldik-0-ta; Mih-ô-me, Idik-ô-te); ia à la première personne du singulier de l’aoriste (laik-ia-u «je tins»); ie1 à la deuxième et ê à toutes les autres ( laik-ë-wa, Idik-ë-ta, lâik-ê-me, ldik-ë-te)2. On peut comparer lo de Mik-ô-wa, Idik-ô-me avec Yô gothique de la deuxième conjugaison faible (salb-ô-s, salb-ô-m) et avec la latin de am-â-nms (§ ioqa, 6}. Rapprochez aussi:
|
Lithuanien. |
Gothique. |
Sanscrit. | |
|
Singulier. |
laii-a-û «je lèche» |
laig-ô |
îêh-dyâ-mi3 |
|
Duel.... |
lâizr-ô-wa |
laig-ô-s |
lêh-âyâ-vas |
|
Pluriel. . |
làii-Ô-me |
laig-ô-m |
lêh-âyu-mas. |
Dans les formes générales, la classe de conjugaison en question représente le ay sanscrit par y (prononcez t); exemple : laiz^y-siu = sanscrit lêh-ay-i-sydmi 4. On peut rapprocher de ce y Fî du latin audr-î-s, aud-t-mus, aud-î-tis, aud-î-tum (§ iog\ 6); j’y vois la vocalisation de la semi-voyelle sanscrite ^y.
Le septième groupe5 s’accorde avec le sixième au présent et aux formes qui en dépendent. Mais partout ailleurs il suit l’analogie de raudoju 6. Exemple : rÿm-a-u «je reste appuyé », aoriste rÿm-ôja~u, pluriel rÿm-ôja-me1, futur rym-ô-siu, infinitif rym-Ô-ti
1 Lmk-ie~i «tu tins». De même, dans tons les autres groupes, nous trouvons à Faoriste une opposition entre la première et la deuxième personne : en regard de Fa de la diphthongue au vient se placer un e> lequel provient probablement de l'a par l'influence euphonique de Ft précédent (S 92k).
* D'après l'analogie des verbes en ëj*-u (voyez ci-dessus, p. 1 ao).
3 «Je fais lécher», de la racine lih, qui fait au présent U'h-mi «je lèche», duel lih-vât, pluriel lih-mâs.
4 Nous citons le futur, parce que l'aoriste, dans les verbes lithuaniens de la dixième classe, n'appartient pas aux temps généraux.
6 C'est la quatrième conjugaison de Mielcke, avec jÜhau «je cherche» pour modèle (sixième classe de Schleicher).
0 Voyez ci-dessus, p. fso.
7 Comparez l'imparfait sanscrit â-râm-ayâ-ma «nous Ames reposer» (pour A-arâmayâtna), de la racine ram «reposer» précédée du préfixe d.
FORMATION DES TEMPS.
PRESENT.
S 507. Formation du présent.
Le langage n’a pas besoin d’un exposant spécial pour marquer le présent : celui-ci est suffisamment indiqué du moment qu’il n’y a point de signe exprimant le passé ou le futur. Aussi le sanscrit et les idiomes congénères se contentent-ils, au présent, d’unir les désinences personnelles à la racine.
La flexion du présent se fait à l’aide des désinences primaires. La racine reçoit les élargissements qui caractérisent, dans les temps spéciaux, les différentes classes de conjugaison On peut comparer, comme exemple de la première conjugaison principale (§ 493), le sanscrit vâhâmi «.je transporte» avec les formes qui y correspondent dans les autres langues indo-européennes2 :
|
SINGULIER. | ||||
|
Sanscrit. |
Zend. |
Arménien. |
Grec. |
Latin. |
|
vâhrâ-mi 3 |
vas-âmi a |
was-e-m a |
bt-®-’ |
veh-o- |
|
vâh-a-si |
vas-a-hi • |
was-e-s a |
** A |
veh-i-s5 |
|
vâk-a-ti • |
vas-ai-ti * |
was-ê- « |
éx-e-(r)t |
veh-i-t |
1 Voyez SS 109* et 693.
2 L’arménien ^utqÈrtT was-e-m «je cours» me paraît être le congénère du sanscrit vâh-ârtni. Tous deux impliquent l’idée du mouvement. Le qj est, comme le J, s zend, le représentant ordinaire du ^ A sanscrit. Bottîcher rapproche mas de la racine sanscrite vag «aller» (Journal de la Société orientale allemande, t.IV, p. 36a) : on a vu, en effet (S i83b, 2), que le g sanscrit est quelquefois représenté en arménien par un #. Mais il serait surprenant que l’arménien eût perdu la racine cTç» vah, qu’on retrouve dans toutes les langues de la famille.
3 Sur l’allongement de Yâ, voyez S 434.
4 Voyez S 4A8.
■’ En latin, l’affaiblissement de la caractéristique a en i est presque constant; t*n gothique, il n’a lieu que devants et th. Voyez SS 67 et 109", 1.
|
Sanscrit. vâh-â-vas |
Gothique. vig-a- vig-i-s vig-i-ih Zend. |
Lithuanien. wez-ii1 f 1 î wez-i1 wez-a- DUEL. Arménien. |
Ancien slave. ves-u-h • ves-e-êi • ves-e-tï • Grec, |
Latin. |
|
» vâhr-a-ïas • |
vas-a-îô ? m |
* » t • • « • » |
é%-eT-ov3 | |
|
vâh-a-tas |
vas-a-tô |
éy-s-TOV | ||
|
m Gothique. |
Lithuanien. |
Ancien slave. | ||
|
* Ah |
i r |
A | ||
|
Vtg-OS |
wez-a-wa |
ves-e-ve • | ||
|
vîg-a-ts |
wez-a-ta |
ves-e-ta « | ||
|
& |
ves-e-ta * | |||
|
PLURIEL. | ||||
|
Sanscrit. |
Zend. |
Arménien. |
Grec. |
Laliu. |
|
vâh-â-mas • |
vas-â-mahi0 • |
é%-o-(ies |
veh-i-mus | |
|
vâh-a-ta * |
vas-ûrhi m |
was-e-q* |
é^-e-re |
veh-i-tis |
|
vah-a-nli206 |
vas-ë-nli * |
mas-e-n |
é%-0~VTi |
veh-u-nt |
|
Gothique. |
Lithuanien. |
Ancien slave. | ||
|
vig-a-m |
weé-a-me |
ves-e-me • | ||
|
vig-i-lk |
wêz-a-te |
ves-e-te • | ||
|
vig-a-nd |
ves-u-htt. m |
cipale, fTRdlfa tîMâmi «je suis débouta mérite un examen particulier. 11 vient de la racine stâ et appartient proprement à la troisième classe, qui prend le redoublement207. Mais il s’en éloigne en ce qu’il abrège son â radical dans les temps spéciaux 2, et en ce qu’il prend un i, au lieu d’un a, dans la syllabe réduplica-dve. De là les formes tista-si «tu es debout», tiêia-ti «il est debout », au lieu de tas 'tâ-si, tasiâ-ti, ainsi quon devrait s y attendre d’après l’analogie de dddâ-si, dddâ-ti. Comme l’a (devenu bref) de stâ est traité exactement de la même manière que la caractéristique a de la première classe, comme d’ailleurs l’accent reste toujours sur la syllabe initiale3, les grammairiens indiens ont rangé stâ parmi les racines de la première classe; ils divisent donc ainsi : tisi-a-si, üs'i-a-ti, en disant pour toute explication que tis\ s’est substitué à sia. Us expliquent de même le présent glgrâmi «je sens» de la racine grâ.
Le double affaiblissement que les formes comme tîsfa-si, gigra-si éprouvent dans leur syllabe réduplicative et dans leur syllabe radicale, est dû, je crois, aux deux consonnes initiales de stâ, grâ; la syllabe réduplicative se trouvant déjà longue par position, ces mots, pour ne pas prendre une pesanteur excessive, ont diminué le poids de la première voyelle et abrégé la seconde. Le zend histahi « tu es debout», histaiti «il est debout» obéit au même principe. Â cause de la surcharge produite par la syllabe réduplicative, le latin sistis, sistit, sistimus, sistitis a également affaibli l’d radical de stâ-re en i. Il en résulte que sistis a l’air d’appartenir à la troisième conjugaison; mais ce n’est là qu’une apparence, car Fi de sisti-s représente la radical de tté'ta-si, tandis que le signe distinctif de la troisième conjugaison, c’est l’insertion d’un i non radical entre la racine et. la
désinence personnelle. Le grec My-pu s’est mieux conservé, sous un rapport, que les formes correspondantes en sanscrit, en zend et en latin; malgré la syllabe réduplicative et les deux consonnes de la racine, il a maintenu longue la voyelle radicale; s’il l’abrége au duel et au pluriel, ainsi que dans tout le moyen, c’est en vertu d’une loi générale, que nous avons exposée plus haut (§ 48o et suiv.).
Le redoublement de tUtâmi est d’un genre particulier : il en sera traité plus tard (S 699 ). Contentons-nous ici de mentionner le latin testis, qui contient la même sorte de redoublement, en supposant que ce mot dérive, comme je le crois, de notre racine1.
S 609. Les racines M et as crêtre». — Autres racines remplissant le rôle
de verbe substantif.
Le sanscrit et la plupart des idiomes congénères ont deux racines pour le verbe substantif. L’une est en zend^ hû. Elle appartient à la première conjugaison principale (classe i) : elle prend, par conséquent, la caractéristique a dans les temps spéciaux, et frappe la voyelle radicale du gouna. L’autre est la racine qui appartient à la deuxième conjugaison princi
pale (classe a). En sanscrit et en zend, as ne s’est conservé, comme verbe isolé, que dans les temps spéciaux et au parfait : il est remplacé, aux autres temps, par M, qui a gardé sa conjugaison complète.
Dans la plupart des idiomes congénères, Sû et as sont défectifs et se complètent l’un l’autre. En lithuanien, la racine correspondant à as n’est usitée qu’au présent de l’indicatif et au participe présent; il en est de même en slave. Le gothique tire de as, dont il affaiblit Va en i, tout son présent de l’indicatif et
1 Testis serait celui qui se tient debout, qui se lève pour quelqu’un ou quelque chose. Dans steti, le rapport des deux premières syllabes est renversé.
du subjonctif; sij, qui est la racine apparente il’un certain nombre de formes *, dérive lui-même de as. La racine Bû, dans le sens de «être», manque tout à fait en gothique; elle a pris, dans cette langue, l’acception de «demeurer»208 209. Au contraire , le haut-allemand a gardé des restes de la racine ^ Bû avec le sens « être » : ce sont bi-m «je suis », bis ou bist « tu es », bir-u-mês «nous sommes», bir-u-t «vous êtes». D’autre part, is-t «il est» et s-i-nt «ils sont» 210 211 répondent à asti et sântl De as vient aussi le subjonctif $î «que je sois» (en sanscrit syâm ) et l’infinitif sîn «.être».
Outre les racines as et Bu, les langues germaniques ont aussi appelé au rôle de verbe substantif la racine sanscrite vas «demeurer». Le prétérit vas et son subjonctif vêsjauk, l’infinitif visan et le participe présent visands remplacent, en gothique, les formes qui manquent aux deux autres racines 212.
Nous rappellerons à ce propos deux autres racines qui peuvent remplir l’office de verbe substantif. Le sanscrit donne quelquefois à la racine stâ «se tenir debout» le sens abstrait «être»; il a donc en quelque sorte devancé les langues romanes, qui composèrent à l’aide des trois racines sta, es et fu la conjugaison de leur verbe substantif. On trouve aussi, en sanscrit, le verbe âs «être assis » employé dans l’acception abstraite « être ». Exemples : gatasattvâ{s) wâ ”satêG «dementes quasi sunt»; âyusmân âstâm ayam «longævus esto ille»1. Peut-être le verbe as n est-il lui-même qu’une abréviation de la racine as. Il est vraisemblable, en effet, que l’idée abstraite «être» n’a jamais été dans aucune langue le sens primitif d’un verbe. L’abréviation de âs en as, qui lui-même se réduit à un simple s devant les désinences pesantes (S 48o), s’expliquerait aisément dans un verbe si fréquemment employé : il est naturel qu’on cherche à alléger un mot dont on a besoin à tout instant.
La fréquence de l’emploi peut produire des effets de deux sortes. D’une part, le mot s’use, il se simplifie le plus qu’il est possible; mais, d’un autre coté, comme il est constamment prononcé, sa flexion, en s’imposant à la mémoire, échappe à la destruction. L’un et l’autre fait se vérifient pour le verbe substantif, car sum est en latin, avehjnguam, le seul verbe qui ait conservé son m au présent. De même, en gothique et jusque dans l’anglais et dans l’allemand d’aujourd’hui, le signe de la première personne du singulier et celui de la troisième personne du pluriel ont survécu dans les seules formes im, am, Irin (venant de bim) ^je suis» et dans sind «ils sont».
. S 5io. Présent du verbe Bu <rêtre».
La racine sanscrite fi# appartient à la première classe : elle prend, en conséquence, le gouna et insère la caractéristique a devant la désinence personnelle 2. A cause de cet a, Bâ (=* Bau) devient Bav, et c’est sous cette forme que nous trouvons la racine en question dans tous les temps spéciaux. Du sanscrit tiav, du zend bav, je rapproche le vieux haut-allemand bir (ou pir), dans bir-u-mês, bir-u-t, bir-u-n : nous avons déjà fait observer vant le système de transcription adopté par l’auteur, qu’une voyelle longue s’est combinée avec ta voyelle finale du mot précédent. ïvâ ”mte est pour ira àsatc. — Tr.]
1 Urvasî, édition Lenz, page 92, ligne 8.
2 Voyez S 109', i.
que les semi-voyelles permutent fréquemment entre elles et que notamment le v se change volontiers en rou en/1. Vu de bîr-u-mês, bir-u-t est un affaiblissement pour a (§ 7), et IV de la syllabe radicale bir est un autre affaiblissement encore plus fréquent de la même voyelle (§ 6). D’après l’analogie du pluriel, nous devrions avoir au singulier birum, birus, birut; mais la deuxième syllabe a été éliminée, de sorte que bim est avec Bdvâmi à peu près dans le même rapport que malo avec son primitif mavolo.
Les subjonctifs archaïques latins fuam, fuas, fuat, fuant supposent un indicatiffuo, fuis, fuit, qui sans doute a existé autrefois, et qui est au sanscrit Bdvâmi, Bdvasi, Bâvati ce que veho, velus, vehit est à vdhâmi, vâhasi, vdhati. D’un autre côté, le parfait archaïque fuvi suppose un présent fuvo, qui ressemble encore plus à Bdvâmi. Je regarde le v de fuvi comme étant sorti de Vu, par un développement analogue à celui qui nous a donné en sanscrit le parfait baBuva, l’aoriste àBûvam, et en lithuanien l’aoriste buwau213 214.
Je fais suivre le tableau comparatif du présent de la racine liû, en sanscrit, en zend, en vieux haut-allemand et en grec :
SINGULIER.
Sanscrit. Zend. Vieux haut-allemand. Grec.
bàv-â-mi bav-â-mi hi-m „
bàv-a-si bav-a-hi bi-s215 (pv-si-s
bdv-a-ti bav-ai-ti ....... ^v-e~(r)i
DUEL.
bav-â-vas ......................
Bav-a-tas bav-a-tô ? (pv-e-ror
Bâv-a-tas bav-a-tô ....... (fiv-s-vor
PLURIEL.
Sanscrit. Zend. Vieux haut-allemand. Grec.
bâv-â-mas bav-â-mahi bir-u-mês (pv-o-psç
bâv-a-ta bav-ar-ta bir-u-t @v-£-ts b'âv-a-nti bav-ai-nti ......1 Çv-o-vrt.
$ 5i 1. Présent du verbe as «être».
Il est inutile de donner ici un modèle de la deuxième conjugaison principale (la conjugaison en pu du grec). Nous en avons déjà donné plusieurs aux §§ 48o et suivants.
Nous placerons cependant ici le présent du verbe substantif, parce que ce verbe donne lieu à plusieurs observations en gothique. C’est le seul qui, dans cette langue, appartienne à la conjugaison en question. Nous plaçons en regard le présent sanscrit, zend et arménien du même verbe216 217.
SINGULIER.
|
Sanscrit. |
Zend. |
Arménien. |
Gothique. |
|
às-mi |
ah-mi |
e-m |
i-m |
|
d-si • |
a-hi |
C-S |
i-s |
|
ds-ti |
as-h |
A e |
is-t |
|
PLURIEL. | |||
|
s-mas |
k-mahi |
e-mq |
sij-u-m |
|
s-ta |
s-ta |
A C e-q |
sij-u-th |
|
s-â-nti |
h-ë-nti |
e-n |
s-i-ndo |
Remarque 1. — Le présent du verbe auxiliaire trêtre» en gothique. — On voit sans peine que les formes plurielles sij-u-m, sij-u-th ne joignent pas immédiatement les désinences personnelles à la racine : ces formes ne devraient donc pas, à la rigueur, figurer ici. On eu peut probablement dire autant de la deuxième personne du duel, dont il ne reste pas dexemple, mais qui serait sans doute sij-u-ts. La première personne du duel est sijû\
Quant à la syllabe «)'*, je ne crois pas qu’il faille lui attribuer une autre origine qu’à im (qui a perdu son s radical) et à sind. Il y a accord entre sij et sind, en ce que tous deux ont perdu la voyelle qui se trouvait à la tête du mot. Je rattache sij au potentiel sanscrit syâm (== sjâm) : le gothique diffère seulement du sanscrit en ce qu’il a inséré un. i devant le y. Il semble, en effet, que le gothique ne supporte pas un; précédé d’une consonne initiale : c’est ainsi que le thème numéral tkri «■trois» fait au génitif thrij~ê et au nominatif-accusatif neutre tkrij-a (S 3io). Pour la même raison nous avons sijan et non sjan en regard du potentiel TrClue je
sois». D’après cette explication, le s seul serait radical et ijserait l’expression d’un mode. Mais la langue gothique, telle qu’elle nous est parvenue, n’a plus conscience de l’origine de la syllabe sij, qu’elle traite comme une racine : au subjonctif, sij prend la caractéristique a3, avec laquelle vient se combiner un nouvel t comme expression du mode; a 1 indicatif, il prend la même voyelle u qui s’insère régulièrement au prétérit, entre la racine et
la désinence personnelle.
Remarque 2. — Effet du poids des désinences personnelles sur la voyelle radicale, dans les langues romanes4. — Les langues romanes également se montrent sensibles à l’effet exercé sur la racine par le poids des désinences personnelles. Le rapport qui existe en français entre tenons et tiens s’explique par le même principe que celui qui existe en grec entre SiSoftev et BfêaïfAt . La troisième personne du pluriel suit 1 analogie du singulier, en ce qui concerne la voyelle radicale, parce qu’elle a, comme le singulier, une désinence plus légère que la première et la deuxième personne du pluriel. en français, par exemple, la désinence est muette; on peut comparer tiennent à tenons et tenez.
' Pour sij-it-va. Voyez S hk\.
3 On retrouve cette même syllabe au subjonctif sij-au, sij-ais, etc.
3 Voyez 8109% î.
4 II faut rapprocher cette remarque du S £92. — Tr,
5 J’ai déjà indiqué ces faits dans les Annales de critique scientifique, 182 7, p. s 61, Vocalisme, p. 16.
Diez, dans sa Grammaire des langues romanes \ propose une autre explication : il suppose que le changement de voyelle dans tiens et tenons vient de la différence d’accentuation que présentent, en latin, les formes téneo et tenémm. Mais dans la troisième conjugaison l’accent ne change pas de place : néanmoins, l’espagnol a quiero et querimos et le français acquiers et acquérons \
Il se peut que IV du français^ soit identique aveciV du latin sapio; mais la suppression de cet t dans savons n’en devra pas moins être expliquée par la même cause qui a amené dans tenons la suppression de IV adventice de liens. C’est ainsi.qu en sanscrit la racine vas (deuxième classe) rejette son a radical dans les mêmes formes grammaticales où d’autres verbes de la même classe se débarrassent du gouna : uém'is -mous voulons» est avec le
singulier ôrfsFT vâsmi ffje veux» dans le même rapport qu’en français savons avec sais.
Remarque 3. — Les caractéristiques des classes servent-elles à exprimer l’idée du présent? — Je ne crois pas que dans la conjugaison il faille attribuer au gouna une valeur grammaticale3. Il sert simplement, selon moi, à renforcer et à soutenir les voyelles légères i et u, tandis que T« lui-même, éLanl la plus pesante des voyelles, n’a pas besoin d’un secours étranger.
Pott regarde le gouna, au présent et à l’imparfait, comme l’expression de la continuité de l’action *. Mais pourquoi alors y a-t-il des verbes avec un î ou un u radical qui gardent le gouna presque à tous les temps et a tous les modes? On trouve des verbes de cette sorte non-seulement en sanscrit, mais dans les langues congénères de l’Europe (dans celles du moins qui ont sauvé les diphthongues résultant du gouna) : ainsi les racines grecques Ài7r et Çvy, qui ont le gouna au présent Aenrco et Çevyco, le gardent dans toute leu** conjugaison, excepté à l’aoriste éXnrov et éfivyov5.
Si l’aoriste second nous présente la voyelle radicale pure, je ne voudrais pas davantage en chercher la raison dans la signification de ce temps. En effet, l’aoriste second n’a pas d’autre sens que l’aoriste premier, lequel garde le gouna quand le verbe en est pourvu dans le reste de sa conjugaison. La vraie cause est, selon moi, que l’aoriste second aime générale-
1 1, page 168. [Comparez la deuxième édition, I, page 81, note. — Tr.]
2 Cette remarque se trouve déjà dans l'excellent écrit de Fuchs, Mémoires pour servir à l’étude des langues romanes, p. 18,
3 En d’autres termes, le gouna ne modifie pas le sens du verbe. — Tr.
* Recherches étymologiques, i" édition, 1.1, p. 6o.
b Au parfait XéAonra, le gouna subsiste, avec o au lieu de Pc (S â6, s).
laenl à conserver la forme primitive de la racine : aussi la voyelle qu il noos présente est-elle tantôt plus légère et tantôt plus pesante que celle des autres temps; il fait, par exemple, évçavov, quand, au contraire, l’aoriste premier et l’imparfait font érpeif-a et ÎTpsmv. Si nous avons donc les aoristes éXimv, êÇoyov, irvxpv en regard des imparfaits éXenrov, éÇeuyov, êTivxpv, on ne peut pas dire, pour expliquer cette différence, que l’aoriste indique l’action momentanée et l’imparfait l’action continue, et que le gouna
est l’expression symbolique de la durée. _
A un point de vue plus général, je ne crois pas que la langue ait besoin d’exprimer par un signe particulier la durée d’une action. II s’entend de soi que chaque espèce d’acte, non moins que chaque espèce de repos, exige un certain laps de temps. Quand je dis «il mange, il boit, il dort, il est assis», on sait bien qu’il n’est pas question d’une action instantanée : il en est de même quand je dis «il mangeait, il buvait, il dormait, il était assis [pendant que se faisait telle ou telle autre action]». Je ne puis donc pas souscrire à cette opinion de Pott que les temps spéciaux ‘ prennent, a l’exclusion des autres temps, les caractéristiques des classes, parce qu’ils ont à exprimer une action qui se prolonge. Pourquoi le sanscrit aurait-il inventé neuf formes différentes pour symboliser la durée? et pourquoi, parmi ses dix classes de conjugaison*, y en aurait-il une privée de tout complément étranger? Je crois plutôt que les caractéristiques ont appartenu, dans l’origine, à tous les temps, et qu’à une époque plus récente, quoique antérieure à la séparation des idiomes, elles ont ete éliminées de certains temps, dont la structure .ne se prêtait pas a leur maintien. Ainsi l’aoriste3 et le futur les auront rejetées parce qu’ils s’adjoignaient le verbe substantif; on a dit, en conséquence, iâsyami et Saurai, au lieu de dadasyâmi et SiSûùa-ar. Au parfait, c’est le redoublement qui aura été cause de cette élimination; on a préféré, par exemple, Uîetypou à une forme SsSeixvvfiai. La crainte de surcharger le verbe a été jusqu a faire retrancher, en sanscrit, la désinence personnelle; ainsi à la deuxième personne du pluriel du parfait actif, ona 339T dadrm «vous avez vu». en regard du grec SeSépic-a-ve.
8 5ia. Tableau comparatif du présent moyen.
Il a déjà été question (S 466 et suiv.) des désinences du
» C’est-à-dire le présent et l’imparfait, avec les modes qui eu dépendent.
“ Voyez S 109*. '
3 Nous parions ici de l’aoriste premier, qui est le plus j^m-ralement usité.
moyen. Nous avons vu, à ce sujet, que le présent moyen sert également de passif en grec. En gothique, nous trouvons les formes du moyen presque toujours employées dans le sens du passif. Comme modèle de la première conjugaison principale, nous prendrons le verbe Bar a porter» (classe i); pour la seconde conjugaison, le verbe tan détendre» (classe 8) :
|
SINGULIER. | |||
|
Sanscrit. |
Zend. |
Grec. |
Gothique. |
|
b'àr-ê1 |
<pèp-o-pcu |
3 | |
|
Uâr-asê |
bar-a-hê |
(<pép~e-<jctt) | |
|
bar-a-tê |
bar-ai-tê , |
(pép-e-rai |
bair-a-da |
|
DUEL. | |||
|
Bâr-â-vakê * |
@ep-6-pe6ov | ||
|
Tff A*A S bar-ete |
(pép~6-t/0ûv 223 | ||
|
lr f A* A bar-ete |
tpéps-aOov | ||
|
PLURIEL. | |||
|
bâr-â-makê224 |
bar-â-maidê |
(psp-à- peÔa | |
|
bar-a-dvê225 |
bar-a-dwê ? 226 |
(pép-e-aOe | |
|
Bâr-a~ntê |
bar-ai-ntê |
(pép-o-vreu |
bair-a-nda. |
SIKttULIElV.
|
Sanscrit. |
Grec. |
|
lan-v-e (de tan-u-më) |
t âv-v-(iaa |
|
tan-u-së |
t âv-v-ffat |
|
lan-u-ië |
râv-v-vat |
|
DUEL. | |
|
tan-u-vâhê |
Tav-v-’fisOov |
|
tan-v-dtê |
r âv-v-trôov |
|
tan-v-atê |
Tav-v-adov |
|
PLURIEL. | |
|
lan-u-mahê (de lan-u-madê) |
TOtv-b-fisOa |
|
tan-u-dvë |
râv-v-crds |
|
tan-v-dtê (de tan-v-antë)1 |
Tâv-v-vrai. |
Remarque 1.— Le présent moyen en zend. — En zend, tan, s il est conjugué d’après la même classe, doit faire à la deuxième et à la troisième personne du singulier tan-ûi-êê (SS 4 î et 5a), tan-ûi-tê2, et a la première et à la deuxième personne du pluriel tan-u-mai£ê, tan-u-dwê. La troisième personne du pluriel serait sans doute tan-v-aitê ou taip-v-atntêj suivant que le zend conserve ou rejette la nasale. U y a des exemples qui montrent que le zend peut supprimer la nasale, comme le sansent. Au sanscrit airctln sasati correspond le zend sënhaiti crils enseignent», et au moyen
sâsâtê correspond senhattê3. D’un autre côté, le sanscrit, au
moyen, conserve quelquefois la nasale 4?ns deuxième conjugaison principale; exemple : âcïmanta, pour la forme plus usitée amwata. — A la première personne du singulier, le zend a tan-uy-ê, avec un y euphonique
(S 43).
Remarque 2. — La forme moyenne vêdê, en ancien slave. Autres dé-
d’après l’analogie de la forme secondaire dkrêm. Voyez Bumouf, Yaçna, notes, p. 38.
1 Voyez SS 458 et 459. Nous avons donné plus haut (S 488) un tableau de la conjugaison de l’actif pour ut verbe de la même classe ou d’une classe très-voisine. — Au sujet de l’accentuation, voyez S 69a et Système comparatif d’accentuation,
S 66.
* D’après le modèle de kërë^mk-té «il fait?>.
3 Voyez Burnouf, Y açna, p. 48o.
bris du“ moyen dans cette langue. — 11 y a, en ancien slave, une forme moyenne unique en son genre, savoir K'fcA'fc vcd-ê, qui est fréquemment employée, selon Miklosich1, comme forme secondaire de vêmï (pour vêdmï) ffje sais». C’est ce savant qui a d’abord reconnu dans vêdê un moyen. Si l’on fait abstraction du gouna, que le verbe slave dont il s’agit, différent en cela du verbe sanscrit, conserve au moyen, ainsi qu’au duel et au pluriel de l’actif227 228, frbA'Ë vêd-ê répond très-bien au sanscrit vid-ê'. Comme le sanscrit, le slave a perdu le m de la première personne. C’est là, avec beaucoup d’autres faits mentionnés précédemment229 230, une raison de croire que le slave s’est détaché du sanscrit postérieurement aux autres idiomes européens.
Si pourtant E'fcA'fc vêdê était, comme l’admet Miklosich, la seule trace que le moyen eût laissée en slave, on serait autorisé à douter de son identité avec le sanscrit videk. Mais je crois avoir découvert en slave encore d’autres formes de moyen, notamment dans la conjugaison qui joint, au présent, les désinences personnelles immédiatement à la racine. Je regarde, par exemple, comme appartenant au moyen, la deuxième et la troisième personne de l’aoriste, comme da-s-tu <rtu donnas, il donna», ja-s-tü «tu mangeas, il mangea», bü-s-tü crtu fus, il fut». A la deuxième personne, la désinence tu répond, selon moi, à la désinence sanscrite tas (S Û70) : en effet, le i sanscrit (8 12) est représenté en slave par T t; c’est ainsi qu’au sanscrit ta de la deuxième personne du pluriel répond, en slave, te231. Si l’on remplace la désinence moyenne ïâs par sa forme abrégée tas, on arrive très-aisément à la forme slave tu (S à21). A la troisième personne du singulier, T2 lu répond au ta sanscrit, au to grec; on peut comparer AdCTS da-s-tü fri! donna» aux aoristes sanscrits comme â-yâ-s-ia (racine yâ «aller»)232.
A la troisième personne du pluriel, il s’est également conservé en ancien slave des désinences moyennes, non-seulement à l’aoriste, mais encore plus fréquemment à l’imparfait. Ce sont les formes en ntüy qui correspondent très-bien aux formes sanscrites en nta et aux formes grecques en vro. On peut comparer MOfOLUATS mog-o-mntü1 «ils pouvaient » avec les aoristes moyens comme âdik-êanta, en sanscrit, et comme èhstx-aavro en grec. Le rapport entre mog-o-sahtü et l’actif mog-o-èah est le même qu’entre ddik-mnta, èheix-navro et Mik-san, êàsiK-aoLv 2.
LES TROIS PRETERITS.
S 5i3. Emploi des trois prétérits en sanscrit. — Manières
d’exprimer le parfait.
Ainsi que le grec, le sanserit a, pour exprimer le passé, les formes de l’imparfait, de l’aoriste et du parfait. Mais il n’y attache pas, comme le grec, des nuances différentes : il les emploie toutes indistinctement soit dans le sens de l’aoriste, soit dans celui de l’imparfait grec.
actives en t, par l’adjonction d’une voyelle : il rappelle l’adjonction d’un a dans les neutres pronominaux comme tha-ta (= sanscrit ta-t), en gothique. Mais ce fait n’est pas isolé en gothique (S 18), au lien qu’il le serait en ancien slave, quoique cette langue eût de très-nombreuses occasions de sauver une consonne finale, en lui adjoignant une voyelle. On sait, en effet (S 92 “), qu’une loi phonique de l’ancien slave exige la suppression de toutes les consonnes qui se trouvaient primitivement à la fin d’un mot. En regard du génitif sanscrit ndUas-as «du nuage», nous avons nebes-e «du ciel» (S 269) î en regard du nominatif pluriel gûnâv~as, nous avons sürwv-e (S 274 ) ; en regard de l’instrumental pluriel 6w, nous avons mi (en lithuanien mi»). Pourquoi le slave n’a-t-il pas fait nebeg-esü, êünov-esü ? Je ne vois pas de raison pour admettre l'adjonction d’un ü pour la seule désinence tu, d’autant plus qu’elle s’explique sans difficulté par la désinence sanscrite ta, — Quant au lu de da-s-tü «tu donnas», Mikîosich suppose que c’est la désinence de la troisième personne qui s’est introduite ici par abus dans la deuxième. Il y a, en effet, des exemples de celte sorte de confusion; mais je n’en connais pas en slave, et il n’est pas nécessaire d’admettre que nous ayons ici une anomalie de cette espèce.
1 Voyez Mikîosich, 5 toi, p. 87.
a Sur l’aoriste premier, en ancien slave, voyez S 561 et suiv.
Le prétérit redoublé, qui répond, quant à la forme, au parfait grec, a le plus souvent le sens de l’aoriste1. Il n’existe pas de temps, en sanscrit, qui ait exclusivement pour emploi de marquer l’achèvement de l’action. Pour exprimer qu’un acte est accompli, le sanscrit a d’ordinaire recours à un tour particulier : il remplace l’actif par le passif, c’est-à-dire qu’il prend un participe correspondant par le sens et par la forme au participe latin en tus, et il le combine avec le verbe substantif2. Voici quelques exemples de cette construction. Dans 1 épisode de Sâvitrî3, un personnage dit : «Tu es allée aussi loin qu’il fallait », yâvad gamyam gatan tvayâ, littéralement «quoad eun-dum [erat], itum [est] a te». Dans l’épisode de Nalas4 : «As-tu vu Nalas ? », kacéit drstas tvayâ nalô «an visus a te Nalus?». Dans l’Urvasî de Kâlidâsa5 : «Tu as pris sa marche» gatir asyâs tvayâ hrtâ «incessus ejus a te surreptus».
Il arrive fréquemment aussi que pour indiquer l’achèvement de l’action, celui qui l’a accomplie est désigné comme en étant le possesseur. Ainsi uktavân asmi signifie «j’ai dit»,
littéralement «dicto-præditus sum»6. Dans Urvasî233, la question: «as-tu vu ma bien-aimée?» est rendue par api drstavân asimarna priyâm, c’est-à-dire « an viso-prsgditus es meî amicam ? ».
Nos langues modernes qui, pour exprimer l’achèvement de
1 L'auteur citera plus loin des exemples tirés des Védas, où Ton trouve le prétérit redoublé employé dans le sens du parfait grec. Voyez S 588. — Tr.
s Ge dernier verbe est fréquemment sous-entendu, car le sanscrit l’omet le plus souvent qu’il peut.
3 Diluvium cum tribus alüs Mahabharati episodiis. Sâvitrî, V, 19.
4 XII, 39.
5 Édition Lenz, p. 66.
6 Oktâ est le participe passé du verbe vac «parler». Dans l’exemple suivant, drilavân se compose du suffixe vaut (nominatif masculin vân) et de drstu, participe passé du verbe dré «voir», Priyâm est le régime à l’accusatif du verbe renfermé
dans dritavân. — Tr.
• *
l’action, se servent du verbe auxiliaire «avoir», n’emploient pas un autre procédé que le sanscrit : car le suffixe vant (dans les cas faibles, vat) sert à former des possessifs, et uktdvant signifie «ayant parlé» comme vîrâvant «ayant des héros»234. Au reste, les formes en lavant, quoiqu’elles semblent créées exprès pour rendre le parfait, sont aussi employées quelquefois dans le sens de l’imparfait ou de l’aoriste.
Les verbes neutres, en sanscrit, ont l’avantage de pouvoir employer les participes en ta, soit avec le sens actif, soit (ce qui est la signification propre de cette forme) avec le sens passif. Le sens actif est de beaucoup le plus fréquent; nous le trouvons, par exemple, dans cette phrase : kva nu râgan gatâ ’si (par euphonie pour gatas asi) « quone, rex ! profectus es ? ». Ainsi employée dans le sens actif avec un verbe neutre, la forme en ta représente toujours un parfait. Quant au sens passif, on ne le rencontre que dans les constructions impersonnelles, telles que l’exemple précité gatan tvayâ « itum [est] a te », où le participe est toujours au singulier neutre.
$ 5i4. Manières d’exprimer le plus-que-parfait en sanscrit.
Le sanscrit est absolument dépourvu d’une forme pour le plus-que-parfait. Là où l’on pourrait s’attendre à le trouver, la langue se sert d’un gérondif, qui a pour rôle d’exprimer la postériorité. Nous avons, par exemple, dans l’épisode de Nalas2 : âkrandamânâh sahsrutya gavênâ ’Bisasâra ha «flentem postquam-audiverat cum-velocitate advenit igitur ». La traduction littérale serait « post-auditionem flentem».
Le même gérondif sert aussi,- quand il s’agit de l’avenir, a
exprimer le futur passé. Exemple : katam buddvà Hamyati1 « que deviendra-t-elle quand elle se sera réveillée?», littéralement « après le réveil ».
Pour marquer le plus-que-parfait, le sanscrit emploie également le locatif absolu. Apakrântê nalê râgan damayantî.......
abudyata2 «postquam-profectus-erat Nalus, ô rex! Damayantî... cxpergefacta est» (littéralement «profecto Nalo»).
$ 5i5. Les trois prétérits sanscrits avaient-ils à lorigine des significations différentes?
Le sanscrit a-t-il, de toute antiquité, employé ses trois prétérits sans y attacher aucune différence de signification? Faut-il croire qu’il ait ainsi prodigué inutilement ses formes? Ou bien ces trois temps se distinguaient-ils à l’origine, comme en grec, par des nuances particulières, qui se sont effacées dans le cours du temps? Cette seconde supposition me paraît la plus vraisemblable. Si le corps des mots s’émousse et s’use à la longue, le sens n’est pas moins sujet aux altérations et aux dégradations. Pourquoi, par exemple, le sanscrit a-t-il un si grand nombre de verbes signifiant «aller»? Ils devaient désigner à l’origine les diverses variétés du mouvement, et l’on retrouve encore pour quelques-uns des traces de cette diversité. Ainsi le verbe sanscrit sdrpâmi «je vais» a dû avoir le sens de «ramper», comme serpo9 ép7T6t*, car c’est d’après ce verbe que les Indous, ainsi que les Romains, ont nommé le serpent (sarpd-s, serpens, comparez le grec êpirsrép)3.
1 Nalas, X, as.
* Nalas, XI, i.
3 Je crois pouvoir rapporter à la même famille la racine germanique «ftp, slij «traîner, glisser». En vieux haut-allemand, nous avons slîfu, steij, slifamés; en anglais, I slip. La forme gothique serait sans doute sk'ipa, siaip, stipum (le p primitif conservé invariable comme dans slepa — svâpimi «je dors»). La forme slip
•
suppose une métathèse de sarp en trop et le changement de r en l. Comme les senti-
Si les trois prétérits sanscrits se distinguaient d'abord par des nuances qui se sont effacées dans la suite, le prétérit redoublé avait sans doute le même rôle que son congénère le parfait grec, c’est-à-dire qu’il marquait l’action accomplie. Le redoublement n’étant pas autre chose à l’origine qu’une manière de renforcer l’idée, le langage aura opposé la racine redoublée, comme type de ce qui est achevé et accompli, à la racine non redoublée, qui exprime l’action inachevée et en voie d’accomplissement. Par le sens comme par la forme, le parfait est proche parent de l’intensif sanscrit, qui admet également le redoublement L
§ 5i6. L’imparfait et l’aoriste sanscrits avaient-ils à l’origine
des significations distinctes?
11 nous reste à examiner s’il y a des raisons de croire que les deux prétérits à augment, qui remplissent en grec l’office d’imparfait et d’aoriste, avaient reçu dès l’origine des significations différentes et avaient été créés pour des emplois distincts.
Rien, dans la forme de ces temps, ne nous autorise à le penser. Le seul indice qu’on pourrait apercevoir, ce seraient les aoristes grecs comme ëXmov9 ëSo>v9 comparés aux imparfaits ë\ei-ttov, êSt'Sùiv, et les aoristes sanscrits comme dlipam2, âdâm, comparés à dlimpani, ddadâm. On pourrait être tenté de regarder les premières formes comme les formes primitives, et de voir
voyelles permutent fréquemment entre elles, et comme une seule et même racine , en s'altérant diversement, a très-souvent donné naissance à plusieurs racines nouvelles, je serais tenté de rapporter encore à la même origine le verbe smpr swif «courir çà et là», en moyen haut-allemand swife, sweif, swif en.
1 Pour donner à la syllabe réduplicative encore plus d'énergie, l'intensifia frappe du gouna (S 753 et suiv.).
a II ne faudrait pas croire que le sanscrit lip et le grec A*tt soient de même famille : la racine sanscrite signifie «oindre» et a pour dérivés, en grec, Ahros, dXeitpsû. Mais le rapport entre âlipam et dlimpam est jusqu’à un certain point semblable à celui qui existe entre éhvov et éfAeivap; le verbe grec, pour s'alléger, se débarrasse à l'aoriste du gouna, comme le verbe sanscrit, au même temps, élimine la nasale.
dans leur brièveté et leur rapidité, comparée à la pesanteur di* l’imparfait, l’expression de l’action instantanée1. L’aoriste, pourrait-on dire alors, se débarrasse du gouna et des autres caractéristiques, parce que, dans l’ardeur du récit, le narrateur ne se donne pas le temps de les prononcer; c’est pour une raison analogue que l’impératif sanscrit emploie, à la seconde personne du singulier, la forme verbale la plus faible, à cause de la rapidité naturelle du commandement235 236. Mais cette explication souffre de graves difficultés.
En premier lieu, cette sorte particulière d’aoristes comme ëh-tïov, ëScov, dlipam, âdâm, est relativement rare, en sanscrit comme en grec. De plus, l’aoriste n’est pas le seul temps qui supprime les caractéristiques. Enfin, dans l’une et l’autre langue, l’aoriste a la plupart du temps une forme plus pleine que l’imparfait. On peut comparer, par exemple, l’aoriste sanscrit ddiksam (= avec l’imparfait Misant. Ici les rapports sont renversés, et c’est l’imparfait qui est formé comme les aoristes précités âlipam, âdâm.
Est-ce la sifflante de l’aoriste premier (ddik-sam, ëhixrtm) qui aurait pu lui donner sa signification particulière ? Mais cette sifflante appartient, comme on le verra plus tard (§ 54a), au verbe substantif : ce verbe pouvait concourir aussi bien à la formation de tous les temps, et il sert, en effet, à en former plusieurs n’ayant aucun point de contact entre eux.
On peut donc affirmer que rien, dans la forme, n’implique une différence de signification entre l’imparfait et l’aoriste. H ne s’ensuit pas que dès une époque très-reculée, et avant la séparation des idiomes indo-européens, l’aoriste et l’imparfait n’aient pu adopter des sens distincts : la langue a pu profiter de quelques divergences peu importantes, pour attacher à deux formes, primitivement équivalentes, des nuances de signification particulières. C’est un fait assez fréquent dans l’histoire des langues qu’une seule et même forme finisse par se scinder en plusieurs, et que chacune d’entre elles soit alors affectée à un usage spécial. Le nominatif sanscrit dâta237 238, par exemple, signifie à la fois «donateur» et «devant donner»; mais le latin, de cette forme unique, en a tiré deux, en ajoutant encore un o à l’ancien thème. Il a réservé la formation nouvelle (daturus) pour le participe futur, tandis que l’ancienne (dator), restée plus près du type primitif, est toujours employée, ainsi que le grec Sorn'p, comme nom d’agent.
IMPARFAIT.
S 517. Caractères de l’imparfait. — Tableau comparatif de l'imparfait
en sanscrit et en grec.
Nous allons examiner successivement les trois prétérits.
Nous commencerons par celui que dans ma Grammaire sanscrite j’ai appelé le prétérit augmenté uniforme, pour le distinguer de l’autre prétérit à augment, qui admet sept formations différentes2. Nous emploierons ici les termes d’imparfait et d’aoriste, quoiqu’ils éveillent l’idée d’une différence de signification qui n’existe pas en sanscrit.
Le temps sanscrit qui répond, quant à la forme, à l’imparfait grec, présente les caractères suivants. Pour exprimer l’idée du passé, il se fait précéder de la voyelle a, laquelle reçoit toujours l’accent tonique3; il a la caractéristique de la classe; enfin, il a les désinences émoussées ou secondaires (§ 43o), probablement à cause de la surcharge résultant de l’augment.
Comme exemple de la première conjugaison principale, on peut comparer âtiar-a-m «je portais»1 avec etyep-o-v; comme exemples de la deuxième, âdadâ-m «je donnais» avec êSt'Stu-v, âstr-nav-am2 «je répandais » avec êolép-vv-v, et âkrî-nâ-m «j achetais» avec hrép-vâ-v. On a donné plus haut (§§ 481, 485 et 488) le tableau de l’imparfait de ces trois verbes. Nous nous contenterons donc de présenter ici le tableau de àSar-a-m, ëÇsp-o-v,
DUEL.
PLURIEL.
SINGULIER.
Sanscrit. Grec.
âBar-âr-ma è(pép~o-pev àb'ar-Orfa èÇ>ép-e-^e âbar-ür-n éÇep-o-v.
Sanscrit. Grec.
db'ar-â-va ........
âb'ar-a-tam èfiép-s-rov âb'ar-a-tâm s^ep-é-rrjv
aiâonta et ils pensaient», advaranta ou admrenta «ils couraient». Ce dernier vient dune racine dmr qui est probablement une altération du sanscrit tvar «se hâter», à moins qu’il n’y ait eu primitivement les deux racines tvar et dvar marquant Tune et l’autre le mouvement; on pourrait alors rapporter à cette dernière le sanscrit dvâr (féminin) et dvâra-m (neutre) «porte, entrée» L La forme précitée adâonta appartient à la racine sanscrite dyâi «meditari»2, qui a perdu sa semi-voyelle, en sorte que le zend traite dâ comme étant la racine. Il faut quelle ait eu aussi l’acception «voir», car le mot dôi-ira «œil»3 en est dérivé; dans ce mot, la racine sanscrite dyâ ou dyâi a perdu sa voyelle, vocalisé le y en i et frappé cet i du gouna.
S 519. Conjugaison de l’imparfait en zend.
Il y a, en zend, des exemples assez nombreux de l’imparfait actif. Nous en citerons quelques-uns, qui feront connaître les désinences du temps en question.
Première conjugaison principale. —Singulier. Première personne : mbar-ë-m «je faisais sortir » frâtwarës-ë-m ou frâiwërës-g-m4 «je créais»; frâdaüaêm «je montrais», pourfrâdaié-ayë-m = sanscrit prMM-aya-m «je faisais montrer »{§ 4 a).
Deuxième personne : jrâdaié-ayô «tu montrais»; kërë-nvo0 «tu
faisais».
1 Voyez Glossaire sanscrit, page 179, et comparez torana (masculin et neutre) tr porte».
2 s*r dyâi (classe 1), ou plutôt dyâ (classe h ). Voyez S 109 \ 2.
3 Le suffixe zend ira, en sanscrit tra, marque l'instrument a laide duquel on
fait l'action exprimée par le verbe (S 816 ).
4 Gomme la préposition sanscrite pra est ordinairement rendue en zend par Jrc avec un â long, il n'y a pas de raison pour supposer quefrdtwarëé-ë-m contienne un nugxnent. Mais je crois bien reconnaître l'augment dans la forme ns-asayanha e tu naissais» (S A69), où il serait difficile d'expliquer le premier a comme une simple voyelle de liaison. Comparez S 5oo.
5 Au lieu de hëvëftütvs* Ainsi qu'il arrive souvent, a la caractéristique déjà contenue
m.
Troisième personne : gas-a-d «il venait » = sanscrit dgacc-a-t « il allait ».
Pluriel. Troisième personne : gaéën «ils venaient»; baron «iis portaient».
Comme exemples de la deuxième conjugaison principale, nous citerons :
Singulier. Première personne : dadahm «je posais, je faisais» = sanscrit âdadd-m, grec èviQn-v; mrau-ml «je parlais».
Deuxième personne : mrau~s «tu parlais».
Troisième personne : mrau-d2 «il parlait»; kërë-nau-d «il faisait».
Au pluriel, ces deux derniers verbes feraient sans doute amrû-ma, amrû-la (= sanscrit àbrw-ma, âbru-ta) et kërë-nu~mar kèrë-nu-ta, comme en grec nous avons écrlop-vu-fxsv, êa16p-vv-7e = sanscrit âslr-nu-ma, âstr-nu-ta. 11 est plus difficile de conjecturer quelle serait la troisième personne du pluriel. 239 240 241 242 243 244 245 ordre que le zend, là même où il emploie le subjonctif, exprime bien plus souvent Faction actuelle à l’aide de l’imparfait qu’à laide du présent. Pour la même cause, le conditionnel, en sanscrit, est pourvu de l’augment, et la relation conditionnelle, en allemand et en latin, est marquée par des temps du passé.
Voici des exemples de l’imparfait de l’indicatif employé en zend avec le sens du subjonctif présent : fraca kërëntën1 « qu’ils découpent» = sanscrit âhrntan; dm vâ nara anhënpanca va «qu’ils soient deux hommes ou cinq»; yêsi anhad âiravâ2 «si c’est un prêtre»; yêsi anhad raiaistâo «si c’est un guerrier»; yêsi anhad vâstryô «si c’est un laboureur»; yêsi anhad spâ «si c’est un chien»3; yêsi vas'ën masdayasna sahm raudhyanm4 «si les Mas246 dayasniens (adorateurs d’Ormuzd) veulent cultiver la terre». La conjonction yêsi, que nous trouvons dans la plupart de ces exemples, aime à être suivie d’un mode autre que l’indicatif, soit le potentiel, soit le subjonctif, ou bien elle se fait suivre de l’imparfait de l’indicatif comme représentant du subjonctif présent. On trouve aussi quelquefois, après yêsi, le parfait redoublé employé dans le même sens; exemples : yêsi moi yimanàid vt-visé239 « si, ô Yima, tu ne m’obéis pas»; yêsi tvJtava «s’il peut» ou (d’après Anquetil) «si on le pejit».
§521. L’imparfait après la particule prohibitive mâ, en sanscrit. —
L’imparfait arménien.
Le sanscrit fait de ses deux prétérits augmentés un emploi qui se rapproche jusqu’à un certain point de ces constructions
zcndcs. L’imparfait et l’aoriste, précédés de la particule prohibitive ma, prennent le sens de Timpératif.
On a vu plus haut (§ hàÿ) que l’impératif prohibitif arménien, c’est-à-dire le temps qui après la négation mi prend la place de l’impératif, est très-probablement un ancien imparfait privé de Taugment. Abstraction faite de cette construction, l’arménien ne paraît avoir conservé quun seul imparfait simple, à savoir celui de la racine es «être» *. Tous les autres imparfaits renferment la racine es2, dont la sifflante est devenue un r à la troisième personne (ér) et s’est perdue partout ailleurs3. Je fais suivre l’imparfait de berem «je porte», placé en regard de l’imparfait du verbe substantif :
PLURIEL.
SINGULIER.
êi pM-pty berêi kfcp êir berêi y
L, u>.l> êaq bfe êiq cm
p.ù-pl^wp ber êaq p.frpbl'-e berêiq plrp^fo berêin.
§ 5s9. Conjugaison de l'imparfait arménien.
Uê de berêaq «ferebamus» appartient à la fois à la caractéristique du verbe principal et au verbe auxiliaire annexe. La forme êaq «nous étions» suppose en sanscrit une forme comme âsâma; par l’insertion de la voyelle, êaq se trouve plus près du latin er-â-mus que du sanscrit âsma ou du grec tffiev. Je considère IV de êiq «vous étiez» et de êin «ils étaient» comme un affaiblissement pour Va; si l’on rétablit cet a, êan répondra très-bien, sauf la suppression de la consonne radicale, au sanscrit asan et au grec Dans la deuxième et la troisième conju-
1 Voyez $ i83b, a.
2 Sauf, bien entendu, tes formes dans lesquelles nous reconnaîtrons pins loin des aoristes. .
s Le a de la racine e<r s'est perdu de même, en grec, à l'imparfait %v, tffJtei», , $TOV, TïfV.
gaison, le verbe auxiliaire annexe est moins visible : 1« de la deuxième conjugaison, en s’unissant avec le t e du verbe auxiliaire, donne uy ai; on a, par exemple, nftuuMjft orsaii «je chassais», pluriel orsaiaq. Après Vu de la troisième conjugaison, la voyelle du verbe auxiliaire disparaît complètement; exemple : nhmi «accipiebam », pluriel arnuaq. Dans toutes les conjugaisons, on reconnaît clairement le verbe annexe à la troisième personne du singulier, où le r final ne peut appartenir à la désinence personnelle, mais doit être sorti de l’ancien s radical du verbe substantif (S t83b, â).
S 593. L’aoriste en lithuanien.
L’aoriste lithuanien1 a une double origine. Dans les verbes primitifs, il répond à l’aoriste sanscrit (sixième formation)2; dans les verbes qui appartiennent à la dixième classe sanscrite (S 5o6), il répond à l’imparfait3. Je fais suivre 1 aoriste lithuanien raudo-jau «je pleurai», que je mets en regard de 1 imparfait sanscrit drôdàyam «je .faisais pleurer»4.
DUEL.
SINGULIER.
Sa usait. Lithaaaieii.
drâd-aya-m raud-oj-u arôd-aya-s raud-oje-i drod-aya-t raud-ojô
Lithuanien.
Sanscrit.
* raml-ojô-wa
drôd-ayâ-va ....... v
àrôd-aya-iam raud-ojo-tu
drôd-aya-tâm Gomme au t"
smg.
PLURIEL.
Sanscrit. Lithuanien.
â-rod-ayâ-ma raud-ojô-me d-rôd-aya-ta raud-ojô-te
A-rûd-aya-n Gomme au sing.
» D’accord avec Kurseliat, je nomme maintenant ainsi le temps que Ruhig et
* *
Mielcke appellent le parfait.
Voyez S 576.
Voyez ci-dessus, t. 1, p. 408, note 3.
Voyez le présent du même verbe, S 109% h*
Remarque. — Explication de l’ô de l’aoriste lithuanien. — On peut se demander d’où provient Va qui, à l’aoriste lithuanien, précède immédiatement les désinences personnelles1. Il faut remarquer que cette voyelle, qui répond à l’a du présent, se trouve dans tous les verbes lithuaniens; on a. par exemple, lipô «fil colla», Üp-ô-te «vous collâtes». Au contraire, le présent fait Ümp-a «il colle», Ihnp-a-te frvous collez»247 248. Il est probable qu’en allongeant la voyelle caractéristique qui précède la désinence personnelle, la lang’^ a voulu faire mieux ressortir son prétérit, d’autant plus que le lithuanien a perdu la vraie expression du passé, savoir l’augment. le n’hésite donc pas, malgré cet allongement, à voir dans lip-a-ù, lîp-ô-me le représentant de l’aoriste sanscrit âlip-a-m, d-lip-â-ma, de même que limp-u, Ihnp-a-me représente le présent sanscrit Ump-a-mt, limp-â-mas249.
§ 5a A. Origine de l’imparfait d’habitude, en lithuanien. — La racine da ou dâ jointe au verbe, en lithuanien et en gothique.
Dans la forme lithuanienne appelée l'imparfait d'habitude, comme sùk-dawau «j’avais l'habitude de tourner», davoau est un verbe auxiliaire annexe. Il ne diffère pas beaucoup de dawjaü (présent dü~mi) «je donnais, j'ai donné», dont il se sépare seulement en ce qu’il est fléchi comme lipaû et les aoristes analogues. Cependant, comme il y a en sanscrit, à coté de dâ «donner», auquel se rattache le lithuanien durai, une racine VT dâ «poser» qui est également représentée en lithuanien, et qui fait au présent demi «je pose », on peut attribuer à cette dernière racine le verbe auxiliaire renfermé dans sùk-dawau. 11 est vrai que le prétérit simple de demi est dejau et non dawjau ou dawiaa. Mais demi est pour dami (= sanscrit dddami, grec
tce qui explique l'a de dawau; quant au w, nous le trouvons également au prétérit dawjau, quoique l’un de ces deux verbes n’y eût pas plus de droit que l’autre. Il se pourrait donc que l’adjonction du verbe auxiliaire, dans sùk-dawau, appartînt à une époque où dümi «je donne» et demi «je pose» étaient, dans leur conjugaison, aussi rapprochés l’un de l’autre qu’en sanscrit dàdâmi et dâdâmi; en effet, ces deux derniers verbes ne diffèrent que par l’aspiration, laquelle nexiste pas en lithuanien. Gomme dàdâmi, quand il est précédé de la préposition vi, prend en sanscrit le sens de «faire», et quen zend il a ce sens même sans préposition, ce verbe paraît bien approprie, par sa signification, au rôle de verbe auxiliaire (8 636). G est la même racine que nous retrouvons dans la dernière partie du gothique sôk-i-da «je cherchais », sôk-i-deduM « nous cherchions » : j’ai déjà expliqué dans mon premier ouvrage que ces mots renferment le verbe qui a donné le substantif dêds «aetion »; le sens littéral de sôk-i-dêdum serait donc «nous chercher faisions » 1.
Il reste à examiner quelle peut être 1 origine du w de suk-dnwau; je crois que dans ce mot, comme dans dawiau «je donnais» et dans stévomi «je suis debout», pluriel stow-i-me, le w est l’amollissement du p qui est joint, en sanscrit, au causatif des racines finissant par un â ou par une diphthongue (8 7^7)* Les racines stâ «être debout», dâ «donner», dk «poser» forment les causatifs stâp-âyâ-mi, dâp-ayâ-nii, dap-aya-mi. Il faudrait donc identifier le lithuanien daw-ia-û250 251 avec l’imparfait sanscrit âdâp-aya-m, stow-ja-u avec d$tàp-aya-ni, et le dawau de suk-dawau avec Mâp-aya~m252. En ce qui concerne l’amollissement
du p en w, on peut comparer les mots français savoir, recevou,
neveu, pauvre, poivre, avoir, devoir, cheval, ou le p ou le b iatoi, placé entre deux voyelles, s’est également amolli en v. Comparez aussi l’anglais seven et l’arménien evtn (§ 315) au sanscrit saptan, védique saptan253.
S 5a5. L’imparfait en ancien slave.
Nous passons à l’imparfait en ancien slave. Il est de formation nouvelle, comme l’imparfait latin en bam (§ 526^ : il se termine en achû. On a vu (§ 92 g) que le X ch répond a un s sanscrit. Si les aoristes comme dachü «je donnai» représentent les aoristes sanscrits en sam (§ 561 et suiv.), il s ensuit que les imparfaits comme vesê-acku doivent contenir le thème du verbe principal combiné avec l’imparfait de la racine sanscrite as2. Cet imparfait n’est plus employé seul; mais ce n’est pas une raison pour qu’il ne se soit pas maintenu dans des formes composées. L’æ de as est resté a en slave, peut-etre parce quil s’est mêlé avec Va de l’augment. A la deuxième personne du pluriel, la ressemblance est frappante entre le slave aste et le sanscrit â's-ta (en grec ija-re). A la deuxieme et a la troisième personne duelles, asta représente le sanscrit âs~tam «vous étiez tous deux» et âs—tûm «ils étaient tous deux» (jjct-tïjî^;
on sait (S 93“) que les consonnes finales primitives tombent toujours en slave.
Devant le k v et le m m de la première personne duelle et plurielle, on insère la voyelle de liaison 0; on a donc : ach-o-vê, ach-o-mü pour le sanscrit âs~va, as-ma. A la troisième personne, achuii (pour asm) répond au sanscrit âsan et au grec ticmv.
Le thème du verbe attributif se termine en ê ou en a. Le
est plus fréquent; Y a ne se trouve qu après un;1, après m è (venant de k) et dans les verbes appartenant à la dixième classe sanscrite, dont le thème se termine aussi en a à l’aoriste et à l’infinitif. Comme exemples, nous citerons : Hecnd?cs nesê-achü «je portais»; vesê-achü «je transportais??; peca-achü «je cuisais» (présent : pek-u-h, pec-e-si); bij-achü «je frappais» (présent : Mj-u-ii, bij-e-êi, § 5oa); selê-achü «je désirais » (présent : êelêju-ii, selêje-si, aoriste selê-chü); gorê-achü «je brûlais» (présent : gor-jurh, gor-i-si, aoriste gorê-chü, § 5o4); chvalja-achü «je louais» (présent: chvalju-n, chvalje-si, aoriste chvalê-chu, § 5o4); iêla-chü «je travaillais» (présent : dêlaju-n, dêlaje-si, aoriste Aêla-chü).
Je regarde partout le ou 1 a qui précédé \ & du verbe auxiliaire comme la caractéristique de la dixième classe sanscrite (S 5o4 et suiv.), et j’admets que les verbes qui n appartenaient pas déjà par eux-mêmes à cette classe, y ont passé à l’imparfait254 255. Je crois donc devoir identifier le ê de ves-ê-achü «je transpoi-tais» avec celui des formes comme gor-ê-achü, aoriste gorê-chü, et le premier a de bij-a-achü avec celui de rüd-ct-cichü. La différence entre l’imparfait chvol-j(i-(ichü et 1 aoriste chvol-e-chü vient de ce qu’à l’imparfait la caractéristique sanscrite oya conserve sa syllabe finale, au lieu quelle est toujours contractée dans les formes générales; le ê (pour ai) de chval-c-chü nous présente le même changement de on ê que nous trouvons en pra-
crit et en latin (§ iog\ 6).
Les verbes qui appartiennent à la neuvième classe sanscrite ajoutent encore Yê à la caractéristique de cette classe ; exemples : gubn-ê-achü «je périssais» (présent güb-nu-n, güb-ne-si256, aoriste güb-o-chü). C’est comme si du sanscrit krî-m-mi (§ 485) venait un verbe dérivé krînayâmi. Il y a aussi en grec des formes de cette sorte, par exemple 'srepm'cu, qui vient de 'SfépvYi^i.
L’ê s ajoute enfin à Timparfait des verbes qui joignent immédiatement les désinences personnelles a la racine (§ 436, 9); exemple : jadr-ê-achü «je mangeais » 1. À l’aoriste, au contraire, nous avons jad-o-chü (avec 0 comme voyelle de liaison), a 1 infinitif jas-ti, au supin jas-tü (par euphonie pour jad-ti, jad-tü,
S io3). Le verbe eumi, vêmï «je sais» (en sanscrit vé'd-mi) prend Yi à tous les temps, excepté à l’impératif et aux participes dérivés du présent; nous avons, par exemple, l’imparfait vêd-ê-achü «je savais » 257 258, l’aoriste vêd-ê-chü, les participes passes actifs ved-e-vü et vêd-ê’lü, l’infinitif vêd-ê-ti, le supin vêd-ê-tü.
On trouvera pins loin (§ 53a) le tableau de l imparfait en
ancien slave.
S 5a6. Origine de Timparfait latin. — Comparaison avec le celtique.
l’ai exprimé pour la première fois dans mon Système de conjugaison de la langue sanscrite l’idée que les imparfaits latins en bam, comme les futurs en bo, renferment le verbe substantif. Ces formes contiennent la même racine Bâ «être» (8 609), qui a donné en latin le parfait fui, l’infinitif fore et le subjonctif archaïque fmm259. A moins de nier d’une manière générale que les formes grammaticales puissent provenir d’une composition, on ne doit pas s’étonner de voir intervenir le verbe substantif dans la conjugaison des verbes attributifs : sa place y est en quelque sorte marquée d’avance, puisqu’il sert (de la son nom de copule) à unir le sujet, qui est représenté par les désinences personnelles, avec l’attribut qui est exprimé par la racine. En prenant le verbe auxiliaire, l’imparfait latin ne fait pas autre chose que ce que font le grec et le sanscrit à l’aoriste : seulement Tun se sert de la racine M, les deux autres de la racine as,
La même racine Bû est chargée, dans les langues celtiques, d’un rôle analogue. Dans le dialecte irlandais, on a les formes mealfa-m, ou meal-fa-maid, ou meal-fa-maoid «nous tromperons»; mealfai-dhe «vous tromperez»; meal-fai-d «ils tromperont»; meal-fai-r «tu tromperas»; meal-fai-dh «il trompera». La forme mutilée fam, qui marque la première personne du pluriel, mais qui a perdu le signe de la pluralité, s’accorde d’une façon remarquable avec le latin bam. Il ne faut pas nous laisser arrêter par cette circonstance que le latin bam sert pour le passé et Tir-landais fam pour l’avenir : fam est pour fiam ou biarn, car on dit, hors de composition, biad me «je serai» (littéralement «sera moi»), biadhr-maoid «nous serons»260; dans ces formes, IV est l’exposant de l’idée de futur (comparez le latin ama-bis, ama-bit, eris, erit). Mais en composition, cet i a été éliminé, pour éviter la surcharge, et le b a été affaibli en f Les faits sont donc les mêmes en irlandais et en latin, quoique, à l’égard de la lettre initiale, le rapport soit renversé : car en.latin ce sont les formes simples fui, fore, fuam qui ont le f et en irlandais ce sont les formes composées. Mais l’euphonie est la seule cause de cette diversité; on a déjà vu (§ 18) que le latin, au commencement des mots, représente le B sanscrit par un f, tandis qu’à 1 intérieur des mots il préfère la moyenne à l’aspirée.
S 5*27. Allongement de la voyelle e, devant la désinence bain, dans les verbes de la troisième conjugaison latine.
On peut se demander pourquoi la voyelle caractéristique ê est longue dans leg-ê-bam, puisque la troisième conjugaison latine correspond à la première classe sanscrite1, dont la bref devient en latin un i ou (devant un r) un ë. Agathon Benary croit que la voyelle caractéristique s’est fondue avec la voyelle de l’augment2. Il serait intéressant de voir -le latin, qui a perdu l’augment, le retrouver de cette façon comme expression du passé; mais quoique j’aie adopté autrefois cette opinion3, je ne voudrais plus aujourd’hui la soutenir avec la même confiance, d’autant plus que le zend, dont j’avais cru pouvoir invoquer l’exemple, et où j’avais cru que l’augment ne s était conserve qu’à l’abri d’une préposition précédente, en a, comme on 1 a
vu, conservé d’autres traces (S 518).
Je pense donc qu’il ne faut pas absolument écarter une autre explication. Il est impossible de nier qu’il y ait des allongements inorganiques, que des voyelles primitivement brèves se changent, pour les besoins de la flexion, en longues ou en diphthongues. C’est ainsi, par exemple, qu’en sanscrit la caractéristique a s’allonge toujours devant un ni ou un v {vâh-â-mi, vdh-â-vas, vah-a-mas)4, et qu’en gothique IV et IVi prennent toujours le gouna quand ils sont suivis d’un r ou d’un h Le lithuanien renforce les voyelles finales des désinences personnelles, pour les mettre en état de porter le poids du pronom réfléchi annexe (§ 676); il renforce de même, à quelques cas, les désinences des adjectifs devant le pronom défini annexe (S 983). Un renforcement
1 Voyez S 109% 1.
2 Phonologie romaine, p. 29.
s Annales berlinoises, i838, p. iH. _
* Voyez S h$h.
h Voyez § 83.
paml a lieu en gothique dans des circonstances analogues (j 3go). H faut donc admettre la possibilité qu’en latin la voyelle caractéristique de leg-ê-bam se soit allongée simplement pour donner au thème du verbe principal la force de porter le poids du verbe substantif annexe
g 5a8. Allongement de Ve, devant la désinence bam, dans les verbes
de !a quatrième conjugaison latine.
Dans la quatrième conjugaison latine, 1 ê de aud-ie~bam rc— présente l’a final de la caractéristique aya (§109°, 6); il est avec cet a dans le même rapport que le de veh-ê-bam avec la caractéristique a de dvah-a-m. H faut donc admettre quil y a eu fusion entre la voyelle finale de la caractéristique et 1 aug— ment du verbe auxiliaire, ou bien que nous avons encore ici un allongement purement phonétique261 262. Ce qui semble confirmei la première explication, c’est que nous avons bien des futurs archaïques comme audîbo, vctiîbo, dormîbo, servîbo, oppertbor, (imicîbor, demolibor263 264, mais qu’on ne trouve jamais dormiêbo, ve-niêbo, etc. Ce fait n’a rien que de naturel, si l’on admet que aud-iê-bam est pour aud-ië-ëbam; en effet, le futur n ayant pas droit àl’augment, il n’y avait place que pour des formes comme audîbo, qui doivent s’expliquer comme étant pour aud-ië-boJ.
11 est vrai que dans la troisième conjugaison on trouve un petit nombre de futurs archaïques en e-bo : exmgebo, dieebo, mvebo. Mais on doit sans doute les expliquer, ainsi que le font toutes les grammaires latines, par un mélange avec la deuxième
conjugaison, où Yê appartient à la caractéristique. Gomme il y a à l’imparfait, entre mon-ê-ham et leg-ê-bam, une identité apparente de flexion, la langue a pu être amenée a étendre
quelquefois cette identité au futur1.
L’imparfait dâ-bam et le futur dâ~bo méritent une mention à
radical devrait être long partout, comme dans le verbe correspondant en sanscrit ; on devrait donc avoir dà-sf et non dâ-s, en regard du sanscrit dddâ-si et du grec JiSw-s265 266. Mais puisque le verbe latin en question a partout abrégé son a, on n’a pas plus le droit de s’étonner des formes comme dâ-b<wi que
X T 5
(111. U lé
des formes comme dâ-mus, dâ-tis.
Quoi qu’il en soit, l’augment à l’intérieur d’un verbe n’aurait rien de plus surprenant que le redoublement : nous avons, par exemple, en latin crê-didi, ven-didi, et en gothique les formes comme sôk-i-dêdum « nous chercher faisions n 267.
S 629. L’augment temporel en sanscrit et en grec. — Imparfait du verbe
substantif en sanscrit, en grec et en latin.
Gomme l’augment syllabique, l’augment temporel s est fidèlement conservé en sanscrit et en grec. G’est un principe général en sanscrit que deux voyelles qui se rencontrent se confondent en une seule. Quand l’augment se trouve devant une racine commençant par un a, les deux a en se mêlant forment un a long : de même, en grec, où l’augment est un s, les verbes commençant par un s prennent ordinairement un w.
Choisissons comme exemple la racine du verbe substantif : devient et U devient
On peut comparer, à l’imparfait :
Sanscrit. Grec.
as-ma %-psv (pour ija-uev)1 as-ta rja-re
as-an rja-av as-lam ov as-tâm ya-rrjv.
La première personne du singulier est en sanscrit âs-am, ce qui devrait donner en grec d<7-av. Mais le grec a supprimé une syllabe entière et a fait %-v. *
Le latin eram (pour esam)268 269 a mieux conservé la forme primitive : en général, le latin a su partout conserver la consonne de la racine as270, mais, suivant une loi phonique particulière à celte langue, il change s en r, quand il est entre deux voyelles.
Il est très-probable que ëram a été précédé dune forme pourvue de l’augment êram; on peut donc dire que Yë de ëram appartient moitié à la racine, moitié à Taugment.
L’arménien kf* êi a conservé partout la longue résultant de la fusion de Ÿe de Taugment avec Ye de la racine (S i83\ a).
S 53o. Deuxième et troisième personnes du singulier de l’imparfait du verbe substantif en sanscrit, en grec et en arménien.
A la deuxième et à la troisième personne du singulier, le sanscrit insère entre la racine as et les signes personnels s et t un î comme voyelle de liaison : as As, âs-î-L Sans cette voyelle . auxiliaire, ces deux personnes auraient perdu leur désinence, puisque le sanscrit ne souffre pas deux consonnes à la fin d un
mot : on trouve, en effet, dans le dialecte védique, une forme «il est»; on en peut rappi’oeher le dorien «il est» et l’arménien bp êr. Il serait permis aussi de voir, avec Kühner1, dans le s de fis le remplaçant d’un ancien t, de sorte que cette consonne serait l’expression de la troisième personne, et non la lettre radicale271 272. La forme n’en serait que plus remarquable, car elle serait la seule forme secondaire qui aurait gardé le signe de la troisième personne. Quoi qu’il en soit, nous aide à comprendre la forme ordinaire de la troisième personne ifr, dont l’identité extérieure avec le de la première personne peut sembler bizarre. A la première personne, est pour (moyen ripriv), au lieu qu’à la troisième, le v est l’altération d’un s : tir est avec le dorien $$ «il est» dans le même rapport que Tvnloftev avec tu7t7o/x£s, ou le duel péperov, pépeiov avec Mralas, Sdratas (§ 97).
$ 531. Deuxième et troisième personnes du singulier de certaines racines sanscrites finissant par s.
En sanscrit, c’est une règle établie que les racines en s changent, à la troisième personne du singulier de l’imparfait, leur s en t, quand elles appartiennent, comme as, à une classe de conjugaison qui n’insère aucune syllabe intermédiaire entre la racine et la désinence personnelle. Le même fait a lieu, mais d’une façon facultative, à la deuxième personne : toutefois, le s ou ses remplaçants euphoniques sont plus fréquents que ls. Ainsi jprçyd# «gouverner» fait à la troisième personne de l’imparfait osât, h la deuxième dsâs (ou dmk) et osât. En ce qui concerne la troisième personne, je crois qu’il vaut mieux regarder le t comme le caractère personnel : sinon, on ne voit pas pourquoi le t se serait maintenu de préférence à la troisième personne, tandis que la deuxième affecte plutôt la forme
llnnc In
£itittrJm JL/ U4-*V au IJv XWl-X/
ans îa nprindn où le sanscrit tolérait encore, comme les
idiomes congénères, deux consonnes à la fin du mot, la troisième personne a dû être sans doute dsâ$-t, et la deuxième àsat-s273.
S 53a, Imparfait du verbe substantif.
A côté de à&4-8 «tu étais», 'MIaDh â’s-î-t «il était»,
ont sans doute existé d’abord les formes âs-a-$, as-a-t; nous voyons, en effet, que plusieurs verbes de la seconde classe prennent à volonté, dans les mêmes personnes, a ou î comme voyelle de liaison. On a, par exemple, ârôd-î-s «tu pleurais», érôd-î-l «il pleurait», ou ârôd-a-s, ârôd-a-t (racine rud). Je crois que les formes en as, ai sont les plus anciennes, et que les formes en îs, U proviennent, par imitation, des aoristes comme dbôiîs, dbôdît (troisième formation). Dans ces aoristes, l’allongement de l’i est une compensation pour la perte de la lettre s, qui se trouve à toutes les autres personnes : dbocï-i-mm, àbôd-i-éva, dbôcl-i-éma 2.
Le zend confirme cette hypothèse, car il nous présente a la troisième personne la forme anhad (avec suppression de
Paugment3 et insertion d’une nasale4). Je ne connais pas d’exemple, en zend, de la deuxième personne; mais je ne doute pas qu’elle n’ait fait anhâ (avec ea «et», anhad-ca). En ancien perse, nous trouvons âh-a «il était», avec suppression du signe personnel (§86, û !)).
1 Pour âéàs-s, le « se changeant volontiers en t devant un autre s,
3 Ge s appartient au verbe auxiliaire as (S 5 A a). LV est une voyelle de liaison.
3 Autrement nous aurions âonkmL
• «
De même, en latin, nous avons erat : Y a a subi un allongement inorganique, puis il a été de nouveau abrégé à cause du t final. Cet allongement s’est étendu à toutes les personnes1, même à celles où le sanscrit, le grec et probablement aussi le zend joignent immédiatement les désinences à la racine.
En arménien, nous trouvons ê-i «j’étais», ê-i~r «tu étais b (§ i83b, 2), ê-i-n «ils étaient». Je regarde cet i comme l’affaiblissement relativement récent d’un ancien a. Il en est de même pour Ye du slave uuic ase «tu étais, il était»2 : un e final, en ancien slave, est toujours l’altération d’un a primitif. A la troisième personne, le slave ase est donc plus près du perse âh-a que du sanscrit as-4-t. Quant à la deuxième personne, elle a du être également âh-a en ancien perse, car après un a, à la fin des mots, cette langue ne souffre pas plus le s que le t
Mentionnons encore l’albanais, qui, sans avoir un lien spécial de parenté avec l’ancien slave, s’en rapproche ici d’assez près. A la première et à la deuxième personne du singulier, il fait jéir-e, jéa-s; à la troisième, ta (comparez le védique as, le dorien Comme en slave, cet imparfait se combine avec les verbes attributifs; mais il perd alors sa voyelle radicale3.
Remarquons enfin qu’en zend, à la troisième personne du singulier, à coté de anhad, on trouve aussi une forme dépourvue de flexion as, qui s’accorde avec le védique âs\ Burnouf a
1 A la première personne eram, Ta redevient bref à cause de m final.
2 N’est employé que comme enclitique (S 5a5).
3 Voyez mon mémoire Sur l’albanais et ses affinités, p. iü et suiv.
4 Spiegel, De quelques interpolations du Vendidad (p. a5). Burnouf (Yaçna, p. ) cite aussi une forme âs, avec â long : il rejette avec raison le-»y s comme fautif, et le remplace par » é. Dans le & d sont renfermées à la fois la voyelle de l’augment et la voyelle radicale. On peut se demander comment le zend peut faire ai ou ai, puisque cette langue change en V à le et en do le as final sanscrit. Mais le t, qui terminait originairement ces formes, a probablement préservé la sifflante. — Spiegel mentionne une leçon aitërn, qui est sans doute un duel, car le sanscrit ffstam «vous étiez tous deux» doit donner en zend âitëm ou aétëm.
aussi reconnu un imparfait du subjonctif1, savoir âonhâd «es-jjet*, qui se rattache à Fimparfait de Findicatif anhad; mais il a conservé Faugment, qui s’est perdu à Findicatif; en sanscrit, nous aurions âsât.
Je fais suivre Fimparfait du verbe substantif en sanscrit, en albanais, en grec, en latin et en arménien. J’y ajoute le slave, dont les formes ne sont employées quen combinaison avec des verbes attributifs (§ 5 a 5).
SINGULIER.
|
Sanscrit. |
Albanais. |
Grec. |
Latin. |
Ancien slave. |
Arménien |
|
asam |
jéij-e |
7}V |
eram |
-achü |
A** et |
|
as e (ISIS |
jéàe |
-r rjs |
erâs |
-ose |
A*• eir |
|
A. Ai asti, as |
là |
rjs, r)v |
erai |
-ose |
4 er |
|
DUEL. | |||||
|
nanti |
-achevé | ||||
|
UùVlv natnWi |
tktIov |
-asta | |||
|
astâm |
MM |
-asta | |||
|
% |
PLURIEL. | ||||
|
asma |
jéàe fi |
Û(<y)fiev |
erâmus |
-aehomü |
A C eaq |
|
asta |
jéàsre |
ijale |
erâtis |
-aste |
A*- < et q |
|
asan |
làve |
r)<ja.v |
erant |
-achun |
A** etn. |
Remarque. — Allongement de Va, à l’imparfait eram. — On vient de voir que Ya, dans eram, eras, est simplement une voyelle de liaison et qu’il a dû être bref à Forigine. Ce qui a pu contribuer à 1 allongement inorganique de cette voyelle, c’est Fanalogie des imparfaits en batn, bas, où la longue a sa raison d’être, puisque ces syllabes sont la contraction du sanscrit à-lavam, d-b'avas (S 5$6). Après la suppression du v, les deux a brefs, se trouvant en contact, se sont fondus en une voyelle longue, de même que, dans la première conjugaison latine, la caractéristique sanscrite aya (dixième classe) est devenue à, après la suppression du y (% 109*, 6) : 274 275 ainsi amâs, amâtis correspondent au sanscrit kâmdyasi «tu aimes», kâmâ-yata «vous aimez».
Le besoin de modeler eram, erâs le plus exactement possible sur les formes en bam, bas, et de mettre un â long partout où le permet la consonne finale, devait se faire sentir d’autant plus vivement qu’au futur il v a accord complet entre eris, erit, erimus, eritls et bis, bit, bimus, bitis. Il était naturel que la langue cherchât à établir le même accord à l’imparfait. Ajoutez à cela que pour ceux qui pariaient le latin, toute la différence entre l’imparfait et le futur résidait dans la voyelle qui précède la désinence personnelle : le contraste entre Yâ long de l’imparfait et Yï bref du futur ne pouvait que contribuer à la clarté du discours. Il est impossible, si ion se renferme dans la langue latine, de voir que i i n’est pas une simple voyelle de liaison, mais la véritable expression du futur1, et qu’au contraire Yâ n’est pas l’expression du passé, mais une voyelle caractéristique de la classe.
S 533. Augment temporel en sanscrit, devant les racines commençant par i, î, u, à et r.
Devant les racines commençant par i, î, u, û on r, Taugment sanscrit ne suit pas les lois phoniques ordinaires, suivant lesquelles il aurait dû donner ê (= a + i ou a + î), â (= a + u ou a + u) et ar (= a + r). Au lieu d’un ê nous avons âi, au lieu d’un â nous avons au, et au lieu de ar nous avons «r*. Ainsi ic «désirer»276 277 fait âtcam «je désirais», uks «arroser» fait âûksam «j’arrosais». Il est difficiles de dire avec certitude la raison de cette exception aux règles habituelles. Peut-être est-ce à cause de l’importance que Taugment a pour la signification du verbe, qu’ici le vriddhi remplace Taugment; il ne pouvait être indifférent que Tas restât parfaitement perceptible à l’oreille et ne se confondît pas avec la voyelle suivante. Peut-être aussi l’exemple des verbes de la première classe278, qui prennent le gouna quand ils se terminent par une seule consonne, a-t-il entraîne les racines n’ayant pas droit au gouna : âîcam serait alors pour a-êcam, quoique comme verbe de la sixième classe il ne doive pas changer son i en ê, et âüksam serait pour a-âksam, quoique Vu, étant suivi de deux consonnes, doive rester invariablel.
S 534. Effets différents de l’augment et du redoublement dans les verbes sanscrits commençant par i et u.
Devant les racines commençant par un a, l’augment et le redoublement produisent, en sanscrit, exactement le même effet; car quand on place devant la racine as «être » un a comme augmenl ou comme syllabe réduplicative, le résultat est toujours a-as = as. Ainsi, au parfait, as fait osa «je fus, il fut». Il il en est pas de même pour les racines commençant par i et u : ti « désirer » et us «brûler» (en latin uro) font avec l’augment âiê'\ dus; mais avec le redoublement ils font ü, ûê, qui sont la contraction régulière de i-ié, u-us. Aux personnes du singulier qui frappent la voyelle radicale du gouna, 1Y et Vu de la syllabe réduplicative s’élargissent en iy et m; on a donc iy-ê’êa «je désirai», uv-osa «je brûlai», en regard des pluriels dépourvus du gouna îéimâ, mima. 279
Paugment et le redoublement produisent le même effet. Ce nest pas une raison pour nier Pexistence du redoublement : on vient de voir(§ 534) par les formes comme Utmâ tcnous désirâmes », ûsimd «nous brûlâmes » (pour i-isitna, u-usima), que ce redoublement existe en sanscrit. Je crois donc que les verbes grecs qui changent un i bref ou un v bref en ï} s, comme *ïxéreuov, e«£STst;xa, <rv€pi%ov9 c'vGpto-(mt, doivent cette longue au redoublement, en d autres termes que l’ï est pour t + t et Pü pour v + y. Pourquoi, en effet, e + i aurait-il donné î, quand partout ailleurs il donne es, et que cette diphthongue est si familière au grec que parfois les verbes commençant par un s prennent à Paugment un et au lieu d’un On en peut dire autant pour Pt/, car la diphthongue ev est très-usitée en grec. De même, je reconnais le redoublement dans le changement de Po initial en car e + o devraient donner ov et non
Remarque. — Examen d’une hypothèse de Kühner sur i’augment temporel. — Kühner2 fait consister Paugment temporel dans la répétition de la voyelle initiale. Cette explication, en ce qui concerne les verbes comme ïnérevov, üSpt^or, ''v€pt<r(iat, oipiXeov, c&p/Àjpta, est d’accord avec celle que nous venons de donner. Mais elle me paraît conçue en des termes trop généraux, car il en faudrait conclure que les verbes commençant par une voyelle n’ont jamais de véritable augment : il faudrait regarder, par exemple, comme n étant pas absolument identiques le grec rjcrav et le sanscrit a'sant car la de âsan se compose de l’augment (c’est-à-dire d’un élément étranger à la racine) et de la voyelle radicale, tandis que l’a; de yjaav contiendrait la voyelle radicale répétée ou redoublée; la ressemblance de asan et de vcrav serait donc en partie fortuite.
Quoi qu’il en soit, si l’on fait abstraction du sanscrit, l’explication de
1 H est vrai qu’on trouve dans certaines formes dialectales un w remplaçant ov; ainsi le dorien fait réS vé[xo, tms v6\lws. Mais ce sont là des exceptions. On pourrait dire aussi, à la rigueur, que IV» grec étant sorti d’un ancien a et Paugment ayant d’abord été lui-même un <x, ces deux voyelles ont donné une longue qui est représentée par IV
2 Grammaire grecque développée, S qq.
Külmer pourrait convenir à la langue grecque, et j’aimerais mieux, avec lui, n’accorder que le redoublement aux verbes commençant par une voyelle que de voir partout l’augment, comme le font quelques grammaires grecques.
§ 536. Imparfait moyen.
Au moyen, l’accord est complet entre le sanscrit, le zend et le grec, à la troisième personne du singulier et du pluriel. On peut comparer ê(pép-s-TO, èCpép-o-vzo avec le sanscrit dBar~a~taf (tiar-a-nta, et le zend abar-a-ta, abar-a-nta.
A la deuxième personne du singulier, êSeix-vv-cro présente la même désinence que le zend urûrucfii-sa «tu grandis»280 (S 469).
Dans la première conjugaison principale, Taccord entre le grec et le zend est un peu moins évident, parce que le zend a changé la désinence primitive sa en nha (§ 56#) et que le grec a contracté s-o-o en ou. On a donc êtyépov (pour êtpép-e-cro) en regard du zend abar-an-ka ou bar~an~ha, La forme sanscrite est â-Bar-a-tâs (S 469). A la première personne, le sanscrit est beaucoup plus altéré que le grec : il a dBarê (pour dBar-a-i) en regard de éÇep-o~[tyv2. A la première personne du pluriel, êtpep-o-peda est plus près du zend bar-â-maide que du sanscrit âBar-â-mahi (§ 479). La deuxième personne ètyép-e-aQe3 répond au sanscrit dBar-a-dvam (pourdBar-a-ddvamy Au duel, nous avons en grec ê(pép-e-<T6ov9 êtyep-é-aOtiv ( pour êtysp-s-rlov, eÇep-s-T7»/i/}4, et en sanscrit aBarêtâm, dBarêtâm ( pour dBar-a-âlâm} Sar-a-âtâni)5.
Nous avons dit plus haut (§ h'jh) que la forme primitive était
flmit.p. nilnr-n-tâtaM. àbav-fi-tatafft.
ORIGINE DE L’ADGüIENT.
S 537. Identité de Faugment et de Va privatit.
Je regarde l’augment comme originairement identique avec l’« privatif : c’est l’expression de la négation du présent. J’ai déjà émis cette idée dans les Annales de littérature orientale \ et elle a été appuyée depuis par Ag. Benary 2 et par Hartung3. Elle a été, au contraire, combattue par Lassen 4. Ce savant refuse , en général. de croire que les désinences grammaticales aient pu se former par adjonction : il doute, par exemple, que le verbe substantif joue un rôle quelconque dans la conjugaison des verbes attributifs, quoique sa présence, à certains temps, soit aussi évidente que possible. Je ne puis donc pas m étonner que mon explication de l’augment lui ait paru le comble du système dit d’agglutination. Comment croire, dit M. Lassen, que pour signifier «j’ai vus, l’homme primitif ait dit : « je ne vois pas»? Mais l’homme primitif n’a point dît « je ne vois pas » au lieu de «j’ai vu n. La particule négative doit être entendue comme portant uniquement sur le présent, et non sur l’action elle-même. En général, le sanscrit emploie, dans certains composés, ses particules négatives d’une manière qui peut d’abord paraître étrange, jusqu’à ce qu’on découvre la vraie intention du langage. Ainsi l’oprivatif, placé devant l’adjectif uttamd-s «le plus haut», en renforce la signification : an-uttamas5, loin de signifier «le
1 Londres, 1820.
1 Annales de critique scientifique, i833, p. 36 etsuiv.
:i Théorie des particules grecques, II, p. no.
4 Bibliothèque indienne d’Àuguste-Guillaume Schlegel, III, p. 78.
5 Va privatif placé devant un mot commençant par une voyelle se fait suivre
comme en grec, d’une nasale.
moins haut» ou «le plus bas», veut dire «le plus haut de tous». Comment expliquer ce fait? c’est que anuttama-s est un composé possessif, comme, par exemple, abala-s (de « privatif et bala «force») «n’ayant point de force, faible». Le sens propre de anuttama-s est «qui altissimum non habet», et, par conséquent, «quo nemo altior est». D’après cet exemple, on devrait croire que chaque superlatif ou comparatif peut être employé d’une façon analogue, et que apunyâîama-s ou apunyatara-s signifie «le plus pur». Mais il n’en est rien : la langue n’a pas fait un plus ample usage de cette faculté, ou, s’il est permis de parler ainsi, elle n’a pas renouvelé deux fois ce caprice. Du moins, je ne connais pas un second superlatif de cette espèce.
Autre exemple. Le mot eka signifie « un » : on croit peut-être que anêka ou nâika (pour 7ia-êka) signifieront «pas un». Mais de même que la force négative de l’augment, dans les verbes, porte seulement sur l’idée accessoire du présent, et non sur l’acte lui-même, de même les préfixes an ou na naffectent ni l’existence, ni la personnalité1, ni même 1 unité de êka281 282, mais seulement l’idée accessoire de la limitation a 1 unité. H n y aurait rien de surprenant à ce que anêka et nâika signifiassent au duel « deux », au pluriel « trois » ou quelque autre nombre plus élevé; ils pourraient encore signifier «peu» ou «quelques-uns». Mais l’usage en a décidé autrement et ces deux mots veulent dire «beaucoup».
L’usage a décidé aussi du sens de l’augment : d-vêdam, formé de vé'dmi «je sais», aurait pu signifier aussi bien «je saurai» que «je savais». C’est pour le passé que l’usage s est prononcé. Il est vrai que le passé forme avec le présent un contraste plus sensible que le futur, car le passé est irrévocablement perdu et
va toujours s’éloignant, au lieu que le futur, qui constamment se rapproche de nous, tend de plus en plus a devenir le présent. C’est ce qu’a parfaitement senti le langage : aussi trouvons-nous souvent le présent employé dans le sens du futur.
Remarque. — Examen d’une objection de Vorlândei*. — Vorîànder, dans son écrit intitulé Esquisse d’une science organique de l’âme humaine, dit : rc La négation du présent n’est pas encore le passé \ » On pourrait dire avec la même raison : la négation de l’unité n’est pas encore le grand nombre. En effet, la négation de l’unité pourrait signifier deux, trois, ou encore le néant : ce qui n’empêche pas que le grand nombre, comme on vient de le voir, est exprimé par la négation de l’unité, ou du moins par la négation de la limitation a l’unité. Ajoutons que si la négation Uu présent nest pas encore le passé, si la négation de l’unité n est pas encore le grand nombre, du moins le passé est une négation du présent et le grand nombre est une négation, une transgression de limité. Voila pourquoi 1 une et 1 autre idée sont exprimées à l’aide de particules négatives.
Inversement, en certains cas, la négation peut être marquée par une expression dn passé. Dans sa ballade de l’apprenti sorcier, Goethe fait dire au magicien s’adressant à ses balais transformés en porteurs d’eau :
Besen, Besen,
Scid’s gewesen !
Balais, balais! l’ayez été N, c’est-à-dire me le soyez plus!».
En général, le langage n’exprime rien d’une façon complète : en toute occasion, il se contente de faire ressortir le signe le plus saillant, ou du moins celui qui lui paraît tel. C’est la tâche de l’étymologie de retrouver ce signe. L’éléphant s’appelle en sanscrit «le dentu» (dantm), le lion s’appelle ?rle chevelu» (kêstn), quoique le dentu ne soit pas encore un éléphant, ni le chevelu un lion. À son tour, le mot dània «dent» peut donner lieu à une observation analogue : car, qu’on le fasse venir de ad «manger» (avec suppression de IV») ou de dans «mordre» (avec suppression de la sifflante), on peut dire que ce qui mange ou ce qui mord n’est pas encore pour cela une dent (ce pourrait être aussi un chien ou une bouche). Ainsi, le langage tourne dans un cercle d’expressions incomplètes, marquant incomplètement
les objets à l’aide d’une qualité qui elle-même est désignée d’une manière incomplète. Cependant, comme de tous les attributs du passé, le plus saillant, sans aucun doute, c’est de n’être plus présent, le présent accompagné de la négation est une expression mieux justifiée que ne l’est, par exemple, appliqué h Féléphant, le mot dantin.
S 538. L'a privatif et fa de l’augment ne se comportent pas de la même manière devant une racine commençant par une voyelle.
Quand la privatif, pris dans son sens propre, cest-à-dire comme négation, vient se placer en sanscrit ou en grec devant un mot commençant par une voyelle, il se fait suivre d’un n euphonique. Nous avons vu (S 629) qu’au contraire l’augment, dans les deux idiomes, se fond avec la voyelle suivante. Mais je ne crois pas que ce soit là uîie raison pour attribuer une origine différente aux deux particules. La grammaire sanscrite nous présente des faits analogues : ainsi l’adjectif svâdü «doux» fait à l’instrumental féminin svâdv-a, au lieu qu’au masculin et au neutre il évite l’hiatus, non par le changement de Vu en v, mais par l’insertion d’un n euphonique (§ i58). C’est de la même façon que se distinguent Faugment et l’a privatif ordinaire : ils emploient des voies différentes pour éviter 1 hiatus. Cette distinction, quoique certainement ancienne, puisque le grec et le sanscrit la présentent l’un et l’autre, doit cependant appartenir à une époque ou la force négative de laugment n’était plus perçue, et où il' servait déjà d’exposant au passé, sans qu’on en pût dire la raison. En général, la condition requise pour que les mots ou parties de mots exprimant des relations grammaticales deviennent de vraies formes grammaticales, c’est que le motif pour lequel il en est ainsi ait été oublié. Le s, par exemple, qui exprime le nominatif, n’est devenu 1 exposant d’une relation casuelle déterminée que quand le sentiment de son identité avec le thème pronominal sa fut eteint (§ i36).
% 53g. Le « des particules privatives m, en latin, et un, en allemand,
, est-il primitif?
Quoique je regarde la particule privative in, en latin, et un, en allemand, comme de même famille que Va privatif sanscrit et grec, je n’en voudrais pas conclure qu’il y avait originairement une nasale à côté de Y a. En effet, nous avons ici trois témoins, le sanscrit, le zend et le grec, qui déposent en faveur de l’opinion commune, savoir que le n est une insertion euphonique; il faut jouter que ces trois langues se distinguent, en général, par un état de conservation plus parfait que le latin et l’allemand. Nous ne devons pas nous étonner qu’une insertion euphonique très-fréquente soit devenue constante dans un ou dans plusieurs idiomes, la langue ?y étant peu à peu tellement habituée qu’elle n’a plus pu s’en passer. Il faut remarquer, en outre, que les idiomes germaniques ont une grande propension à prendre un n inorganique, même là ou l’euphonie ne l’exigeait pas : c’est pour cette raison qu’un si grand nombre de mots de la déclinaison à voyelle ont passé dans la déclinaison des thèmes en n, appelée par Grimm la déclinaison faible. Ainsi le sanscrit vidavâ « veuve», en latin vidua, en ancien slave vïdova (à la fois thème et nominatif), est devenu en gothique viduvon (génitif viduvôn-s) \
Si, cependant, an était en sanscrit la forme primitive du préfixe en question, son n n’en tomberait pas moins, non-seulement devant les consonnes, mais encore devant les voyelles. C’est une règle générale, en sanscrit, que les mots finissant par n perdent cette consonne au commencement d’un composé : rdgan « roi » suivi de putra « enfant » fait râga-putra « enfant de roi » ; suivi de indra «prince», il fait râgêndra2. En ce qui concerne
1 Au nominatif, le n est rejeté (S i4o), ce qui donne viduvo.
* Après la suppression de n, l’a de rtiigan, en se combinant avec IV, fait ê (= « -4* » ) les lois phoniques, les particules inséparables obéissent au même principe que les mots pouvant être employés hors de composition. En conséquence, si la forme primitive était an, il faudrait expliquer dune autre manière la différence qui sest établie, dans la suite des temps, entre l’augment et la particule négative : l’augment, conformément au principe général, aurait rejeté son n devant les voyelles comme devant les consonnes, au lieu que la particule n’aurait supprimé son n que devant les consonnes.
S oh o. L’æ privatif et ïa de faugment peuvent être rapportés
à un pronom démonstratif.
La négation n’étant que l’exclusion ou l'éloignement dune chose ou d’une qualité, nous avons cru pouvoir rattacher les particules négatives a et na aux thèmes pronominaux a et na, servant à désigner les objets éloignés (§ 371). En supposant que an soit la forme primitive de l’a privatif et de l’augment, on pourrait le rattacher au thème démonstratif ana, en lithuanien anà-s ou ans, en slave onü1 « celui-là ».
Si l’on admet cette origine pronominale de la négation, il se présente pour l’identité de l’augment et de l’a privatif une autre explication, qui d’ailleurs ne s’écarte pas, quant au fond, de ce que nous avons dit plus haut. Le langage, peut-on dire, en plaçant un a devant les verbes, n’a pas songé à l’a négatif, et il n’a pas eu l’intention de nier le présent : il a entendu employer le pronom a, pris dans le sens de « celui-là», et il a voulu, de cette façon, rejeter l’action dans le lointain, la reléguer dans le temps disparu derrière nous. Le langage se serait donc contenté de recourir au même procédé qu’il avait employé une première fois en créant les expressions négatives. D’après cette hypothèse, l’augment ne serait pas, avec l’a privatif, dans un rapport de
1
Thème ono (S 373).
filiation : ils se trouveraient l’un et l’autre sur la même ligne. Tous deux viendraient immédiatement du pronom, au lieu que, selon la première explication, on arrive d abord du pronom à la négation, et de celle-ci à l’expression du passé considéré dans son opposition avec le présent.
D’après l’interprétation que nous venons de proposer, le rôle de l’augment pourrait se comparer à celui que joue, en sanscrit, la particule ^ sma construite avec un présent : cette particule, qui forme alors un mot à part, donne au présent le sens du passé. Je la regarde comme identique avec le sma, pronom de la troisième personne, que nous avons trouvé en composition dans asmê' nous v, yusmê1 « vous», et dans beaucoup de pronoms de la troisième personne1. Employé comme expression du passé, sma doit être entendu dans le sens de k celui-là, là-bas, au loin»2.
G. de Humboldt a expliqué d’après le même principe le mot na, qui sert, en tagalien et en tonga, comme expression du passé. Je rattache ce na au thème démonstratif sanscrit na, et, par conséquent, d’une manière indirecte, à la particule négative nas. Rappelons, à ce sujet, que l’expression du futur, en tonga et en madécasse, peut se ramener également à un thème démonstratif : le tonga te se rapporterait au thème sanscrit ta4 et le madécasse ho au thème ^ sa (S 345)283.
<le la particule négative est resté a en grec. Nous voyons de même que le parfait sanscrit tutopa1 «je frappai, il frappa» est représenté à la première personne par réru^a, à la troisième
par Térvtys.
Il est certain qu’en se renfermant dans la langue grecque, il était impossible de soupçonner la parenté de faugment et de la privatif, puisque ces deux préfixes ne semblent pas moins éloignés par la forme que par le sens. Buttmann284 285 286 fait sortir laugment du redoublement : ërvnlov, selon lui, serait pour réru-tîIov. Mais il suffit de mettre à côté de l’imparfait erviflov le sanscrit dtopam, et à côté de rérv<pct le sanscrit tutopa, pour montrer que cette explication ne se peut soutenir. Les prétérits augmentés n’ont pas, en sanscrit, le moindre rapport avec le parfait redoublé : celui-ci fait toujours entrer dans la syllabe réduplieative la voyelle radicale (en l’abrégeant, si elle est longue), au lieu que l’augment consiste toujours dans un a, quelle que soit la voyelle de la racine. Une explication de celte sorte ne serait possible à la rigueur que si, au lieu d’un a, i’aug-ment consistait dans un i, parce que les syllabes réduplicatives, pour alléger leur poids, substituent volontiers un i à un et quelquefois môme à un u 287.
Dans ses Recherches étymologiques288, Pott suppose que l’aug-
ment est une sorte de variété du redoublement; selon lui, l'a de l’augment devrait être regardé comme un son neutre destiné à représenter toutes les voyelles. Cette hypothèse me paraît très-peu vraisemblable : elle serait admissible tout au plus pour les verbes qui ont affaibli un a radical en u ou en i\ et il faudrait supposer que l’augment appartient à une époque antérieure à cet affaiblissement.
Si pourtant Ton voulait, malgré tout, voir dans laugment une sorte de redoublement, j’aimerais mieux admettre que les voyelles radicales t, î, u, u ont été frappées du gouna, et que 1a du gouna est seul demeuré : çt^âvêdam, par exemple, serait
pour êvêdam (== awaidüTii^, qui lui-meme serait pour vawaidum.
AORISTE.
8 54a. Les sept formations de l’aoriste sanscrit. — Première formation.
Dans ma Grammaire sanscrite, j’ai appelé le second prétérit augmenté le prétérit multiforme, parce qu’il a sept formations différentes. Il représente, sous les réserves exprimées plus haut (§ 5i3), l’aoriste grec. Quatre formations répondent plus ou moins exactement à l’aoriste premier, et les trois autres à l’aoriste second.
Les quatre formations qui s’accordent avec l’aoriste premier ajoutent toutes un s à la racine, soit immédiatement, soit a 1 aide de la voyelle de liaison i. Dans ce s'2, je reconnais le verbe substantif. La première formation nous représente très-exactement l’imparfait du verbe as, avec cette seule différence que Yâ de asam, asîs, etc. est supprimé et qu’à la troisième personne du pluriel, au lieu de (â)san, nous avons {â)sus. On ne doit pas être surpris de la perte de Yâ, puisqu’il contient l’augment, qui,
1 Et non pour les racines qui, de toute antiquité, ont eu un u ou un i. — Tr.
2 Qui, dans certaines positions, devient ^ é (S aib).
dans le temps en question, est déjà exprimé devant la racine du verbe principal ; quant à Ya bref qui reste, après la suppression de l’augment, il devait, en composition, se perdre d’autant plus aisément qu’au présent il manque même dans le verbe simple, devant les désinences.pesantes du duel et du pluriel (S 48o). Entre le présent smas tenons sommes » et la syllabe finale des aoristes comme dksâip-snia te nous jetâmes «l, la seule différence réside donc dans le s final; mais celui-ci devait être supprimé à Taoriste, puisque ce temps prend les désinences secondaires.
Quant au changement de an en us, à la troisième personne du pluriel, par exemple dans dkêâip-sits (pour dleéâip-san), il vient de ce que us est une désinence plus légère que an. Nous voyons le même changement à l’imparfait des racines réduplicatives; exemple : âbiBar-us «ils portaient?? (pour âbiBar-m). C’est pour éviter la surcharge causée par le redoublement que nous avons abiBar-us, de même quon a dksâip-sus à cause de la surcharge résultant de la combinaison avec le verbe attributif.
% 543. Mutilation du verbe auxiliaire annexe.
Devant les désinences personnelles commençant par un t, un l ou un d\ les racines finissant par une consonne autre que n rejettent le s du verbe substantif : celte suppression est destinée a éviter la rencontre désagréable de trois consonnes. On a donc dksâip-ta «vous jetâtes?? (pour dkêâip-sta), de même qu’au parfait passif grec les racines terminées par une consonne rejettent le cr des désinences aOov, <j6e; exemples : tstu06s, Térayde (pour Téra§fe). C’est la même raison qui fait aussi que la racine sia. «être debout?? perd sa sifflante, quand celle-ci se trouve en contact immédiat avec le préfixe ut; exemple : ut-tita «levér (pour ut-stita).
1 Racine ksip «jeter*.
§ 566. Imparfait moyen du verbe substantif.
Avant de passer à l’aoriste moyen, il est nécessaire de donner le tableau de l’imparfait moyen du verbe substantif. Sauf en composition, ces formes sont presque complètement sorties de l’usage \
|
SINGULIER. |
DUEL. |
PLURIEL. |
|
A* * asi |
asvalil * |
dsmahi • |
|
A* Ç A ustas |
asâtâm |
addvam ou ddvmn |
|
asta |
asâtâm |
asata. |
§ 565. Tableau de la première formation de Taoriste sanscrit.
Comme modèle de la première formation de 1 aoriste sanscrit, nous prenons la racine finissant par une voyelle nî r conduire », et la racine finissant par une consonne kêip « jeter». Les racines terminées par une voyelle prennent à l’actif le vrid-dhi, et au moyen, à cause de ses désinences généralement plus pesantes, le gouna. Les racines terminées par une consonne prennent à l’actif également le vriddhi; au moyen, elles présentent la voyelle radicale pure.
ACTIF.
Singulier.
Duel.
Pluriel.
dnâisam289 290 àksâipsam ânâiéîs dksâipsîs
(inâisît âksâipsît
dtiâisva âkMipsva dnâiêtam dkêâiptam291 dnâiStdm âksâiptâm
dnâièma âksâipsma
ânâièta dMmpta
ânâiêus âksâipsus
MOYBN.
ânêêvahi
ânêsâiâm
dnêêâtâm
Dueî.
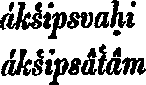
âJcêipsâtâm
Pluriel.
dnêsmahi ânêddvam1 ânêèata2
âldipsmatii
dksibdvam
àJcsipsata.
§ 546. Les parfaits latins en si. — Le parfait latin est un ancien aoriste.
U y a une ressemblance surprenante entre le moyen aksipsi et les parfaits latins comme scripsî : si l’on fait abstraction de la quantité de Yî final, la forme latine est la représentation parfaite de la forme sanscrite.
La troisième personne scripsit s’accorde mieux avec l’actif âksâipsît, qui sans vriddhi ferait dkêipdt; de même veæit (vec-sit) avec ^m^t^àvâlcsît et il transporta». Au contraire, la première personne vexî ressemble au moyen mqfq dvaksi3.
A la deuxième personne, nous avons veæistî, qui peut être rapporté au moyen dkêip-ias!i (pour dkmpsiâs); le s final est tombé et l’a s’est affaibli en î5.
Ainsi le parfait latin, qu’on aurait aussi bien, d’après sa signification, le droit d’appeler un aoriste, n’a rien de commun
avec le parfait grec et sanscrit1. Je crois pouvoir en rapporter toutes les formes, sans en excepter les formes redoublées comme cucurri, motnordi, cecim, à 1 aoriste sanscrit293 294. Nous avons, en effet, des aoristes comme dcûéuram, moyen dcâcurê (racine cur «voler»), et êitéQpaSov, sm<pvov295. Cucurri, momordi, cecini ont donc simplement perdu l’augment, comme l’ont perdu scripm, vend, mansi, et comme l’a perdu aussi 1 imparfait; cest cette absence de l’augment qui leur donne l’aspect des parfaits grecs et sanscrits.
S 547. Cause de l’allongement de la voyelle radicale, dans les parfaits latins comme scâbi, vidi, lêgi,fugi,fodi.
Les parfaits latins comme scâbi, indi, Ugi, fêgi, fâdi, pourraient, si l’on faisait abstraction de la voyelle longue, être comparés aux aoristes comme dlipam (moyen âlipê), en sanscrit, et ekmov, en grec. Mais l’allongement de la voyelle, en latin, s’oppose à ce rapprochement. Je crois donc que les parfaits en question appartiennent à la septième formation sanscrite (dcâ-éuram, dcûéurê, § 58o) : Us contiennent un redoublement caché, comme certains prétérits allemands, tels que htess «j’appelai, il appela» (= vieux haut-allemand kiaz, gothique haikail). Je reconnais dans lêgi, scâbi, fâgi, fôdi des contractions pour le-egi, sca-abi, fu-ugi, fo-odi, qui sont eux-mêmes pour hlegi, scacabi,Jufugi, fofodi. Comme la consonne de (a deuxième syllabe a été supprimée, celle de la première 11’a plus l’air d’appartenir
à une syllabe réduplicative : c’est ainsi que dans le grec yïvofjiat (pour yi-yév-o-{iou ) le 7 a l’air d’appartenir à la syllabe radicale, quoique en réalité le v seul, dans yiv, représente la racine296.
§ 548. Changement de la voyelle radicale, dans les parfaits latins
comme cêpi, frêgi, fêci
Dans les formes comme cêpi, frêgi, fêci, il y a sans aucun doute un redoublement297 298. Si c’étaient des parfaits, on les pourrait rapprocher des formes sanscrites telles que têpimd «nous brûlâmes» (§ 605). Comme aoristes, je les rapporte à la septième formation sanscrite : de même que ânêêam «je
succombai» est pour ananisam, dont le deuxième n a été supprimé299, de même cêpi est une contraction pour cacipi On a vu (§ 5) que Yê latin, quand il est pour a-i-i, correspond parfois à Xè sanscrit. Dans la seconde syllabe, l’a radical est affaibli en i, à cause de la surcharge produite par le redoublement : on peut rapprocher des formes supposées cacipi, fafici les formes réellement usitées cecinî, tetigi. Mais la contraction de cêpi, fêci, frêgi doit remonter à une époque ou Va de la syllabe réduplicative n’était pas encore, comme dans cecini, tetigi, affaibli en e.
Cependant, on peut aussi faire venir cêpi, fêci de cecipi, fefici,
par les formes intermédiaires cëipi, fëici; la première voyelle, après avoir absorbé la seconde, se serait allongée, comme nous avons au subjonctif legâs, legâmus, pour legais, legaimm.
Le parfait êgi mérite une mention spéciale : il différé defêci, cêpi, en ce qu’il n’a pas perdu <L consonne entre les deux éléments dont est composé son ê, c’est-à-dire entre la syllabe ré-duplicative et la syllabe radicale ; êgi est la contraction de a-igi ou o-igl On peut expliquer de la même manière AK, êmi (pour e-edi, e-emi). Toutefois, comme nous reconnaissons dans les parfaits latins d’anciens aoristes, on pourrait aussi voir dans êgi, êdi, êmi un reste de l’augment.
S 5^9* Les désinences stî, stis (amavistî, amavistis) du parfait latin.
Je reviens à la désinence stî du parfait latin. Dans le tî de serp-sisti, vexisli, cucuirisli, cêpisti, nous avons cru devoir reconnaître la désinence moyenne tâs, et dans le parfait latin un ancien aoriste. Si cette explication est juste, serpsistî sera un aoriste de la quatrième formation plutôt que de la première L 11 est vrai que la quatrième formation est inusitée, en sanscrit, au moyen, et, pour les racines finissant par une consonne, également à l’actif. Mais il n’est pas vraisemblable que, dans le principe, elle ait été d’un usage aussi restreint : à côté de l’actif ayâsisam (racine yâ « aller »] on peut supposer un ancien moyen dont la seconde personne devait être âyâ-sistâs; c’est à cette forme que correspondrait le latin serp-sislî. Le sanscrit sarp, srp ttaller», en lui supposant un aoriste moyen de la quatrième formation, ferait dsrp-sisiâs.
A l’égard de la lettre s qui précède, au singulier et au pluriel, la désinence de la seconde personne (cêpisti, cêpi-stis; 296
cucum-sti, cucurri-stis; serpsi-sti, serpsi-stis), on peut ericore noter en sanscrit un autre fait analogue. Le précatif296 moyen, qui unit également à la racine le s du verbe substantif (soit immédiatement, soit à l’aide de la voyelle de liaison i), fait précéder d’un autre s les désinences personnelles commençant par un t ou un i : ce second $, qui peut-être est purement euphonique, se change en i sous l’influence de Yî précédent. Ainsi la racine sarp, srp, si elle était usitée au moyen, ferait au précatif srpsîUâs, srpsîkta (deuxième et troisième personnes du singulier), srpsîyâslâm, srpsîyâstâm (deuxième, et troisième personnes du duel). La forme srpsîktâs est très-proche du latin serp-s-i-stî, bien qu’il faille faire cette distinction que IV latin est simplement une voyelle de liaison, tandis que Yî sanscrit est l’expression du mode. Les formes de précatif que nous venons de citer sont d’ailleurs les seules qui insèrent une deuxième sifflante : la première personne du pluriel est srpsî-mahi en sanscrit, de même que nous avons serpsimus (et non serpsismus) en latin. Non pas que le sanscrit ne supporte le groupe sm; nous le trouvons, par exemple, à la troisième formation de l’aoriste, abo-disma «nous sûmes», moyen àhôdikmaliL
$ 55o. Exemples de désinences du moyen introduites h l’actif.
De ce qui précède, nous croyons pouvoir conclure qua la deuxième personne du singulier, le temps improprement appelé parfait en latin contient une désinence moyenne; mais la langue n’a plus conscience de l’origine de cette forme et elle i emploie comme une terminaison de l’actif transitif. Quoique le grec ait parfaitement conservé son moyen, il a également intercalé dans son actif une désinence moyenne; nous voulons parler de la troisième personne de l’impératif, où (pepovtcov répond aussi 300
exactement que possible au sanscrit Bârantâm. Dans les idiomes où le moyen ne s’est conservé que par fragments, il est naturel que les formes qui subsistent aient servi à combler des lacunes de l’actif1; d’autres fois, quand la forme active est restée, le moyen vient prendre place à côté d’elle, comme une variante à signification identique.
$ 551. La syllabe si dans les formes latines comme vec-si-mm, die-si-nm.
Nous avons rapproché plus haut (§ 546) les premières personnes comme vexî, mansî des formes sanscrites comme uvaksi, dmahsi. Mais je ne crois pas que l’identité s’étende jusqu’à la voyelle finale. On peut expliquer l’i latin comme provenant d’un ancien a, de sorte que sî fera le pendant du crct grec dans eXv-aa, ënrn-oa. En effet, ce n’est pas à la première formation de l’aoriste, mais à la deuxième, que je rapporte aujourd’hui le parfait latin en sî, au moins à la plupart de ses personnes301 302.
La seconde formation de l’aoriste insère un a entre le s du verbe substantif et les désinences personnelles. Cet a est traite à peu près de la même manière que Va des verbes de la première et de la sixième classe303 : ainsi on l’allonge à la première personne du duel et du pluriel, devant les désinences va et ma. De même que vâh-a-si, vâk-a-ti, vâh-a-ta deviennent en latin rch-i-s, veh-i-t, veh-i-tis, de même que vâh-â-mas devient veh-i-mus, il est naturel de supposer que dans dic-si-stî, dic-si-t, dic-si-mus, dic-si-stis, la syllabe si répond au sa, sa304 de la for-
mation en question et au grec crût. Conséquemment, dic-si-mus répondra à êSelx-enx-f*er, ddik-sâ-ma, et dic-si-stis à êSetx-cm-Te* ddik-sa-ta.
D’après ce qui précède, la parenté entre vec-si~t et le sanscrit âvâk-sî-t ne serait point si étroite que je Fai admis autrefois : le latin vec-si-t suppose une forme sanscrite dvak-êa-t, de même qu’en regard de dic-si-t nous trouvons effectivement ddik-sa-t (grec eSetx-crs, pour ëSstx-aa-r1 ).
La deuxième personne dic-si-stî correspondra au moyen ddik-sa-tâs «tu montras??, si l’on voit dans le second s une lettre euphonique 2. »
S 55a. La première personne du singulier du parfait latin.
Même en rapportant les parfaits latins en sî à la deuxième formation de Faoriste sanscrit, il n’en reste pas moins très-vraisemblable que la première personne du singulier appartient au moyen. En effet, Fa de la deuxième formation sanscrite est supprimé devant Yi de la première personne du moyen; au lieu de ddik-sê (= adik-êa-i), on a donc ddik-si. H y a accord complet entre les formes latines comme dic-sî et les formes sanscrites comme adik-éi; au contraire, Faoriste actif est ddiksam, ce qui ne pouvait guère donner dixî en latin, puisque le m final s est généralement conservé dans cette langue3. De ddiksam, le latin aurait fait probablement dixim, comme il a dicêbam, dicam, dice-rem, dixertm.
Il est vrai qu’à Fépoque où le latin s’est détaché du sanscrit, il est impossible que la forme mutilée ddiksi existât déjà; c’était
1 Comparez le moyen èSetx-aa-xo = sanscrit âdik-êa-ta.
2 Le t en latin se fait volontiers précéder d’un « (S gS). [L’auteur a proposé une autre explication au S 54g. — Tr.]
3 II s’est conservé notamment à la première personne des formes secondaires. En grec, au contraire, un m final est quelquefois supprimé. Comparez êSstlfr avec âdik-sam, asàêa avec pâdarn. pedem.
probablement ddiksama ou ddikêanumi (= iSst^dfxrjv^ § 4 y 1) : mais même ces formes nous conduisent plus aisément que ddiksam au latin dtxî, car c’est précisément là où le m était encore suivi d’une voyelle que la première personne en latin a perdu sa désinence.
§ 553. La troisième personne du pluriel du parfait latin.
A la troisième personne du pluriel, nous trouvons, en regard du sanscrit ddiksan et du grec eSet^av, le latin dtxêrunl. Le r tient sans doute (comme d’habitude entre deux voyelles) la place d’un ancien s; dic-sêrunt est donc pour dic-sêsunt (comme cram, ero} pour esam, eso). Le verbe auxiliaire est redoublé ou répété, soit que dic-sêsunt doive être rattaché à la quatrième formation sanscrite1 {à-yâ-sisus, pour â-yâ-sisant), soit plutôt que la répétition du verbe auxiliaire ait été opérée dans la période latine. Une fois qu’on eut oublié le sens et l’origine de la lettre s dans dic-sî, il ne serait pas étonnant qu’on eût de nouveau combiné cette forme avec le verbe substantif2.
Le même besoin de clarté fait qu’en grec on dit hids-act-v, sOz-cra-v, quoiqu’à la première et à la seconde personne on ne dise pas èrtBé-aa-fisv, êTtÔé-cra-Te, ni êôé-cra-fJLSv, é6é-cra-7£. Une circonstance qui a pu contribuer à l’adjonction du verbe auxiliaire, c’est que, sans ce verbe, la désinence eût été trop courte : elle n’eût pas formé une syllabe. Au médio-passif, où la même raison n’existait pas, nous avons èréOe-vro, et non èrtQé-tTOL-VTo.
Le prâcrit adjoint le verbe substantif à la première personne du pluriel du présent de l’indicatif3; mais il n’en fait pas usage
1 Voyez 8 6^9.
2 C’est le besoin de clarté qui aurait amené cette nouvelle addition du verbe substantif. Mais les éléments constitutifs de dixérunt (pour dic-sêmnl) se sont si étroitement unis, que cette forme, à son tour, a pris l’apparence d’une forme simple.
3 De même, à l’impératif.
pour la deuxième et la troisième personne. Exemple : gaccamha {mita pour sma) « nous allons» 1.
S 554. Allongement de l’e dans les formes latines
comme diæêrunt.
On devrait s’attendre à avoir diæêrunt, et non diæêrunt, puisque IV, devant un r, se change ordinairement en ë bref. L’ê long de diæêrunt n’est pas moins remarquable que celui de dic-ê-bam (pour dic-i-bam). Il est probablement dû à la même cause (§ 527). Si nous avons eu raison de supposer que ¥ê de dicêbam renferme laugment, la même explication devra s’appliquer à diæêrunt (pour dic-së-erunt).
On pourra objecter que Ve est bref dans dic-ë-rem, dic-së-™305 306 307; mais l’optatif grec et le potentiel sanscrit, auxquels correspond le subjonctif latin, n’ont pas l’augment : il n’y avait donc pas de raison pour que le subjonctif l’eût en latin. Dice, dans dice-rem, représente le sanscrit disa (racine dis + caractéristique a), et dic-se (plus anciennement dic-sï) représente le sanscrit dik-éa, le grec Seix-cra,
§ 555. Deuxième formation de l'aoriste sanscrit. —
Tableau de cette formation.
La deuxième formation, qui a laissé de nombreux rejetons en grec et en latin, est d’un usage très-restreint en sanscrit. H n’y a que les racines finissant par /, s ou h (encore 11’est-ce pas la totalité) qui prennent cette formation.
Les, s ou h final se change en k devant le s du verbe auxiliaire. A son tour, ce s, à cause du h précédent, se change en
s1. On a donc ks, par exemple dans àdiksam, ddiksi «je montrai», en regard du f grec de ë$si%a et du x latin de diocP.
Je fais suivre le tableau de la deuxième formation de l'aoriste
|
sanscrit, et je place en |
regard le grec ëSet^a et le latin diæt : | |||
|
Sanscrit. |
SINGULIER. Grec. |
Latin. | ||
|
Actif. |
Moyen. |
Actif. |
——. ? Moyen. | |
|
âdik-êa-m |
àdik-si |
ëhsm-Ga |
éS etK-trâ-yLïfv |
dic-sî |
|
ââik-sa-s |
âdik~sa~tâs |
éheiK-<TCL-S |
êhsix-crm |
dic-si-sti |
|
âdik-sa-t |
âdik-êa-ta |
éheiK-CTS |
ehetn-aoL-xo |
dic-si-t |
|
âdik-sâ-va |
âdik-iâ-vaki |
DUEL. |
èhetx-Gâ-usdov | |
|
âdik-èa-tam |
âdih-êâtâm 3 |
èhelx-cra-TOv |
èhehi-<ja-fy8ov | |
|
âdik-êa-tâm |
âdik-êâtâm4 |
è$stx-<râ-Ti]v |
éSeix-cTâ-uduiv | |
|
ddik-èà-ma |
âdik-sâ-mahi * |
PLURIEL. èheix-ffa-fJisv |
èhetx-aâ-fieda |
dic-si-mus |
|
àdik-êa-ta |
âdik-sa-dvam |
èàelx-crcL-re |
èheln-Ga-crds |
dic-si-stis |
|
Mik-sa-n |
adtk-sa-nta |
êhetH-cra-v |
shslK-GCL-mo |
dic-sê-runt. |
crite, j’ai rapporté au verbe fu les parfaits latins en vi, ni; mais je crois avoir eu tort de voir dans le v ou Vu le représentant de/ Je suppose aujourd’hui que le /est tombé, à peu près comme est tombé le d de duo dans viginti, bis, bi-pes308.
S 557. Origine de ces parfaits.
Conformément à une règle générale, Vu de (f)ui s’est changé en v entre deux voyelles; mais il s’est conservé intact quand il est précédé d’une consonne. On a donc amavi, audivi, en regard de momi.
C’est pour alléger le poids du mot composé que fui a perdu son /initial. C’est ainsi que dans les mots français onze, douze, treize, la syllabe de du latin undecim, drndeci îîî, v**sdectfn a disparu2.
S 558. Le parfait point.
La preuve la plus claire que dans amavi, audivi, monta est contenu le verbe substantif nous est fournie par la forme potui. En effet, cette forme appartient à un verbe qui dans toute sa conjugaison se combine avec le verbe substantif. II fait pos-sum (pour pot-sumf pot-eram, pot-ero, pos-sim, pos-sem. Au parfait, où la racine es faisait défaut, il a eu recours hfu : de là pot-ui, pour pot-fui qui eût été trop dur. On pouvait s’attendre à avoir pof-fui; mais la langue a préféré sacrifier l’une des consonnes. Malgré cette suppression de l’un des /, je doute que personne soit tenté de voir dans potui une forme simple, contrairement à
l’analogie de tous les autres temps du même verbe. Mais si l’on accorde que pot-ui est une forme composée, force est d’en dire autant pour les parfaits comme mon-ui, ama-vi, audi-vi, sê-vi,
sî-vu
S 559. Les parfaits latins en ni, vi sont d’anciens aoristes.
Comme les parfaits en si, les parfaits en ui, vi sont, selon moi, d’anciens aoristes, en ce sens que fui, dont ils sont formés, est un aoriste. Rapprochez le latin fuit de 1 aoriste sanscrit â-Ut et de l’aoriste grec ë-Çvfô. Il me paraîtrait beaucoup plus difficile de rapporter fait au prétérit redoublé baMva, en grec vséÇüxe, car il faudrait supposer que le verbe latin a perdu le redoublement et qu’il a conservé une désinence dont, le sanscrit, le grec et le gothique sont privésl. Nous reviendrons plus loin
sur ce sujet (§ 577)-
S 56o. Troisième formation de j’aoriste sanscrit. —
Tableau de cette formation.
La troisième formation de l’aoriste sanscrit se distingue de la première, en ce que le verbe auxiliaire se joint à la racine du verbe attributif au moyen de la voyelle de liaison L Sous l’influence de cet i, le s se change en s; mais, grâce à la voyelle euphonique, il peut se maintenir dans des positions où le s de la première formation est supprimé2. Tandis que kêip, par exemple, fait à la deuxième personne du pluriel âhàâip-ta, au lieu de dksâip-sta, parce que la rencontre des trois consonnes eût
été trop dure, bud « savoirs fait abocf-i-sta.
Au contraire, à la deuxième et à la troisième personne du singulier actif, la sifflante est supprimée et l’on allonge la voyelle de liaison, probablement pour compenser cette perte. On a
1 Voyez S 610.
2 Voyez S 5/i3.
donc âboiï-U «tu sus», àbôi-U «il sut». Ces deux personnes forment, comme on voit, avec ubodr~î~s(ini et toutes les outres flexions du même temps un contraste dont il est possible de deviner la cause. Comme les désinences de la deuxième et de la troisième personne consistent simplement dans un s et un î, on aurait eu les formes âbôdtss, âbôdïit (pour dbôdîst) ; en sanscrit, suivant une règle générale, les mots terminés par deux consonnes doivent sacrifier la deuxième (§ 9A). Mais la langue a mieux aimé renoncer au verbe auxiliaire qu’au signe personnel, parce que les deux personnes seraient devenues semblables1.
Je fais suivre le tableau de l’aoriste actif et moyen de la racine bui «savoir». Les racines finissant par une consonne frappent leur voyelle du gouna à l’actif et au moyen ; les racines finissant par une voyelle ont, comme dans la première formation, le vriddhi à l’actif, le gouna au moyen. Ainsi nu «célébrer» fait ânâvisam, anaviêi.
ACTIF.
|
Singulier. |
Duel. |
Pluriel. |
|
âbô&-i-êam |
dhôd-i-sva |
dbôd-i-sma |
|
dbM-î-$ |
àbod-i-sUnn |
âbôd-i-ka * |
|
dbM-î-t |
dbôd-i-siàin |
dbôd-i-sus |
|
MOYEN. | ||
|
dbôi-i-si |
dhM-i-svahi |
àbôd'-i-sniahi |
|
âbôd-i-êîâs |
dbôd-i-sâtàm |
âbôd-i-ddram ~ |
|
àbod-i-sta |
dbod-i-sdtâm |
àbôd-i-satas. |
|
1 Cotte confusion a cependant lieu assez souvent à Tina parfait : ainsi | ||
dire «tu parlais» (pour âvak-i) et «il parlait» (pour âvak-t).
4 Pour âbôcFisdvatn.
* Au sujet de la suppression de n, voyez S /j5ç) , et comparez les formes ioniennes comme zrsnotvaTcu.
$ 561. L’aoriste en ancien slave. — Tableau comparatif de l’aoriste
en ancien slave et en sanscrit.
En ancien slave comme en sanscrit, l’aoriste supprime le verbe substantif à la deuxième et à la troisième personne du singulier, et le conserve à toutes les autresl. Mais des formes comme ^abâdh, ^*i\y£\t^dbo(lît devaient encore perdre, en slave, la consonne finale (§ 92 m). On a donc EoifAH budi «tu éveillas » en regard de âbôd-î-s «tu sus» ou «tu t’éveillas»; eoifAM budi «il éveilla» en regard de àhôd-î-t «il sut» ou «il s’éveilla»; mais E0\fAMCT£ bud-i-ste «vous éveillâtes» en regard de abod-i-éta «vous sûtes» ou «vous vous éveillâtes».
Nous donnons ici le tableau comparatif de l’aoriste slave, en nous réservant d’y revenir dans les paragraphes suivants.
SIKtiULIER. DI EL.
Ancien slave.
bud-i-chü bud-i-bud-i-
Sanscrit.
âbôd-i-sva
âbM-i-stam
*
âbM-i-kâm
Ancien slave. bud-i-chovc bud-ista bud-i-sta
Sanscrit.
d&M-i-Sam
âbôd'-t-s âbôd-î-t
PLURIEL.
as-
Sanscrit.
âbôd-i-sma
àbôd-i-sta
»
dbod-i-sus
Ancien slave. bud-i-ckomü budr-i-ste bud-i-san.
pants qu’on puisse trouver entre le sanscrit et ses frères de l’Europe. Toutefois, l’accord des deux langues n’est pas si parfait qu’on pourrait le croire à première vue. Ui du slave bud-i-chu n’a pas la même origine que celui du sanscrit dbôd-i-sam; en effet, budr-i-ti «éveiller» ne répond pas au verbe primitif bud ( présent bo(T-â-mi) d’où vient dbôd-i-êam ; il répond au causatif hoddyâmi «faire savoir, éclairer, éveiller». C’est pour cette raison que nous avons comparé plus haut (§ àk'j) la deuxième personne du présent bud-i-si au sanscrit bod-dya-si, et le premier i de chval-i-ti (§ 5oA) à la caractéristique aya de la dixième classe sanscrite. La ressemblance vient de ce que les verbes slaves conservent à l’aoriste leur caractéristique.
En réalité, l’aoriste slave appartient à la première formation sanscrite; pour s’en assurer, on peut comparer a<i?G da-chü «je donnai», AdCT€ da-ste «vous donnâtes» avec les formes sanscrites comme anâi-sam, dnâi-ila. Nous ne pouvons mettre en regard le verbe sanscrit dâf parce qu’il prend la cinquième formation (S 573): s’il prenait la première, il ferait ddâ-smn, nàà-sUt.
* 563. Insertion d’un o euphonique devant les désinences de la première personne du duel et du pluriel, en ancien slave.
A la première personne du duel et du pluriel, l’ancien slave insère un o, comme voyelle de liaison, entre le verbe auxiliaire et le signe personnel. J1 en résulte que da-ch-o-vê, da-ch-o-mü ont plutôt l’air d’appartenir à la deuxième formation sanscrite (àdtks-â-va, ddikê-â-ma = èSet^rOrfiev) qu’à la première ( dnmsva, nnàistmy Mais l’insertion de cet o est de date récente; elle a lieu pour éviter le groupe chv, chm. Le serbe, qui a conservé dans ses prétérits (à l’imparfait, comme au temps communément appelé prétérit simple) l’ancienne sifflante du verbe substantif, na pas inséré de voyelle de liaison; on a, par exemple, igramio
3
mi.
«nous jouâmes », dont le smo s’accorde très-bien avec le sma sanscrit, dans les aoristes comme âtâp-sma «nous brûlâmes».
§ 564. Aoriste des verbes correspondant aux verbes sanscrits de la dixième classe, en ancien slave et en grec.
Les vexlbes slaves qui correspondent aux verbes sanscrits de la dixième classe gardent la caractéristique à l’aoriste; elle s’y montre sous la même forme que dans la deuxième série de temps *. On a donc des aoristes en a-chü, en ê-chü et en i-chü; exemples : rüd-a-chü «je pleurai», sel-ê-chü «je désirai», gor-ê-chü «je brûlai», bud-i-chü «j’éveillai»2.
En sanscrit, les verbes de la dixième classe ne prennent pas l’auxiliaire à l’aoriste 3. Au contraire, en grec, nous avons hip-tj-aex. (^êr/fi-ôt-eraj, è(pï\-r)-<ra, êpLtaO-cû-aa, qu’on peut comparer aux aoristes slaves comme rüd-a-chü (pour rüd-a-sü). L’accord de l’ancien slave et du grec nous autorise à penser qu originairement les verbes sanscrits de la dixième classe formaient également leur aoriste par l’adjonction du verbe substantif; je suppose des formes comme ârôd-ay-i-sam, en analogie avec les futurs comme rôd-ay-i-sya-mi4.11 me parait peu vraisemblable que l’ancien slave et le grec soient arrivés, chacun de leur côté et d’une façon indépendante, à former, pour la classe des verbes en question, des aoristes aussi ressemblants que le sont, par exemple, à la troisième personne du pluriel, éTi{Â-à-crav et rüd-a-éah.
S 565. Insertion d’un o euphonique entre la racine et le verbe auxiliaire,
en ancien slave.
Les verbes slaves qui appartiennent à la première, à la sixième
1 Voyez S 5o6 et suiv.
2 Voyez S 56i et suiv.
3 Ils suivent à l'aoriste la septième formation. — Tr.
4 L’t est une voyelle de liaison (S 664).
et à la neuvième classe sanscrite1 placent, quand leur racine finit par une consonne, un o, comme voyelle de liaison, entre la racine et le verbe auxiliaire. Ils s’éloignent sur ce point de la première formation sanscrite 2. On peut comparer k€30?g ves-o-ch-ü «je transportai» avec âmk-s-am (par euphonie pour
dvâh-s-am ).
DUEL.
SINGULIER.
Sanscrit.
dvâk-s-am
Ancien slave.
ves-o-ch-ü
âvâk-sî-s ves-e
âvâk-sî-t ves-e
Sanscrit.
âvâk-s-va
âvâk-(ê)-tam
àvâk-{s)-tâm
Ancien slave.
ves-o-ch-o-vc
ves-o-s-ta
♦
ves-o-s-ta
PLURIEL.
Sanscrit.
Ancien slave.
âvâk-s-ma ves-o-ch-o-mü
âvâk-(s)-ta ves-o-s-te
âvâk-ê-m ves-o-ê-an.
S 566. Absence du verbe auxiliaire et de la désinence personnelle à la deuxième et à la troisième personne du singulier, en ancien slave.
La deuxième et la troisième personne du singulier, dans toutes les conjugaisons slaves, sont privées, a Faoriste, non-seulement de la désinence personnelle, mais encore de la consonne du verbe auxiliaire3
La suppression de la désinence personnelle était obligée (S gâm). Après cette suppression, on devrait avoir ves-o-se «tu transportas, il transporta » 4, pour faire pendant a la première
1 Voyez S 109% î et ,F>*
3 On vient de voir (S 56a) que tous les aoristes slaves qui prennent le verbe
auxiliaire appartiennent à la première formation.
1 Nous faisons abstraction ici des formes qui présentent la désinence moyenne Ta
tü — sanscrit tas, ta (S 51 a, remarque a ).
* A la deuxième personne, ves-o-Se serait pour vcs-o-se-s {= sanscrit avdk-si-s).
personne ves-o-ch-ü et à la troisième personne du pluriel ves-o-s-ah. Mais au lieu de ves-o-se, nous avons vese. Peut-être la svl-
•j
labe finale a-t-elle été supprimée et la voyelle de liaison o s’est-elle altérée en e; c’est ainsi qu’au vocatif singulier l’o final du thème, n’étant protégé par aucune désinence, s’affaiblit en e (§ 272).
Miklosich propose une autre explication. Selon ce savant, vese serait un aoriste second; cette forme serait venue s’intercaler dans l’aoriste premier, à peu près comme si hvn-vol avait perdu sa seconde et sa troisième personne du singulier, et qu’il eût remplacé £TV7i-cra-$, ÎTuit-crz par sTVTt-s-s, srun-e. Mais les verbes slaves qui correspondent à la dixième classe sanscrite (§ 5oû) ne se prêtent pas à cette hypothèse, car ils n’ont pas d’aoriste second, et ils ne peuvent pas plus en avoir que <ptXéoj ou tn&ôéoj en grec K
Mais si l’on ne veut pas supposer que eesc ves-e soit pour ves-o-ck-e(s), ves-o-ch-e(t), on peut, en modifiant l’explication de Miklosich, admettre que ves-e appartient à l’imparfait. Il correspondra alors au sanscrit dvah-a-s, avah-a-t. De même, pec-e répondra à âpac-a-s, dpac-a-t; rüd-a à drod-aya-s, arôd-aya-t; bud-i à abôd-aya-s, dbôd'-aya-t, et vid-è à dvêd-aya-s, avêd-aya-t2. On devra supposer que ces formes d’imparfait se sont introduites à l’aoriste, et que l’imparfait slave les a remplacées par des formes composées de création nouvelle (§ 5â5). Si cette explication est juste, il serait intéressant de retrouver et à la troisième personne pour vex-o-ie-l (= sanscrit âvâh-sî-t). C’est ainsi qu’à l’imparfait nous avons la désinence -ose, en regard du sanscrit ils-Î-s, a$-î-t (pour âs-a-s, Ss-a-t, S 53a).
1 Des aoristes correspondant à la sixième formation sanscrite (S 576) ne sont guère possibles en slave qu’avec des verbes comme dvig-nu-n «je remue» (S i 09 % 5), et ces verbes en possèdent effectivement.
2 Comparez les formes analogues en lithuanien (S 5a3) et les aoristes arméniens en zi (S i83b, a).
en slave, cachées au milieu de l’aoriste, deux formes de rancicn imparfait sanscrit et grec.
S 567. Aoriste des racines da et bü, en ancien slave.
Les aoristes dachü «je donnai» et esixs büchü «je fus» méritent une mention spéciale: non-seulement ils prennent, comme toutes les racines finissant par une voyelle, le verbe substantif sans le secours d’&ne voyelle de liaison, mais ils conservent la sifflante de la deuxième et de la troisième personne, en la combinant avec la désinence moyenne ts tu1. On a donc da-s-tü «tu donnas, il donna», bü-s-tü «tu fus, il fut»309 310.
Au lieu de la forme moyenne büstü, on trouve souvent, dans des manuscrits glagolitiques du xive siècle, emch bisi; Miklosich311 fait remarquer qu’il faut lire eSich büû, car les documents en question confondent souvent h et si. Cette forme bm ou büsi est employée pour la deuxième comme pour la troisième personne. La désinence si s’accorde très-bien avec les désinences sanscrites sî-8, sî-t de la première et de la quatrième formation. Ainsi, H bu, d’après la première formation, ferait âSû-s-am, dbu-sî-s, dbu-sî-1312.
Je fais suivre la conjugaison complète de raoriste des racines slaves da et bü :
SINGULIER.
DUEL.
PLURIEL.
da-ck-ü bü-ch-ü da-ch-o-vê bü-ch-o-vê da-ch-o-mü bü-ch-o-mü
da-s-tü bü-s-tü da-s-ta bü-s-ta da-s-te bü-s-te
da-s-tü bü-s-tü da-s-la bü-s-ta da-S-aii bü-s-an.
§ 568. Les aoristes grecs éScoxa, êdijxa, fjxa.
La gutturale qui remplace une ancienne sifflante dans le slave dachü et dans les formations analogues, rappelle le x des aoristes grecs ëSaxa, ë6vxa, fixa. Ce qui est de règle, en ancien slave, à la première personne des trois nombres, a bien pu arriver accidentellement en grec : nous voulons dire le changement d une sifflante primitive en gutturale. Nous supposons donc que ëSaxa est pour ëSûxm, soit que le o* se soit transformé tout d’une venue en x, soit qu’un x ait pris place aux côtés de la sifflante qui aurait fini par disparaître1; ëSoaxa viendrait alors de ëSœŒxa. Peut-être aussi un x était-il d’abord venu se placer devant le cr, comme dans pour ovv (= sanscrit sam «avec»), en sorte que ëScûxa serait pour ëS&j^a; de même, le latin cum, s’il est le congénère de êîi>, ovv, iQsam, doit peut-être s’expliquer comme étant pour xum.
S 569. Le s du verbe auxiliaire changé en k, à l’impératif lithuanien. —
Le x du parfait grec. — Le <r du parfait passif, dans la même langue2.
Ce n’est pas seulement en grec et en ancien slave que nous trouvons le s de l’aoriste changé en gutturale : le lithuanien nous présente une forme de même famille, où, à ce que je crois, un s primitif a été remplacé par un k. Je veux parler de l’impératif, qui représente le précatif sanscrit ou l’aoriste de l’optatif grec3; on a, par exemple, duk «donne», dükite «don-
1 Comparez le x qui s'est introduit, en grec, dans l’imparfait éarxov, éfoxe, et en latin, dans le futur archaïque escit. Rapprochez aussi les imparfaits et les aoristes comme Sivstieaxe, xaléeaxov, xaXéaxeTo, éfAourxe, SaGaaxeio, dans lesquels il est impossible de méconnaître la présence du verbe substantif : les formes en aa-axov, aCL-axopnv le contiennent deux fois.
4 L’auteur recherche quels sont, dans les différentes langues indo-européennes, les temps formés comme le slave dachü, et il est amené de la sorte à parier de certaines formes verbales qui n’appartiennent pas à l’aoriste. — Tr.
■1 Voyez S 93 *.
uez». en regard du sanscrit dâsidvdm aque vous eussiez donné;? (précalif moyen).
Mais si le x de ëS&xoi, ëOnxa, ÿxa est sorti d’un cr, soit immédiatement (ce que je croirais le plus volontiers)1, soit par l’intermédiaire de <rx ou f, nous sommes amenés à nous demander si le x des parfaits comme SéSoûxa ne provient pas lui-même d’un o-, et par conséquent du verbe substantif. Il est vrai qu’en sanscrit le parfait ne se combine pas avec la racine as; mais cette circonstance importe peu, car tous les temps, au fond, ont le même droit de recourir à la copule (§ 026). Nous voyons, par exemple, quen grec les imparfaits comme êSiScov et les aoristes comme ëScjv se combinent, à la troisième personne du pluriel, avec le verbe substantif (§ 553), quoiqu en sanscrit les formes correspondantes s’en abstiennent. A l’imparfait, certains dialectes grecs se servent de la forme ëaxov (§ 568), et le latin de la forme bam (S 626), quoique le sanscrit, au même temps, se prive absolument du secours du verbe substantif. Il n’est donc pas étonnant que le parfait grec emprunte un verbe auxiliaire, tandis que le parfait sanscrit emploie une iorme simple. ,
Comme la racine du verbe attributif porte déjà, au parfait, le poids du redoublement, le x ne vient se joindre qu’aux thèmes où il trouve le plus aisément accès, c’est-à-dire après une voyelle ou une liquide : nous avons, par exemple, SéStoxa, m(piXijxa, ëÇdapxa., ëalakxa, isétpayx*, mais non lérvTrxa, «ré-nXexxa. Pour éviter ces combinaisons trop dures, le x, par une sorte de substitution analogue à celle des consonnes germaniques2, est devenu h, et en se joignant, sous cette forme, a la consonne précédente, a changé le «r ou le jS en Ç, le x ou le y en ^ : on a* donc TérvÇa pour rérun-à* venant de 'lémir-xa ; «re-
1 Sur le changement inverse d’une guUuralc en cr, voyez S 109*, -2.
2 Voyez S 87, 1.
T:\zyjx pour 'sr£7rXe«-â, venant de 'zsênXex-Ka. Quant aux dentales, la langue a préféré les sacrifier complètement au x : nous avons e\|/£üxa pour ëjrevSxa, 'sréneixa pour 'srénetOxa,
Au passif, où les désinences sont plus pesantes, le verbe auxiliaire devait plus difficilement trouver accès. En regard des parfaits actifs en xa, nous ne trouvons point de parfaits passifs en xafiat (ou <ra(iai, avec maintien de la sifflante primitive), de même qu’en regard de êStSocrav, sSocrav on n’a point êStSéaavTQ, êSâaavjo. On pourrait toutefois admettre que le cr de TsréXea-txai* ë&naeruai, yvvcrjiai, qu’on explique ordinairement comme une insertion euphonique, appartient au verbe substantif1 ; nous voyons, en elfet, qu’il est traité exactement de la même manière que le cr qui tient la place d’une dentale radicale fiai, 'sséneiar-fiat) et qu il tombe seulement devant un autre cr ( isénsi-<Tat, têtéXs~<rai ). Dans les verbes en v, il y a lutte entre le v et le cr. A la première personne, une forme 'urétyavcrfiai étant impossible, il fallait opter entre 'nrétya-crfiai ou 'æéÇtafi-ficu (comparez è^pafifiat, etc.) : c’est œéÇa-o-fiat qui l’a emporté. Au contraire, à la troisième personne, on dit '&é<pav--tat et non <sfé(pa-</Jai.
Les substantifs comme (pourfia, téXs&fm, rsXe&lys ne sont pas une objection suffisante contre l’explication que nous venons de proposer. Sans faire dériver ces noms du parfait passif, on peut admettre cependant que la langue grecque, une fois habituée aux groupes <rfi, cri, les a introduits dans des formes où ils n’avaient pas la même raison d’être que dans le temps en question.
S 070. Quatrième formation de faoriste sanscrit. —
Tableau de cette formation.
La quatrième formation sanscrite donne lieu à peu de com-
1 Ce <7 se trouve surtout après une voyelle brève, quelquefois cependant après une longue (tfxotf<rp<xi).
paraisons avec les langues de l’Europe. Mais elle est importante en ce que le verbe substantif s’y étale tellement qu’il est impossible de ne pas reconnaître sa présence. Dans les formes comme âyâ-mam a j’allai », il occupe la plus grande partie du mot, et il présente deux fois sa consonne radicale; il en est de même aux autres personnes, excepté à la deuxième et à la troisième du singulier, où nous avons âyâ-sis, dyâ-sit (au lieu de dyâsis-s, iiyâsis-t) pour la même raison que, dans la troisième formation, on a dhôdis, âbôdît1.
La conjugaison complète de ayâsisam est :
SINGULIER.
dyâ-siéam
(iyâ-sîs
r 4 A.
aya-sit
DUEL.
dyâ-sism
àyâ-siêtam
dyâ-siêtâm
PLURIEL.
âyâ-sisma
dyâsista
âyâ-sisus.
^ 071. La quatrième formation est inusitée au moyen. — Elle n’est employée à l’actif qu’avec des racines finissant par une voyelle ou par m.
Au moyen, cette formation de l’aoriste n’existe pas ou est sortie de l’usage. Les désinences du moyen étaient probablement trop pesantes par elles-mêmes pour être ainsi surchargées; c’est un motif semblable qui fait qu’en grec la syllabe <jol de êSiSo-£$Q-ara~v ne se trouve pas au passif sSiSo-vto, ëSo-vTo
(S 553).
Même à l’actif, la quatrième formation n’est pas usitée pour les racines finissant par une consonne, excepté ram «jouer», nam «s’incliner», yam «dompter». Mais comme m se change, devant un s, en anousvâra (n), c’est-à-dire en un son très-faible, il n’y a pas grande différence, à l’égard de la pesanteur, entre âyâ-sisam (racine yâ) et drah-siéam, anah-siêam, dyah-sisam.
1
Voyez S 5(io.
Remarque. — Origine de la quatrième formation. — On doit se demander comment le sanscrit est arrive h la forme sisam : cette question peut être résolue de deux manières.
Ou bien (c’est l’explication que j’ai admise autrefois) sam sera la syllabe principale et si une syllabe réduplicative 1 ; ou bien il faut regarder sam comme étant venu se surajouter à la deuxième formation de l’aoriste, dans laquelle on avait cessé de sentir la présence du verbe auxiliaire. Selon cette seconde explication, que je regarde aujourd’hui comme la plus vraisemblable, la syllabe sa313 314 315, qui, à elle seule, représente déjà le verbe substantif, s’est fait suivre de nouveau du même verbe, à peu près comme serpseruni (pour serpsesunt)3 en latin. Cette syllabe sa s’est ensuite affaiblie en si. En conséquence, sisam serait pour sasam, stèva pour sasva ou sâsva, siêma pour sasma ou sâsma, stslam pour sastam, etc.
Il y a, en sanscrit, une racine qui nous présente, à certaines personnes, le même genre d’altérations phoniques : c’est la racine sas tt gouverner », qui fait au duel sistâm, éistam, au lieu de éastâm, sâslam, et au pluriel stétaf au lieu de sâstâ. ,
À la troisième personne du pluriel, nous trouvons mjA-sims, au lieu de àyâ-sisan. On a vu précédemment que us est une désinence plus légère que an (S 46g) : la racine, déjà chargée par la répétition du verbe auxiliaire, a du choisir les formes les moins pesantes. De même, la racine précitée sas, qui aime les formes affaiblies, fait à la troisième personne du pluriel de l’imparfait âsâs-us.
Nous avons aussi en grec des exemples d’un auxiliaire joint deux fois au verbe principal. Ce sont les aoristes ioniens comme è'kâaa.Gxe (pour $Aa<rs, venant de ^Aao-a-r), haerdaxero (pour èMtraro). La suppression de l’aug-raent dans ces aoristes et dans les imparfaits analogues a probablement pour cause la surcharge résultant de la répétition du verbe auxiliaire316.
S 57a. Exemples de la première et de la deuxième formation en zend.
En zend, les aoristes qui joignent le verbe substantif à la racine sont rares. Comme exemples de la première formation nous citerons : paréta, deuxième personne du pluriel
actif de la racine par «détruire» = sanscrit par, pr; mansta «il parla» = sanscrit âmahsta «il pensa» (racine man x); cest un aoriste moyen; rusta «il se leva», également un
aoriste moyen de la racine rud' (en sanscrit ruh)2.
La forme daéta «il donna» n’appartient pas à l’aoriste,
mais à l’imparfait; elle répond au sanscrit ddatta (pour adad-ta, venant de adadâ-ta — êSiSo-ro), dont le premier t doit, en zend, devenir un s (§ 109).
Comme exemple d’un aoriste de la deuxième formation, on peut citer tawsat, troisième personne du singulier actif de la racine tap «brûler»; rapprochez-en les aoristes grecs comme huir-cre.
§678. Cinquième formation, en sanscrit. — Aoriste second en grec. —
Restes de cette formation en arménien. — Laugment en arménien.
Nous passons aux formations sanscrites qui sont représentées en grec par l’aoriste second. Selon l’ordre adopté dans ma Grammaire sanscrite, ce sont les cinquième, sixième et septième formations.
La cinquième formation ajoute immédiatement les désinences personnelles à la racine : elle ne se distingue de l’imparfait que par l’absence de la caractéristique de la classe. La même diffé-
1 La racine sanscrite «urn c penser» prend en zend le sens de « parler» ; comparez le dérivé #^£6 montra «discours».
2 Voyez Burnouf, Etudes sur la langue et les textes zends , page 307. Le s de "*“0^ msta est la transformation euphonique du d de la racine; rusta est donc formé comme le sanscrit âkiipta pour âkéipsta (S 543), comme dtuUa pour dtuista. — Sur le sanscrit rnA, pour voyez S a3.
rence qui existe en grec entre ëSaov et êSiScjv se retrouve eu sanscrit entre ddâm et ddadâm, et en zend entre dahm et dadaiim1. Au grec ët/hw, ëa-lns, ëexlti répond en sanscrit âs'tâm, dstâs, dsiât, tandis que l’imparfait est âtiêtam, dtisîas, ditis-\at (§ 5o8). Au grec ë6rjv répond en sanscrit ddâm, tandis que l’imparfait st/Ovv est représenté par ddadâm. Au grec e(pv-v, ëÇv-s, ë<pv-(Tj répond le sanscrit dSûv-am (pour dBû-m 2), âSû-s, dBû-t, pendant que l’imparfait eÇ>v-o-v, ë(pv-s-$, ë(pu-s est représenté par dEav-a-m, àfiav-a-s, âEav-a-t.
A cette formation appartient, en arménien, l’aoriste bmnL. c-tu — sanscrit ddâm, grec ëSav, deuxième personne e-tu-r (pour e-tu-s), troisième personne e-t, troisième personne du pluriel e-tu-n 3 = dorien s-So-v 4.
On peut comparer :
SINGULIER.
|
Sauscril. |
Grec. |
Arménie» |
|
1 Jt A aaa-m |
ê6ï}~V |
edi5 |
|
U< A ad as |
édy-s |
ede-r |
|
àdâ-t |
êOv} |
ed |
PLURIEL.
|
Sanscrit. |
Grec. |
Arménien. |
|
t Jt A ada-ina |
êde-(ies |
eda-q |
|
âdâ-ta |
ê6e-re |
edi-q |
|
âd-ns |
êds-v |
cdi-n. |
A la même formation appartient encore en arménien A^r/r eki
1 Sur le d, tenant en zend la place d'un d, voyez $ 39.
* Voyez S 437, remarque. .
s Voyez S i83 b, a. La voyelle radicale a est affaiblie en u comme en latin dans le subjonctif archaïque dnim. A la troisième personne du singulier e-t, la voyelle radicale est supprimée.
4 Dans les formes spéciales, le verbe arménien supprime la voyelle radicale devan! la caractéristique ne (S 4q6); exemple : tfüfriP d-ne-m «je place». À l’aoriste, comme on peut le voir par le tableau que nous donnons, la voyelle radicale est tour à tour a, t, e, ou bien elle est supprimée.
5 Voyez Schroder, page 102.— En ce qui concerne l’affaiblissement de l’o radical en i, comparez Yi du latin tradi-s, tradi-t, tradi-mus, ou mieux encore celui de crê-di-s = érad-dada-xi (S 63a ).
«je vins » 1 = sanscrit dgâ-m, grec £6u-v; deuxième personne
dh-r 2, troisième personne ekn 3.
L’augment ne s’est conservé, en arménien, que devant les formes monosyllabiques4 : les formes polysyllabiques, à cause de leur poids plus considérable, s’en sont débarrassées. En conséquence, le seul temps qui à toutes ses personnes nous présente laugment, c’est Taoriste des trois verbes que nous venons de citer5. L’augment se trouve en outre à la troisième personne du singulier de l’aoriste de quelques verbes irréguliers, comme e-les « vidit » 6. Devant a et 6 l’augment s’allonge en 4 ê; exemples : Çuià- êal «il conduisit»”, 4°*^ êol «il oignit»8. Cet allongement se trouve aussi assez souvent devant une consonne; exemples : 4ft^'4 êbek ou ebek «il brisa»9; êtes ou etes «vidit»; êber ou eber « il porta » ; êker « il mangea »10. .
Les racines commençant par i* e n’ont pas d’augment a l’aoriste. Je crois pourtant, en comparant l’d de l’imparfait 4/* ét «j’étais» à Ye bref du présent em «je suis», reconnaître dans cet ê, comme dans 1*jj du grec une contraction de la voyelle radicale et de la voyelle de l’augment. Il y a aussi, à ce qu’il me semble, un augment temporel dans 4jP êg «il descendit»; a
1 Présent ga-m, S 436, 4.
2 Avec maintien de l’t qui, dans ede-r, s'est changé en e.
3 D’après l’analogie de et «il donna» et cd « il plaça», on aurait attendu une troisième personne eh. Peut-être le n de ekn représente-l-il le tn de la racine IUT gam «aller» = gothique qvam «venir», proche parente de UT gâ (même sens).
* Petermann, Grammaire arménienne, page 196.
5 Encore faut-il excepter la première personne du pluriel tuaq «nous donnâmes», qui, étant dissyllabique, est privée de l’augment. On a, au contraire, e-daq «nous plaçâmes», eMaq «nous allâmes».
0 On a, au contraire, tesi «vidi», tesor «vidisli»; de même an pluriel. — La première personne du présent est tesanem «je vois» (S 496).
7 Première personne ait (en grec dya, en latin ago, en sanscrit ag «aller»).
* Première personne é?» (en latin utigo, en sanscrit ang «oindre»).
l) Schroder, Thésaurus, page 122. Comparez le sanscrit tiatig «briser».
10 Schroder, Thésaurus, page 125. Comparez le sanscritgar, gf «dévorer».
la première personne, cet aoriste, qui d’ailleurs est seul de son espèce, fait igi; le présent est ig-ane-m (S A96). Dans èg, l’ancien a de l’augment s’est contracté, d’après les lois phoniques du sanscrit,’avec Fi de la racine l. Il ne se présente pas d’autre occasion dans la conjugaison arménienne pour une contraction de ce genre, car il n’y a pas d’autre verbe commençant par un i radical qui ait à l’aoriste une forme monosyllabique.
S 57h. Restes de la cinquième formation, en ancien slave.
En ancien slave, il reste également quelques débris de la cinquième formation sanscrite. Tel est, par exemple, da «tu donnas, il donna»317 318; au contraire, la forme da-s-tü (même sens) est, comme nous l’avons reconnu, un aoriste moyen de la première formation 319. À la deuxième personne, si l’on fait abstraction de la perte de Faugment, da s’accorde aussi exactement que possible avec le sanscrit â-dâ-$ = grec e-Ay-s; à la troisième personne, da répond à à-dâ-t = grec ë-Soj : la suppression de la consonne était obligée en ancien slave. Citons encore Faoriste BSi bü «tu fus, il fut», qui répond au sanscrit drBâ-s, a-M-t, au grec s-(pv-s, ê-<pv 320 : nous avons vu qu’il s’est également conservé une forme moyenne hü-s-tü.
§ 675. Sixième formation de Faoriste, en sanscrit. —Comparaison avec le grec, le lithuanien et le latin.
La sixième formation sanscrite se distingue de la cinquième eu ce qu’elle insère uu a entre la racine et la désinence personnelle : cet a est traité exactement de la même manière que la
caractéristique a de la première et de la sixième classe l. Pour les verbes de la première classe, entre cet aoriste et l'imparfait-, il n’y a donc d’autre différence que l’absence du gouna. Ainsi ris « blesser» (classe i) fait à l’imparfait ârês-a-m (~ lïrais-a-nij et a l’aoriste âris-a-m. C’est le même rapport qui existe entre eXsin-o-v et êXnr-o-v. La racine bttd' «savoir» (classe i) fait à l’imparfait âbôd-a-m (= âbaud-a-m) et à l’aoriste dbud-a-m; c’est le même rapport qu’entre ë(psvy-G-v et ë(puy-o-v.
A cette formation appartiennent, en lithuanien, les aoristes des verbes primitifs, quand ils ne passent pas, au temps en question, dans la dixième classe (S 5o6). Ainsi likaü (racine lik) «je quittai» répond au grec eXinov et au sanscrit dricam (racine rie2 «abandonner») et est avec son présent. Ukii3 dans le même rapport que ëkmov avec Ae/rra*. Certains verbes qui ont un i à l’aoriste prennent un e bref au présent; mais cet e tient très-probablement la place d’un ancien ê 4. Le cas ne se présente, du reste, que pour bredu «je traverse à gué [une rivière]», aoriste bridaû, et pour des racines terminées par deux consonnes, comme kertù «je taille», aoriste kirtau5. Dans certains verbes comme kylà (ÿ = /) «je m’élève», aoriste kilaü, le présent allonge la voyelle, au lieu de la frapper du gouna, ou bien il prend, comme dans les langues germaniques, un i pour voyelle du gouna, de sorte qu’on a î — i + iII y a aussi des verbes qui ont à l’aoriste un y (prononcez ï) et qui, au présent, prennent le gouna; exemple : mëzù «mingo»7, aoriste myzaü. Les aoristes des verbes en tu (S 499) sont avec leur présent dans
1 Voyez S 109% t.
2 Pour rik. -
3 Sur ë pour ai, voyez S |g3.
1 Voyez Schleicher, Gramtnaire lithuanienne, S 1 » 3,3. 5 En sanscrit kart, krt «fendre».
Voyez S 97.
7 Racine sanscrite mi h.
le môme rapport quen grec êTim-o-fAsv avec tw-t o-pev ; exemple : dm-ô-me «nous nous refroidîmes», présent dw-ta-me.
Dans les verbes sanscrits de la sixième classe, la formation en question se confondrait nécessairement avec 1 imparfait, puisque ces verbes ne prennent pas le gouna dans les temps spéciaux1. Aussi ne rencontrons-nous cette formation de l’aoriste que pour un petit nombre de verbes irréguliers qui , aux temps spéciaux, insèrent une nasale, et la suppriment dans les temps généraux. Tel est, par exemple, le verbe lip «oindre», qui fait à l’imparfait dlimpam et à l’aoriste alipam; tel est encore lup «couper», qui fait à l’imparfait dlumpam et à l’aoriste dlupam321 322 323.
Le même fait se présente en lithuanien : nous avons, par exemple, l’aoriste Up-a-u «je collai» (pour hp-ct-m, ^ 436, i) = sanscrit dlip-a-m, et le présent limp-ii (pour hmp-a-mi) = sanscrit limp-a-mi.
En latin, je rapporte à cette formation les parfaits Jidi, scïdi \ dont la troisième personne Jîd-i-t, scîd-i-t s accorde tres-bien avec le sanscrit dËïd-a-t, dëïd-a-t324, Je regarde aussi tüli comme un aoriste de la sixième formation325 : il répond, quant à sa racine, au sanscrit lui (classe i) «soulever», qui ferait à
l’aoriste dtulam, s’il suivait cette formation. À ftdi, scïdi tûli, je joins encore fàèi : car quoique bibo soit une ancienne forme redoublée, comme on peut le voir par le sanscritpïvâmi (védique pibâmi, pour pîpâmi), il n’en est pas moins traité en latin comme s’il venait d’une racine bib326 327.
En grec, les aoristes comme eAa£ov, eyaSov, èXafiov sont avec leurs imparfaits iXdp&avov, êydvSavov, êXdvOavov dans le même rapport que les aoristes sanscrits âlipam, âlupam avec les imparfaits dlimpam, dlumpam : il y a seulement cette différence qu’outre la nasale insérée dans la racine, le verbe grec, à l’imparfait, présente encore la syllabe av, qui est également supprimée à l’aoriste.
Comme verbe de la cinquième classe, nous citerons sak « pouvoir», dont l’imparfait est dsak-nav-am et l’aoriste dsak-a-m : le rapport entre ces deux formes est le même qu’entre ê^evyvvv et èlvyriv, èfiiyvvv et èfityijv, iTrtfyvvv et êndytjv.
Comme exemple de la neuvième classe, mus citons khi s tourmenter», dont l’imparfait est dkUs-nâ-m et l’aoriste aklis-a-m : le rapport entre ces deux formes est le même qu’entre êSap-vri-v et êSdfivjv.
Enfin, pour la quatrième classe, on peut prendre comme exemple la racine svid «suer» qui fait à l’imparfait dsvid-ya-m et à l’aoriste dsvid-a-m. Nous avons de même l’imparfait ëQx\Xo-v ( par assimilation pour ëëoîk-jo-v328) en regard de l’aoriste ISxX-o-t'.
S 5y6. Restes de la sixième formation, en arménien
et en ancien slave.
A la sixième formation sanscrite appartiennent, en arménien, tous les aoristes seconds qui ne sont pas, comme etu, eM, edr,
de la cinquième, ni comme le seul arari (8 687) «je
fis T? de la septième formation. La voyelle a qui, en sanscrit, s’intercale entre la racine et la désinence personnelle, est affaiblie en i1, excepté à la deuxième et à la troisième personne du singulier, et à la deuxième du pluriel. A la seconde personne du singulier, c’es1 un b e qui remplace Y a sanscrit, comme cela arrive très-souvent en arménien. A la troisième personne, la voyelle est supprimée; mais, en revanche, la forme devenant monosyllabique, l’augment reste. A la première personne du pluriel, l’ancien a est maintenu, peut-être parce que la voyelle s’allonge en sanscrit dans la forme correspondante (âlip-â-ma), ou par compensation pour la perte du signe personnel329 330.
A la rigueur, il ne faudrait citer ici que les verbes arméniens qui ont un thème plus plein pour les temps spéciaux, comme, par exemple, tesi « je vis », oo%i « unxi », karzi «j’interrogeai », qui font au présent tes-ane-m, âl-ane-m, hari-ane-m. Quant à la plupart des verbes arméniens, je regarde leur aoriste second comme originairement identique avec l’imparfait sanscrit et grec. Nous avons déjà montré (S 44q) que le temps appelé impératif prohibitif est en réalité un imparfait. De même que l’arménien mi ber-e-r «ne porte pas» répond au sanscrit ma Bar-a-s (même sens), de même ber-e-r « tu portas » répond à dBar-a-s (= ëÇsp-s-f). La troisième personne du pluriel ber-i-n s’accorde très-bien avec le zend bar-ë-n ( ou abarën), le sanscrit dBar-a-n, le grec ë(pep-o~v331.
On peut consulter le tableau comparatif suivant :
|
Sansfi'if. |
Zeinl. |
Arménien. |
Grcv. |
|
àbar-a-w |
bar-ë~m |
ber-i- |
ëfiep-o-v |
|
Abar-as |
bar-o |
ber-e-v |
é(p£p-e-s |
|
Alîar-a-t |
bar-a-d |
eber |
êÇep-e |
|
Abar-â-ma |
bar-â-ma |
ber-a-q 1 |
è<pép-o-[xev |
|
Aftar-a-ta |
bar-a-ta |
t ■ t 0 oer-i-q |
è(pép-e-T£ |
|
Altar-a-n |
bar-ë-n |
bet'-i-n |
ë@ep-o-v. |
Bu même quen arménien les seuls verbes qui aienl de véritables aoristes de la sixième formation sont ceux qui répondent plus ou moins exactement à la neuvième classe de conjugaison sanscrite (§ A96), de même, en ancien slave, les seuls aoristes de cette formation appartiennent et ne pouvaient appartenir qu’aux verbes comme güb-nu-ii, güb-ne-si (§ &97)* ^ar SUP“ pression de la caractéristique et par l’adjonction d’une voyelle de liaison, on forme, en ancien slave, des aoristes seconds332 333 334 335 336 tels que dvig-ü sje remuai» (présent dvig-nu-hj.
On peut comparer, comme modèles de cette formation, le sanscrit dstaB-a-m ^j’appuyai, j’arrêtai» (présent skib-na-ini) *, le grec ëSax-o-v (présent Sdx-v&), le lithuanien gaw-a-u «j’obtins» (présent gau-n-nf et l’ancien slave dvi-g-ü (présent dvig-nu-n).
|
Sanscrit. |
Grec. |
Lithuanien. |
Ancien slave. |
|
astab-a-m |
éhax-o-v |
gaw-a-ü |
dvig-ü |
|
ùstab-a-s |
éhctx-s-s |
gaw-a-% |
dvis-e- 1 • |
|
â$lab-a-t |
êhax-s |
gâw-a- |
dvis-e-» |
|
âstab-ârva |
• •••■••« |
gaw-Ô-wa |
dvig-o-vê |
|
astati-Ortam |
êbaK-e-rov |
gâw-ô-ta |
dviè-e-ta |
|
âstab-a-tâm |
èàzK-é-Ttjv |
Comme au sing. |
dvü~e~ta • |
|
âstab-â-ma |
êhâK-o-fiev |
gaw-ü-me |
dvig-omü |
|
âstab-a-ta |
èhâK-e-TS |
gaw-ü-te |
dms-e-le • |
|
â$tab-a-n |
éhax-o-v |
Comme au sing. |
dvig-u-n. |
|
La sixième formation, dans |
les verbes terminés par une voyelle, | ||
en sanscrit, en latin et en lithuanien.
Les racines sanscrites finissant par une voyelle prennent rarement la sixième formation. Les grammairiens indiens posent la règle que devant la voyelle de liaison il y a suppression de la voyelle radicale finale, excepté pour et Ils citent comme exemples mvam «je grandis», dhvam «j’appelai», quils font venir des racines ivi et /ivêMais je crois que ces aoristes dérivent des racines suthu, et je les regarde comme des formes irrégulières pour asuv-a-m, âhuv-a-niz.
D’après le même principe, le latin a les parfaits fuv-î^ et pluv-it, pluv-isse. Le v de ces deux dernières formes n’appartient pas à la flexion, comme dans ama-vi, audi-vi : c’est ce qui ressort des substantifs pluv-îa, pluv-ius337 338 339 340 341.
En lithuanien, la racine bû « être « (futur bu-siu) fait à l’aoriste büw-a-û «je fus». Sont formés de même les aoristes : püw-a-ii «je pourris»l; züw-a-u «je succombai» (présent zûw-u, infinitif zu-ti); ïdmv-a-û «hæsi» (présent klüiv-è? infinitif klu-li); gi'üm-(Hi «je m’écroulai» (présent grüw-u, infinitif grû-U).
S *>78. La sixième formation, en zend.
En zend, il est très-difficile de distinguer avec certitude si une forme appartient à l’imparfait ou à la sixième formation de l’aoriste. Au moins cela est-il presque impossible pour certains verbes tels que sanad «il frappa». Comme la racine sanscrite han (= zend san ou gan) appartient à la deuxième classe de conjugaison, 1 imparfait est dhan (pour dhah-s, dljan~tf § q4). En zend également, cette racine suit ordinairement la deuxième classe : ainsi nous avons gainti* il frappe », saintê (même sens)2. Il semble donc que sanad doive être un aoriste. Mais d’uh autre côté, nous trouvons en zend des formes où san ou gan est conjugué d’après la première classe; exemple : ganaiti. Conséquemment on peut aussi regarder sanad comme un imparfait. Mais même en rapportant san à la deuxième classe, on peut encore expliquer sanad comme un imparfait formé d'après l’analogie du sanscrit drodal «il pleurait» et du zend anhad «il était»
(8 539). . *
S 679. Septième formation de l’aoriste, en sanscrit. — Comparaison avec le grec.
La septième formation sanscrite se distingue de la sixième par une syllabe réduplicative qui vient se placer devant la racine, Elle est représentée en grec par les aoristes comme eirs^vov^
Présent pütv-u, infinitif pub-ti. Comparez la racine sanscrite pày «puer» , d'où vientpu-Ü-s «puanteur». Voyez Glossaire sanscrit, a* édition, p. aaa.
2 C’est un moyen, à moins que la leçon 11e soit fautive et qu’il ne faille lire minti.
ênétypaSov, ixéxXero, ainsi que par certaines formes privées d’augment comme Tervxov, /z$éit$ov. Nous avons déjà rapproché (§ 546) les parfaits latins tels que cumrri, tutudi, cecini, et nous avons fait observer que les formes comme cêpi, frêgi, fêei, lêgi, fôdi, scâbi, vîdi, fûgi cachent un redoublement (SS 54^ et 548).
La structure de l’aoriste grec ëne<pvov est la même que celle de dpaptam «je tombais *, pour âpapatam (racine pat « tomber» ). En sanscrit comme en grec, la voyelle radicale est supprimée1-.
La racine pat «tomber», que nous venons de mentionner, existe en grec sous la forme «rer. Mais les deux langues ont suivi le procédé inverse, car le grec prend le redoublement au présent isMoi) et à l’imparfait ëmi/lov, et y renonce à l’aoriste sneaov (dorien eireror), tandis que le sanscrit fait à l’imparfait âpatam et à l’aoriste dpaptam. C’est donc l’aoriste redoublé dpaptam qui ressemble à l’imparfait grec ëiwrfov, et c’est l’imparfait sanscrit dpatam qui est le pendant de l’aoriste threrov.
$ 58o. Allongement de la syllabe réduplicative ou de la syllabe radicale, dans les aoristes de la septième formation.
A la septième formation appartiennent en sanscrit tous les verbes de la dixième classe et, par conséquent, tous les causai tifs. Une sorte de loi rhvthmique veut que la syllabe réduplicative soit longue et la syllabe radicale brève, ou vice versa : peu importe d’ailleurs que la voyelle longue le soit par nature (dcû-curam) ou par position {apaptamy La même racine peut adopter les deux formes : ainsi, de la racine s«i «faire» viennent les aoristes dsîsilam et détsîlam. Mais la plupart du temps l’usage a consacré exclusivement l’une des deux formes d’aoriste. C’est d’habitude le redoublement qui a la syllabe longue : ainsi cur « voler » fait seulement deucuram.
1 Grammaire sanscrite abrégée, S 38s, remarque.
- La racine de éndpvov est d'où vient <pévo$. — Tr.
$ 581. Verbes sanscrits ayant l’aoriste de la septième formation.
Outre les verbes de la dixième classe, les causatifs, la forme précitée âpaptam, et quelques autres dont il sera question dans les paragraphes suivants, la septième formation ne compte que cinq racines, qui finissent toutes par une voyelle. Ce sont : sn «aller», hi «croître», dru «courir», êru «entendre», mu « couler »1 ; elles font à l’aoriste : dmriyam, dsisviyam, ddudruvam, dsusruvam, àsusnuvam.
S 58a. Contraction de la syllabe réduplicative avec la syllabe radicale,
en sanscrit et en zend, dans les aoristes de la septième formation.
y
Nous avons déjà fait remarquer que dnêéam «je succombai» (racine nas) contient un redoublement : dnês'am est sorti de ânanisani (pour dinanas-a-ni) parla suppression du second ». Les parfaits latins comme cêpi ont une origine semblable (§ 548).
Je reconnais aussi un redoublement dans avocam «je
parlai» (racine wflcj, quoique lo ait lair de netre quune modification de Va radical. La racine vac supprime volontiers sa voyelle radicale et vocalise alors son v en u; nous avons, par exemple, au participe parfait passif, ukfâ, et au pluriel du prétérit redoublé ûc-i-ma (pouvu-ucima). Si Ton admet qua laoriste en question vac s'est contracté en uc, vôc s'expliquera très-bien comme venant de varuc (pour va-vac). Ainsi quon l'a vu plus haut (S 58o) pour dcucuram «je volai» (racine cur), la syllabe réduplicative, dans va-u-é, est plus pesante que la syllabe 1a-
dicale.
Nous avons de même, en zend, vancëm «je parlai»,
vattcad «il parla».
1 Les racines ma «couler» et sm (même sens) ont une origine commune; elles ne diffèrent que par le» liquides, qui, comme on Ta vu, permutent souvent entio elles (S ao). Les formes grecques sont véu, vetet péa>, pev-aopxi.
S 583. L’aoriste lirandam. — Liquide changée en nasale.
Je crois encore reconnaître un redoublement dans drandam « je blessai, je tuai» (racine rai)\ les liquides r et n auraient permuté entre elles (drandam pour drardam) et Y a de la syllabe radicale draradhm aurait été supprime comme dans apaptam, pour dpapatam. En ce qui concerne le changement dun r en w, on peut rappeler le tongouse titma « cinq », en regard des formes rima, lima usitées dans les dialectes congénérés* Rapprochez aussi les formes intensives xm^^à^cancal (racine cal) et cancur (racine car) où le l et le r de la syllabe radicale sont remplacés par une nasale dans la syllabe réduplicative342 ; il en est de meme pour le fi du grec tsr/ftffXvfxi, «rijpnrpiïfw. Le changement inverse de ni en l s’observe dans le sanscrit dmâ « souffler » compare au
latin jlare2.
§ 584. Aoriste de la septième formation dans les verbes sanscrits commençant par une voyelle. -— Comparaison avec le grec.
Les verbes sanscrits commençant par une voyelle redoublent, dans cette formation de l’aoriste, la racine tout entière : la première syllabe est nécessairement longue, la voyelle radicale venant se mêler à celle de l’augment (S 5âo). Le meme fait se
présente en grec* dans les aoristes à redoublement attique, comme ilyayov, iïpopov. Il y a toutefois cette différence entre le grec et le sanscrit que ce dernier idiome, dans la seconde syllabe, exige toujours la plus légère de toutes les voyelles, a savoir un i. Ainsi al «aller», ou plutôt son causatif atay, fait à 1 aoriste
1 Voyez Abrégé de ia grammaire sanscrite, SS 5o6 et 607.
2 Le changement de r en » s’observe aussi en Jette, si Pott a raison, comme je Je crois, de rattacher à la racine dur-t «piquer» Je substantif danduris «frelon» (Recherches étymologiques, ire édition, lî, p. 690). Le même savant suppose aussi que le grec SévSpov est pour Sépêpov, et il en rapproche êpvs et le inscrit drunm s
"arbre» (Ibidem, II, p. a35).
alitant; âpay, causatif de âp «obtenir», fait âpipam] ; îday, causai de îd «célébrer», fait âîdidam. C’est le même changement de 1 a en i que nous avons observé dans les formes latines comme contingo, tetigi (§ 6). En grec, on peut comparer ârndXXù}, ovlvrifu, GTwr1sv& pour àraTaXXw, ovSvrjui. Ô7T07r7euw2.
L*i remplace aussi, dans la seconde syllabe, un ^ u et un radical, ainsi que les diphthongues qui renferment u. Par exemple, unday, causatif de und «mouiller»3, fait âundidam, et un «diminuer» (classe 10) fait âuninam. Ces aoristes et les formes analogues du désidératif prouvent que Xu est traité par la langue sanscrite comme une voyelle plus pesante que Xi : autrement Pt ne remplacerait pas Vu dans des syllabes qui tendent à diminuer leur poids le plus possible. Ce sont, du reste, dans toute la grammaire sanscrite, les seules formes où un te, pour s’alléger, se change en i. Ainsi les racines commençant par une consonne suivie d’un u le gardent invariable au désidératif, tandis que les racines contenant un a le changent en i : en regard des désidératifs comme pipatis «vouloir fendre» (racine pat «fendre»), nous avons yuyuts «vouloir combattre» (racine yiul «combattre»)4.
$ 585. Aoriste de la septième formation dans les verbes sanscrits
finissant par deux consonnes.
Quand une racine finit par deux consonnes dont la première est une liquide, on conserve la liquide dans la syllabe rédupli-cative, mais ou la supprime dans la syllabe radicale, pour alléger le poids du mot; exemples : âundidam «je mouillai» pour 342 âündundam (§ 584), ârgigam «j’acquis » pour argargam (racine arg, classe 1 o). C’est d’après le même principe qu’en latin pungo supprime sa nasale au parfait et fait pupugi au lieu de pupungi La suppression de la nasale dans tetigi, tutudi est moins surprenante, car le n n’appartient pas à la racine (S 109 % 1) et disparaît aussi au supin et dans les formes analogies.
Si en sanscrit la première des deux consonnes finales est une muette et la seconde une sifflante, la syllabe réduplicative prend seulement la muette, tandis que la syllabe radicale garde Tune et l’autre; ainsi, de îlcsay, causatif de îks «voir», vient l’aoriste âiciksam (pour âîMksam1 ou Mksiksam). C’est d’après le même principe que nous avons en grec akahtov ; formé selon l’analogie de âéndidam343 344, l’aoriste serait, au contraire, âhcaxGv ou fiXxaxov.
S 586. Aoriste de la septième formation avec redoublement incomplet.
Il y a un petit nombre de thèmes verbaux de la dixième classe qui comptent deux ou plusieurs syllabes avant le complément causatif ay; mais l’aoriste n’admet dans le redoublement que ce qui peut être compris en une syllabe. Ainsi avadîray345 «mépriser» fait à l’aoriste âv-avad'îram. En grec, le même principe est suivi par les formes comme âk-tfXs^a^ ay-dyspxa, op~ cSpvyst.
S 587. Restes de la septième formation, en zend et en arménien.
Nous avons déjà plusieurs fois mentionné, en zend, un aoriste qui appartient à la septième formation : wrw-rudusa «tu grandis» (§ 4 6 (j ), de la racine vud «grandir» = sanscrit ^ ruh1. Va de l’augment, dans urûruduêa, est remplacé par un u : mais cet u est probablement le reste de la diph-thongue au, qui, à une époque plus ancienne, se trouvait en tête de cette forme; dans au Y a représentait l’augment et tu était le résultat de l’épenthèse (§ 46). Peut-être est-ce rallongement de Vu dans la seconde syllabe qui a entraîné la mutilation de la diphthongue initiale. On peut rapprocher les aoristes sanscrits comme acûéuram (S 58o), où c’est également la syllabe réduplicative qui est allongée.
II y a aussi en arménien un reste de la septième formation sanscrite : c’est l’aoriste, unique en son genre, iMipsupp ar-ar-i «je fis» (présent iniAh-tT af-ne-m). Gette forme l’emporte sur les formes sanscrites comme àt-it-a-m (§ 584), en ce que Ya de la racine n’a point éprouvé d’aflaiblissement dans la syllabe principale; ar-ar-i rappelle, à cet égard, les aoristes grecs comme rjyayov.
PARFAIT 2.
S 588. Signification du prétérit redoublé, en sanscrit et en gothique. — Emploi des verbes auxiliaires dans les langues germaniques.
Dans le sanscrit classique, comme nous l’avons déjà fait remarquer (§ 5i3), le prétérit redoublé a ordinairement le sens de l’aoriste grec. Dans les Védas, il est souvent employé comme un véritable parfait : il a surtout ce sens quand il est précédé d’un pronom relatif ou de la conjonction hi «car» 3. Néanmoins,
1 La racine sanscrite n’a gardé du que l’aspiration.
2 Pour compléter le chapitre du parfait, il faut se reporter aux SS 546 et suiv. 575, 677 et 579, où il est question du parfait latin, et au S 56q, où l’auteur traite du parfait grec en xa. — Tr.
■' On a, par exemple, dans le premier livre du Rig-véda : yë... tatakêur mana&à harî «qui-... creaverunt mente futvos jequos]» (xx, 2 ): yad vâ ’ham aBiilndrôha yad le temps dont les Védas se servent de préférence pour marquer l’achèvement de l’action, ce n’est pas le prétérit redoublé, mais l’aoriste.
En allemand moderne, les prétérits non périphrastiques, comme ich schlief ich Mess, ich wuchs (de schlafen «dormir», heissen «appeler», wachsen «grandir»), qui sont les congénères du parfait grec et du prétérit redoublé sanscrit, ne s’emploient plus que comme des aoristes et des imparfaits. Le parfait est exprimé par les formes périphrastiques : ich habe ge schlafen, ich habe ge heissen, ich bin gewachsen, En gothique, et dans les plus anciens monuments du vieux haut-allemand, ces formes à verbe auxiliaire n’existent pas encore1 et le prétérit simple remplit à la fois l’office de l’imparfait, de l’aoriste, du parfait et même du plus-que-parfait. C’est au ixc ou, comme Grimm le fait observer, peut-être déjà au vinc siècle, que les auxiliaires commencent à se montrer. Le procédé est le même qu’en sanscrit, où l’on peu dire : gato ’smi (pour g a ta s asmi) «je suis allé» et uktdmn asmi «j’ai dit» (littéralement «je suis dit ayant»)2. Outre l’auxiliaire qui est devenu en allemand moderne haben «avoir», le vieux haut-allemand se sert encore pour ses parfaits périphrastiques du verbe mgan (même sens)3.
va éêpê «quod aut ego peccavi, quodve juravi?>(xxiii, 22); yâ mânuséév â yasaé cakré «qui hominibus decus paravit» (xxv, i5); yat ic cakyma «quod tibi fecimus» (xxxi, 18); yâni cakâra «quæfecit» (xxxu, i); urun hi râgâ varunaé cakâra sûryâya pan-iâm anvêtavâi «longum enim rex Varunas fecit soli iter insequendo» (xxiv, 8). De même que le pronom relatif et la conjonction ht semblent exercer une certaine influence sur l'emploi du prétérit redoublé, ils ont aussi le pouvoir de conserver au verbe son accent : suivant une règle de l'accentuation sanscrite, le verbe perd son accent quand il n’est pas à la tête de la phrase (voyez Système comparatif d’accentuation, remarque 87 ) ; mais accompagné du pronom relatif ou de la particule AL il le garde.
1 L’auteur parle, bien entendu, de l’actif, car, au passif, le prétérit gothique emploie toujours des auxiliaires. — Tr. '
a Voyez S 5i3.
3 Grimm, Grammaire allemande, IV, page îûq et suiv. Le verbe eigan, à l’in-
§ 089. Le redoublement en gothique.
Dans certains verbes gothiques, le redoublement s’est entièrement conservé. Ce sont : i° les verbes (d’ailleurs en petit nombre) dont la voyelle radicale est longue 20 les verbes qui ont au présent un a long par position. Ainsi slêp «dormir» fait au parfait (première et troisième personnes du singulier) saislêp2; vô « souffler» (= sanscrit vâ) fait vaivô; hait «appeler» fait liai-hait; auk «augmenter» fait aiauk; fald «plier» (présent falda) fait faifalth 3.
Les verbes qui ont un ê au présent, le remplacent tous, excepté saislêp, par un ô au prétérit. Ainsi têka «je touche » fait taitôk; grêta «je pleure » (= sanscrit krand « pleurer ») fait gaigrôt; lêîa «je laisse» fait lailot; Jlêka «je déplore» (= latin plangoj fait faijlôk; rêila «je conseille » fait rairôth. Ce changement de voyelle n’a rien de surprenant, puisque Yê et Tu sont l’un et l’autre les représentants de l’a primitif (§ 69)* comme en grec Va bref est représenté habituellement par e et par 0, et Yâ long par n et par 6>. Il y a donc le même rapport entre taitôk et têka qu’entre texposa et Tpétpco, XéXonra et Xe«rgléivoiBa et 'ZsatOco. eppwya et ptfywpt (S 491). Le changement en question vient, je crois, de ce que l’o est une voyelle plus pesante que Fc; or, le parfait, qui a à porter le poids du redoublement, éprouve le besoin de fortifier le plus possible sa racine : nous voyons, en effet, que si le gothique a pu conserver le redoublement, c’est seulement avec celles de ses racines qui étaient le plus solidement constituées 4.
dicatif, ne se trouve qu’au pluriel. Au subjonctif, il est employé dans les deux nombres.
1 II n’est pas question ici des verbes qui allongent au présent une voyelle naturellement brève, comme cela arrive, par exemple, pour ceux qui prennent le gouna.
2 Sur § pour s, voyez S 86, 5.
3 Pour fmfatd (S q3a).
* Voyez S 690, remarque a. J’avais supposé autrefois (Vocalisme, p. ho) qu’au
S 590. Les parfaits gothiques vôks et xtôth.
Les deux seuls verbes gothiques qui aient perdu le redoublement, quoiquau présent ils aient un a long par position, son! vahsja «je grandis » (= sanscrit vaks, zend uks) et simula «je suis debout». Ils font au prétérit (première et troisième personnes du singulier) vôhs, stôth. Le ja de vahsja devait tomber au parfait, étant la caractéristique de la classe (S 109% 2). Il y a donc le même rapport entre vâhs et vahsja qu’entre le sanscrit nanàsa et nâsyâmi «je succombe». Le parfait stôth supprime la nasale inorganique qui se trouve au présent standa 1 ; mais il est irrégulier en ce qu’il conserve le th devant les désinences2 : il fait, par exemple, stothum «nous fûmes debout», au lieu de stâdam que nous devrions attendre d’après Tanalogie de bauth, budurn (racine bud «offrir»).
S 691. Les parfaits gothiques haihah et faîfak.
Si vahsja et standa ont perdu leur redoublement au parfait (§ 590), il y a au contraire deux autres verbes qui ont conservé la syllabe réduplicative, quoiqu’ils n’aient pas au présent un a long par position. Ce sont haha «je pends» et faha «je prends», qui font au parfait haihah et faifah. Mais dans tous les dialectes germaniques autres que le gothique, ces verbes ont au présent deux consonnes après leur a ; on est donc autorisé à croire qu’en gothique leur a était primitivement long par position3.
parfait grec, Ta, qui suit ïa syllabe radicale, avait pu exercer une influence sur la voyelle e ; mais c’est une explication que je crois devoir retirer.
1 Au contraire, le vieux haut-allemand fait au prétérit sluont ( présent stantu).
2 Sur l’origine de ce th, voyez S 91, 3.
1 Comparez S fi90, remarque a.
$ 5ga. Contraction de la syllabe réduplicative avec la syllabe radicale,
dans les langues germaniques. — Faits analogues en sanscrit, en grec
et en latin.
Comme J. Grimm Ta remarqué le premier, le redoublement de ces deux classes de verbes ne se perd pas dans les autres dialectes germaniques, quoiqu’il ne se montre plus d’une façon aussi apparente qu’en gothique. Ce qui fait qu’on l’aperçoit moins, c’est que la seconde syllabe du parfait est supprimée ou privée de sa consonne; dès lors, la syllabe réduplicative fait l’effet d’être la syllabe radicale ou se fond avec celle-ci1.
Des faits analogues se présentent en sanscrit, en grec et en latin. Ainsi les racines laB «prendre», pat «voler, tomber» font au désidératif lips, pits (pour lilaps, pipats)2. Je crois que ces formes ont perdu leur seconde syllabe. Il est vrai qu’on pourrait dire aussi que c’est la syllabe réduplicative qui a été supprimée et que l’a radical a été affaibli en {; mais on ne voit pas pourquoi la langue aurait fait subir cet affaiblissement à l’a de la racine, puisque, la syllabe réduplicative une fois retranchée, la forme était suffisamment allégée. La seconde syllabe a perdu une consonne dans le grec yw&nta (pour yiyvaexa), ytvopcu (pour yfyvofxou, qui lui-même est pour ytyévopou). On a de même en sanscrit l’aoriste dnêsam (= ânaisamj pour ânanimm. Nous en avons rapproché (§ 548) les parfaits latins comme cêpi.
$ 598. Origine de la diphtbongue ai, contenue dans la syllabe
réduplicative, en gothique.
La syllabe réduplicative, en gothique, renferme toujours la
1 Ainsi, dans l’allemand moderne ich hielt, la syllabe hi appartient au redoublement. La forme gothique est haihald, vieux haut-allemand hi(h)alt (S Ay3). [C’est également un redoublement qui est caché dans le prétérit anglais I hcld (S 5q A). —Tr.]
2 Voyez Abrégé de la grammaire sanscrite, S A90. Je regarde aussi diks «allumer» comme un désidératif pour di(dh)ké (moine dah «brûler» ).
diphthongue ai : cest là une particularité qui peut-être appartient en propre à ce dialecte. Voici comment je serais tenté de l’expliquer.
Avant la séparation des différents idiomes germaniques, l’usage a pu exister de remplacer un a par un i dans la syllabe réduplicative. Le même affaiblissement a lieu en sanscrit au désidéra tif : la racine dah «brûler», par exemple, fait didaks et non dadaks. Par un allégement analogue, dans les formes latines comme cecini, Va devient t dans la première syllabe et i dans la deuxième. Le présent gothique valda «je gouverne » aurait donc eu la forme redoublée vivald. Plus tard, le gothique, en frappant cet i du gouna, en aurait fait vaivald346. Comme l’d et le, en gothique, sont sortis d’un ancien à (§ 69), la même explication s’appliquerait aux parfaits tels que vaivô (racine vo «souffler» = sanscrit va) et saislêp (racine slip «dormir» = sanscrit svap).
Quant aux racines renfermant la diphthongue au, comme auka «j’augmente», parfait aiauk, il est difficile de décider si c’est Va ou Vu qui est représenté par i dans la syllabe rédupli-cative. Je croirais plutôt que c’est !’«, car sous le rapport étymologique la seconde voyelle des diphthongues en est toujours la partie essentielle, et c’est toujours la seconde voyelle (i ou te) que les verbes sanscrits à diphthongue radicale admettent dans la syllabe réduplicative.
S 594. Le redoublement, en vieux norrois et en ancien saxon.
En vieux norrois, les verbes renfermant un «2 suivent au prétérit redoublé le procédé inverse. Ils prennent, comme en sanscrit, un a dans la syllabe réduplicative, et ils affaiblissent l’a de la syllabe radicale en i. Les deux voyelles, en se contrae-
tant, forment un ê. Ainsi la racine hald « tenir»1 fait hahüt (pour hahalt) et, par contraction, hêlt, pluriel hêldum347 348. Les racines ayant un â long (= gothique ê 349 350 351) forment leur prétérit de la même manière. Ainsi grât«pleurer» faitgrêt (pourgra(gr)il), blâs «souffler» fait blés (pour bla{btjis)à. L’ancien saxon, dans ses prétérits, suit l’analogie du vieux norrois; ainsi fallu «je tombe» fait au prétérit fêll (pourfafill), et slâpu «je dors» fait slêp (pour slaslipY-
Si l’explication que nous venons de proposer est juste, ces formations sont l’inverse de celles que nous trouvons en gothique et en vieux haut-allemand, car le prétérit de hait «tenir», en vieux haut-allemand, est hi-alt (pour hi-halt)9 et celui de Mas «souffler» est bli-as (pour bli-blas).
§ 695. Le redoublement, en vieux haut-allemand.
Il nous reste à examiner ce que deviennent en vieux haut-allemand les prétérits des verbes qui ont, en gothique, un ai ou un au dans leur racine.
De la diphthongue ai, le deuxième élément se perd dans la syllabe radicale et le premier seul est conservé, soit sous la forme a, soit, ce qui est plus fréquent, altéré en e. Au prétérit gothique haihait «j’appelai» correspond dans Otfrid hiaz (pour hiltaz, qui lui-même est pour hihaiz); partout ailleurs que chez
Otfrid, nous trouvons liiezK En allemand moderne, les deux voyelles i et e se sont fondues en une seule (= 2), en sorte qu’on a hiess (prononcez Mss).
De la diphthongue gothique au, c’est, suivant les différents textes, tantôt le premier, tantôt le second élément qui a été conservé. L’a reste a ou devient e; Yu reste u ou s’altère en o (§ 77). Ainsi le verbe gothique hlaupa «je cours», qui faisait probablement au prétérit haihlaup (pour Maihbup 352 353), a en vieux haut-allemand les prétérits liaf (pour lilaf, qui lui-même est pour hlihlauf), lief, liuf et liof354 355. La forme usitée en allemand moderne est ich lief (prononcez lîf) « je courus».
§ 696. Le redoublement, en sanscrit.
En sanscrit, la syllabe réduplicative prend la même voyelle que la syllabe radicale; mais si la voyelle radicale est longue, on l’abrége dans le redoublement, et si c’est une diphthongue, on n’en conserve que la dernière partie (§ 5g3)- En conséquence, bani «lier» fait bahaniï\ bas «briller» fait babas, bid «fendre» fait bibid, dtp «briller» fait didîp, tud «frapper» fait tutud, pur «remplir» fait pupur. Les racines ayant un r pour voyelle radicale ont l’air de faire exception, car elles ont un a dans la syllabe réduplicative : ainsimrd «écraser» fait mamârda356 «j’écrasai» ou «il écrasa». Mais ce parfait vient de la forme primitive mard, et non de mrd (§ 1).
Il a déjà été question (§ 53A) des racines commençant par une voyelle. Ajoutons seulement ici que les racines commençant par un a et finissant par deux consonnes forment leur redoublement d’une façon toute particulière : Ya du redoublement se contracte avec Y a de la racine, ce qui donne un â long, quon fait suivre d’un n euphonique, après quoi vient de nouveau la racine tout entière; la voyelle radicale est donc représentée trois fois. Ainsi ang «oindre» (= latin mgo) a pour thème du parfait a-n-a\f (venant de m-n-ang).
$ 597. De la voyelle du redoublement, en grec et en latin.
Quelle que soit la voyelle radicale, le grec a toujours un s dans la syllabe réduplicative, si la racine commence par une consonne. On peut comparer, par exemple, têt<x(pa au sanscrit tntâpa ou tatû'pa «je brûlai», rhv<pa, à tutopa «je frappai, je blessai, je tuai», «ai£<ptkrwoLl a piprâya ou piprâya (racine prî «réjouir, aimer»357 358).
Le latin fait de même pour ces parfaits que nous avons rapportés à l’aoriste de la septième formation (S ->79), comme cecinif tetigi ; il ne va pas si loin, toutefois, que le grec, car il n’est obligé de prendre un e dans la syllabe réduplicative que si la racine renferme un a, c’est-à-dire la plus pesante de toutes les voyelles359. Il ne craint pas de redoubler un 0 (momonh), ni un n {tutudi).
Je ne doute pas que le grec n’ait eu égard, dans le principe, à la qualité de la voyelle radicale; mais les voyelles du redoublement se sont décolorées à la longue et ont fini par devenir uniformément g. II est arrivé quelque chose de semblable en
allemand moderne, où c’est toujours un e que nous trouvons dans les syllabes finales des mots polysyllabiques : ainsi fonde, salbe, gaben représentent les formes gothiques fonda, salbô, gêbutn, et gàste, gâsten sont pour le gothique gasteis, gastim. Cette sorte d’affaiblissement, dont souffrent les extrémités des mots en allemand moderne, a fort bien pu atteindre, en grec, une syllabe initiale qui n’appartenait pas proprement au thème.
$ 598. La consonne dn redoublement, en sanscrit, en grec, en latin
et dans les langues germaniques.
Après avoir traité de la voyelle du redoublement, nous passons aux lois qui régissent les consonnes.
Le sanscrit remplace une gutturale par la palatale correspondante : ainsi kas «briller» fait cakâs, gam «aller» fait gagam.
Comme le grec, le sanscrit remplace une consonne aspirée par la non aspirée correspondante : M «placer, poser » fait dada, comme 6n fait reOv.
Quand la racine commence par deux consonnes, le sanscrit redouble ordinairement la première : ainsi krand « pleurer » fait cakrand, ksip «jeter» fait ctksip. Le gothique suit le même principe, quand la seconde consonne est une liquide : ainsi gaigrôt «je pleurai» correspond au sanscrit cakrânda, et saislêp1 «je dormis » au sanscrit susvâpa2. Nous pouvons conclure par analogie que le parfait de hlaupa «je cours» a dû être haihfoup3, et non hlaihlaup. Mais si la seconde des deux consonnes est une muette, le gothique redouble l’une et l’autre; exemple : skai- 360
skaiih1 «je séparai ». De même on doit croire que staut faisait staistaut.
Les autres dialectes germaniques n ont mis aucune restriction au redoublement des deux consonnes : en vieux haut-allemand, les prétérits sliaf «je dormis », spialt «je fendis » ne peuvent s’expliquer que par d’anciennes formes slislaf, spispalt, à moins quon n’admette que l’une des deux consonnes ait été supprimée dans la seconde syllabe. Je crois, en effet, reconnaître une suppression de ce genre dans les formes am-steroz «impinge-bat», ana-sterozun «impingebant», pleruzzin «adolerent», ca-pleruzzi «immolaret». Grimm 361 suppose que ces formes ont inséré un r euphonique ; mais le r de ana-steroz et de ana-sterozun lient, selon moi, la place d’un s : je vois dans ces formes un redoublement de la racine stêz (= gothique staut «frapper»). Ainsi steroz pour stcsoz, qui lui-même serait pour stestoz. Quant aux deux formes pleruzzin et ca-pleruzzi, je crois que leur r remplace un l; les liquides permutent fréquemment entre elles, et ici ce changement a pu être favorisé par le désir d’éviter le voisinage de deux syllabes ayant la même consonne. Pleruzzi serait donc pour pleluzzi, qui lui-même serait pour plepluzzi.
On peut rapprocher de ces formes les parfaits latins spopomh, steti, qui ont également sacrifié, dans la seconde syllabe, l’une des deux consonnes initiales. Il y a seulement cette différence entre le vieux haut-allemand et le latin, que celui-ci. au lieu de supprimer la deuxième lettre (ce qui donnerait sposondi, stesi, et, par le changement de s en r, sporondi, «fer»362), a préféré se débarrasser de la première.
X.
'Luc, IX, 33.
3 Bulletin mensuel de l’Académie de Berlin, i85o, pajje 17. GralF, Dictionnaire du vieux haut-allemand, III, 260, et VI, 713.
1 Comparez sero, pour seso.
S 699. Redoublement des racines commençant par sp, si, sh, en sanscrit, en zend et en latin.
Quand une racine sanscrite commence par deux consonnes, dont la première est une sifflante et la seconde une muette, le redoublement se fait par exception à l’aide de la deuxième et non de la première consonne. Les autres lois phoniques précédemment exposées restent en vigueur. Ainsi stâ «être debout» fait tastâü; spars, sprs «toucher» fait paspdrsa.
Le zend, quoique très-proche parent du sanscrit, ne connaît pas cette sorte de redoublement à l’aide de la deuxième consonne. En regard du sanscrit tîsiâmi, il a la forme Instânu ou le h initial représente la sifflante de la racine. J en conclus que la loi qui vient d’être exposée n’existait pas encore ou n’avait pas toute son extension au temps où le zend sesl séparé du sanscrit. Le latin le grec ïcflriyu redoublent ,
comme le zend histâmi, la première consonne (§ 5o8).
S 600. Redoublement de la racine «r'/a, en grec.
l>e même que dans StSoûfju, ri6nt(u9 nous avons dans
tarlïifxt un redoublement (comparez avec i la syllabe hi dans le zend histâmi). Le <7 initial s’est changé en esprit rude. Il en est de même au parfait ë&lnxa. où le redoublement est représenté par è (pour <rs)3. 363 361 362
Buttmann1 pense quà l’origine Inspiration plus forte de l’esprit rude a pu servir à remplacer le redoublement, et il cite comme exemples, outre Mnxa, les formes eipapTcu et a<peV7aX-«a2, lequel suppose un ancien s<r1ahia. Je ne crois pas quon doive mettre éVW sur la même ligne que si^aprai, dont je ne veux pas m’occuper ici : &rhixa a l’esprit rude au meme droit que le latin sisto a son s. Quant à la forme dialectale âQéolahta, il est intéressant de remarquer que sa racine commence également par un cr. Ce qui a pu contribuer à maintenir 1 aspiration de Mïixa, c’est l’analogie du présent et de l’imparfait, marqués également de l’esprit rude.
S 6oi. Redoublement des racines commençant par deux consonnes, en grec. — Confusion de l’augment et du redoublement.
Si l’on excepte Ëahtxct, dont il vient deti'e question, et les racines commençant par une muette suivie d’une liquide, le grec a renoncé au redoublement de la consonne pour ses racines ayant deux consonnes initiales. Il fait, par exemple, eiJ/otXxa, SfOopa, et non «ftyaXxa, «üpflopa. C’est évidemment le poids de la syllabe radicale qui a fait alléger ainsi la syllabe redupli-cative. On voit que la similitude entre l’e de ëÿahta, ë(p6opot et l’e de ëÿaWov, ëÇÔetpov est purement fortuite. L’e de ItyaXXor, ëfôstpov, qui représente un a sanscrit, est complètement indépendant de la racine : il vient s’y adjoindre comme expression du passé. Au contraire, Ye de ë^cthca, ëÇ>8opct, est le reste dune syllabe qui avait originairement la consonne initiale de la racine.
Je ne veux pas nier cependant que le grec n ait quelquefois confondu son redoublement avec l’augment : il se peut, par exemple, que l’e de %a, êo&pnx* soit, le même que celui de
' Grammaire grecque développée, S 83, remarque 6.
2 Sur une inscription milésicnno, dans Ciiislmll, AnliqniMes «siatica. p. 67.
$a%a\ êovpovv. Toutefois, on peut aussi expliquer Ye des parfaits eSya, eovpjpca comme un redoublement, puisque a et o, qui sont originairement identiques, s’altèrent très-souvent en s'2.
S 609. La voyelle radicale au prétérit redoublé, eu sanscrit. —- Allongement d’un a radical suivi dune seule consonne. — Comparaison avec
le gothique.
Nous passons à l’étude des changements qu’éprouve, en sanscrit, au prétérit redoublé la voyelle radicale. Va suivi d’une seule consonne est allongé à la troisième personne du singulier actif; il peut à volonté rester bref ou être allongé à la première personne. Ainsi car «aller?? fait cacara ou cacara «j allai», cacara
«il alla».
J’ai cru, dans la première édition de cet ouvrage (S 602), pouvoir comparer aux formes comme cacara les formes gothiques telles que fâr «j’allai, il alla»3. Mais comme la gothique reste à toutes les personnes des trois nombres et comme il se trouve également dans les formes terminées par deux consonnes, telles que vôhs «je grandis, il grandit», je renonce aujourdhui a cette explication. Je vois dans vôhs, for des formes redoublées remontant à une époque où la syllabe réduplicative, au lieu de ai, contenait encore la voyelle radicale a. Vôhs est donc pour va-vahs, à peu près comme à la première personne du duel nous avons bairôs « nous portons tous deux », pour baira-a$ et, plus anciennement, baira-vas = sanscrit bdr-â-vas (§ 441).
1 Le digamma initial, qui se rattache à un V sanscrit (racine bang «briser»), fait supposer un aoriste éjFctifa et un parfait f éfay et — sanscrit babanga.
* Voyez S 3. Comme exemple du changement d’un a en e, nous rappelons êSeit-e (= uffrëfiT Mkiat, S 555), à côté de éèei&s', et comme exemple du chan
gement d’un o en e, nous citerons le vocatif fnics (S soi).
3 Septième conjugaison forte de Grimm. La racine far «aller» (en allemand moderne, fahrm) est, je crois, de même origine que car.
S 6o3. L’a radical suivi de deux consonnes reste invariable en sanscrit. —
Comparaison avec le gothique.
Quand un a radical est suivi, en sanscrit, de deux consonnes, il reste invariable à toutes les personnes des trois nombres; exemple : mamdnta « j’ébranlai », mamant-i-mâ «nous ébranlâmes» (racine mani).
Il en est de même en gothique pour les verbes qui ont conservé leur syllabe réduplicative, comme vaivald «je gouvernai, il gouverna», duel vaivaldû, pluriel vawald-u-ni.
$ 6o4. Le parfait gothique. — Cause du changement de la voyelle radicale au pluriel. — La deuxième personne du singulier en vieux haui-alle-mand.
Les verbes gothiques qui, dans les temps spéciaux, changent en i un a radical suivi de deux consonnes1, conservent la dans les formes monosyllabiques du parfait. Mais dans les formes polysyllabiques du même temps, ils remplacent l’a par la voyelle plus légère u. Nous avons donc, au singulier, band «je liai, il lia», hans-t «tu lias», mais, au pluriel, bundum «nous
Je fais suivre le parfait du gothique band (s il avait conservé le redoublement,- nous aurions baiband366). Je place en regard le parfait sanscrit babândk «je liai, il lia».
SINGULIER.
DUEL.
babànd-a barul
baband-i-ia1 bans-t
babànd-a band
baband-i-vâ bund-û
baband-â-tus buml-u-ls
baband-d-lus
pluriel.
baband-i-nià bund-u-m
haband-â bund-u-th
baband-ûs bund-u-n.
En regard du gothique bcuis-t et tu lias», le vieux haut-aile-niand présente la forme bunt-i (ou punt-i}. L adjonction dun i, en rendant le mot polysyllabique, a amene 1 affaiblissement de l’rt en u, de sorte que la seconde personne du singulier na pas la même voyelle radicale que la première et la troisième2.
Quelle est l’origine de cet i qui vient s’ajouter, en vieux haut-allemand, à la seconde personne de tous les prétérits réguliers à forme forte ? Je serais porté à y voir la voyelle de liaison i que nous trouvons dans le sanscrit baband-i-ta. 11 est vrai qu il y a des raisons de supposer que cet % a été plus anciennement un a (§ 61 4 et suiv.). Mais on peut admettre que le vieux haut-allemand a eu d’abord un a. qui s’est affaibli en u et finalement en i. L’i de bunti serait alors identique, quant a son oxi-gine, avec la voyelle de liaison u dans buîit-u-mês, bunt-u-t, bunt-u-n.
On a proposé une autre explication pour la forme bunti . le
1 Dans les formes en i-ta, l’accent peut être placé à volonté sur les différentes syllabes du mot. On a donc bâbandiUi ou bahandita, etc. Les formes <jui s adjoignent immédiatement la désinence ta prennent toujours le ton sur la syllabe radicale,
exemple : ya-y$-ta.
2 La conjugaison du parfait, en vieux haut-allemand, est : banl, bunti, haut, nui timm, huntul, ZumOm. — Tr.
prétérit redoublé aurait perdu sa seconde personne et l’aurait remplacée par une forme du subjonctif367. Mais, dans cette hypothèse, on s’attendrait à trouver la seconde personne du subjonctif kuntî-s, et non la première ou la troisième bunti.
Remarque. — Examen d’une opinion de Holtzmann. — Holtzmann2 attribue le changement de la voyelle radicale, dans les formes comme band ot bandum, à l’influence de l’accent. Selon ce savant, partout où la est accentué en sanscrit, il reste (i en gothique ; partout ou, en sanscrit, 1 a n'est pas accentué, en gothique, il devient u3. Mais je ne puis admettre celte explication, car je regarde eomme relativement récente l’accentuation de babandïmâ et des formes analogues : on a dû avoir plus anciennement babândïma, comme nous avons au singulier babândh. En général, le déplacement que les désinences pesantes font éprouver à l’accent sanscrit me parait un fait particulier à cet idiome et d’une date relativement moderne. Je regarde, par exemple, l’accentuation de ifisv comme plus ancienne que celle de imds4 ; si, au singulier, êmi est d’accord avec eipi, cela vient de ce que l’accent ne s’est pas déplacé en sanscrit, n’étant point attiré par le poids de la désinence5.
S (io5. Contraction de la syllabe réduplicative avec la syllabe radicale,
en sanscrit et en gothique.
Nous passons aux verbes gothiques qui, au présent, ont affaibli en t un a radical suivi d’une seule consonne, et qui ont
conservé cet a au singulier du prétérit. Ils se distinguent des verbes précédemment examinés par une particularité curieuse : au duel et au pluriel du prétérit indicatif et dans les trois nombres du prétérit subjonctif, par conséquent, dans toutes les formes polysyllabiques appartenant au passé, ils prennent un ê comme voyelle radicale. En vieux et en moyen haut-allemand, au lieu de cet ê, nous avons un â. Ainsi la racine las slegcre», dont le présent est Usa en gothique, lisu en vieux haut-allemand, Use en moyen haut-allemand, nous donne au passé les formes suivantes :
|
INDICATIF. |
SUBJONCTIF. | ||||
|
Gothique. |
Vieux haut-allemand. |
Moyen haut-allemand. |
Gothique. |
Vieux haut-allemand. |
Moyeu haul-aileuiaiid. |
|
las |
las |
las |
lêsjau |
lâsi |
lœse |
|
las-t |
lâsi1 |
lœse1 |
lêseis |
lâsts |
lœsesi |
|
las |
las |
las |
lêsi |
lâsi |
lœse |
|
lêsum |
lâsumês |
lâsen |
lêseima |
VA A A lastmes |
lœsen |
|
lêsuth |
lâsul |
lâset |
lêseith |
lâsît |
lœset |
|
lêsun |
lâsun |
lâsen |
lêseina |
lâstti |
lœsen. |
Nous voyons ici les formes polysyllabiques prendre une voyelle plus pesante que les formes monosyllabiques : c’est là un fait qui est en contradiction, non-seulement avec ce que nous avons observé jusqu’à présent, mais avec ce qui se passe pour tous les autres verbes forts. La même dérogation apparente aux lois de pesanteur a lieu en sanscrit pour les racines correspondantes. Par un accord qui est peut-être fortuit, le sanscrit change, comme le gothique, Y a radical en ê devant les désinences pesantes, c’est-à-dire au duel et au pluriel du parfait actif et aux trois nombres du parfait moyen. Dans l’une et Tautre langue, le
1 Avec à pour a, parce que la forme est polysyllabique (S 606 ).
2 Avec «? pour «, par adoucissement ( umlaut).
lait en question ne se présente que pour les racines finissant par une seule consonne; mais il faut, de plus, en sanscrit, que la racine ne commence point par deux consonnes, ni par un v, une aspirée ou une gutturale*. Partout où Va radical est changé en ê, la syllabe réduplicative est supprimée2.
Comme exemple, nous donnons le parfait actif et moyen de la racine tan s étendre » :
ACTIF.
Duel.
tênivâ pour tataniva têndîus pour tatanatus iênàlus pour tatanatus
Singulier.
tatana ou tatâna
latânîa ou tênita pour tatanita3
tatana
Pluriel.
lênimd pour tatanima tend pour tatana ténus pour tatanus
XOYEft.
Singulier.
Duel.
Pluriel.
ténimakê pour taîanimahê tênidve pour tatanidvê tènire pour tatanirê.
tênê' pour tatanê ténivdhê pour tatanivahê fé/uJe'pour tataniêê tend té pour tatanâté
tênê' pour tatanê tend té pour tatanâté
Comme il ressort de ce paradigme, tên remplace toujours
1 Sur la cause de ces restrictions et sur quelques exceptions qu'elles comportent, voyez S 6o5, remarque 2.
2 Ainsi peut s’énoncer la règle pratique : nous donnerons tout à l’heure 1 explication théorique.
’ Au sujet de l’accentuation, voyez ci-dessus, page 936, note i.
tatan devant les désinences pesantes ou aux personnes qui auraient quatre syllabes, si elles conservaient le redoublement. En effet, la forme complète de la deuxième personne du pluriel serait tatanaia (§ 610), comme on le voit par le grec TSTtî^are et le gothique vaivalduth, fôruth, lêsuth; la forme complète de la troisième personne serait tatananti (§ A62). A la deuxième personne du singulier, on a tatânta quand la désinence se joint a la racine sans le secours d’une voyelle de liaison; mais on a têniin (pour tatanita), quand un i, en s’intercalant, vient augmenter
le nombre des syllabes.
«!
De tous ces faits, je conclus que tên cache un redoublement. Tên est, selon moi, pour tatm (comme, en latin, cecim pour ca-cani); la forme latin est elle-même pour tatan qui, en éliminant le second t9 aurait donne tan (— Ut-ati^* C est probablement tan qui, à une époque plus ancienne, se trouvait dans ces personnes du parfait : et je crois que le des prétérits gothiques comme lêsum ne représente pas un ê sanscrit, mais un â (§ 6g, 2). Le vieux haut-allemand a conservé l’ancien â; il oppose au gothique lêsum la forme lâsumês (pour lalasumês), qui est avec lêsum dans le même rapport que certaines formes du dialecte dorien avec celles du dialecte ionien.
A la deuxième personne du singulier, nous avons las-t en gothique et lâsi en vieux haut-allemand. Le premier s’accorde avec les formes comme tatânta, le second avec les formes contractées comme têniin. Il faut admettre que le gothique, au lieu de las, last, a eu d’abord lailas, lailast, et plus anciennement encore lalas9 lalasL Le rapport entre le singulier lailas ou lalas et le pluriel lêsum (pour lâsum) était alors correct, cest-a-dire qu’on avait la raciift au singulier sous la forme la plus forte et au pluriel sous une forme affaiblie.
Nous faisons suivre le tableau comparatif du prétérit redouble de la racine sanscrite sad «être assis, s asseoir ??, et nou^
PARFAIT. $ 605.
,,laçons en regard le prétérit sut en gothique, soi en vieux haut-allemand :
|
SINGULIER. | ||
|
Sanscrit. |
Gothique. |
Vieux haut-alleniaml. |
|
msad-a ou sasâd-a |
(sai)sat |
(si )saz |
|
sasài-ta ou sêd-i~t(i |
(sai)sas-t |
A " J saz i" |
|
msad-a |
(sai)sat |
(si )saz |
|
duel* | ||
|
sêd-i-râ |
sein? ($ h h |
o ........ |
|
sêd-â-ius sêd-â-tus |
sêl-n-ts |
■ « * • * * » * |
|
PLURIEL. | ||
|
sêd-i-nm |
set-u-m |
sâz-u-mês |
|
sed-a- |
sêt-u-th |
siîz-u-t |
|
sêd-vs |
set-u-n |
sdz-u-u. |
Remarque 1. — Examen de l’opinion de Jacob Grimm sur l’apophonie (abîma). — An sujet de l’exemple qui précède, comme au sujet de tous les verbes appartenant aux dixième, onzième et douzième conjugaisons de Grimm, je m’écarte de l’opinion de ce savant, car je regarde l’n du prétérit comme la véritable voyelle radicale et l’i du présent comme un affaiblissement de ]’«; Grimm, au contraire, suppose que ces verbes ont renforcé leur i en a au prétérit, pour exprimer par ce changement l'idée du passé. Aux preuves que.j’ai données plus haut a 1 appui de ma théorie, j ajouterai
encore le fait suivant.
Quand le verbe gothique a un causalif, celui-ci prend Va, non-seulement au prétérit, mais encore au présent. Ainsi, sat * être assis* forme le causalif satja tfje place « = sanscrit sâdâyâmi. Si lmtention de la langue était seulement de renforcer la voyelle radicale, il lui était facile de tirer de la racine sit une forme causative seitja (= sîlja) ou saitja; et, de fait, les verbes qui ont véritablement un i ou un u radical prennent au causalif la diphthongue ai ou au. Il en est de même en sanscrit, où les racines ayant un i ou un u prennent le gouna au causalif. Nous avons, pai exemple, en
gothique, ur-ris «se lever» (ur-reisa, nr-rais, ur-risum), dont le causatil’ est ur-raisja «je dresse»; drus «-tomber» (driusa, draus, drusum), dont le causatif estga-drausja «je renverse». De même, en sanscrit, vid «savoir* fait vêddijâmi (= vaiddyâmi) «je fais savoir», et bmï (même sens) fait bôddyâmi (= baudâyâmi).
Ce n’est donc pas seulement parce qu’au gothique sat «je fus assis*. band «je liai» correspondent, en sanscrit, des verbes ayant un a radical, que je crois devoir combattre l'explication de J. Grimm. Cette seule raison ne serait pas suffisante. Nous accordons, pourrait-on dire, que binda vient d’une ancienne forme band et sita d’une ancienne forme saâ; mais l’a des prétérits band, sat ne date pas de l’époque reculée où les langues germaniques ne s’étaient pas encore séparées du sanscrit; il est de formation nouvelle : il est sorti de Yi du présent, par un développement spécial, parce que le passage de l’i à Va est le symbole du passé.
A cette théorie je crois devoir opposer les faits suivants : i° ce n’est pas seulement sat qui s’accorde avec le sanscrit sasàda ou sasdda ; le pluriel sêtum (pour sâtum) répond au sanscrit sêdimd (pour sâdimâ, venant de sa(s)adima). Il est impossible d’attribuer au hasard une double coïncidence aussi parfaite; 20 comme on vient de le faire observer, les causatifs des verbes en question supposent une racine renfermant un a; 3° la voyelle a se retrouve dans des substantifs comme band, satz, qui n’ont point affaire avec l’idée de passé, ni, en général, avec l’idée de temps; 4° dans toute la famille des langues indo-européennes, on ne citerait pas un exemple d’une relation grammaticale qui soit exprimée par le changement de la voyelle radicale ; 5° le redoublement, qui est la véritable expression du passé, est encore visible dans les verbes gothiques précités (S 589). Il y a donc une raison suffisante pour admettre que sat est une forme mutilée pour saisat, et sêtum (sâtum) une contraction pour sa(s)atum.
Remarque 2. — Pourquoi certains verbes sanscrits n’opèrent-ils pas, au parfait, la contraction entre la syllabe réduplicative et la syllabe radicale? — Comparaison avec le gothique. — R n’y a pas de contraction, au parfait, pour les racines sanscrites commençant par deux consonnes ou par une gutturale, une aspirée ou un v (S 6o5). La raison de celte restriction est aisée à comprendre. La racine gain a pour thème du parfait gagam : supposons que le g de la syllabe radicale soit éliminé et que les deux a, en se fondant, produisent un ê (8 6o5); nous arriverions alors à une forme
fjrèm qui n aurait presque plus rien de commun avec la racine. Les verbes commençant par deux consonnes s'abstiennent de la contraction par une raison analogue : supposons que stan rr soupirer », qui fait tastan au prétérit redoublé, perde le groupe st de la seconde syllabe; nous aurions alors la forme contractée tên, dans laquelle personne ne reconnaîtrait la racine stan.
Il y a toutefois quelques exceptions : ainsi bag crrendre hommage » devrait partout garder son redoublement, puisqu’il commence par une aspirée; néanmoins il se contracte, mais en faisant passer l’aspiration sur la consonne de la syllabe réduplicative : il fait, par conséquent, bêg368. Quelques racines commençant par deux consonnes opèrent la contraction et gardent leurs deux consonnes dans la syllabe réduplicative : ainsi tras « trembler* a au parfait pour thème redoublé tairas et pour thème contracté très. Il est assez difficile d expliquer cette anomalie. Qu le r a été rétabli parce que la forme tes (venant de tatras) eut été trop éloignée de la racine; ou bien très remonte a une époque où la syllabe réduplicative comprenait encore les deux consonnes, comme cela a lieu pour le latin spopondi, sleli et le gothique skaiskaith; ou bien enfin (c’est l’explication la plus probable) les formes comme trêsimâ rrnous tremblâmes » ont été créées à l imitation des formes comme sêdimâ rrnous fumes assis», dans un temps où ion avait cessé d’y reconnaître aucune contraction ni aucun redoublement, et où l’on prenait Pc pour l'exposant du passé. Ce qui, en sanscrit, est l’exception, est devenu la réglé en gothique : à trêsimâ rrnous tremblâmes», brèmhnâ «mous voyageâmes» répondent en gothique les formes telles quefrehum «nous interrogeâmes» s.
Il y a accord entre le sanscrit et les idiomes germaniques, en ce qu'ils ue souffrent pas de contraction pour les racines finissant par deux consonnes. C est sans doute que des racines d’une constitution plus vigoureuse étaient plus capables de porter la syllabe réduplicative (S 589). En gothique, toutefois, le redoublement a fini par se perdre dans les verbes qui ont affaibli au présent leur a radical en i ; ainsi le verbe binda <rje lie» fait au pré-îérit band, bundum (en sanscrit babânda, babandïmâ). Si le présent gothique était resté banda, le parfait eût été baihand.
> fïoO. La contraction de la syllabe réduplicative et de la syllabe radicale est postérieure à la séparation des idiomes. — Parfaits ayant le sens d’un présent.
Sî nous avons rapproché (§ Go5) le sanscrit sêdimd du gothique sêtum et du vieux haut-allemand sâzumês, il n en faudrait pas conclure que nous regardons ces formes contractes comme antérieures à la séparation des idiomes. Je crois, au contraire, que le sanscrit et le gothique y sont arrivés chacun de son côté et d’une manière indépendante : en sanscrit, Vê de sêdimd remplace un ancien â et sêd est pour sasad; de même, en gothique, le de sêt est le représentant régulier (§69,2) d’un ancien a qui s’est conservé dans le vieux haut-allemand sâzumês, et sêt est pour sât, qui lui-même vient de sasat. La coïncidence que nous observons ici ne doit pas nous surprendre, si nous songeons qu’il arrive très-fréquemment aux formes polysyllabiques de rejeter la consonne de la seconde syllabe ou la seconde syllabe tout entière; c’est surtout avec un redoublement qu’une contraction de ce genre est chose naturelle, car on y est en quelque sorte invité par la similitude des deux syllabes369. Quand la voyelle radicale est a, le besoin d’alléger le mot devient d’autant plus pressant que Va est la plus pesante des voyelles. Le latin nous montre encore clairement comment, en pareil cas, il a procédé : dans les formes comme momordi, tutudi, il a conservé la syllabe réduplicative ; dans cecini, teligi, il s’est contenté d’affaiblir Va radical en i et Va réduplicatif en e; mais dans cêpi, fêci, il a opéré la contraction, comme Font fait, de leur côté, le sanscrit et le gothique.
Des coïncidences de ce genre ne sont pas rares dans Fhistoire des idiomes : ainsi, le persan et l’arménien cm «je suis» sont
aussi presque possible de l’anglais am, parce que les trois langues ont mutilé de la même manière la forme primitive dsmi. A la troisième personne, c’est avec le latin que se rencontre le persan : ils ont tous deux altéré le primitif asti en est. De même encore, le vieux haut-allemand fior est à peu près avec le gothique Jîdvôr dans le même rapport que le latin quar (dans qmr-tus) avec son primitif quatuor.
Pour terminer, remarquons enepre que le gothique mon «je crois », quoique étant, par sa forme, un prétérit et quoique ic pondant au sanscrit niamdna ou mamdna fait au pluriel munum. et non mênum; cette forme munum suppose un ancien maimunum (pour mamunum), comme bundum suppose un ancien baibundum (pour babundum). De même, au prétérit singulier skal «je dois» correspond le pluriel skidum (et non skêlum). Au prétérit singulier mag «je peux » correspond le pluriel magum, sans affaiblissement de Va en u. Mais peut-être tous ces verbes, qui ont le sens d’un présent avec la forme d’un parfait, n’ont-ils jamais eu de redoublement : nous voyons que le sanscrit vêda «je sais» et le grec oïSa (= gothique vait, § 491) en sont privés. On s’expliquerait dès lors très-bien pourquoi mon ne fait pas au pluriel mênum.
Remarque. — Suppression d’un a radical, au parfait sanscrit. — Plusieurs verbes sanscrits, renfermant un a dans le corps de la racine370 371, suppriment la voyelle radicale devant les désinences pesantes : ainsi gam fait {ragm4-mâ «nous allâmes»372 373. Dans le dialecte védique, «tomber» fait papl-i-mâ4 (en sanscrit ordinaire, pêtimâ) et tan « étendre» fait, à la troi-
sièine personne du pluriel moyen, tatnirc (en sanscrit ordinaire, tênire). Je ne crois pas que ces formes, qui sont d’ailleurs en petit nombre, soient une raison suffisante pour modifier ce que nous avons dit de 1 origine de pêliiid, tênimâ. On a suppose que pêiimâ venait de paptimâ et tênire de tatnirê' : pour compenser la perte de la seconde consonne, 1 a précédent aurait été allongé en & et ensuite change en cf comme cela est ai rive pour l'impératif êdi «sois», venant de ad-di {par euphonie pour as-di) . Mais je regarde paptimâ, tatnirc comme les formes sœurs et non comme les formes mères de pêthnâ} tênire : la forme primitive, selon moi, est papatima? ia-lanirêf qui a perdu dans le premier cas une voyelle et dans le second cas une consonne. Le changement de Va (= â + â) en ê n’a pas eu lieu dans le participe parfait sâh-vdiis (pour sasah-vans), qu’on peut rapprocher du parfait indicatif sêlùnuîs (racine sali ersupportern)a. Lune de ces formes nous présente Xâ, comme en vieux haut-allemand, l’autre le comme en
gothique.
$ 607. Parfait des verbes sanscrits ayant un i ou un u radical suivi d’une seule consonne. — Comparaison avec le gothique. — Le gouna au présent gothique.
Les verbes sanscrits dont la racine renferme un i ou un u suivi d’une seule consonne, prennent au parfait le gouna devant les désinences légères374 375 376; en d’autres termes, ils insèrent un a devant la voyelle radicale, Il en est de même en gothique pour les formes monosyllabiques377 du prétérit des verbes correspondants (huitième et neuvième conjugaisons de Grimm). Gomme le sanscrit Md «fendrez fait au prétérit redoublé bilïaida, le go-
thique bit «mordre» fait bail; comme le sanscrit bug- «plier» fait bubaûga, le gothique bug (même sens) fait baug.
- Cet accord entre le gothique et le sanscrit nous amène à rechercher s’il ne reste pas trace aussi, en gothique, du gouna que prennent, en sanscrit, dans les temps spéciaux, les verbes de la première classe. On a vu (S 109°, 1) que, sauf un petit nombre d’exceptions, tous les verbes forts germaniques appartiennent à cette clause de conjugaison. Je crois que le gouna s’est en effet conservé au présent des verbes ayant un i ou un u radical : seulement, au lieu d’avoir, comme au prétérit, le son «, le gouna affecte le son i. Ainsi, en sanscrit, la racine bud'(classe 1 ) «savoir» fait au présent bodami «je sais», bodamas «nous savons», et au prétérit redoublé bubodk «je sus», bubudïimâ «nous sûmes»1. En gothique, la racine correspondante bud «offrir, commander» fait au présent biuda, pluriel biudam, et au prétérit bauth378 379, pluriel budum. Dans les verbes dont la voyelle radicale est i, IV du gouna forme avec celui-ci un î, qui s’écrit1 ci en gothique (§70). Ainsi la racine bit «mordre» fait au présent beita (prononcez bîta). Si le verbe correspondant, en sanscrit, était de la première classe, il ferait au présent Eé’dâmi380, qui serait avec buta dans le même rapport que bodami avec biuda 381.
Remarque. — Sur IV, comme voyelle du gouna en gothique. — G’est dans ma recension de la Grammaire allemande de Grimm que j’ai exposé pour la première fois ma théorie de l’apophonie germanique382. Graff adopte
en général cette théorie1 ; mais il s'en écarte sur ce point qu’il ne veut pas voir dans l’i de bîuda, ni dans le premier t de belta (— bîta pour biita), l'affaiblissement d’un ancien a. Pour expliquer comment bud a fait biuda au présent, et comment bit a fait beita (— bîta), il propose trois voies différentes; mais aucune n’est aussi simple ni aussi directe que celle qu’on vient d’indiquer.
A l’appui de notre explication, nous pouvons encore citer le rapprochement suivant. Le thème sanscrit sûnû «■ filsn fait au datif singulier sunâv-ê et au nominatif pluriel üüîutt'_iïo y C col*Ü“Uii E que Vu final du thème prend le gouna avant de s’adjoindre la désinence. Au nominatif pluriel, le gothique affaiblit i’« du gouna en i et fait sunju-s (pour suniu-s). Mais au datif singulier sunau, le gothique a conservé Va, tandis que le vieux haut-allemand suniu opère le changement de l’a en t. Il y a le même rapport entre le sanscrit baudâmi (par contraction bodami) et le gothique biuda qu’entre le sanscrit sûnâvas et le gothique sunius, ou entre le gothique sunau et le vieux haut-allemand suniua.
S 608. Tableau comparatif du parfait des verbes ayant un i ou un u radical suivi d’une seule consonne, en sanscrit, en gothique et en vieux haut-allemand. -
Nous faisons suivre le tableau comparatif des formes dont il vient d’être traité. Pour mieux faire ressortir l’accord qui existe entre le sanscrit et le gothique, nous écrirons ai au lieu del^ê, au au lieu de ^Stt 0. On a vu plus haut (§607) que c’est bien là, en effet, la valeur étymologique de ces diphthongues. Nous ajoutons aussi le vieux haut-allemand, qui représente IV gothique par et, 19au gothique par ou (par ô devant les dentales, s et /t). On remarquera qu’en vieux haut-allemand la voyelle radicale reste pure à la deuxième personne du singulier, ce qui vient, comme nous l’avons dit (§ 6o4), de ce que la forme n’est pas monosyllabique. 383 384
h
|
Sanscrit. |
Gothique. Vieux haut-allemand. | |
|
Racine : |
• | |
|
bi(V |
bil2 |
biz |
|
SINGULIER. | ||
|
hibmd-ti |
bait |
beiz |
|
bihaid-i-ta3 |
bais-l4 |
biz-i |
|
bibatd-a |
bait |
beiz |
|
DUEL. | ||
|
biBid-i-vâ bibid-â-tus bibid-àrtus |
bit-û5 bil-u-ls | |
|
PLURIEL. | ||
|
bibid-i-mà . |
bit-u-m |
biz-u-tnês |
|
bibid-â-’ |
bit-u-tk |
bizr-u-t |
|
bibid-m |
bit-u-n |
biz-u-n. |
|
IL | ||
|
Sanscrit. |
Gothique. |
Vieux haul-allemaud |
|
Racine : | ||
|
bug |
bug | |
|
SINGULIER |
• | |
|
bubaûg-a |
baug |
boug |
|
buBaug-i-ïa |
baug-t |
bug-i |
|
bubaûg-a |
baug |
boug |
|
1 «Fendre». s «Mordre». 3 Voyez ci-dessus, page a 3 6 ' Voyez S toa. ' Voyez S h h i. |
, note i. | |
|
" «Pliera. | ||
|
DUEL. | ||
|
buÜug-i-vâ biibug-d-lus bubug-â-tus |
bug-u bug-u-ls | |
|
PLURIEL. | ||
|
tmüug-i~mâ hubug-à- Imblig-ÛS |
bug-u-m bug-u-th bug-u-11 |
bug-u-mês hug-u-t bug-u-n. |
H 0o(j. Les p a lia ils seconds comme Tzénoida, 'Sfépevya, en grec. ;— La différence entre ia voyelle du singulier et celle du duel et du pluriel, en sanscrit et en gothique, est-elle primitive?
Avec les formes sanscrites htSaida, buÜaûga et les formes gothiques bail, baug s’accordent, en grec, les parfaits seconds comme 'usénoiOaL, AAonra, ëotxa, 'csityevya. Le grec conserve le gouna au duel et au pluriel : il fait '&e7roi6apev, ursÇsuyapsv, et non 'sseTriBapev, ^rsipuyapev.
En présence de ce fait, on est conduit à douter si la loi suivie par le sanscrit et les langues germaniques est primitive. Le grec a-t-il irrégulièrement étendu au duel et au pluriel le gouna qui, dans le principe, nappartenait qu’au singulier? Ou le renforcement de la voyelle radicale avait-il lieu d’abord dans les trois nombres du parfait actif? Nous ne voulons pas nous prononcer sur cette question. Dans la dernière hypothèse, le sanscrit et les idiomes germaniques se seraient fortuitement rencontres, en accordant au poids des désinences ou à l’étendue croissante du mot le pouvoir d’abréger la syllabe radicale385. Des effets de ce
wnre sont si naturels qu’on n’aurait pas le droit d’être surpris si, avec le cours du temps, ils s étaient produits d’une manière indépendante dans les deux idiomes. Le vieux haut-allemand suit sa voie propre, quand il fait à la seconde personne du singulier bugi, et non beizi, bougi, quoique en sanscrit on ait bibaid-i-ta, buBauif-i-ta. Il est d’ailleurs certain que le sanscrit, tel qu’il nous est parvenu, accorde au poids des désinences personnelles une influence beaucoup plus grande quelle n’a pu être dans la période primitive; ainsi le grec SsSépxapLSv, comparé à SéSop-m, nous présente une forme mieux conservée que le sanscrit dadfsimd « nous vîmes », qui a mutilé en r la syllabe ar du singulier dadarsa.
$ Cio. Les désinences du partait actif, en sanscrit, en grec et eu gotliique.
Les désinences personnelles du prétérit redouble méritent un examen à part, car elles n’appartiennent complètement ni aux flexions primaires, ni aux flexions secondaires. L est toutefois vers les premières que le parfait penche le plus (en grec plus visiblement qu’en sanscrit) : si elles ont été mutilées et quelquefois supprimées, cela tient évidemment a la surcharge causée par la syllabe réduplicative.
La première et la troisième personne du singulier sont les mêmes en sanscrit; toutes deux finissent par une voyelle qui ne servait d’abord qu a porter la désinence personnelle. Le gothique a encore perdu cette voyelle, ce qui fait qu’il présente les formes baug, hait en regard de buSaüga, bîBaida. Le grec, qui termine sa première personne en a, altère a la troisième personne la eus, comme à l’aoriste ou il fait s$si%e (= sanscrit adîksat). Nous avons donc, d’une part, les premières personnes ren/<pa, SéSopxa (= sanscrit tutopa «je frappai», dadarsa «je vis»), et, d’un autre coté, les troisièmes personnes , SéSopjes (= sanscrit tulopa,
dadarsa).
En voyant le sanscrit, le grec et le gothique (et Ton peut encore ajouter le zendJ) privés de flexion à la première et à la troisième personne du singulier, on pourrait être tenté de conclure que cette suppression est anterieure a la séparation des idiomes. Mais la conclusion n’est pas obligée, car les langues en question ont fort bien pu être conduites, chacune de son côté, à affaiblir la désinence par suite de la surcharge du redoublement. Les trois idiomes2 n’ont pas d’ailleurs affaibli la flexion au même degré : celui qui a été le plus loin, c’est le sanscrit. Dans cette langue, dès l’époque la plus reculée, la désinence de la deuxième personne du pluriel est devenue semblable a la première et à la troisième personne du singulier, oublie ne s en distingue plus que par l’accent et par l’absence du gouna, ou par une mutilation intérieure de la racine dont le singulier est reste exempt. Nous avons, par exemple, la racine krand «pleurer», qui fait éakrânda «je pleurai, il pleura » et cakrandd « vous pleurâtes ». Le gothique, au singulier, fait gaigrôt «je pleurai, il pleura», et ici il est moins complet que le sanscrit, qui a conserve la voyelle finale; mais, au pluriel, nous avons en gothique gai-grôt-u-tli, qui évidemment suppose une forme sanscrite cakrand-a-ta ou cakrand-a-ta. Encore à l’heure qu'il est, les formes allemandes ihr bisset « vous mordîtes », îhr boget « vous pliâtes » sont plus complètes que le sanscrit de la période la plus ancienne. On en peut dire autant pour les formes grecques comme t£tvÇ>-<x.-ts, SsSépK-ûL-re, auxquelles correspondent, en sanscrit, tutup-â «vous frappâtes», dadrê-â «vous vîtes» (pour tutup-a-ta, dadrs-a-ta).
61 i. Désinences du parfait moyen, en sanscrit et en grec.
Au médio-passif, le prétérit redoublé sanscrit a perdu non-
1 Au sanscrit dadârsa correspond, eu zeiul, la lorme dddarem (§ Aa).
- Nous pouvons laisser de côté le zond, donl la parente plus intime avec le >ans-rit ne lait pas de doule.
seulement le m de la première personne, qui manque aussi au présent, mais encore le t de la troisième. Ainsi iulupe remplace tutup-mê et tutup-tê. Le grec est beaucoup mieux conservé, car il nous donne T£TV(Â-(tou et TeTwir-rou.
De ces formes TéTVfÂ-ftou, réiun-rai on peut conclure que lactif, à une époque plus ancienne, a du faire tstvtt-a-ju*, T£Tü7r-a-T« ou ?£Tv<p-cL-{Ju, 7£Tu(p-ot-Ti, et en sanscrit lutop-a-mi (ou tutop-â-mi, § 434), tutop-a-ti. Devant les désinences plus pesantes du médio-passif, le grec a supprimé la voyelle de liaison a, d’après le même principe qui fait que nous avons à l’optatif moyen SiSoipsOa (au lieu de StSotrffxsOa), en regard de l’actif StSohjuevl.
Le sanscrit, au parfait moyen et passif, insère ordinairement la voyelle de liaison i devant les désinences commençant par une consonne386 387 : il fait, par exemple, tutup-i-sê’(en grec tstotr-crou). Toutefois, dans le dialecte védique, on pourrait trouver tutup-sê, car ce dialecte supprime souvent la voyelle euphonique de la langue ordinaire; par exemple, au lieu du parfait habituel omd-i-sê'ktu trouvas», on a dans le Rig-Véda vivil-sv (racine ml)388.
^ 6 îa. La désinence rê, à la troisième personne du pluriel du parfait moyen, en sanscrit.
A la troisième personne du pluriel, la désinence sanscrite, pour le moyen et le passif, est rL Devant ce rê, la langue ordinaire insère toujours la voyelle de liaison i; dans le dialecte védique, IV peut manquer. Ainsi le Rig-Véda389, au lieu de la forme habituelle dadrsirê' «ils furent vus», nous présente dadri-re.
Il est presque impossible de donner une explication certaine de cette désinence. Je suppose390 que le r est pour un ancien s. Le changement de s en r n’a lieu ordinairement, en sanscrit, qu’à la fin des mots, où il est obligé quand le s se trouve devant une lettre sonore et est précédé d’une voyelle autre que a ou a.
Si, comme nous le conjecturons, r tient ici la place d’un s, il appartiendrait au verbe substantif; nous avons déjà vu (§ 553) qu’en grec certains temps prennent le verbe substantif à la troisième personne du pluriel (,iStSoerav, ëSoaav), tandis que toutes les autres personnes ont des formes simples. C’est probablement le besoin d’alléger le mot qui a fait changer s en r. Un fait analogue a lieu en vieux haut-allemand, pour les racines finissant par is et par us, et pour une partie des racines finissant par as; la sifflante radicale, qui est conservée dans les formes mono-syllabiq ues du prétérit, s’affaiblit en r dans les formes polysyllabiques. Ainsi la racine ris «tomber»2 fait rets, riri, rets, riru-mês, etc.; lus «perdre» fait lôs, luri3, Us, lurumês, etc.; was «je fus, il fut» fait, à la deuxième personne du singulier, wàri, el au pluriel wârumês, wârut, wàrun.
S G13. Insertion d'un r à la troisième personne du pluriel du potentiel ci du précalif moyens. — Même insertion à l’aoriste moyen védique.
La désinence sanscrite rê nous amène naturellement à parler de la désinence ran, qu’on trouve à la troisième personne du pluriel du potentiel et du précatif moyens. Je vois dans ran un reste de vanta. lia déjà été question de la racine si « être couché », qui prend un r à la troisième personne du pluriel de tous les temps spéciaux1. La racine vid «savoir» (classe a), combinée avec la préposition sam, peut à volonté prendre ou laisser un r au présent, à Fimparfait et à Impératif moyens; exemple : sawvidratê ou sanvidatê «ils savent»391 392. 11 est clair que dans toutes ces formes le r a la même origine.
Le dialecte védique accorde encore une plus grande latitude à l’insertion de ce r, au moyen et au passif393 : il fait, par exemple, dduhra « mulserunt », pour dduhrata; la langue ordinaire exige dduhata. Remarquons aussi les formes ddr&rah et dsrgran394 395, pour ddrsranta et asrgranta; la langue ordinaire demande ddrsanta et asrganta. L’anousvâra de ran (probablement pour une forme plus ancienne rans*) se change en m devant une voyelle; exemple : dsrgram indra
têgiraK «effusi sunt, Indra! tibi hymni» 396.
$ (> i f\. De la voyelle de liaison i au parfait sanscrit.
La voyelle de liaison i, que le moyen contient presque à tontes les personnes, a sans doute été originairement un a. On en peut dire autant, avec plus de vraisemblance encore, pour l’actif, où la forme tutup-i-md a dû être précédée d’une forme lulup-a-ma 1 ; «n effet, le grec fait TSTv<p-a-{isv et le gothique gaigrât-u-m «nous pleurâmes», lequel suppose en sanscrit eakrand-a-ma2, et non éakrand-i-md. On trouve bien en gothique l’« “ la place d’un ancien a, mais on n’a pas d’exemple d’un «
représentant un ancien i.
§ Gi5. Suppression de la voyelle de liaison au parfait sanscrit et grec.
À la deuxième et à la troisième personne du duel, le sanscrit a fidèlement conservé l’ancienne voyelle de liaison a; mais la des désinences primaires tas, tas s’est affaibli en u, probablement à cause de la surcharge produite par le redoublement. Nous avons donc iutup-d-ius, tutup-â-tus, en regard du grec T£Tv(p-a-Tov, T£Tu(p-œ-Tov3, et de même cakrand-d-ius «vous pleurâtes tous deux», en regard du gothiquegaigrot-u~ts (même sens).
Tandis que les désinences tus, tus sont toujours précédées de leur la désinence va de la première personne du duel et la désinence ma de la première personne du pluriel sont quelque-lois jointes immédiatement à la racine; ainsi sid «arrêter» fait sisid-i-va, sisid-i-md ou sisid-và, sisid-mâ. U en est de même en grec, ou la est quelquefois supprimé devant les désinences pesantes du duel et du pluriel; on a, par exemple, ïS-pev3, eoty-fxsv, ëÏK-Tov, dvcoy-fxev, SéSt-psv. Je ne veux pas dire que la suppression de la voyelle de liaison remonte à l’époque où le grec ne s’était pas encore séparé du sanscrit : les deux idiomes ont fort bien pu s’alléger, chacun de son côté, d’une voyelle auxiliaire qui n’ajoutait rien au sens.
1 Ou tutup-â-ma (S hZh). '
- Ou cakrand-â-ma.
5 Pour TerûÇ-a-Tosj têt6Ç-a-Tos (S 97).
* Aussi les grammairiens indiens regardent-ils cet a, non nomme une voyelle de liaison, mais nomme apparlonnnl à la désinence.
5 Pont1 oîêapet* ^91).
^ (ii6- Deuxième personne du singulier du parfait actif, en sanscrit, en grec, en gothique et en vieux haut-allemand.
Nous avons déjà parlé (§ 453) de la désinence de la seconde personne du singulier ta. Nous en avons rapproché les formes grecques comme ola-ôa et les formes gothiques comme
rais-t «tu sais». En vieux haut-allemand, les prétérits forts n’ont conservé du sanscrit i-ia que la voyelle de liaison; nous avons, par exemple, en regard du sanscrit bubâg-i-ta (venant de bu-fkufr-i-'ta) et du gothique baug-t «tu plias», le vieux haut-allemand bag-i. Toutefois, les prétérits qui, comme le sanscrit vêcla, le grec olSa et le gothique vaii, ont le sens d’un présent, conservent le t qu’ils joignent immédiatement à la racine. Tels sont : wcis-t1 (— gothique vais-t, grec ola-Oa, sanscrit vê't-ia ) '?tu sais»; muos-t «tu dois»; tôh-t2 «tu es capable de»; scal-t «tu es obligé de » ; an-s-t3 « tu 'es disposé à » ; clum-s-t « tu peux, lu sais»; ge-tars-t «tu oses»; darf-t «tu as besoin de»; mah-t «tu peux»4.
$ 617. S inséré en gothique devant le t de la deuxième.personne du singulier. — La racine gothique so « semer ».
Il a déjà été question (§ 454) de la lettre s, que les racines
1 Par euphonie pour weiz-t.
2 U n'y a pas d’exempte de-celte forme; mais ou peut la déduire avec certitude de la troisième personne touk et du prétérit toh-ta.
5 Avec un * euphonique (S q5) : cette forme n’est pas douteuse, quoiqu’il n’en reste pas d’exemple.
4 La plupart de ces verbes sont encore usités en allemand moderne : ce sont, ivis-miy müssen, taugen, sollen, gônnen (avec le préfixe ge ), konnen, d in j'en, môgen. L’est parce que leur présent est une ancienne forme de parfait, que nous avons ; iek iveiss et wir wissen, ich mnss et wir müssen, ich kann et wir kônnen, ich darf et tviv durfeny ich tnag et wir môgen (S 606). Quant à taugen, sollen, gônnen, ils sont conjugués comme des présents ordinaires. Voyez. sur ce sujet, G ri mm, Histoire de la langue allemande, chnp. xxxv. — Tr.
gothiques finissant par une voyelle insèrent devant le t de la deuxième personne. Ainsi so et semer» fait saisô-s-t'1.
Comme ce dernier verbe se retrouve en slave, en iette et en latin, on doit s’étonner que le sanscrit ne présente aucune racine qui en puisse être rapprochée avec certitude. Benfey397 398 rattache le gothique sô à la racine sanscrite ^as (présent tis-yâ-mi, classe 4) «jeter». Mais comme ce verbe, dans toutes les langues congénères de l’Europe, commence par un s, je doute du rapprochement. Je penserais plus volontiers à la racine san «donner», qui figure sur les listes des grammairiens indiens comme racine de la première et de la huitième classe; mais je crois que la vraie forme est sâ399, que je rapporte à la cinquième et a la neuvième classe. Au lieu de san-$-ti, je divise ainsi : sa-nô-ti(pour sâ-no-ti), et, au lieu de san-a-ti, je divise de cette façon : sa-na-ti (pour sa-nâ-tï)400. Il y a le même rapport entre le gothique $d401 «semer» et le sanscrit sâ «donner»402 qu’entre le gothique vô «souffler» et le sanscrit m vâ (même sens). 11 est vrai que sâ signifie «donner» et non «semer»; mais l’idée de semer est sans doute trop particulière pour qu’elle ait été représentée dès l’origine par un mot ayant cette acception spéciale. On a dit «donner [à la terre]», de même qu’en sanscrit la racine vap, dont la signification primitive est «répandre», a pris le sens de «semer».
:i iv.;* ,i„j:
ji iati
moyen, le sanscrit snpp «que nous donnionsr.
Si le gothique sa répond au védique sa, le substantif gothique dth-s (thème sê-di)1 sera identique avec le thème sanscrit sâ-lt «don». Peut-être le latin sô-lum est-il de la même famille, et signifiait-il dabord «ce qui doit être ensemencé». En irlandais, siol veut dire «semence» et siohnm, qui est probablement un verbe dénominatif, «je sème».
S618.
Première et troisième personnes du singulier des racines sanscrites en à.
A la première et a la troisième personne du singulier racines sanscrites en â ont pour désinence au; il en est de même pour les racines qui finissent par une diphthongue 403 404. Ainsi dû fait dadâü «je donnai, il donna»; sia fait tastâû «je fus debout, il fut debout». Ces formes sont irrégulières, car 1« de
les
la racine, devant Va de la désinence, aurait dû se fondre avec lui et faire â, ou il aurait dû tomber comme devant les autres désinences commençant par une voyelle. Si la première personne était la seule qui eût cette flexion, on pourrait dire que Vu est la vocalisation d’un m 405. Mais la même explication ne peut s’appliquer à l’tt de la troisième personne, à moins qu’on ne veuille admettre que la désinence au, dont le sens et l’origine auraient été oubliés, ait irrégulièrement pénétré de la première dans la troisième personne406. Une autre explication, c’est de regarder dadàu «je donnai, il donna» comme absolument dépourvu de désinence personnelle : Vu serait un affaiblissement de la voyelle
m.
de liaison a l. LVî final de la racine, en se combinant avec cet u, aurait produit la diphthongue au, suivant le principe du vriddhi (§29), au lieu qu’ordinairement un â s’abrége en a devant un u ou un i, et fait alors 0 (— au) ou e (= ai).
S 619. Forme périphrastique du parfait, en sanscrit.
Tous les verbes sanscrits de îa dixième classe, ainsi que tous les verbes dérivés, se servent au prétérit redoublé dune forme périphrastique. Ils prennent l’un des verbes auxiliaires kar, kr « faire», as «être» ou bû (même sens), dont ils joignent le parfait à l’accusatif d’un substantif abstrait forme du verbe attributif. Ce substantif abstrait, inusité à tous les autres cas, se termine par un â, devant lequel il conserve la caractéristique ay. Ainsi eut (présent càrâyârni, classe 10) «voler» fait au prétérit redoublé côrayan-cakâva407 408 «il vola» ^littéralement «il fit action de voler»), ou éôrayani-âsa ou covayam-bahuva409 (littéralement «il fut action de voler»). Déjà, dans la première édition de ma Grammaire sanscrite, j’avais expliqué cette forme en awi comme l’accusatif d’un substantif abstrait; j’ai depuis trouvé en zend une forme analogue employée comme infinitif et marquant la relation de l’accusatif. Nous avons, en effet, dans le Vendidad-
Sâdé410 : va*ën
masdayasna sahm raudayahm411 « si les adorateurs de Masda veulent cultiver (littéralement «faire grandir») la terre».
Au lieu du verbe auxiliaire kar, kr « faire », le sanscrit emploie encore quelquefois d’autres verbes du même sens. Nous lisons, par exemple, dans le Mahâbhârata1 : mpustamârian varayâm pracakramuh «ils demandèrent [en mariage] Vapusta-mâ», littéralement «ils firent demande» ou «ils allèrent en demande a cause de Vapustamâ». Le sens propre de pra-kram est «aller»; mais les verbes exprimant le mouvement prennent souvent le sens de « faire », l’accomplissement d’une action étant représenté comme une entrée dans cette action.
Remarque. — Formes périphrastiques de l’aoriste et du précatif, dans le dialecte védique. — Il arrive quelquefois que l’auxiliaire kar, kr est séparé dans la phrase du substantif abstrait qu’il régit2. De cette circonstance on pourrait conclure que les formes comme corayancakâra ne sont pas de vraies formes composées. Mais cette conclusion n est pas obligée : on trouve aussi au futur, au lieu de kartasmi «facturas sum», des constructions comme kartâ tad asmi tê « facturas hoc suni tibi» 3.
Quant aux verbes auxiliaires as et bu, je ne pense pas qu’on les trouve jamais séparés de leur substantif abstrait, car as et bu ne régissent jamais 1 accusatif, excepté dans la combinaison en question. On ne dira certainement pas coray an4 lad âsa ou coray ân tad baliuva cril vola ceci».
Dans les Védas, non-seulement le parfait redoublé, mais l’aoriste et le précatif (c est-à-dire le potentiel de l’aoriste) ont des formes périphrastiques composées d’un accusatif en dm et de l’auxiliaire kar, kr. Tels sont, par exemple, praganayam-akar «il engendra» (littéralement «generationem fecit»), pâvayân-kriyât «qu’il purifiât» (littéralement «qu’il fît purifica-
formes m'ont conduit à la restitution de la véritable leçon, que Burnouf a confirmée depuis par la comparaison des autres manuscrits. Randhyaftm est le causatif de rud «grandir», en sanscrit ruh (pour rud, S 23). J’en rapproche le gothique lad «grandir», d’ou vient le substantif îauths, taudis «homme» (en allemand moderne, lente,). Anquetil traduit raudayanm par «creuser des ruisseaux» : il est possible que l’idée de «faire grandir» ait conduit à celle de «creuser [la terre]».
1 I, vers 1809.
2 Voyez Abrégé de la grammaire sanscrite, 2e édition, § k 19.
3 Voyez S 6^7.
1 Avec n pour m, à cause du t suivant.
17 •
tion»), L'impératif de la racine vtd «savoir» présente, même dans le sanscrit classique, une forme périphrastique analogue : viddn-karotu «qu'il sache» (littéralement «quil fasse aclion de savoir»).
Dans toutes ces formes, les verbes auxiliaires perdent leur accent tonique : mais cette circonstance ne suffirait pas pour prouver la nature composée des formes en question; car, si nous nous en rapportons aux grammairiens indiens, le verbe, à l'intérieur de la phrase, sauf certains cas spéciaux, est toujours dépourvu d’accent1.
S 620. La racine da dans les langues germaniques. — Le prétérit des
verbes faibles, dans les idiomes germaniques, est formé à l’aide de cette
racine.
Remarquons que ce sont surtout les verbes sanscrits de la dixième classe, les causatifs et autres verbes dérivés, qui, au prétérit redoublé, se servent de la forme périphrastique, et s’abstiennent de la forme simple. Un fait analogue a lieu dans les langues germaniques, où les trois conjugaisons faibles, qui sont précisément celles qui répondent à la dixième classe sanscrite2, forment leur prétérit à l’aide d’un verbe auxiliaire signifiant « faire ».
Déjà dans mon premier ouvrage3, j’ai montré que les formes gothiques comme sôki-dêdum «nous cherchâmes» (littéralement «nous chercher fîmes»), sâkidêdjau «que je cherchasse» (littéralement «que je chercher fisse») renfermaient le même verbe signifiant «faire», qui a donné aussi le substantif dêds (thème dêdï) «action»4. Depuis ce temps, J. Grimm a prouvé que même le singulier sâkida «je cherchai » contenait le verbe auxi-
1 Voyez $ aoè.
* Voyez 8 109“, 6.
* Système de conjugaison de la langue sanscrite, p. i5i et suiv.
4 Ce substantif déds s’est seulement conservé, en gothique, dans le composé mtssordéd» «méfait». Mais nous le retrouvons dans le vieux haut-allemand tât, l'ancien saxon dâd et l’allemand moderne that « action». [Le h, dans l’allemand that, thun, est une insertion de date relativement récente. — Tr.] üaire; l’auxiliaire existe donc aussi dans l’allemand moderne ich suchte, ainsi que dans toutes les formes correspondantes des autres idiomes germaniques.
Dans l’ouvrage cité plus haut, j’avais supposé que le singulier sokida dérivait du participe passif1 : le thème de ce participe est, en effet, sokida (nominatif sâkiths) 412 413. Mais, malgré l’identité des deux formes, je les sépare aujourd’hui absolument414. En effet, si le da de sôkida «je cherchai» appartient à la même racine qui a donné dêdum dans sôkidêdum «nous cherchâmes» et dêds «action», il n’a rien de commun avec le da du participe; ce dernier représente le suffixe sanscrit ta415, latin tô, grec to ^Xsk-to-s, xffotrt-ri-s), lithuanien ta-s (sùk-ta-s «tourné»). La présence de ce suffixe dans toutes les langues indo-européennes est une preuve manifeste de son ancienneté.
S 621. Dérivés de la racine du, en gothique. — Conjugaison
du verbe auxiliaire.
Le thème du substantif dêds «action» est dêdi, dont lï a été supprimé au nominatif (§ i35); le génitif est dêdai-s, l’accusatif pluriel dêdi-ns. La syllabe di représente le suffixe sanscrit ti, qui sert à former des substantifs abstraits : nous avons vu (§ qi, 2) que ce suffixe devient en gothique ti, tin ou di, suivant la lettre qui le précède. Il reste la syllabe dê (en anglo-saxon dâ, en vieux haut-allemand ta) qui représente la racine; en sanscrit et en zend, la racine correspondante est VT du, ^ dâ « poser, faire». On peut se demander si le dê de dê-di «action» est absolument identique au dê de dêdum, dans sôki-dêdum. Je ne le crois pas; je regarde aujourd’hui dêdum comme un pluriel analogue à lêsum, nêmam, sêtum (§ 6o5), et je divise ainsi : dêd-u-m, dêd-u-th, dêd-u-n. Au subjonctif, je divise : dêd-jau (comparez tês-jau). J’admets une racine gothique dad, contenant un redoublement dont la langue n’a plus conscience, de meme que nous trouvons en sanscrit, au nombre des racines reconnues par les grammairiens indiens, ^V dad «placer, coucher», qui n’est pas autre chose au fond que la racine VT da précédée d’une syllabe réduplicative et privée de sa voyelle radicale.
Au singulier du prétérit composé en question, la syllabe réduplicative du verbe auxiliaire s’est perdue; mais, en revanche, la voyelle de la syllabe radicale s’est conservée, tantôt sous la forme abrégée a, comme à la première et à la troisième personne $ôki-da «je cherchai, il chercha», tantôt avec la longue primitive, comme à la seconde personne $ôki-dê-s « tu cherchas »l. De la syllabe da on peut rapprocher le da du zend dada (on trouve aussi une fois dada) «il créa, il a créé». Au pluriel et au duel de l’indicatif, et dans les trois nombres du subjonctif, le redoublement s’est conservé en gothique; mais la voyelle radicale a été supprimée.
1 Au sujet de IVgothique, qui représente ie UT d sanscrit, voyez S 69, a. C’est évidemment le * final qui a protégé la longue. On s'attendrait à avoir sôk-i-de-s-t, d’après l’analogie de sawo-s-t (S 454 ) ; nous avons vu plus haut (S 453 et suiv.) que le signe de la deuxième personne, au prétérit gothique, est t (— sanscrit ta). Nous pouvons donc supposer que dans sôk-i-de-s, salb-ô-dë-x, fuib-ai-dé-s, le s était anciennement suivi d’un t; en ce cas, il ne faudrait pas voir dans le s l’expression de la seconde personne, mais simplement une insertion euphonique.
S 6 a a. La racine du hors de composition, en anglo-saxon et en vieux haut-allemand.
Hors de composition, nous ne trouvons le verbe en question ni en gothique, ni dans les langues germaniques du Nord. En ancien saxon, nous avons au présent le singulier dô-m, do-s, dô-d (ou do-t), qui, si l’on fait abstraction de la perte du redoublement, répond très-bien au sanscrit dâdïï-mif dada-si, ddda-li. Le prétérit a gardé son redoublement : il fait au singulier dëda, dëdâ-s (peut-être pour dëdô-s-t), dëda. Cette dernière forme répond très-bien au zend dada (pour dada)\ Le pluriel dâd-u-n, qui sert pour les trois personnes 2, suppose, comme le gothique -dêd-u-m, -dêd-u-th, -dêd-u-n, une racine secondaire dad, dont le présent eût été didu; j’explique, en conséquence, dâdun comme étant pour daadun, qui lui-même est pour dadadun, avec deux redoublements.
En vieux haut-allemand, la confusion se met dans ce verbe dès la seconde personne du singulier tâti (pour tatati) «tu fis s3. Mais la première et la troisième personne iëta «je fis, il fit» sont restées fidèles à l’ancienne formation : elles n ont ni contraction. ni double syllabe réduplieative. Le pluriel est lât-u-mês, tât-u-lf iât-u-n (pour tatat-u-mês, tatat-u-t, tatat-u-n),
S 6a3, De lï dans les prétérits gothiques comme sôkida, salida.
11 reste à expliquer l’t de sôkida dje cherchai». Nous avons vu (§ 109% 6) que 1 eja de sôkja «je cherche» répond à la caractéristique aya des verbes sanscrits de la dixième classe ;
* Voyez S 6s i. Il ne reste pas d’exemple de la première personne zende, qui probablement faisait aussi dada.
* C’était d’abord la troisième personne du pluriel : elle a été transportée ensuite aux deux autres personnes.
■416 L’ancien saxon également permet la forme contractée dàdi, au lieu de dêfhi-x. Voyez Schmeller, Glosmrium suronicum, p. a5.
daus sôki-da, ceUe syllabe gothique ja se contracte en i. L7 de sôhida est donc en quelque sorte 1 équivalent du sanscrit ayâm dans éôrayân-éakâra1 et je volai??; ou, pour prendre des verbes de même famille, F* de sali-da «je plaçai??2 représente h ayâm du sanscrit sâdaydn-cakâra «je fis asseoir??; le gothique tham, dans tham-da «j étendis ??3, répond à tânayâm dans le sanscrit tânayân-cakâra «je fis étendre??; le gothique vasi, dans vasi-da «j’habillai», répond à vdsayâm dans le sanscrit vâsayân-cakâra « je fis habiller??.
On pourrait conjecturer que dans les composés gothiques en question le premier membre avait également la désinence de 1 accusatif, car il est un accusatif véritable par la signification. Comme la déclinaison gothique, telle qu’elle nous est parvenue, a partout perdu le signe de ce cas, on ne devrait pas s’étonner s il avait aussi disparu en composition. En regard du sanscrit mdaydn-cakara, tcuiayan-cakara, vâsaydû-cakâra, on pourrait donc supposer d’anciennes formes gothiques satinnla, tlianm-da, va-mi-da. La différence du verbe auxiliaire ne doit pas nous arrêter, car nous avons vu (§ 619) l116 sanscrit aussi remplace quelquefois kav «faire?? par un autre verbe de même signification, ou par les verbes as et Ikt «être??.
§ 62^. De ! d et de i ai dans les prétérits gothiques comme saJbôda, munaida.
A cote des prétérits composés comme sokida9 nous en trouvons d autres comme salbô-da : ils appartiennent aux verbes que Grimm range dans sa deuxième conjugaison faible. Nous avons vu (S 109®, 6) que ces verbes ont éliminé le y de la caractéristique sanscrite aya, et que les deux a, en se fondant ensemble, 416
ont formé un o (—d)416. On peut rapprocher, par exemple, du sanscrit lêhayân-éakâra2 «je fis lécher» le gothique laigô-da «je léchai » 417 418 419.
Il reste enfin la troisième conjugaison faible de Grimm, qui forme des prétérits comme munai-da «je pensai». Ces verbes, comme je le crois, ont retranché Va final de la caractéristique sanscrite aya, et ont vocalisé le y en t420. On peut donc rapprocher du gothique munai-da le sanscrit mânayân-cakâra «je fis penser», de ga-bauai-da «je bâtis» le sanscrit Bâvayân-cakâra «je fis exister, je créai » 421 422.
S 6a5. Verbes forts prenant le prétérit composé, en gothique. — Suppression de IV dans les prétérits comme thakla «je pensai».
Ce ne sont pas seulement les verbes de la dixième classe et les verbes dérivés qui prennent, en sanscrit, la forme périphrastique du parfait. Il y a aussi des verbes qui tirent immédiatement de la racine un substantif abstrait en â, dont ils joignent l’accusatif à l’un des auxiliaires précités. Ce sont notamment les racines commençant par une voyelle longue0 : ainsi U «commander» fait îsan-cakâra «je commandai».
De même, en gothique, nous avons le prétérit brah-ta «j’apportai» à côté du présent à forme forte bringa. En outre, les verbes dont le prétérit simple a la signification d’un présent (§ 616 ), expriment le passé à l’aide du prétérit composé. Ainsi nous avons môs-ta «je dus» à côté de mât «je dois»; mun-da «je crus» à côté de man «je crois»; skul-da «je fus obligé de» à côté de skal «je suis obligé de»; vis-sa (pour vis-ta) «je sus» à côté de u«2t(§ Agi ) «je sais» l.
Il existe enfin quelques verbes faibles ayant la syllabe dérivative ja qui, au lieu de former leur prétérit d'après le modèle de sôkida> suppriment 1 V et joignent immédiatement le verbe auxiliaire à la racine. En gothique, ces verbes sont seulement au nombre de quatre : thah~ta «je pensai» (présent thankja), bauh-ta2 «j'achetai» (présent bugja), vaurh-ta «je fis» (présent vaurkja), thuh-ta «il sembla» (présent thunkeith mis «il me semble »)3. Mais en vieux haut-allemand, la suppression de IV devient beaucoup plus fréquente ; elle a lieu toutes les fois que la syllabe radicale est longue. En même temps que IV disparaît, cesse aussi l’influence que cet i exerçait sur un a précédent (§ 78) : ôn a donc nan-ta4 (et non nen-ta) «je nommai», wan-ta5 (et non wen-ta) «je tournai», lêr-ta «j’instruisis». Les formes correspondantes, en gothique, sont namni-da, vandi-da, laisi-da. Ces verbes, et d’autres semblables, ont également perdu le j ou IV0 de la caractéristique ja au présent et aux temps qui s’y rat-
1 La dentale initiale du verbe auxiliaire devient!, th, d (S 91) ou s (S 109), selon la nature de la consonne précédente.
2 Avec au pour «, à cause de h (S 8a ).
3 En allemand moderne, ich denke, ich daehte; es dünkt mtr, es dàuckte mir. En anglais, l think, I ihought; l btty, l bought. — Tr.
4 Pour nann-ta (S a 09 ).
5 Pour wand-ta (S 102). Je crois que ce verbe est identique avec le sanscrit vart (m*t) «aller, être», qui, avec la préposition m, prend le sens de «retourner»; en latin, verto. Les liquides r et « ont permuté (S 90). Cela ne doit pas nous empêcher de rapporter aussi à la racine vart Pallemand werden «devenir», car il arrive souvent qu'une seule racine se scinde en plusieurs formes à significations différentes.
s L’écriture, en vieux haut-allemand, ne distingue pas le j de Pi ; il est donc impossible de savoir si le gothique nasja «je sauve», nasjam «nous sauvons» fait en vieux haut-allemand nerju, neijamës, ou neriu, neriamés. 11 n'est pas douteux, toutefois, qu’au moins à l'origine on a du prononcer j.
tachent; mais radoucissement de Va précédent a subsisté [nennu, wendu, lêru), d’où Ton peut conclure que le j ou IV sont demeurés beaucoup plus longtemps au présent qu’au prétérit.
S 636. Y a-t-il une parenté entre la flexion du participe passif sôkida ff cherché » et celle du prétérit composé sokida «Je cherchai « ?
Le participe passif marche de pair, en gothique, avec le prétérit actif, en ce qui concerne la suppression ou le maintien de 17 dérivatif, et en ce qui touche les modifications euphoniques subies par la consonne finale de la racine. Du prétérit ôh~ta «je craignis», ori peut donc induire le thème participial ôh-ta «craint» (nominatif dAfe), quoiqu’il n’existe point d’exemple de cette forme. A côté de vaurh-ta «je fis» (venant de vaurkja), nous avons le participe vaurhts «fait»1 (thème vaurhta). A côté de jva-bauh-ta «je vendis» (venant defrabugja), on a fra-bauhts « vendu » 2.
Mais on n’est pas autorisé à conclure de ces rencontres que l’un des deux temps en question soit dérivé de l’autre. Ce serait commettre la même erreur que si nous disions que les participes latins en lus (doctus, monitus) et en turus (docturtis, moni-turus), ou les noms d’agent en tor (doctor, monitor) sont sortis des supins (doctum, monitum). Il est naturel que des suffixes commençant par la même lettre se combinent de la même manière avec la racine, et contractent de la sorte entre eux une analogie extérieure, quoiqu’ils soient d’origine complètement différente. Il est vrai que le verbe auxiliaire signifiant « faire », dans les langues germaniques, et le suffixe du participe passif, n’avaient pas primitivement la même lettre initiale : en effet, l’un se rapporte à la racine sanscrite ^|T d'à et l’autre au suffixe rl la. Mais ils en sont venus à avoir tous les deux un d, par suite des
1 Marc, xiv, 58.
a Jean, xii, 5.
lois phoniques propres aux langues germaniques. La loi de substitution veut d’une part qu’un d: sanscrit devienne un d en «o-thique (S 87, 1), et, d’un autre côté, le suffixe ta, qui régulièrement devrait donner tha, devient da quand il est précédé d’une voyelle de dérivation (§91,3). Ayant par conséquent da au participe passif et da au prétérit composé, la langue gothique a traité de la même façon deux formes extérieurement semblables. Pareille chose a lieu pour le suffixe sancrit ti qui sert à former des substantifs abstraits; en gothique, il devient di après une voyelle, et U, tin ou di après les consonnes (§ 91, a ). On peut donc aussi conclure du prétérit mah-ta «je pus» à un substantif nmh-ts
(thème mahti «puissance»), sans que, pour cela, l’un dérive de l’autre.
* $ 627. Prétérit périphrastique, en persan moderne.
S il est permis de dire qu’en gothique le prétérit sôkida «je cherchai » et ie participe sôkiths (thème sôkida) «cherché»1 ne sont unis entre eux par aucun lien de dérivation, je ne crois pas qui! faille étendre le même principe, ni appliquer le même 1 aisonnement au persan moderne, où nous trouvons d’une part hev deh «ayant» ou «étant porte», bes-teh «ayant» ou «étant lié », pors-î-deh « ayant » ou «étant interrogé», et d’un autre côté bcr-dem «je portai», bes-tem «je liai», pors-Mem «j’inter-îogeai». Je pense, au contraire, que les prétérits persans dé-livent des participes2. Remarquons d’abord que les participes en question ont a la fois le sens actif et le sens passif, au lieu quen sanscrit Br-td- ( nominatif masculin Br-td-s ) signifie seulement «porté» : il ny a que les verbes neutres qui aient, en sanscrit, la forme ta avec la signification active; tels sont, par
f éminin sôkida (thème sôkido) «cherchée».
J ai déjà exprime celte opinion dans mon Système de conjugaison, page i j8, cl dans ma recension de la Grammaire allemande deGrimm (Vocalisme, page 7a).
exemple, Mtd-s «ayant été», gatd-s «ayant marché». Or, le parfait, en persan, consiste dans la juxtaposition du participe et du verbe substantif : berdem «je portai» équivaut à berdeh em ^je suis ayant porté». La contraction qui s’est opérée entre les deux mots ne doit pas surprendre, si l’on songe que le persan unit très-souvent le verbe «être», non-seulement avec des participes, mais avec des substantifs et des adjectifs : il fait, par exemple, merdetn «jesuis un homme», busurkem «je suis grand».
À la troisième personne du singulier, on a berd ou berdeh, sans verbe auxiliaire. De même, au futur sanscrit (S 646), ou emploie Sarta « laturus » dans le sens de «laturus, latura, latu-rum est», tandis qua la première et à la deuxième personne des trois nombres, la présence du verbe auxiliaire est de règle (Sartdsmi «je porterai», etc.).
Les formes du verbe substantif sont réduites à si peu de chose en persan, que, si l’on excepte la troisième personne est, elles ne se distinguent plus des simples désinences des autres verbes423. Aussi pourrait-on soutenir, contrairement à ce qui vient d’être dit, que berdem ne contient pas le verbe substantif, mais consiste simplement dans le participe berd (pour berdeh) suivi des désinences personnelles. Mais il faudrait alors admettre que berd est devenu une sorte de racine verbale, ce qui me paraît bien moins vraisemblable que la contraction de berdeh em en berd-em,
S 628. Le prétérit périphrastique, en polonais.
Les dialectes slaves vivants, à l’exception du serbe, forment ou plutôt transcrivent leur prétérit comme le persan moderne.
Il y a même identité entre les deux langues, si j’ai raison de regarder le suffixe slave lo (féminin la) du participe prétérit actif comme le représentant du suffixe sanscrit ta; je reconnais, par exemple, dans l’ancien slave bülü «été» le sanscrit Bûtd-set le persan bûdeh. Peut-être le changement du t en l s’est-il opéré par l’intermédiaire d’un d. Comparez le rapport du lithuanien brolis «frère » 1 (en lette brâlis) avec le borussien brati et l’ancien slave bratü (ou bratrü). On pourrait objecter que, dans certaines formes slaves, le suffixe participial ta s’est conservé avec son ancien t et son ancienne signification passive; mais cela ne doit pas nous empêcher de rapporter aussi au participe sanscrit en ta les participes ordinaires en h, la, à signification active, d’autant plus que le sanscrit attribue la signification active à certains participes comme ga-tâ-s « ayant marché » (S 819 ) Pour expliquer le suffixe slave h (féminin la), on pourrait être tenté de songer au suffixe sanscrit la3, que nous trouvons, par exemple, dans iuk-la-s « blanc » (primitivement «brillant»), cap-a-lâ-s « tremblant », tar-a-lâ-s ( même sens), an-i-M-s « vent » (littéralement «soufflant»). On trouve des formations analogues en grec, en latin et en lithuanien (§ 988 et suiv.). Mais il n’est guère vraisemblable que le suffixe la, relativement rare dans tous ces idiomes, soit devenu dans les langues slaves l’expression ordinaire du participe passé actif.
En polonais, hyl signifie «il fut», byta «elle fut», bylo «cela fut», byti «ils furent», byly «elles furent»4. Comme le verbe auxiliaire est sous-entendu et comme les formes en l, la, to, K,
1 Le t s’est conservé dans le iitbuanien brôtuéë « nièce, fille du frère».
s Nous avons, de même, en latin, à côté des participes passifs en tus, des formes à signification active en dus, telles que viv-i-dus, splend-i-dus (S 819).
3 Le suffixe en question est, selon toute apparence, originairement identique avec le suffixe ra (S 987).
4 La forme masculine byü sert seulement pour les noms d’hommes : tous les autres substantifs des trois genres emploient la forme féminine byty.
hj ne sont jamais employées en qualité de vrais participes, mais seulement pour remplacer l’indicatif présent, elles ont complètement pris l’apparence et adopté la nature des flexions personnelles. On peut donc les rapprocher des formes latines ama-mini, amabamni : le polonais l’emporte toutefois sur le latin, en ce qu’il a conservé la différence des genres, au lieu que le latin emploie invariablement le nominatif pluriel masculin (§ 478). H y a encore une ressemblance plus grande entre ces formes polonaises et la troisième personne des trois nombres du futur participial en sanscrit (§ 646). Mais c’est surtout avec le persan qu’on peut comparer les formes en question : ainsi byt «il fut» répond au persan bûd ou bûdek «il fut» (littéralement «été»). A la première personne du singulier masculin, byleni (byl-em) répond très-bien au persan bûdem, que j’explique, comme on l’a vu, par le sanscrit Bâto ’smi (par euphonie pour butas asmij, littéralement « été je suis » ; le féminin bylam (byta-m) répond au sanscrit Buta ’smi, et le neutre bytom ( bylo-m) à Bûtâm asmi. A la deuxième personne du singulier, nous avons en polonais byles (byl-es)* bytaé (byla-s), hytos (Jÿfc-s), ce qui répond au sanscrit Bûto’si (pour Bûtds ori), Butaisi (pour Bâta asi) et Bûtâm asi. Au pluriel, la première personne est, pour le masculin, byli-my, et pour le féminin byly-smy : la forme sanscrite correspondante est Butas smaSy pour les deux genres. A la deuxième personne, nous avons byUdcie, bylyscie1; en sanscrit, Bâtas sia.
Remarque 1. — Mutilation du verbe auxiliaire au prétérit périphrastique, en slave. — La syllabe cm dans le masculin byl-cm, et la lettre m dans le féminin byla-m et le neutre bylo-m y appartiennent, selon moi, au verbe substantif. Dans ces deux dernières formes, ainsi que dans byla-s, byto-P.
1 Le c polonais, qui se prononce t$} représente un ancien f ; ainsi le cie de la seconde personne du pluriel répond à l’ancien slave TC te, et le c final de l’infinitif à l’ancien slave TM fi.
* Deuxième personne du singulier féminin et neutre.
il ne reste donc du verbe substantif que la désinence personnelle. C’est à peu près ce qui est arrivé en allemand moderne dans les contractions comme im «dans le», zum (rvers le», am «près du », beim «chez le» (pour in dm zu dem, an dem, bei dem). où l'article n’est plus représenté que par sa désinence l.
A la première et à la deuxième personne du pluriel, la consonne radicale s’est maintenue : on a émy, scie en regard du sanscrit smas, sia et du latin sumus (pour sinus).
Employé hors de composition, le verbe substantif fait en polonais jestem ffje suis», jesteé «tu es», jestesmy «mous sommes», jcstescie «vous êtes». Mais je ne pense pas que ce soient là des formes primitives : je les crois sorties de la troisième personne du singulier jest «il est». Cette forme jest1 répond très-bien à l’ancien slave jeslï, au russe cstj, au bohémien gest (g = 7), au slovène je (avec perte de st), ainsi qu’au sanscrit asti, au grec èali, au lithuanien esti et au latin est. Au contraire, jeslem, jestesmy, etc. s écartent de toute analogie avec les langues congénères. Je crois donc que jestesmy «nous sommes» doit se décomposer en j'est-esmy, et je reconnais dans la dernière partie esmy le représentant du russe esmy. Quant à la forme polonaise jest-em «je suis», il faut supposer qu’elle a perdu un s devant le m, comme cela est arrivé aussi pour le em de byl-em «je fus» (littéralement «été je suis»).
11 n est pas étonnant qu’eu composition avec le participe nous ne rencontrions pas l’élément superflu jest : peut-être qu’à l’époque où fut formé le prétérit périphrastique, cet élément n’était pas encore entré dans le présent du verbe substantif; ou bien l’on en sentait encore la valeur, cm' jest-em ne signifie pas «je suis», mais plutôt «c’est moi». Nous trouvons quelque chose danalogue dans les langues celtiques : en gaélique irlandais, is me, selon OReilly, veut dire proprement «cest moi», et ba me ou budh me «ce fut moi» 3. De même, au futur, je crois que le signe de la troisième personne s est introduit dans la première ; il a même fini par faire corps avec le thème du verbe substantif, de sorte que celui-ci peut y ajouter les désinences des autres personnes.
Remarque 2. — Comparaison du verbe auxiliaire, au parfait périphras-
1 Encore cette désinence n’est-elie qti’apparenle (S * 70).
2 Sur le j initiai, voyez S 92*.
3 Budh «il fut» = sanscrit éBût (S 573); ha (même sens) = sanscrit âbaval.
tique, en persan et en slave. — En persan moderne, à côté de em «je suis», nous avons hesiem qui a le même sens. 11 y a une similitude frappante entre ce hestem et le polon ^ jestem, ainsi qu’entre la troisième personne O-*0 hest et le polonais jest. En admettant la parenté de h est et de est, on pourrait supposer la prosthèse d’un h \ de même que le polonais jest et l’ancien slave jestï ont pris un j prosthétique : le persan hestem «jesuis», hestî «lu es», etc. dériveraient alors de la troisième personne, comme le polonais jestem, jestes. Mais je préfère rapprocher le persan hestem du zend histâmi (venant de sistâmi) trje suis debout». Déjà, en sanscrit, la racine sia rrse tenir debout» a fréquemment le sens «être»; dans les langues romanes, la racine du même verbe sert à compléter la conjugaison de l’ancien verbe substantif.
On peut donc comparer :
|
Grec. |
Zend. |
Persan. |
|
folayua |
histâmi |
hestem |
|
ï<flàs |
histahi |
hestî |
|
folàn |
histaiti |
hest |
|
ï&7a(ies |
histâmahi |
hestîm |
|
fol are |
histaia |
hestîd |
|
folâvrt |
histënti |
hestend. |
On voit qu’à la troisième personne le verbe persan hest est privé de tonte désinence personnelle : autrement, il faudrait hcstcd, comme nous avons hered «il porte», pursed rril demande», dehed «il donne» 424 425 426, etc. La désinence de la troisième personne manque pareillement eu allemand moderne, dans les formes comme vcird «-il devient», huit «il tient», pour wirdet, hâltet.
Pott \ qui a également songé à la racine stâ pour les formes persanes en question, s’est cependant arrêté à une autre explication. Il voit dans le t du persan kestem et du polonais jestem le t du participe passif. Mais on peut objecter que ni en sanscrit, ni dans aucune langue congénère, le verbe as ne forme un participe en ta : le sanscrit fait bûta-s et non asta-s, le persan fait bûdeh et non esteh, le slave fait bylü et non jeslü; le lithuanien n’a pas de forme estas , ni le latin estas, ni le gothique ists. On est donc autorisé à conclure que si la racine as a jamais eu un participe en ta, il s est perdu a une époque tellement ancienne qu’il n’a pu servir ni au polonais, ni au persan moderne, pour la formation du prétérit et du présent de 1 indicatif.
§ 6y9. Le prétérit périphrastique, en bohémien et en slovène.
Le bohémien, au prétérit, place après le participe passé le présent du verbe auxiliaire; mais il ne joint pas les deux mots ensemble. Le slovène met d’abord le verbe auxiliaire. Le russe s’en passe tout à fait et distingue les personnes par les pronoms placés devant le participe. «Je fus» se dit donc, en bohémien, suivant la différence des genres : byl sent, byla sem, bylo sem; en slovène : sim bil, sim bila, sim bilo; en russe : ja («je») bül, ja büla,ja bülo.
Entre le slovène et le sanscrit, il y a une rencontre curieuse aux trois personnes duelles et aux deux premières personnes plurielles du présent du verbe substantif. En sanscrit, suivant une loi phonique d’une application générale, svas «nous sommes tous deux» et stas «ils sont tous deux» doivent perdre leur s final devant une voyelle (excepté devant un a bref) : nous avons alors sva, sta427 428, qui sont précisément les formes slovenes. Au pluriel, en regard du sanscrit smas (devant les voyelles sm) «nous sommes», sia «vous êtes», sânti «ils sont», nous avons, en slovène, smo, ste, so. Remarquons toutefois que, si les deux
langues ont perdu la voyelle initiale de la racine, c’est là une rencontre fortuite, car l’ancien slave a partout conservé cette voyelle 1, qu’il fait précéder dun j prosthétique (§ 48o).
§ 63o. Le verbe dâ, en grec. — L’aoriste et le futur passifs, en grec, sont formés à Faide de ce verbe auxiliaire.
Nous avons vu plus haut (§ 621) que les prétérits comme sohida, en gothique, et comme suchte, en allemand moderne, renferment un verbe auxiliaire signifiant « faire », qui est identique avec la racine sanscrite dâ « poser, faire ». C’est le meme verbe que je reconnais, en grec, dans les aoristes et futurs passifs comme êrv(p-Qtjv, Tv(p~8ïjaro(Aat : je crois, en effet, que stuÇ-Brjv renferme l’aoriste actif, et rvÇ-Bifo-Qf&ou le futur moyen de tt'Ôtjpu = sanscrit dddâmï2.
On peut comparer ?v(p-Bœ, 7v<p-8eiijv, rv(p-8tf<TO(iat avec les formes simples 3*<y, 3-sttjv, 3rf^o{iat, qui se fléchissent exactement de même. Entre hitp-Qrjv et eQrjv, il y a cette différence que ce dernier abrège la voyelle radicale devant les désinences pesantes du duel et du pluriel, au lieu que êjvip-Otjv garde partout son j/. Mais la comparaison du sanscrit nous montre que la longue restait primitivement dans les trois nombres, car nous avons, en regard du singulier ddâ-m = s8tjvy le pluriel
âdd-ma, qui supposerait en grec ëôri{isv9 au lieu de eôsfiev. L’aoriste grec Mt)v est resté plus près du sanscrit, car il garde la longue au duel et au pluriel. À l’impératif, tv<P~8vti se distingue encore avantageusement du simple 3-es, par la conservation de la voyelle longue, comme par sa désinence plus pleine.
A côté du futur Tv(p-6tf(TOfia.i, nous devions nous attendre à trouver un aoriste èrv<p6rl^vv, ou inversement l’aoriste èvify-Briv 429
semblerait demander un futur à désinence active *. Peut-être v
J
a-t-il eu, en effet, dans une période plus reculée, un futur et un aoriste périphrastiques actifs tv$~6rlcrw et èTv<p-6iiv, à côté desquels ‘TvÿOïi-o'oyLOLi et exv<p-6ti(iyv (ou êrv(p-6é(xrjv^ servaient pour le passif. Mais la langue grecque, telle quelle nous est parvenue , a perdu deux de ces formes, et une fois qu’on eut cessé de reconnaître dans la syllabe S-y un verbe auxiliaire, on s’habitua à y attacher une signification passive. C’est ainsi qu’en allemand moderne la syllabe te de suchte n’est plus sentie comme verbe auxiliaire, et fait simplement l’effet d’un exposant du passé. De même encore, dans le mot heute, la syllabe te n’est plus reconnue comme une expression signifiant «jour», ni la syllabe heu (vieux haut-allemand km) comme un pronom démonstratif; mais le tout fait l’impression d’un adverbe simple spécialement créé pour signifier « aujourd’hui ».
8 631. L’aoriste et le futur seconds passifs, en grec.
A l’aoriste et au futur seconds, nous avons èiittyv et TtWo-c-pou, que je regarde comme des formes mutilées pour irv(p9yv et tv<p8ffero(mi. Le 3- s’est perdu, de même qu’à l’aoriste actif des verbes finissant par une liquide s’est perdu le cr. Comme c’est seulement à cause du 3- que nous avons un dans êrvÿOyv, tv(p6rt<royLat, on ne doit pas s’étonner si l’ancien it reparaît dans ëTVTTtjv, tv7ïrfcropuu. Un fait analogue a eu lieu en allemand moderne; on dit au génitif et au datif singuliers kraft, quoique le moyen haut-allemand ait krefte; mais la voyelle finale qui exigeait l’adoucissement de Va étant tombée, l’ancien son a reparu. Au contraire, au pluriel, Ve de la désinence étant resté, on continue à dire krâjte (en moyen haut-allemand, krefte).
Une autre explication pour èxiisyv consisterait à y voir le
1 Ahrens (De dialecto dorica, page 289) cite les formes doriennes cvvajfBrtoovvtt^ warwôrffféo, Seixdyaovv'tt, et, à l’infinitif du futur second, (pav^aeiv.
verbe substantif; en effet, irvntjv se fléchit exactement comme iv. Mais nous aurions alors deux augments dans une seule et même forme, car ff»9 comme on l’a vu (§ 629), renferme un augment. Il est vrai que le sanscrit unit l'imparfait àsam « jetais » avec un verbe attributif; mais alors il supprime Faugment et, du même coup, la voyelle radicale a du verbe auxiliaire (§ 542). Une objection encore plus grave, c’est que nous aurions l’aug-ment au futur Tvni/fo-opat et à l'impératif tvir#0i. Les formes quon attendrait sont TwécrofÂat, TvwtaOi, ou peut-être, avec suppression du <r, twTtôt; à la troisième personne, rviréalù) ou vmheo. Enfin, au participe tunsk, la désinence ets est sans analogie aucune avec le participe du verbe substantif.
S 63*2. Le verbe dâ employé en composition, en latin. — Les verbes comme vendo, credo.
Le latin vendo présente une formation analogue au germanique sokidtty sokidêdum et au grec èTvÇ>6rjv, rvÇdrfo'Ofiai. Je crois, en effet, que le do renfermé dans vendo correspond au grec t/-Qtipt - sanscrit dddâmi, et non à SiSwyn = sanscrit dddâmi. Entre les racines dâ «donner» et dâ «poser», il n’y a de différence que 1 aspiration : en zend, il est presque impossible de distinguer ces deux verbes1; en latin, ils pouvaient aisément se confondre, puisque le dsanscrit et le 3* grec sont souvent représentés, surtout a l’intérieur des mots, par un à, de même que le B sanscrit par un b (§§ 16 et 18). De ce que la racine dâ, Bn ne s’est pas conservée en latin comme verbe simple, on n’a pas le droit de conclure qu’elle ne puisse être renfermée en composition : nous croyons la reconnaître dans credo2, perdo, abdo, condo et
1 Le d, en zend, devient fréquemment un dr à l’intérieur des mots (S 89), et le <1 perd son aspiration quand il est lettre initiale.
2 C’est Auguste-Guillaume de Schlegel qui a reconnu le premier ( Bhagavad-Gîtd, *** «dition, page to8) la parenté du latin credo et du sanscrit srad-daddmi «je crois1!, littéralement «je mets croyance» (comparez S 109", 5).
vendo, ainsi que dans pessundo, pessumdo. Dans venundo, le premier mot est à l’accusatif, comme dans le composé sanscrit Uan-cakâra (§§ 619 et 625).
S 633. Le verbe dà employé comme auxiliaire, en slave. — Le futur buhduh trje serai», l’impératif buhdêmü «que nous soyons».
Pour montrer dans toute son étendue l’influence que la racine d'â, dans les langues de l’Europe, a exercée sur la conjugaison, il nous reste à examiner le slave. Je crois reconnaître cette racine dans la dernière partie du futur et de l’impératif du verbe substantif. « Je serai» se dit en ancien slave bunduh, c’est-à-dire littéralement «être je fais». Dans ce composé, dm se fléchit exactement comme le présent vesuh (S 5 0 7 ) : il fait, par exemple, bun-desi «tu seras», buh-detï «il sera». Il y a seulement cette différence, que dans ves-e-êi, ves-e-tï, Ye est la caractéristique de la classe, au lieu que dans bun-de-si, buh-de-tï, Ye représente la de la racine dd. Il faut supposer qu’en ancien slave cet â s’est abrégé, car Ye correspond ordinairement à un a bref sanscrit (§ 92°); nous rappellerons à ce sujet que la racine stà abrège en sanscrit son â, qui est traité comme s’il était la caractéristique de la première classe (5o8). À l’impératif slave, nous avons E<ftA’fcMZ bun-dê-mü «que nous soyons» (littéralement «être que nous fassions»), bun-dê-te «soyez». Nous avons
ici un t ê3 comme en sanscrit au potentiel de siâ : tisiê-ma « que nous soyons debout», tiê^ê-ta «que vous soyez debout».
On voit que e^a bund a pris tout à fait l’aspect d’une racine simple : on croirait que c’est un verbe appartenant à la sixième classe sanscrite ou à la troisième conjugaison latine. 11 en est tout à fait de même, en latin, pour les verbes composés comme vendo : sans le parfait vmdidi, on pourrait supposer qu’il appartient à la même conjugaison que veho. Mais il y a cette différence entre IV de ven-di^s, ven-di~t et celui de veh-i-s, veh-i-t,
que le premier répond à ïâ de dd-da-si, dd-dd-tï ou à P»; de t/-Qn-s, Ti-On-Th au lieu que le second représente la caractéristique a de vâh-a-si, vdh-a-ti.
§ 634. Le verbe dâ employé hors de composition, en slave.
Il y a aussi en ancien slave un verbe a* dê « faire », qui s’emploie hors de composition; il ne se distingue du verbe aé de renfermé dans buh-duh que par sa voyelle longue et par la différence de sa conjugaison : au lieu de suivre la première classe sanscrite, il appartient à la dixième (S 5o4). Il fait au présent Am dêjuh s je fais» : Kopitar en a rapproché avec raison Taile-mand thun et 1 anglais do. De la même racine vient le substantif neutre dêlo «action, acte», qui est formé comme les participes dont il a été question plus haut (§628), et qui, à la différence de ceux-ci, a laissé à son suffixe son ancienne signification passive.
S 635. Le verbe dâ employé comme auxiliaire en slave. — Le présent iduh trje vais b. — Comparaison avec le gothique.
De buiidun «je serai» on peut encore rapprocher l’ancien slave maiduh «je vais», qui signifie littéralement «aller je fais». Le premier membre du composé appartient à la racine % «aller» (infinitif mtm i-ti).
Nous avons, de même, en gothique, le prétérit irrégulier i-idja «j’allai», pluriel «i-ddjêdum «nous allâmes». Je crois que ces formes sont pour i~dat i-dedum (littéralement «aller je fis, sJler nous fîmes»), avec redoublement dû d et addition d’un y. Je les regarde donc comme le pendant du présent slave i-duh.
S 636. Le verbe dâ employé comme auxiliaire, en lotte et en lithuanien. En lette, il y a quelques verbes qui, dans toute leur conjugaison, sont unis avec le verbe auxiliaire en question. Tels sont : dim-deh-t430 « sonner», nau-deh-l « miauler », à côté desquels se trouvent aussi les simples dim-t et nau-t. Quelquefois la signification du verbe auxiliaire se fait encore clairement sentir, et le verbe avec lequel il est joint prend le sens d’un causalif : on peut comparer bai-deh-t « effrayer » avec bî-t «craindre» (en sanscrit Bi « craindre » ), et skum-deh-t « attrister » avec skum-i «être triste». D’autres fois, comme dans le précité dim-deh-t, il équivaut à l’auxiliaire anglais to do431.
11 a été déjà question (§ &2Ô) de la forme lithuanienne appelée l’imparfait d’habitude : nous y avons reconnu la présence du même verbe auxiliaire.
S 637. Le verbe da employé comme auxiliaire, en zend.
En zend, nous trouvons aussi le verbe en question employé comme auxiliaire annexe. II est contenu, par exemple, dans yaus-dâ «purifier», qui fait au présent moyen yyaus-datente «ils purifient», au potentiel moyen *pairi-yauê-daüita «qu’ils purifient» (§ 7û3), et à l’impératif yaus-dat-âni «que je
purifie». Dans le substantif yaus-dâiti «purification», la forme dmti correspond exactement au gothique dêths (thème dêdi)432.
On rencontre plusieurs fois dans le Vendidad-Sâdé l’expression yaus-dayahn anhën « ils sont purifiés»;
peut-être faut-il lire yaîisdayanm anhën ; je prendrais alors le premier mot pour le locatif de yausdâ, et je traduirais le tout par «ils sont en purification». Mais s’il faut conserver la leçon du texte, je regarderai yausdayahn comme l’accusatif pluriel de
PARFAIT. S 637. l’adjectif yauêdaya « pur » : le verbe substantif est alors construit avec l’accusatif, comme en arabe.
Remarque. — La forme dni (venant de d'tî), en zend. Burnouf explique le t de dni comme un complément inorganique qui est venu se joindre l ia racine dâ, da. J’ai partagé autrefois cette opinion*; mais je regarde aujourd’hui le i de dai comme étant pour nn d', et je vois dans le da la syllabe réduplicative, comme dans le sanscrit Stnfa dMâmt. En conséquence, ni-daiiyahn «deponant» correspondra au sanscrit
tddadÿus et ni-daiiîta à FRJÎfrT m-dadïta (S 70s). Au participe
du prétérit redoublé, nous avons le génitif daiusâ qui répond au sans-
critdad'ùsas. Au contraire, le nominatif ?»»^ dadvâo (= sanscrit sfësrR, M-wdn) et l’accusatif <cow»»£» dadbâoMin (= sanscrit dadi-i-vdhsam) n’ont pas opéré la substitution du t au d’-• c’est que très-vraisemblablement elle n’avait lieu qu’aux cas faibles.
Remarquons que quand le verbe dâ est en composition avec un autre
mot et chargé d’un redoublement, ü a presque toujours le l; au contraire, quand il n’est pas précédé d’une préposition, quand il n’est pas en composition avec un autre mot, ni chargé d’une syllabe réduplicative, il emploie de préférence le tf : cette différence tient peut-être à ce que le l est traité par
le zend comme une lettre plus faible que le d' et le d3.
Dans les formes comme nidaiëm «j’ai créé», je regarde la voyelle qui suit le l, non comme la caractéristique de la classe, mais comme la voyelle radicale abrégée ; on a vu que le verbe OTT stâ, en zend *><•» étâ, abrège de même sa voyelle radicale (S 5o8).
Il y a quelques formes où, au lieu de dai, nous trouvons dat; exemple : nidâlayën «qu’ils déposent* \ La syllabe réduplicative s’est peut-être allongée pour compenser l’abréviation de la syllabe radicale; ou bien le da nest 433 431 432 434
thé «ils sont tous
plus reconnu connue un redoublement435, de sorte que dat est traite par
la langue comme une racine secondaire.
Nous avons encore en zend un autre verbe composé dans lequel je reconnais la racine da, dont Va final s’est abrégé : c’est le thème verbal snâdii ff laver 75, composé des racines snâ et dW.
8 638. Le prétérit redoublé, en zend.
Nous revenons au prétérit redoublé, qu’il nous reste à étudier en zend.
~ Nous avons déjà donné (S 5 *20) quelques prétérits zends formés de la même manière qu’en sanscrit. Ce qui est particulier au zend, c’est le penchant à allonger l’t ou Yu dans la syllabe réduplicative, quand la racine commence par une seule consonne; exemples : vîvîsê, tûtava. Le premier de ces prétérits vient de la racine vis, qui semble signifier, au moyen, «obéir», et qui correspond à la racine sanscrite fw*^vis (classe 6), dont le sens habituel est «entrer». Dans le passage déjà cité : yesi moi yima nâid vîvîsês «si mihi, Yima! non obtemperasti», vîvîsê est à la seconde personne du prétérit moyen. Il ressort de cet exemple que de la désinence sanscrite sê (= grec <ra<), la voyelle seule s est conservée après une consonne 4 ; vîvîsê peut donc servir pour les trois personnes du singulier. Quant à la forme tûtava, elle est a la troisième personne dans le passage : yêsi tûtava «s’il le peut» ou «si on le peut, si cela est possible». La forme correspondante, en sanscrit, est tuttiva, de la racine tu «grandir». Quand la racine commence par deux consonnes, Yi ou i’« ne s allonge pas dans la syllabe réduplicative : c’est ce que prouvent les formes
1 didvaisa vj’ai offensé, j’ai blessé» et tuîrnyê2 «il a
conservé».
Va, étant la plus pesante des voyelles fondamentales, reste ordinairement bref dans la syllabe réduplicative, même quand la racine commence par une seule consonne : nous avons, par conséquent, vavaca3 «je parlai»; la forme correspondante en sanscrit, uvdca ou uvâ'ca, a contracté le premier va en u. Un autre exemple est tatasa «il a formé» = sanscrit tatdksa4. Il y a toutefois des verbes qui allongent Va dans la syllabe réduplicative : tel est dâdarëéa « il a vu » — sanscrit daddrsa, grec SéSopxe.
Au contraire, les racines ayant un â prennent un a bref dans le redoublement; exemple : dada5 «il a créé» = sanscrit dadau «il a posé». Cet exemple nous montre aussi que la forme sanscrite au (pour à, § 618) n’est pas usitée ou, du moins, n’est pas obligatoire en zend. Du zend dada6 on peut rapprocher l’ancien saxon dëda (pourdtda) j’ai fait, i! a fait» (§ 692). Je ne doute point que la première personne n’ait été également dada; à la deuxième personne, je suppose que le zend faisait dadâîa (§ 453 ).
S 689, La forme zen de âmkênti.
Au pluriel, je ne connais pas d’exemple, en zend, du par-
1 Vendidad-Sàdc, page 13. Le manuscrit lithographié aun^s, que je remplace, avec Burnouf (Yaçna, page 580), par un ^ s. Mais je maintiens ie d devant le v.
- Vendidùd Sddé} page 1 a. Sur le y euphonique devant IV, voyez S 63.
3 Vendidad-Sâdé, p. 83.
4 Voyez S 5a, et Burnouf, Yaçna, p. lia. r’ Vendmad-Sadé, p. 2.
0 Pour dada (S n8), qui lui-même est pour dadd-a (S 6i8) ; rapprochez les formes sanscrites comme ninfty-a «il conduisit?*, éuériïv-a «il entenditvenant des racines ni, sru. BurHouf écrit ( Yaçna, page 358) dadhâo, peut-être par erreur, car je ne trouve aucun exemple à l’appui de celte forme. Les seuls exemples qui me soient connus sont dada et une fois dada; mais cette dernière forme se trouve dans le dialecte du Yaçna qui, ainsi qu’on l’a dit (S 188), allonge les voyelles finales.
fait actif, à moins que nous ne voyions dans âonhënti le pluriel de âonha «.il a été» = sanscrit asa1. La forme âonha se trouve dans ce passage2 : fgpL»
mutent âonha nôid garëmëm «neque fri gus fuit neque æstus». Quant à la forme âonhënti, nous la rencontrons dans cette phrase 3 :
haumô taicid yôi lutta y ô naskâ frasâonhô âonhënti spânô mastîmca balisaiti «Haumas iis quicunque capitula dicentes fuerunt excellentiam magnitudi-nemque largitur»4. Nous avons traduit âonhënti par «fuerunt» quoiqu’on puisse aussi le considérer, quant au sens, comme un présent : il a déjà été question (S 5so) de cette particularité de la langue zende.
Nériosengh, dans sa traduction sanscrite, rend la forme en question par nisîdanii «ils sont assis»5, ce qui nous
prouve qu’il a vu dans âonhënti un tout autre verbe. Mais je ne crois pas qu’il faille attribuer une trop grande importance à cette interprétation. Nériosengh a fort bien pu confondre les racines as «être» et ij(^ as «être assis», qui toutes deux existent en zend comme en sanscrit : nous voyons bien qu’il confond aussi les deux racines zendes dâ «donner» (= sanscrit dâ) et dâ «poser, placer» (= sanscrit da). Dans le cas présent, l’erreur était d’autant plus facile que âonhënti, si on le considère comme un parfait, est peut-être une forme unique
1 Voyez SS 56a et 56 b. [ Ou trouvera des formes de pluriel dans Justi, Manuel de la langue zende. p. 4oi. — Tr.]
* Vendidad-Sâdé, p. ho.
5 Vendidad-Sâdé, p. i5.
4 Anquetil, qui, dans une phrase, conserve rarement à toutes les formes leur valeur grammaticale, traduit : «O Hom, accordez l'excellence èl la grandeur à celui qui lit dans sa maison les Nosks-\
e »
5 Burnouf, dans ses Etude» sur la langue et les teæles zends, p. 287 et suiv. examine en détail le passage dont il est question ici.
t|aps les textes zends, au lieu que comme présent âonhënti aurait Je nombreux analogues. Si, toutefois, Nériosengh avait raison, je regarderais ici la racine as comme ayant le sens du verbe substantif : nous avons vu, en effet (§ 609), qu’en sanscrit la racine «s signifie quelquefois «être»1.
Ajoutons, pour terminer, que si âonhënti est, comme nous l’avons supposé, le parfait du verbe substantif436, cette forme est plus ancienne que la forme correspondante en sanscrit : âsüs (S462).
S 64o. Les formes zendes âonharë, âonhairi.
Au moyen, comme troisième personne du pluriel du verbe substantif, nous trouvons fréquemment $*&**&> âonharë, avec lequel on peut comparer, en ce qui concerne la désinence, la forme $*b*)jl* irîritarë «ils sont morts»437. Si l’orthographe de ces deux mots est correcte, nous avons une désinence zende are en regard de la désinence sanscrite ire : la voyelle de liaison 438 qui, en sanscrit, s’est affaiblie en i, serait donc restée en zend sous sa forme primitive a. lïê final de la flexion sanscrite a été supprimé en zend ; mais comme un r n’aurait pu se maintenir à la fin du mot (S 44), on l’a fait suivre d’un ë inorganique, comme au vocatif dâtarë «créateur» = sanscrit
datar. Si, dans les formes âonharë, irîritarë, Yë était mis par erreur pour ê, il faudrait, en vertu de la loi de l’épenthèse, qu’un i vînt se placer à côté de Y a de la syllabe précédente (§ Ai ). C’est là pour moi une présomption que la forme en ë est correcte.
1 Deux des manuscrits de Paris donnent, comme le fait observer Burnouf, la forme moyenne âonhënté : si c’est la vraie leçon, elle est en faveur de la
racine as «être assis», qui, comme ^{o)-pat, en grec, n’est employée en sanscrit qu’au moyen.
* Comparez $ 660.
* Voyez S fi/i 1 et suiv.
‘ Voyez S 61A et suiv.
Je ne veux pas dire pour cela que le zend ait eu seulement la forme âonharë : nous trouvons, en un autre endroit du Vendidad-Sâdé1, âonhairi, où Yi, comme il fallait s’y attendre
(§ Ai), s’est répercuté dans la syllabe précédente. La forme âonhairi, à côté de laquelle on trouvera peut-être aussi la leçon âonhairê, prouve également que la voyelle de liaison, en zend, est restée un a, au lieu de se changer en i, comme en sanscrit.
Remarque. — Signification des formes précédentes. — Dans ce qui précède, je n’ai rien changé à ce que j’avais dit dans la première édition (S 6èi). Ma conjecture, en ce qui concerne âonhairê, a été confirmée depuis par Burnouf, qui a trouvé cette leçon dans l’un des manuscrits du Yaçna. et qui l’a admise dans son texte \ Nériosengh traduit également cette forme, quoique évidemment elle soit un prétérit redoublé moyen, par nisîdanti
(rsedent». Burnouf traduit yâo.....âonhairê par » qui sont restées». Si
l’on compare tous les passages où se trouve le mot en questionon arrivera à la conviction qu’il ne peut signifier autre chose que trils furent», comme le prouve aussi l’expression kënti «ils sont», à laquelle ordinairement il est opposé. Je mentionnerai seulement ce passage du Yaçna4 : yâo si âonharë yâoscâ hëntî yâoscâ rnasdâ bavaintî ffquæ enim fuerunt, quaeque sunt, quæ-que, ô Masda! erunt» \ Il est évident que dans ce passage, où le passé est si nettement opposé au présent et au futur, le sanscrit ne mettrait pas d’autre verbe que as ou M, quoiqu’il puisse aussi, comme le zend, employer quelquefois les verbes as b être assis» et stâ a être debout» dans le sens du verbe substantif.
S’il est prouvé que le moyen âonharë ou âonhairê appartient à la racine X» as ou ah «être», il devient d’autant plus probable que l’actif âonkënîi doit être rapporté à la même racine. On conçoit que l’emploi fréquent de la forme moyenne ait fait presque sortir de l’usage la forme active : c’est 439 436 437 438 440
ainsi qu'en grec te moyen êcropai a complètement supplanté l'actif êtreo. au lieu quen sanscrit c’est l’actif de la racine as qui est seul usité hors* de composition.
8 641. Les formes zendes irîritarë, irînirë
Nous avons mentionné plus haut (§ 64o) le prétérit iriritarë. Cette forme est remarquable par son redoublement. La racine est b*)* irii, d’où dérive un verbe de la quatrième classe fréquemment employé. Dans irîrii, la première syllabe ir est donc un redoublement; IV qui vient ensuite a été allongé * comme pour lui donner la force de porter la syllabe réduplica-t-ive *.
Cette formation rappelle celle des parfaits attiques comme ihpatOa, ê[xtffx£Ka, hpépvya, car je ne crois pas qu’il faille expliquer IVj ou Yùj comme provenant de l’augment temporel. S’il est bien vrai quun c ou un o, en se mêlant avec le de l’augmenta devient y ou il ne s’ensuit pas que dans tous les verbes où une voyelle initiale est allongée, il faille apercevoir l’augment. Dans les formes comme êhfXvOa, le passé est déjà exprimé par le redoublement : quant à l’allongement de la voyelle suivante, je crois qu’il est du au sentiment du rhylhme ou au besoin de donner un appui à la syllabe réduplicative. Le même fait a lieu dans le zend trîrii ou, pour ne pas sortir de la langue grecque, dans les substantifs comme dyojyôs, dy&yevs, âyarytf 2, dans lesquels on ne sera pas tenté de voir un augment. En général, si l’on songe que l’augment est un élément étranger à la racine, il paraîtra peu naturel de l’aller chercher au milieu du mot, entre la racine et la syllabe réduplicative : c’est seulement au défaut de toute autre explication qu’on doit supposer une telle anomalie.
I Uiî fait analogue a lieu en gothique; voyez S 589.
II On a vu (S /j ) que Tw est en grec l’un des représentants de Ta long.
Pour revenir au zend irîriiarë, ajoutons qu’on trouve aussi irtritrë1, avec adjonction immédiate de la désinence à la racine. On peut comparer les formes védiques comme dadrsre 2.
S 64a. Signification des formes précédentes.
D’accord avec Burnouf3, je rapporte le verbe zend irit à la racine sanscrite fx^ris «blesser, tuer». Cette racine a donné au zend deux verbes différents, l’un avec l’ancienne sifflante, l’autre avec uni4; tous deux ont pris un {prosthétique5, qui réfléchit en quelque sorte la voyelle radicale. Nous avons vu (S 882) qu’en arménien tous les mots commençant par un r ont pris de
même une voyelle prosthétique.
Le causatif du verbe zend en question s’abstient à la fois de la prosthèse et du changement de la sifflante primitive en ^ i; on a, par exemple, à l’imparfait du subjonctif (§_ 71&), ratsayad6 «quil tuât, qud fît mourir».
En ce qui concerne le changement d’acception de cette racine, qui signifie «blesser, tuer» en sanscrit, et «mourir» en zend, rappelons la racine grecque &av « mourir », qui correspond à la racine sanscrite han1 «frapper, tuer».
S 643. Emploi du prétérit redoublé, en zend.
Il nous reste à parler de la signification que le zend attache
1 C’est même la leçon la plus fréquente. Le manuscrit lithographié donne une fois irîiihrê*
î Voyez Grammaire sanscrite abrégée, $ 891.
3 Yaçna, alphabet, page 5a. J’avais émis dans la première édition une autre conjecture à laquelle je renonce aujourd'hui.
' Comparez 8 637, remarque.
5 Iriiyêiti et irtàyêili «il meurt'1.
6 Vendidad-Sâdé, chapitre xm. Le manuscrit lithographié aun^* au lieu dun
7 Pour d’an (S a3).
à son prétérit redoublé : je (rois avoir observé que c’est surtout quand il a pour sujet un pronom relatif quil est resté fidèle à son acception primitive, qui est de marquer l’achèvement de l’action1. Peut-être même ne trouvera-t-on pas un seul exemple où le zend, ayant à construire avec le pronom relatif un verbe indiquant une action accomplie, emploie un autre temps que le parfait. C’est le pronom relatif qui sert de sujet dans la phrase déjà citée : yo nâ dada yô tatasa yâ tutruyê « qui nous a créés, qui [nous] a formés, qui [nous] a conservés»2. De même pour âonharë «iis ont été», qui se trouve six fois dans le Vendidad-Sâdé, et chaque fois avec le relatif pour sujet. De même encore pour irîritarë ou irtriirë « ils sont morts », qui est employé trois fois 3.
La conjonction yêsi «si» me paraît également se faire suivre toujours du parfait, quand il s’agit d’exprimer l’accomplissement de l’action. Nous avons, par exemple : yêsi iwâ didmisa «si je t’ai offensé » 4. On peut rapprocher de ce fait cette autre observation qu’en sanscrit, après la conjonction yadi «si», le verbe conserve son accent5.
L’accusatif du pronom relatif donne lieu à la même remarque, dans cette phrase : yim asërn... sraisiëm dâdarësa «quem ego.., optimum agnovi » 6.
Mais quand le verbe n’est précédé ni d’un relatif, ni de la conjonction yêsi, l’accomplissement de faction est ordinairement marqué par le temps qui répond à l’imparfait grec. C’est ainsi que nous avons, au commencement du Vendidad : asëm dadahm «j’ai créé»; au neuvième chapitre du Yaçna : hunûta ou,
1 On a vu plus haut (S 588) que le dialecte védique présente un fait analogue.
3 Vendidad-Sâdé, p. 3.
3 Voir l’Index du Vendidad-Sâdé, dans l'édition de Brockhaus.
4 Vendidad-Sâdéy p. ta.
5 Système comparatif d’accentuation, p. 261.
6 Yaçna, chapitre ix.
avec la caractéristique de la première classe, hunvata «il a exprimé»; hê tûm uéasayanha «à lui tu es né».
PLUS—QUE—PARFAIT.
S 6 à 6, Le plus-que-parfait latin.
Nous avons déjà dit (§ 5i4) que le sanscrit n’a pas de plus-que-parfait, et nous avons indiqué comment il le remplace. Il est permis de supposer que le zend en était également privé; mais on ne peut rien dire de certain à ce sujet, car le Zend-Avesta ne renferme aucun passage donnant lieu à remploi du temps en question.
En latin, le plus-que-parfait est formé par la combinaison de l’imparfait du verbe substantif avec le thème du parfait. On peut se demander si fueram, amaveram renferment la forme complète, eram, ou si l*c de eram est tombé. Dans la première hypothèse, il faudrait diviser ainsi : fu-eram, amav-eram; dans la seconde : fue-ram, amave-ram. Contrairement à l’opinion que j’ai exprimée autrefoisA, j’adopte aujourd’hui la seconde explication, et je regarde fueram comme étant pour fui-ram. On a déjà plusieurs fois fait observer qu’en latin IV se change volontiers en e devant un r ; nous voyons, par exemple, que dans la troisième conjugaison latine, la caractéristique % devient e dans leg-e-ris, leg-e-rem et leg-e-re. Or, la même opposition qu’on remarque entre leg-e-ris et leg-i-tur, hg-i-mur, se retrouve dans fue-ram opposé à fui-ssem. Il serait beaucoup plus difficile d’expliquer comment fu-essem aurait pu devenir fur~issem. En général, le latin nous présente beaucoup de cas ou IV, même sans être suivi d’un r, est devenu ë; mais je n’en connais pas un seul où ¥ë se soit changé en t.
! Système de conjugaison de ïa langue sanscrite, p. 100.
[/£ est un son inorganique d’origine relativement récente; au contraire, 1V est aussi ancien que la langue elle-même, car, quoique je ne veuille pas nier que Yi et Yu ne soient souvent iaffaiblissement d’un a, je ne saurais cependant me figurer une période de la langue où Ya aurait été la seule voyelle.
En divisant de cette façon : fue~ram, fui-ssem, nous admettons que le verbe auxiliaire annexe a perdu sa voyelle initiale. La même chose est arrivée pour les aoristes sanscrits en sam et les aoristes grecs en cfcl. Il n’est pas étonnant que le verbe substantif, en entrant en composition avec des verbes attributifs, perde une partie de sa racine.
S 645. Le plus-que-parfait grec.
En grec, le plus-que-parfait se forme sur le thème du parfait, comme l’imparfait sur celui du présent. De même qu’à l’imparfait, l’augment vient se placer devant le verbe; il transporte dans le passé l’action achevée qu’exprime le thème. On devrait s’attendre à trouver les désinences de l’imparfait : ainsi rhv(pa devrait faire èré^vCpov, ce qui nous donnerait une forme analogue à l’imparfait de l’intensif (dtêtopam), en sanscrit. D’où peut provenir la désinence dans èrerv^etpl Landvoigt et Pott441 y voient l’imparfait du verbe substantif, en sorte que érervtpsiv serait pour ère*v<pttv. Mais il y aurait deux augments dans cette forme, puisque le grec tfv répond au sanscrit âsam : il semble que si le verbe substantif entre dans la composition de êrsTv(psiv, il doit y entrer simplement comme copule , c’est-à-dire sans aug-ment, ainsi que cela a lieu dans les aoristes sanscrits comme aksâip-sam. Conséquemment, si êreruipeiv contient en effet ie verbe substantif, je crois qu’il faut chercher une autre explication pour et. Remarquons d’abord l’analogie de etv avec eîpu' ; si
ce dernier remplaçait ses désinences primaires par les désinences secondaires, il ne pourrait faire autre chose que eh. On peut donc dire que Ÿt de sw représente le <7 de la racine es, absolument comme ei-pi est pour Le pluriel etêtvtysifiev sera de
même pour sTSTv^scrfxev 442 443 et le duel érervipstrov pour irervipealov.
A la troisième personne du pluriel èTeTv(pe<rav 444, la composition avec le verbe auxiliaire est évidente; mais on ne saurait conclure de cette forme que les autres personnes soient également composées, car à l’imparfait et à l’aoriste le verbe auxiliaire est renfermé dans êSt'So-ara-v, ëiïo-o-a-v, quoique nous ayons partout ailleurs des formes simples comme êSiSo-fiev, #<5o-(iev : il en est de même en latin, où nous avons fuerunt (pour fuesunt), à côté de fui.
Si nous admettons que la syllabe et de èreTv(p-eiv est identique avec le et de ei-pt, nous arrivons à cette conclusion que dans les plus-que-parfaits comme êXeXvxstv, èrerxjtpeip, le verbe substantif est contenu deux fois. Nous avons vu, en effet, que le x de XéXvxa et l’aspiration de rérvÇa doivent être considérés, l’un comme le renforcement, l’autre comme l’affaiblissement du <r de la racine es (§§ 568 et 569). Mais ce n’est pas là une raison pour écarter l’opinion qui vient d’être exposée : dans les aoristes sanscrits comme âyfaisant (§ 670), le verbe substantif est, de même, contenu deux fois. Je crois d’ailleurs qu’à l’époque où êXeXvxeiv, érerityetv sont, comme je le suppose, sortis de èxéw-(pov, êXéXvxov , l’origine du x et de l’aspiration était depuis longtemps oubliée; on a rétabli le verbe substantif dont on ne reconnaissait plus la présence dans ces formes, à peu près comme en anglo-saxon le simple sind s ils sont 5? est devenu sindun 1, à une époque où l’on avait cessé de sentir que sind renfermait déjà le signe de la troisième personne du pluriel445 446.
Au médio-passif grec, le verbe substantif n a pas trouvé accès; èlski-xet-v ferait attendre une forme ê'ks'kv-xei-p'fjv ; mais nous avons eXsAu-fw*', qui est sorti immédiatement de la racine redoublée et précédée de l’augment. Cette formation nous reporte à une époque où l’actif n était pas encore e’XeXuxezr, mais probablement êXshjv.
Remarque. — Examen d'une opinion de Pott et de Curtius. — Les plus-que-parfaits ioniens comme sTvsTtoiÛea. — Le plus-que-parfait en slave et en arménien. — L'hypothèse émise par Landvoigt, Pott et, plus tard, par Curtius447, que le plus-que-parfait grec renferme l’imparfait du verbe substantif, s’appuie principalement sur la comparaison des plus-que-parfaits ioniens en -ea avec l’imparfait ionien êa «j’étais». Mais ce rapprochement ne serait décisif que si, en regard de l’ionien -ea, la langue ordinaire, au lieu de -ero, avait -r)v comme désinence du plus-que-parfait. Cette terminaison —Y}v = ïjv «j’étais » (en sanscrit iistxïti} en latin ctaîk) serait certainement plus organique que l’ionien -ea, car la langue grecque laisse ordinairement sa nasale finale à la première personne de 1 imparfait.
Je regarde la forme simple éa comme étant pour ija. L absence du v, jointe à la seconde personne ijtfdoL, ina porté (S 453) a rapprocher ces formes du parfait sanscrit osa «je fus», âs-i-la «tu fus», et non de 1 imparfait asam «j’étais». Il ne serait pas étonnant qu’un ancien parfait du verbe ès eût pris dans l’un des dialectes grecs l’emploi de l’imparfait448. Ce qui serait plus étonnant, c’est qu’un tel parfait eût servi à former le plus-que-parfait des verbes attributifs : nous aurions alors deux redoublements et un augment dans une seule forme verbale.
Il est vrai qu’Homère ne connaît que les plus-que-parfaits ioniens en sa, et non les plus-que-parfaits en etv : mais le dialecte homérique ne nous présente pas toujours les flexions les plus régulières, ni les plus anciennes; il a, par exemple, à la première personne du pluriel, la terminaison pev, au lieu que le dorien a encore la forme ties = latin mus et sanscrit mas; de même, à la troisième personne du singulier et du pluriel, nous avons dans Homère at (ovgi), au lieu que le dorien a Tt, vrt.
Curlius1 divise- de celte façon : iivenoide-a, et regarde i’e comme une altération pour l’a final du thème ènsnoida. Mais alors il ne reste plus absolument rien de la racine du verbe substantif; en effet, qu’on fasse de éa un imparfait ou un parfait, son a n’est jamais qu’une voyelle euphonique destinée à porter les désinences personnelless.
En dorien, il ne reste malheureusement aucun exemple de la première personne du singulier du plus-que-parfait. À la troisième personne, dont il nous est parvenu d’assez nombreux exemples \ nous trouvons aussi bien et que 7} : je regarde v comme une contraction pour et. C’est l’habitude du dialecte dorien de remplacer par y la dïphthongue si de la langue ordinaire, au lieu que nous ne voyons jamais en dorien un y primitif (c’est-à-dire représentant un ancien â) remplacé par si4.
Au sujet du plus-que-parfait latiu, je dois encore ajouter une observation. De ce que fueram, amaveram renferment fui et amavi, je ne crois pas qu’il faille conclure avec Curtius que fui, amavi soient, quant à leur origine, de véritables parfaits. Comment, demande Curtius, un aoriste aurait-il pu devenir un plus-que-parfait, par l’adjonction de l’imparfait du verbe substantif? Mais fui et amavi, tout en étant, par leur formation, d’anciens aoristes, ont à la fois, en latin, le sens du parfait et celui de l’aoriste ; et c’est avec la signification du parfait qu’ils sont entrés en composition avec eram.
1 Ouvrage cité, p. a3a etsuiv.
2 Si l’on voit dans ëa un imparfait, l’a répond à l’a du latin er-a-m, er-n-s, cr-a-f et à l’a du zend anh-a-d et il était» (S 53a) ; si l’on fait de éa un parfait, son a est identique avec celui de rérop-a, réro<p-a-s, et avec l’a du sanscrit <&-a «je fus, il fut», ds-d-lm «ils furent tous deux» (S 6i5).
3 Ahrens, De dialecto dorica, p. 33e.
4 Par exemple à l’imparfait du verbe substantif, nous avons toujours y et non et, en regard de l’d du sanscrit ffsam, Ahrens, De dialecto dorica, p. 3a5.
En ancien slave, le plus-que-parfait comme le parfait sont représentés par une forme périphrastique. C’est le participe passé en lu, la, lo qui se joint, soit au présent, soit à l’imparfait du verbe substantif. On a, par conséquent. bülü, büla, bülo jesmï «je fus*, bülü, büla, büh bêchü kj’avais
été». • ...
L’arménien a également recours à une forme périphrastique. 11 fait :
sireai cm fffai aimé», sir ml1 êaq (rnous avons aimés; sireal ei «j avais
;»imé», sireal êaq «nous avions aimén.
FUTUR.
S 646. Le futur à participe, en sanscrit.
Le sanscrit dispose de deux temps pour marquer l’avenir. Lun (c’est le moins employé) consiste dans la combinaison d’un participe futur avec le présent du verbe as «être ». Quel que soit le genre du sujet, le participe reste toujours au masculin. A la troisième personne, il prend tout a fait la valeur dune forme verbale, car il se passe du secours du verbe substantif. Ainsi dâtâ «daturus» est employé dans le sens de «dabit», et «daturi» dans celui de «dabunt». Gest le lieu de rappeler le latin atnaîtiiui, qui équivaut a artiamira estis, cwia-minœ estis, antamina estis (S A78); rappelons aussi ce qui a été dit de la troisième personne du prétérit en polonais et en persan (S 628). Aux autres personnes, c’est le nominatif masculin singulier qui se combine avec le verbe auxiliaire. On a, par exemple, dâtâsi (pour êâtâ a&i) = «daturus, datura, daturum es»; dâtasta (pour dâta sia) = «daturi, daturæ, datura estis».
Je fais suivre la conjugaison de ce futur, à l’actif et au moyen. A la troisième personne, le moyen est semblable à 1 actif, les participes en târ ne faisant pas la distinction des voix (§ 810).
i
Le participe, dans cette construction, ne prend pas le signe casuel.
SINGULIER DUEL. PLURIEL.
|
Actif. |
Moyen. |
Actif. |
Moyen. |
Actif. |
Moyen. |
|
dâtasmi |
dâtahê m |
dâtasvas |
1 A datasvane • |
.dâtdsmas |
dâtâsmahê |
|
dâtasi |
dâtasê |
dâtasîas |
dâtasâiê |
dâtasia |
dâtadvê |
|
data |
data |
J A,«r A datamu |
7 AÆAf A datarau |
dâtaras |
dâtaras. |
Remarque. — De la forme moyenne hê {dâtahê), au lieu de sê. — II est bien clair, et les adversaires les plus décidés du système dit à'agglutination n ont pu nier, que le futur sanscrit dâtasnd se compose de la réunion de deux mots : néanmoins, aucun de mes devanciers n avait attiré l’attention sur ce fait, que j’ai été le premier à signalerl.
A la première personne du moyen, il faut remarquer que la racine as change son s en h ; c’est là un changement qui n’a lieu nulle part ailleurs en sanscrit; mais il est très fréquent en prâcrit, où sm, su deviennent régulièrement mk, nh (par métathèse pour îim, lin). On a, par exemple, amht ou mhi (cette dernière forme après un mot finissant par une voyelle) — sanscrit dsmt trje suis* *. Gomme le h sanscrit (qui est pour un ancien g) est ordinairement représenté en grec par un quelquefois aussi par un y et même par un x3, on peut citer dâtahê à l’appui de l’opinion exprimée plus haut (S 56q), d’après laquelle le x de éhcoxa, SéScoxat serait un épaississement du <r du verbe substantif.
S 647. Emploi du futur à participe. — Le suffixe participial târ ; formes congénères en latin, en zend et en slave.
Même à la troisième personne du singulier, on trouve quelquefois le verbe substantif uni au participe; exemple : vakt&ii «il parlera», au lieu de vaktâh. D’un autre côté, on trouve aussi le verbe substantif sous-entendu à la première et à la deuxième
1 Système de conjugaison de ia langue sanscrite, p. 26.
2 Voyez Lassen, Institutiones linguæ prâcritieœ, p. 267 etsuiv. etHôfer, Dsprâ-krita dialcctOj p. 77.
3 Comparez êyé avec aham, péyas avec mahdt, xfjp, xctpdia avec hrd, hrdaya-m.
4 Voyez ma collection d'épisodes du Mahâbhârata, publiée sous le titre Diluvium. Dntupadi, ÏII, vers 2.
personne, qui sont alors exprimées uniquement par le participe et un pronom1, comme cela a lieu en russe pour le prétérit (§629). Quelquefois le participe est séparé du verbe auxiliaire par un ou plusieurs mots; exemple : kartâ tad asmi tê s facturas hoc sum tibi». Néanmoins je ne pense pas quune séparation de ce genre pût avoir lieu là où le sujet ne serait pas un singulier masculin : je suppose que si le sujet était du féminin, il faudrait alors kartrî. Hormis ces constructions, les formations en târ (tr, § t44) sont très-rarement employées comme participes futurs2 : ordinairement, ce sont des noms d’agent correspondant aux mots grecs et latins en tj?p, rop (nominatif wp), târ-; ainsi dâtâr (forme faible dâtr, nominatif data, § i44) répond à Sordp- dator, datàr-is.
De la forme feV est sortie en latin une forme élargie en tûrô, qui est seule employée dans le sens du participe futur.
En zend, les formations en târ ne paraissent usitées que pour désigner les noms d’agent; exemple : dâtâr «créateur» (= sanscrit iâtar), nominatif dâta (S i44), accusatif dâtârëm, vocatif dâtarë (§ 44).
En slave, je rapporte ici les formations en telï (thème teljo, § 969), avec permutation de r en l et addition de la syllabejo. Ainsi dêtelï «factor» correspond au zend dâtâr et au sanscrit datàr (§ 634). Ce mot dêtelï n’est jamais employé quen composition avec la préposition n su ou l’adjectif dobro «bon» : sü-detelï «conditor», dobro-dêtelï «benefactor». Voici d autres exemples du suffixe telï : ïiützM>pê~telï «coq» (littéralement «chanteur»), îkatcau éaii-telï «moissonneur», grab-i-telï «voleur»3, etc.
1 Voyez le même recueil, page 1, vers 3i : bavitâ ’ntas tvam (au lieu de bavi-îmy antas tvam) «tu seras la fin?).
* J’en trouve un exemple dans le Ragbou-vança (éd. Stenzler), VI, 5a : myan tain.,. vyatyagâd anyavudur havitvî «regem iÜum... præteriit aiius uxor tulura^.
3 Comparez la racine védique graV«prendrez. — Dobrowskv fait dériver cette classe de mois de l’infinitif en ft\ et suppose un suffixe €AÏ* elï (ïnstilutinnes lingtiæ
Au sujet du suffixe sanscrit târ, tr, remarquons encore qu’il demande le gouna quand la voyelle du thème en est susceptible, et qu’il se fait souvent précéder de la voyelle de liaison i. On peut comparer, à cet égard, le sanscrit gan-i-ta, gan-i-taram avec le latin gen-i-tor, gen-i-tôrem, et d’autre part pak-ta, pak-taram avec coc~tor, coc-tôrem1.
S 648. Le futur à auxiliaire. — Sa composition.
A côté de ce futur, qui est particulier au sanscrit, et que j’ai appelé dans ma grammaire sanscrite le futur à participe2, il y en a un autre qui est commun au sanscrit, au zend, au grec, au lithuanien et au latin, et que j’ai nommé le futur à auxiliaire, parce que j’ai cru y reconnaître la présence du verbe as «être». Tel est profil dâsyâti, que je divise ainsi : dâ-syâ~ti. Le caractère sya n’est pas autre chose, selon moi, que le futur, inusité hors de composition, du verbe as. Conséquemment, dans dâ-syd-li, l’idée de l3 avenir est uniquement exprimée par y a, puisque le s est la consonne radical? de as ; on ne sera pas étonné de la disparition de l’a initial, qui manque souvent même hors de composition (S 48 o).
Il y a une affinité évidente entre la seconde partie du futur dâ-syami et le potentiel syâm « que je sois ». On peut comparer :
SINGULIER. DUEL. PLURIEL.
|
Futur. |
Potentiel. |
Futur. |
Potentiel. |
Futur. |
Potentiel. |
|
syâmi |
syâm |
syâvas |
syava |
syâmas |
sytima |
|
syasi |
syâs |
syatas |
sy a tant |
syaîa |
sydta |
|
syati |
syâl |
syaîas |
syatâm |
syanti |
syus. |
slavicœ, page 292). C’est ainsi qu’en latin on fait communément dériver les noms en tor des supins en tum.
1 L’auteur reviendra sur le suffixe târ au S 810 et suiv. — Tr.
* H sera question plus loin (S666) d'urt futur périphrastique en zend, qui est formé d’après le même principe que ce futur sanscrit.
§ 64g. En quoi ia flexion du futur syâmi diffère de celle du potentiel syâm.
Comme on le voit par le tableau précédent, la différence principale entre le futur et le potentiel, c’est que celui-ci a partout un â long, et le futur un a bref449. Le futur a, en outre, les désinences primaires, c’est-à-dire les désinences pleines, au lieu que le potentiel a les désinences secondaires ou émoussées. À la troisième personne du pluriel, le potentiel a la terminaison us, qui quelquefois se trouve aussi à l’imparfait.
S 65o. Comparaison du futur sanscrit syâmi et du futur latin ero.
Tandis que le sanscrit n’a conservé le futur du verbe as «être » quen composition avec les verbes attributifs, le latin a gardé ero, eris, mit, à l’état indépendant. Le r dans eris, erit, tient la place d’un s (esis, esit, § 22). Ue initial représente l’a de la racine as, lequel est tombé dans les formes sanscrites correspondantes : il y a donc le même rapport entre mis, erit et syasi, syati, qu’entre es-tis et s-ta, entre êcr-fiés et s-mas, ècr-iov et s-sas, s-tas (S k80).
S 651. D’où vient îï du latin eris, erit.
Déjà dans mon Système de conjugaison de la langue sanscrite2, j’ai expliqué IV de eris, erit comme la contraction de ya, qui est le caractère du futur. J’ai été depuis confirmé dans cette opinion par le prâcrit, où l’on trouve quelquefois hi au lieu du sanscrit sya ou syâ, notamment à la première personne du singulier hirni pour syâmi et à la deuxième hisi pour syasi. Rappelons à ce sujet que le sanscrit lui-même contracte quelquefois
la syllabe ya en i, comme il contracte va en u et ra en r1 et qu au potentiel moyen la syllabe yâ se resserre en î450 451.
S 65a. Le futur lithuanien.
En lithuanien, la caractéristique ya, aux personnes les mieux conservées du futur, s’est également contractée en i; nous avons, par exemple, diï-si~me «nous donnerons», diï-si-te « vous donnerez »= sanscrit dâ-$yâ-ma$, dâ-syâr-ta; dü-si-wa et nous donnerons tous deux», dü-si-ta «vous donnerez tous deux» = sanscrit dâ-sya-vas, dâ-sya-tas. En lithuanien comme en sanscrit, le futur du verbe as n’est pas usité hors de composition.
Le verbe substantif combine au futur les deux racines Su et as y et fait, par exemple, bu-si-wa, bu-si-ta, bu-si-ino, bu-si-te. Nous avons, de même, en sanscrit, Bav-i-sya-vas, Bav-i-syd-ias, Bav-i-syâ-nms, Bav-i-syd-ia452. Une combinaison du même genre a lieu, en latin, au parlait fue-runt et au futur passé fue-ro453.
§ 653. Deuxième et troisième personnes du futur lithuanien. —
La forme bhus, en irlandais.
A la deuxième et à la troisième personne du singulier, le lithuanien a perdu IV, caractère du futur, et n’a gardé que le s du verbe auxiliaire. Je crois du moins que dans les formes comme dü-si « tu donneras » IV final appartient à la désinence personnelle et non à l’expression du futur454. A la troisième personne, dus sert pour les trois nombres (§ 45 7); le verbe substantif fait bus.
11 y a une ressemblance remarquable entre cette dernière forme et l’irlandais bhus «il sera» qui, dans cette langue, est une forme unique en son genre. Le sanscrit fiav-isyati et le zend bû-syêki servent d’intermédiaire entre le lithuanien bus et l’irlandais bhus.
S 654. Première personne du futur lithuanien. —
La première personne ero, en latin.
A la première personne du singulier, je regarde Vu final du lithuanien dw-siu1 «je donnerai » comme la vocalisation du caractère personnel m.
Au contraire, en latin, Yo de ero représente Yâ du caractère sanscrit yâ ; ero (au lieu duquel on aurait pu s’attendre à avoir erio) est à syâmi «je serai» ce que veho est a vdhâmL De même, à la troisième personne, erunt (pour eriunt) est à syanti «ils seront» ce que vehunt est à vâhanti.
S 655. Le futur moyen êetropai, éao*iat, en grec.
Avec le latin ero, erunt (pour eso, esunt) s’accorde, si l’on fait abstraction des désinences moyennes, le grec eo-opou, ëcrovTcu, dont l’actif n’est plus usité qu’en composition. Evovtou, pour êatovTai, répond au sanscrit -syantê (pom* -asyantê}, et le singulier icrsrau répond à syatê (pour -asyatê}. Nous avons conservé dans le dialecte épique la forme ëao-opou455 456, où le deuxième cr représente encore le y sanscrit; ëacroptau est à ëajofiat ce que {£&■-vos est à fxéojos (pour fxéSjos ~ sanscrit mddyas, latin médius} et ce que aXkos est à akjo$ (= latin alius, sanscrit anyas457}. Dans le
dialecte dorien, nous trouvons la forme êaaovpat (venant de êa-créopou, pour êaaiofiat), où le caractère du futur est contenu deux fois (S 656) : cette forme appartient à une époque où Ton avait cessé de sentir que le redoublement du a était déjà par lui-même l’expression du futur1.
La forme salai n’est pas autre chose, quant à son origine, que le moyen de écrit. Sans le témoignage des langues congénères et sans la comparaison de sacrerai, on pourrait prendre également ia-e-rat pour un présent ayant la caractéristique de la première classe sanscrite (comparez Ç>ép-s-Tai = Mr-a-tê).
Le prâcrit, comme le grec, assimile le y de sya à la lettre s qui précède : d’après une règle générale en prâcrit, la plus faible des deux consonnes consécutives s’assimile à la plus forte, que celle-ci soit la première ou la seconde. Nous avons donc, au lieu de syâmi, syasi, syati, les désinences ssah458 459, ssasi, ssadi; exemple : karissadi «il fera», en regard du sanscrit karisydti.
S 656. Le futur premier et le futur second, en grec.
Dans les formes $cà~aco, Scj-aopcss, Seix-aco, Seix~aop.es, le verbe auxiliaire se dépouille de sa voyelle initiale, comme en sanscrit dans dâ-sydmi, dâ-syâmas, dêk-syamt460 461, dêk-êyâmas. Le y, qui, en grec, aurait du donner un <, s’est perdu également. Nous le retrouvons toutefois dans quelques formes doriennes, savoir : 'sspatyopev, ^apt^tôpsOa, auvSia(pv\a£i6pe6a, fioaOyaiw-, 4. Il s’est de même conservé dans le futur dorien ordinaire en ow, arovpev, pour &é(*>, aéopiev, qui lui-même est pour <r/(», (rlofJLsv. L’< s’est d’abord altéré en e, puis contracté avec la voyelle suivante; dans la déclinaison des thèmes en nous
•J
voyons de même -srtikt-es devenir 'tfêXe-es et par contraction xs6-et xrSh-as devenir xs6\s-cl^ et par contraction xsSXets. Un fait analogue a lieu dans les langues germaniques : au génitif gothique balgi-s1 correspond en vieux haut-allemand la forme balge-s (oupalke-s); au génitif-datif vieux haut-allemand krefti2 correspond, en moyen haut-allemand, la forme krefte; au génitif pluriel vieux haut-allemand kreftio (qui, plus anciennement, a dû être kreftjo) viennent se joindre, dans le même dialecte, mais d’après d’autres manuscrits, les formes krefteo et krefto (ou chrefto). C’est exactement ce qui s’est passé en grec, où ff/opep, est devenu d’abord aéw, créopev, puis cr<w, (rovfxev, et enfin (comme dans Setx-o-o), Setx-<joixsv} «r<y, aofiev.
Au contraire, le futur second a perdu la sifflante et gardé la semi-voyelle du sanscrit sya : nous avons, par exemple, crlekcû qui est pour <r7e>iâ>, venant de aleXta qui lui-même est pour (jisXaria) (comparez les formes précitées (3oa9ri-cri&, '&poXsi7r-<Ttcü). En ce qui concerne l’expulsion du <7, on peut rapprocher ce qui se passe à l’aoriste premier des racines terminées par une liquide; exemple : écrleiXa, pour ialekara.
S 667. Forme primitive du futur. — Le futur dans les langues
slaves modernes.
Il n’est pas vraisemblable que le caractère du futur ya ait été, à l’origine, exclusivement employé pour le verbe substantif as.
accentuer de cette façon : fioa&yoiw, , et non ]3©aÔiî«ws3, 'mpoAei-^iw. En
effet, les formes en â sont la contraction des formes en sa?, qui elles-mêmes sont pour <». Si l’on écrit ic5, T* sera donc représenté deux fois.
1 Thème balgi «bourse, outre» (masculin).
1 En allemand moderne, kraft (féminin) «force-'.
Je crois plutôt qu’à une époque très-reculée et antérieure à la séparation des idiomes, les verbes attributifs formaient également leur futur par l’adjonction immédiate de la syllabe y a : il a dû y avoir des formes comme dâ-yati « il donnera » avant quon eût des formes comme dâ-syâti ou concurremment
avec celles-ci. Mais les langues indo-européennes, telles qu’elles nous sont parvenues, pour former le futur de leurs verbes attributifs, ont toujours besoin du concours du verbe substantif.
C’est aussi au futur de leur verbe substantif qu’ont recouru les langues slaves vivantes; mais, à l’exception du serbe, elles emploient l’auxiliaire comme mot indépendant. En slovène et en polonais, c’est le même participe en l, la, lo que nous avons déjà vu comme expression du passé (§ 628 et suiv.), qui vient se placer à côté du futur du verbe auxiliaire. Le slovène fait par exemple, suivant les différents genres, boni1 igràl, bom igrdla, bôm igràh «je jouerai» (littéralement «je serai ayant joué»)2. Le polonais fait bede czytal, czytala, czytaio «je lirai» (littéralement «je serai ayant lu»). En russe et en bohémien, c’est l’infinitif qui accompagne le verbe auxiliaire. Le russe fait 6yay 4BHramb budu dvigatj «je remuerai» (littéralement «je serai remuer»). Le bohémien : budu krasti (pour kradti) «je volerai» (littéralement «je serai voler»). Seul parmi tous les dialectes slaves, le serbe n’a pas besoin, pour son futur, du secours du verbe substantif : il peut unir le verbe signifiant
1 La forme complète est bôdem «je serai» (littéralement «être je fais», S 633). En prâcrit, nous rencontrons une contraction analogue du même verbe, à savoir hômi «je suis» (pour Vomi, venant lui-même du sanscrit b’dvâmi). Rapprochez aussi le vieux haut-allemand bim «je suis», en allemand moderne 6m.
2 Le borussien joint de même un verbe auxiliaire signifiant «être» à un participe parfait dont le suffixe correspond au suffixe sanscrit vâns (S 786 et suiv.); exemple : laukyti, tyt wirstai tus aupailums «cherchez et vous trouverez» (littéralement «vous serez des ayant trouvé»). Le même participe entre aussi dans une forme périphrastique du parfait : asmat kîantîwuns «j’ai maudit» (littéralement «je suis un ayant maudit»). Voyez mon mémoire Sur la langue des Borussiens, p. 33 et suiv.
«faire» au thème de tous les verbes attributifs de la même façon qu’au verbe «être»; il fait, par exemple, igradju {igra-dju) «je jouerai», comme il fait bidju «je serai».
§ 658. Le futur exprimé en slave par le préfixe po. — Le futur à auxiliaire
en ancien slave.
Plusieurs idiomes slaves peuvent ou doivent, dans certaines circonstances, exprimer le futur en faisant précéder le présent d’une préposition po signifiant «après». C’est ainsi qu’en bohémien «je volerai» se ditpo-kradu aussi bien que budu krasti: au sujet de la nuance de signification qui sépare ces deux futurs, je renvoie le lecteur à Dobrowsky1.
En ancien slave, Schafarik a signalé quelques futurs renfermant, comme en sanscrit, le verbe auxiliaire et correspondant aux fu turs lithuaniens et lettes en siu et en su 462 463. Tous les exemples que nous avons conservés sont à la première personne du singulier : comme le présent de la conjugaison ordinaire, ils ont n au lieu de mï pour signe de la personne. Tels sont ; H3A\huj^ is-mi-su-ii «tabescam» et bêg-a-sjajuh « cursabo » 464.
Dans ce dernier exemple, le caractère sanscrit ^sya s’est maintenu sans changement : quant à Va qui précède, je le regarde comme identique avec l’a de l’infinitif bêg-a-ti «fuir», c’est-à-dire que j’y vois la lettre finale du thème de la deuxième série de temps. Dans la syllabe ju de bêg-a-sja-ju-h je crois reconnaître une sorte de caractéristique de la conjugaison ou de la classe : il y aurait donc le même rapport entre bêg-a-sja-ju-n et le thème bêgasja du futur qu’entre snajuh «je connais» et la racine 3Hd ma (§ 5o3). La syllabe finale nu-n des futurs comme pla-s-nu-n « ardebo », vüs-kop-ü-s-nu~h - calciirabo » (racine kopj, o-bri-s-nu-ji «tondebo» (racine Jri), tük-ü-s-mi-h «tangam» contient, à ce que je crois, la caractéristique de la neuvième classe sanscrite : comparez les verbes comme güb-nu-n, güb-ne-êi (S 497). Remarquons le si ü de tük-ü-s-nu-h et vüs-kop-ü-snu-h : il rappelle Yu du védique tar-u-sê-ma « transgrediamur » ; cette dernière forme, si nous faisons abstraction de la voyelle de liaison u, répond en grec aux aoristes de l’optatif comme Tw-erai-jugr.
S 669. Forme périphrastique du futur, en ancien slave. -— Le futur
dans les langues romanes.
À l’ordinaire, l’ancien slave, pour exprimer le futur, emploie une forme périphrastique1. Il joint le présent du verbe auxiliaire imêti « avoir », na-cahti « commencer » ou choiêti « vouloir» à l’infinitif du verbe principal. Exemples : glagolati imatï «il parlera», littéralement «il a [à] parler»; ne imatïpiti «il ne boira pas » ; priiti imatï sünü « veniet films » ; ne bojati san naeïnesi «non timebis», littéralement «tu ne commences pas à t’effrayer»465 466; ne mosti naeïnesi «non poteris»; ckotahti priiti «ve-nient»467. L’auxiliaire le plus usité est imamï «j’ai»468.
C’est ici le lieu de rapprocher le futur dans les langues romanes. Quoique dans ces langues le futur ait pris tout à fait l’aspect d’une forme simple, il consiste dans la combinaison de l’infinitif avec le présent de l’auxiliaire «avoir». H eût peut-être été difficile ou même impossible de reconnaître cette composition, à cause des contractions que le verbe auxiliaire éprouve au pluriel, sans le témoignage de l’ancien provençal, qui sépare quelquefois par un pronom le verbe auxiliaire de l'infinitif. Nous avons par exemple : dar vos nai «je vous en donnerai»; dir vos ai « je vous dirai»; dir vos em «nous vous dirons»; gitar metz «vous me jetterez». Le verbe «avoir» lui-même forme son futur de cette' manière; ainsi le français tu auras est une contraction pour tu avoir as L
S 660. Restes du futur à auxiliaire, en gothique et en persan.
Le gothique aussi forme quelquefois son futur avec laide de l’auxiliaire «avoir»; exemples : taujan haba ^.'usotricrco», visan habaith «ëalat » ’469 470. Dès l’époque la plus reculée, les langues germaniques ont perdu la flexion primitive du futur, qui s’est au contraire conservée et qui existe encore à l’heure qu’il est en lithuanien et en lette. Remarquons toutefois qu’Ulfilas rend fréquemment le futur grec par le subjonctif présent : or, en sanscrit, le futur -syâmi est presque identique avec le potentiel sÿdm471, et le caractère du futur y a dérive, selon moi, de la même source que le caractère du potentiel y à; il en résulte que le
subjonctif gothique, qui est identique, quant à la forme, avec le potentiel sanscrit et l’optatif grec, peut être regardé comme parent du futur primitif. Nous avons, par exemple, sijau «&ro-fjztt », sijai ^s&lai », sijaina «s&ovtou », thulau «âvé^ofiai », Inlei-tliai « «araXenfm » 472.
En persan moderne, nous pouvons observer le fait inverse : le seul verbe qui ait conservé l’ancien futur l’emploie aussi dans le sens du subjonctif présent; c’est hâseni — sanscrit Savisyami «je serai».
S 661. Formes du futur périphrastique dans les langues germaniques.
Au lieu du futur qui lui manque, le gothique se sert habituellement du présent de l’indicatif. Le même fait a encore lieu fréquemment en vieux haut-allemand; mais on voit déjà s’introduire dans cet idiome le futur périphrastique formé à l’aide des verbes a devoir » et « vouloir» (ce dernier seulement à la première personne). L’auxiliaire werden « devenir » appartient en propre à l’allemand moderne, quoiqu’il soit, en quelque sorte, déjà annoncé par le gothique, qui emploie parfois vairtha dans le sens du futur du verbe substantif. Grimm cite les exemples suivants*1 : vairthith « lofai», vairtha « ëo-oftai », vairthand «Ht ov-tou.» 2. Il est certain que de toutes les expressions du futur c’est la plus naturelle et la plus juste, car le verbe «devenir» indique ce qui sera, au lieu qu’en disant «je veux, je dois», le langage ne fait pas la part des obstacles ni des changements de résolution qui peuvent entraver ou modifier notre action.
Le vieux norrois emploie pour son futur le verbe «je pense», dont le prétérit mm a le sens du présent. Exemples : muni vera «eris», mun slitna «rumpetur», koma munu «venient». Rappelons ici qu’en gothique le verbe faible munan s’emploie quelquefois, sinon pour exprimer un véritable futur, du moins pour rendre la construction grecque avec p&Xa 3; exemple : munais gabairhtjan « (xéXXeis i(ji<pcLvtlsiv »4. Mais il y a lieu de penser qu’Ulfilas ne se doutait pas que son verbe muna et le grec pAXw viennent de la même racine. Je crois pouvoir établir cette parenté : fiéXXùj est, selon moi, avec le sanscrit mânyè* «je pense,
1 Grammaire allemande, IV, p. 177 etsuiv.
3 Matthieu, vin, 12; Luc, 1, 1U ; Deuxième aux Corinthiens, xi, i5, et vi, 16.
3 On trouve aussi haban dans la même acception. Voyez J. Grimm, Grammaire allemande, t. IV, pages 93 et 178.
4 Jean, xir, a2.
a Mânyë est au moyen.
je croisw dans le même rapport que aXXo? avec anyâ-s « l’autre» (§ 19). H est vrai que le grec présente aussi des formes où le n de la racine sanscrite man s’est conservé sans changement, par exemple fiévos = rndnas « esprit » ; mais ceci ne doit pas nous empêcher d’admettre que le v se soit aussi changé en X, par suite de la permutation si fréquente des liquides. C’est le changement de n en X qui fait que (xé\\ù) ne présente plus aucune ressemblance avec les formes où est resté le v.
S 662. Le futur latin en bo.
Déjà dans mon Système de conjugaison de la langue sanscrite, j’ai expliqué les futurs latins amabo, docebo comme des formes composées renfermant la racine ful, et j’ai rapproché bo, bis, bit de l’anglo-saxon beo «je serai », bys « tu seras », bydh « il sera ». Bo, qui est une forme sœur de bam (dans atnabam, docebam)2, se conjugue exactement comme ero : bo est donc pour bio, bunl est pour biunt, et Yi de bis, bit, bimus, bitis est une contraction de la syllabe y a, qui est la caractéristique du futur sanscrit (S 651). Si le verbe sanscrit fiw, au lieu de former son futur à l’aide de la racine as3, s’adjoignait immédiatement la syllabe ya, nous aurions : Bûyâmi, buyasi, Myati, ou, avec le gouna, Sâyâmi, Bôyasi, Bôyati. La forme correspondante en latin serait fujo, fuis, fuit4; mais Yu de la racine fu a été supprimé, et l’on a bo, bis, bit.
La même suppression de l’a de Ju s’observe dans le latin Jio, fis, fa : ce verbe, qui n’est à proprement parler que le passif de
1 Au sujet du b tenant la place d’uuf, voyez S 16.
2 Voyez S 5s6 et suiv.
3 II fait au futur b'av-i-éyftmi, avec gouna de Vû et insertion d’un i euphonique. —Tr,
4 Entre ce fuit et le fuit du parfait, il y a cette différence qu'au futur f* est la contraction de la caractéristique ya, et par conséquent l'exposant de la relation temporelle, au lieu qu'au parfait Pt est simplement une voyelle de liaison. On a vu plus haut (S 566 et suiv.) que nous expliquons le parfait latin comme un ancien aoriste.
fu et qui correspond au passif sanscrit Eu-ye, Bû-yd-sê, Bû-yd-lê. a remplacé les désinences passives par celles de 1 actif. La même chose est arrivée en prâcrit : ce dialecte a bien conservé la caractéristique y a du passif (§ 733), mais il a remplacé les désinences du moyen par celles de l’actif.
S 663. Origine de la forme latine bo. — Comparaison avec 1 irlandais.
Le bo du futur latin peut s’expliquer de deux manières. On peut, comme on vient de le voir, supposer un futur buyâmi ou boy ami qui aurait encore subsisté à l’époque de la séparation des idiomes, soit seul, soit concurremment avec la forme composée Eavisyâmi (comparez le lithuanien bu-siu, le grec (pil’irlandais bhus «erit»); ou bien le latin bo comprendra lui-même Tautre auxiliaire signifiant «être», en sorte que bo sera pour furo, fuso et plus anciennement fusio (en grec Çu-era pour Ç>v-<rfo). Il est difficile de choisir entre ces deux hypothèses. Mais c’est la seconde qui me parait la plus vraisemblable473. Je suis d autant plus porte a voir dans amabo, amabis des contractions pour amaburo, amaburis, que ce sont précisément les formes surchargées par la composition qui ont le plus de penchant à s’alléger et a s’affaiblir* Même hors de composition, le vieux haut-allemand a contracté son singulier bitum (pour bvgoutiij en bim2.
Langlo-saxon beo (ou heom) «je serai» n’est pas, quant à la forme, un futur : c’est un présent qui répond à l’allemand moderne bin, au vieux haut-allemand bim et au sanscrit Bdvâmi; on 1 emploie surtout dans le sens du futur, au lieu que eom (= sanscrit asmi, gothique im) reste consacré à l’expression du présent. On pourrait de meme contester au latin bo, dans amabo, sa qua-téristique a du sanscrit Bdv-a-si, Bdv-a-ti, comme Fi de veh-i-s, veh-i-t est identique avec Va de vdh-a-si, vdh-a-ti (§ 5o8). Remarquez le subjonctif archaïque fuam qui suppose un présent de Findicatiffm, fuis (§ 51 o). Il paraît toutefois plus vraisemblable de supposer que bo, bts est formé comme ero, eris, et
jitc de futur : Fi de bis, bit serait alors identique avec la carac
que par conséquent amabo, monebo contiennent un véritable futur*
Il n est pas douteux que la troisième et la quatrième conjugaison n’aient eu primitivement des futurs en bo (§ 528). Quant aux futurs en am, ce sont d’anciens subjonctifs, comme nous le montrerons plus loin*.
Il a déjà été question (§ 5â6) du futur irlandais, qui joint à tous les verbes attributifs le verbe auxiliaire Bu, Mais il y a cette différence entre le latin et l’irlandais que ce dernier idiome emploie aussi hors de composition le futur du même verbe. 474
syami (= 'keix-crco); yug «joindre» fait yok-syâmi (= Çeux-o-fc1); Bu « être » fait Bav-i-syâmi.
En grec, les seuls verbes qui prennent le gouna au futur sont ceux qui l’ont aussi au présent : on a donc, sans le gouna. Xvcrco, (pv-&&), tv7t-(t(a) en regard du sanscrit lav-i-syâmi (de lil «couper»), Bm-i-syami (de BA «être»), tôp-i-syami (de tup «frapper, tuer»).
Ainsi que le grec, le zend garde la voyelle pure dans des cas où le gouna est obligé en sanscrit; nous avons, par exemple, en regard du sanscrit Bav-i-sydti «il sera», le zend bûsyêih (§ 665), auquel on peut comparer le grec (pv-osi et le lithuanien bür-s.
Nous faisons suivre le futur complet du verbe Bû «être» : nous y joignons le latin fac-so, qui est formé comme <pi-crtw, bu-
|
siu, quoique, |
par le sens, |
ce soit un futur passé 2. | ||
|
SINGULIER. | ||||
|
Sanscrit. |
Zend. |
Lithuanien. |
Latin. |
Grec. |
|
Bav-i-êyami |
bû-syêmi3 |
bu-siu |
fac-so ' |
<pV-G(Û 4 |
|
Bav-i-éyàsi ~ |
bûrêyêki |
bû-si474 |
foc-sis |
<pb-cre'~ |
|
Bav-i-sydti |
bû-syêiti |
bü-s |
fac-sit | |
|
DUEL. | ||||
|
Hæh\jS jtiÀn/ie |
bû-simu | |||
|
vtw"duwv(tu | ||||
|
fitw-i-êyàîas |
bû-êyatô ? |
bûsita |
• « + • • • • a |
<pb-(T£TOV |
|
Bav-i-èyâtas |
hu-syato |
Gomme au sing. |
<pb-<F£TûV | |
1 Voyez S 19.
a Voyez $ 19. Au sujet des formes archaïtjues en a-sso, e-sso, so, voyez § 856. [Au 5 856, l’auteur propose encore une explication pour les formes latines comme fac-so. — Tr.]
* Voyez § 665. Au sujet de IV, voyez 8 As.
4 Pour (pvaloi (8 656).
ft LV est la désinence personnelle.
Sanscrit.
bav-i-syamas
Jjav-i-hjâta
bav-i-syânti
Zend.
bûrêyâmaM
bû-êyata
bûrêyantt
PLURIEL.
Lithuanien.
bu-sime
bu-site
Latin. Grec.
fac-simus (pb-ctoy.es
fac-sitis Çv-tjeve
Comme au sing. fac-sunt1 pb-crovti.
Nous ajouterons aussi le futur du verbe dâ «donner?? en sanscrit, en grec et en lithuanien. Le latin dabo est formé à laide d’un autre auxiliaire; mais IV de dabis a la même origine que IV du lithuanien dü-si et représente le y a du sanscrit da-syasi.
ACTIF.
SINGULIER.
|
Sauscrit. |
Grec. |
Lithuanien. |
Latin. |
|
dârsyami |
àü}-<JCû J |
dü-siu |
da-bo |
|
dâ-syâsi |
Sé-vets |
dü-si |
da-bis |
|
dârsyâti |
ZdMT&t |
dà-S |
da-bit |
|
DUEL. | |||
|
dâ-sydvas |
. dü-siwtt | ||
|
hé-ffSTOV |
dü-sita | ||
|
dâ-syâîas | |||
|
dâ-syàtas |
$<b-CFGTOV |
Comme au siog. | |
|
PLURIEL. | |||
|
dâ-syâmas |
Scé-tTOfxes |
dü-sime |
da-bimus |
|
dâ-syâia |
hcb-aere |
dü-site |
da-biüs |
|
dârSyânti |
bé-<TOVTt |
Comme au sing. |
da-bunt. |
MOYEN.
SINGULIER.
DUEL.
Sanscrit. ' dâ-sye dâ-syâsê dâ-syâtê
Grec. Sanscrit.
hco-ctoycti dâsyavahê
(S&MTsaai) dâ-sye U ScG-trerati dâ-syêtê
Grec.
Zcû-erbyedov
h(b-ctect6ov
hcb-asadov
Ca forme faxint est la seule usitée chez les auteurs
TV
PLURIEL.
Grec.
Sanscrit.
dâ-sydinahê
dâ-syMvê
dâ-syântê
§«-<t ôy.e0a
hcb-Gsade
hcb-Govrat.
S 665. Le futur en zend.
Le futur zend a la même formation que le futur sanscrit. Mais il en reste peu d’exemples, si ce n’est au participe, où nous trouvons entre autres les accusatifs bûsyantëm «futurum», bûsyantîm « futuram », et le composé bûsyamta « futuri estis ». De ces formes, nous pouvons conclure avec certitude qu’à l’indicatif du verbe en question le futur n’avait ni gouna, ni voyelle de liaison L L’absence du gouna vient peut-être de ce que la voyelle radicale, dans bû, est longue. Au contraire, les racines ayant un u bref prennent au futur le gouna, comme on le voit par le participe mu-syam «le devant être utile» L
Nous avons essayé plus haut (§ 664) de restituer le futur zend du verbe bû « être ». On pourrait avoir des doutes au sujet de la première personne bâêyêmi475 476 477, car il n’existe pas d’exemple, en zend, de la désinence mi au futur. Dans le dialecte de la
deuxième partie du Yaçna, on trouve des formes comme fra-vahyâ «je dirai» (= sanscrit pravaksyàmi1 ), et au présentpërësâ kje demande». Dans ces formes, la désinence mi est supprimée. Comparez les futurs comme a§y, en grec, et les futurs passés comme aæo, en vieux latin ; de përësâ rapprochez les présents comme fêpojifero, en grec et en latin, et comme baira (= sanscrit Mrâmi, zend barâmi) en gothique. La première personne du futur est ordinairement remplacée en zend par la première personne de l’impératif (S 728) : c’est la cause de la rareté de nos exemples "
S 666. D’une forme de futur participial, en zend.
La forme bûéyansta mentionnée plus haut (S 665)
mérite un examen spécial, car elle est unique en son genre478 479 480. A la rigueur, elle ne devrait pas être rapportée ici, puisqu’elle nous représente un futur participial; mais ce n’est pas le même participe qu’en sanscrit (S 646), Il y a, toutefois, accord entre les deux langues, en ce que le nominatif singulier masculin sert
«
aussi pour le duel et le pluriel, et probablement pour les trois genres : la traduction littérale de hmyansta, qui signifie «vous serez», devrait être «futurus estis». 11 est difficile de décider si le » s appartient au verbe substantif, comme le veut BurnouP, en sorte que le participe aurait perdu son signe casuel, ou si c’est le verbe substantif qui est privé de son s initial. Je préfère la seconde hypothèse, car nous trouvons, même hors de composition , les formes mahi ou mahî « nous sommes » privées de leur consonne radicale481 482 483 484 485; nous voyons, en outre, que le sanscrit fait, à la première formation de 1 aoriste, uksaip-tfl pour cikêfiip-stu
(§§ 543 et 545).
S 667. Insertion d’un * euphonique au futur zend.
Comme le sanscrit, le zend se sert quelquefois, pour son futur à auxiliaire, de la voyelle de liaison i; mais probablement cette insertion n’a lieu qu’après une consonne. La racine dab, qui correspond à la racine sanscrite damM « tromper », fait au futur daibiêyanti3 «ils affligeront». Dans un
autre passage, nous trouvons le futur moyen du même verbe,
f
daibisyantê.
S 668. Futurs zends changeant le sya sanscrit en hya.
Dans les futurs zends que nous avons examinés jusqu’ici, nous avons toujours vu la sifflante du verbe substantif représen-
iêe, par un jgj s1. Cela vient de ce que la sifflante en question s’y trouve toujours après une des lettres qui exigent en sanscrit le changement de en (§ s ib) : or, le sanscrit est représenté en zend par j^sou gu i (§§ 51 et 5 2).
Mais après les lettres qui laissent en sanscrit le sans modification , nous devons nous attendre à trouver en zend un h (§ 53) : c’est, en effet, un h que nous avons dans sanhyamana, qui est un participe futur passif signifiant a devant naître». Il est vrai qu’Anquetil traduit les mots : •upigliq
narahméa sâtanahmca sanhyamanananmca par aies hommes qui naissent et engendrent» : il faudrait, en adoptant ce sens, regarder sanhyamana comme un participe présent moyen ; mais la vraie signification est « des hommes nés et devant naître », car le ^ h de la forme zende ne s’expliquerait point si sanhyamana n’était pas un futur486 487 488. En sanscrit, la racine gan, si elle s’adjoignait immédiatement le verbe auxiliaire, ferait 5TO7TTO gansyamâna. Mais la racine sanscrite insère un i devant le caractère du futur : on a donc à l’indicatif gan-i-sydtê ail naîtra», qui supposerait en zend une forme san-i-syêi-tê.
S 669. Futurs zends changeant le sya sanscrit en qya.
Les racines zendes dâ «donner» et dâ «poser» ont dû faire au futur dâonhyêmi (§ 56b); mais comme nous trouvons quelquefois le sanscrit sy représenté en zend par jjjjj qy (§ 3 5 ), on pourrait s’attendre aussi à une forme dâqyêmi. Il existe en effet un participe futur passif3 usdaqyamnananm (= sanscrit udddsya-mânânâm) « sublevandorum », qui est opposé au participe passé us-dâtananm «sublevatorum», comme nous avons vu plus haut sanhyamanananm-ca opposé à sâtanahm-ca.
On a ici un exemple de la sifflante du verbe substantif changée en gutturale : c’est le cas de rappeler ce que nous avons dit plus haut (§ 568 et suiv.) sur l’origine probable du « de eSaxa, SéScoxa, que nous croyons provenir d’un a. Comme la racine zende dâ «poser, placer, faire»489 répond au grec S-rç, le dâq du précité dâqyamnanahm serait identique avec le Srnx. du grec edtjxa, téOrjxa.
§ 670. Origine de la caractéristique du futur ya.
Il reste à nous demander quelle est l’origine de cet exposant du futur ya, auquel se rattache aussi le yâ du potentiel et du précatif. Je persiste à cet égard dans l’opinion que j’ai déjà exprimée dans mon premier ouvrage : je crois que ces syllabes viennent de la racine î «désirer». L’optatif grec, qui est le représentant du potentiel et du précatif sanscrits, devrait donc son origine à un verbe signifiant « souhaiter », c’est-à-dire ayant précisément le sens de la dénomination qui a été donnée a ce mode. Si l’on ajoute à la racine ^ Ha voyelle de liaison de la première et de la sixième classe, on obtient ya d’après la même règle phonique qui nous donne ydnti à la troisième personne du pluriel de la racine i «aller» ; la forme en question ydnti coïncide tout à fait avec la partie finale de dâ-s-yânti «ils donneront».
Wüllner2 propose la racine i «aller» pour expliquer le ya du futur : il est certain que sous le rapport de la forme cette racine ne convient pas moins que * « désirer ». Mais pour la signification, «désirer, vouloir» se prête mieux à l’expression du futur et de l’optatif que «aller». En grec moderne comme en vieux haut-allemand et dans différents dialectes germaniques , c’est à un verbe signifiant «vouloir» qu’on a eu recours pour former
le futur périphrastique : et c’est d’une façon indépendante, c’est-à-dire sans emprunt ni imitation, que les divers idiomes germaniques sont arrivés à se servir du même auxiliaire.
En ancien slave également nous trouvons quelquefois le futur exprimé par un verbe signifiant «vouloir» (§ 65g); mais il faut prendre garde que les exemples cités par Dobrowsky1 appartiennent tous à des passages de la traduction cyrillienne où le texte grec a le mot p£k\v. On peut donc supposer, jusqu’à ce qu’on ait trouvé d’autres exemples, que le choscuit slave
est une traduction littérale du verbe grec. Ainsi nous avons : jegdachotahtï sija büti a&zav fxéXkrt tolütol yevécrOai » 490 491; chotahj priât «ô péXkùtv ëpxjsaBau»492.
S 671. De l’affinité du futur avec la forme désidérative, en sanscrit,
en latin et en grec.
Pour exprimer le futur, le sanscrit emploie quelquefois son désidératif : ainsi dans l’épisode de Drâupadi, nous trouvons mumûrsu, littéralement «désirantmourir», dans le sens de «mo-riturus». Inversement, plusieurs langues font servir le futur a t l’expression de la volonté : le latin, par exemple, forme ses de-j sidératifs des participes futurs en turus. On pont comparer esurus et esuriû, parturus et pariurio. Uu a été abrégé et l’on a ajoute PI de la quatrième conjugaison latine. Il ne faudrait pas rapprocher cet î de l’exposant du futur ya dont il vient d’être question : en effet, K latin représente le caractère de la dixième classe : aya, qui est employé également en sanscrit pour la formation
| de beaucoup de verbes dénominatifs.
Le grec tire certains désidératifs du futur en <7«, ou peut-être de la forme plus ancienne en de sorte que urapaSœffsfo, yeXacretù) auraient simplement renforcé F< par l’e du gouna. Peut-être aussi le désidératif et le futur sont-ils dçux formes soeurs, et sont-ils directement dérivés l’un et l’autre du thème verbal. Nous voyons pareillement en sanscrit des verbes désidératifs qui ont la forme du futur, mais qui n’en dérivent pas ; ils sont sortis du même thème nominal par un procédé de formation analogue. Tels sont : vréa-syâmi «désirer le taureau», madv-asyâmi «désirer du miel». Dans ce dernier exemple s’est peut-être conservé Y a radical du verbe substantif. Mais ordinairement, dans les désidératifs formés de thèmes nominaux, le verbe substantif est tout à fait omis, ou bien il s’est perdu avec le temps : il ne reste que la syllabe ya, c’est-à-dire la caractéristique du futur, ou, en d’autres termes, le verbe auxiliaire «désirer»; on a, par exemple, patî~yâmi «je désire pour époux», venant de pâti «époux».
Quant aux désidératifs sanscrits qui viennent d’une racine1, avec addition d’une sifflante et avec redoublement, peut-être ont-ils eu d’abord un y après la sifflante ; ce y appartiendrait également à la racine «désirer», et pipâ-sâmi «je désire boire» (pour pipâ-syâmi) aurait une formation analogue hpâ-syâmi «je boirai ». Entre pipâsami et la forme supposée pipâsyâmis le rapport serait le même qu’entre le grec Soé-cra et la forme plus ancienne Sùtcritt) (= sanscrit dâsyami'j. Il ne serait pas étonnant que la surcharge amenée par le redoublement eût déterminé un affaiblissement dans la partie finale du mot : c’est ainsi que les verbes redoublés, à la troisième personne du pluriel, ont perdu la nasale qui appartenait de droit à la désinence (MBrati «ils portent» au lieu de bîbranti)2.
Nous reviendrons plus loin sur les désidératifs.
1 Et non d’un thème nominal. — Tr.
â Voyez S A59.
FORMATION DES MODES.
POTENTIEL, OPTATIF, SUBJONCTIF.
-H*67*2, Le potentiel dans la deuxième conjugaison principale, en sanscrit.
— Caractéristique yâ, en grec
Le potentiel sanscrit réunit en lui les significations du subjonctif et de Poptatif grecs ; il a, en outre, divers emplois qui lui sont propres. Sous le rapport de la forme, il répond à Poptatif grec.
Dans la conjugaison qui est représentée en grec par la conjugaison en fii, les verbes sanscrits forment leur potentiel en insérant la syllabe yâ devant les désinences personnelles. Les caractéristiques des différentes classes sont maintenues : conséquemment, la racine vid (classe 2) fait vidyâm «sciam»; la racine Bar, Br (classe 3) fait BiBryâm «feram»; la racine star, str (classe 5) fait strnuyam «sternam»; la racine as (classe 2) fait syâm (pour asyâm) k sim ».
On n’a pas de peine à reconnaître l’exposant modal yâ dans le grec où la semi-voyelle, conformément au système phonique de la langue grecque, s’est vocalisée en 1 ; mais cet t forme toujours une aiphihongue avec la voyelle radicale qui précède, attendu qu’il n’y a pas de présents comme ë$pt (— sanscrit âdmi, lithuanien edmï)1, et que, par conséquent, il ne peut y avoir d’optatifs comme iShv (= sanscrit adyam). Néanmoins, SiSofav répond assez exactement au sanscrit dadyam, surtout si l’on rétablit dans cette dernière forme la voyelle radicale, qui a été irrégulièrement supprimée. La forme complète serait dadâyâm; mais la racine dâ, chargée des désinences pesantes et du caractère mo-
C’est-à-dire de présents où la désinence (it soit précédée d’une consonne. — Tr.
dal yâ, retranche sa voyelle en sanscrit, tandis qu’elle se contente de l’abréger en grec. Nous avons donc dadyâm = StSoiyv1.
La racine as «être», par une anomalie qui lui est propre, supprime son a initial là où la racine dâ renonce à sa voyelle finale 493 494 : on a donc syâm « que je sois » en regard du grec eïr\v495. Cette dernière forme est pour êcririv, le a- tombant volontiers entre deux voyelles. A la différence du sanscrit, la racine es conserve en grec sa voyelle ; on peut comparer le présent de l’indicatif, où nous avons êcrpévy ec/lé, avec les formes sanscrites smas « nous sommes », sla «vous êtes». *
* S 673. Suppression de la voyelle longue du caractère modal,
au moyen sanscrit, zend et grec.
Au moyen, le grec, le sanscrit et le zend s’accordent d’une façon remarquable, en ce qu’ils ont laissé entièrement disparaître la voyelle longue du caractère modal yâ, iïj. On a, par exemple, StSono, StSoipsOa (pour StSoirrro, StSoirl^sOa) comme en sanscrit dadîtdy dadîmâhi (pour dadyâta, dadyâmahi). La cause de cette suppression est évidemment le poids plus considérable des désinences du moyen; mais je ne voudrais pas affirmer qu’à l’époque où le grec ne s’était pas encore séparé du sanscrit, le caractère modal fût déjà mutilé de cette façon, il est vrai sans doute que dès cette période reculée certaines formes s’étaient affaiblies par suite de la différence de poids des désinences personnelles; on peut prouver, en outre, par plus d’un fait, qu’avant la séparation des idiomes indo-européens, l’organisme de la langue mère avait déjà souffert diverses perturbations. Mais sur le point spécial qui nous occupe, nous ne croyons pas que l’al-
tération soit aussi ancienne. L’accentuation du grec SiSoiro nous montre que nous avons devant nous une contraction relativement récente : car si I’j; était tombé avant la séparation des idiomes, nous aurions une forme SiSoitg, comme on a XéyoïTo. En second lieu, le grec se distingue du sanscrit, en ce quil peut supprimer F); même à l’actif, dans les formes du duel et du pluriel, au lieu qu’en sanscrit, dans la seconde conjugaison principale, le caractère modal yâ est intégralement maintenu au duel et au pluriel de l’actif. Le grec fait, par exemple, StSoïfiev (à côté de StSoiijftev), tandis qu’en sanscrit on a seulement dadyâma (et non dadîma)496.
S 674. Le caractère modal yâ changé en iê, x, au subjonctif latin.
Le subjonctif latin répond, sous le rapport de la forme, à 1 optatif grec et au potentiel sanscrit. Même sans l’intermédiaire du sanscrit, on aurait pu reconnaître la parenté du subjonctif latin et de l’optatif grec, en voyant que le caractère modal % figure dans sim, velim, edim et duim aussi bien que dans StSofyv. Mais la ressemblance du latin et du sanscrit est bien plus manifeste : en regard de edim nous avons adyâm «qtfe je mange», et si le moyen de ce verbe était usité, nous aurions, par suite de la contraction de yâ en î, adî-mâki en regard de edî-mus. De même, sim (pour sîm) régond à syâm, et encore plus exactement sîmus au moyen sîmâhi. La forme archaïque siem, siês, siet, comparée au sanscrit syâm, syâs, syât, est précieuse en ce quelle a conservé les deux éléments du caractère modal yâ, grec (j? : on en peut conclure que de même edim, edis, edit ont été précédés de ediem > ediès, ediet (= sanscrit adyâm, adyâs,
adyât) et que velim, dnim, etc. sont pour des formes plus complètes veheni, dujem (venant de dajem). Il est vrai qu’au pluriel nous n’avons pas d’exemple de siêrnus, siêtis (= sanscrit sydma. syàta); mais la contraction a pour cause Faccroissement du nombre des syllabes 1. C’est, je crois, pour la même raison qua côté de velim, velîs, velit, edtm, edîs, edit, duim, etc. l’ancienne langue n’a pas conservé de formes comme veliem, etc. Au contraire , à la troisième personne du pluriel, à côté du monosyllabe stnt, nous avons, dans l’ancienne langue, sient.
§675. Le caractère modal au prétérit du subjonctif, en gothique.
Dans les langues germaniques, comme en latin, le subjonctif correspond au potentiel sanscrit et à l’optatif grec. Le prétérit du subjonctif ajoute le caractère modal immédiatement a la racine , comme le font en sanscrit les verbes des deuxième, troisième et septième classes, et comme le font les verbes grecs en tIl y a même une ressemblance frappante, à la première personne du singulier, entre 1 ejau gothique et le yâm sanscrit2 : on peut comparer êtjauB «que je mangeasse» avec adyam «que je mange». Aux autres personnes, le gothique suit l’analogie du moyen sanscrit et grec, en supprimant l’a deya et en changeant le j en î (représenté dans l’écriture gothique par ci). On peut comparer le gothique êt-ei-ma, le vieux haut-allemand âzîmês avec le sanscrit ad-î-mâhi4 et le latin ed-î-mus; de même, le go-
1 Struve, De la déclinaison et de la conjugaison latines, p. 6i.
* LM sanscrit s’est abrégé et le tn vocalisé en u (S 18).
a II faut faire abstraction du redoublement contenu dans étjau. La racine est at; présent : ita «je mange» ; prétérit : êtum «nous mangeâmes» (pour aluni, venant de a-atum). Comparez le vieux haut-allemand animés, qui répond aussi exactement que possible au prétérit redoublé sanscrit âd-i-mâ (pour a-adimây Remarquez que ce verbe germanique prend le redoublement sans subir, comme sêtum et les formes analogues, aucune mutilation (S 6o5).
4 Adîmâhi, ainsi que adîdvâm et adîtd, ne sont pas employés réellement, le moyen de la racine 55^ ad étant inusité.
thique êt-ei-th, en vieux haut-allemand âzît, avec le sanscrit ad-î-dvdm et le latin ed-î-tis; à la deuxième personne du singulier, êt-ei-s (= êt-î-s) est presque identique avec le latin ed-î-s. A la troisième personne, le signe personnel étant tombé1, la voyelle qui précède s’est trouvée placée à la fin du mot et s’est abrégée : on a, par conséquent, êti en regard du sanscrit adîtd et du latin edit.
$ 676. Cause de la contraction du caractère modal au prétérit
du subjonctif, en gothique.
En rapprochant le gothique êt-d-ma du sanscrit ad-î-méhi, je ne veux pas dire que le prétérit du subjonctif, en gothique, se rattache au moyen sanscrit. La contraction déjà en d (prononcez 1) doit être attribuée aux lois phoniques qui régissent la langue gothique. Il est probable que ja s’est d’abord affaibli en ji; c’est ainsi qu’au nominatif singulier nous avons ji-s au lieu de ja-s, lorsque le thème est dissyllabique et que la syllabe précédente est brève (S 13 5 ). Mais si la voyelle de la syllabe précédente est longue, soit par nature, soit par position, ou si le thème comprend plus de deux syllabes, ja se contracte en d (prononcez 2), et, à la fin du mot, en i bref : nous avons, par exemple, andeis ce fin » au lieu de andjis (venant de atidjas); accusatif : andi, au lieu de andja. Devant une nasale finale ou devant ns, la syllabe ja est maintenue; ainsi au datif pluriel nous avons andja-m, à l’accusatif andja-ns. C’est pour la même raison que, devant le m (changé en«) de la première personne du singulier, le caractère modal ja s’est maintenu intégralement : on peut donc comparer êtjau (pour êtjam) «que je mangeasse » avec le datif pluriel andjam; êteis « que tu mangeasses » avec le nominatif et le génitif singuliers andeis; «qu’il mangeât» avec l’ac
cusatif andi.
1
Voyez S 86, ab. .
S 677. L’impératif slave correspond au potentiei sanscrit, à l’optatif grec.
— Impératif des verbes en mï. — Deuxième et troisième personne du
singulier.
On a vu qu’en ancien slave il subsiste quelques restes de la deuxième conjugaison principale (conjugaison grecque en fit) : ce sont les verbes qui, à la première personne du présent, ont conservé la désinence iwt mï. À l’impératif, que je crois devoir identifier avec le potentiel sanscrit et zend, avec le subjonctif latin et germanique et avec l’optatif grec1, l’exposant de la relation modale se joint, dans les mêmes verbes, immédiatement à la racine. Mais le caractère modal n’a gardé du yâ sanscrit que la semi-voyelle, et comme à la seconde personne du singuliei le s de yâs devait nécessairement disparaître (§ 92“), nous avons raîKA^ jasdi497 «mange» en regard du sanscrit adyàs «que tu manges» et du latin edîs, E'bftAi* vêsdï3 «sache» en regard du sanscrit vidyas, et A4/KAL daidï4 « donne » en regard du grec St-et du sanscrit dadyas5. Les formes slaves en question servent aussi pour la troisième personne : en effet, par suite de la suppression des anciennes consonnes finales, \yâs et sont devenus semblables. Au contraire, en grec, SiSoItjs^ quia conservé son s, se distingue par là de SiSotrt, dont la consonne finale a disparu.
S 678. Pluriel de l’impératif des verbes précédents.
A la première personne du pluriel, iu^ammjasdimü, e^aha^ vêsdimü, AdffiAHAtë dasdimü s’accordent avec '4|<£J [M adyâma, edîmus;
1 Cette identification est admise par Miktosicb, dans la deuxième édition de sa Théorie des formes de l'ancien slave, S 107.
2 Par euphonie pour jadj ($ 93 *).
3 Pour vêdj.
4 Pour dadj.
5 Comme le slave, le sanscrit a perdu ici la vojeüe radicale.
fqqtfl vidyâma; dadyâma, SiSoïyëv, duîmus. A la deuxième personne du pluriel, ki?kahte jasdite, ch^ahtê vêsdite, ayante iasdite s’accordent avec m adyâta, edîtis; f^TRï vidyàta; ^TTri dadyâla, SiSqits, duîtis. La troisième personne plurielle de ce mode s’est perdue en slave : dans les dialectes vivants, on la remplace par la personne correspondante du présent de l’indi-cafif, qu’on fait précéder d’une particule L
S 679. L’impératif lithuanien.
L’impératif lithuanien appartient également, quant à son origine, au mode en question : tous les verbes sans exception prennent un t, lequel correspond à la voyelle slave 1. ï, h i, dont il vient d’être traité, à 1\ des optatifs grecs, à Pt latin dans sim, edim, velim, duim, au yâ ou à Pt sanscrit et zend. Mais ce qui donne à l’impératif lithuanien un aspect à part, et ce qui d’abord empêche d’apercevoir la parenté que nous venons de signaler, e est que Pt est toujours précédé d’un k 2, à moins que la racine 11e soit elle-même terminée par un k Comme à la seconde personne, où Pt devait se trouver à la fin du mot, on supprime ordinairement cette voyelle, et comme le k se présente à toutes les personnes de l’impératif, excepté à la troisième3, on pourrait aisément être tenté de regarder le k comme le véritable suffixe de l’impératif, et de méconnaître la parenté qui relie le mode lithuanien aux formes correspondantes des autres langues de la famille. La racine hü «être», par exemple, fait büki ou 498 497
bük « sois », bukiie « soyez », bâkime « soyons », bukiwa « soyons tous deux», bukita « soyez tous deux». De même on a düki ou dük « donne », dükite « donnez », etc.
La plupart du temps, le k se trouve entre deux voyelles. En effet, ou bien c’est, comme dans les exemples précédents, la racine qui se termine par une voyelle, ou bien, comme dans les trois dernières conjugaisons de Mielcke, c’est la caractéristique (§ 5o6). Quant au verbe sukù «je tourne», qui sert de modèle, chez Mielcke, ppur les verbes de la première conjugaison , il ne prend pas le k en question parce que sa racine finit par un k. En conséquence, la grammaire de Mielcke ne nous offre aucun exemple où nous puissions voir le k de l’impératif se combinant avec une consonne. Cependant Ruhig nous donne, pour le verbe laupsinu « je loue », l’impératif laupsink’ (pour laupsinki). D’après la règle posée par Mielcke1, suivant laquelle le k doit prendre la place du suffixe de!’infinitif, le verbe ras-ti «trouver» (par euphonie pour rad-ti) suppose un impératif comme ras-h ou ras-h.
$ 680. Le k de l'impératif lithuanien provient du verbe substantif. — Comparaison avec le précatif sanscrit. — Formes correspondant h l’optatif aoriste grec (holrjv, &e(rjv), en zend, en arménien, dans le dialecte védique, en ombrien et en osque.
Quelle est l’origine de ce k qui est particulier à l’impératif lithuanien? Il est très-probable que c’est l’altération d’un ancien s, lequel appartient au verbe substantif. Conséquemment düld «donne» est doublement parent avec l’ancien slave daehü « je donnai » , avec le grec sS&xa, SéSaxa499 500, ainsi
qu’avec le zend dâqyêki1 «il donnera» (= sanscrit
dâsyâti).
Le même rapport qui existe entre le futur zend dâqyêiti et le futur sanscrit dâsyâti, se retrouve, en ce qui concerne le remplacement de la sifflante primitive par une gutturale, entre le lithuanien düki et le précatif moyen sanscrit dâsîsta « qu’il donne ». Au duel, le lithuanien düJciwa s’accorde avec le sanscrit dâswdhi, et au pluriel dükime avec dâsîmdhi.
Le précatif sanscrit, dont nous avoqs rapproché le futur arménien (§ i83b, s), n est pas autre chose en réalité qu’une modification du potentiel : entre le précatif et le potentiel le rapport est à peu près le même qu’en grec entre l’aoriste et le présent de l’optatif; en d’autres termes, les caractéristiques des classes sont supprimées. Comparez le sanscrit dey as, dêyat (pour dâyâs, dâyât)2, le zend dâyâo, dâyâd, avec le grec Soins, Soin. A toutes les autres personnes, le sanscrit ajoute un s, c’est-à-dire le verbe substantif, à l’exposant modal yâ : de cette façon, dêyâsam «que je donnasse» ressemble à la troisième personne du pluriel, en grec, Soitja-av.
C’est seulement après la séparation des idiomes que le verbe substantif a pénétré dans les formes en question : le zend, qui de toutes les langues indo-européennes tient au sanscrit par le lien le plus intime, ne prend pas le verbe substantif; nous avons, par exemple, au pluriel, dâyâma,
Myata, dàyahn 3, comme en grec Soirjfiev, Soinre, Soïev.
Au contraire, le sanscrit fait dêyasma, dêyasta, dey asus. L’armé-
port entre le lithuanien ju/fa et le slave jucha qu’entre diïki «donne» et AdXS dackü «je donnai».
1 Je ne connais pas d’exemple de cette forme zende; mais je crois pouvoir la supposer d’après l’analogie de la forme usddqyamnanafim (S 669).
4 Dans la plupart des racines sanscrites, un â primitif se change en ê au précatif actif; mais il n’en est pas de même en zend.
3 Comparez Burnouf, Yaçna, notes, p. i5o et suiv.
nien, dans les formes correspondantes de son futur, s’abstient également du verbe substantif : il fait à la première personne du pluriel taiumq, à la troisième tazen (= zend dâyâma, dâyahny.
A la première personne du singulier, je trouve en zend la forme dyanm (avec suppression de la voyelle radicale, pour dâyanm) dans un passage où la signification «donner» convient aussi bien que «poser, placer»2. Si cette forme appartient à la racine dâ «donner», elle s’accorde avec le grec Soirjv et, abstraction faite du verbe auxiliaire, avec le sanscrit dêydsam; si, au contraire, c’est la racine sanscrit Vt dâ «poser, placer», il faudra rapprocher le grec 3-strjv et le sanscrit îfàrwwdeyâsam.
Même en sanscrit, dans le dialecte védique, le verbe auxiliaire peut être laissé de côté : c’est du moins ce qui ressort pour moi de la forme Bûyaima «que nous fussions». En l’absence d’un présent Bûmi, Bûsi, etc. j’aime mieux voir dans Bûyàma un pré-catif, c’est-à-dire un optatif aoriste de la cinquième formation (S 573), qu’un potentiel, c’est-à-dire un optatif présent. Pour la même raison, je reconnais dans le védique Butu «qu’il soit» un impératif aoriste de la cinquième formation, et non un impératif présent appartenant à la seconde classe de conjugaison.
Avec la troisième personne du singulier Bûyât, en zend buyâd} s’accorde parfaitement l’ombrien fuia « qu’il soit » 3. L’osque fiiid (même sens)4 a conservé le signe personnel qui a disparu en ombrien; mais il a perdu Yâ de l’expression modale (en sanscrit yâ). Au contraire, dans l’osque stai-ed «qu’il soit debout», 501
la voyelle de l’exposant modal est restée sous la forme d’un e : rapprochez, en grec, l’optatif aoriste , ainsi que le zend
élâ-yâ-d1 et le sanscrit stê-ya-t (pour s'tâ-yâ-l).
§ 681. Le précatif moyen, en sanscrit.
Au précatif moyen, le sanscrit confie au verbe substantif fexpression de la relation modale, de même qu’au futur actif et moyen c’est le verbe substantif qui est chargé de marquer la relation temporelle. La forme dâ-sî-y-â2 «que je donne » renferme le précatif ou le potentiel aoriste de la racine as502 503 504, comme da-sydmi «je donnerai» contient le futur de la même racine. Rapprochez de dasî le lithuanien iu-ki «donne» (sans désinence personnelle), où la sifflante s’est durcie en k (S 680). Ce changement de s en k est la seule chose qui distingue 1 impératif et le futur lithuaniens ; comparez, par exemple, dü-kite « donnez » avec dü-site «vous donnerez».
§ 682. Comparaison de l’impératif lithuanien et lette avec le précatif
et le potentiel sanscrits.
11 y a encore un fait qui prouve, selon moi, que l’impératif lithuanien se rattache au précatif sanscrit et non au potentiel : c’est que les verbes correspondant à la première classe sanscrite n’ont pas la voyelle caractéristique qui devrait s insérer entre la racine et la désinence personnelle. A côté du présent wez-a-me «nous transportons», wêz-ci-te «vous transportez», nous aurions eu très-probablement le potentiel wtz-ai-me, wêz-ai-te= gothique vig-ai-ma, vig-ai-th, grec syj-oi-pev, s%-qi-t£ , sanscrit vdh-ê-ma, vàh-ê-ta (pour vdh-ai-ma, vâh-ai-ta). Or, on a wes-ki-me, wês-ki~tet formes qui, comme nous avons essayé de le montrer, répondent, si Ton fait abstraction des désinences moyennes, à vak-sî-mâhi, mk-sî-dvâm.
En lette, c’est le potentiel et non le précatif qui a prêté sa forme à l’impératif; en regard du présent darrat «vous faites», nous avons l’impératif darrait «faites», littéralement «que vous fassiez». Le rapport entre ces deux formes est le même qu’entre l’indicatif gothique lis-a-ts «vous lisez tous deux» et le subjonctif Ms-ai-ts «que vous lisiez tous deux»1. A la deuxième personne du pluriel, nous avons toujours en lette ai ou ee (= grec ot) en regard de Va de l’indicatif505 506. Ainsi le lette et le lithuanien se complètent à l’impératif : l’un nous a conservé le potentiel sanscrit ou optatif présent, l’autre le précatif sanscrit ou optatif aoriste; il faut remarquer en outre que c’est le moyen du précatif qui nous est resté, c’est-à-dire une forme qui manque dans tous les autres idiomes de l’Europe507.
§ 683. Restes conservés en lithuanien du potentiel de la seconde
conjugaison principale.
En Jette, la deuxième personne du singulier de l’impératif est toujours identique avec la personne correspondante de l’indicatif : il n’est donc pas nécessaire de nous y arrêter. De même, en lithuanien, ce qu’on appelle ordinairement la troisième personne de l’impératif n’est pas autre chose que la troisième personne de l’indicatif présent : elle se fait précéder de la conjonction te, en sorte quelle doit plutôt être considérée, quant au sens, comme un subjonctif que comme un impératif.
Mais il y a en lithuanien un certain nombre de verbes dits irréguliers, qui ont une forme spéciale pour l’impératif, laquelle correspond de la façon la plus évidente au potentiel de la seconde conjugaison principale en sanscrit, et à l’optatif présent de la conjugaison grecque en pi. Le caractère personnel est tombé, comme il tombe régulièrement à tous les temps de 1 indicatif. On a, par conséquent, ie = grec nj, latin ie£(dans siel)> sanscrit yât, zend yâd. On peut comparer notamment êsie avec le grec sïij (pour sWjj), l’ancien latin siet et le sanscrit syât; la forme lithuanienne l’emporte en fidélité sur le latin et le sanscrit, en ce quelle a conservé la voyelle radicale508, et sur le grec eh en ce qu’elle a gardé aussi la consonne de la racine.
S 684. Comparaison des formes lithuaniennes comme dudie rrqu il donne»
et comme diïki « donne !».
Le lithuanien dëdje «qu’il donne» répond au grec SiSow, au sanscrit dadyat et au zend daidyâd. Comme le sanscrit et le zend, le lithuanien a perdu la voyelle radicale : du~dt& est pour duduje, comme da-dyàt est pour dadâyât et dai-dkjcul pour da-dayad*
Le rapport entre düdie et les autres personnes non réduplica-tives de l'impératif, telles que düki, dükime, est exactement le même qu’en sanscrit et en zend le rapport entre le potentiel et le précatif, ou en grec le rapport entre le présent et l’aoriste de l’optatif : ce que dadydt est à \iuM-yât (pour dâyat, au moyen dâ-sîétâ), ce que daidyâd est à dâyâd,
ou ce que StSotrj est à Sofa, le lithuanien düdie « qu’il donne» l’est à düki «donne». Preuve nouvelle et très-claire que l’impératif lithuanien, à la troisième personne des verbes dits irréguliers, se rattache au potentiel ou optatif présent, tandis qua toutes les autres personnes il représente le précatif ou optatif aoriste, et que le k de düki est identique avec le * de sScokoi et le s du sanscrit dâsîyd. Il ne sera pas inutile de rappeler ici la division des temps et des modes sanscrits en formes spéciales et générales : ces dernières, auxquelles appartient le précatif, ainsi que l’aoriste grec, suppriment les caractéristiques des classes509. Or, dans dâdâmi, düdu, la caractéristique con
siste dans le redoublement : conséquemment la syllabe rédu-plicative manque dans dê-yâmm, dâ-sîyâ, Sotyv, düki pour la même raison qu’au futur dâ-sydmi, Scû-ggû, dü-siu. Conformément à ce principe, la racine lithuanienne bü «esse» (= sanscrit Eû) fait au pluriel du futur bur-si-me, et à celui de l’impératif, bu-ki-me.
f .
$ 685. Le subjonctif lithuanien et ïette.
Outre l’impératif, le lithuanien nous offre encore un autre mode que nous devons rapprocher du précatif sanscrit : c’est le mode que Ruhig et Mieicke appellent subjonctif et Kurschat optatif. Il n’a d’autre temps que l’imparfait.
Voici le tableau complet du mode en question : nous prenons
pour exemple la racine dû «donner», et nous mettons en regard les formes correspondantes du lette, attendu que cet idiome nous est ici nécessaire pour l’intelligence du lithuanien.
SINGULIER.
PLURIEL.
DUEL-
Lithuanien. dûtumbiwa dütumbita dûtu.
Lithuanien. Lette.
«
dûc'iau es dohtu dûtumbei tu dohtu dûtu winsch1 dohtu
La troisième personne du singulier sert également pour le pluriel, comme il arrive toujours en lithuanien et en lette; dans ce dernier dialecte elle s’emploie aussi pour le dueL Si nous nous bornions à l’examen de la troisième personne, nous serions amenés à rapprocher dûtu, dohtu de l’impératif sanscrit dddâtu « qu’il donne » ; on pourrait dire alors que c’est par une sorte d’abus que le lette dohtu a pénétré aussi dans la seconde et dans la première personne : c’est ainsi qu’en gothique la troisième personne du pluriel du présent passif sert aussi pour les deux autres personnes (S 466). Mais je ne regarde pas le tu en question comme une désinence personnelle : je l’identifie avec le tum des autres personnes, et j’explique dûtu comme une forme mutilée pour dütumbi. Cette opinion me parait d’autant plus vraisemblable qu’à la première personne du pluriel on peut dire à volonté dütum ou dütumbime512 : dans cette dernière forme, le second m est le caractère de la première personne; quant au premier m, il n’a rien de commun avec la désinence personnelle. En lette, on supprime tout à la fois la syllabe bi et le m qui précède : le tu qui reste se combine au pluriel avec le signe personnel. Quant
au singulier, lequel perd toujours en lette les consonnes des désinences, il reste sans complément aucun : es dohtu, tu dohtu, winsch dohtu.
Ces faits nous conduisent à soupçonner qu’en lithuanien, à la première personne du singulier, la forme duciau et les formes analogues ont épreuve une forte mutilation : je ne doute pas que duciau ne soit pour dütumbiau, dont la syllabe umb a été supprimée. Le t s’étant trouvé en contact avec Ÿi suivi lui-même d’une voyelle, il s’est changé en 6 (§ 9a11). La mutilation de dütumbiau en duciau (pour dütiau) n’est pas plus forte que celle de dütu(mbi)me en dütum, pour dütume. Dans les deux cas, trois lettres ont été omises : une fois, mb précédé d’une voyelle, l’autre fois mb suivi d’une voyelle.
S 686. Comparaison du subjonctif lithuanien avec le futur latin.
Dans le bi du subjonctif lithuanien, je reconnais l’exposant de la relation modale. Nous retrouvons la même syllabe au futur latin de la première et de la deuxième conjugaison. Comparez da-bimus avec dütum-bime, da-bitis avec dütum-bite, dabis avec dütum-bei (pour dûtum-bi-i}, dabo (pour dabio) avec la forme supposée plus haut dü-tum-biau, et dabit avec la forme également supposée dütum-bi (mutilée.en dütu). Cette rencontre entre le subjonctif lithuanien et le futur latin n’est pas purement fortuite : sans sortir du latin, nous voyons par les futurs comme legês, leget, legêmus, legêlis, qui ont la même forme que les subjonctifs de la première conjugaison, l’affinité qui existe entre le futur et le subjonctif. 513
donne la troisième personne du précatif ïRTR Bûyat, en zend buyâd, Le lithuanien a renoncé à Vü de sa racine hü, soit à cause de la surcharge causée par la composition, soit parce que Ÿû? qui partout ailleurs est suivi d’une consonne , se trouverait ici devant une voyelle. Quant à la syllable yâ, elle est assez bien conservée à la première personne du singulier ia-u; mais à toutes les autres personnes elle s’est contractée en t. Comparez biau (pour biam, S 436, î) avec le zend buyanm514 (venant de buyâm^i et, d’autre part, bime, bite (venant de bigame, bujate) avec #$*»**>) buyâma, buyata.
II reste a expliquer la première partie du composé lithuanien diïtum-bei, etc. J’y vois une forme correspondant à l’infinitif sanscrit (^TcJlT datum) et à l’accusatif du supin latin (datant).. Hors de composition, le supin lithuanien se termine en ta. Quant à la lettre m, qui est le signe de l’accusatif, elle a pu se conserver ici sous sa forme primitive, grâce au verbe auxiliaire qui suivait, et qui commence par une labiale. On a vu (§ qu’or-dinairement le m de l’accusatif devient h en lithuanien.
§ 688. Le potentiel dans la première conjugaison principale, en sanscrit.
—- Optatif des verbes grecs en a.
En sanscrit, la première conjugaison principale supprime au potentiel l’a de l’exposant modal yâ ; cette suppression a lieu à 1 actif comme au moyen. Le y, vocalisé en i, se réunit à la caractéristique a qui précède, ce qui nous donne la diphthongue m> <lue le sanscrit a contractée en ê; exemple : Bérês «que
tu portes», pour Bar-a-yâs; nous avons de même en grec (pipots pour (pspolris (Ç>ep-o-/j;-s). D’autres idiomes nous présentent, comme le sanscrit, la diphthongue ai contractée en ê; mais cette contraction est si naturelle que plusieurs langues de la famille ont fort bien pu se rencontrer en l’opérant d’une manière indépendante. Le grec, au contraire, nous présente toujours la diph-thongue sanscrite ê sous la forme ai, et ou oi. A l’optatif, c’est ot : 1 o représente la voyelle caractéristique1, Yt l’exposant modal.
La voyelle jy, que nous avons dans l’exposant complet 07, est supprimée en grec comme Yâ de yâ est supprimé en sanscrit. On a donc (pép-oi-s, <pép-oi-[r) en regard de Edr-â-s, Edr-ê-t; Qép-ot-toî>, (pep-ot-Ttfv en regard de Eâr-ê-tam, Bdr-ê-tâm; <psp-ot-fxev, $ép-oé-Te en regard de Bdr-ê-ma, Bdr-ê-Ui.
Remarque. — Pourquoi ia caractéristique modale yâ s’est-elle affaiblie en i? — Ce qui a du favoriser la suppression de Yâ, au potentiel sanscrit, cest la facilité avec laquelle le y, vocalisé en i, se combine avec un a précédent. Ajoutez le besoin d’alléger des formes qui, par la présence de l’exposant modal complet, auraient souvent trois ou quatre syllabes : ainsi boîtes ?rque tu saches» est pour bod-a-yâs; kâmâyês trque tu aimes a est pour kâm-aya-yâs.
Dans la deuxième conjugaison principale, la syllabe modale yâ ne se combine avec un a radical2 que si le thème verbal est monosyllabique ; exemple : Ba-ymn «-que je brille». Les racines de la troisième classe, devenues polysyllabiques a cause du redoublement, s’allégent en supprimant \a; exemple : dad-yîim «“que je donne» (pour dadâ-yâm), gah-yam a que je quitte» (pour gaha-yam) La neuvième classe affaiblit sa caractéristique nâ en ni comme devant les désinences personnelles pesantes (S 485); on a donc yu-m-yâm ^que je lie» (pour yu-nâ-yâni). De cette façon, on évite absolument la combinaison de l’exposant complet yâ avec un a ou un â, dans les thèmes verbaux polysyllabiques. Au contraire, les racines qui s adjoignent nu ou u n’affaiblissent ni le thème, ni le caractère modal : ici, en effet, la de ya ne peut se perdre, car 17 ne saurait se réunir en diphthongue avec un u précédent; quant à la voyelle u de la syllabe caractéristique , elle n a pas besoin d’être affaiblie, puisqu’elle est déjà par elle- 515 516 517
même l’une des voyelles les plus légères. Conséquemment, nous avons des formes comme âp-nu-ytim -rque j’obtienne». En grec, on aurait dû avoir, comme forme correspondante, des optatifs tels que heixvmyv ; mais le grec,' probablement à cause de la difficulté de la prononciation, a modelé ces optatifs sur ceux de la conjugaison en ®. Le petit nombre de formes qui sont restées fidèles à (ancienne conjugaison suppriment T» et, par compensation, allongent lu; exemple : èmietxvtifjujv, pour êjriSsixvvlfiyv.
S C89. La première personne oifu. en grec. — La première personne êyam,
en sanscrit.
Nous avons déjà fait observer (S 43o) que la première personne du singulier otfti est une forme inorganique et que vm1ot(tt)v suppose un actif tvttIow1. Nous ne chercherons pas à savoir si les formes en olw, olys, dans la conjugaison des verbes contractes, sont des restes d’une période plus ancienne de la langue, en sorte quelles surpasseraient en fidélité le sanscrit bdr-é-s (pour Bar-a-yâs), ou si, ce qui me paraît plus vraisemblable, elles ont été refaites sur le modèle de la conjugaison en pu.
Entre la diphthongue ê et les désinences personnelles commençant par une voyelle, le sanscrit insère un y euphonique (S 43); exemple : Bârê-y-am, en regard du grec Çépotpu (pour fêpotv). La même insertion a lieu, dans la deuxième conjugaison principale, après ¥î qui est la contraction de l’exposant modal ya.
La désinence am est pour m 516 : sans l’insertion de cet a, la lettre euphonique y n’eât pas été nécessaire et nous aurions eu,
? u ^eu de Bàrêyam, une forme Bdrêm.
' La forme xpéÇow, attribuée à Euripide, est citée dans VEtymologicum ma-(s. t>.) : '
ÂÇpav âv £Ïr}v et rpétpotv xà xûv xsi'kas. — Tr.
3 Voyez S 687, remarque.
§ 690. Le subjonctif des verbes latins en ave.
Au subjonctif de ia première conjugaison latine, nous trouvons, comme en sanscrit, un ê. Cet ê représente la diphthongue qui provient de la contraction de la syllabe caractéristique avec la voyelle modale i; mais en latin Yê s’abrége devant un m ou un t final. On a donc : amëm, amët, en regard de amês, amêmas, amêtts. Peut-être n aurait-on jamais reconnu, sans le secours du sanscrit, la parenté de ces subjonctifs avec les optatifs comme (pépoifAt ((pépoiv}, (pépots, (pépotfiev, (pépons.
Si 1 on compare amês, amet, amêmus, amêtis avec les formes sanscrites à signification identique kâmdyês, kâmàyêt, kâmdyêma, kâmàyêta, on sera conduit à admettre que c est le dernier a de la caractéristique aya qui s’est contracté avec IV modal1. C est donc des formes comme Ttpustots, (piXéots, Syfkoois qu’il faut rapprocher le latin amês. Le premier a de la caractéristique a été supprimé. Dans les formes archaïques verberit, temperint518 519, le second a manque également, de sorte qu’il reste seulement 1 élément modal. Ces formes peuvent s’expliquer de deux maniérés : ou bien elles doivent leur naissance au sentiment qu’un i se trouvait renfermé dans Ye de verberet, temperet? ou bien elles ont été créées a 1 imitation de sit, veht, edit (S 6y 4). Âu contraire, les subjonctifs duim, perduim sont réguliers, car le verbe do est conjugué comme les verbes sanscrits de la deuxième conjugaison principale ou comme les verbes grecs de la conjugaison en pu : 1 i de duim, perduim correspond donc au y du sanscrit dad-yam ou a 1 < du grec StSoirjv. L’affaiblissement de IV* en u, dans duim,
vient peut-être de ce que le groupe ui est plus fréquent en latin que ai.
S 691. Subjonctif des verbes îatins en ère.
Le subjonctif latin moneâs, numeâmus n’a rien laissé perdre des éléments renfermés dans le thème causatif sanscrit mân-dya «faire penser» L Le ay sanscrit est devenu en latin un ê, lequel s’est abrégé devant la voyelle suivante. Si l’expression modale i a disparu, en compensation 1 a precedent s est allongé, de même qua l’optatif grec nous avons v au lieu de w. Moneâs est donc pour moneais comme êmSetxvôfiîjv est pour é7riSetxvvt(iw, comme SeuvvTO, 'TStiywjo sont pour Sctivvtto, 'SfïjyvvÏTo. II en est, au contraire, de carint^ (au lieu de careant, venant de c a venin t j comme de ver ber it, temperint (§ 690).
$ 693. Subjonctif des verbes latins en ire. — Le futur klin en am
est un ancien subjonctif.
Entre audts et audtas (pour audiats^ le rapport est le même qu’entre monês et moneâs 520 521 522.
Le futur de la troisième et de la quatrième conjugaison n’est pas autre chose qu’un subjonctif523. Il a conservé l’élément modal t : cet i, en se contractant avec l’a caractéristique de la classe, a donné un ê a toutes les personnes, excepté à la première du singulier. On a donc legcs, legêmus, legêtis, legênt, audiês, audiê-mus, audiêtis, audiênt; mais la première personne fait legam, audiam, au lieu de legem, audiem. Quintilien rapporte que Caton
le censeur écrivait dicem, faciern et il est probable que la quatrième conjugaison avait également des formes comme audiem.
Dans la troisième et la quatrième conjugaison latine, le futur et le subjonctif sont donc les représentants d’une seule et même forme primitive. Au subjonctif, fi de la diphthongue ai est rentré dans fa précédent qui s’est allongé ; au futur, fi s’est contracté avec fa précédent, qui s’est changé en ê. En se scindant, la forme primitive a laissé une partie de sa signification à chacune des deux formes qui en sont issues. De pareils faits ne sont pas rares dans l’histoire des langues : c’est ainsi que datûri et datârês se rapportent tous deux au sanscrit dâtdras, lequel réunit en lui les significations des deux formes latines.
L’emploi du subjonctif dans le sens du futur rappelle ce qui se passe dans les langues germaniques, où le futur est exprimé par des auxiliaires signifiant, les uns, «devoir??, et les autres, «vouloir??. Nous avons vu aussi que le zend emploie quelquefois l’impératif dans le sens du futur2. Il y avait d’ailleurs, dès les temps les plus anciens, une véritable affinité entre l’expression du futur et celle des relations qu’indique le subjonctif latin : en sanscrit, c’est ya qui marque le futur et yâ le potentiel.
§ 698. Le futur des verbes latins en ëre.
Arrêtons-nous un peu plus longtemps au futur et au subjonctif de la troisième conjugaison latine, quoique l’essentiel ressorte déjà de ce qui a été dit au sujet de la deuxième et de la quatrième conjugaison. Dès mon premier ouvrage, j’avais reconnu la parenté des futurs comme vehês, vehêmus avec les potentiels sanscrits comme vâhês, vdhêma et avec les subjonctifs latins comme amês, amêmiis. Mais dans la première conjugaison, fè avait une raison d’être qu’il n’était pas difficile d’apercevoir, car
1 Comparez Struve, p. 167.
3 Voyez § f>65.
il provenait évidemment de la fusion de Yâ avec IV du caractère modal : au contraire, Yê de vehês, vehêmus paraissait inexplicable, à moins quon ne regardât ces formes comme transplantées de la troisième dans la première conjugaison. Aujourd’hui que nous avons reconnu dans IV de la troisième conjugaison le représentant d’un ancien a1, vehês, vehêmus s’expliqueront tout autrement. Leur ê contient l’ancienne caractéristique a, qui dans veh-i-mus, veh-i-tis s’est affaiblie en i : Y a s’est maintenu sous sa vraie forme au futur et au subjonctif, grâce à la diphthongue où il se trouvait englobé. C’est ainsi qu’un mot s’est quelquefois mieux conservé en composition qu’à l’état isolé524 525. Avant qu’à l’indicatif les formes veh-â-s, veh-â-mus eussent dégénéré en veh-i-s, veh-i-mus, on en avait déjà tiré le futur veh-ê-s, veh-ê-mus et le subjonctif veh-â-s, veh-â-mus : aussi l’altération de la caractéristique à l’indicatif n’a-t-elle pas eu d’influence, au futur et au subjonctif, sur Y a fondu avec l’expression modale526.
S 696. Le subjonctif présent, en gothique.
Les formes comme vehâs, vehâmus, vehês, vetiêmus nous conduisent au gothique, où les douze classes de verbes forts correspondent à la troisième conjugaison latine527. A la différence du latin, le gothique n’a altéré l’ancien a de l’indicatif en * que devant un s ou un th final : partout ailleurs Ya s’est conservé. Il ne faudrait donc pas dire que haïrais «feras», bairai «ferai», hai-raitk s feratis r> se forment de l’indicatif bains, bairith, bairith au moyen de l’insertion d’un a; un pareil procédé de dérivation serait tout à fait sans analogie dans la famille des langues indoeuropéennes. 11 faut rapporter les subjonctifs en question à une époque où le présent était encore bavr-a-s, bair-a-th (comparez le passif bair-a-sa, bair-a-da, § 466). À la deuxième personne du duel et à la première du pluriel, bair-ai-ts, baîr-ai-ma sont avec l’indicatif bair-a-ts, baîr-a-m dans le même rapport que le sanscrit bâr-ê-tam, Mr-ê-ma (pour Mr-ai-tam, Bdr-ai-ma) avec Bâr-a-tas, Bâr-â-mas. A la troisième personne du pluriel, bair-ai-na1 « ferant » est avec bair-a-nd « ferunt » dans le même rapport que le zend |bar-ay-ën est avec bar-a-nti (ou bar-ë-nify ou que le grec (pép-oi-sv est avec Çép-o-vTi. A la première personne du duel le rapport entre bair-ai-va et baîr-os (pour bair~ a-vas, § 44i ) repose sur le même principe que le rapport entre le sanscrit Bâr-ê-va et Bâr-â-vas2. A la première personne du singulier bairau k feram », la voyelle modale i manque ; mais Yu est la vocalisation du signe personnel m : il y a donc la même relation entre bairau (pour bairaim) et bairais, bairai, qu’au futur latin entre la première personne feram (pour ferem) et ferês, feret (venant de ferais, ferait)*. Le vieux haut-allemand présente la diphthongue ai sous la forme ê, mais il abrège cet ê quand il est final (§ 81) : il y a donc le même rapport entre bere (pour
1 Par métathèse pour bairaian, à moins que ie dernier a de bair-aî-na ne soit une addition inorganique. Comparez S j 69.
3 Sur rallongement de l’d, voyez S 434.
3 En ce qui concerne la suppression de IV dans bairau, on peut comparer en gothique la troisième conjugaison faible de Grimm. De la caractéristique ai (= sanscrit ïRT aya, latin e), celle-ci a perdu IV* à toutes les personnes qui ont ou avaient anciennement une nasale, soit finale, soit accompagnée d’une autre consonne : 011 a donc à la première personne du singulier haba pour habai, en vieux haut-allemand habcm : pluriel habam pour habaim, en vieux haut-allemand habêmês; à la troisième personne du pluriel, haband pour habaind, en vieux haut-allemand hnbènt. Au contraire, là où ne suivait point de nasale, on a kabaix, habaith, etc.
POTENTIEL, OPTATIF, SUBJONCTIF. S 695-696. 345
bërê) «feram, ferat » et hërês (= sanscrit Bârês) « feras », herêmês t feramus », qu’entre le latin amem, amet et amês, amêmus.
S 696. L’impératif borussien.
En borussien, dialecte très-proche parent du lithuanien, nous avons des impératifs comme immais «prends», immaiti «prenez», qui ont avec les formes de l’indicatif imm-a-se «tu prends », imm-
#4 » il muinrl ** imâ
Irtt \\ u pi uuu // y uuv
ttnloli An ni ne fooilû n AAmnr»Anrl va rt
p'IUO iu\/il-u U Wiiâjj'i GiiUi V â|
du gothique nim-ai-s « que tu prennes », nim-ai~th qu’il prenne » avec nim-i-s, nim-i-th. D’un autre côté, le lette nous présente des impératifs comme darrait «faites», en regard du présent iarrat «vous faites» (S 68â). Le rapport que nous voyons en borussien entre dais «donne», daiti «donnez» et dose «tu donnes», dati «vous donnez» nous sert à comprendre celui qui existe en latin entre dès, dêtis et das1, dati? : le borussien nous présente encore la diphthongue ai qui en latin s’est contractée en ê. Mais le plus souvent l’indicatif borussien a pour voyelle caractéristique un e ou un i, et l’impératif la diphthongue ci; exemples : derets «vois» = Sépxots; ideiti «mangez» = sSotrs, gothique itaith «que vous mangiez».
Toutefois les deux modes ne sont pas toujours d’accord : ainsi en regard de tickinnaiti « faites » nous trouvons tickinnimai « nous faisons», tandis qu’on s’attendrait à avoir tickinnamai. On trouve aussi à l’impératif borussien un simple i ou un y; exemples : mylis « aime », endiris « regarde ». Ces formes ont perdu la voyelle caractéristique de la classe devant l’expression modale, comme verberit, temperint en latin (690).
S 696. Impératif des verbes slaves qui ont perdu la désinence mï.
En ancien slave, dans la conjugaison ordinaire, la deuxième et la troisième personne du singulier de l’impératif n’ont gardé
1 II n’existe pas d’exemple de dm avec a bref. — Tr.
que le dernier élément de la diphthongue primitive ai. Conséquemment, comme la consonne finale est tombée (§ 92™), e€3H vesi «transporte, qu’il transporte» correspond au sanscrit vâhês, vdhêt (§ 433), au latin vehês, vehct et vehâs, vehat, au gothique vigais, vigai, au grec ë%ot (§688). Mais au duel et au pluriel, comme la diphthongue était protégée par la désinence personnelle, nous trouvons u ê (pour ai, § 93 e) en regard de Yê sanscrit, latin et vieux haut-allemand, de Y ai gothique et (le l’oi grec; exemples : E€3U<i\s vcsêmü = sanscrit ^ OQr , latin vehêmus, vieux haut-allemand wëgêmês, gothique vigaima, grec éxotpev ; Bt3HT6 vesête528 — sanscrit vdhêta, latin vehêtis, vieux
haut-allemand wegât, gothique vigaitk, grec I^oits ; duel : KWbTû vesêta = sanscrit vâhêtam et vdhêtâm, grec honov
et èyohrtv, gothique vigaiis.
S 697. L'impératif en sîovène.
Parmi les autres langues slaves, le slovène mérite une mention spéciale : les verbes qui ont un a pour syllabe caractéristique distinguent leur impératif de leur indicatif présent en plaçant un j (= i) à côté de cet a, de sorte qu’ils ont aj en regard de Yê du potentiel sanscrit, de Y ai du subjonctif gothique, de Yê du subjonctif et du futur latins. Le singulier fait aj aux trois personnes2, les consonnes finales qui marquaient la desmence personnelle ayant dû tomber, en vertu d’une loi commune à tous les idiomes slaves (§ 92"*). Nous avons donc : dM~aj «que je travaille, que tu travailles, qu’il travaille» (pour dêl-aj-m, dêl-aj-s, dêl-aj-t3), qu’on peut comparer aux formes gothiques comme hair-ai-s, bair-ai, aux formes sanscrites comme Bdrês, Bârêt, aux
1 Sur la troisième personne du pluriel, qui a disparu en ancien slave, voyez S 678.
2 Seul parmi tous les dialectes slaves, le slovène a une première personne du singulier de l’impératif.
a L’indicatif présent, au contraire, fait dêl-a-m (pour dêl-a-mi), dél-a-sh (pour dèl-a-shi), dél-n (pour dêl-a-ti).
formes latines comme amcm, amês, amet, vehês, vehet, aux formes grecques comme ((pépow), (pépotpt, (pépois, (pépot. Au duel, dêl-aj-va1 s’accorde parfaitement avec le gothique bairaiva et le sanscrit Bdrêva; à la deuxième personne du duel, dêl-aj-ta est avec l’indicatif dêl-a-la dans le même rapport quen gothique bair-ai-ts «que vous portiez tous deux» avec baiv-a-U «vous portez». Au pluriel, dêl-aj-mo est à dêl-a-mo ce que le gothique bair-ai-ma est à bair-a-m; à la deuxième personne du pluriel, dêl-aj-te est à dêl-a-te ce que le gothique bair-ai-th est à la forme primitive hair-a-th (devenue bair-i-th, § 67), ou ce que le vieux haut-allemand bër-ê-t (pour ber-ai-i) est à l’indicatif bër-a-i.
Remarque. — D’où iî vient que le verbe slave, dans quelques-unes de ses formes, fait la distinction des genres. — A l’indicatif comme au subjonctif, le duel du verbe slovène distingue les genres. Il fait, par exemple, dêl-a~va «nous travaillons tous deux» et dêl-a-vê «nous travaillons toutes deux», dêl-aj-va «que nous travaillions tous deux» et dêl-aj-vê «que nous travaillions toutes deux». De même, on a dêl-a-ta «vous travaillez tous deux, ils travaillent tous deux» et del-a-tê «vous travaillez toutes deux, elles travaillent toutes deux», dêl-aj~ta «que vous travailliez tous deux, qu’ils travaillent tous deux» et dêl-aj-tê «que vous travailliez toutes deux, quelles travaillent toutes deux» 2.
En ancien slave également, on trouve quelquefois Tt te comme désinence féminine et neutre, en regard de ta qui est indifféremment employé pour les trois genres3. Cette désinence tê vient évidemment du pronom féminin-neutre T'fc tê (— sanscrit ^ tê) rrhæ duæ, hæc duo». Dobrowsky et Kopi-lar, dont j’ai suivi les écrits avant de pouvoir consulter ceux de Miklosich, présentent aussi à la première personne du duel Et vê connue une désinence exclusivement féminine, tandis que Kd va servirait seulement pour le masculin et le neutre. Cette dernière distinction ne s’est pas trouvée confirmée, à ce qu’il semble, par les textes étudiés par Miklosich. Aussi i’ai-je laissée de"côté, dans la présente édition; je pense toutefois que c’est par abus que 528
K’b vê s’est introduit au masculin : le slovène me paraît plus régulier, sous ce rapport, que l’ancien slave, de même qu’il a conservé le m de la première personne du singulier, lequel, en ancien slave, est devenu n (S 436, 2 ).
D’où provient cette distinction des genres, au duel des verbes, dans certains idiomes slaves? Je ne puis que répéter à cet égard ce que j’ai dit dans la première édition (S 429) : ce n’est point là un reste des temps primitifs de notre famille de langues, mais au contraire une déviation relativement récente de l’usage grammatical. Mais elle est remarquable en ce qu’elle montre combien le sentiment de l’identité grammaticale du verbe et du nom s’est maintenu longtemps. A l’époque où les verbes slaves ont pris les désinences féminines en ê (comparez les substantifs comme vïdovê cries deux veuves» et les pronoms féminins comme T'fc tê «hæ duæ»), ou sentait encore le rapport intime qui a existé de toute antiquité entre les pronoms employés à l’état indépendant et les pronoms unis à des thèmes verbaux.
S 698. L’a de l’impératif slovène dêlam représente - la caractéristique sanscrite aya.
En rapprochant les formes slovènes comme dêlraj-nio «que nous travaillions » du gothique hair-ai-ma et du sanscrit Mr-ê-ma, nous devons toutefois faire une restriction. Il ne faudrait pas identifier 1 « de dêl-a-m avec la caractéristique a de la première et de la sixième classe sanscrite, ni avec celle des verbes forts en gothique. Dans Ya de dêl-a-m comme dans celui du polonais czyt-a-m «je lis»528, je reconnais le représentant de la caractéristique aya qui appartient à la dixième classe sanscrite. Cet aya se montre à nous sous diverses formes dans les langues slaves, comme en latin et comme dans la conjugaison faible des langues germaniques. Si nous plaçons à coté du slovène dêl-a-m et du polonais czyt-a-m les formes russes a'kaaio djelâju, uiimaK) citâju (pour djel-djo-m, cit-ajo-m), nous nous trouvons déjà beaucoup plus près des formes sanscrites comme cint-âyâ-mi «je pense».
1 Czyt-ay «lis», czyt-ai-my «que nous lisions». C’est la première conjugaison d’après le classement de Bandtke.
\ la troisième personne du pluriel, le slovène dêiajo et le polonais czytaja sont déjà plus près du sanscrit cint-âya-nti.
S 699. Le potentiel zend. — Pourquoi il présente tantôt la diphthongue ôi, tantôt ai.
Les verbes zends de la première conjugaison principale prennent au potentiel tantôt la diphthongue ot, comme en grec, tantôt la diphthongue ai § 33), comme en gothique. Ainsi barôis répond très-bien, abstraction faite de la longue de fô, au grec (pépots, et barôid à <pépot(r). Au contraire,
au moyen, la troisième personne du singulier baraita
s’accorde mieux avec le gothique bairaith1 qu’avec le grec (pé-potTo. Je ne connais pas d’exemple de la première, ni de la deuxième personne plurielle de l’actif, dans la première conjugaison principale : mais je ne doute pas quelles n’aient été bar aima, baratta, et non barôima, barôita*. En effet, je crois avoir reconnu que le zend préfère la diphthongue ôi quand la consonne suivante est finale, et la diphthongue ai quand la consonne suivante est encore accompagnée d’une voyelle3. C’est pour cela qu’à la troisième personne du singulier le potentiel ac-lif est barôid et le potentiel moyen baraita. II est
vrai que le Vendidad-Sâdé nous présente deux fois la première personne du pluriel moyen bûidyôimaid'ê «vi-
deamus » = sanscrit bûdyêmahi « sciamus ». Mais T étendue
de la flexion, dans ce mot que le manuscrit lithographié coupe en deux par un point4, a pu être cause que bûidyôi a été con-
1 Sur la forme moyenne bairaith, venant de bairaidu 7 et sur deux formations analogues, voyez plus haut, 1.1, p. 20, note 2.
2 La supposition de l’auteur s’est vérifiée. On a trouvé gaéaima, vanaima, han-aima, êrâvayaima ; mais il ne s’est point rencontré de forme en ôima. — Tr.
3 Comparez les génitifs et les ablatifs en ois, oui = sanscrit ês, et la particule nôid «ne ... pas» “ sanscrit nêt.
4 Ce mot se trouve deux fois page 65. Une fois le texte donne la leçon fautive
sidéré comme un mot à part. Il faut remarquer, en effet, qu’à la fin des mots la diphtliongue oi est permise, surtout si elle est précédée d’un y; exemples : R lesquels » = sanscrit ^ yê, grec oï; maidyâi «in medio » (§ 196)= *T§1
madyê; moi «à moi», 4?P et iivoi «à toi», *4$)» h™
«à soi» (à côté de mê, yjç» tê, twê, Aê). De la
forme bûidyôimaid'ê je ne voudrais donc pas conclure à des
formes comme barôimaide, encore moins à un actif barâima, car nous n’avons pas le y qui favorise la présence de'di, et dans la dernière forme la désinence n’est pas assez étendue pour prendre l’apparence d’un mot à part. C’est pourquoi aussi à la troisième personne du verbe moyen en question, nous avons hûidyaita, et non bûidyôita *.
§ 700. Exemples du potentiel dans les verbes zends de la première conjugaison principale.
À la troisième personne du pluriel, ia de la diphtliongue primitive ai s’est conservé ; mais IV s’est changé en sa semi-voyelle y, à cause de la voyelle suivante. On a donc barayën en
regard du grec Çépotev, ce qui fait que pour la seule diph-thongue grecque ot le zend présente tour à tour, dans le même mode, ôi, yj*» ai et 44* ay.
Si les exemples de la troisième personne du pluriel sont nombreux, il n’en est pas de même pour la première personne du singulier2. Le seul exemple que je connaisse a perdu le signe personnel et se termine en ou C’est le mot nëmâi qu’on trouve deux fois au commencement du chapitre xlvi du Yaçna : $£$ $£$ kahmnëméisahm, qu’Anquetil traduit par : «quelle terre bûid'tôi maide et l’autre fois bùidyôi maêdê. Voyez Burnouf, Études sur la langue et les textes zends, p. 370. Sur la longueur de Pu, voyez S ht.
1 Vendidad-Sâdé, p. 65.
- Nous ne parlons ici que des verbes de la première conjugaison principale.
invoquerai-je?» et Spiegel par : a quel pays célébrerai-je?». Le sens est à peu près : ttqualem celebrem terram? » L La phrase suivante est : kutrâ nëmôi ayêni, qu Anquetil tra
duit par s quelle prière choisirai-je?»529 530.
Parmi les potentiels zends de la première conjugaison principale, je citerai encore upa-sôid v.qu’il frappe», de la racine son (= sanscrit hanj; après la suppression de n, la voyelle a est traitée comme si elle était la caractéristique de la première classe 531.
Mentionnons encore la forme H? *}£%>** stërënaita « qu’il répande », qui abrège la de la caractéristique nâ (neuvième classe); le thème verbal étërëna est ensuite traité comme s’il appartenait à Tune des quatre classes de la première conjugaison principale : ainsi, au potentiel, la final du thème est supprimé devant la diphthongue modale ni. On peut rapprocher, à cet égard, le latin stemet (§ A g 6).
S 701. Exemples du potentiel dans les verbes zends de la seconde conjugaison principale.
Dans la seconde conjugaison principale, le potentiel zend est généralement d’accord avec le potentiel sanscrit, excepté à la troisième personne du pluriel, où nous n’avons pas la désinence
ns (S 46a)1, À la première personne du singulier, yanm532 533 534 répond au sanscrit yâm, au grec itjv; ainsi daidyahm (§ 44a) «que je place, que je crée» répond au sanscrit ^ERi^dadyâm, au grec ttdetrjv. À la deuxième personne, nous avons p»,» yâoz pour 'ZCIQyâs, exemple : fra-mruyâo «dicas» -
pra-brûyâs. A la troisième personne, on a ywjj yâd - yât, exemple : kerënuyâd « faciat » = |dkrnuyât
(forme védique).
Au pluriel, je ne connais pas d’exemple du potentiel proprement dit, pour les deux premières personnes de l’actif ; mais il existe de nombreux exemples du précatif, qui a exactement le même sens535. Il diffère seulement du potentiel par la suppression des caractéristiques : on peut donc, de l’un de ces modes, déduire avec certitude les formes de l’autre. A la première personne du pluriel, nous avons, pour le précatif, la désinence yâma = sanscrit yâsma et grec trjpev' exemple : buyâma536
«que nous soyons» = sanscrit Bûyâsma. Nous pouvons donc conclure à un potentiel daidyâma. A la deuxième personne du pluriel, le précatif fait y ata (avec abréviation de la voyelle modale) = sanscrit yâsta et grec une ; exempl es ; buyata « que vous
soyez» = HJITO Bûyasla; dâyata «que vous donniez» =
dê-yàsta, Sotine. De ces formes je conclus que le potentiel a dû être daidyata — sanscrit dadyâta, grec StSoitne. Remarquez que la syllabe yâ abrège sa voyelle : il est difficile d’admettre que cette différence entre la première et la seconde personne provienne du hasard. Je suppose que la désinence ta, à cause de la muette initiale, a plus de poids que la désinence ma, qui commence par une liquide; la syllabe précédente aura été affaiblie pour compenser cette différence de pesanteur1.
S 705. Troisième personne du pluriel du potentiel zend. — Comparaison avec le sanscrit et le grec.
À la troisième personne du pluriel, la syllabe modale yâ, en se combinant avec la désinence personnelle ën (plus anciennement an), nous donne la forme yaim (pour yân)2. Devant la nasale finale, la seconde moitié de Yâ long (= a + a) s’est donc changée en un son nasal faible, que l’on peut comparer à l’a-nousvâra sanscrit. Comme exemple, nous citerons le potentiel nidaityann «quils déposent»3.
La racine dâ « donner » doit faire à la troisième personne du pluriel du précatif actif dâyann ou peut-être, avec abréviation de la voyelle radicale, dayann, ce qui est très-près
du grec Soisv, au lieu que le sanscrit dêyasus (pour dêyâsani) s’accorde mieux avec SotJiaa.v537 Cette différence vient de ce que le sanscrit, comme nous l’avons déjà fait remarquer (S 680), adjoint le verbe substantif à la racine4. Il est très-remarquable que le zend s’abstient absolument de prendre le verbe substantif; il en est de même à l’optatif grec, excepté pour la forme Sotfj(7<xv (à côté de Aneu).
§ 7o3. Restes du potentiel moyen, en zend.
A la troisième personne du singulier moyen, nous avons une forme daitîta « qu’il placer = sanscrit dadîtd, grec TÎÔeno. La forme correspondante du pluriel est daiiita, qui se distingue seulement du singulier par l’abréviation de la voyelle modale. Cette abréviation vient peut-être de la nasale qui, à une période plus ancienne de la langue, a dû suivre ïi. On peut donc supposer qu’il y a eu d’abord une forme daitinta; en grec, nous avons TtôstvTo : si la voyelle radicale s’était perdue en grec comme elle a été supprimée en zend et dans le singulier sanscrit dadîtd, on aurait eu t/&vto.
La forme daiiita est fréquente en zend, surtout en composition avec ikluMf— yaué; les progrès de la grammaire zende ont mis hors de doute que 1 ÿ***?^®*^® * purificent »1
est un pluriel, quoique Anquetil le traduise toujours comme un singulier. Je supprime donc ce que j’ai dit à ce sujet dans la première édition de cet ouvrage.
S 706. Restes du précatif moyen, en zend.
Je reconnais une deuxième personne du pluriel du précatit moyen dans la forme dayadwëni, que Burnouf traduit
par ^ donnez » et qu’il considère probablement comme un impératif moyen2. Cette forme, qui ressemble assez au grec So'tcrOs, est importante en ce qu’elle nous montre que le précatif zend, pas plus au moyen qu’à l’actif, ne s’adjoint le verbe substantif. De même que l’actif dayata (— grec Soinre), le moyen dayadwëm se rattache à la cinquième formation de l’aoriste sanscrit {ada-m
1 Voyez S 637. -
3 ïaçna, notes, [>. 38.
= 2<5W), au Heu que le précatif sanscrit dâ-sî-dvâm appartient à la première formation
Si toutefois l’on voulait voir dans le zend dayadwëm « donnez » un véritable impératif, il faudrait supposer que la racine dâ a produit en zend un verbe de la quatrième classe : la syllabe y a, au lieu d’être l’exposant modal, serait alors la caractéristique de la classe. Mais je ne vois pas de raison suffisante pour admettre cette hypothèse.
S 706. Formes correspondant à l optatif aoriste grec
dans le dialecte védique.
Le potentiel sanscrit et zend n’a qu’un seul temps. Mais le précatif est avec le potentiel dans le même rapport qu’est en grec l’aoriste second de l’optatif avec le présent du même mode. Dê-yâ's, dê-yât (pour dâ-yâs, dâ-yât) est à ddâs, Mât ce qu’en grec Soit) s, Soir) (pour 5W>fs, <5Wîj) est à ëSws, ëSo>. Pour les précatifs comme budyas, budyat il n’existe pas à l’indicatif de forme correspondante, parce que la cinquième formation de l’aoriste est bornée, en sanscrit, aux racines finissant par une voyelle538 539. Mais il est probable qu’à l’origine cette formation s’étendait aussi à des racines finissant par une muette; nous pouvons donc supposer qu’il y a eu anciennement des aoristes comme dhud-ma, dBut (pour dBut-s), dBut (pour dbut-t), abud-ma, etc. auxquels appartiennent les précatifs tels que bud-yasam.
Il n’est pas nécessaire de regarder comme des potentiels conjugués d’après la sixième classe les formes védiques telles que vidêyam « sciam », sakêyam « possim v, gamêyam « eam », vôcêma «dicamus»1. Ces formes, qui appartiennent à des verbes ne faisant point partie de la sixième classe, sont en quelque sorte les prototypes des aoristes optatifs grecs comme tv7foitu (plus anciennement tuttotv). Il les faut considérer comme des rejetons de l’aoriste de la sixième formation (dvidam, dsakam, dgmtiam, dvâcam) : la voyelle de liaison a s’est unie avec la voyelle modale i, exactement comme en grec la diphthongue o*, dans tu-7roifAi, renferme la voyelle de liaison o 2 de stvtt-o-v et la voyelle modale t. A l’appui de cette explication, nous citerons surtout vôcêma «dicamus» : il n’existe pas de racine vôc à laquelle on puisse rapporter vôcêma, comme Bdrêma se rapporte à la racine Bar; mais il existe bien un aoriste dvôcam3, d’où est tirée la forme en question.
S 706. Formes correspondant à l’optatif aoriste grec (ruinât, Ancrât), dans le dialecte védique. — Comparaison avec le borussien.
Il y a aussi trace, dans le dialecte védique, de quelques formes qui présentent la même structure qu’en grec l’aoriste premier de l’optatif. Pânini4 cite tarusêma qui, par le sens, équivaut à târêma «transgrediamur», mais qui, par sa forme, dérive d’un indicatif aoriste comme âdik-sam = ëSsiÇa (§ 555). Il y a seulement cette différence que le verbe auxiliaire ne vient point s’adjoindre immédiatement à la racine, mais qu’il insère une voyelle de liaison u, comme au futur védique tar-u-syâti et dans quelques formes analogues5.
II est difficile de croire que rppfâ tarusêma qui, considéré à
1 Pânini, III, 1, scholie 86.
2 A l'indicatif, cet o alterne avec e (érviz-e-s).
J Nous avons vu plus haut (S 58a) que âvôcam est une forme redoublée peut’ a-va-ucam, venant iui-méme de a-vavacam.
* III, 1, scholie 85.
5 Voyez Benfey, Glossaire du Sâma-véda, p. 81.
part, semble une anomalie, ait été toujours seul de son espèce. Il est probable quà une époque plus ancienne, dont le grec a gardé un souvenir plus fidèle que le sanscrit, tous les aoristes de la seconde formation (§ 555) pouvaient donner naissance à un précatif. Ainsi âdik-sam (= eSet^a) aura donné dik-sêyam (= pluriel dik-sêma (= SefëoiifÂSv'); dans ces formes,
l’élément modal yâ, contracté en i, a produit une diphthongue avec la voyelle précédente, comme nous Pavons vu plus haut pour bâr-ê-y-am (= (pép-ot-pu), Ear-ê-ma (= (pép-ot-fAsv).
Avec les formes grecques comme tutt-gou, Xô-erat (troisième personne du singulier de Paoriste premier de Poptatif) et avec le védique tar-u-êêma \ s’accordent très-bien les formes borus-siennes comme da-sai « qu’il donne » 540 541, bou-sai « qu’il soit », galb-sai «qu’il aide». Par l’altération de Ya en e, le sai borussien (= grec <ra<) est devenu sei : de là les formes bau-sei «qu’il soit», sei-sci «qu’il soit», au-da-sei «qu’il arrive». Enfin, par la suppression de IV final, on a eu se dans da~se «qu’il donne», bou-se « qu’il soit », galb-se « qu’il aide », tussî-se « qu’il se taise ». La forme si, danspo-lcûn-si «qu’il préserve», eb-signâ-si «qu’il bénisse», provient de sai ou de sei, par la suppression de la première partie de la diphthongue. Quant à la forme -su, dont il n’existe qu’un seul exemple, savoir mukimusin «discat» (littéralement «se doceat»), elle ne peut provenir que de sa(i) par l’affaiblissement de Y a en u 542.
Cette forme d’aoriste optatif reste bornée, en borussien, à la troisième personne du singulier, laquelle sert en même temps pour le pluriel (busei «qu’ils soient»). A la deuxième personne du singulier, on aurait pu s’attendre à avoir des formes comme da-sais (comparez grec \v-erous)\ il est probable que des formes de ce genre ont effectivement existé à l’origine.
-S 707. L’imparfait du subjonctif, en latin, est un temps composé.
On pourrait être tenté de voir dans l’imparfait du subjonctif latin la même formation que dans les aoristes grecs comme Set-ïfripev 1 et dans l’aoriste védique tarusêma. Il est certain qu’entre le latin stâ-rêmm et le grec il y a une ressemblance
frappante, car le r représente un ancien s (comparez eram, pour esam) et ¥ê est une contraction pour ai (comparez le = ai de amêmuSy kgêmus). Cependant, je m’en tiens, au sujet de stâ-rem et des formes analogues, à l’opinion que j’ai exprimée dans mon premier ouvrage543 544; je les regarde comme des formations nouvelles, appartenant en propre à la langue latine.
Nous remarquons, en effet, qu’en regard de l’indicatif stâ-bam, qui est un composé de date relativement récente, nous devrions avoir un subjonctif stâ-bem (pour stâ-baim); ou, inversement, l’indicatif correspondant à stâ-rem devrait être stâ-ram (pour stâ-eram). Mais la langue latine, qui disposait de deux racines545 pour exprimer l’idée d’être, s’est servie de l’une à l’indicatif et de l’autre au subjonctif : par suite, la symétrie entre sta-bam et sta-rem s’est trouvée, jusqu’à un certain point, rompue, et le r de starem a l’air de participer 5 l’expression de la relation modale, quoique en réalité cette expression réside uniquement dans IV que renferme la diphthongue ê.
Personne ne refusera de croire que possern (venant de potsem) ne renferme, au même titre que pos-sum et pot-eram, le verbe substantif réuni avec pot. Mais si l’on accorde que pos-sem soit une formation nouvelle, appartenant en propre au latin, il faudra en dire autant pour son analogue es-sem (venant de ed-seni) «que je mangeasse», ainsi que pour Tarchaïque fac-sem1, car si ces formes étaient dérivées du parfait fêci, on aurait eu fexem, fexim, Dans possem, essem et fac-sem, l’ancien s du verbe auxiliaire s’est conservé; après un r ou un l, il s’est assimilé à la liquide précédente [fer-rem > vel-lem). Entre deux voyelles, il s est changé en r, et c’est là le cas le plus fréquent, puisque l’imparfait a droit à la voyelle caractéristique de la classe. C’est ainsi qu’on a eu leg-e-rem, dic-e-rem (pour leg-i-rem, dic-i-rem). Au contraire, si l’imparfait du subjonctif avait la même origine que l’aoriste de l’optatif en grec, nous devrions nous attendre à avoir dixern (= Sellai fxi, pour SetÇouv ), au lieu de dic-e-rem.
Les formes es-sem « que je mangeasse » et fer-rem sont régulières, car elles ne prenaient point originairement la voyelle caractéristique, comme nous le voyons encore par les formes ê-s, es-tf es-tis = sanscrit àt-si, dt-ti, ai-iâ; fer-s, fer-t, fer-tis
= sanscrit bibdr-si, bibâr-ti, biBr-tâ. Il n’y a donc aucune raison pour faire venir fer-rem de fer-e-rem, par la suppression d’un e; il faudrait, au contraire, expliquer fer-e-rem, si cette forme existait, en disant que ce verbe, par l’insertion d’un e, s’est introduit dans la classe de conjugaison la plus usitée, comme effectivement à côté de es-sem nous avons ed-e-rem.
§ 708. L’imparfait du subjonctif essem <rque je fusse», en latin.
Mais comment expliquer es-sem «que je fusse», au lieu duquel, pour correspondre à l’indicatif eram, nous devrions avoir erem?
Remarquons que eram est pour esam (= sanscrit osant, § 532); c’est de cette forme primitive esam qu’est sortie la forme esem
1 Fac-sem est un imparfait du subjonctif, au moins quant à la tonne, de même fjue/he-sim est un présent.
(pour esêm), par l’insertion de la voyelle modale il. Une fois que esem fut dérivé de esam, la forme primitive a pu, dans le cours du temps, céder au penchant qu a la langue latine de changer en r un s placé entre deux voyelles, sans que pour cela la forme dérivée esem dût nécessairement suivre cet exemple; car le changement en r d’un s placé entre deux voyelles n’est pas en latin une règle absolue. On a donc eu, à l’indicatif, eram et, au subjonctif, esem; la sifflante que le subjonctif a gardée ayant été plus tard redoublée, on obtint essem. Nous observons une opposition de même nature, quoique en sens inverse, dans le vieux haut-allemand ivas «j’étais» et wâri « que je fusse » 546 547.
Quant au redoublement de la lettre s dans essem^ ie crois pouvoir l’expliquer par le même principe qui fait qu’en grec, dans la langue épique, les consonnes les plus faibles (à savoir les liquides et <r) sont quelquefois redoublées, et qui veut que le p le soit toujours dans certaines positions. En sanscrit, un n final précédé d’une voyelle brève est toujours redoublé si le mot suivant commence par une voyelle. Conséquemment, si nous admettons que le redoublement de s, dans essem et esse, est, comme je le crois, purement euphonique, nous en pourrons surtout rapprocher les aoristes grecs tels que iréAsaaa, car ici le <rar appartient également au verbe substantif. Au sujet du futur so-nopai, je renvoie le lecteur au § 655.
On pourrait toutefois proposer une autre explication, d’après laquelle le redoublement de s, dans essem, aurait sa justification étymologique548. Nous avons vu précédemment (§707) que esem (venant de esam) s’est abrégé en sem, devenu plus tard w, et qu’il s’est adjoint sous l’une de ces deux formes aux verbes attributifs : il est possible que dans cette position on ait cessé d’en sentir la vraie valeur, et que sê, rê aient été pris pour des exposants de la relation modale ; alors la racine es se serait combinée avec elle-même, et es-sem signifierait « que je fusse étant », comme nous avons es-sem s que je fusse mangeant» et pos-sem «que je fusse pouvant».
Il se peut aussi que l’analogie de es-sem « que je mangeasse » et de pos-sem, ainsi que de ferrent et de vellem, ait agi sur notre forme essem « que je fusse » ; la langue aurait alors redoublé le s de essem, à l’exemple de ces verbes et sans se rendre un compte bien net de ce quelle faisait.
Quoi qu’il en soit, on peut regarder essem, ainsi que la forme qui a dû précéder, esem, comme de création nouvelle, car ni en sanscrit ni en grec l’imparfait ne sort de l’indicatif1. Le terme de comparaison le plus proche qu’on puisse trouver pour l’imparfait du subjonctif latin, c’est l’aoriste de l’optatif en grec : esem est sorti de esam (eram), comme rvÿaifju (pour rvÿcuv} de
§ 709. Parfait du potentiel, dans le dialecte védique et en ancien perse.
— Le parfait de l'optatif en grec.
Dans le dialecte védique, il y a des potentiels redoublés tels que : sasrgyât, mvrtyât, baüûyât, gagamyâm, gagamyât; et au moyen : vavrtîta, vavrùaahi, susucîta, dudïwîta549 550. D’accord avec Westergaard 551, je crois aujourd’hui devoir les expliquer comme des parfaits du potentiel552. Comme tels, ils s’accordent très-bien
avec les prétérits du subjonctif dans les langues germaniques ; on peut notamment rapprocher les premières personnes gothiques comme haihait-jau «que j’appelasse » des formes védiques comme gagam-yâm. En regard de bundjau (pour baibundjau) «que je liasse », on pourrait s’attendre à trouver dans le sanscrit védique babandÿâm. À Tégard de la signification, il n’y a plus de différence, dans les Védas, entre les parfaits et les présents du potentiel : ainsi baBû-yât veut dire «qu’il soit» Mais c’est probablement le résultat d’une confusion. En ancien perse, au contraire, dans l’inscription de Béhistoun2, nous trouvons caUriyâ avec le sens d’un prétérit3-
A la différence des formes correspondantes en sanscrit, en ancien perse et en germanique, les parfaits de l’optatif, en grec, conservent la voyelle de liaison du parfait de l’indicatif: mais l’a se change en o, lequel, en se combinant avec la voyelle modale, produit la diphthongue 01, comme au présent et à l’aoriste second. À la troisième personne du singulier, au lieu de rerv(poe, on aurait dû s’attendre à avoir, d’après la formation sanscrite, rsruÇfirj; dans le dialecte védique, la forme correspondante eût été tutupyat, s’il nous était resté un potentiel parfait de la racine tup «frapper, tuer».
smrg-ydt comme étant pour sâsrg-yàt. Mais le redoublement irrégulier de la forme babuyât (ba au lieu de 6m) s’accorde mieux avec le parfait babuva (venant de bal)û-a) «je fus» qu’avec l’intensif bôbû~yât, qui frappe du gouna la syllabe ré-duplicative.
1 Rig-véda, I, xxvii, 2. s Colonne 1, ligne 5o.
3 «Il n’y avait pas un homme, ni Perse, ni Mède, ni quelqu’un de notre race, qui aurait fait ce Gaumata, le mage, privé de la puissance.» L’* de caJcriyâ s’explique comme celui du pâli rattiy-ah, rattiy-â (S 202). Quant à la suppression de la voyelle radicale ( cakriyâ pour cakariyâ), comparez en sanscrit les parfaits de l’indicatif tels que gagmimâ (S 606, remarque).
S 710. Parfait du subjonctif, en latin.
En latin, les parfaits du subjonctif comme amave-rim (pour amavi-sm) sont indubitablement de formation nouvelle : le thème du parfait est joint avec sim «que je sois». Le s, placé entre deux voyelles, s’est altéré en r, et à cause de ce r IV de amavi, amavi-sti est devenu e1. On pourrait, au besoin, diviser aussi de cette façon : amav-erim, puisque sim est pour esim, comme sum est peur esum. Mais cette supposition me paraît moins vraisemblable, puisque déjà à l’état simple nous trouvons sim, et non esim, et que ¥e, à plus forte raison, a dû être supprimé en composition; on sait d’ailleurs que le changement de IV en e, devant un r, est conforme aux habitudes du latin.
S 711. Tableau du potentiel et du préeatif.
Nous faisons suivre le tableau du potentiel et du préeatif, en sanscrit et en zend, avec les modes qui y correspondent dans les langues de l’Europe :
POTENTIEL.
SIKGULIEB.
|
Sanscrit. |
Zend. |
Grec. |
Latin. |
Lithuanien. Ancien slave. |
|
dadyaÈi* |
daidyanm3 |
hthotyv |
daim4 |
» « * « * • « » * # |
|
dadyas |
daidytîo |
Sr hotys |
dms |
..... daidt5 |
|
dadyat |
daidyâd |
htobj |
doit |
diïdie0 àdklï |
|
dadîtâ7 |
daidîta |
§{§OfTO 8 |
« # * • • | |
|
Comparez S 707. | ||||
|
Pour dadâyâm (S 672). | ||||
1 Voyez ci-dessus, page 28, noie 9. Comparez § 701.
* Voyez S 676.
5 Voyez S 677.
■’ Voyez S 684.
7 Pour le moyen, je ne mets ici que la troisième personne du singulier et du pluriel. Je renvoie, pour les autres personnes, à ce qui a été dit des désinences du moyen (SS 466 et suiv.).
8 Voyez S 673.
DUEL.
Sanscrit.
dadyava
dadyatam
dadydtâm
Zend.
Grec.
Latin.
hholl)TOV
hihotrjTrjv
Lithuanien, Ancien slave.
..... daàdivê
..... dasdita
■
dasdita
i * « • *
PLURIEL.
|
dadydma |
daidyâma |
à&oltjpsv |
duimus |
dasdimü | |
|
dadyata |
daidyata1 |
h&oirjTs |
duîtis |
■ « * « a |
dasdite * |
|
daidyaim555 |
SiSoisv |
duint |
* * * # r |
4 * • • • | |
|
daidita557 |
ebSofpro |
* ■ i » * |
***** |
• « • • * | |
|
SINGULIER. | |||||
|
Vieux | |||||
|
Sanscrit. |
Latin. |
Gothique. |
h.-allemand. Ane. slav | ||
|
Actif. |
Moyen. |
♦ | |||
|
adyam |
adîyâ1 |
êtjau9 |
A * azt |
* • • * * | |
|
adyas |
adîias |
edîs |
êteis |
A 4 azts |
jasdï562 |
|
adydt |
aditâ |
edit |
A.* eu |
A * azt |
* t Jv jasai |
|
DUEL. | |||||
|
adyam |
adivdhi m |
êteiva |
jasdivê | ||
|
adyatam |
adîydtâm |
cteits |
jasdita | ||
|
adyatam |
adiyatâm |
« • * • • |
» ■ » • * |
V » « • « |
jasdita |
PLURIEL.
Vieux
Sanscrit. Latin. Gothique, h.-aïlemand. Ane. slave.
|
Actif. |
Moyen. | ||||
|
adyama |
adtmâhi a * |
edîmus |
êteima |
A 4 A aztmes |
jasdimü |
|
adyata |
adîdvâm |
edîtis |
êteith |
A A. azit |
jaidite |
|
adyiis |
adirân |
edint |
êteirn |
âun |
t • « * « |
PRÉCÀTIF.
SINGULIER.
|
Sanscrit. |
Zend. |
Grec. |
Arménien. |
|
dêymam8 |
dâyahm3 |
hoirjv |
mujg la£ 4 |
|
dêyas |
JA A dayao |
8067s |
tntuglru tüZ€S |
|
dêydt5 |
dâyâd |
806/ |
tntuyf^ (azê |
|
dêydsva dêyastam dêydstâm |
- |
DUEL. | |
|
SotïJTOV SotTjrrjv PLURIEL. | |||
|
dêydsma |
dâyâma |
$Ot?f(tSV |
wuignL-jA taZUq |
|
dêyas ta |
dâyata6 |
dobjre |
tnutpfcg tagiq |
|
dêyasus |
dâyann |
8ofei>, Ûoirjcrav |
ututglfü taien. |
|
Voyez S 678. | |||
|
Pour dâytfoam (S 706). | |||
Le texte zend donne dyanm. Mais je crois pouvoir rétablir la forme plus ancienne dâyantn (S 680).
4 Voyez 8 i83b, a.
5 Voyez S 70a.
Pour dâyâta (S 701).
POTENTIEL.
SINGULIER.
|
Sanscrit. |
Zend. |
Grec. |
Latin. |
Gothique. V. |
haut-allemand. |
Ane. slave |
|
bârê-y-mn1 |
(1pépoi-vY |
feram566 |
baira-u567 |
hëre568 | ||
|
lr f A bare-s |
Çépots |
ferê-s feras |
bairai-s |
bërê-s |
beri* | |
|
bârê-t |
baroi-d * |
?époi-(r) |
fere-t fera-t |
bairai |
hëre |
beri |
|
bârê-ta |
barai-ta |
<pépoi-TO |
bairai-th | |||
|
barai-dau | ||||||
|
DUEL. | ||||||
|
Irf A bare-va |
bairaî-va |
t AA uei'eve | ||||
|
bârê-tam |
(pépOl-'TOV |
bairai-ts |
berêta | |||
|
bârê-tâm |
(pepoi-Tijv |
berêta |
PLURIEL.
bârê-ma
Bârê-ta
barê-y-us
barê-ran
barai-ma571 572 (Zéooi-aev bairai-ma bërê-mês berêmû
1 1 1 )jera-mus
barai-ta Çépot-re bairai-th bërê-t berête
baray-ën 0épot-ev bairai-na bërê-n ....
....... Çèpoi-vro ......bairat-ndau19 . ..........
SINGULIER. PLURIEL.
|
Sanscrit. |
Latin. |
Sanscrit. |
Latin. |
|
ttêtê-y-am |
ste-ni |
Itsiê-tna m |
stê-mvs |
|
tüïê-s |
stês |
lüïê-ta |
stê-lis |
|
tiêtê-t |
ste-t |
tistê-y-us |
ste-nt. |
S 712- Le présent du subjonctif des verbes faibles, en gothique
et en vieux haut-allemand.
Au sujet du subjonctif gothique, il nous reste encore à faire observer que les verbes faibles qui ont contracté la caractéristique sanscrite aya en â (= a + a)1 sont incapables de marquer la relation modale : en effet, l't ne peut se réunir en gothique à un è précédent; partout où nous devrions avoir oi, l’t est absorbé par Yâ. Conséquemment frijôs signifie aussi bien «âmes» que «amas»; dans le premier cas, il est pour frijois573 574. Au pluriel, frijâth signifie aussi bien « ametis » que « amatis ». A la troisième personne du singulier, frijô «amet» (pour frijôilh) se distingue de frijâth « amat » ; mais cette distinction n’a rien d’organique : elle vient de ce que le subjonctif a perdu la désinence personnelle (S 43a).
En vieux haut-allemand, les formes de subjonctif comme salboe, salbôês, salboêmês sont inorganiques, car Yê, qui est une contraction pour ai (S 78), n’aurait ici sa raison d’être que s’il contenait Ya de la caractéristique; mais cet a se trouve déjà renfermé dans Fd (= ^\aya)575. Il ne reste donc pas d’a qui, en se contractant avec la voyelle modale i, ait pu donner un ê. C’est par abus que Yê, qui avait sa raison d’être dans d’autres classes verbales, a pénétré dans celle qui nous occupe.
Au contraire, dans les formes comme habêês «que tu aies», habêêmês «que nous ayons», les deux voyelles longues figurent à juste titre : le premier ê représente les deux premiers éléments de la caractéristique W’Ef uya1; le second ê en représente le dernier a fondu avec la voyelle modale L Ainsi dans var-manêês «que tu méprises», comparé au sanscrit mânayês et au latin moneâs2, le second ê correspond à ¥ê sanscrit3 et à ¥â latin; le premier ê, au contraire, représente le ay sanscrit et le latin.
Gomme le gothique ne met jamais la diphthongue ai deux fois de suite, la deuxième personne habais «que tu aies» est moins bien conservée que la forme correspondante habêês en vieux haut-allemand. A la deuxième personne habais, le gothique ne distingue pas le subjonctif de l’indicatif.
S 713. Le lêt ou subjonctif sanscrit.
Le dialecte védique a un mode qui manque au sanscrit classique et qui, même dans les Védas, est assez faiblement représenté : les grammairiens indiens l’appellent Ut4. Lassen en a rapproché avec raison le subjonctif grec; de même, en effet, que Xéy-w-fÂev, Xéy-tj-re, Xéy-cà-yuxi, Xéy-ri-'vat, Ady-oj-vrai se distinguent seulement de Xéy-o-fjLsv, Xéy-s-Ts, Xéy-o-fxai, Xéy-s-Tcu, Xéy-o-vrat par l’allongement de la voyelle caractéristique, de même, dans le dialecte védique, nous avons les formes pâtnâ-ti «qu’il tombe» à côté de pdt-a-ti « il tombe», grh-yâ-ntâi «qu’ils soient pris» à côté de grh-yâ-ntê «ils sont pris». Il faut remarquer que ,dans la forme grh-yâ-ntâi, non-seulement la caractéristique est allongée, mais la diphthongue finale est ren-
1 À l’indicatif hab-ê-m, kab-é-s, les deux premiers éléments de SU aya sont seuls représentés (S 109% 6).
3 Moneâs est pour moneais (S 691).
3 On a vu (S 109% 6) que, dans les formes précrites comme cinlèni, le ay sanscrit se contracte également en ê.
4 Voyez S 628.
forcée. On observe un fait analogue aux premières personnes de l’impératif moyen, lesquelles, en général, tiennent de plus près au lêt qu’aux autres personnes de l’impératif : nous avons, par exemple, bibârâmahâi «que nous portions», à côté de l’indicatif bibrmdhê «nous portons». T)u reste, on se contente aussi, au lêt moyen, du seul allongement de la voyelle a qui précède les désinences personnelles en ê; exemple : mâddyâsp « que tu t’enivres », mâddyâtê « qu’il s’enivre »1.
S
§
S
ilkj
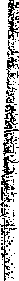
B
Remarque. — La première personne plurielle de l’impératif, en gothique, appartient au subjonctif. — L’identité de formation qu’on observe, en sanscrit, entre les premières personnes de l’impératif et le subjonctif576 577, nous conduit à la constatation d’un fait analogue en srotliiaue. Dans cette
G u A
f
langue, nous avons à la première personne du pluriel de l’impératif la forme hair-a-m «-que nous portions »578 = sanscrit tiâr-â-ma, zend bar-â-ma, grec Ç>ép-ù)-{jLev. Il est vrai qu’il n’y a aucune différence extérieure entre cette forme bair-a-m et la première personne du pluriel de l’indicatif. Mais, pour rendre un subjonctif grec \ Ulfilas n’aurait certainement pas employé ris-a-m (— sanscrit vâs-â-ma «que nous habitions»), si l’ancienne signification impérative ou subjonctive ne s’était pas conservée dans cette forme : il aurait plutôt eu recours au mode qui correspond au potentiel sanscrit et à l’optatif grec. C’est ainsi que, pour rendre le grec <pépsTs, il n’aurait pas (comme il l’a fait) mis bair-i-lh, lequel est extérieurement semblable à la seconde personne du pluriel de l’indicatif : il aurait probablement employé bair-ai-th = sanscrit Mr-ê-ta, grec (pép-oi-re.
fi
I
S 71 k. Imparfait dn lêt, en sanscrit et en zend.
En grec, Timparfait ne sort pas de l’indicatif; mais dans le sanscrit védique Timparfait possède aussi un lêt. Il en est de même pour le zend, qui fait un emploi très-fréquent de ce mode, et surtout à Timparfait, auquel il donne toutefois la signification d’un subjonctif présent. Nous avons, par exemple, IgAtdjîp car-â-d «qu’il aille», venant de Tindicatif car-a-d «il allait»; yjjjjâijy van-â-d «qu’il détruise», venant de Tindicatif mn-a-d «il détruisait»; pat-an-n «qu’ils volent»579;
bar-aii-n «qu’ils portent». Les formes de Tindicatif seraient pat-ë-n, bar-ë-n (pour pat-a-n, bar-a-n).
Dans les Védas nous avons : bavât «qu’il apporte», venant de Tindicatif âbarat «il apportait»: praéodayâi «qu’il excite», venant de Tindicatif âpracôdayat « il excitait » ; vadân « qu’ils disent», venant de Tindicatif dvadan «ils disaient».
$ 7i5. Parenté du subjonctif et du potentiel. — Nuance de signification
qui les distingue.
Je crois reconnaître que le potentiel et le précatif sanscrits, ainsi que les modes qui s’y rattachent dans les idiomes congénères, ont été formés d’après le principe du lêt ou subjonctif.
De même que le subjonctif allonge Va caractéristique (§ 713), le verbe auxiliaire qui est contenu dans le potentiel et le précatif a un â long devant les désinences personnelles; nous avons, par exemple, en sanscrit, dad-yat et dê-^yat, en zend daid'-yâd et dâ-yâd9 en grec $t§o-tri et So-fa. Je suppose que ces formes signifient proprement «qu’il veuille donner»; j’y vois, en quelque sorte, une variété plus respectueuse du lè\ ou subjonctif. Entre les deux modes, la nuance serait la même qu’entre «[je désire] qu’il veuille donner a et « [je désire] qu’il donne»1.
A l’appui de cette explication, nous rappellerons que le futur, qui prend le même verbe auxiliaire (S 670), a un a bref devant les désinences personnelles. C’est qu’en effet le futur àâ-s-yâtiénonce simplement un fait : il signifie «il veut donner» ou, plus exactement, «il veut être donnant». Le verbe auxiliaire « vouloir » n’est pas employé ici par déférence, mais pour marquer que l’action ne se fait pas présentement2.
S 716. Formation du lêt.
Nous venons de voir que, pour former le lêt ou subjonctif, le dialecte védique allonge l’a de l’indicatif : quand l’indicatif ne contient point d’a, le lêt en insère un. C’est ainsi qu’à l’aoriste Sût «il était» répond le subjonctif Buvat «qu’il soit» 3; à dkar4 «il fit» répond karal «qu’il fasse ». De la troisième formation de l’aoriste dérivent des formes de lêt telles que goéisat « qu’il favorise», pra... târisat «quïl étende», sâoiêat «qu’il engendre», mandisat «qu’il réjouisse»; dans une période plus ancienne de la langue, quand deux consonnes de suite pouvaient encore se trouver à la fin du mot, on a dû avoir à l’indicatif àgâsiêt, àtârist, dsâvisi, dmandist5. Le lêt correspondant provient donc de l’insertion d’un a entre la sifflante du verbe substantif et la désinence personnelle6.
1 On a vu plus haut (S 670) que dans la syllabe yâ de dadryft-t, fauteur reconnaît le verbe i «désirer, vouloir», qui, frappé du gouna, fait ya. — Tr.
* C’est une négation du présent, mais moins énergique que l’a privatif des prétérits augmentés (S 537 et 8Uiv*)*
:t L’augment étant supprimé, la forme en question perd son sens de prétérit; il eu est de même pour l’aoriste du potentiel et de l’impératif.
4 Pour âkart (S 96 ) ; c’est un aoriste de la cinquième formation, laquelle est plus fréquente dam les Védas que dans le sanscrit classique.
s Comparez les formes de pluriel et de duel comme âgôsiiva, àgâiiita. ü Voyez Abrégé de la grammaire sanscrite, 8 44s, et Benfey, Grammaire sans-
De cikêt-ti «il connaît» (racine kit, classe 3) vient cikêtati «qu’il connaisse». On a de même, en ancien perse, ahaliy * qu'il soit», en regard de astiy «il est» 1.
De l’aoriste, le dialecte védique tire aussi des subjonctifs ayant les désinences du présent, tels que karati «qu’il fasse»2, formé de âkar. II se contente même de joindre les désinences personnelles du présent au thème de l’aoriste; exemple : vivâcati « qu’il annonce », formé de vyavocat « il annonça » 3.
Remarque. ■—■ Le subjonctif latin correspond-il au lêt sanscrit? — Le subjonctif des trois dernières conjugaisons latines présente une certaine analogie avec le lêt védique et avec le mode correspondant en zend, ainsi qu’avec les premières personnes de l’impératif actif dans ces deux langues \ Ainsi fer-a-t (pourfer-â-t) ressemble beaucoup au védique Bar-â-t (S 71 A) «qu’il porte»6; de même, fcr-a-nt (pour fer-â-nt) s’accorde avec Bâr-â-n6 «qu’ils portent», et fcr-â-mus avec Bâr-â-ma «que nous portions». Mais ces analogies sont purement apparentes, si nous avons eu raison de rapporter le subjonctif latin au potentiel sanscrit (S 691 et suiv.)7. A l’appui de mon opinion qu’il s’est perdu un i après l’a. du subjonctif latin, et que cet a a été allongé par compensation, je rappellerai les datifs latins comme populoi Romanoi («S 177), devenus plus tard populo Romand. Par une rencontre fortuite avec le latin, l’ancien saxon, dont le subjonctif présent correspond d’ailleurs également au potentiel sanscrit, a supprimé l’i delà diphthongue ai crite développée, p. 365, où l’on trouve aussi le lêt osas «que tu sois», asat «qu’il soit», venant d’un ancien indicatif âs-s, âs-t. Le sanscrit, tel qu’il nous est parvenu, a, au lieu de ces dernières formes, r&w, âsit, védique du (S 53a ).
1 Inscription de Béhistoun, IV, 38* Le ^ s en ancien perse reste s devant un t; mais devant une voyelle il devient h.
2 Rig-véda, I, xlvi, 6.
3 Rig-véda, 1, cv, A. — Le vi de vivâcati est un préfixe.
4 On vient de voir (S 713) que ces personnes peuvent être rapportées au lêt.
h Au présent Bâr-â-tt. Comparez la forme patr-â-ti «qu’il tombe» (S 713 ).
* Rapprochez vad-a-n (S 71A ).
7 Pott (Recherches étymologiques, 1”édition, II, p. 6q5) etCurfius (Formation des temps et des modes, p. a6û ) sont d’une autre opinion.
et allongé 1 a précèdent1, ou bien il a contracté en ê les deux éléments delà diphthongue; on a, par exemple, bërâs ou bërês = sanscrit b'ârês (pour bmais^ vieux haut-allemand bëresf latinferas ou ferês^. Rappelons enfin qu’en latin le m de la première personne n est resté, sauf sum et inquam, que dans les formes secondaires (S 431) ; or, c’est à ces formes qu’appartient le potentiel sanscrit. Si done, feras, ferâmus, ferâtis correspondaient à (péprjs, Çépofpev, pépyre, au lieu de répondre, comme je le crois, à <pépot$, (pépotfxev, pépoiTs, nous ne devrions pas avoir à la première personne du singulier feram, mais plutôt fera ou fera, ou encore fero, comme au subjonctif grec on a Çépw.
L imparfait du let, a signification de présent, me paraît de formation purement sanscrite et zende : je le crois postérieur à l’époque où les langues euiopéennes se sont séparées des deux idiomes asiatiques. Le grec, qui surpasse ordinairement le sanscrit par la conservation plus parfaite des anciennes formes modales, ne présente aucune trace de ce temps. Je ne voudrais donc pas rapporter les subjonctifs latins tels que moneam, legam, audtam, a des imparfaits du lêt3. Il me paraît plus naturel de faire dériver tous les subjonctifs latins d une seule et même source, que de les rapporter, suivant la différence des conjugaisons, tantôt au potentiel sanscrit (optatif grec, subjonctif germanique, impératif slave), et tantôt au lêt sanscrit et zend (subjonctif grec)4.
IMPÉBATIF.
S 717. L’impératif sanscrit.
Ce mode ne se distingue de 1 indicatif que par les désinences personnelles, excepté à la première personne des trois nombres (S 7i3)5. Dans le sanscrit classique, l’impératif n’a d’autre temps que le présent.
1 La longue nest pas représentée dans l'écriture; mais Grimm écrit (et je ne Joute pas qu’il n’ait raison) d.
2 Ferês a été, par abus, employé en latin comme futur (8 693).
J Dans cette hypothèse, la forme correspondant à forain serait en sanscrit haram ; mais je n’ai pas encore rencontré de forme semblable.
4 On a vu (S 713, remarque) que la première personne du pluriel de l'impératif gothique se rapporte aussi au lêt sanscrit. Comparez S 726.
En d’autres termes, l’impératif n’a pas de caractère modal. — Tr.
Nous avons déjà traité des flexions de l’impératif1. Le duel a les désinences secondaires : il en est de meme pour le pluriel, excepté à la troisième personne. Nous avons, par exemple, Bdratâm « qu’ils portent tous deux », qui diffère seulement de l’imparfait dBaratâm « ils portaient tous deux » par l’absence de
l’augment.
En grec, la différence entre la désinence wv de l’impératif Çspéwv et la désinence t*v de l’imparfait èÿzplmv est inorganique çar •zcov et Ttfv se rapportent tous les deux a une seule et
même forme tâm*
S 718. Suppression de la désinence à la deuxième personne du singulier,
en sanscrit, en grec et en latin.
A la deuxième personne du singulier, il y a en sanscrit cette différence entre les verbes actifs de la première conjugaison principale et ceux de la seconde2, que les premiers ont perdu la désinence personnelle. Ainsi Bdr-a «porte» (= zend bar-a) na pas de flexion : Xa final est la voyelle caractéristique de la classe, à laquelle viennent au duel et au pluriel se joindre les désinences personnelles = (pép-e-TOv, Bdr-a-ta
= <pép-e-ts).
La perte de la désinence personnelle paraît fort ancienne, car en grec nous avons (pép-s (et non (pep-e-Oi) et en latin leg-e3, am-â, mon-ê, auà-%, lesquels sont privés aussi du signe delà
personne.
1 Voyez entre autres S é5o et suiv. et S &70.
2 On a vu que la première conjugaison principale correspond à la conjugaison grecque en aux quatre conjugaisons latines et à la conjugaison faible des langues germaniques. La deuxième conjugaison principale est représentée en grec par les verbes en fit,
3 L’e de tege est originairement identique avec l’t (pour a, S 109 , 1) de teg~i te. A la fin des mots, le latin préfère Ye à i’i : ainsi ie thème mari lait mare.
g 719. Deuxième personne de l impératil, en gothique. - Formes latines
et grecques en tof t«, nio, vtù) et tôle.
Dans les langues germaniques, les verbes forts, a la deuxieme personne de l’impératif, rejettent la voyelle caractéristique de la classe : ils se terminent donc par la dernière lettre de la racine1. Cependant, dans la plupart des cas, ils ne présentent pas la vraie forme de la racine, parce que la voyelle radicale, a 1 impératif comme au présent de l’indicatif, est tantôt affaiblie, tantôt frappée du gouna. Ainsi les racines gothiques band « lier » (= sanscrit band ), bug « plier 73 (= sanscrit Bug), bit «mordre» (= sanscrit Bid «fendre») font à l’impératif bind, biug, beit. De même, en sanscrit et en grec, le présent de 1 impératif garde les renforcements de l’indicatif présent ou, en general, des temps spéciaux : ainsi la racine sanscrite bud «savoir» fait à l’impératif bôda (pour bauda), la racine grecque <pvy fait (p&vys.
Les verbes faibles, dans les langues germaniques, gardent leur caractéristique (§ iog\ 6). Cependant, ceux qui, comme tamja, représentent par^a le caractère sanscrit aya, contractent ja en î580 581; exemple : tani-ei582 «dompte! » = sanscrit dam-aya, latin dom-â, grec Mp-ote. Dans la deuxième conjugaison faible, on a laig~ô «lèche!» en regard du causatif sanscrit leh-ayavenant de lih «lécher»; la diphthongue gothique 0, qui est une contraction pour a{y)a, représente Xâ des impératifs latins comme
liom-à (S 69, 1). Dans la troisième conjugaison faible, on a hab-ai k aie ! », tbah-ai « tais-toi 1 «, sil-ai ( même sens) en regard des formes latines bab-ê, tac-é, sil-e, dont 1 e est une contraction pour ai et représente le ay du sanscrit aya (§109 ,6).
A la deuxième personne du pluriel, tam-ji-th (pour tam-ja-th) répond au sanscrit dam-âya-ta, au latin dom-à-te, au grec Sap-âs-re. En gothique comme en grec, la deuxieme personne du pluriel est la même à l’impératif qu’à l’indicatif présent; au contraire, en sanscrit, nous avons à 1 impératif la desinence ta des formes secondaires, tandis que l’indicatif a la désinence ta des formes primaires : ainsi damâyata signifie « domptez »
et damâyata «vous domptez". En latin, on a à l’imperatit
JnmAia pt à l’indicatif domâtis : le premier représente 1 impératif
sanscrit damâyata; pour le second, il coïncide, quant a la forme, avec le sanscrit 4*ti|«l^ damiya'tas (gothique tamjats), qui est. la seconde personne duelle de l’indicatif présent ’.
Au temps appelé impératif futur2, nous avons en latin te (= grec rca) pour désinence de la deuxième et de la troisième personne ; le dialecte védique nous présente la forme correspondante tât (§ 470), qui sert pour la deuxième comme pour la troisième personne, et qui, comme on l’a déjà fait remarquer, s’est conservée le plus fidèlement en osque (hcitud, estid). Dans cette forme TTT\tât, l’expression de la personne est contenue
deux fois,
U en est de même, en latin, à la deuxième personne du pluriel tête, qui ferait supposer en sanscrit une forme «TTîT tâta, dont il n’y a pas d’exemple.
A la troisième personne du pluriel, on a en latin nlo, en grec vwv (iegmto = Xsybvrav); nous avons rapproché (§ 4?°) en sanscrit les formes moyennes en autant (Ç>epévtut> — bavantam t
! Voyez S fihh.
3 Voyez plus haut» page 67 » note 2. — Tr.
Mais on peut proposer encore une autre explication. De même quii y a en sanscrit des singuliers comme givatât « qu’il vive », il a pu y avoir des pluriels comme gîvantât (en latin vivuntô, § 4 70). Cette désinence ntât sera devenue en grec vt&, avec la suppression obligée de la dentale finale ; à son tour, vm sera devenu vtup, par l’addition d’un v inorganique583. Cette explication, à laquelle je donne maintenant la préférence, est confirmée par les formes doriennes en vrw, quoique même pour ce dialecte les impératifs en vtcûv soient plus fréquents dans les inscriptions que les impératifs en vtcû 584.
8 720. Impératif sanscrit en tu, nlu. — Forme correspondante en zend.
La désinence sanscrite tu, pluriel ntu, s explique par le thème pronominal «T ta : Ya s’est assourdi en u, tandis quau présent de l’indicatif et, en général, dans les formes primaires, Y a a pris le son de la voyelle la plus mince, c’est-à-dire de 1’#. Nous avnns donc les trois formes -ta, -tu, -ti. Le theme du pronom
interrogatif, même hors de composition, se présente aussi a
nous sous les trois formes ka, ku9 ki
En zend, Vu de l’impératif s’est quelquefois allongé, par
exemple dans la forme fréquemment employée mrautû
,qu’il dise». Vu est bref, au contraire, dans qaratu
* qu’il mange», vanhatu «quil revete».
8 721. Les impératifs zends en anuha.
En zend, à la deuxième personne du singulier, la désinence moyenne ma585, précédée d’un a, s’est presque toujours altérée en
anuha (pour anhva). Le v s’est vocalisé en u et est venu se placer devant le h; mais la nasale qui avait été insérée devant le h (§ 56a) est restée, quoique d’ordinaire le $ n, en sa qualité de nasale gutturale, ne se trouve qu’en combinaison immédiate avec h. On serait tenté de croire que le zend a fini par trouver trop incommode le groupe nhv, car presque partout où il devrait se rencontrer, il est remplacé par ^»>| nuh : c’est ainsi que nous avons vwanuhato — sanscrit vwasvatas « de
Vivasvat».
Comme exemples d’impératifs en anuha on peut citer1 : aiwi vastra yâonhayanuha 2 « revêts les habits » ; fra sasta snayanuha3 «lave-toi les mains»; â aiémahm yâéanuha4 «étale du bois».
On trouve encore hunvanuha à côté de hunvanha 5. Mais on a, au contraire, msanha «obéis», pour lequel il ne semble pas qu’il y ait de variante *
Remarque î . — L’impératif zend hunvanuha. — Dans l’exemple précité hunvanuha, ia racine »y» hu (= sanscrit ^ ss'} prend a la fois la carac- 586 584 585 587 588 589 590 téi’istique de la cinquième classe nu et la caractéristique a de la première; autrement, nous aurions à l’impératif hunuba (= sanscrit gÿot sttntelvd).
[1 reste à savoir quelle est, parmi les différentes racines sanscrites g su, celle que représente ici le zend ku. On peut hésiter entre le sens de (flouer, célébrer», qui est adopté par Nériosengh et Anquetil1, et celui de «exprimer [le suc] », que préfère Bumouf. La phrase : frâmahm hurwanuha qaretëê2 est traduite par Nériosengh : parisaiiskârahkuni Uâ-
danaya591 592 593. Cette explication est commentée par la glose suivante : m^vrx tFHPTÊT594 595 âhârârlan saninânaya «honore [moi] à cause de la nourriture» Anquetil rend le même passage par : «qui me mange en m’invoquant avec ardeur», et aux autres endroits où se présente la racine >o* hu596, il traduit toujours par «ayant invoqué et s’étant humilié»597. Mais, dun autre côte, il est certain que le sens «exprimer [le suc]», proposé parBurnouf, convient très-bien pour tous ces endroits, où il est question de la plante appelée, précisément d’après la même racine, hautna (== sanscrit rifrr soma).
Remarque 2. — Les impératifs grecs comme Xéyov, S/So<ro. — Des impératifs zends comme vîsanha «obéis» (S 721) on peut rapprocher, quoique, h première vue, ils ne leur ressemblent guère, les impératifs grecs comme Xéyov (pour Xéy-e-vo). En effet, la désinence <ro. laquelle est restée aux impératifs des verbes en {ju (S/So-tro), représente le ha zend, le sva
sanscrit; quant à la nasale insérée dans vîéanha, elle n’est qu'une addition inorganique (S 56a). Si nous supprimons cette nasale, nous aurons, par exemple, bar-a-îw (pour bar osa) = grec <pép-e-ero. D’après cette explication, hiho-trc est pour une ancienne forme SïSo-er/^o\
Mais il se présente encore une autre lîvpothèse, qui mérite d’être prise en considération. Les impératifs grecs comme Ç*pov (pour Çépsao), hi-%o<to sont identiques, sauf l’absence de l’augment, avec la seconde personne de l’imparfait. Or, nous avons vu qu’en sanscrit l’imparfait et l’aoriste peuvent remplacer, après la particule prohibitive ma, 1 impératif, soit en gardant, soit en rejetant l’augment; on a vu aussi (S M9) qu’en arménien la seconde personne du singulier de l’impératif (mi beres <rne porte pas») était originairement un imparfait. Il se pourrait donc que les impératifs grecs comme Xéyov, hihotro fussent sortis des formes correspondantes de l’imparfait, avec suppression de iaugment.
§ 729. Première personne de l’impératil, en sanscrit et en zend.
Au singulier comme au duel et au pluriel, la première personne de l’impératif se forme suivant un principe particulier, qui rappelle plutôt le subjonctif ou lêt que les autres personnes de l’impératif (§ 7*3). On insère un à devant les désinences personnelles; au moyen, les flexions qui à l’indicatif présent finissent en ê, allongent cette diphthongue en ai; dans la seconde conjugaison principale, le thème verbal prend la forme renforcée, qui d’ordinaire ne se trouve que devant les désinences faibles.
La première personne du singulier a ni pour flexion : le n est évidemment une altération pour m. Au moyen, ce n est supprimé en sanscrit; mais il est resté en zend : on a donc gp» ânê en regard du sanscrit âi. Nous avons déjà vu (§ 467) que le sanscrit supprime de même, au présent de l’indicatif moyen, le ni de la première personne, lequel s’est conservé en grec; le zend, qui s’est altéré de la même manière que le sanscrit à l’indica-
t
En sanscrit dat-svâ (pour da/ld-sva).
(if, a, au contraire, gardé la consonne à l’impératif. Il y a le même rapport entre jgpi» âne et l’actif *\m âni qu’entre le grec pat et l’actif \u.
Nous faisons suivre les premières personnes de l’impératif de la racine fin dois «haïr», mises en regard des personnes correspondantes de l’indicatif.
ACTIF.
MOYEN.
|
Indicatif. |
Impératif. |
Indicatif. |
Impératif. | |
|
Singulier. . |
dvêsmi |
dvês-â-ni598 |
J avise |
J A't A * ave sai |
|
Duel..... |
dvihâs |
dvês-â-va |
dvisvâhê m |
dvêê-â-vahâi • |
|
Pluriel.... |
dvismâs |
dvês-u-ma |
dvisimhê |
dvês-â-maliâi. |
Comme exemples de la première personne de l'impératif en zend, nous pouvons citer gan-â-ni (= sanscrit hdn-â-ni)
«je tuerai, je détruirai» 2 et kerënav-â-nê (= sanscrit
kni-dv-âi, pour karnav-â-nê) «je dois faire».
S 723, 1. La première personne de l’impératif dans les verbes sanscrits de la deuxième conjugaison principale.
Le verbe dvis, dont nous venons de donner les premières personnes de l’impératif, appartient à la seconde conjugaison principale; mais si l’on en rapproche un verbe de la première, par exemple tvü «briller» (classe 1), on verra qu’il présente exactement les mêmes formes. Comparez dvê'ê-â-ni, dvês-â-va. ivês-â-ma avec tvês-â-ni, tvés-â-va, tvêê-â-ma, et, au moyen, dvês-âi, dvês-â-vahâi, dvês-â-mahâi avec tvês-âi. tvês •a-vahat,
tvês-â-mahâi. ,€et entier accord nous amène à supposer qu’en sanscrit la seconde conjugaison principale n’a pas de première personne de l’impératif, absolument comme en grec les verbes en fit sont privés de subjonctif1. Je regarde l’a de dvês-â-ni comme identique avec l’d de tvês-â-ni, boi-â-ni, c’est-à-dire comme la voyelle caractéristique de la classe 599 600 601 602. Le verbe dviê a donc passé dans la première classe.
D’après le même principe, «être» (classe 9) fait âs-â-
ni, ds-â-va, âs-â-ma; ces formes supposent un thème verbal ma, absolument comme la racine vas «demeurer» (classe 1) tire du thème verbal vasa les formes vâs-â-ni, vds-â-va, vas-â-ma. C’est ainsi qu’en grec la racine h (la seule racine finissant par une consonne qui appartienne à la deuxième classe) tire d un theme élargi i<ro, èm le futur sa-o-fiou 3 et le subjonctif homérique et dorien ha (pour saco, qui est lui-même pour sa-ea-fit « sanscrit ds-â-ni, pour ds-â-mi). Au pluriel, on peut comparer le dorien ëa-fies (pour ëa-co-fiss)^, par contraction àfiss, avec le sanscrit âs-â-ma « que nous soyons ». En regard de la troisième personne du pluriel ë-oj-vrt603 (pour ëa-ca-vTi ), par contraction ëva, on devrait attendre en sanscrit une forme de lét ou de subjonctif
as-â-nti.
De la racine \i «aller» (classe 2), qui fait au présent ê-tni, i-vds, i-mds (= grec si-fit, ï-fiss), viennent les premières personnes de l’impératif dy-â-ni604, ây-â-va, ây-â-ma, qui sont for-mecs comme guy-a-ni, gay-a-va, gay-a-vtia (racine gi « vaincre 5?, classe 1 ). Sans le gouna et sans le changement de la voyelle t en semi-voyelle, nous aurions eu i-â-mi, %-â-va, %-â-ma, ce qui répondrait parfaitement au subjonctif grec t-a-fjLev l.
La septième classe sanscrite (S 109% 3) joint la voyelle caractéristique au thème élargi, c’est-à-dire renfermant la syllabe na : nous avons déjà dit que le lêt ou subjonctif préfère les formes les plus larges. On a donc, pour la racine yug, l’impératif tjunâg-â-ni «que je joigne», pluriel yumg-â-ma «que nous joignions», de même que pour la racine tyag «abandonner»
(classe 1) on a tydg-a-ni, tyâg-â-ma; les thèmes verbaux de ces formes sont yunaga, tyaga.
Les verbes de la cinquième et de la huitième classe frappent du gouna Yu de la caractéristique (S 109% 4), à laquelle vient se joindre la voyelle a de la première classe; exemples : strnâv-d-m «que je répande», pluriel $trndv-â-ma. Comparez, en grec, fflopvvcû, crlopvvGOfxev. En zend, nous trouvons pour cette classe de verbes 1 impératif actif kërënav-â-ni (moyen kërënav-â-nê) «je dois faire». On y peut joindre la deuxième personne du subjonctif hërënav-â-hi «facias», ainsi que la troisième personne de 1 imparfait du même mode kërënav-â~d «il doit faire». Comparez encore la deuxième personne de l’impératif kërënav-a « fais » 605 606 avec l’indicatif à double caractéristique kërë-nav-ô 607 « tu faisais » (S 5i9).
Les verbes sanscrits de la troisième classe ajoutent au thème fort et redoublé Va caractéristique de la première classe, et ils
allongent cet «. Ainsi le verbe Bar, Br fait biBdr-â-ni1, biBdr-à-va, biBdr-â-ma; biBâr-âi, biBdr-â-vahm, biBdr-â-mahm. En faisant abstraction de la syllabe réduplicative, nous arrivons à dos formes qui appartiendraient à la première classe; ainsi Bar, Br. conjugué d’après la première classe, fait Bâr-â-ni (présent do l’indicatif Bâr-â-mi), pluriel Bdr-â-ma = grec (pép-œ-fxsv, gothique bair-a-m.
Dans les verbes de la neuvième classe, lesquels, aux formes fortes, s’adjoignent la syllabe nd2, il est impossible de constater l’allongement; en effet, yu-nâ-â se contracte en yu-nâ. Conséquemment on a yw-na-ni «je dois lier», duel yu-na-va, pluriel yu-nâ-ma; moyen yu-nâi, yu-nâ-vahâi, yu~nâ~imhâi (pour yu-nâ-â-ni, etc.). De même, en zend, nous avons le moyen përë-nâ-nê «je dois détruire»3.
Les racines sanscrites en â appartenant à la deuxième et à la troisième classe contractent également â + â en â; exemple : dàdâni «je dois donner», pour dadââni. Au pluriel, dddàma, pour dadââma, répond à la forme homérique StS&iisv, pour StScoœfisv
OU StSoùJfJLSV^,
§723, 2. La première personne de l’impératif dans les verbes sanscrits de la première conjugaison principale. — Impératifs zends en uni, ânê.
Les verbes sanscrits de la première conjugaison principale allongent en â l’a final de leur thème, de même que les verbes grecs correspondants allongent leur 0 en on a, par exemple, a la première personne plurielle de l’actif, Bdr-â-ma, hrs-yâ-ma,
1 A la différence des autres verbes de la troisième classe, b'ar, Ur, dans les temps spéciaux, prend l’accent sur la syllabe radicale, et non sur la syllabe réduplicativc.
9 Ni dans les formes pures ou faibles. .
3 Voyez Burnouf, Commentaire sur le Yaçna. p. 53o et suiv. Au sujet de la désinence ne, comparez S 732.
4 Comparez, dans Homère, l’aoriste non contracté Awoftev (pour êéwuev) et la troisième personne du singulier S&yatv.
dam-dyâ-ma en regard des formes grecques (pép-Gt-pev, yjxip-ro~ ftsv, ou SafjL-d^ùJ-fisv608. Mais comme le sanscrit opère
le même allongement à la première personne de l’indicatif présent2, il n’y a pas, dans cette langue, une opposition aussi marquée entre l’indicatif et l’impératif qu’en grec; ainsi (pép-v-comparé à <pép-o-psv, fait mieux ressortir l’expression modale que le sanscrit et le zend Bàr-â-ma, bar-â-ma, comparés à Mr-â-mas, bar-â-maki.
Il est probable que l’allongement de l’a opéré par le sanscrit à la première personne du présent de l’indicatif appartient à une période relativement récente, quoique pourtant antérieure à la séparation du sanscrit et du zend. En effet, nous trouvons en grec (pép-o-fisv, en ancien slave ber-e-mü 3, en latin fer-i-mus. Je suppose que dans Bdr-â-mi, Bdr-â-vas, Bdr-â-mas l’allongement de Va est purement euphonique, et je l’attribue à l’influence rétroactive des semi-voyelles v et ni4. Au contraire, dans les formes d’impératif Bar-â-ni, 'Bdr-â-va, Bdr-â-ma, je regarde l’allongement comme ayant une valeur grammaticale, c’est-à-dire comme servant à marquer le mode. Si nous avions conservé la conjugaison complète du subjonctif ou lêt, je ne doute pas que nous n’eussions trouvé le même allongement à toutes les personnes des trois nombres de l’actif et du moyen ; nous avons vu plus haut pat-â-ti «qu’il tombe» en regard de pdt-a-ti «il tombe », et en zend van-â-hi « que tu détruises » en regard de van-a-hi «tu détruis». Le sanscrit ne nous a point présenté jusqu’à ce jour de formes duelles comme Bar-d-tns, Bar-à-tas en
regard du grec (pip-y-iov 9 (pép-tj-rov, ni de formes plurielles comme Sâr-â-ta en regard du grec (pép-ti-Ts.
Je fais encore suivre quelques exemples d’impératifs zends à la première personne, lesquels, comme l’impératif gan-â-ni «je tuerai» (S 722), sont employés dans le sens du futur : vîsânê «j’obéirai »1 : varëdhyêni (§ 62) «je ferai
grandir»; frahârayênê «je ferai marcher»2;
daiâni «je donnerai»3; q**»)^** â-frînâni «je bénirai».
S 724. De plusieurs formes zendes en ai.
Outre la désinence moyenne ânê, qui est mieux conservée que la forme sanscrite correspondante, le zend a aussi une forme mutilée ai, dont toutefois il fait rarement usage. Comme exemple on peut citer visai; cette forme revient sept fois dans la
phrase osent visât9 au IVe chapitre du Vispered. Il est vrai qu Anquetil traduit par «j’obéis » et que l’impératif âétâya « apporte » 4 qui précède semble appeler un présent de l’indicatif ; en l’absence de passages plus concluants, on serait donc en droit de croire que viiâi est simplement une forme plus énergique pour le présent de l’indicatif vise.
Eugène Burnouf voit une première personne de l’impératif dans la forme yasâi, qui revient plusieurs fois au
xxuc chapitre du Vendidad5. Mais Anquetil traduit yasâi par
1 Vendidad-Sâdé, page 12 4 : ftjiua^lp ftp asëm te vUânê «je t’obéirai».
2 Vendidad-Sâdé, page 82 : ftlft»*^*,0'*^ tfty* 100* ^
urvânëm vahistèm ahûm frahârayênê «je ferai aller son âme au séjour excellent».
3 Vendidad-Sâdé, farçjard xxii. — Au sujet du i t tenant la place d’un voyez S 637, remarque. Au sujet du tf zend remplaçant un ancien d, voyez S 3c> Par suite de ces permutations, datâm «je dois donner, je donnerai» est devenu identique, dans sa forme, avec le daiâni (— ^TTFT dadâm «je dois poser, je dois faire») renfermé dans le composé yaui-datâm (S 687).
* Littéralement «fais venir» ; c’est le causatif de été «être debout», avec la préposition â.
5 Commentaire mr le Yaçna, p. âq5.
* rendez hommage », et le contexte exige en effet la deuxième personne, car Ormuzd adresse à Zoroastre Tordre de Thonorer1. Je ne crois donc pas qu’il y ait lieu de mettre les mots yasâi, etc. dans la bouche de Zoroastre, comme le fait Burnouf. Je vois aujourd’hui 609 610 dans yasâi un subjonctif ou lêt; la forme complète serait yasâhi611. Gomme exemples de formes mutilées de la même façon on peut citer encore vanâi «frapperas-tu, veux-tu frapper?», apa-yasâi «veux-tu détruire?»612 613, vindâi «obtiens», ava-gasâi «va».
Dans ces formes en âi, la consonne de la désinence personnelle a été supprimée, tant à la première qu’à la deuxième personne. Je rappellerai à ce sujet le grec (pépst, pour (pépert = sanscrit Bârati; St Soi, pour SiSoQt (S 456); fàpy = sanscrit Mrasê, gothique bairasa (§ 466). Mentionnons aussi les formes prâcrites comme 3T5FÇ Bandi, pour Ban-a-hi «parle» (S 456), ainsi que les formes espagnoles comme cantais, pour cantatis. Au reste, le zend a conservé à la seconde personne du subjonctif des exemples de la désinence complète en alu : ils sont meme plus nombreux que les formes en âi. On peut citer avi... vasâhi0 «conduis [l’eau]», upa... vasâhi (même sens), upa... fra-sayayahi « déverse », fra-frâvayâhi « fais couler » 614.
S 706. Emplois divers de la première personne de l’impératif, en zend.
Non-seulement la première personne de l’impératif, en zend, peut être employée dans le sens de l’indicatif futur, mais elle peut aussi remplacer le subjonctif, quand elle est precedee de la conjonction yata «que». Exemples :
*|X**^^.*J yata asëm bandayêni s que je lie»1,
uta büstëw vâiayêni «et que je frappe [1m] lié», «p> uta bastëm upanayêni «et que j’emmène [lui] frappé». Burnouf établit entre l’emploi des formes en âni2 et celui des formes en ânê 3 une différence que je ne crois pas fondée : selon lui, les formes en âni seraient usitées tantôt dans le sens de l’impératif, tantôt dans le sens du potentiel; quant aux formes en ânê, il nie quelles aient jamais la signification de l’impératif, et ce sont les formes en ai qu il regarde comme les seules vraies formes de la première personne de l’impératif moyen4. Mais nous avons gayasânê qui signifie «je dois sacrifier» et qui a le sens impératif, autant du moins que peut l’avoir la première personne. D’un autre coté, visai (8 7 ai) est plutôt, quant au sens, un présent de l’indicatif, et y asai vient d’être expliqué comme une seconde personne du subjonctif615 616.
au pluriel. Ainsi visam1 «simus» répond au sanscrit vasâma « habitemus »617 618. Comme les désinences sanscrites mas et ma sont l’une et l’autre représentées en gothique par un simple m619, l’impératif visam se confond avec le présent de l’indicatif visam « nous sommes».
On a déjà fait observer (SS 677 et 679) que l’impératif, en slave et en lithuanien, doit être rapporté, quant à son origine, à un autre mode.
Je fais suivre le tableau des formes dont il vient d’être traité.
|
Sanscrit. |
Zend. |
Grec. |
Latia. |
Gothique. | |
|
inpers. sing. act. |
ïum-a-ni « |
gan-ârni | |||
|
le r A » bar-a-m |
bar-â-ni620 | ||||
|
1” pers. sing. m. |
karâv-âi |
karav-â-nê | |||
|
b'dr-âi |
bar-â-nê | ||||
|
ir* pers. piur. act. |
Mr-â-ma |
bar-â-ma |
Ç>ép-co-{iev |
***** |
baîr-a-m |
|
2* pers. sing. act. |
• |
das-diù • |
♦ * * « * • | ||
|
ê-dV |
t<T~0l |
• ■ * « 0 |
m • «• ■ • « | ||
|
b'âr-a |
bar-a |
Çép-s |
hait | ||
|
vâk-a « |
vas-a ■ |
êx-s |
veh-e |
vig |
2* pers. sing. m.
2* pers. duel act. 2e pers. plur. act.
2* pers. plur. m. 3* pers. sing. act.
3e pers. duel act. 3* pers. plur. act.
Sanscrit. Zend. Grec. Latin. Gothique.
v âh-ortât1 ................veh-i-to ......
dat-sva ....... - 8/S(Hiro ..... ......
bâr-a-sva bar-an-u-ha624 625 626 <pèpov (de...........
(psp-s-ao)
bâr-a-tam ........ (pép-s-Tov ..... bair-arts
bâr-a-ta bar-a4a (pép-s^re ..... bair-i-th
bibr-tâ ................f&'-te ......
vâk-a-tn vas-a-ta é%-e-rs veh-i-te vtg-i-th
Bâr-Ordvam bar-a-dwëm <pép-s-adz ...........
v âs-a-tu vanh-a-iu ...................
vâh-a-tât ....... . è%-é-Tù) veh-i-to ......
bâr-a-tâm ........ (psp-é-rcov ..........
bâr-a-ntu bar-a-ntu? ..................
§ 727. Aoristes premiers de l’impératif, dans le dialecte védique,
en grec et en arménien.
Dans le dialecte védique et en zend, on trouve des formes d’impératif qui répondent aux impératifs aoristes grecs. En renonçant à l’augment, qui est la véritable expression du passé, elles ont du même coup perdu la signification de prétérit. Nous avons, par exemple, Bûsa627 «sois» ou « deviens » qui répond à l’aoriste premier (pv-aov.
Si le v de la désinence crov est organique, on peut le regarder comme tenant la place d’un ancien $ 628, qui lui-même provient d’un 6\ exemple : Sos, pour S66i. La forme primitive serait donc -aaô*, qui aurait fait -er«s, puis -erov9 avec changement de l’a en 0 à cause de la nasale (S 109% 1). Dans cette hypothèse, le
v de TVTi-ao-v représenterait la désinence personnelle, qui s’est, au contraire, perdue dans le védique bû-sa (pour bû-sa-dï)1.
Au moyen, crotBt devrait nous donner une forme , comme Tt^aT&j donne tvyf/aurBcj, et comme tuipctTe donne rml/aa-ôe629 630. Par la suppression de <70, on arrive à la forme ruypctt, qui présente une ressemblance fortuite avec l’infinitif aoriste actif, de même qu’en latin ama-re k sois aimé » est devenu extérieurement sem blable à l’infinitif actif631. La mutilation de l’impératif 'zvit-crac'Bt en TU7r-<7at ne serait pas beaucoup plus forte que celle de l’in- ; dicatif èrvTT-cra-cro en ètum-aco.
Si l’on fait abstraction de la désinence, les formes comme TUTT-o’ût—T<y s’accordent avec le védique nê-sa-îu « qu’il conduise», cité par Pânini632. A la deuxième personne du duel, <pv-(xol'zqv est très-bien représenté par Wiïï*r bâsatam633. A la troisième personne du pluriel, les formes comme \v-<rd-vtwv ont un pendant, en ce qui concerne la syllabe exprimant l’aoriste, dans 3ft^J srô-éa-ntu 634 « qu’ils entendent ».
L'arménien a perdu l’ancien présent de l’impératif, tel qu’il est usité en sanscrit et en zend; il l’a partout remplacé par l’impératif aoriste635, excepté quand il emploie l’impératif prohibitif dont il a déjà été question (§ 449). Suivant que l’indicatil prend l’aoriste premier ou l’aoriste second, l’impératif prend l’une
ou l’autre de ces formes1 Mais l’impératif arménien n’a gardé que la seconde personne des deux nombres Celle du pluriel est la mieux conservée; exemple : npumj^ or$-azê~q «chassez», dont le £ é s’explique très-probablement par le même principe que celui de ber-ê-q «vous portez» (§ 44g). Au contraire, l’aoriste indicatif garde IV de la première personne du singulier et de la troisième personne du pluriel : on a, par exemple, ors-azi-q «vous chassâtes», comme on a ors-azi «je chassai», ors-azi-n «ils chassèrent». Le sanscrit, dans ces deux formes, nous présente un a; il fait âkâm-aya~ta «vous aimâtes», kâm-dya-ta «aimez» (S i83b, a). Le singulier, à l’impératif aoriste premier, a perdu en arménien son z, ainsi que la voyelle qui l'accompagnait2 : les verbes de la deuxième conjugaison finissent en a (orsa «chasse! »), de sorte qu’à prendre ces formes isolément, on pourrait y voir des impératifs présents et les rapprocher des formes latines telles que ama. Comme exemple d’un aoriste second de l’impératif, nous pouvons citer ar «reçois», pluriel arêq; le présent de l’indicatif est ar-nu-m (S 4g6), l’aoriste de l’indicatif afi «je reçus». Citons encore l’impératif du verbe substantif bp er «sois», dont le r représente l’ancien s radical3. Au pluriel ê-q, le r a disparu tout à fait, comme dans la personne correspondante du présent de l’indicatif. A côté de ê-q «soyez», il y a une forme plus complète hpni.jp er-u-q, dont la voyelle de liaison u est probablement l’affaiblissement d’un ancien a, comme au futur ta-iu-q «dabimus» s= sanscrit dê-yâ-sma, grec So-h-pev (S 183 b, 2).
1 Sur l'aoriste premier, dont nous avons ramené ie g z au ^ y sanscrit des verbes de la dixième classe, voyez S i83b, 2. Sur l'aoriste second, voyez SS 573 et 576.
s H faut excepter la quatrième conjugaison ou conjugaison passive, où nous avons, par exemple, JcSseaz «parie» (présent Ués-i-m «je parie»), Uâsezai (prononcez Uôsezé) «je pariai».
a Comparez l'imparfait êr «il était» (S î83h, 2).
S 728. Aoristes seconds de l’impératif, en zend et dans le dialecte védique.
En zend, il ne s’est pas trouvé jusqu’à présent d’impératifs correspondant, comme le védique Wf Bâêa, aux aoristes premiers de l’impératif grec.
Mais on a dâi-dî « donne » qui s’accorde avec l’aoriste
second S6-s (pour $0-61), dâta « donnez?)1 qui s’accorde
avec Sêts, et dâ-ta «faites ?? (dans le composé yauêdâta «purifiez ??) qui répond à Oé^tz. Je crois reconnaître un impératif moyen de la cinquième formation de l’aoriste dans dâonhâ « donne ??,
que je serais tenté de rapprocher du sanscrit dâ-sva,, du grec Sô-o-o 2. Sur la désinence nha (plus souvent nuha) = sanscrit sva, voyez S 721.
Dans le dialecte védique, les formes correspondant à l’aoriste second de l’impératif grec sont très-nombreuses à l’actif. On a, par exemple : srudl « écoute ! ?? = xXvdt3, venant de srnô'mi4 (racine sru, classe 5); éag-di «peux!??, venant de saknomi (racine êak, classe 5 ) ; pûr-tti « remplis ! », venant de pi[parmi (racine par, pf, classe 3 ). L’impératif Bû-tu « qu’il soit ?? est formé comme âBût «il fut??5. Les impératifs comme mumugdi ^ délivre ! » (racine
1 Vendidad-Sâdé, p. 226. J'écris data au lieu de data, parce que cette forme est empruntée à la partie du Yaçna où l’a final est toujours allongé.
1 Vendidad-Sâdé, p. a a s. Le sens de dâonhâ n'est pas encore clairement établi : il faut attendre la traduction de Nériosengh. [Nériosengh traduit par karômi : c’est une première personne du futur. — Tr. ]
3 Tant qu’on n’aura pas trouvé un présent érâmi (deuxième classe), je serai très-
porté à considérer les formes âsravam «j’entendis», asrot «il entendit», comme des aoristes de la cinquième formation, avecgouna de lu radical. Dans le grec xAù0i, nous avons l’allongement de la voyelle radicale, ainsi que dans dsfcpüfu, où l’v correspond à un au sanscrit. De même encore à l’aoriste védique àkar «il fit», âkaram «je fis», on trouve la forme pleine de la racine, tandis qu’à l’impératif krd'i «fais» on a la forme abrégée. .
4 Ce verbe est irrégulier déns sa conjugaison.
5 Aoriste de la cinquième formation, § 673.
mue, troisième personne mumâktu) ressemblent beaucoup aux impératifs grecs comme xéxpaxOt. Mais il n’est pas douteux que les impératifs sanscrits mumugd'i, mumâktu n’appartiennent à l’aoriste : nous avons de même, à l’aoriste indicatif, âmumuktam. Mumugii est avec srudi dans le même rapport que les aoristes de la septième formation (§ 879) avec ceux de la sixième
(§ 5J1.
Dans vâvrdasva « grandis ! »636 637 nous avons peut-être un
impératif moyen de la septième formation de l’aoriste; il serait alors pour vavrdasva. C’est ainsi que mrg fait à l’aoriste indicatif actif mmmrgam. L’allongement de la syllabe réduplicative serait bien mieux justifié ici (S 580) qu’au parfait de l’indicatif vâvrde 638. On pourrait objecter qu’en regard de vavrdasva, considéré comme aoriste, il ne se trouve pas d’indicatif de la même formation; mais, en regard des impératifs aoristes précités (S 797) Bûêa, BusaUim, nêsatu, srôsantu, on ne trouve pas non plus d’indicatifs comme dBûsarn, dnêêam, dérôsam.
a r aoriste dvâéam (§ 58s) se rattache l’impératif védique sah-vôcâvahâi (première personne duelle du moyen)639.
S 799. Futur de l'impératif, en sanscrit et en arménien.
Le futur à auxiliaire de l’impératif a laissé des traces dans le sanscrit classique. Toutefois, le petit nombre d’exemples constatés jusqu’à présent appartient sans exception à la deuxième personne plurielle du moyen; ce sont : prdsavîsya-
dvarn1 «procréez!», Mfabavisyàdvam 2 «soyez» et vêtsyddvam3 «trouvez! obtenez!». J’ai supposé autrefois que la forme sahvakêyata4 était un impératif futur actif (deuxième personne du pluriel). Mais, par le sens du contexte, je me suis assuré depuis qu’au lieu de sahvakêyata, que Stenzler
traduit par « alloquimini », il faut lire sahrakêata «arcete»5.
En arménien, le futur de l’impératif est presque partout identique avec celui de l’indicatif (S 183\ a). Remarquons seulement qu’à la deuxième personne du singulier, outre la forme ze-s (= sanscrit yâ-$ du précatif), on a aussi une forme fkftgi^r ; le r remplace le s de la deuxième personne, et le£ g, sous l’influence de l’i suivant, a pris la place du g z6; on a, par conséquent, sires-gi-r «aime» à côté de sires-ze-s «amabis» et «ama ».
1 Bhagavad-Gltâ, III, îo. '
a Mahâbhârata, III, vers 14396. Râmâyana, éd. Schlegel, I, xxix, s5.
3 Mahâbhârata, 1, 11 î 1.
4 Stenzler, Brahma-vâivarta-purâfii specimen, I, 35.
5 H faut observer que dans les manuscrits d’écriture bengalie, et notamment dans celui dont s’est servi Stenzler (voyez sa remarque, p. 10), il est souvent impossible de distinguer le r du v. Le ^ ÿ, après le ^ ké, est une correction de Stenzler. Le sens «alloquimini» ne convient pas dans le contexte, au lieu que «arcete principem» s’accorde avec le sens du vers précédent. Le vers 3 a du même ouvrage nous présente une forme remarquable au point de vue de la syntaxe; c’est l’impératif brûtâ employé comme représentant du subjonctif et régi par yâdi «si» : yadi satyam brûtâ «si vous dites la vérité». Au cinquième livre du Mabâbbârata, on a la deuxième personne plurielle de l’impératif moyen prayaccadvam régie par cet «si» : nacét praya-cüadvam amitra^âünô yud'iétirasyâ ’néam ab'îpsitaii svakam «msi detis hostium inter-fectori Yuiïiétirœ partem petitam suam». Dans le Rig-véda (I, xxvn, 19), nous trouvons après yâdi la première personne plurielle de l’impératif ou du lèt : yadi mknavâma «si nous pouvons».
b II en est de même à la deuxième personne du pluriel de l’indicatif futur. Voyez plus haut, t. I, p. 606 et suiv.
CONDITIONNEL.
S 730. Origine du conditionnel sanscrit.
si r on considère la forme du conditionnel sanscrit, on voit qu’il est avec le futur à auxiliaire dans le même rapport que l’imparfait avec le présent : en d’autres termes, la racine prend l’augment, et les désinences secondaires remplacent les désinences primaires. En regard de dâsyâmi «je donnerai», on a donc âdâsyam «je donnerais» ou «j’aurais donné».
Contrairement à une opinion autrefois exprimée par moi, je serais porté aujourd’hui à faire venir le conditionnel du futur à auxiliaire : il ne serait donc pas nécessaire d’admettre pour le verbe substantif une ancienne forme tombée en désuétude âsyam «je serais» ou «j’aurais été». Quand même une telle forme aurait existé, on y pourrait voir un dérivé du futur asyâmi640 «je serai», comme âdâsyam dérive de dâsyâmi.
Aucune langue de l’Europe ne nous présente rien d’analogue au mode en question; on est donc amené à supposer qu’il est d’origine relativement récente. La forme qui ressemble le plus au conditionnel sanscrit, c’est l’imparfait du subjonctif latin. Mais on a vu (S 707) qu’il est lui-même de formation secondaire et appartient en propre à la langue latine. Comparez, par exemple, da~rem (pour dâ-sem, qui est lui-même pour dâ~sam) avec â-dâ-syam.
S 781. Emploi du conditionnel sanscrit.
Au lieu du conditionnel, le sanscrit, dans sa plus ancienne période, se sert ordinairement du potentiel. En général, l’emploi du conditionnel est assez rare. Nous en donnerons donc ici quelques exemples :
yadi na pranayêd râgâ dandan dandyêsv atandritak sûlê matsyân ivâ ’pakéyan durhalân balavaitarâh1 «Si non infligeret rex pœnam puniendis indefessus, veru pisces quasi coquerent infirmos firmiores. »
Nous avons ici le conditionnel; mais à sa suite nous trouvons quatre potentiels, quoique la relation reste exactement la même. II est vrai que le scoliaste les explique par des conditionnels, savoir : adyat «il mangerait» par dïïâdiêyat, dva-liliyât «il lécherait» par cwalêkêyat, syât «il serait» par diEavisynt et pra-vartêta « il deviendrait » par prâvartisyat.
Nous lisons dans le Mahâbhârata 641 642 :
vrginan ht Bavêt kirïcid yadi karnasya pâriiva nâ ’smâi hy astrâni divyâni prâdâsyad BrgunandanaK «Car si quelque chose de fautif se trouvait en Karna, ô prince! le fils de Bhrgu ne lui aurait pas donné les armes divines. »
Le conditionnel peut se trouver à la fois dans la proposition antécédente et dans la proposition conséquente. C’est ce que nous voyons par l’exemple suivant, où la première fois le conditionnel a le sens d’un plus-que-parfait du subjonctif : nacêd araksisya 643 tmatî ganam Bayâd dtriéaMir êvam baliBiK prapîditam | îatâ Bavisyad dvisatâm pïamédanam644. «Si tu n’avais pas délivré du péril cette troupe pressée par des ennemis redoutables, elle serait la joie des ennemis. »
On trouve de même dans le Nâisada-carita 645 :
api sa vagram adâsyata cêt tadâ tvadisuBir vyadaliêyad asâv api
«Quand il [Brahma] t’aurait donné [pour but] sa massue, elle aurait été fendue elle-même par tes flèches. »
VERBES DÉRIVÉS.
S 73a. Des verbes passifs, causatifs, désidératifs et intensifs.
Dans l’acception rigoureuse du mot, l’expression «verbes dérivés » ne convient en sanscrit qu’aux seuls verbes dénominatifs. En effet, parmi les dix classes de verbes appelés primitifs, il n y a véritablement que ceux de la seconde classe646 qui méritent ce nom : les autres ne sont pas plus près de la racine que ne le sont les verbes passifs, causatifs, désidératifs'et intensifs. Il y a d’ailleurs identité, si l’on fait abstraction de l’accent, entre la forme du passif et celle du moyen de la quatrième classe; entre le causatif et les verbes de la dixième classe; entre l’intensif, quand il unit immédiatement les désinences personnelles à la racine, et les verbes de la troisième classe2. On serait donc autorisé à dire que le sanscrit possède en tout douze classes de verbes : les intensifs composeraient la onzième et les désidératifs la douzième (ou vice versa); on ferait rentrer les verbes passifs parmi les verbes moyens de la quatrième classe, tandis que les verbes causatifs seraient assignés à la dixième.
On ne peut nier toutefois que si l’on a égard au sens et à l’âge des verbes appelés «dérivés», ils doivent être subordonnés à ceux qui expriment simplement l’idée verbale, accompagnée des notions accessoires de personne, de temps et de mode : ils appartiennent à une époque postérieure et sont sortis de ceux-là. Il a fallu qu’il existât un verbe signifiant simplement « j’entends », avant qu’on pût avoir un verbe signifiant «je fais entendre», ou «je désire entendre», ou «je suis entendu». Encore que srâvdyâmt «je fais entendre», sûsrûsâmi «je désire entendre», srûyê' «je suis entendu» s’expliquent plus facilement par la racine sru que par le thème srnu1 (contraction pour srunu), on peut néanmoins regarder srunu comme la forme fondamentale d’oii sont sortis ces verbes dérivés et secondaires; car devant la marque du causatif, du désidératif ou du passif, la syllabe caractéristique nu a pu tomber, comme tombe la caractéristique ay des verbes eausatifs, quand ils sont mis au passif, devant la syllabe ya qui est la marque de cette voix647. Si, par le fait, les verbes dérivés ont la racine pure pour point de départ, cela vient de ce que les verbes primitifs, dont ils sont le produit, ont été débarrassés de tous les accessoires qui ne servent point à l’expression de l’idée marquée par la racine. On comprend, en effet, que, sans cette suppression, la forme dérivée eût été chargée outre mesure. C’est ainsi que nous avons vu certains comparatifs et superlatifs venir, non pas du thème complet du positif, mais d’un thème mutilé et dépouillé de son suffixe648.
PASSIF.
S 783. Formation du passif sanscrit.
Nous examinerons successivement les diverses formations de verbes dérivés. Nous commencerons par le passif.
1 Le verbe dru (cinquième classe) fait au présent de l’indicatif êrnffmi « j’entends n (contraction pour érunâmi).
3 Nous avons, par exemple, en regard du causatif érâv-âya-ti «il fait entendre», le passif drâv-yâ-tê (pour drâv-ay-yate) «il est fait entendre».
3 Voyez $998*.
En sanscrit, le passif, dans les temps spéciaux, est marqué par la syllabe yà, qui reçoit l'accent tonique, et qui vient se placer après la racine : les désinences personnelles sont celles du moyen. La flexion est tout à fait la même que pour les verbes moyens de la quatrième classeavec cette seule différence que laccent doit être reporté sur la deuxième syllabe2.
Je me contenterai de donner ici la troisième personne du singulier et du pluriel des verbes suivants : bui (classe i) «savoir» (gothique ana-bud «commander»); tud (classe 6) «frapper» (latin tud, tundo); vas (classe a) «se vêtir» (gothique vasja «je revêts» = causatif sanscrit vâsdyâmi); Bar, Br (classe 3) «porter»; yug (classe 7} «unir» (latin jug, grec star, str, str (classe 5) «répandre, couvrir»; prî (classe q) «réjouir, aimer». En face du passif, je mets la forme correspondante du moyen 3.
TROISIEME PERSOHNB BD SINGULIER. TROISIEME PERSONNE DD PLURIEL.
|
Racine. |
Passif. |
Moyen. |
Passif. |
Moyen. |
|
bud (classe i ) |
bud-yâr-lê |
bod-a-tê |
bud-yâ-ntê |
bôd-a-ntê |
|
tud (classe 6) |
tud-yâ-té |
tud-ârtê * |
tud-yérntê |
tud-û-ntê |
|
vas (classe 3) |
vas-yârtê |
vas-te |
vas-yâ-ntê |
r.A 4 vas-ate * |
|
Bar (Br) (classe 3) |
Bri-yâ-te |
biBr-tê' • |
Bri-yâ-ntê |
biBr-atê |
|
yug (classe 7) |
yug-yértê |
yunk-tê' |
yug-yâ-ntê |
yung-àtè |
|
star (str) (classe 5 ) |
star-yà-tè |
str-nu-ie » ■ |
star-yàriUê |
str~nv-âtê • • |
|
prî (classe 9) |
pn-yàrtê |
A 4 .A* prt-ni-te |
prî-yâ-ntê |
prî-nu-tê. |
Remarque. — Passif des racines finissant en ar, r. — Les racines en ar qui, à l’actif et au moyen, contractent cette syllabe en r dans les formes 649 647 648 650
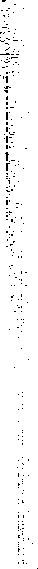
*\
!'
pures ou. légères, prennent au passif la syllabe ri, si elles commencent par une seule consonne ; ainsi Bar fait Bri-yâ-tê. Si, au contraire, elles commencent par deux consonnes, elles gardent ar : ainsi star fait star-yâ-tê. Je regarde la syllabe ri comme une métathèse pour ir, qui lui-même est, à ce que je crois, un affaiblissement de la forme primitive ar.
C est grâce à la protection des deux consonnes initiales que les verbes comme star ont maintenu leur ancienne forme. On peut rapprocher, à ce sujet, ce qui a été dit des impératifs comme âpnukï « obtiens! », comparés aux impératifs comme ctnû « assemble !» (§ &5i). Je crois découvrir un fait analogue en latin : si la racine sla (= sanscrit sia ffêtre debout n) a presque partout conservé sa longue, tandis que dâ ( = sanscrit dâ redonner») l’a perdue, c’est probablement grâce à la protection des deux consonnes initiales.
Eu ce qui concerne la métathèse de Btr en bri , on peut rapprocixer les formes grecques comme 'srarpao-t (pour 'usaxap-at)651.
S <7 S A. Affaiblissements irréguliers de la racine, devant la caractéristique du passif ya, en sanscrit, en zend et en ancien perse.
La racine subit quelquefois, au passif, des affaiblissements irréguliers, à cause de la surcharge produite par l’addition de la syllabe y a. Ainsi vue «dire» se contracte en uc, par exemple dans uc-yd-tê «dieitur»; rapprochez certaines formes anomales de l’actif, comme ûcimâ «nous parlâmes» (pour u-ucwiay La racine îfà^prae «interroger» contracte la syllabe ra en r, par exemple dans prcÿdié «interrogatur»; on a, de même, a 1 actif, prccâmi «j’interroge», paprccimd «nous interrogeâmes»2. Quelques racines en â affaiblissent au passif cette voyelle en %y ainsi dâ «donner» a pour thème du passif dtya; exemple : diyatê
«datur».
Le zend, en vertu du même principe, abrège m a en « a;
exemples : nidayêinîê «deponuntur » 1 (= sanscrit
vidîyantê); jrû... snayanuha «sois lavé»652 653
f= sanscrit pra-snâyasvay, snayaka «qu’il soit lavé»
ou «qu’il se lave».
En ancien perse, Yâ de la racine pâ s’est également abrégé devant le ya du passif dans yy. y^>- .^y"ÿ • ^ ÎTf
patipayauvâ654. On peut citer cet exemple à l’appui de l’explication que nous avons donnée plus haut (§ 721) pour les formes zendes snayanuha et snayaiia : nous y avons vu des passifs à signification réfléchie. C’est aussi le sens réfléchi qu’il faut donner à l’impératif patipayauvâ : Benfey le traduit par «garde-toi», Rawlinson par «te expeditum kabe».
Remarque. — Examen d’une opinion d’E. Burnouf : le signe du passif y a existe-t-il en zend? — Burnouf, dans la forme précitée snayanuha, ne fait pas de y a le signe du passif655 656. En général, selon ce savant, le zend n’aurait guère plus de part au signe passif ya que le grec et le latin \ Mais le changement du sens passif en sens réfléchi ou moyen n’a rien de plus surprenant que le fait contraire qui a lieu en grec, en gothique, en latin, en lithuanien et en slave. Burnouf cite sans autre indication la forme nidhyêinti, qu’il traduit par «ils déposent»; dans le manuscrit lithographié, je trouve deux fois cette forme au troisième fargard du Ven-didad657; mais je lis, avec Lassen et Westergaard, nidhyêintê «deponuntur». Si, cependant, nidàyêinti était la vraie leçon, je n’v verrais pas moins un passif avec désinence de l’actif : au passif sanscrit, il arrive assez fréquemment que les désinences de l’actif prennent la place des désinences moyennes, en sorte que le passif est exprimé uniquement par la syllabe
ya1* .... * . .
En admettant avec Bumouf que nidhyêinti fut un actif, il faudrait prendre (Tils déposent» dans le sens de *on dépose», et expliquer narô irista comme des accusatifs.
§ 735. Passif du verbe gan tr engendrer », en sanscrit et en zend.
De la racine gan «engendrer» vient la forme irrégulière gayê (pour ganyê) «je nais», que les grammairiens indiens expliquent comme un moyen de la quatrième classe. La position de l’accent tonique autorise cette explication (§ 733), qui, si elle est admise, devra s’étendre aussi au verbe zend correspondant.
Mais remarquons que le sens exige le passif et non le moyen ; observons, en outre, quabstraction faite de l’accent, la forme du moyen est identique, pour les verbes de la quatrième classe, avec celle du passif. J’aime donc mieux regarder dans les deux langues la forme en question comme un véritable passif. Il est vrai que l’accentuation de gayê est irrégulière658 659; mais Pânini660 nous apprend qu’on peut aussi accentuer de cette façon : gayê'.
La racine zende correspondante est san : nous la trouvons plusieurs fois employée au passif, en combinaison avec la préposition ®> ué (- sanscrit ut). Comme en sanscrit, le n final est rejeté devant le signe du passif ya; mais Y a précédent n’est pas allongé, ou la longue a été de nouveau abrégée. Ce fait ne doit pas nous surprendre, si nous considérons que même les racines qui ont par nature un â long, l’abrègent devant le y a
du passif. En conséquence, ^us-sayêintê1 «ils naissent» répond exactement h la forme précitée (§ 734) nidayêiniê. À l’imparfait, nous trouvons la deuxième personne uiasayanha «tu naissais» (§ £69), et, à la troisième, ussayata « il naissait » 2.
S 736. Les formes driyê' «je dure» et mriyê' «je meurs» appartiennent
au passif. — Restes de l’ancien passif, en latin, en gothique et en
géorgien.
Les grammairiens indiens expliquent également comme des moyens de la sixième classe la forme mriyê’ «je meurs », venant de la racine mar> mr, et la forme fli% driyê'x. je me maintiens, je dure», venant de la racine dhr, dr. On a vu plus haut (§ 733, remarque) que parmi les racines finissant en ar, celles qui sont sujettes à contracter ar en r3 prennent au passif la syllabe ri (pour va). Or, il en est de même, à l’actif et au moyen, pour les racines en ar de la sixième classe; suivant donc qu’on divisera de cette façon : mriy-ê\ driy-ê'4, ou de cette autre manière : mn-yê', in~yê\ on aura des moyens de la sixième classe ou des passifs. Dans l’une et l’autre hypothèse, l’accentuation doit rester la même, puisque la caractéristique de la sixième classe reçoit l’accent aussi bien que la syllabe ya du

Le sens de dar étant «soutenir, porter», je suppose que la signification primitive de driyé' est «je suis soutenu, je suis porté». Je vois donc dans cette forme un passif. Mais si driyeesi
1 Vendidad-Sâdé, p. «36.
5 Vendidad-Sâdé, p. 39 : yad hé (le texte porte hé) putrô ussayata «qu’il lui naquit un fils».
3 Selon les grammairiens de l’Inde, la forme en r serait la forme primitive.
* Dans ces formes, iy tiendrait la place d’un simple i. Sur celte modification euphonique de Vif voyez S 5oa.
* Voyez SS 109% 1, et 783.
un passif, je crois aussi devoir reconnaître un passif dans mriyê* «je meurs » l. On peut rapprocher les formes zendes mërë-yêi-ti «il meurt», fra-mërë-yêi-ti (même sens), mair-yâi-ti (par euphonie pour mar-yâ-îi) «qu’il meure», ava-mair-yâi-tê (même sens). Il est vrai que ces formes peuvent être expliquées aussi comme des actifs ou des moyens de la quatrième classe2. L’accentuation zende nous étant inconnue, il est impossible de décider cette question; mais ce qui est certain, c’est que, si le y sanscrit dans mriyê\ mriyâsê correspond au y des mots zends précités 3, le verbe sanscrit représente par la forme et par l’accent un véritable passif.
A la racine sanscrite et zende mar répond, en latin, mor : dans le io, iu de morior9 moriuntur, nous avons encore un reste fort bien conservé du caractère passif ^ ya. Comparez le iu de mor-iu-ntur avec le y a sanscrit de mn-yd-ntû (pour mar-yâ-ntê).
Un autre représentant de ce y a nous est fourni par le gothique u$-ki-ja-na « enatum », lequel fait au présent de l’indicatif m-ki-ja «enascor», et suppose, par conséquent, un simple ki-ja «nascor» \
Mentionnons encore en latin, comme reste de l’ancien passif, le verbe fio, que je divise de cette façon : f-io, et que je regarde comme étant pour fu-io. C’est ainsi qu’en ancien perse nous avons b-iyâ5 «qu’il soit» = sanscrit fiûyâ't. Le latin fio répond donc au sanscrit Myê\ si Ÿon fait abstraction de la désinence
1 Peut-être l(e sens primitif était-il «je suis usé, consumé'î; comparez le grec fiapaîvii). La racine sanscrite mar, mr, conjuguée d’après la neuvième classe signifie «tuer». Les grammairiens de l’Inde supposent pour ce dernier verbe une racine *T mr, et ils admettent que le r s’est abrégé devant la caractéristique de la classe.
% On a vu (S 734} qu’en sanscrit le passif a quelquefois les désinences de l’actif.
3 C’est-à-dire nest pas du à la ioi phonique indiquée au 8 5oa.— Tr.
4 Pour hin-ja, comme en sanscrit nous avons giï-yê> pour gan-yê.
6 Par euphonie pour byâ; il est rare qu’en ancien perse un y, quand il se trouve après une autre consonne, ne se fasse pas précéder d’un », moyenne de ce dernier1. Comparez f-iu-nt avec Bû-yd-ntê, f-ie-t avec Bû-yê-ta, f-iê-mus avec Bû-yê-mahi.
Comme le passif sanscrit est souvent employé avec le sens impersonnel, dans des locutions telles que sruyâtâm « entends !» (littéralement «qu’il soit entendu!»), âsyâtâm «assieds-toi!» (littéralement « qu’il soit pris place!»), je rappellerai ici que des expressions du même genre sont très-habituelles en géorgien 661. Je veux parier des verbes ou des temps que Brosset appelle indirects : leur élément formatif ui ou îe présente une ressemblance incontestable avec le signe du passif ya. On a, par exem pie : 3 m-gon-ia «il est pensé par moi», pour «je pense » 3 ; '3gc)oggségooi> se-mi-qwareb-ia « il fut aimé par moi », pour «j’aimai». Le passif ordinaire, quand il s’est conservé en géorgien, présente également une formation qui rappelle le ya sanscrit; c’est à la troisième personne du pluriel que la ressemblance est le plus visible. On a, par exemple, DgoggségàobE ée-i-qwarebian «amantur» en regard de l’actif se-i-
qwareben « amant » 662.
S 737. Restes du caractère passif ya, en arménien.
L’arménien, comme l’a d’abord remarqué Petermann5, a
1 Le passif de M «être» ne peut guère trouver son emploi qu'à la troisième personne du singulier, dans le sens impersonnel. C’est dans le même sens qu’on rencontre aussi le neutre du participe futur passif : tavâ ’nucarêna maya Uavitavyam «c’est à moi à être ton compagnon» (Hitôpadéça, éd. Schlegel, p. 17). L’idée «devenir» est exprimée par l’actif de b'â, b'âvâmi signifiant non-seulement «je suis», mais «je deviens».
2 J’ai exposé les affinités grammaticales du géorgien et du sanscrit dams mon mémoire intitulé Les membres caucasiques de la famille des langues indo-européennes. Voyez en particulier page 69.
3 En sanscrit *UÏT fTPTrT maya gnà^ya-te «il est su par moi»,
4 Dans sa désinence, cette forme géorgienne nous présente la même mutilation que l’allemand *ie lieben (pour liebent) «ils aiment». Voyez le mémoire précité, page 56.
5 Grammatica linguon artneniaeœ, p. 188.
sacrifié F a du caractère passif y a, et a vocalisé le y en L Cet i se joint au thème du présent, dont la voyelle finale est supprimée ; exemples : orsan-i-m « venatione capior » arnan-i-ni « ac-cipior», gow-i-m «laudor». L’actif est orsmie-m, avnane-mf gowe-m. Cette forme passive est prise aussi par beaucoup de verbes neutres et déponents qui n’ont point d’actif correspondant : ils joignent IV à la consonne finale de la racine, comme %umfnT n-st-i-m2 «je suis assis», iiiudfnP kam-i-m «je veux», ou bien ils l’ajoutent à la consonne finale du thème du présent, comme meran-i-m3 «je meurs ». Une partie des verbes de la troisième conjugaison gardent devant IV* la voyelle caractéristique u des formes spéciales: exemple : sem-i-m «mactor», venant de sen~u-m, dont la racine répond au sanscrit ^s^han «tuer».
A l’imparfait, devant le verbe «être» qui vient s’adjoindre au verbe attributif, le caractère passif est rejeté; il faut excepter toutefois la troisième personne du singulier, où, à côté de êr, nous avons iwr4, dans lequel je crois reconnaître IV du passif. Je regarde Vu de i-ur comme un affaiblissement de Va de la racine ns; le même affaiblissement a lieu, entre autres, dans ut-e-rn «je mange» = sanscrit âd~mi, grec ë$-w, latin ed-o (§ i83 b, i). 663 661 664 662
S 788. Passif des temps généraux, en sanscrit.
. Il est probable qu’à l’origine le caractère passif y a s’éten
dait aussi aux temps généraux. Le sanscrit, tel qu’il nous est parvenu, nous en présente peut-être encore un reste dans les racines finissant par â ou par une diphthongue l. Je veux parler du y qui précède la voyelle de liaison i à 1 aoriste, aux deux futurs, auprécatif et au conditionnel; exemples : âdâyiéi «je fus donné», dâyitâliê «je serai donné», dâyisye (même sens), dâyiêîyâ «que je sois donné», âdâyiêyê «je serais donné». Ce qui me détermine surtout à expliquer le y de cette façon, c’est que, dans la formation déponente de l’intensif2, le caractère passif reste aux temps et aux modes en question même après dautres voyelles que Yâ; on a, par exemple, âcêêîym «j’assemblai», cêcîyitahê «j’assemblerai», cêcîyisyê’(même sens)3. Si le \ V se trouvait seulement après un â, on pourrait, ainsi que je l’ai cru autrefois, y voir simplement une insertion euphonique, analogue à celle qu’on a, par exemple, dans l’adjectif yâ-y-in «allant», venant de yâ et du suffixe in (§ 43).
En sanscrit comme en grec, le parfait passif est toujours semblable au parfait moyen : ainsi dadréê' signifie «j’ai vu, il a vu» ou «j ai été vu, il a été vu». Parmi les temps généraux, le parfait est le seul, avec la troisième personne du singulier de l’aoriste4, qui soit d’un emploi habituel au passif.
1 On a vu (S 109*, 2) que les racines qui, suivant les grammairiens de l’Inde, finissent par une diphthongue, peuvent être ramenées è des racines en â.
* J appelle ainsi cette formation, parce qu’elle a la signification active avec les formes du passif.
* Racine éi «assembler». Devant le y du caractère passif, i’i et l’u sont allonges. En general, le y allonge habituellement un i ou un u précédent, à moins que iy ne soit simplement le développement euphonique d’un t ou d’un i, comme dans 6*iyfls «timoris», venant de fct+o*. De même, en latin, le j, à l’intérieur d’un mot, rend la voyelle précédente longue par position.
4 Cette forme se termine en i et est privée de désinence personnelle; exemple :
S 789. Origine de la syllabe ya, exprimant Je passif.
H reste à nous demander quelle est l’origine du caractère passif V ya. Sir Gr. Haugbton1 nous en fournit, ce semble, une explication parfaitement satisfaisante. Il rappelle qu’en bengali et en mdoustam le passif est exprimé par un verbe auxiliaire signifiant «aller», savoir, en indoustani, 3TRT gânâ (pour yana, § 19), et, en bengali, ^TT yâ. Dans ce dernier dialecte par exemple, ^ ^ kôrâ yâï signifie «je suis fait», littéralement «[injconfectionem eo». Or, en sanscrit, il y a deux verbes, t et yâ (classe 2), qui signifient l’un et l’autre «aller».
our 1 explication du passif, nous préférons le second, qui sert à exprimer la même relation en bengali : l’abréviation de la syllabe myâ en K ya vient, comme je le pense, de la surcharge produite par la composition. LWu caractère passif ya appartient donc a la racine, et n’est pas, comme dans la caractéristique de la première et de la sixième classe, un complément servant à la conjugaison2. L’adjonction des désinences moyennes, qui expriment l’action réfléchie, ajoute encore une nuance à la signification du verbe auxiliaire : tandis que le bengali kôrâ yâï veut dire seulement «[in] confectionem eo», le composé sanscrit knyé'dit quelque chose déplus, savoir «me [in] confectionem verto ». On peut comparer les constructions latines comme
II Iimjuil774
WH U
.rJ . \ w cet * «ne contraction du carac-
t"?3 ya\mi"S “ formeS C°mme âdi9i fut donn«” supposent à cette explication , car .ci le y est 1 expression dn passif et IV est très-probablement une voyelle
de ha,son, comme dans Wy-i-ii «je fus donné», my,-iuU «vous fûtes donnés».
Umsequemment, «rfdy.peul être regardé comme étant pour àdâyiila
Dans son édition de Manou, t. I, p. Sac, et suiv. et dans sa Grammaire bengalie, pages 68 et 96.
’ Il suit néanmoins l'analogie de la caractéristique a, absolument comme la ra-
Z l^e de I ' ' 8Pf S’èlre abré8ée en SUi‘ ranai°Sie *• verbes de la première et de la sixième classe.
amatum tri «être ailé en aimer». Rapprochez aussi veneo qui est le contraire de vendo (§ 632). Les expressions comme «aller en joie, en colère», au lieu de «être réjoui, être irrité», sont très-fréquemment employées en sanscrit; on dit même : grakanan samupâgamat «il alla en captivité», au lieu de «il fut pris» l.
CAUSATIF.
S 7^0. Origine du caractère eausatif.
Par sa formation, le eausatif sanscrit et zend est identique avec les verbes de la dixième classe (§ i oqa, 6). Dans les temps généraux, il prend ay, et dans les temps spéciaux ^Rï aya. Pour expliquer cette caractéristique, le sanscrit nous présente deux racines : i «aller» et î «désirer, demander, prier». Lune et l’autre, étant frappée du gouna, devient mj devant les voyelles, et, combinée avec la caractéristique a de la première classe, ^Rf aya. La signification «désirer, demander» convient bien, ce semble, pour l’idée accessoire exprimée par le eausatif; en effet, le eausatif sert à marquer que l’action est accomplie par la volonté du sujet, et non point directement exécutée par lui. Kârdyâmi «je fais faire» signifierait donc proprement «je demande que quelqu’un fasse, qu’une chose soit faite». Si, au contraire, le caractère eausatif vient de la racine i «aller», nous rappellerons que les verbes sanscrits signifiant «se mouvoir, aller» servent en même temps à marquer l’action (S 739). Le verbe eausatif vêdâyâmi signifierait alors à la lettre «je fais savoir».
S 7^1. Le eausatif dans les langues germaniques.
O11 a vu que, dans les langues germaniques, les trois con-
1 Ràmâyana, éd. Schlegel, l, 1, 78.
I
j,
•i
£
1
|
i
J
i
'j“
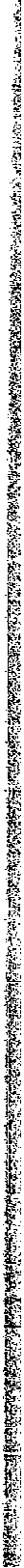
jugaisons faibles se rapportent à la dixième classe sanscrite 1 ; mais c est seulement la conjugaison qui a conservé le plus clairement la caractéristique aya, c’est-à-dire celle des verbes ayant ja à la première personne du singulier du présent2, qui est employée pour marquer le causatif ou pour exprimer qu’une action, d’intransitive qu’elle était, devient transitive. Ajoutons qué la langue n a plus la faculté, comme en sanscrit, de tirer de chaque verbe primitif une forme causale : il faut qu elle se contente
des causatifs qui lui ont été transmis en héritage par un âge antérieur.
En gothique comme en sanscrit, le causatif renforce le plus quil est possible la voyelle radicale : dans les deux idiomes, c est sous la forme la plus forte qu’ait développée le verbe primitif que la voyelle radicale nous apparaît au causatif3. Ainsi les verbes germaniques qui ont, au présent de la conjugaison primitive ou forte, affaibli un a radical en i, reprennent leur a dans la forme causale. Les i et u susceptibles du gouna se changent en ai, au 4, On peut dire d’une façon générale que le causatif gothique a toujours la même voyelle que les formes monosyllabiques du prétérit du verbe primitif; mais nous n’en conclurons pas que le causatif dérive de ces formes : il est avec elles dans un rapport collatéral et non dans un rapport de filiation. Comparez, par exemple, satja «je place» (racine sat) avec sita «je suis assis», sat «je fus assis»5; lagja «je couche» avec 1 Voyez S 109*, 6.
a la première conjugaison faible de Grimm.
3 Jï faut seulement excepter les verbes qui, au prétérit redoublé, contractent ensemble leurs deux premières syllabes (S 6o5). Encore, en sanscrit, où l’â est un
son plus pesant que IV, tidéyâmi a-t-il une voyelle plus forte que sêdirnd (pour sasidimâ). . r
4 C’est-à-dire qu’ils prennent le gouna le plus fort, le gouna par n, et non par i comme au présent du verbe primitif (S 27).
6 C’est le même rapport qu’en sanscrit entre le causatif sâdàyâmi «je fais asseoir» et la racine »ad «s’asseoir».
liga «je suis couché», iag «je fus couché» 1; nasja «sano» avec ga-nisa «sanor», ga-nas «sanatus sum»665 666; sanqvja «inclino» avec sinqva «inclinor», sanqv «inclinatus sum»667; drankja «j’abreuve» avec drînka «je bois», drank «je bus» 668; ur-rannja «je fais sortir» avec ur-rinna «je sors», ur-rann «je sortis»669 670. Voici des exemples de l u gothique frappé du gouna : ga-draus-ja «je fais tomber, je jette en bas», causatif de ia racine drus «tomber» (présent driusa, prétérit singulier draus, pluriel drusum)ù\ lausja «je délie», causatif de la racine lus (présent fra-liusa «je perds», prétérit singulier fra-laus, plurielfra-lusum)671 672 673. On a de même en sanscrit bêddyâmis «je fais savoir, j’éveille», causatif de la racine b ud' « savoir, s’éveiller». Voici des exemples de 1ï gothique devenu ai : ur-raisja «je dresse», causatif de la racine ris {ur-reisa «je me lève», prétérit singulier ur-rais, pluriel ur-risuniji hnawja «j’abaisse», causatif de la racine hmv «s’abaisser» (présent hneiva, prétérit singulier hnaiv, pluriel hnivum). On a de même en sanscrit vêddyâmi9 «je fais savoir», causatif de la racine vid «savoir».
En haut-allemand moderne, il subsiste quelques restes de causatifs, comme ich seize «j’assieds», ich lege «je couche», ich senke «j’abaisse»674. Mais la flexion de ces verbes a été tellement mutilée quelle est devenue semblable à celle de leurs primitifs ;
c’est là une preuve remarquable des altérations qui peuvent dénaturer certaines formes jusqu’à les rendre méconnaissables. Si nous n’avions conservé les verbes gothiques comme satja, et quelquês formations plus ou moins analogues d’autres vieux dialectes germaniques, il eût été impossible d’apercevoir dans le deuxième e de seize le représentant du sanscrit ayâmi, dans sâdâyâmi; par suite, l’identité de formation du causatif sanscrit et du causatif gothique nous aurait pour toujours échappé. Déjà en vieux haut-allemand la marque du causatif est souvent fort effacée; nous avons, par exemple, dans Notker, nerent «ils font vivre, ils nourrissent», pour neriant (= gothique nasjand); lego «je couche», pour kgio, legiu (= gothique fagja); legent «ils couchent », pour legiant (= gothique lagjand).
§ 74q. Le causatif eu ancien slave.
Celle des conjugaisons, en ancien slave, qui répond à la dixième classe sanscrite1 est aussi celle qui doit renfermer les verbes causatifs. Elle contient effectivement plusieurs verbes à sens causal, à côté desquels on trouve des primitifs à signification non causale ou intransitive. Comme en sanscrit et en gothique (§ 7 Ai), le causatif a une voyelle plus pesante que le verbe primitif, ou bien il contient une voyelle, tandis que ce dernier l’a perdue. De même, par exemple, qu’en regard de ta racine sanscrite mar, mr «mourir» il y a le causatif mârâyâmi «je fais mourir, je tue», en regard du slave mp* mrun «je meurs», dont la voyelle radicale a été supprimée, il y a un causatif MophR morjuh «je tue». Le même rapport existe entre Kp'tTH vr-ê-ti «cuire» (intransitif) et KdpHTt* var-i-ti «faire cuire». En face de Ye du primitif, le causatif présente la voyelle plus pesante 0; exemple : ACftdTK les-a-ti «être couché» et nodOftHTH po-los-i-ti
1
Yoyeï S 5o5.
«coucher». Va de sad-i-ti «planter», littéralement «placer», représente ïâ de sâd-âyâ-mi (= gothique satja «je place»), tandis que le 1» ê de cucth sês-til «se placer» a probablement d’abord affaibli en £ e Y a bref de la racine, et la ensuite allongé en % ê. On peut comparer en lithuanien le rapport qui existe entre la voyelle de sedmi «je suis assis» et celle de sôdinu «je plante»2. Citons aussi l’irlandais suidiughaim «je place, je plante», rapproché de suidhim «je suis assis»; le ghf dans le premier de ces verbes, comme en général dans les causatifs irlandais, représente le y sanscrit.
Parmi les causatifs slaves, nous remarquerons encore pdCTHTH rast-i-ti «augmenter», littéralement «faire croître», à côté de rast-ê-ti « croître » 3 ; kuchtm vês-i-ti « suspendre », à côté de vis-ê-ti «être pendu»; na-po-i-ti4 «abreuver», à côté de pi-ti «boire»; po-ko-i-ti «tranquilliser», à côté de po-ci-ti «être tranquille». Comme le n ê slave est le représentant ordinaire de la diph-thongue ê (= ai)5, le rapport de vês-i-ti «suspendre» avec vis «être pendu» est le même qu’entre le sanscrit vês-âyâ-mi «je fais entrer» et vis «entrer»6. H serait impossible, sans la connaissance du sanscrit, de se rendre un compte exact du rapport
1 Par euphonie pour sêd-ti (S io3).
* L’ô lithuanien, comme Vô gothique, représente très-souvent un ancien « (S 92a). . ,
â En sanscrit var&ùyami, en zena vareaayemi^e uu* gramur, j auuiuio». slave a pris un t complémentaire, ce qui a déterminé le changement du d radical en s. Comme le verbe primitif a déjà un a, la gradation de la voyelle était impossible au causatif. Comparez encore le sanscrit ari, rd‘ «grandir», qui est peut-être une forme mutilée de vard
4 Avec la préposition na. .
5 Voyez S 93*.
« Combinée avec la préposition m, la racine sanscrite vis prend au causatif, entre autres significations, celle de «joindre, attacher», ce qui nous rapproche beaucoup du slave vês-i-ti «suspendre». Avec les préfixes d, upa, le sanscrit vis signifie «sap procher, s’asseoir»; toutes ces acceptions ont pour fond commun celle de «s’approcher».
qui existe entre {ndjpoïti « abreuver » et piti « boire » : au point de vue de la grammaire slave, il semble que poiîi vienne de piti, qui aurait inséré un o devant son i; mais, en réalité, cet o représente Yâ de la racine sanscrite pâ «boire», Yeo du grec 'üfâdt, 'GsénoôxoL, l’o de inéByv, Yô du latin pô-tum, pô-turus, Y no du borussien puo-ton «boire». Au contraire, IV du slave pi-ti se rapporte à IV du grec ^1-91, «r/-îw, à Yî (affaiblissement de Ta) du sanscrit pî-ydtê «bibitur», pî-tâ-s «bu», pî-tva «après avoir bu». Le slave a gardé au causatif la voyelle la plus pesante, conformément au principe général que nous venons d’exposer.
Le rapport de po-koïti1 «tranquilliser» avec po-ci-ti «être tranquille» est d’une autre nature. Je regarde, en effet, avec Miklosich2, la racine slave hm ci comme représentant le sanscrit sî (pour kî) «être couché, dormir» : cette racine, par exception, en sanscrit comme en grec, garde partout le gouna; comparez, par exemple, les formes xeipiai, xofay, koîto?, xotfxact). C’est Yo du grec xot que je reconnais dans po-ko-i-ti; mais la voyelle radicale s’est perdue, car IV suivant est l’expression de la relation causative.
S 7A3. La marque du causatif, en ancien slave.
La marque du causatif, en ancien slave, est devenue ordinairement i; de même, en gothique, la syllabe ja, qui exprime le causatif, se contracte en i devant le verbe annexe du prétérit (§ 6^3) et devant le suffixe du participe passé. On a, par exemple, en gothique, §at~i-da «je plaçai», sat-i-th’-s «placé» (génitif sat-i-di-s), et, en slave, sad-i-ü « plan tare », sad-i-tï «plantât», sad-i-si «plantas», sad-i-mü «plantamus», sad-i-te «plantatis».
A la première personne du singulier et à la troisième per-
1 Po est une préposition.
9 Radices linguœ sbvmicœ, p. 36.
sonne du pluriel du présent, vuju-h, atk ahtï correspondent au gothique ja, jand, au sanscrit ayâ-mi, aya-nti \ A l’impératif (§ 626), le caractère causatif s’est confondu avec Fexposant modal; exemples : sadi «plantes, plantet» (gothique satjais, sat-jai); cdAMMS sadimü «plantemus»; CdAUTe sadite «piantetis» (gothique satjaima, satjaith).
§ 7/16. Le causatif en lithuanien. —- Formations en inu.
Nous avons examiné (§ 5o6) les différentes sortes de verbes qui représentent en lithuanien les verbes sanscrits de la dixième classe. Mais le lithuanien utilise très-rarement les formes en question pour tirer d’un verbe primitif le causatif correspondant. Les seuls exemples que je connaisse sont ûndau «j’allaite», à côté de zindu «je tette », et grâu-ju «je fais écrouler, je démolis », à côté de grüw-ù «je m’écroule». Le w de grüm-ù me paraît être un développement de l’w, comme dans le sanscrit baMva «je fus, il fut» (racine bû). Si l’on regarde grü comme la racine, il y a dans le causatif grdu-ju une gradation de la voyelle radicale comme dans le sanscrit bâv-âyâ-mi «je fais devenir, je produis».
Les causatifs ordinaires, en lithuanien, finissent en inu (pluriel ina-me). La même flexion sert pour former des verbes déno-minatifs2, tels que ilg-inu «j’allonge», qui est un dénominatif à sens causatif venant de ilga-s «long». Le n reste à tous les temps et à tous les modes, ainsi qu’aux participes et à l’infinitif3.
1 A moins que les lois euphoniques n’exigent une modification ; ainsi 1 on a
CdffiArf* saidun, au lieu de sadjun (S 9a1 ).
a En sanscrit également, aya sert tout à ta fois pour former les causatifs et 1rs
dénommai! (s.
3 Devant un s, ce n prend le son nasal faible (S 10); exemple : lâup-sin-siu «je louerai». Mais ce n’est pas une raison pour dire avec Mielcke (Éléments de grammaire lithuanienne, p. 9^ » 10) (lue Ie a disparu.
on a paprâéca « j’interrogeai, il intér

CAUSATIF. S 745a.
/i 17
S 7^5 a. De ia voyelle radicale dans les causatifs lithuaniens en inu.
11 v a accord entre les causatifs lithuaniens en mu et les eau-
%}
satifs sanscrits, zends, germaniques et slaves, en ce qu’ils aiment à avoir une voyelle pesante dans ia racine» Aussi plusieurs des formations lithuaniennes ont-elles gardé un ancien a, tandis que leurs primitifs l’ont laissé s’altérer en i ou en e; il en résulte des oppositions de voyelles semblables à celles que nous trouvons dans les langues germaniques. De même, par exemple, qu’à l’intransitif gothique sita (pour sata) «je suis assis» vient s’opposer un prétérit sat et un causatif satja «je place», de même, en lithuanien, au verbe neutre mirslu «je meurs» s’oppose le causatif marinù «je laisse mourir» \ Au verbe à signification passive gemù « gignor » répond le causatif gaminù «gigno ». On peut encore citer : gadinù « perdo, occido », kankinù « cru-cio», à côté de gendà, nagendà «perdor», kenciu «patior». Quelquefois le causatif lithuanien nous présente un o, au lieu d’un a; exemple : sôdinù «planto», à côté de sedmi «sedeo».
?
Remarquons le rapport qui existe entre la voyelle de pa-klai dinù «je séduis, je trompe» et celle depa-kljstu (par euphonie pour pa-klyd-tu) «je me trompe». Gomme ïy lithuanien se pro nonce ly nous avons ici un go un a analogue2 à celui du causatif gothique hnaivja «j’abaisse» et du causatif sanscrit vêddyâmi «je fais savoir» (§ 741). La même opposition existe encore entre at-gaiwinu «je recrée », littéralement «je fais vivre »3, et son primitif at-gijà «je me recrée, je revis» (probablement pour at-giwju); entre waidinü-s «je me montre» (§ 4^6) et wêizdmi «je vois». La première de ces formes, qui contient un gouna plus fort que la seconde, répond au causatif sanscrit précité vêddyâmi.
' En sanscrit ntârdyâmi, en slave morjun.
2 Sauf la longueur de l’t en lithuanien.
1 Comparez gywas avivants, en sanscrit giv «vivre*.
m. 27
Le lithuanien n’a pas toujours aussi bien marqué cette opposition : ainsi dans le causatif degmu « uro », Ta primitif s’est altéré en e comme dans l’intransitif correspondant degu « ardeo»L
S 7^5 h. Origine de la lettre n, dans les causatifs lithuaniens en înu.
On vient de voir qu’entre la formation lithuanienne ina (première personne du singulier mi’-m2) et le sanscrit aya il existe une double analogie : l’un et l’autre forment aussi bien des causatifs que des dénominatifs; en outre, comme les causatifs sanscrits, germaniques et slaves, les formes lithuaniennes en inu aiment à avoir une voyelle pesante dans la syllabe radicale. De cette double analogie on est peut-être en droit d’inférer qu’il existe une parenté entre ina et aya. Dans IV de ina on pourrait voir l’affaiblissement d’un a primitif, comme dans IV de if-u, ija (§ 5o6). Le n serait alors l’altération d’un ancien Tf^y (/)3« On peut encore proposer une autre explication. LV de in-u, ina, comme celui de iu, pluriel i-me [mÿl-i-me «nous aimons», § 5o6), répondrait au y du sanscrit aya; ainsi la syllabe in, dans sôd-ln-ti«planter», serait identique avec IV du slave sad-i-ti (même sens) et du gothique sat-i-da «je plaçai» (§ 743). Le n des formes lithuaniennes serait alors une addition inorganique qui serait venue s’ajouter au thème verbal, de même que, par exemple, en gothique, nous avons le thème viduvôn (nominatif viduvô} «veuve» en regard du sanscrit vidavâ, du latin vidua et
1 En sanscrit, la racine dah, conjuguée d’après la quatrième classe (dâkyâmi te ardeo»), a le sens intransitif, au lieu que d’après la première classe (dâhâmi «uro»), elle a la signification transitive. C’est à la dernière de ces formes que se rattache l’irlandais daghaim «uro».
* Sur tt employé comme expression de la personne, voyez SS 436 et 438.
3 On a vu (S no) que les semi-voyelles permutent fréquemment entre elles. Comparez, par exemple, le rapport du sanscrit yâkrl (pour yakart), en grec farap, en latin jecur, avec l’allemand leber (voyez Graff, Dictionnaire vieux haut-allemand, Il, col. 8o). En ce qui concerne le changement de l en n, rapprochez le dorien %v9ov (pour %\6ov).
du slave vïdova x, ou de même que les thèmes participiaux en antî prennent en gothique la forme andein (nominatif andei). Dans cette hypothèse, il faudrait admettre que le thème verbal sôdln, forme élargie pour sôdi - sanscrit sâdaya, a pris la caractéristique de la première classe sanscrite2; sédin-a-me «nous plantons» se décomposerait comme sùk-a-me «nous tournons ».
A lappui de la première de ces deux explications, on pourrait rappeler quà côté de slowinu «je loue, je célèbre » il existe une forme slowiju (même sens)3, qui est évidemment identique avec le sanscrit érâvàyâmi «je fais entendre» et avec le russe c^iaB.iK) slavlju «je célèbre».
S 745 e. Lecausatil en latin. — Causa tifs de la deuxième et de la quatrième conjugaison.
En latin, c’est dans la première, la deuxième et la quatrième conjugaison, qui répondent à la dixième classe sanscrite, que nous devons chercher les causatifs. La deuxième conjugaison nous présente le verbe momo, monê-s = sanscrit mânâyâmi «je fais penser», prâcrit mânêmi (§ 109% 6); mais le latin ne voit plus dans nwneo un causatif, parce qu'il ne possède point de verbe primitif correspondant, qui conduise à cette forme par une route bien connue et suivie aussi par d'autres verbes. Me-mini peut bien être considéré par la langue latine comme une forme sœur, mais non comme la forme mère de moneo. Sêdo, sêdâ~sk pourrait, quant à la signification, être regardé comme le causatif de sedeo; mais ce dernier a lui-même la forme d’un causatif et nous n’avons pas d’autre exemple d’un verbe de la
1 Voyez $*i4o.
2 La première conjugaison lithuanienne, d’après ta division de Mielcke.
3 La forme klausau «j’écoute», qui est de même origine, a conservé, comme te grec xAtio», l’ancienne gutturale, tandis que sMwiju, ainsi que le sanscrit #Vu, l’onl laissée dégénérer en sifflante.
'* Sèd-â-a = mzïïfà sdd~à(y)a-si.
sanscrite sad. Avec
le sanscrit trâsdyâmi (j
fM/ t O/tM-l ^ \ „ Y _ 1* '
uvui, cr Uovmij ^je lais
deuxième conjugaison dont on aurait tiré un causatif en le faisant passer dans la première. Il faut donc nous contenter de voir dans sîdo, sëdeo et sêdo trois verbes de même famille, qui se rattachent, chacun avec une formation particulière, à la racine
O O \ _
trembler, j’effraye » s’accorde le latin terreo, par assimilation pour terseo, venant de treseo.
La quatrième conjugaison nous fournit sâpio = sanscrit svâ-pdyâmi «je fais dormir», causatif de svdpimi1 «je dors». Mais le latin ne sent pas non plus la formation causative de sâpio, parce qu'il n’a pas de verbe intransitif sôpo appartenant à la troisième conjugaison, qui y puisse servir de point de départ. En vieux norrois, le verbe correspondant fait au pluriel svepium «nous endormons» (singulier svep); en vieux haut-allemand, nous avons m-suepiu. Les langues germaniques ont gardé le verbe primitif (vieux haut-allemand slajumais il est devenu étranger au causatif par la permutation des semi-voyelles v et / (§ 20). En russe, le causatif est ycbin.iaio u^süplaju^, à côté duquel est resté cilæk> splju «je dors» 3. Je fais suivre le tableau comparatif de svapâyami et de son potentiel svâpâyê-y-am (§ 689), en sanscrit, en latin et en vieux haut-allemand :
|
svâp-nyâ-mi |
sop-io |
in-suep-iu |
|
svâp-éya-si |
sôp-î-s |
m-suep-i-s |
|
svâp-dya-li |
sop-i-l |
in-suep-i-t |
|
JL t ji svap-aya-mas |
sôp-i-miis |
in-suep~ia~m |
|
svap-àya-ta |
sôp-î-tis |
in-suep-ia-t |
|
svâp-âya-nti |
sôp-iu-nt |
in-suep-ta-itf |
|
1 Forme irrégulière pour 2 Vu est une préposition. |
svapmi. Le l n’est qu’une addition |
euphonique appelée par le |
comme mêupimâ «nous dormîmes *, supin «ayant dormir. Rapprochez la syllabe dans le grec tinvos.
? Par euphonie pour spju.
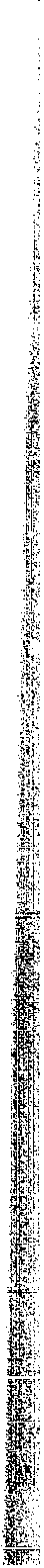
sop-ia-m
m-suep-ie "
in-suep-iê-s
iit-suep-ie
in-suep-iè-mh
in-suev-ic-t
in-swp-iê-n.
svap-aye-y-am
svâp-âyê-s
svâp-âyê-t
svâp-âyê~ma
svâp-ayê-ta
svâp-âyê-y-us
sôp-iê-s sâp-iâ-8 sôp-ie-t sôp-ia-t sôp-îê-nms sôp-ià-mus sôp-iê-tis sôp-iâ-tis sop-ie-nt sop-ia-nt
$ 7A6. Causatifs de !a première conjugaison latine.
Outre le verbe sêdâre, déjà cité, on peut mentionner, comme causatifs appartenant à la première conjugaison latine, necâre, plôrâre9 lavâre et clâmâre; mais le latin n’a plus conscience de leur origine causative, parce que le primitif a disparu ou a pris une forme trop différente.
Necâre3 répond au sanscrit nâé-dyâ-mi «je fats périr », eau— satif de nâs-yâ-mi (classe à) «je péris». Il y a encore en latin un autre représentant du sanscrit nâsdyâmi; mais il a une signification mitigée : c’est noeeo. En grec, à la racine sanscrite nas (pour nak} se rattachent véxvs et vexpos.
Plâro est, selon moi, une altération pour plôvo (§ 20); il répondrait donc au sanscrit plâvdyâmi, littéralement «je fais couler», causatif de la racine plu «couler». Cette racine se retrouve, avec substitution irrégulière de l’aspirée à la ténue, dans le latin Jluo, au lieu que pluit a conservé la ténue primitive. Dans lavâre (grec Aowy), l’une des deux consonnes initiales est tombée; mais, sauf l’absence de cette lettre, lavo ressemble plus que pléro au sanscrit plâvdyâmi «j’arrose» (au moyen «je me lave»). En vieux haut-allemand, le verbe causatil correspondant est Jlewiu4 «je lave».-En slovène, nous avons plev-i-m «j 1111 675 676 677 678
merge, je fonds»1, qui est le causatif régulier de phw-a-m « je
nage». .
Clâmo, dont j’ai expliqué le m comme le durcissement'd un
ancien n(§2o), signifie littéralement, d après cette hypothèse, «je fais entendre»; j y vois un parent caché de duo, hXvùj. Les causatifs correspondants sont, en sanscrit érav-ayâ-mi ^pour krâv-dyâ-mi) «je fais entendre, je parle»; en zend srav-aye-mt (même sens); en slovene slav-i-m «je célébré» (piimitif slujem «j’entends»); en ancien slave shvljuh (dans bkgoslovlpm «je bénis»); en russe slavlju «je célébré»; eh lithuanien slôwiju
(même sens)676.
$ 'jUj. Causatifs sanscrits en -payâmi. — Restes de cette formation
en latin.
Les racines sanscrites finissant par d677 prennent devant aya un p : ainsi stâ «être debout» fait au causatif stap-aya-mi «je fais tenir debout»; on en peut rapprocher le lithuanien stéwju (pour stôpju) «je suis debout» (§ 62a), dont le réfléchi stowjô-s «je me place» a gardé la signification causative. La racine sanscrite yâ «aller» fait yâp-dyâ-mi «je fais aller, je mets en mouvement». Les labiales étant assez souvent remplacées, en latin, par des gutturales678, je crois devoir, avec Pott5, expliquer le latin jacio comme étant pour japio, et 1 identifier avec yap-aya-mi. Il est vrai que jacio appartient a la troisième conjugaison
erbe (S iog\ 1) ne l’a nas rendu moins différent dejlewiu que ne l’est le latin jlua tu causatif lavo.
1 Voyez Metelko, Système de la langue slovène, p. 115.
2 Voyez S 7Ô5b.
1 Les racines qui, selon les grammairiens de l’Inde, finissent par une diph-thongue, doivent être considérées comme d’anciennes racines en d (S 10g , 2).
* Comparez, par exemple, quinque avec pâncan, vrévre; coquo avec pâcâtm,
'orétra®, en serbe pecem «je rôtis ».
6 Recherches étymologiques, i" édition, l. p. 190.
latine, dont le io répond ordinairement au sanscrit ^ y a (quatrième classe)et non klftaya (dixième classe). Mais les formes comme audio, audiunt, audiam étant semblables aux formes comme capio, capiunt, captant, il a pu se faire aisément qu un verbe de la quatrième conjugaison passât dans la troisième. Fadmets le même changement de conjugaison pour fado, que je rapproche du sanscrit Bâvâyâmi «je fais exister, je produis?? : le v radical du causatif sanscrit1 s’est durci en c (S i9 ). Le gothique nous présente bau-a (pour bau-ai-m) «je bâtis??, qui est la forme sœur du sanscrit bâv-dyâ-mi et du latin fado : il y a donc accord, â la deuxième et à la troisième personne, entre le caractère ai de baur-ai-s, bau-ai-th et le sanscrit aya de Mv-dya-si, Bâv-dya-ti. 11 est d’ailleurs tout aussi impossible, en se renfermant dans les langues germaniques, de voir la relation qui existe entre bauen « bâtir ?î et bin «je suis??, que d’apercevoir, en se bornant â la langue latine, la parenté de fac-io et de fu-i.
De même que le c de jado, j’explique celui de doceo comme le représentant d’un p sanscrit. Rapprochez de doceo, littéralement «je fais savoir», le désidératif di-sco, littéralement «je désire savoir», ainsi que le grec êSdnv, St$dtrx&. Si le d de ces formes est sorti d’un g (comparez àvfiriryjp pour nous
sommes conduits au sanscrit gmp-dyâ-mi «je fais savoir », causatif de gâ-na-mi (pour gnâ-nâ-mi) «je sais». Nous avons également un d dans le persan dâ-ne-m «je sais ».
Comme exemple d’un causatif latin où le p primitif est resté sans changement, nous citerons mpio, s’il est vrai qu’il corresponde au sanscrit râpdyâmi«je fais donner»2, causatif de la ra-
1 Le v de lavâyâmi représente ïû de bü. On a vu (S 39) que ie vriddhi de i’tî est nu (devant les voyelles de). Les racines en «t, au causatif sanscrit, ne prennent jamais le p.
2 J’ai admis autrefois que rapio pourrait être parent] de lup (présent lumpâmi) ^fendre, briser, détruire(comparez Pott, Recherches étymologiques, iTe édition, l, p. a58), d’où vient le latin rumpo. Mais cetto explication est moins satisfaisante.
cine râ «donner». Cette dernière racine n’est, ce me semble, qu’un affaiblissement de dâ : nous avons à côté de dâ une forme élargie dâs, de même qu’à côté de râ le dialecte védique nous présente râs. La racine lâ, que les grammairiens indiens expliquent par «donner» et «prendre», paraît aussi être originairement identique avec râ et dâ.
S 7Ù8. Restes de la même formation en grec.
Au nombre des racines sanscrites qui prennent irrégulièrement unp au causatif se trouve r, ou plutôt ar (§ 1) «aller»; le causatif est arp-âyâ-mi «je meus, je jette, j’envoie» (simm arpayâmi « sagittas mitto » ). Peut-être faut-il y rattacher le grec ipetne*)1, lequel, il est vrai, devrait faire, comme verbe causatif, êpe tirée*), èpstirae*) ou êpe tirette*)2. Par la perte du caractère causal, le thème èpztir a pris tout à fait l’apparence d’un verbe primitif. Il en est de même de iairlea, que Pott ramène, comme le précité jario, au sanscrit yâp-âyâ-mi «je fais aller». Si pliéle*> se rapporte également à arpayâmi, il faudra y voir une métathèse pour ipir-re*)3.
car il faudrait alors admettre que rapio a perdu sa voyelle radicale et a gardé la voyelle du gouna. Or, le latin n’aime point le gouna et conserve ordinairement la voyelle radicale : ainsi l’on a video ~ sanscrit vêdâyâmi «je fais savoir», causatif de la racine vid.
1 On pourrait voir dans peor une métathèse pour sipn; Te initial serait prosthétique, comme dans êXayà-s — sanscrit lagâ-s. Sonne, dans ses Epilegomena au Dictionnaire des racines grecques de Benfey (page aê), identifie le tt de craXwiy% avec le p du causatif sanscrit; la racine de ce mol serait svar, svr «résonner», et signifierait littéralement «ce qui fait résonner». En adoptant cette étymologie, que propose aussi Pott (Recherches étymologiques, 1” édition, I, p. a»5), nous aurions une autre racine sanscrite finissant en ar, r, qui aurait pris le p causatif. Peut-êlrc le
* lithuanien éwilpinu «je siffle», malgré son é au lieu de &, appartïent-H à la mémo racine; il faudrait alors tenir compte de la forme plus brève, citée par fiuhig, xmtlpja «il siffle» (en parlant d’un oiseau), où pjia répond au payafi des verbes sanscrits comme aipâyati «il fait aller, il meut».
2 Voyez SS 19 et 109*, 6.
■’ Peut-être que pin-ro) vient de la racine kstp « jutera ; d serait alors pour Hpîn'tw.
S 7A9. Causatif sanscrit en layâmi. — Restes de cette formation
en grec et en latin. '
La racine sanscrite m fâ « soutenir, dominer » prend au cau-satif un Z ; pâldyâmL Nous croyons reconnaître des formations analogues dans /3a'AA<w, <r1éXXû>, /aXX<y. Le deuxième X provient par assimilation d’un y : la forme plus ancienne était @dXjù>, aléXjù), Idkjcci, de même que âXXos est pour dXjos = gothique alja, latin alius, sanscrit anyd-s (§ 19). Quant au premier X, je le rapproche du l de pâldyâmi.
En effet, à côté de fidXjo), qui a abrégé la voyelle radicale (e&xXov), mais qui a encore conservé la longue primitive au parfait fiéGXv-xot, nous trouvons un primitif 6â L A côté de afléXjw, pobr o’IdXjcô («r7«Xxa), nous avons le primitif cr7â (torJàpu, ttrhifii} = sanscrit siâ, lequel, en combinaison avec différentes prépositions, exprime le mouvement2. A côté de idXjco, nous avons la racine sanscrite tff yâ «aller», qui est représentée en grec par typu (pour jljypu)3.
Peut-être faut-il rapprocher xéX-Xù> du sanscrit éâUyâmi «je meus», causatif de la racine cal «se mouvoir». Peut-être aussi mdX-Xoj (pour «rdX-jc», venant de atctS-ja») correspond-il au sanscrit pâddyâmi, causatif de la racine pad «aller». En latin, on
dont le p représenterait la sifflante sanscrite, comme dans xpeiav, que Fr. Rosen a rapproché de la racine sanscrite «dominer» (Big-vedæ specimen, admlationes, p. xi). Le même savant compare xpeuitvôs avec kéiprâ «rapide» (de kéip «jeter») et le latin crepusculum avec kiapâ «nuit» (ou mieux avec kêâpas).
1 Voyez S io<)\ 1.
a Remarquez aussi qu’il existe en sanscrit une racine sial? de même qu’à côté de pâ le sanscrit a la racine pal. A sial je rattache l’allemand s telle (vieux haut-allemand stellu, pour stelju), littéralement «je fais se tenir debout» = sanscrit stdlâyâmi.
* Comparez, par exemple, le futur ?7IM.fjNT ydsyanu avec ou lithuanien jd-sitt «equilaho». Voyez $ Ô83. — D’après celle explication, iinlot (§7^8) et i&Xkù) seraient deux causalifs différents d’un seul et même primitif.
pourrait rapprocher pel-lo, qui serait pour pel-jo. Toutes ces formes, si notre explication est iondée, auraient perdu 1 a initial du sanscrit aya, et auraient, en quelque sorte, passé de la dixième classe sanscrite dans la quatrième1.
Gomme les représentants ordinaires de la forme causative ou de la dixième classe sanscrite sont les verbes en soi, (pour sjoj, ajoj), on peut encore découvrir un causatif dans xa-Xeîü2. Le sens propre de ce verbe serait donc «je fais entendre» (comparez le latin clâmo, le sanscrit sravayami^. D apres cette hypothèse, xaXico serait une métathèse pour xA<x-&>, xkaF-év.
Remarque. -— Examen d’une opinion de G. Curtius. — Le verbe grec ï'rffit, dans lequel je vois une forme redoublée de la racine sanscrite ya, est expliqué autrement par Pott679 680, qui en fait le représentant au sanscrit âsyâmi n-je jette». Au contraire, Curtius adopte mon explication \ Mais je ne puis souscrire a l’opinion de ce dernier, quand il soupçonne mie parente entre la racine sanscrite yâ «■ aller» (et, par suite, le caractère passif y a qui en dérive681 ) et la syllabe 6v que nous trouvons à l’aoriste et au futur passifs en grec. Curtius cherche à appuyer le changement de y en B sur l’exemple de = sanscrit hyas «hier», et sur l’infinitif grec en trdcu — védique A dyâi (§ 862). Nous avons expliqué autrement (S 16) le rapport de yBés avec hyas; quant à l’infinitif en ct-Ocli , s il est en effet apparenté avec l’infinitif védique en dyâi> il faut, selon nous, reconnaître dans ces deux formes la présence du même verbe auxiliaire que dans les aoristes en dt}-v et dans les futurs en Qï)-aoy.<u (S 63o). Conséquemment, le B de a Bat répondra au d\ et non au y de dyâL
1 Comparez Pott, Recherches étymologiques, 1” édition, II, p. 45.
2 On a vu (S 109“, 6) qu’en sanscrit la caractéristique de la dixième classe n est pas bornée aux temps spéciaux : c’est une analogie de plus avec les verbes grecs en
S 760. Le causatif en zend et en ancien perse. — La forme sanscrite en payâmi conservée en prâcrifc et dans les langues du Caucase.
Le zend, à ce qu’il semble, ne prend point part au p que s’adjoignent en sanscrit les racines finissant par un â (§ 7^7). Du moins, je ne connais, dans cette langue, aucun exemple de cette sorte de causatifs. Une forme qui tend à prouver, au contraire, que le zend s’en abstient, c’est â-stâya «fais venir,
apporte » 1 = sanscrit âsiâpaya ( de *§TT « être debout » et de la préposition â «près»). Le zend âstâya est pour âstâ-aya, c’est-à-dire que Va initial de la caractéristique s’est fondu avec l’d radical. II en est de même pour l’ancien perse, où nous avons
TTT * ■ TH * • MT - th • wâstâyim (venant
dç ava-astâ-ayam) «j’établis » 2.
Au contraire, en prâcrit, même les racines finissant par une consonne prennent fréquemment au causatif la labiale en question; mais le prâcrit amollit le p en b et il élargit la racine en y ajoutant un â. On a, par exemple, gîvâbêhi «fais vivre». gîvâbêdu «qu’il fasse vivre»3. En sanscrit également, dans les récits populaires, qui n’emploient pas la langue classique, on trouve des formes de cette sorte : nous avons notamment gîvâ-paya4, qui correspond au précité gîvâbêhi, avec cette différence que le prâcrit a conservé la désinence de l’impératif hi (pour dV), laquelle s’est perdue dans la forme sanscrite. A la première personne du singulier, on a gîvâpayâmiù (= prâcrit gîvdbêmi), et au participe parfait passif gîvâpitaK (= prâcrit givâbidô).
En traitant de ces formes, Lassen rappelle0 que le mahratte
1 Vendidad-Sâdé, p. 55 et suiv.
- Inscription de Béliistoun, I, 63,66 et 69.
3 Voyez Delius, Radtces prdcritœ, s. v.gtv.
4 Lassen, Anthologie sanscrite, p. 18.
1 Imtitutiotm Unfîtup pvâcnücœ, p. 36o et suiv.
f' Lassen, ouvrage cité.
a encoi'e des causatifs de cette espèce. De mon côté, j’ai pu en constater la présence jusque dans les langues ibériennes 682 : en laze, comme le fait observer G. Rosen, la syllabe ap (après les voyelles simplement p) donne toujours aux verbes la signification transitive. Ainsi gnap « dévoiler, révéler» correspond au sanscrit gnâpdyâmi «je fais savoir», tandis que gna «comprendre» s’accorde avec gnâ «savoir». En géorgien, 1 exposant causatif se présente sous les formes ah, eb, oh, aw, ew, ow, sans que pourtant les nombreux thèmes verbaux qui finissent ainsi aient la signification causale. Ce dernier fait ne nous surprendra pas. Nous avons vu que la forme du causatif sanscrit (dixième elasse) s’est tellement multipliée quelle fournit à elle seule trois conjugaisons (et plus) au latin et les trois classes de la conjugaison faible aux langues germaniques (§ 109*, 6); mais il s’en faut que tous ces verbes aient le sens causal.
DÉSIDÉ1UTIF.
g 75i. Le désidératif sanscrit. — Formes correspondantes
en grec et en latin.
Nous passons à l’étude du désidératif sanscrit. Comme nous l’avons déjà fait observer ailleurs2, le grec en a conservé la forme, sinon le sens, dans les verbes comme 0«ëp*><rxû>, ytyva-trxcktf , StSdarxoa, SiSpcùrxco, TtTp&(TX&, ^miaxco, zsi-
7rptil<?xty, /ufi(p<xvcrxûj. La gutturale n’est tres-probablement, fi ans ces formes, qu’un accompagnement euphonique de la sifflante : il en est de même dans ëarxov et dans le futur archaïque latin
escit (§ 568). ^
Le sanscrit, pour former ses désidéra tifs, ajoute un a a la
racine, soit immédiatement, soit à i’aide de la voyelle de liaison t. Les verbes commençant par une voyelle répètent la racine tout entière, d’après le principe de la septième formation de l’aoriste (§ 585); ainsi as « s’asseoir 5) fait ows-t-s683 «désirer s’asseoir » ; ar, r «aller» fait arir-i-s «désirer aller»684 685. On a de même en grec dpapiVxcy. Les verbes qui commencent par une consonne prennent le redoublement : si la voyelle radicale est a, dans le redoublement on l’affaiblit en t686 687, d’après le même principe qui veut qu’en latin ïa soit toujours exclu de la syllabe réduplicative (§ 584). C’est, comme on le voit, H quon trouve le plus souvent dans le redoublement des verbes desideratifs, et l’accord avec le grec n’en est que plus frappant. On a bien, par exemple, yuyutsâmi «je désire combattre » (racine yod}, bubusarm «je désire être» (racine bû); mais on dit gïgadisâmi «je désire parler» (racine gad) et non gagadisâmi; de même, fa’ssWïft gigââsâmi, moyengignâsê «je désire savoir» (racine gnu), et non gdgnâsâmi. Rapprochez le grec ytyvé(rxa> et le latin (g'jnosco : ce dernier, comme toutes les formations -analogues en latin, a perdu le redoublement Avec mimnâsâmt, desidératif de
mnâ 1 «memorare, nunciare, laudare», s’accorde gLtyLvijGKto et le latin re-nnniscor.
Dans les temps spéciaux, le sanscrit place à côté de la sifflante un a, lequel, à la première personne, est soumis à Rallongement comme Va de la première et de la sixième classe ($ 434). En grec et en latin, cet a est représenté par les mêmes voyelles que Va caractéristique de ces classes (§ ioqa, *■)• fais suivre le tableau comparatif du présent et de l’imparfait de gignâsâmi, avec les formes correspondantes en grec
et en latin. 683
|
Sanscrit. |
PRÉSENT. Singulier. Grec. |
1 .qÿi ri UUIIM • |
|
f f t * A h • gtgna-sa-int |
ytyVOMTXOû |
no-sco |
|
gignâ-sa-si |
yiyvcb-GKSt-s |
no-sci-s |
|
gigna-sa-ti |
yiyvœ-tTHSt |
no-sci~t |
|
gtgiïâ-sâ-vas |
Duel. • f«*«****** -* | |
|
gigiiâ-saAas |
ytyvû>-GKS-TOV | |
|
gignâ-sa-ias |
ytyvé-(JK£-TOV | |
|
gtgtiâ-sâ-mas |
Pluriel. ytyvcô-o’xo-[ies |
no-sci-mis |
|
gigna-sa-ta |
yiyVùJ-(7K£-T£ |
no-sci-tis |
|
gigiui-sa-nü |
ytyVÛO-GKQ-VTt |
no-scu-nt |
|
âgignâ-sa-m |
IMPARFAIT. Singulier. èyiyvtû-oKO-v | |
|
âgignâ-sa-s |
èyiyvùô-<FX£-$ | |
|
agigna-sa-t |
èytyvay-trxe |
Duel.
Sanscrit. Grec. Latin.
âgignu-sâ-va ..................
âgignâ-sa-tam èyiyvùi-GKz-'vov .....
âgignâ-sa-tâm èyiyvaj-Gxé-rrjv .....
Pluriel.
agignâ-sâ-ma
âgignâ-sa-ta
àgignâr-sa~n
êyiyvcb-crxo-pev
èyiyvd)~(TK£-T£
èylyvw-GKO-v
Dans les temps généraux, les désidératifs sanscrits se contentent de supprimer la voyelle a adjointe à la sifflante, tandis qu'en grec et en latin la formation correspondante ne sort pas des temps spéciaux. On a, par exemple, yvco-tro), qui vient de ia racine simple yrtw, tandis que le futur du désidératif sanscrit est gigÂâs-i-éyâmi «je désirerai connaître». Si le futur latin noscam s’éloigne du grec en ce qu’il garde son sc, cela vient de ce que le futur de la troisième et de la quatrième conjugaison latine est, par son origine, un potentiel présent; ainsi noscês répond au sanscrit gignâsês et au grec ytyvao-xoïs (§ 6g3 ).
S 762. Le désidératif en zend. — Origine du caractère désidéra tif.
On doit supposer que le zend également a possédé la forme désidérative ; mais je n’en connais pas d’exemples certains. Peut-être faut-il rapporter ici les formes gigisanuha et
gigisâiti1. Ànquetil traduit le premier de ces verbes par «est viyante» et le second par «on s’approchera». Mais gigisanuha est évidemment un impératif moyen, comme përësa-nuha « interroge ! », qui vient tout de suite après ; gigisâiti est
1
Vendidad-Sâdé, p. 43i. Comparez Anquetil, Zend-Avesta, l,p. 398.
un subjonctif actif, comme jiërësâiti «qu’il interroge» dont il est suivi. Peut-être la première forme correspond-elle au sanscrit
fgRTTOTCr gigMsasva « x #
gignâsâti. Je n’ose rien décider à ce sujet, non plus que
sur les formes vmfiarëksanuha et
Tïiimarëksâiti1 qui ont également 1 air de désideratifs.
11 reste à rechercher l’origine de la lettre s qui est le caractère du désidératif. Elle provient probablement de la racine as « être », comme le s du futur auxiliaire et comme le s de l’aoriste des verbes primitifs. Comparez, par exemple, didîk-sâmi «je désire montrer fl avec ilêk-~syaiîii «je montrerai a, et ach di h-sam «ie désirai montrer» avec l’aoriste de l’indicatif âdik-êam, ainsi
J / Â> \
qu’avec les impératifs aoristes, comme bûsa, nêsatu (5 727).
INTENSIF.
§ 753. L'intensif en sanscrit et en grec.
Outre les désideratifs, il v a encore en sanscrit une autre classe de verbes dérives qui prend le redoublement . ce sont les intensifs. L’intensif donne à son redoublement un poids considérable; il frappe du gouna les voyelles qui en sont susceptibles, même les voyelles longues, et il allonge a en a. Ainsi vis « entrer a fait vêvêsmi (ou vêvis'îmi), pluriel vêvismds2: dtp «briller» fait dê'dîpmi (ou dê’dîpîmi); lup «couper» fait loBpmi (ou lolupîmi); Bûê « orner » fait bSSuémi (ou bô’bûsîmi) ; sak « pouvoir » fait sasahni
(ou sàsakîmi).
Comme co est très-fréquemment en grec le représentant d un 688
a long (§ 4), on peut voir dans la structure de tcelle d’un intensif sanscrit, avec cette seule différence que le verbe grec a passé dans la conjugaison en ù>688. Dans 'sraz7raAA<y, Sou-'&atÇd<T(TG), jua/jwa&y, {jLaifxdo-croj, Fi qui est venu se mêler à la syllabe réduplicative tient lieu de l’allongement de la voyelle radicale. 11 en est de même pour 'usomvvco (racine wd)2, potfAvdGû, poifjLvXXù), dont Ÿv radical a été remplacé par un o dans la syllabe réduplicative, pour éviter la diphthongue vt. C’est d’après la même analogie que sont formés Sot'Svï; et xoi-XvXkù).
S 754. Intensif des racines commençant par une voyelle, en sanscrit
et en grec.
Parmi les racines commençant par une voyelle, un petit nombre seulement forme des intensifs. La racine est répétée tout entière : si la voyelle radicale est a, la seconde fois on l’allonge. Ainsi ai «aller» fait atât, as «manger» fait asâs.
Je crois reconnaître une formation analogue dans le grec âycay, quoique ce dernier n’ait pas donné de verbe, mais seulement quelques noms comme dyaryos, dycjysvsr. Il en est ici de l’<y (pour â) comme de celui du précité (§ 753).
Au contraire, dans bviv^yu, qtuttIsvcû, artrdXkù), la voyelle radicale a éprouvé un affaiblissement analogue à celui des dé-sidératifs sanscrits (§ 761). Néanmoins, j’aime mieux rapporter ces formes à l’intensif qu’au désidératif3. Ajoutons encore àkcLkdfya et où la voyelle reste la même dans la syllabe radicale
et dans le redoublement.
1 J’ai déjà fait ce rapprochement dans mon Glossaire sanscrit, édition de i83o, page 1 i 3.
* Présent <ztvéa> ( pour 'aviFus), futur 'tsvzùgw.
3 Voyez Pott, Recherches étymologiques, i”éd. U, p. 70.
ni.
28
S 755. Intensif des racines finissant par une nasale. — Le verbe gang,
en gothique.
Les verbes commençant par une voyelle ne sont pas les seuls qui redoublent la racine tout entière : les verbes commençant par une consonne et finissant par une nasale, s’ils ont a pour voyelle radicale, répètent leur racine en entier, mais sans allonger la voyelle ni dans la syllabe radicale, ni dans la syllabe réduplicative. Si le verbe commence par deux consonnes, la première seule est redoublée; quant à la nasale du redoublement, elle se règle, suivant une loi phonique bien connue, sur la consonne dont elle est suivie. Ainsi dram « courir » fait dan-dram; Bram « errer » fait bamBram; gara « aller » fait Rapprochez le grec «rapt<pa«W (venant de Çalvù}), dont le v. quoique n’appartenant pas à la racine, se trouve reflété dans la syllabe réduplicativel.
!?■
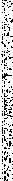
A gahgam se rapporte, comme je crois, le gothique ganga2 : gava ayant perdu, dans la seconde syllabe, sa partie finale «w3, le gothique a obtenu de la sorte une forme gang qui a tout l'air d’une racine. Aussi, en vieux haut-allemand, trouvons-nous un nouveau redoublement : giang (pour gigang), en allemand moderne gieng (§ Bqs). De même, dans la formation des mots, gang est traité comme une racine indépendante : nous avons, par exemple, le gothique gah-ts4 «marche» (inna-gahts «entrée » ,fram-gahts « progrès »). Le lithuanien nous présente comme formation analogue le verbe îengiu «je marche » 5.
1 Voyez S 598.
2 Voyez SS go et 48a.
3 L’a final de ganga appartient à ta caractéristique; nous avons, par exemple, à la troisième personne du piuriei, gang-a-nd,
4 Par euphonie pour gag-ts, avec suppression de la nasale. Le suffixe est le même que dans le sanscrit gâ-ti-s «marche» (pour gan-li s). Voyez S 91, a.
5 Le z lithuanien représente souvent un g ou un g sanscrit. Comparez zadas «parole» avec le sanscrit gad «parier».
S 756. Insertion d'une nasale dans la syllabe réduplicative, en sanscrit et en grec. — Intensif des racines finissant en ar, r.
H y a aussi des racines sanscrites qui, sans être terminées par une nasale, insèrent une nasale dans la syllabe réduplica-tive. Ainsi cal a se mouvoir?? fait cancal (ou éâcal);pal «éclater» fait pampul689 ; car «aller» fait cancur. Comme les liquides permutent volontiers entre elles, on peut admettre qu ici la nasale du redoublement représente la liquide l ou r. Il en est de même, en grec, pour beaucoup de formes redoublées, comme m'fi-7t\y)£U, 'SïipirptjfÂt, yiyypalvw, ytyyXvptos, yayyaXt^co, y dy y pat va, TOp6opV%&9 TCtîfTaXsv&f , TBvOpfjScJV, 'SfeflÇpïjSôJV.
Comme exemples de verbes où la liquide est restée invariable dans le redoublement, on peut citer pjap\mlpm, {jLopfjtvpû), pép-pepos, iuepfxaipa, psppypiZfij, xapxaipw, yapyaipm, fiopêopéfe, uropipupa, utopcpvpù). On peut rapprocher ceux des verbes sanscrits en ar qui, dans les formes affaiblies, contractent «r en r : à l’intensif actif, les verbes en question répètent la racine tout entière. Ainsi dar, dr «tenir, porter» fait dur-dhr-mi, pluriel dar-dr-mâs. Toutefois, les racines commençant par deux consonnes ne répètent que l’une d’entre elles et se conforment à la règle générale : par exemple, smar, smr «se souvenir» fait
Avec dÂrdarmi, potentiel dardrydm, troisième personne dar-drydt (pourdardaryâm, dardaryât), s’accorde le zend darëdaiiyââ2, que nous trouvons dans ce passage du Vendidad » 3 : *»&*»/(—
yata vëkrko caiwarësangrô barëiryâd haca joutrent nié-daredairyâd «quasi lupus quadrupes a génitrice filium eriperet», On peut se demander si nisdarëdmryâd vient de la racine sanscrite dhr, dr «porter» ou delà racine dar, df «fendre, déchirer» (en grec Sépœ, gothique taira), dont l’intensif est dardar dans le dialecte védique, dâdar dans le sanscrit classique. La première hypothèse me paraît la plus vraisemblable; quoi qu’il en soit, la forme en question est une preuve certaine que le zend prend part à l’intensif.
S 787. Intensif des racines ayant une nasale pour avant-dernière lettre. — Insertion d’un î ou d’un * entre la syllabe rédupiieative et la syllabe radicale.
Quelques racines sanscrites ayant une nasale pour avant-dernière lettre admettent cette nasale dans la syllabe rédupiieative. Ainsi Bang «briser» fait bdmBangmi; dans «mordre» (grec Sax) fait ddndahsmi; skand «monter» (latin scand) fait cdn-î-skandmi. Remarquez dans ce dernier exemple 1*1 qui sert de voyelle de liaison entre la syllabe rédupiieative et la syllabe radicale : il en est de même pour quelques autres racines de cette sorte. Un î ou un i peut aussi être inséré à volonté dans les intensifs des racines en ar susceptibles de la contraction en r : ainsi de kar, kr « faire » viennent edr-karmi, edr-î-karmi et cdr-i-karmi.
S 758. Intensifs comme pati-î-pad., pan-i-pat.
Comment expliquer les intensifs pan~î~pad et pan-î-pat, venant de pad «aller» et pat «tomber»690 ? On peut admettre qu’à côté de T^rpad et de tr^pat il y avait des formes nasaliséespand et pant. C’est ainsi quà côté de beaucoup d’autres racines finissant par une muette simple, il y a des formes faisant précéder cette muette de la nasale du même organe : tels sont, par exemple, pat et faut «allers1. A côté de dah «brûler s nous avons aussi la racine ^|f dahh, qui explique l’intensif dandah 2 : rapprochez le gotbique tandja3 «j’allumes, qui est avec eette dernière forme dans le même rapport que ganga «je vais» (§ 755) avec le thème intensif ^jf^T gaiïgam4.
Remarque. — La racine tand «allumer» en gothique, zand en vieux haut-allemand. — On vient de voir que nous rapportons le gothique tandja rr j’allume » à l'intensif delà racine sanscrite dah rr brûler». Graff5 pose pour le vieux haut-allemand une racine zantfi, qu’il cherche également à rapprocher du sanscrit dah, mais sans donner pour le n et le t l’explication que suggère l’intensif dandah. A la racine primitive dah ou à son causatif dâhay se rapporte aussi le vieux haut-allemand dâk-t ou tâh-i, en allemand moderne docht-, dacht «mèche»; ces formes, cpxi ont plus fidèlement conservé les consonnes radicales, sont devenues tout a fait étrangères a zand ou zant. Il arrive assez souvent qu’une moyenne initiale soit conservée sans changement dans les langues germaniques : c’est ce qui est arrivé, par exemple, pour l’intensif précité ganga «je vais» (S 755), tandis que le simple qvam «venir», qui se rapporte à la racine primitive gain, a régulièrement substitué la ténue à la moyenne.
S 789. Restes de l’intensif en latin.
En latin, gingrio a tout Fair d’un intensif sanscrit : Pott7 le
1 À pant se rattachent les cas forts de patin «chemin», ainsi que le latin ports, pont-is «chemin [par-dessus un fleuVe], pont». Le slave IMiTL puntï «chemin» est de la même famille. A pat se rapporte, entre autres, le grec 'mdxos. Voyez Glossaire sanscrit, éd. 18^7, p. 206.
9 Pâmai, Vil, iv, 86.
3 Sur le caractère causatif ja, voyez $ qhi.
4 Sur le t de tandja, voyez S 87, 1 ; la conservation du d est due à la lettre n qui précède. On peut rapprocher la forme sandja «j’envoie», dans laquelle je crois reconnaître le causatif de la racine sanscrite sad «aller» (sàdâydmi «je fais aller»), avec insertion d’une nasale.
5 Dictionnaire vieux haut-allemand, V, col. 686.
6 Avec z pour le gothique t, et t pour le gothique d (S 87, a).
7 Recherches étymologiques, 1” éd. Il, p. 75.
rapporte à la racine gî-, c’est-à-dire gar, gir (d’où vient le substantif gir « voix»). La syllabe réduplicative a un » au lieu de r, comme en sanscrit codeur et comme les formes grecques précitées (§ 756). A girami (ou gilami) «deglutio» se rattachent entre autres le latin gula et gurgulio : ce dernier a remplacé l par r dans la syllabe réduplicative.
S 760. Forme déponente de l’intensif. — Exemples de l'intensif actif.
La forme passive kde l’intensif sanscrit a ordinairement la signification active. Aussi les grammairiens de l’Inde y voient-ils, non pas un passif, mais une variété particulière de 1 intensif. Je ne puis partager leur opinion à ce sujet : 1 origine passive de cette forme, que j’appellerai déponente, n’est pas douteuse.
En sanscrit classique, on trouve plus souvent l’intensif avec ya que sans ya. Ainsi : Méûryâniê1 «ils voyagent» (de
car, S 756); Ulihyâsê2 «tu lèches» (de lih); dêdîpydmâna3 «brillant» (de dîp). Dans dôduydmâna^ «agité» (de dû ou du) nous avons à la fois la forme et la signification passives.
Comme exemples d’intensif sans ya, nous citerons le participe présent lêïihat, moyen lêlMnâ5 «léchant». Le dialecte védique fait un plus fréquent usage de la forme active; tels sont nânadati «ils résonnent» (de nad)ù9 aBipratiônumas «nous célébrons» (de nu précédé des prépositions aBî et pra), gôkavwu « j’appelle» (de hu, contraction pour hvê, avec la voyelle de liai-
1 Mahâbhârata, I, vers 7 91 o.
2 Bhagavad-gîtâ, XI, 3o.
3 Nalas, III, 12; Drâupadî, II, 1.
4 Drâupadî, II, 1.
' Mahâbhârata, lit, vers io39& et taaâo.
6 Toutes les formes redoublées qui adjoignent immédiatement les désinences a la racine suppriment le n de la troisième personne du pluriel (8 â5q). Rapprochez de la racine nad le gallois nadn « crier ».
son î, § 753), â-navînôtl ail remua, excita» (de nud «remuer, pousser», précédé du préfixe a)691 692.
VERBES DÉNOMINATIFS.
S 761. Formation des verbes dénominatifs en sanscrit. — Les dénominatifs en aya. — Verbes correspondants en latin.
Les verbes dénominatifs693 sont d’un usage moins fréquent en sanscrit que dans les langues de l’Europe. Ils se forment soit en prenant la caractéristique de la dixième classe, soit en ajoutant ya, sya, asya. Je décompose sya et asya en s-ya, as-ya, et je reconnais dans (a)s, as la racine du verbe substantif (§ 648).
Les verbes latins des première, deuxième et quatrième conjugaisons répondent aux verbes sanscrits de la dixième classe (S 109% 6); conséquemment laud-â-s694, nomin-â-s, lumin-â-s, color-â-s, jluctu-â-Sy œstu-â-s, domm-â-s, regn-â-s, sororï~â~s 695, cœri-â-s, plant’-â-s, pîsc-â-ris, alb’-ê-s, calv-ê-s, cau-ê-sr miser-ê-ris, feroc-î-s, lascw-î-s, lipp’-î-s, abort’-î-s, jiri-î-s, siC-l-s s’accordent avec les formes sanscrites comme kumâr-àya-si «tu joues » (de kunutrd « garçon1 ), suM’-dya-si s tu réjouis 7? (de suUa «plaisir»), yôktr-dya-si «tu attaches» (de ÿdfom «lieu»696 697 698), ksam-dya-si «tu supportes» (de Marna « patience 77). On voit par ces exemples que le sanscrit, comme le latin, supprime devant la caractéristique la voyelle finale du mot primitif; sans cette suppression, on aurait yôktra-aya-si, qui, en se contractant, donnerait yâktrâyasi. Ce qui prouve que dans les formes latines comme cœn-â-s Yâ n’appartient pas au mot cœna, c’est qu’on a regn-â-8, calv-ê-s, lasciv-î-s, où la voyelle finale du theme est rejetée devant Yâ, Yê ou Yî de la syllabe formative. Au contraire, dans les verbes comme Œstu-â-s, jluctu-â-s, Yu de la quatrième déclinaison est maintenu. On peut remarquer, à ce sujet, qu’en sanscrit également, Yu, dans certaines formations nominales, se maintient devant une voyelle avec plus de ténacité que 1 a et que IV; on a, par exemple, manu (nom d’une divinité) qui donne un dérivé mânav-â-s3 «descendant de Manu, homme», tandis que suci «pur» fait sâué-d-m «pureté» et que dasarata (nom d’homme) fait dâéarat-i-s «fils de Dasarata». Cependant, devant un î, IVe de la quatrième déclinaison latine disparaît dans certains verbes dénomînatifs, comme dans le précité abort-i-s.
S 762. Verbes dénominatifs grecs en ao), eo>, o&>, a&M, tfa.
Je crois que les dénominatifs grecs en aw, cûj, où), a?&>, ont également supprimé la voyelle finale du thème nominal dont ils sont formés. Je divise donc de cette façon : dyop’-a£ct>, âyop-do-[iou, (JLoptp’-oco, hvktg-Ôù), ‘Ziïo'kefi-Sco, ts'oXsft-éoj, 'ssoXefi-t'lù). Dans Ta de a&y, je reconnais Y a de ayâ-mi, et dans le ? une altération de y (§ 19). Dans les formes en aw, ea?, où), la semi-voyelle a été supprimée; les verbes en soj, oco ont, en outre, opéré le changement très-ordinaire d’un a en s, 0 (§ 3). Les verbes en doivent, à ce que je crois, leur « à l’affaiblissement d’un ancien a : quoique le changement de 19a en { soit moins fréquent en grec qu’en latin et en gothique, il n’est pourtant pas sans exemple; ainsi, pour citer un cas qui se rapproche assez de celui que nous examinons en ce moment, i'&y, t^opat correspond à la racine sanscrite sad «s’asseoir», gothique sat (sita, sat),
S 763. Devant les formations en a?&>, où), gw, ow, le thème primitif
supprime sa voyelle finale.
C’est sans doute parce que IV est la plus légère des voyelles que les formes en i&y sont plus employées que les formes en et que notamment les thèmes qui ne perdent point une lettre finale devant l’élément dérivatif prennent presque tous la forme en iloi. On a, par exemple, «ro<î-<?<w, âycov-Imitai,
àxovT-ftfi), âvSp-t^ù), alpiaT-i%(*)9 dXox-/?<y, yvvai)t~t%ù), &copaK-4%ù)9 xvv-ffyk), çwù)7f-{£cû , xepaT-/?6>, xepfxaT-/&y, éppux,T~t%ù). Mais on dit éppL-d^Ct), èvopL-d£&9 yovv -dlofxat1, que je ne crois pas devoir diviser en êpfxd-lo, è?opta-?<y, quoique au point de vue de la grammaire grecque on puisse être tenté d’identifier l’a de
!
be primitif n’est pas yovv, mais yovvax, d’où viennent yovvar~os, yoûvat-a.
épfJidÇ<v, ovopctÇ&r, dyopdÇùt, dyopaofiai avec celui des thèmes nominaux correspondants. Ce serait rompre sans nécessité l’analogie qui rattache ces verbes aux verbes comme bra -o££opa<, Xt0’-d^oj, eiK-dlo) (du thème sïhot}, èv$i~aoj, ysvei-dw, «reXex’-act), vspiscf-dù), ainsi qu’aux dénominatifs sanscrits en aya : puisque o et v, et quelquefois aussi v et t tombent devant la dérivation a<w, a?co\ il est naturel de supposer la même chose pour la.
Gomme les thèmes en a et en y (pour â, S 4) forment de préférence des verbes dénominatifs en a<w, a&y, tandis que les thèmes en o donnent plutôt des verbes en oœ, on peut croire que la voyelle finale du thème a exercé une certaine influence sur le choix de la voyelle dérivative : l’a et Y y favorisaient le maintien de la primitif, tandis que les thèmes en o699 700 701 donnent naissance volontiers à des verbes en o<y. Mais, malgré cette sorte de reflet de la voyelle finale du thème, nous devons regarder tous ces verbes dérivés comme présentant une seule et même formation, dont l’origine est antérieure à la séparation des idiomes. Le même principe qui a donné au grec les verbes comme aîpuxT-éa, â^psv-écj, mp-éw, xcLToÇpv-ÔG), S-aXacrofa)-^, Kvt<Ta-(a)-6câ9 est aussi celui qui a fourni eroXep(o)-é&f, yjpva{p)-60), àyHv'k{o)~6oj', et la même formation qui a donné xvv-dto, yevetty-dû), Xopt(o)-a<y, àv?i(p)~dù)9 veftô«7(*)-flccy, t3'eXex(y)-a« se retrouve aussi dans dyopfy-ao-fxai, ToXfjt(a)-oi», A^(a)-a(y, viK^ydct).
En résumé, les verbes grecs en a&w, a<y, gw, o«, iî& me paraissent tous répondre aux dénominatifs sanscrits en aya (première personne ayâ-mi, zend ayê-mi), et puisque le sanscrit, le zend et le latin suppriment la voyelle finale du thème nominal
devant la voyelle de la dérivation, je suppose que le grec opère la même suppression1. Là où la voyelle finale du thème reste (et cest ce qui arrive seulement avec quelques thèmes en $ et en u), on la fait suivre de la voyelle de la dérivation; exemples :
Stipi-'do-fJLOU, b(ppv-6cü, l'xfiv-dù).
Quant aux formes comme Stjpi-o-ftcu, p7t/-o-^œê , privi-a, psOv-a), Saxpv-ù>, elles appartiennent à une autre classe de dénominatifs qui se retrouve aussi en sanscrit : nous y reviendrons
plus loin.
$ 764. Dénominatifs gothiques de la première conjugaison faible. — Mutilation du thème nominal, en gothique, en sanscrit et en grec.
Les langues germaniques également suppriment la voyelle finale du thème devant le j (pour aj = sanscrit aya) ou devant la voyelle de la dérivation verbale. Ainsi, en gothique, audaga (nominatif audag’-s, § 13 5 ) « heureux » fait audag’-ja «je bénis » ; gaura (nominatif gaur’-s) « triste » fait gawr’-ja «j’afflige » ; shafti (nominatif skaft’-s2) «création» fait skaft’-ja «je crée»; manvu (nominatif manm-s) «prêt» fait manv-ja «j apprête»; maurthra (nominatif maurthr, § i53) «meurtre»® fait maurthr’-ja «je tue »; tagra (nominatif tagr’-s) «larme »4 fait tagr -ja «je pleure ». Le verbe dénominatif ufar-skadv-ja «j’ombrage », qui a conservé au présent i’tt final du thème skadu (nominatif skadw-s) « ombre », est unique en son genre ; au contraire, thaursu (nominatif thaur- 702 703 704
sus) «sec» a fait thaurs-jan1 ; dauthus a la mort» a fait dautli-
ja «je tue»2.
Comme verbes dénominatifs dérivés d’un theme a consonne, nous citerons namn-ja a je nomme», venant de naman (nominatif nantâf S i4i), et aug-ja a je montre», venant de augan (nominatif augô) «œil». Le premier de ces verbes a conserve la consonne finale du thème, comme le latin nomino et les formes grecques telles que aifiar-oey, acfiaT-t&; mais il a fait subir a la partie intérieure du mot une mutilation analogue a celle des cas faibles en sanscrit (nâmn-as «nominis»). Au contraire, aug-ja (pour augan-ja ou augui-ja) suit le principe des dénomi-nalifs sanscrits comme varni-dyâ-mi «je couvre dune cuirasse», pour varinan-uyâ-mi, venant du theme vqviïkm. Rapprochez aussi les verbes grecs dérivés de thèmes comparatifs en gi>, tels que jSeÀTt(ov)-èa>, fist(pv)-6a), s'\wt<7(qv)~6cû 9 xam[ov)-6o) 3.
Les verbes grecs dérivés d’un thème en s suppriment cette consonne ainsi que la voyelle précédente : on en sera d autant moins étonné que cette classe de noms a egalement perdu son s à la plupart des cas de sa déclinaison (§ 128). On a, par exemple, -crX»;p(e<venant de 'crAj/pe* (§ 1&6); aky{e<j)-sù), venant de âXyes ; daO£v(sa)-éoj, venant de daOevss ; t, venant de Tevye$9 ytip{a<T)~<xcj, venant de ytjpas (S 128).
§ 765. Dénominalifs gothiques de la deuxième et de la troisième conjugaison faible.
Nous retournons au gothique pour faire observer que la deuxième et la troisième conjugaison faible contiennent aussi
1 Employé comme impersonnel : thmirs-jith mik (en allemand moderne mich dur&tet) «j’ai soif».
4 Comparez le grec B-avar'-éat, venant du thème &avato. — Je ne crois pas que dauth’-ja vienne de dauth(a)~s «mortuus», car en vieux haut-allemand todiu dérive évidemment de tôd (thème toda)«mors» et non de tôt (nominatif tâter) «mortuus».
3 On a, au contraire, ©Aeov-d&w, et non ©Ae-d&>.
quelques verbes dénominatifs. On a vu (§ ioqa, 6) que la deuxième conjugaison faible représente par ô la caractéristique sanscrite aya : elle a donc rejeté le ^y, et contracté les deux a en 6 (= a, § 6q, i). Nous avons, par exemple, jislz-ô-s «tu pêches » en regard du latin pisc-â-ris ; le thème gothique jiska (nominatiffisU-s, S i35) a supprimé son a devant la dérivation, comme en latin pisci a perdu son e(§ 761). Le gothique tkiu-dari-â-s «tu commandes», venant du thème thiudana(nominatif thiudan-s) «roi», a la même formation que le latin domiri-â-ris, puisqu’il y a identité d’origine entre les noms gothiques comme thiudans (première déclinaison forte) et les noms latins comme dominus, ainsi qu’entre la deuxième conjugaison faible en gothique et la première conjugaison latine. Aux verbes latins venant des noms de la première déclinaison, comme cœri-â-s (S 761), répondent les verbes gothiques comme fairiri-ô-s «tu accuses», venant du thème féminin fairinô (nominatif fairina) «faute». A œstu-â-s, jluctu-â-s répond, mais avec suppression de Vu, Imt’-ô-s «tu désires», venant de lustu «plaisir, désir».
Les thèmes en an affaiblissent leur a en i, comme au génitif et au datif. On a, par conséquent, fraujin-ô-s «tu règnes», venant de fraujan «seigneur» (nominatiffrauja, génitiffraujin-s), comme en latin nous avons nomn-â-s, lumin-â-s (§ 761); même formation pour gudjin-â-s « tu exerces le sacerdoce », venant de gndjan (nominatif gudja) «prêtre». Quelques thèmes en a, avant de former leur dénominatif, prennent un n devant lequel Va s’affaiblit en i; exemples : skalkin-ô-s « tu sers », venant de skalka (nominatif skaW-s, génitif skalki-s, § i q 1) « serviteur » ; horin-â-s «pot^evets », venant de hora (nominatif hor-s) «/xo*-
» ; reikin-o-s «tu règnes», venant de reikja ( nominatif reiki, S 153) «royaume».
La troisième conjugaison faible contracte la caractéristique aya en ai et répond à la deuxième conjugaison latine. Comme exemple de dénominatifs de cette classe, nous citerons arm-ai-s «tu as pitié de», venant de arma (nominatif arm-s) «pauvre»; on en peut rapprocher le latin miser-é-m, venant du thème miserô (nominatif miser, pour miser u-s}. Citons encore ga-hvaü’-ai-s «moraris», venant du thème féminin hveilo (nominatif hveila) « tempus, mora».
8 766. Verbes dénominatifs en slave.
En slave également, les conjugaisons qui correspondent à la dixième classe sanscrite (§ 5o4) servent à former des verbes dé» nominatifs : A^A4trf» dêV-aju-h «je travaille», aoriste dèl’-a-chü, venant de dêlo (à la fois thème et nominatif-accusatif neutre705) «ouvrage»; bogat’-êju-n «je suis riche», deuxième personne bogal’-eje-si, aoriste bogat’-ê-chü, venant du thème adjectif bogato (nominatif bogatü) «riche»; rüd’-ê-ti sah «rubescere»2, présent riisduh, par euphonie pour rüdjuh (§92*); seri-ju-h sah «ytwém», deuxième personne sen-i-si sah, aoriste sen-i-chü sah, venant de sena «femme»; glagoV-ju-h «je parle», deuxième personne glagol’-je-si, aoriste glagol-a~chü (S 5o4), venant de glagolo «parole».
S 767. Verbes dénominatifs en lithuanien.
Le lithuanien aussi emploie les conjugaisons sorties de la dixième classe sanscrite pour former des verbes dénominatifs (§ 506). Nous citerons : raédôn-oj~~u «je suis rouge», venant du thème adjectif raudôna «rouge» (nominatif raudôna-s); bàk-ôj-u «j’ai l’air blanc», venant de bàlta «blanc» (nominatif bàita-s}; asar-ôj-u «je verse des larmes», venant de asara (ié-
minin) « larme »; durn-oj-u «je suis en fureur», venant de durna «fou» (nominatif durna-s); êikét’+ej-it «je suis avare», venant de sikstù-s «avare»; cpt’-ij-u «je purifie», venant de cpta-s «pur»; ga-taw-ij-u «j’apprête», venant de gâ-tawa-s «prêt»; püst’-ij-u «je dévaste», venant de püstct—s «désert», stÿr’-ij-u «je gouverne [un vaisseau]», venant de stÿr-as «gouvernail».
11 ressort de ces exemples que le lithuanien, comme le slave (S 766), le germanique, le grec et le latin (§ 761 et suiv.), rejette devant la dérivation verbale la voyelle finale des thèmes adjectifs et substantifs. Mais dans les cas peu nombreux ou le slave tire un verbe d’un thème substantif finissant par n, cette liquide est maintenue : ainsi l’on a, en ancien slave, snamen-aju-h «je désigne», venant de snamen (nominatif snamü, § 266).
S 768. Dénominatife sanscrits mpayâmL —* Restes de cette forme conservés en lithuanien et en ancien slave.
Retournant au sanscrit, il nous faut encore remarquer que certains thèmes en a insèrent un p devant le caractère aya des verbes dénominatifs, et allongent Y a final du tlieme. Ainsi aria «chose» fait artâpdyând, satyâ «vérité» fait satyapayami, H y a accord entre ces verbes dénominatifs et les formes causatives comme stâp-âyâ-mi «je fais se tenir debout», dapayami «je fais
donner» (S 767).
Nous avons rapproché du p en question le w lithuanien de stowmi ou stow-ij-u «je suis debout», de daw-iaii «j ai donne», ainsi que celui des formes appelées imparfaits d’habitude, comme sith-daw-au (pour sùk-duwiau) «j’avais l’habitude de tourner»1 (S 524). Je rapporte aussi à un p sanscrit le w ou Vu des dénominatifs lithuaniens comme prâ-rak’-auj-u «je prédis», aoriste
1 Comparez ramollissement du p en v dans les tonnes françaises comme savoir, pour êapoir.
‘prârakawau, venant de praraka-s « prophète, devins (§ 20): pastinink’-auj-u «je jeûne», venant de paslinmka-s «jour de jeûne»; gaspadôr-auj-u «je suis hôte», venant de gaspadôru-s «hôte, maître de maison»; gaspadïn-duj-u «je suis hôtesse», venant de gaspadinë «hôtesse»; kar-auj-u «je fais la guerre, je combats », aoriste kar-dwau, venant de kara-s « guerre, combat » K
nmm
Va qui, dans toutes ces formes, précède Yu ou le w de la dérivation verbale, est, à ce que je crois, le représentant de Yâ qu’en sanscrit et en prâcrit nous trouvons dans les causatifs formés de racines terminées par une consonne (§ ”5oV G
les thèmes nominaux finissant par une voyelle rejettent celle-ci en lithuanien, auj et awa se trouvent correspondre a la caractéristique âpay, âbê des causatifs sanscrits et pracrits comme gîv-âpâyâ-mi, gîv-âbê-mi. Comparez au pluriel les formes lithuaniennes comme kar-duja-me, har-âuja-te} kar-awa-vtie, kar-awa-te avec les formes sanscrites comme giv-âpâyâ-mas, giv-apaya-ta; et, à l’imparfait, dgîv-âpayâ-ma, âgîv-âpaya-ia. On peut objecter que ces formes sanscrites se trouvent seulement dans des écrits modernes en langue populaire; mais il arrive souvent que le langage populaire conserve d’anciennes formes qui ne sont plus admises par les écrivains classiques. Rappelons à ce sujet 1 emploi en laze du p des causatifs sanscrits comme gnâpdyâmi
(S 7&e).
Il reste à examiner de quelle manière le lithuanien répartit les formes en u et en w, comme kar-duj-u et kar-dwa-u (aoriste). Le p sanscrit (= b prâcrit) a pris la forme du iv devant les voyelles, tandis que devant la semi-voyelle j on préfère la vocalisation du w en u, auj-u, auja-mc étant plus aisés a prononcer que awj-u, awja-rne. Rapprochez, à ce sujet, la relation qui existe en gothique entre le nominatif thius «enfant, servi-
1 On trouvera encore d’autres formes de la même sorte dans Kurschat, Mémoires pour servir a la connaissance de la langue lithuanienne, II, p. agS et suiv.
leur » (pour thiv-s, venant du thème thiva) et le génitif thivi-s, le datif thiva, et les cas du pluriel thivô-s, tliiv-ê, thiva-m, thiva-ns.
Tous les verbes lithuaniens en auj-u, awa-u1 ne sont pas des dénominatifs : certains d’entre eux se rattachent à des causa tifs sanscrits ou à des verbes de la dixième classe. Tel est, par exemple, rék-auj-u «je fais du bruit», en regard duquel on pourrait s’attendre à trouver en sanscrit une forme vâc-âpâyâ-mi2 (pour vâc-dyâ-mi «je fais parler»), si l’on admet que le r lithuanien tient ici la place d’un v (§ 20).
En ancien slave, nous rapportons ici les verbes finissant à la première personne du présent en o\fw» uju-h3 (deuxième personne ovfieuuH uje-si) et à l’aoriste en ova-chü ou eva-chü, La caractéristique ma, cm4, qui s’étend à toutes les formations de la seconde série 5, correspond au lithuanien awa et au sanscrit apay. Nous citerons comme exemples Kovfnoijm kup’-uju-ii «j’achète », deuxième personne kup’-uje-si, aoriste kup’-ova-chü, venant du thème kupo, nominatif kapü «mercatura»; ver-uju-h «je crois», aoriste vêr-ova-chü, venant de vêra (à la fois thème et nominatif) «croyance»; vïdov-uju-h «je suis veuve», aoriste vïdov -a-chü, venant de vïdova; KpdAtotrY706 kralj-uju-h «je règne », aoriste kralj’-eva-chü (par euphonie pour kraljovachüj, venant du thème kraljo «roi», nominatif KpdAk kralï (§ 258); klistj’-uju-h «je fais du bruit», aoriste Mist’-eva-chü (pour klistj-eva-chü), venant du thème klisijo «bruit», nominatif kliétï. Mais je ne puis reconnaître l’infinitif d’un verbe dénominatif dans stav-i-ti «placer», littéralement «faire se tenir debout», quoique je voie dans son v, comme dans le v des dénominatifs en question et dans le iv du lithuanien stow-j-n, ramollissement d’un p sanscrit. C’est plutôt un causatif qu’il faut voir dans ce verbe , que je rapproche du sanscrit stâpdyâmi (§ 767).
S 769. Origine des verbes dénominatifs grecs en cvrco, ÀAo>,
atpù) et atvw.
Nous avons déjà rapproché1 les verbes grecs en acrco et en XXea des dénominatifs sanscrits en ^ ya> Le deuxième a ou a provient d’un j par assimilation régressive707 708, comme dans les verbes de même forme correspondant aux verbes sanscrits de la quatrième classe. Mais tandis qu’en sanscrit on allonge, quand elle est brève, la voyelle finale du thème nominal primitif, le grec rejette cette voyelle709; exemples : àyyikpour âyye\(o)-j&>9 'ssoixiXktM) pour ufoixû.fy-jw, aîxdXkeû pour aixa\(o)-j<*>9 jua-Xda-croj pour ixaXax(oyjù}, fietXiaerco pour pst\tx(o)-j<v.
Les thèmes en p, en po et en v vocalisent le j en t et le font
passer dans la syllabe précédente, au lieu de l’assimiler à la
liquide; exemples : rexpaip-o-pat pour 'rexpicLp-jo-fmt, venant de
Texfiap ; xaOotip-ôô pour KaBap(o}-]v, venant de xaQapo ; (xsycttp-cû
pour peyap-jw, venant, non pas de pisya-s, mais du thème
des cas obliques pt,syoïko, avec changement de X en p 710 ; jaeXouW
pour peXav-jù}, venant du thème pteXap; 'æotpaivc*}, 'zseTvaivw,
« * *
rexraiv(kt9 d(ppatvoj, eù<ppa(voj, pour ^tsoipavjù) 9 «reTraiÿca, TSXTCtvjù), âtypcLvjù), sv<ppavj&, venant des thèmes 'tsoip-ev, gtsttop, tsxtop, à<ppov9 sô(ppov9 qui, dans le verbe, ont conservé leur ancien a (S 3).
Les verbes comme àpopatvù>9 xvp.aiW, <nrepiiou'vco 9 crvpaipa), y&t(iou'vG*9 venant des thèmes substantifs en (mr, doivent probablement leur v à une période antérieure, car le suffixe par est une altération de pav = sanscrit man, latin men, min1-
Mais il reste un très-grand nombre de dénominatifs en atvoo, dont le thème nominal primitif ne finit ni par un v, ni par une lettre qui puisse provenir d’un v. 11 me paraît impossible de dire quelque chose de certain sur l’origine de ces verbes; mais ce que je ne puis croire, c’est que le grec ait de lui-même inventé de pareilles formations, qui ne se rattacheraient par aucun lien aux formes déjà créées dans la période indo-européenne. Il se peut que les thèmes finissant par un v ou par une lettre provenant d’un v aient simplement fourni le type des verbes en aivôj : on sera en droit de dire alors que àAeouW, dxra/vw, yXvxalvùJj B’SpfÂatvw, êptSaivat, xtjpatvco ont suivi la route frayée, de même que dans les idiomes germaniques beaucoup de thèmes nominaux, en s’élargissant par l’addition d’un n ou de la syllabe an9 ont passé dans la déclinaison communément appelée faible. Peut-être aussi y a-t-il quelque rapport entre certains verbes en cuvcd2 et la formation sanscrite en aya, de même qu’en lithuanien nous avons cru pouvoir rapporter à cette formation les causatifs et les dénominatifs en inu (§ 7 45 Le v représenterait le sanscrit; quant à la diphthongue au, elle pourrait être considérée comme représentant la qui, dans la plupart des thèmes dénominatifs en yaf précède la semi-voyelle : en effet, quoique cet â appartienne au thème nominal et quoiqu’il soit d’ordinaire l’allongement d’un a bref (cirâ-yâti «il tarde», venant de cira «long»), néanmoins, dans le cours des temps, il a pu être traité comme s’il faisait partie intégrante de la dé rivation. Devant cet ai, le grec aurait alors supprimé la voyelle
finale du thème nominal primitif, comme il la supprime devant les formations en aw, etc.
Il y a encore un autre moyen de rattacher au sanscrit ceux des verbes en ouvu qui dérivent de verbes plus simples. Le rapport qui existe entre avctivca, iïpaivco, xpaSatvo), yctkatvM et avco, Spaco, xpaSàuv, xaXa'o*, est analogue à celui qui existe entre le védique caranyami et je vais » et le simple cârâmi. La forme élargie vient du nom d’action edrana «la marche»1. Quelques verbes sanscrits de cette sorte ne sont pas exactement conformes au nom d’action dont ils dérivent : ils en affaiblissent la voyelle radicale, ou ils opèrent une contraction, ou ils ont la voyelle radicale pure, au lieu que le mot primitif prend le gouna; tous ces changements paraissent provenir de la surcharge qu’amène la dérivation verbale. Ainsi Bârana «l’action de porter, de conserver» (racine Bar, Br) donne Buranyâmi «je conserve2»; îvd-ram «la hâte» (racine tvar) donne turanyami «je me hâte»3; coram «l’action de voler» (racine car) donne curanyàmi «je vole » 4„ Comme toute racine est capable en principe de former un nom d’action en ana, et que notamment nous voyons tous les infinitifs germaniques et ossètes provenir de ces noms 5, il ne faudrait pas s’étonner si le grec avait conservé certains dénominatifs de cette sorte, dont les primitifs nominaux se seraient perdus. Ainsi avœivoâ (pour amvjco) pourrait venir d’un thème nominal perdu aôavo ou œùavti. Napà(vù>, à côté duquel nous ne trouvons pas un verbe plus simple, rappelle le sanscrit mdrana-m «l’action de mourir» (racine mar, mr «mourir», causatif md-rdyâmiy Rappelons ici les noms abstraits féminins en ovn qui
t
a
k
5
Au sujet de n, pour n, voyez S 17h.
Rig-véda, I. l, 6 : b'uranyântam.
Rig-véda, I, cm, i : turanyan.
Westergaard, Radices sanscrite, p. 337.
Ainsi l'infinitif ossète baïin «lier» répond au nom sanscrit bandana «faction de
lier» (S 87/1).
correspondent aux substantifs sanscrits en anâ ou anii, comme yâcanâ «precatio», arhanâ «honoris testificatio ».
L’explication qui vient d’être proposée pourrait s’appliquer aussi à une partie des verbes en ava, qui doivent peut-être leur origine à des thèmes nominaux perdus en avo.
S 770. Origine des verbes dénomma tifs gothiques en na.
Le gothique nous fournit une nouvelle preuve de ce fait, que, pour expliquer les verbes dénominatifs, il faut se reporter à un état antérieur de la langue et consulter les idiomes congénères. Nous avons en gothique une classe de dénominalifs dans lesquels le n joue également un rôle, bien qu’il ne faille pas songer à établir aucune relation entre ces verbes et les verbes grecs en atvco, dont il vient d’être question, quelle que soit l’explication qu’on adopte pour ces derniers. Je veux parler des dénominatifs gothiques comme ga-fullna «impleor», us-gutna «effundor», distauma «disrumpor», and-bundna «solvor», gu-haüna «sanor », fra-qvistna «perdor », ga-vakna «excitor », us-lukna «aperior», dauthna «morior». Gomme je l’ai fait déjà dans mon premier ouvrage1, je rattache ces verbes gothiques aux participes passifs sanscrits en m, comme fiug-nd «plié», auxquels répondent en grec les noms verbaux en vo-s, comme <r1vy-v6$, a-epL-vôs. Les participes passifs gothiques ont la même formation; mais ce qui leur donne un aspect un peu différent, c’est qu’au lieu de joindre le suffixe na immédiatement à la racine, ils intercalent une voyelle de liaison a(§834);ona, par conséquent, bug-a-n(af$ «plié» en regard de bug-nà~s.
Au contraire, les verbes tels que ga-fullna se rapportent à un état antérieur de la langue, où le suffixe se joignait encore immédiatement à la racine, comme en sanscrit et en grec.
1
Système de conjugaison de la langue sanscrite, p. 125 etsuiv,
Le présent ga-skaidna s je me sépare»1 se trouve donc plus en accord avec le parlicipe sanscrit cin-nu-s (par eupho
nie pour cid-nd-s) « fendu » que ne Test le participe gothique skaid-a~n{a)-s. Comparez de même and-bund-na «je suis délié, je suis délivré » avec bund-a-n(a)-s «lié»; bi-auk-na «je suis augmenté» avec bi-auk-a-n(a)-s «augmenté»; fralus-na «je suis dissous, détruit, perdu» avec lm-a-n(a}-s «dissous» (en sanscrit Jû-nd-s «détaché, arraché»); ga-luk-na «je suis fermé» avec ga-luk-a-n(a)-$ «fermé»; and-lêt-na «je suis dissous» avec lêt~a-m(«.)-s «laissé»; af-lif-na «je suis de reste, &sp&£fao(iat» avec Ub-a-n(a}-s2 «reliquus»; ufar-haf-na «je m’enorgueillis, vnepal-pofxott » avec xifar-haf-a-n{a}-$ « orgueilleux » ; dis-taur-na « dirum-por» avec dis-taur-a-n(ay-s «diruptus»; ga-lhaurs-na «je seche, ^ïjpatvo(xai » avec ga- thaurs-a-n(a)-s « ê^npafifiévos » 711 712 713 714.
Dans dis-hnaup-na «dirumpor», venant de la racine hnup \ le gouna est irrégulier, car les verbes dénominatifs en na, ainsi que le participe passé en na, prennent ordinairement la forme la plus légère du thème verbal. Même observation pour us-geis-ua «pereellor, stupeo», qui devrait faire us-gisna715. Disskrit-na «findor» et tundna «uror» 0 sont, au contraire, réguliers.
S 771. La forme dénominative en na, devenue en gothique
une forme passive.
Une fois que na eut pris en gothique la valeur d’un exposant du passif, ainsi qu’on Ta vu par les exemples précédents, il s’ajouta aussi à des thèmes adjectifs. Il en est résulté qu’entre les verbes dénominatifs en y#1 et les verbes dénominatifs en na il s’est établi la même opposition qu’entre les verbes transitifs et les verbes passifs ou neutres. Devant na comme devant ja (= sanscrit aya), on rejette la voyelle finale du thème nominal. C’est ainsi que le thème fulla (nominatif masculin full-s) «plein» lait fulF-na «impleor» etfulF-ja simple©»; mikila «grand» (nominatif mikiF-s) fait mikiF-na «magnificor » et mikiF-ja «magni-fico»716 717; veiha (nominatif veili-s) «saint» fait veih-na «sancti-ficor» et veili-a (deuxième personne veili-ais) « sanctifico » ; ganôka (nominatif ganôli-s} «suffisant» fait garnit-na «expleor» et ganôli-ja «expleo»; managa (nominatif manag’-s) «beaucoup » fait manag-m «abundo» et marmg-ja «augeo»; gabiga (nominatif gabig’-s) «riche» fait gabig’-na «locupletatus sum» et gabig’-ja « locupleto ».
Les primitifs des verbes dénominatifs en na ne nous ont pas tous été conservés par les textes gothiques; quelques-uns, au temps d’Uifilas, étaient peut-être tombés en désuétude, de manière qu’ils ne se sont conservés que dans les dénominatifs qui en sont sortis. Ainsi nous n’avons pas d’exemple du thème adjectif drâba (nominatif drôb’-s)718 «sombre », d’où viennent drob -ja «j’obscurcis, j’agite, j’ébranle» et ârôb’-na «je suis ébranle». Des prépositions inséparables viennent se placer devant les verbes dénominalifs comme devant les autres verbes, quoique le thème
nominal ne prenne point de préfixe : ainsi blinda (nominatif blind’-s) «aveugle» fait ga-blind’-na «je suis aveuglé» et ga-blincT-ja «j’aveugle » ; dumba (nominatif dumb’-s) «muet» fait af-dumb’-na «je deviens muet»719. Il se peut que les adjectifs simples aient d’abord donné naissance à des verbes dénominalifs simples, sortis de l’usage ou non employés dans nos textes, et que de ces dénominatifs simples proviennent les dénominatifs composés : dans cette hypothèse, dumba aurait fait dumbna, d’où afdumhna, comme en latin mutu-s fait mutesco, d’où obmutesco.
S 77a. Verbes dénominatifs grecs en ttxcô (B-avartdeo).
jNgus retournons au sanscrit pour faire observer qu’une partie des verbes dénominatifs formés avec ^3f y a expriment un désir. Ainsi pati « maître, époux » (ait patî-yâmi «je désire pour époux » ; patrd «fils» fait putrî-yâmi «je désire des enfants». La voyelle finale du thème est allongée; si cette voyelle finale est un a, il se change en î (par affaiblissement pour d)2.
Ces formes nous amènent aux dénominatifs grecs en taco, à sens désidératif : tandis que les verbes sanscrits allongent la voyelle -male du thème et changent A en î, les verbes grecs rejettent la voyelle finale du thème nominal primitif, de sorte qu’on a B-avaT-idü), crlpomly-tacû, xkm)(T-tdcû. Il serait plus exact de dire que ces verbes se rapportent à la forme causale des dénominatifs sanscrits en ya; ainsi Solvolt'-tdo), 3-ava.j-tdo-gsv supposerait une forme sanscrite comme puirî-yaya-mi, putrî-yayâ’-mas. En effet, putrî-ya-mi, puirî-ya-mas ferait attendre en grec des verbes comme &ava?gravai: -io-{xsv^ ou, par le changement de vj en cro-(§ 769)» 3-apaacvy, 3'av&&cro[A£y*
Il est bon d’ajouter qu’on trouve quelquefois le causatif des
dénominatifs en ya employé en sanscrit sans la signification causale. Ainsi asû-yâmi r je maudis »1 a donné le gérondif à forme causale asuyayitvâ 2 qui signifie r ayant maudit» 720 721 722 723.
S 778. Verbes dénominatifs latins en igo (mitigo).
On pourrait rapporter également les dénominatifs latins en igâ à la forme causale des dénominatifs en ^ ya* IA* serait alors la voyelle finale du thème nominal, tantôt restée invariable, comme dans miti-gâ-s, levi-gâ-s, nâvi-gâ-s, tantôt affaiblie en A, comme dans fumî-gâs (pour jumu-gâ-s, fumô-gâ-s), remi-gâ-s, clari-gâ-s, casti-gâ-s724. Dans les verbes comme liti-gâ-s, Ti serait un élargissement du thème725. Quant au g, il faudrait y voir le durcissement d’un j. Il n’y a peut-être point d’autre exemple en latin d’un pareil changement; mais il n’est pas rare dans les idiomes congénères726. L’d serait, comme il l’est partout dans la première conjugaison 727, la contraction du sanscrit a(y)a. De cette façon, fumi-gâ-s serait en quelque sorte le sanscrit dwnâ~yâ{y)a-si et tu lais fumer» latinisé 728. *
Si l’on préfère l’explication habituelle des verbes en igo729, suivant laquelle il y faut voir des composés renfermant le verbe
a go, on devra diviser de cette manière : mit’-igo, fum~igo. Va radical de ago devra être considéré comme ayant subi un affaiblissement en i, et igo comme ayant passé de la troisième conjugaison dans la première. Nous observons, en effet, ces deux changements dans le verbe faccre, qui à la fin des composés devient ficare.
S 77h. Verbes dénominatifs grecs en oew ('fàapti&wGsicû). — Dénominatifs latins en urio, io (parturio, equio).
Les thèmes sanscrits finissant par n suppriment cette consonne devant le ya des verbes dénominatifs, qu’ils aient ou non la signification désidérative, Il en est de même pour quelques autres consonnes : ainsi vrhdt, dans les cas forts vrhdnt \ fait vrhâ-yê'(moyen) «je grandis». On serait donc en droit de s’attendre aussi à des formes comme ilâ-syâ-yê (pour dâsyai-yê ou dâsyant-yê), venant du participe futur dâ-syant « devant donner».
Nous sommes amenés de la sorte aux désidératifs grecs en creta, qu’on pourrait regarder comme des dénominatifs venant d’un participe futur2. Ve de serait l’amincisse
ment de Yo du suffixe ovt: 'üsapa-Sojo-e -to) viendrait de tÊrapœ-, à peu près comme dex-a^Sfievos vient de dsxovr.
Si les désidératifs grecs en proviennent de participes futurs, on en peut rapprocher les désidératifs latins en turio, comme cœnaturio, nupturio, parturio, esurio5 (pour es-turio, § toi). L’t paraît répondre au suffixe sanscrit ^ ya. Il est vrai que 1*1 de la quatrième conjugaison correspond ordinairement au sanscrit aya, tandis que y a est représenté par Yi de la troi-
1 C’est un participe présent de varh, vfh «grandir».
* Et non, comme on les explique d'ordinaire, d’un indicatif futur.
3 Vu des verbes en turio est bref, tandis que celui des participes en iûru-s est long. Mais la surcharge produite par la dérivation verbale me paraît avoir déterminé ce changement de quantité : c’est ainsi qu’eu sanscrit i’d du suffixe târ est complètement supprimé devant le caractère féminin i.
sième conjugaison. Mais comme cet i devient quelquefois î1, on ne doit pas être surpris de voir certains dénominatifs de la quatrième conjugaison latine appartenir à la formation en ya, et non à la formation en aya. Conséquemment equ-io, equ-îs représenterait par son thème comme par sa dérivation le védique asvâyâmi «cquos cupio» (§ 772)*
S 776. Verbes dénominatifs latins en isso et esso (atticisso, capesso).
Il y a aussi des dénominatifs à signification désidérative que le sanscrit forme à l’aide des suffixes sya et asya; exemples : vréa-syàmi «désirer le taureau»; asva-syàmi «désirer l’étalon», en latin «equio»; madv-asyâmi «désirer du miel». Nous avons déjà fait remarquer la ressemblance de ces formes avec celle du futur à auxiliaire, et, en ce qui concerne la sifflante, avec les désidératifs venant de racines verbales.
On peut rapporter ici les verbes imitatifs latins en sso 2. Ainsi patrisso proviendrait par assimilation de pairisjo3, et l’i serait un élargissement du thème, comme dans patri-bus. Dans aîti-ci-sso, grcecisso, Yi proviendrait d’un affaiblissement de la voyelle finale du thème nominal. H est vrai que les verbes sanscrits comme asva-syd-ti faisaient plutôt attendre en latin la troisième conjugaison que la première.
C’est la troisième conjugaison que nous trouvons pour les verbes comme capesso, incipi-sso, lace-sso, peti-sso, lesquels sont eux-mêmes dérivés d’autres verbes. On les peut rattacher aux verbes désidératifs sanscrits en sa, en supposant que le soit effectivement pour ^sy; ou bien encore, on les peut rap-
1 Voyez Struve, De la déclinaison et de la conjugaison latines, p. aoo et suiv. Fodio fait chez Piaule fodtri, gradior fait aggrediri, pario fait chez Ennius parère,
morior fait mortmur. >'
% Ce rapprochement a déjà été fait par Düntzcr, Théorie de la formation des mots
en latin, p. 135.
-1 Comparez les futurs pràcrils(S 655).
porter au futur à auxiliaire. Toutefois, dans Ye ou Pi des verbes comme cap-e-sso, pet-i-ssof je reconnais la voyelle caractéristique de la troisième conjugaison, quoique cette voyelle ne sorte pas d’ordinaire des temps spéciaux.
Incesso, venant de cedo, est probablement une forme mutilée pour incedesso, de même que arcesso, s’il vient de cedo, est pour arcedesso,
S 776. Verbes indicatifs latins en sco; verbes grecs en erjf&ï.
il y a une ressemblance extérieure entre les désidératifs en sya ou asya, formés de thèmes nominaux, et les inchoatifs latins en asco et esco. Mais je ne pense pas qu’il faille rapporter l’origine de ces derniers à la période indo-européenne ; je crois qu’ils sont de formation latine, et qu’ils proviennent de l’adjonction du verbe substantif, pris dans le sens a devenir », au thème nominal. Si le thème est terminé par une voyelle, il la rejette devant le verhe auxiliaire (S 761). De même qu’on a pos-sum, venant de pot-sum, pour poü-sum, et pot-eram pour poti-eram, de même on a pueW-asco, ir-ascor, puer-asco (du thème puerô), tener-asco et tener-esco, acef-asco, geV-aseo (de gehi), herb -esco, exaqu-esco, plum-esco, jlamm-esco, amar-esco, aur-esco, cîar-esco, vetust’-esco, dulc-esco, juven-esco, cekbr-esco, corn -esco. Pour les verbes en isco, nous n’examinerons point s’il faut diviser de cette façon : long-isco, vetust’-isco, ou longi-sco? velusü-sco. Dans le premier cas, on pourrait comparer Pi du verbe auxiliaire avec celui de l’impératif grec îcr-Ôi; dans la seconde hypothèse, li est l’affaiblissement de la voyelle finale du thème adjectif, comme cela a lieu dans les composés tels que kngi-pes et les dérivés tels que longitudo. Les thèmes finissant par une consonne n éprouvent point de mutilation : on a, par exemple, arbor-esco, carbon-esco, lapid- esco, matr-esco, noct-esco, dit-esco. Remarquez toulefois opul-esco, pour opulent-esco : celte mutilation rappelle celle qu’éprouvent en sanscrit les verbes dénominatifs venant de thèmes participiaux en nix.
Si ces formations contiennent, comme je le crois, le verbe substantif, elles sont identiques avec le futur archaïque en esco (escit, superescit, obescit}. Grâce à la composition, le verbe substantif a encore gardé quelquefois son ancien a initial730 731 732. Il n’est pas besoin d’expliquer combien se touchent de près l’idée de futur et celle de devenir.
Nous retrouvons la gutturale dans l’imparfait grec s<rxov, qui se combine aussi avec des verbes attributifs (Stvsue-aKs, xakés-crxov, êXacra-axe 3 ).
Comme le grec eo-xa, le latin esco renonce à sa voyelle initiale, quand il s’adjoint à des thèmes verbaux, car la, Yê ou Yi des formes comme laba-sco, ama-sco, consuda-sco, genera-sco3 palle-sco, vire-sco, rube-sco, senti-sco, obdormi-sco, sont évidemment les caractéristiques des première, deuxième et quatrième conjugaisons. Aussi divisons-nous ces verbes autrement que les verbes dérivés d’un thème nominal, tels que puer’-asco, clar-esco, dulc-esco. Dans gemi-sco, tremi-sco, où le verbe primitif est de la troisième conjugaison, lï est bref par nature; c’est le même i qui, dans gem-i-s, trem-i-s, représente la caractéristique a des verbes sanscrits de la première et de la sixième classe733. LV de profici-scor, concupi-scor est identique avec IV de faci-sy projici-s, cupi-s; nand-scor suppose un simple nanco, nanci-s; frage-sco a un ë au lieu de Yï de frangi-s (§6), et il s’est allégé en rejetant la nasale de la racine.
Les verbes grecs comme ytjpd-erxoa, rjSd-axGô, IXd-axofxat, akSrf-arxw ont la même formation que iaba-sco, ama-sco, palle-sco. Nous ne voulons point dire par là que 1* de '&s(ptXi)-xa, <pihf-<Tù> soit identique avec Yê de la deuxième conjugaison la-line, quoique tous deux se rapportent à la caractéristique sanscrite aya ou ay1 : le latin a contracté en ê les deux premières lettres ay ou «i2, tandis que le grec a simplement allongé le de (piléoô pour compenser la suppression du y de
Dans les formes comme evpt-axc*), alspt-axco, dXi-axofmi, âfxGXi-ax&y je crois que Yt est l’affaiblissement d’une voyelle plus pesante, et non une voyelle de liaison : je regarde ces verbes comme étant pour sùprf-a-xœ, olepif-tntw, âpgXé-crxa), dXcS-o-xofxctt, ainsi que le prouvent, entre autres, les futurs svptf-<7«, dXûj-ŒOfÂott, etc. Nous avons des affaiblissements analogues de lo en t dans èvtvtjpLt (pour àvivtiftt], oTwrlevù) (pour bito-Tr7eüû>4); ajoutons qu’à côté de aXOt-axw on trouve aussi âXOtf-erxoû.
$ 777* Verbes dénominatifs sanscrits formés par la simple addition d'un a.
Formations analogues en latin, en grec, en gothique et en arménien. — Verbes grecs en euca. — Verbes arméniens en anam.
On forme aussi des dénominalifs sanscrits en ajoutant simplement dans les temps spéciaux un a au thème nominal. Cet a est supprimé dans les temps généraux comme celui des verbes
1 Aya dans les temps spéciaux, ay dans les temps généraux.
* Voyez S 109*, 6.
s <l>tXéu est pour ÇtXéjw, comme SrjXàt» est pour SrtXoja (S 5oh). Au futur, qui est un temps général, nous ne devons avoir que la caractéristique ej.
4 Voyez 8 754, et comparez owirfi et oTrauréa, qui, au lieu d’affaiblir la voyelle radicale, 1 ont au contraire allongée. Ces formes, où la racine est entièrement répétée, repondent exactement aux intensifs sanscrits.
primitifs de la première et de la sixième classe l. Si le thème nominal se termine par un a, on le rejette; ainsi lohita « rouge» fait léhit’-d-ti «il est rouge». Dans les textes sanscrits, je nai pas trouvé d’exemple de cette sorte de dénominatifs; mais parmi les racines que les grammairiens indiens attribuent à la première ou a la sixième classe, j’en crois reconnaître plusieurs qui sont des dénominatifs de thèmes en a. Tel est bdm «être en colère» qui fait b'am-a-tê «il est en colère», et que je fais dériver de iïàm-a2 «colère».
L t de la troisième conjugaison latine répondant à Va sanscrit de la première et de la sixième classe, les verbes metu-i-t, tri-bur-i-t, statu-i-t, minu-i-t correspondent aux dénominatifs sanscrits dont nous venons de parler. En grec, on peut rapporter ici les dénominatifs qui, dans les temps spéciaux, joignent un o ou un e au thème nominal, comme , Svpi-o-
fm9 WTt-o-pat, Saxpu-o-fxcu, psOv-o-fmi, iOi-o-psv, d)(Xv-o-fxsv, fiaaiXev-o-fJiev, jSpa&sv-Q-ixsv.
Mais comment faut-il expliquer les verbes dénominatifs en sua a côté desquels nous ne trouvons point de thème nominal en eu? Le grec en compte un assez grand nombre, comme xop'-sv-Q-pou «je suis vierge», ztoXit-sv-ù) «je suis citoyen», d0X’-eu-<y «je combats», littéralement «je suis dans le combat», iarp-ev-& «je suis médecin», xpaTicrT-ev-co «je suis le meilleur», xoXax-etî-w «je suis flatteur», SovX’-ev-ü)«je suis esclave», dX>?0’-eu-<y «je suis véridique». On pourrait supposer que le verbe substantif, qui, dans la plupart de ces formations, est plus ou moins clairement sous-entendu, s’y trouve effectivement renfermé. Il faudrait alors songer à la racine ^uf qui aurait conservé son sens primitif «être», tandis que hors de composition elle a
1 Voyez $ 109% !.
* Le mot bêtma lui-méme, qui signifie aussi «lumière, éclat", vient évidemment de la racine Uâ «brillera.
surtout la signification causative «produire 5?. L’e de -eva serait la voyelle du gouna, répondant à l’a de Bâv-â-mi «je suis, je deviens». En ce qui concerne la perte de la labiale, on pourrait comparer pot-ui, mon-ui, ama-vi, audi-vi1.
A la même classe de dénominatifs appartiennent les verbes gothiques en na ( comme fullna «impleor»)734 735. Ces verbes dérivent de thèmes participiaux en va qui perdent leur voyelle finale devant la caractéristique : on a donc au singulier fulln-i-th «impletur», pourfullna-î-th, qui lui-même est pour fullna-a-th736, et au pluriel fulln-a-nd, comme en sanscrit nous avons rôhît*-à-ti, rôhit’-a-nti. Le gothique n emploie d’ailleurs cette formation qu’au présent et aux temps qui en dérivent : au prétérit, l’a ou IV est remplacé par un 6; ainsi l’on a fulln-ê-da «je fus rempli », dont la formation s’accorde avec celle de regn-â-vi737.
En arménien nous avons également des dénominatifs qui se forment de la même manière : on adjoint simplement au thème nominal la caractéristique (ordinairement e), devant laquelle la voyelle finale du thème est rejetée. Exemples : spufblbtPgan£-e-m «je thésaurise», venant de gant (thème ganzu ou gan{i)
« trésor », u^uml^IrtP psak-e-m «je couronne», venant de psak (thème psaka^ «couronne». Comme exemple d’un dénominatif delà deuxième conjugaison, formé parla simple addition d’un m aj nous citerons [ufinfuinLutT UroUf-a-m «je brave, je suis fier», venant de iïroKt (thème UroKta) «fier».
Toutefois, la plupart des verbes dénominatifs de la deuxième conjugaison arménienne finissent par ana-m à la première personne du singulier du présent; ils s’accordent donc dans leurs traits essentiels avec les formations en ane-ml (dont ïe remplace un ancien a), et avec les verbes primitifs de la neuvième classe sanscrite. Ces dénominatifs traitent comme une racine le thème substantif ou adjectif dont ils sont formés : la caractéristique ana, ou plutôt la syllabe na, est donc supprimée dans les formes générales, ainsi que fait le sanscrit pour la syllabe caractéristique nâ. Exemples : hwand’-am-m «je deviens malade», aoriste hivand-azi, venant de hwand (thème Invalida) «malade»; ana-m «je deviens vieux», aoriste Çer-azi, venant de érk-n £er
t • C *
(theme £ero) «vieux»2; tgai-ana-m «je deviens enfant», aoriste tgai-azi, venant de uiquy tgai3.
1 Voyez S 4<)6.'
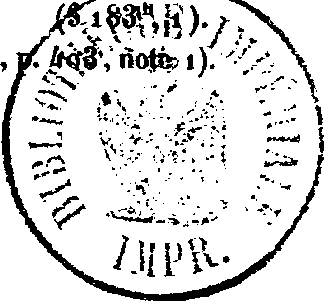
FIN DU TROISIÈME VOLUME.
a En sanscrit garant (forme faiblegarat) =^jicec'*%spovT. Le n o de lero, comme l’o de yepovT, représente un a sanscrit 3 Qui se prononce tgâ (voyez t. ï
3o
ni
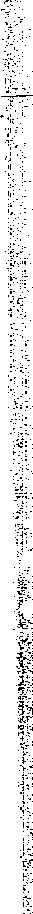
’i
1
‘J!
P
; Mivà . J ïtiin".;^ SÜÜÈStiiê
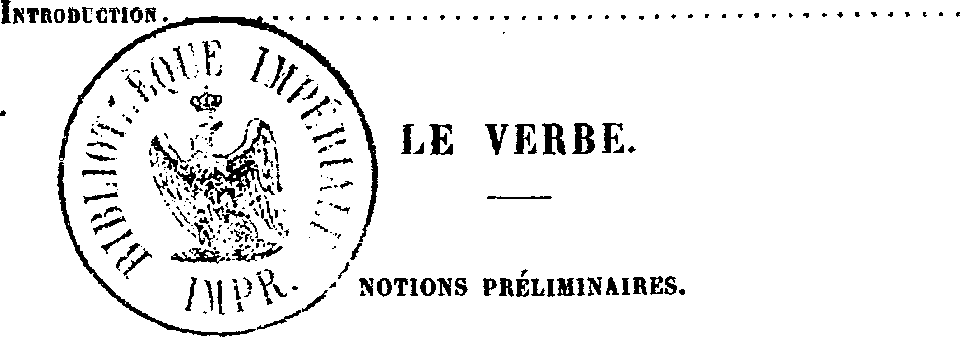
S 6a6. Des voix. — L’actif et le moyen en sanscrit. — Le moyen en gothique.
S 637. Le passif en sanscrit et en zend.............................
S A a 8. Les modes et les temps....................................
S /iaq. Les nombres. —* Les langues indo-européennes ne distinguent pas les
genres dans le verbe...................................
S 63o. Division des temps et des modes en deux classes, d’après les flexions
personnelles.........................................
S A31. Restes de cette division en latin.............................
S 63s. Restes de cette division en gothique..........................
S 633. Restes de cette division en ancien slave.......................
DÉSINENCES PERSONNELLES.
PREMIERE PERSONNE. ‘
S 636. la première personne de l’actif et du moyen, en sanscrit, en zend, en
grec et en latin.......................................
$ 635. La désinence mi en lithuanien..............................*
S 636, ' • Examen des verbes lithuaniens en mi. — La désinence lithuanienne «............................................
S 636, 2. La désinence mien ancien slave. .........................
S 636, 3. Restes de la désinence mi en gothique et en vieux haut-allemand.. .
S 636, 6. Restes de la désinence mi en arménien......................
3o.
S A 37. Expression de la première personne, dans les formes secondaires..... 18
Page*.
» > A n t 14 * * 1 1 rt 1 é u
Remarque. — A euphonique inséré, en sanscrit, devant le m des formes
secondaires.......................................... 18
S A38. Restes de m, désinence des formes secondaires, en gothique et en lithuanien............................................ 20
§ A 3q. Origine de la désinence de la première personne................. 20
S AA0. La première personne du pluriel, en vieux haut-allemand, en gothique,
en' lithuanien, en ancien slave et en arménien................ 2A
S AAi. La première personne du duel, en sanscrit, en lithuanien, en ancien
slave et en gothique................................... 2 G
S A A 2. Tableau comparatif de la première personne des trois nombres...... 2 7
DEUXIEME PERSONNE.
S A A3. Formes diverses de la désinence de la deuxième personne.......... 3o
S A A A. Origine de ces formes diverses.............................. 31
SA 45. Deuxième personne du duel, en gothique, en ancien slave et en lithuanien ........................................... 3 e
S A A 6. Deuxième personne du pluriel.............................. 33
S A A 7. Deuxième personne do singulier, en sanscrit, en zend et en ancien
slave.............................................. 3 A
S AA8. Deuxième personne du singulier, en lithuanien, en grec, en borussicn
et en vieux haut-allemand............................... 3G
S A A 9. La deuxième personne en arménien........... ............... 38
S A50. La désinence «ÏY à la deuxième personne du singulier de l’impératif
sanscrit............................................ Ao
S A5i. Deuxième personne de l'impératif, en sanscrit et en grec.......... A2
S A5a. Suppression de la désinence à la deuxième personne de l’impératif, en
sanscrit et en grec................ ..................... A3
§ A53. La désinence du parfait sanscrit ta............ ................ A3
5 A5A. La désinence du parfait st en gothique et en vieux haut-allemand.... A5
S A 55. Tableau comparatif de la deuxième personne........ ........... AG
TROISIÈME PERSONNE.
S A56. Origine de la troisième personne. — La troisième personne du singulier
A8
h
5i 5s 5 A
en grec.............................................
§ A57. Troisième personne du singulier, en ancien slave, en lithuanien et en
gothique..................................-........
S A58. Désinence de la troisième personne du pluriel, en sanscrit et en grec..
S A 5g. Allégement de la désinence ntt, nté, en sanscrit et en grec..........
§ A60, j . La désinence de la troisième personne du pluriel en ancien slave. .. S A Go, 2. La troisième personne du pluriel en arménien.................
469
PilWS.
55
S /toi. Désinence de la troisième personne du pluriel, dans les formes secondaires, en sanscrit, en grec, en zend et en gothique . . . .........
5 è6a. Troisième personne du pluriel au parfait gothique et sanscrit. —- La
désinence anti ou an changée en ms en sanscrit................ 56
S 463. Désinence de la troisième personne du pluriel, dans les formes secondaires, en ancien slave et en arménien. —La troisième personne du
pluriel en latin...................................* • • • 5 7
S 464. Troisième personne du duel............................... • 58
$ è65. Tableau comparatif de la troisième personne................... 59
DÉSINENCES DU MOYEN.
S 466. Voyelles finales des désinences moyennes...................... 61
S 467. Première personne du singulier moyen, en sanscrit et en zend...... 61
S 468. Voyelles finales du moyen en gothique........................ 6a
S 469. Deuxième personne du singulier moyen, dans les formes secondaires,
en sanscrit, en zend et en grec............................ 64
S 470. Explication de la désinence sanscrite tas. — La désinence grecque
— Les impératifs en tât. — Le pronom personnel est contenu deux
fois dans les désinences du moyen...... ................... 65
S 4 71. Première personne du singulier moyen, dans les formes secondaires, en
sanscrit............................................. 58
S 479. Diphthongue finale e des désinences du pluriel et du duel, en sanscrit
S 478. Explication des désinences moyennes qui ont la diphthongue finale eu
en grec...........................................* • 69
S 474. Explication des désinences moyennes qui n’ont point la diphthongue
finale ai en grec..................................- - • ■ 7a
8 476. Autre explication des désinences moyennes..................... 73
$ 476. Formation du moyen et du passif, dans les langues letto-slaves, par
l’adjonction du pronom réfléchi........................... 70
S 477. Formation analogue du passif latin.......................... 76
S 478. Origine des formes latines comme amamini,.................... 78
S 479. Origine des formes latines en wu'no....... 80
EFFET DL POIDS DES DESINENCES.
S 480. Effet du poids des désinences sur la partie antérieure du verbe. — Le
verbe substantif a#..................................... 81
S 481. Effet du poids des désinences sur les verbes de la troisième classe. —
Le verbe dâ «donner».................................. 83
8 48a. Autres verbes de la troisième classe : affaiblissement d’un û radical en î, devant les désinences pesantes. — Affaiblissement de l’« en i dans la syllabe réduplicative................................... 86
S A83- Effet du poids des désinences sur les verbes de la deuxième classe. . . . S A 8 A. Autres verbes de la deuxième classe. — Le verbe sds « commander?). . S A 85. Effet du poids des désinences sur les verbes de la neuvième classe : affaiblissement de nâ en ni, devant les désinences pesantes. •— Affaiblis
’agt's.
U VJ
89
9<>
91
92
93
«4
95
96
97 97 99
ÎOl
1 03
1 o3
I ou
10b
108
J09
II o
III
1 ! 3
1 1 A 115 118
1 *9
sement, en grec, de vâ en va............................
$ A8(). Verbes sanscrits de la deuxième et de la troisième classe : renforcement de la voyelle radicale devant les désinences légères ■— Fait analogue en grec........................................
S A87. Exception au principe précédent. — Le verbe si * être couché, dormir». S A 88. Verbes sanscrits de la cinquième et de la huitième classe : renforcement des caractéristiques nu, u, devant les désinences légères. — Comparaison avec le grec..................................
S 689. Renforcement de la voyelle radicale, dans les formes monosyllabiques
du prétérit redoublé, en gothique et en vieux haut-allemand.....
S A90. Prétérits germaniques affaiblissant un a radical en u dans les formes polysyllabiques. — Changement de IV en u dans le verbe sanscrit kar...............................................
Rkmàrqlk 1. — Le changement de IV en u peut-il s’expliquer par
FinOuence de la liquide suivante?.........................
Remarque 2. — Pourquoi les verbes réduplicatifs, en gothique, n’affaiblissent-ils pas la voyelle radicale ?.......................
SA93. E
* A 91. Double forme du gouna dans les verbes grecs ayant un t radical — Comparaison avec les langues germaniques. — Le parfait oïêa........
numération et tableau comparatif des désinences légères et des désinences pesantes......................................
S A 93. Répartition des dix classes de racines en deux conjugaisons principales.
S A9A. Subdivisions de la conjugaison en ..........................
K A95. Origine des caractéristiques nâ, nu, u et âna...................
$ A96. Les caractéristiques âna, nd, nu et a, en arménien...............
S A97. La caractéristique na, en sanscrit, en grec, en latin et dans les langues
letto-slaves. — Verbes grecs en avûa........................
S A98. Caractéristique re, ro en grec. — Verbes de même formation en latin.
S A99, Caractéristique ta en lithuanien.............................
S 5oo. Origine rie la caractéristique a..............................
S 5o 1. Origine des caractéristiques ya et a y a. — La caractéristique ya en latin et en lithuanien....................................
§ f>02. Du j dans les verbes comme bijtm, en ancien slave. ..............
S 5o3. Racines slaves en u, en ü et en é............................
S 5oA. Verbes de la dixième cla&e en ancien slave.....................
S 5o5. Verbes slaves à métathèse ou à conjugaison mixte................
S 5o6. \erbes lithuaniens à conjugaison mixte. — Verbes lithuaniens de la dixième classe.......................................
1 a3 12 A
126 128 13o
130
131
i3a i33 i35 135
471
^■IN
FORMATION DES TEMPS.
PRÉSENT.
8 507. Formation du présent....................................
S 5o8. Présent des verbes stâ «être débouta,grâ «sentir»...............
S 5og. Les racines bu et as «être». — Autres racines remplissant le rôle de
verbe substantif...............* *.....................
8 510. Présent du verbe Vâ «être»..................*.............
S 5i 1. Présent du verbe as «être»................................
Remarque 1. — Le présent du verbe auxiliaire «être» en gothique.. . Remarque 2. — Effet du poids des désinences personnelles sur la voyelle
radicale, dans les langues romanes.........................
Remarque 3. —r Les caractéristiques des classes servent-elles à exprimer
l’idée du présent ?......................................
S 512. Tableau comparatif du présent moyen.........................
Remarque 1. — Le présent moyen en zend...................
Remarque 2. — La forme moyenne vêdê en ancien slave...........
LES TROIS PRETERITS.
$ 513. Emploi des trois prétérits en sanscrit. —- Manières d’exprimer le parfait. ..................*............................
S 51 û. Manières d’exprimer le plus-que-parfait en sanscrit...............
S 515. Les trois prétérits sanscrits avaient-ils à l’origine des significations différentes? ............................................
$ 51 fi. L’imparfait et l’aoriste sanscrits avaient-ils à l'origine des significations
distinctes?..........................................
IMPARFAIT.
§517. Caractères de l'imparfait. — Tableau comparatif de 1 imparfait en
sanscrit et en grec.....................................
S 518. L’imparfait en zend. — Imparfaits zends ayant conservé l’augment. . .
S 619. Conjugaison de l’imparfait en zend...........................
8 52o. L’imparfait employé en zend comme subjonctif présent. Emploi
analogue du prétérit redoublé.......-....................
Suai. L’imparfait après la particule prohibitive ma, en sanscrit. L imparfait arménien........................................
8 622. Conjugaison de l’imparfait arménien.........................
8 523. L’aoriste en lithuanien....................................
8 5a&. Origine de l’imparfait d’habitude, en lithuanien. — La racine du ou dd
jointe au verbe, en lithuanien et en gothique.................
8 525. L’imparfait en ancien slave................................
i43 1 hh 1A5
i A 6
1A7 1AS 1 h 9
100 1 5-a
/j7o TABLE DES MATIÈRES.
11 1 * Pagvs.
S 526. Origine de l’imparfait latin. — Comparaison avec le celtique........ i56
S 537. Allongement de la voyelle e, devant la désinence bam, dans les verbes
de la troisième conjugaison latine.........................
S 028. Allongement de Ve, devant la désinence bam, dans les verbes de la
quatrième conjugaison latin.............................. 10 7
S 53 0. Deuxième et troisième personnes du singulier de l’imparfait du verbe ^
substantif, en sanscrit, en grec et en arménien............... 1 a9
S 531. Deuxième et troisième personnes du singulier de certaines racines sanscrites finissant par s. ...............................* * ' l®°
S 532. Imparfait du verbe substantif............................... 161
Remarque. — Allongement de Va, à l’imparfait eram............. 163
§ 533. Augment temporel en sanscrit, devant les racines commençant par i,î,
u,ûetr............................................ 166
S 536. Effets differents de l’augment et du redoublement dans les verbes sans-
ü rr crits commençant par i et u.. ............................ 10r>
S 535. Les verbes grecs commençant par t, v, o ne prennent pas l’augment,
mais le redoublement.. ................................ ^
Remarque. — Examen d’une hypothèse de Kühner sur l’augment temporel..............................................
S 536. Imparfait moyen........................................ 1 ^
ORIGINE DE L’ACGMEMT.
S 537. Identité de l’augment et de l’a privatif................ ....... 168
Remarque. — Examen d’une objection de Vorlandcr............. *7°
S 538. Va privatif et l’a de f augment ne se comportent pas de la même manière devant une racine commençant par une voyelle.........1 * 171
S 539. Le n des particules privatives in, en latin, et mu, en allemand, esl-ii
S 56o. L’a privatif et l’a de l’augment peuvent être rapportés à un pronom
démonstratif....................................... *7*^
S 561. L’augment peut-il être considéré comme le reste d’un redoublement?
—- Examen des opinions de BuLlmann et de Pot!.............. î7 î
AORISTE.
S 563. Les sept formations de l’aoriste sanscrit. — Première formation..... 176
S 563. Mutilation du verbe auxiliaire annexe........................ • 177
S 566. Imparfait moyen du verbe substantif........................* * *7^
8 565. Tableau de la première formation de l’aoriste sanscrit.......*..... 17^
8 566. Les parfaits latins en si — Le parfait latin est un ancien aoriste..... 179
Pages.
S 547. Cause de rallongement de la voyelle radicale, dans les parfaits latins
comme scâbi, vîdi, Ugi,fûgi, fodi ............ 180
S 548. Changement de la voyelle radicale, dans les parfaits latins comme cêpi,
frêgi,fêci........................................... 181
S 5kg. Les désinences ait, stîs (amavistî, amamMis) du parfait, latin........ 18a
S 55o. Exemples de désinences du moyen introduites à l’actif............. i83
S 551. La syllabe si dans les formes latines comme vec-si-mus, dic-si-mus.... 184
S 55a. La première personne du singulier du parfait latin............... i85
S 553. La troisième personne du pluriel du parfait latin................. 186
S 554. Allongement ue l’e dans les formes latines comme dîxêrunt......... 187
S 555. Deuxième formation de l’aoriste sanscrit. — Tableau de cette formation............................................. 187
S 556. Parfaits latins en ui, vi.................................. 188
S 557. Origine de ces parfaits.................................... 189
S 558. Le parfait potui......................................... 189
S 559. Les parfaits latins en vi, vi sont d’anciens aoristes................ 190
S 560. Troisième formation de l’aoriste sanscrit. -— Tableau de cette formation. 19 f S 561. L’aoriste en ancien slave. — Tableau comparatif de l’aoriste en ancien
slave et en sanscrit.................................... 192
S 56a. De l’i dans les aoristes comme bud-i-ckü, en ancien slave.......... 193
S 563. Insertion d’un 0 euphonique devant les désinences de la première personne du duel et du pluriel, en ancien slave................. 193
8 564. Aoriste des verbes correspondant aux verbes sanscrits de la dixième
classe, en ancien slave et en grec......................... 194
S 565. Insertion d’un 0 euphonique entre la racine et le verbe auxiliaire, en
ancien slave........................... 194
8 566. Absence du verbe auxiliaire et de la désinence personnelle à la deuxième
et à la troisième personne du singulier, en ancien slave.......... 195
S 567. Aoriste des racines da et bü,en ancien slave.................... 197
S 568. Les aoristes grecs SSaxa, éOijxa, -fixa,......................... 198
S 669. Le s du verbe auxiliaire changé en k, à l’impératif lithuanien. — Le x
du parfait grec. — Le c du parfait passif, dans la même langue... 198 S 670. Quatrième formation de l’aoriste sanscrit. — Tableau de cette formation. .................... 200
8 671. La quatrième formation est inusitée au moyen. — Elle n’est employée
à l’actif qu’avec des racines finissant par une voyelle ou par m..., 201
S 672. Exemple de la première et de la deuxième formation en zend........ ao3
8 5y3. Cinquième formation en sanscrit. — Aoriste second en grec. — Restes
de cette forme en arménien. — L’augment en arménien......... 2o3
S 674. Restes de la cinquième formation en ancien slave................ 206
S 675. Sixième formation de l’aoriste en sanscrit. — Comparaison avec le grec,
le lithuanien et le latin................................. 206
S 076. Restes de la sixième formation, en arménien et en ancien sïave...... 209
P;ijjos.
S 077. La sixième formation, dans les verbes terminés par une voyelle, en
sanscrit, en latin et en lithuanien. ..................... an
$ 078. La sixième formation, en zend.............................. a 1 3
S 579. Septième formation de l’aoriste, en sanscrit. — Comparaison avec le
grec............................................... 213
S 58o. Allongement de la syllabe réduplicative ou de la syllabe radicale dans
les aoristes de la septième formation........................ 21 4
S 581. Verbes sanscrits ayant l’aoriste de la septième formation........... 2i5
S 582. Contraction de la syllabe réduplicative avec la syllabe radicale, en
sanscrit et en zend, dans les aoristes de la septième formation.... 215
S 583. L’aoriste ârand'am. — Liquide changée en nasale................ 216
S 584. Aoriste de la septième formation dans les verbes sanscrits commençant
par une voyelle. — Comparaison avec le grec................. 216
S 585. Aoriste de la septième formation dans les verbes sanscrits finissant par
deux consonnes..........................-............ 2*7
$ 586. Aoriste de la septième formation avec redoublement incomplet...... 218
S 087. Restes de la septième formation, en zend et en arménien......... si8
PARFAIT.
219
221
222
223
S 588. Signification du prétérit redoublé, en sanscrit et en gothique. — Emploi des verbes auxiliaires dans les langues germaniques.........
S 589. Le redoublement en gothique......................*........
S 690. Les parfaits gothiques vôhs et stôth...........................
S 691. Les parfaits gothiques haihah etfaifah........................
223
223
294
225
226 227
228
230
s3o
S 592. Contraction de la syllabe réduplicative avec la syllabe radicale, dans les langues germaniques. — Faits analogues en sanscrit, en grec et en
latin.............................................
S 093. Origine de la diphthongue ai, contenue dans la syllabe réduplicative,
en gothique.........................................
5 096. Le redoublement, en vieux norrois et en ancien saxon.............
S 095. Le redoublement, en vieux haut-allemand......................
S 596. Le redoublement, en sanscrit.......................-.......
S 597. De la voyelle du redoublement, en grec et en latin...............
$ 5g8. La consonne du redoublement, en sanscrit, en grec, en latin et dans
les langues germaniques................................
S 699. Redoublement des racines commençant par sp, st, sk, en sanscrit, en
zend et en latin...............*.......................
S 600. Redoublement de la racine o7a, en grec......................
S 60s. Redoublement des racines commençant par deux consonnes, en grec.
— Confusion de l’augment et du redoublement...............
$ 602. La voyelle radicale au prétérit redoublé, en sanscrit. — Allongement
%
. . . Pases-
d’un a radical suivi d’une seule consonne. — Comparaison avec îe
gothique........................................... 9 3»
S tio3. L’a radical suivi de deux consonnes reste invariable en sanscrit. —
Comparaison avec le gothique............................ a33
S 6oA. Le parfait gothique. — Cause du changement de la voyelle radicale au pluriel. — La deuxième personne du singulier, en vieux haut-allemand.............................................. 233
Remarque. — Examen d’une opinion de Hoitzmann............. s35
S 6o5. Contraction de ia syllabe réduplicative avec la syllabe radicale, en sanscrit et en gothique.................................... a35
Remarque 1. — Examen de l’opinion de Jacob Grimm sur l’apophonie
(ablaut)........ â39
Remarque 2. — Pourquoi certains verbes sanscrits n’opèrent-îls pas au parfait la contraction entre la syllabe réduplicative et la syllabe radicale? ............................................ 3A0
S 6o6. La contraction de la syllabe réduplicative et de la syllabe radicale est postérieure à la séparation des idiomes. — Parfaits ayant le sens
d'un présent......................................... » A a
H 607. Parfait des verbes sanscrits ayant un i ou un u radical suivi d’une seule consonne. :— Comparaison avec le gothique. — Le gouna au présent gothique. ....................................... 2AA
Remarque. — Sur IV, comme voyelle du gouna, en gothique....... aA5
S 608. Tableau comparatif du parfait des verbes ayant un i ou un u radical suivi d’une seule consonne, en sanscrit, en gothique et en vieux
haut-allemand........................................ 2A6
S 609. Les parfaits seconds comme énoida, en grec. — La diffé
rence entre la voyelle du singulier et celle du duel et du pluriel, en
sanscrit et en gothique, est-elle primitive ?........ ........... a48
S tiig. Les désinences du parfait actif, en sanscrit, en grec et en gothique... 2A9
H (h 1. Désinences du parfait moyen, en sanscrit et en grec.............. a5o
S (>12. La désinence ré à. la troisième personne du pluriel du parfait moyen,
en sanscrit.............................-............ 201
S6i3. Insertion d’un r à la troisième personne du pluriel du potentiel et du
précalif moyens. — Même insertion à l’aoriste moyen védique..... 35s
S (i 1 A. De la voyelle de liaison i au parfait sanscrit......... ............ a53
8 (ii 5. Suppression de la voyelle de liaison au parfait sanscrit et grec........ 354
S (ù6. Deuxième personne du singulier du parfait actif, en sanscrit, en grec,
en gothique et en vieux haut-allemand. ................ 955
S (il 7. 5 inséré, en gothique, devant le t de la deuxième personne du singulier. — La racine gothique sô « semer « ............. 3 55
S 618. Première et troisième personnes du singulier des racines sanscrites en à. a 5 7 8619. Forme périphrastique du parfait, en sanscrit.................... 258
476 TABLE DES MATIÈRES.
2ü9
260
261
*
263 2 63 2 64
260
267
268
269
271
272 274
27b
276
277
278
279
279
279
280
281
282 a83 s85
286
287
288 288
Remarque. — Formes périphrastiques de l’aoriste et du précatif, dans le dialecte védique..................................
$ 620. La racine dd, dans les langues germaniques. — Le prétérit des verbes faibles, dans les idiomes germaniques, est formé à l’aide de cette racine..........................
S 621. Dérivés de la racine da, en gothique. — Conjugaison du verbe auxiliaire..............................................
S 622. La racine da hors de composition, en anglo-saxon et en vieux haut-
allemand ...........................................
S 623. De i’i dans les prétérits gothiques comme sâkida, satida...........
S 6â4. De l’o et de IV dans les prétérits gothiques comme salboda, munaida.. S 62b. Verbes forts prenant le prétérit composé, en gothique. — Suppression
de l’t dans les prétérits comme thahta «je pensais..............
S 626. Y a-t-il une parenté entre la flexion du participe passif sôkida «cherché»
et celle du prétérit composé sôkida «je cherchai »?.............
S 627. Prétérit périphrastique, en persan moderne....................
S 628. Le prétérit périphrastique, en polonais........................
Remarque 1. — Mutilation du verbe auxiliaire au prétérit périphrastique, en slave.......................................
Remarque 2. — Comparaison du verbe auxiliaire, au parfait périphrastique, en persan et en slave..............................
S 629. Le prétérit périphrastique, en bohémien et en slovène.............
S 63o. Le verbe du, en grec. — L’aoriste et le futur passifs, en grec, sont
formés à l'aide de ce verbe auxiliaire.......................
S 031. L’aoriste et le futur seconds passifs, en grec....................
S 632. Le verbe dd, employé en composition, en latin. — Les verbes comme vendo, credo.......................................
S 633. Le verbe da, employé comme auxiliaire, en slave. — Le futur bundun
«je serai », l’impératif bundémü « que nous soyons ».............
S 634. Le verbe dd, employé hors de composition, en slave...............
S 635. Le verbe d'd, employé comme auxiliaire, en slave. — Le présent idun
«je vais». — Comparaison avec le gothique..................
S 636. Le verbe da, employé*comme auxiliaire, en letle et en lithuanien....
S 637. Le verbe da, employé comme auxiliaire, en zend.................
Remarque. — La forme dai (venant de dd), en zend.............
8 638. Le prétérit redoublé en zend...............................
8 639. La forme zende âonhënti...................................
S 64o. Les formes zendes âonharë, âonhairL...........
Remarque. — Signification des formes précédentes...............
8 64 i. Les formes zendes irîntarè, irîritrè...........................
S 642. Signification des formes précédentes..........................
S 643. Emploi du prétérii redoublé, en zend.........................
Vajjos.
PLUS-QUE-PARFAIT.
S 644. Le plus-que-parfait latin.................................. 290
S 645. Le plus-que-parfait grec.................................. 291
Remarque. — Examen d’une opinion de Pott et de Curtius......... 298
FUTUR.
§646. Le futur à participe, en sanscrit............................. 295
S 667. Emploi du futur à participe. — Le suffixe participial târ : formes congénères , en latin, en zend et en slave....................... 296
S 648. Le futur à auxiliaire. — Sa composition....................... 298
S 6/19. En quoi la flexion du futur syâmi diffère de celle du potentiel syâm... 299
S 65o. Comparaison du futur sanscrit syâmi et du futur latin ei-o.......... 299
S 651. D’où vient l’i du latin eris, erit.............................* 299
8 65a. Le futur lithuanien...................................... 3oo
S 653. Deuxième et troisième personnes du futur lithuanien. — La forme bhus,
en irlandais......................................... 300
S 654. Première personne du futur lithuanien. — La première personne ero,
en latin............................................ 3oi
S 655. Le futur moyen ëcaopai, écopau, en grec...................... 3oi
S 656. Le futur premier et le futur second, en grec.................... 3oa
S 657. Forme primitive du futur. — Le futur dans les langues slaves modernes. 3o3 S 658. Le futur exprimé en slave par le préfixe po. — Le futur a auxiliaire, en
ancien slave..............- - *........................ 3o5
S 659. Forme périphrastique du futur, en ancien slave. — Le futur dans ies
langues romanes...................................... 3o6
S 660. Restes du futur à auxiliaire, en gothique et en persan............. 307
S 661. Formes du futur périphrastique dans les langues germaniques....... 308
8 66a. Le futur latin enbo.....................................* 3oq
S 663. Origine de la forme latine bo. — Comparaison avec l’irlandais.......31 o
8 664. Gouna de la syllabe radicale au futur, en sanscrit, en grec et en zend.
— Tableau comparatif du futur........................... 311
S 665. Le futur en zend............................»........... 3t4
S 666. D’une forme de futur participial, en zend...................... 3i5
8 667. Insertion d’un i euphonique au futur zend..................... 3i6
8 668. Futurs zends changeant le sya sanscrit en kya..........-........ 316
8 669. Futurs zends changeant le sya sanscrit en qya................... 317
8 670. Origine de la caractéristique du futur ya....................... 318
8677. De l’affinité du futur avec la forme désidérative, en sanscrit, en latin et
en grec.............................*............... 3iq
Pag«*s.
FORMATION DES MODES.
POTENTIEL, OPTATIF, SUBJONCTIF.
S 672. Le potentiel dans la deuxième conjugaison principale, en sanscrit. —
Caractéristique yâ, en grec trj............................ 321
S 673. Suppression de la voyelle longue du caractère modal, au moyen sanscrit,
zendetgrec......................................... 3ss
S 67/1. Le caractère modal yâ, changé en ié, î, au subjonctif latin.......... Ha3
S 676. Le caractère modal au prétérit du subjonctif, en gothique. ..... 3a4
S 676. Cause de la contraction du caractère modal au prétérit du subjonctif,
en gothique.................. 3a5
S 677. L’impératif slave correspond au potentiel sanscrit, à l’optatif grec. — Impératif des verbes en mt. — Deuxième et troisième personnes du
singulier........................................... 3a6
S 678. Pluriel de l’impératif des verbes précédents. .................. 3s6
S 679. L'impératif lithuanien.. ................................ 897
S 680. Le k de l’impératif lithuanien provient du verbe substantif. — Comparaison avec le précatif sanscrit. — Formes correspondant à l’optatif aoriste grec (êottiv, &elr)v), en zend, en arménien, dans le
dialecte védique, en ombrien et en osque.................... 828
% Ô81. Le précatif moyen, en sanscrit. .............. ......•....... 33i
5 68 a. Comparaison de l'impératif lithuanien et lette avec le précatif et le potentiel sanscrits...................................... 331
$ 683. Restes conservés en lithuanien du potentiel de la seconde conjugaison
principale......................... 333
8 684. Comparaison des formes lithuaniennes comme du aie «qu’il donne» et
comme du ht «donne»................................. 333
§ 685. Le subjonctif lithuanien, en iette............................ 334
S 686. Comparaison du subjonctif lithuanien avec le futur latin........... 336
§ 687. Explication des subjonctifs lithuaniens comme dû'tumhei «que tu
donnes»............................................ 336
S 688. Le potentiel dapsla première conjugaison principale, en sanscrit. —
Optatif des verbes grecs en a......,..................... 337
Remarque. — Pourquoi la caractéristique modale yâ s’est-eüe affaiblie
ent?........... 338
S 689. La première personne otyt, en grec. — La première personne êymn,
en sanscrit.......................................... 339
$ 690. Le subjonctif des verbes latins en dre......................... 34 0
S 69 t. Subjonctif des verbes latins en ère........................... 341
S 692. Subjonctif des verbes latins en îre. — Le futur latin en am est un ancien subjonctif....................................... 341
S G93. Le iutur des verbes latins en ère...................... ^343
S 69/1. Le subjonctif présent, en gothique.;..................... 343
S fig5. L’impératif borussien........................ 3^3
^ ^96. Impératif des verbes slaves qui ont perdu la désinence mï......... 345
S (>97. L’impératif en slovène.......................... 343
Remarque. — D’où il vient que le verbe slave, dans quelques-unes de
ses formes, fait la distinction des genres.................... 34 ?
S 698. Va de l’impératif slovène délam représente la caractéristique sanscrite
. ............................................ 3/i8
699. Le potentiel zend. — Pourquoi il présente tantôt la diphthongue ôi,
tantôt ai......................... ^ ^4^
S 700. Exemples du potentiel dans les verbes zends de la première conjugaison
principale..... ...................... g-
S 701. Exemples du potentiel dans les verbes zends de la seconde conjugaison
principale........................................... 35i
S 70a. Troisième personne du pluriel du potentiel zend. — Comparaison avec
le sanscrit et le grec............ 353
§ 70.3. Restes du potentiel moyen, en zend.................... 354
S 70Ô. Restes du préealif moyen, en zend.......................... 354
$ 705. Formes correspondant à l’optatif aoriste grec (rfaot) dans le dialecte
t . vt:di<l«e............................................ 355
S 706. bonnes correspondant à i’oplatif aoriste grec {jtyat, Aécnu) dans le
dialecte védique. — Comparaison avec le borussien............ 356
S 707. L imparfait du subjonctif, en latin, est un temps composé.......... 358
S 708. L imparfait du subjonctif essem «que je fusses, en latin........... 359
S 709. Parfait du potentiel, dans le dialecte védique et en ancien perse. — Le
parfait de l’optatif, en grec......................... 3gt
H 71 o. Parfait du subjonctif, en latin............................ 353
$711. Tableau du potentiel et du préealif......................... 333
571a. Le présent du subjonctif des verbes faibles, en gothique et en vieux
haut-allemand.............................. 3g^
^ 7l'L Le lêt ou subjonctif sanscrit..................... 333
S 71 ô. Imparfait du lêt, en sanscrit et en zend........................ 3^ 0
S 715. Parenté du subjonctif et du potentiel. — Nuance de signification qui les
distingue............................... g
S 71 fi. Formation du lét.......... «#
Remarque. — Le subjonctif latin correspond-il au lêt sanscrit?...... 372
IMPÉRATIF.
5717. L’impératif sanscrit.......... 3^3
S 719. Deuxième personne de l’impératif, en gothique. — Formes latines et
grecques en to, xa>, nto, vtcû et tâte........................ 3^5
S 720. Impératif sanscrit en tu, ntu. — B’orme correspondante en zend..... 377
S 731. Les impératifs zends en anuha.............................. 3 ^
Remarque 1. — L’impératif zend hunvanuha................... 378
Remarque 2. — Les impératifs grecs comme Aéyov, êlSoao......... 379
S 732. Première personne de l’impératif, en sanscrit et en zend........... 380
§723,1. La première personne de l’impératif dans les verbes sanscrits de la
deuxième conjugaison principale.......................... 33.,
§ 723, 2. La première personne de l’impératif dans les verbes sanscrits de la
première conjugaison principale. — Impératifs zends en âni, âne... 38 A
§ 724. De plusieurs formes zendes en ai............................ 388
S 72b. Emplois divers de la première personne de l’impératif, en zend......388
ratif.
S 726. Première personne de l’impératif, en gothique. — Tableau de l’impé
388
S 727. Aoristes premiers de l’impératif, dans le dialecte védique, en grec et
en arménien......................................... 3ç0
S 728. Aoristes seconds de l’impératif, en zend et dans le dialecte védique... 3g3 S 729. Futur de l’impératif, en sanscrit et en arménien................. 3g/(
CONDITIONNEL.
396
396
3q8
§ 73o. Origine du conditionnel sanscrit........
S 7 31. Emploi du conditionnel sanscrit. ........
VERBES DÉRIVÉS.
S 732. Des verbes passifs, causais, désidératifs et intensifs
PASSIF.
S 733. Formation du passif sanscrit............................. 3^
S ?34. Affaiblissements irréguliers de la racine, devant la caractéristique du
passif ya, en sanscrit, en zend et en ancien peree............. /j0i
Remarque. — Examen d’une opinion d’E. Bumouf : le signe du passif ya existe-t-il en zend?.................................. ^02
§ 735. Passif du verbe g an «engendrer» , en sanscrit et en zend.......... èo3
S 736. Les formes driyê »je dure» et mriyé«je meurs» appartiennent au passif.
— Restes de l’ancien passif, en latin, en gothique et en géorgien.. hoh § 737. Restes du caractère passif ya, ep arménien.................... . /40g
$738- Passif dos temps généraux, en sanscrit..........
A 81
Pages.
Ao8
^09
s 7?9* Origine de la syllabe ya, exprimant le passif......
CAUSATIF.
$ 760. Origine du caractère causalif.............................. , 0
S 741. Le causatif dans les langues germaniques...................... a 1 o
$ 762. Le causatif en ancien slave................................. 41 g
$ 7A3. La marque du causatif en ancien slave........................ fx j 5
$ 7/4/1. Le causatif en lithuanien. — Formations en inu.................. a t g
$ 7/45 V De la voyelte radicale dans les causatifs lithuaniens en üm......... Ai 7
$ 7A5 b. Origine de la lettre 11, dans les causatifs lithuaniens en inu......... A1 8
$ 7 A 5 e. Le causatif en latin. — Causatifs de la deuxième et de la quatrième
conjugaison.................................... ....Ai 9
$ 7 A 6. Causatifs de la première conjugaison latine..................... A21
$ 7A9, Causatifs sanscrits en kyâmi. — Restes de cette formation en grec et
snlatin**’....................................Aa5
Rbmarqce. — Examen d’une opinion de G. Curtius............... A s G
S 7 5o. Le causatif en zend et en ancien perse. — La forme sanscrite en payâmi
conservée en prècrit et dans les langues du Caucase............ a a 7
$ 7/47. Causatifs sanscrits en payâmi. — Restes de cette formation en latin.. . Ass $ 7/18. Restes de la même formation en grec.......................... AsA
DESIDERATIF.
$ 701 $702
INTENSIF.
$703. L’intensif en sanscrit et en grec....................
$ 75A. Intensif des racines commençant par une voyelle, en sanscrit et en grec.
$ 755. Intensif des racines finissant par une nasale. — Le verbe pan?, en gothique...................................
S 75(>. Insertion d une nasale dans la syllabe réduplicalive, en sanscrit et en — Intensif des racines finissant en art r.................
S 7^7. Intensif des racines ayant une nasale pour avant-dernière lettre. — Insertion d un t ou d’un i entre la syllabe réduplicalive et la syllabe radicale........................... .... '
S 7 58. Intensifs comme pan-i~pa4} pan-i-pat.......................
Remarqua. La racine tand «allumer», en gothique, zand, en vieux haut-allemand............ . .
‘«t**»*,,...
S 709. Restes de l’intensif en latin.....................
S 760. Forme déponente de l’intensif. — Exemples de l’intensif actif.......
A3a
A3 A A35
A 30 A30
A3 7 A 87 A3 8
ni.
3i
Pagos.
VERBES DÉNOMINATIFS.
S 761. Formation des verbes dénominatifs en sanscrit. — Les dénominatiis en
aya. — Verbes correspondants en latin..................... 43^
S 76a. Verbes dénominatifs grecs en aea, e<w, oca, a&a, tfo.............. , 441
§ 7<>3. Devant les formations en a&a/aw, saj, oao, <£<sü , le thème primitif supprime sa voyelle finale................................. 44 j
S 765. Dénominatifs gothiques de la deuxième et de la troisième conjugaison .
faibl<î.............................................. h Mi
S 766. Verbes dénominatiis en slave...................*............ 44 g
S 767. Verbes dénominatiis en lithuanien........................... 4/jg
S 768. Dénominatifs sanscrits en payâmi. — Restes de celte forme conservés
en lithuanien et en ancien slave.........\ ................. 44.7
S 769. Origine des verbes dénominalifs grecs en <x<nw, t mvea. . .. 45o
S 770. Origine des verbes dénominatifs gothiques en «a................. 453
S 771. La forme dénominative en na, devenue en gothique une forme passive. 455
S 772. Verbes dénominatiis grecs en ta& (&avanaœ} ............. 45g
S 77.3, Verbes dénominatifs latins en igo (mitigo)...................... Md7
$77^* Verbes dénominatifs grecs en <reia (zsa.paScêaetco). — Dénominalifs
latins en «rib, 10 (parturio, equio). ........................ 458
S 775. Verbes dénominatiis latins en isso et emo (atticisso, capesso)......... 45q
S 776. Verbes inchoatils latins en sco; verbes grecs en okco............... 4g0
S 777. Verbes dénominatifs sanscrits formés par la simple addition d’un a.
— Formations analogues en latin, en grec, en gothique et en arménien. — Verbes grecs en evœ. — Verbes arméniens en amm..... 46a
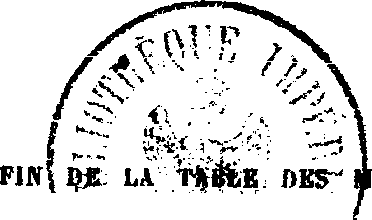
Dobrowsky, Institutiones linguœ slavicœ veteris diadecti (Vienne, 18*22). Kopitar, Glagoîita Clozianus (Vienne, i836). Bopp consulta, en outre, un certain nombre de livres se rapportant aux dialectes modernes. Pour la seconde édition de son ouvrage, il revit toute la partie slave d’après les travaux de Mikïosich.
Voyez S 92m. Comparez Schleicher, dans les Beilrâge de Kuhn et Schleicher, 1, /101-/426.
Première édition de la Grammaire comparée. Préface du second fascicule, p. VI.
Ajoutons cependant que la diversité des contractions est due sans doute
aux lettres différentes ($ et m) dont le thème était suivi.
Inslitntiones linguw slavicœ, p. h'jô. Comparez Kopitar, Glagolila,
Voyez § 237, 3. C’est cette construction qui a donné naissance à IV iulfet persan. Dans les Védas, nous trouvons le pronom y a employé d’une façon analogue.
Voyez S 287 et suiv. Comparez Ebel, dans le Journal de Kuhn, V. p. 80/1.
9 L'allemand montre sur ce point beaucoup de délicatesse et de logi-
La recension en question a été reproduite dans le volume intitulé Vocalismus. Voyez page 121 et suiv. Cette première opinion de Bopp est celle qu’a adoptée Schleicher, dans son Compendium (2e édition), p, 624.
* Des exemples d’empiétement de la déclinaison» pronominale sur la déclinaison des noms se trouvent en grec, en latin, en lithuanien, en pâli (SS 173, 228*, 2/18, 27/i).
Voyez S 280. Comparez Guillaume Scherer, Zur Geschichte der deut-schen Sprache (Berlin, 1868), p. 4o8. On trouvera en cet endroit l’énumération des diverses suppositions qui ont été faites à ce sujet. Voyez aussi Léo Meyer, Ueber dte Flexion der Âdjcctivn im deulschen ( Berlin, 1863 ).
Les langues anciennes fout du comparatif 'in usage beaucoup plus étendu que nos idiomes modernes. Elles peuvent l'employer toutes les fois qu'il s’agit d’exprimer une notion qui, pour être complète, suppose un second terme : ainsi le comparatif est de mise avec les mots signiGant droit et gauche, haut et bas, devant et derrière, notre (par opposition avec ce qui n'est pas à nous), etc. De même, le superlatif s'emploie avec les mots exprimant une situation dans l'espace ou dans le temps, avec les noms de nombre ordinaux et toutes les fois qu'il y a relation exprimée ou sous-entendue entre plusieurs objets.
* Pour le détail de ces identiGcations, nous renvoyons h l’ouvraere de
1 «f KJ
Bopp (8 298* et suiv.). — Sur le comparatif et le superlatif, on pourra consulter aussi ; Weihrich, De gradibus eomparationis linguarum sanscritw, grœcœ, latinœ, gothicœ (Giessen, 1869).
Voyez § 12.
La même chose est arrivée en gothique.
a Benfey, Histoire de la linguistique, p. £92. Sur le comparatif et le superlatif latins, voyez Corssen, Journal de Kuhn, III, afii, et Krittsche Beitrâge, p. 313.
Voyez, par exemple, la déclinaison féminine :
Quatre.
catasras catasrïbhis nitnsi'ïshu, etc.
* Voyez $ 3i3.
On sait que ïe latin emploie quelquefois hic dans le sens de ego :
Si tu hic esses, aliter son fias,
dit Tdrence, dans l’Andrienne (III, i, 10). Le grec, en pareil cas, dit ôSe dvrj(i. Sm* un emploi analogue de ayan ganas <rhic honio» en sanscrit, voyez S 333.
Les pronoms grecs supposent la forme affaiblie smi, et non sma. Au thème sanscrit a-sma ernousn correspond, en éolien, le thème d-fjtjxf, à-fxpe (pour à-<Tfte); au thème yu-shma trvous» répond, dans le même
dialecte, 6-upt, ti-fipe. En dialecte attique, >/-fv~fu; de là les nominatifs pluriel v-fists.
s Voyez § 166-170. 33i-335.
Voyez S 331.
a Voyez l'Essai sur Apollonius Dyscole de M. Egger, p. 106. Peut-être M. Bopp s’est-il montré ici plus philosophe que grammairien. Nous voyons que dans a-stnâi rriltin, a-smât irillo», a-smin (fin illo», sma est construit en apposition avec le thème pronominal précédent. Il est difficile d admettre que dans a-sivA rrnous», yu-shmê rrvousn la construction soit autre. Sur l’origine probable du pronom sma, voyez Benfey, Ueber einige Pluraîbil-dungen des indo-gennanischcn Verbum (Gôttingen, 1867 ), p. i1, et Kuhn,
dans son Journal, XVIII, p. 353 et 363.
* Dans ê-la, ê-ka, le premier membre est probablement le thème i
frappé du gouna.
Inscriptiones NeapoUtanœ de Mommsen, 588â :
Protogenes Cloul. suavei heicei sîtus mitmts,
Heicei est un locatif : il est devenu plus lard hic. Comparez Gorssen, sprache, Vocalismus und Bctonung der laleinischm Sprache (ire édition), I. p. 271.
Vovez $ 343.
Voyez S 341 et suiv.
* H manque déjà en ancien saxon et en anglo-saxon.
De même, les adjectifs pronominaux êàs, <r<péTepos peuvent signifier tr mon, ton, noire, votre». Sur un emploi analogue de l'adjectif possessif svti en sanscrit, voyez le Glossaire de iîopp, au mot mi.
Comparez, par exemple, le latin jam, le gothique jah «et *,ja cr oui «,
jai « certes », jains « celui-là».
Approchons aussi l’emploi de às dans les textes homériques. Nous nous contenterons de citer le nal Ôs é<pïj qui y revient si souvent. Il faut pourtant ajouter que le grec ayant également changé en esprit rude un y et un s initial, il est difficile de distinguer ce qui appartient au thème y a ou au thème sa.
3 En ancien perse, ce sont les thèmes composés hya et tya qui ont le sens relatif.
Comparez aussi les préfixes qui marquent l’éloignement. Le sanscrit . apa-bhî signifie «qui n’a point de crainte n, le grec dnÔH^rjpos « déshérité «, le latin exsors ou eæpers «qui n’a point de part», l’allemand abgunst « défaveur*. Dans tous ces mots, la particule de lieu a pris un sens négatif.
Après la Grammaire comparée, l’ouvrage qui a fait accomplir le plus de progrès à la théorie du verbe est le livre de M. George Curtius : La iormation des temps et des modes en grec et en latin (Berlin, 18A6). Dans
la seconde édition de sa Grammaire comparée, M. Bopp a pu mettre a
proGt ce travail, qu’il cite fréquemment.
Voyez ci-dessus, p. xxxv.
En sanscrit paiement, Taccent n’est pas resté partout à sa place primitive. Ainsi dàdàmi a avancé l’accent sur la syllabe réduplicative, tandis que bihharmi a encore le ton sur la syllabe radicale.
Voyez surtout sa Grammaire sanscrite abrégée.
§ k80-&93. On ne peut nier cependant que M. Bopp cherche à diminuer la part de l’accent; voyez, par exemple, la note dirigée contre Holtz-mann (S 60&, remarque), où il dit en terminant qu’il regarde l’accentuation de t'fier comme plus ancienne que celle de imâs. Notre auteur s’est aussi quelque peu exposé en soutenant contre Diez que la différence qu’on remarque en français entre je tiens et nous tenons est due, non à l’accent tonique, mais au poids des désinences (S 5i 1, remarque 9).
Voyez S 309 % 3.
Si la Conjugaison n’était alimentée qu’à l’aide des seules racines, le nombre des verbes serait extrêmement limité; mais grâce aux nombreux suffixes dont disposent nos idiomes, nous pouvons former une quantité indéfinie de thèmes, et à leur tour ces thèmes peuvent donner naissance à des verbes.
Recherches étymologiques, t" édit. 1, p. 6o; a* édit. II, p. 668.
Odysséej XIII, 358; XXÏV. 3i3, * Voyez S 73s.
' Voyez S Soi.
Recherches étymologiques, II, p. 718. Cette explication est encore adoptée par M. George Gurtius, dans son livre sur les temps et les modes
( 18&6); mais il y a renoncé depuis.
Bopp, dans sa Grammaire comparée, fascicule III ( 1887). Kuhn, dans sa thèse pour le doctoral, De conjugalione in fi*, finguœ sanscriiœ ratione
Au sujet d’un moyen qui s'est formé d’une façon analogue en norrois, voyez Grimm, Grammaire allemande, IV, p. 3g et suiv.
Le changement du moyen en passif est un fait dont on trouve des exemples dans tous les idiomes indo-européens. Ainsi les formes moyennes conservées dans Ulfilas ont pour la plupart le sens passif (8 4a6). D’un autre côté, les formes slaves comme c'ïtuii sah peuvent signifier «je suis honoré», aussi bien que trje m’honore». C’est aussi comme passif que le moyen subsiste en grec moderne. — Un travail sur le passif dans les différentes langues du globe a été publié par H. C. von der Gabelentz (Mémoires de l’Académie royale de Saxe, 1860).
Nous voulons parler des syllabes ya ( tud-ya-tê rr il est frappé *) et Oij (Xv-drf-eerat, èXv-drj-v). Les désinences sont partout celles du moyen ou de factif. Sur les formes sanscrites comme agani n-il fut mis au monde*. anâyi tril fut conduit*, voyez Benfey, Ueber cinige Phralbïldungen, p. 34, et Kuhn, dans son Journal, XVIII, 3pd.
Certaines formes védiques comme dâdrïçus (racine darç) te ils virent?), dâdhâra (racine dhar) rril soutint?), où la syllabe réduplicative est longue, sont peut-être le reste d’une période où l’on disait dardnçus, dardkâra. Voyez Benfey, Grammaire sanscrite développée, page 873, note 8, et Kuhn, dans son Journal, XVili, p. h 10.
* Voyez S 689 et suiv.
II nous reste un petit nombre d’exemples du plus-que-parfait sanscrit. Voyez Benfey, A praetical grammar of the sanskrit iangmge, ac édition (Londres, 1868). S 186.
Plus nos idiomes ont conservé le libre maniement de leurs racines, plus ils ont de facilité à créer des aoristes seconds. Le dialecte védique compte un plus grand nombre de ces formes que le sanscrit classique (Kuhn, dans son Journal, XVIII, p. 878 et suiv.). Sur les restes de ce temps conservés en ancien slave, voyez S et suiv.
Dans ces aoristes, nous avons tout h la fois le redoublement et Taug-ment. Voyez S 584 et suiv.
Voyez SS 609, 611, 615. — %ir toute cette question, voyez Curtius, Les Temps et les modes, p. 190 ef suiv.
4 Selon Curtius, dix-neuf parfaits en xa, aucun parfait à aspiration. Ibidem, p. 196 et 200.
ffCe qui est de règle en slave, dit M. Bopp (S 568), a bien pu arriver accidentellement en grec.» Gf. SS 56q, 646 (remarque) et 66q. — L’explication la plus vraisemblable des parfaits en xa a été donnée par G. Cur-tius, dans ses Principes de l’étymologie grecque (a* édition), p. 6o.
Nous nous contenions de ces exemples empruntés à Faïlemanrl. Le
Voyez S 589 et suiv. L’auteur a soin d’ajouter (S 606) que la contraction de la syllabe réduplicative et de la syllabe radicale, quoique nous la retrouvions en plusieurs idiomes, est postérieure à la période indo-européenne.
Voyez S 607 et suiv. Comparez en latin deico,feido (plus tard dico, jïdo), venant des racines dïc, fïd, que nous trouvons, par exemple, dans judicem, perjidus.
■' Vovez S 60h. Comparez § 60H, remarque.
Sur le sens de ce mot, voyez ci-dessus, t. ï, p. 1, note.
* Sur le phénomène en question, le lecteur pourra consulter : Hoitzraann, Ueber deti Abïaut (Carlsruhe, i SUb ) ; Grein, Ablaut, Reduplication vnd secun-dâre Wurzeln (Gassel, 186a) ; Guillaume Scherer. Zur Geschichte der deutschen Sprache, p. 171 et suiv.
Voyez $ 6so et $ui\.
J Voyez SS G 5 7 et (iyn.
Voyez Curtius, Gruwlzüge der gricchischen Etymologie (2e éd.), p. 35g. - Rapprochez aussi le grec sïftt, qui signifie «je vais» et «j irai».
* Voyez ci-dessus, p. l. Le potentiel (a)s-yâ-t «•qu’il soit» (— grec e(<r)-/>/) ti csl pas autre chose, au fond, que le subjonctif de ce pi’esent (a)s-ya-ti.
• Loin parez !e changement de X&yoajo en Aoyow, Aô-yoo, Adyou.
L’explication de M. Bopp est quelque peu diiïërente (5 650). Nous avons donné l’explication de Curtius et de Schleiclier.
Ajoutons, cependant, qu’on a constaté quelques traces de 1 aoriste second. C’est ainsi que le participe (devenu substantif) parsns -père, mère « est avecpariem dans le même rapport qu en grec tsxwv avec tIktojv.
Voy ez $8 546 et suiv. 676, 877 et 679.
Sur le parfait latin, voyez Curlius, Tempora utid Modi, p. ao5 et •39/1. Schleicher, Compendium (2* édition), p. 789 et 827.
Voir ci-dessus, [». lxï.
Les premières personnes dicem, faciem, qui étaient encore usitées au temps de Caton le Censeur (Quintilien, I, vu, *23), ont été remplacées plus tard par les subjonctifs dicam et faciam.
Voyez S 777.
* Voyez S 769.
Voyez S 762.
Voyez S 778. Les verbes latins en igâre sont un exemple de la force de l’analogie. L’ancienne langue latine a dû posséder un certain nombre de substantifs formés comme remex, remigis (d’où remtgium); on peut supposer, par exemple, un substantif litex, Utigis (d’où iitigium). Ges noms ont donné naissance aux verbes eu igâre, tels que remigare, litigare, et à l’imitation de ceux-ci, on a fait fumigare, mitigare.
Ce qui prouve que, dans les verbes comme açvasyati, l’idée du désir
na pas besoin d’être explicitement énoncée, ce sont les verbes comme equîre en latin, rattpâùs en grec.
Voyez SS 761 et 770.
3 Fullja «impleon, jullna «impleorn. Voyez § 770 et suiv. Comparez s 777-
Sur le changement de sk en ce h, voyez Kuhn, dans son Journal, t- III, p. 3a 1 et suiv.
Tome I, page kh4.
Tome I, page 855.
Le subjonctif gothique correspond au potentiel sanscrit ( bar-è-fa pour bar-ài-ta) "I ;■ l'optatif grec (pép-at-ro). Voyez S 672 et suiv.
s .
Voyez ci-dessus, tome I, page 20, note 2.
* H sera question plus loin (S 733 et suiv.) de Lorigme de cette syllabe.
Forme irrégulière pour dadâ-tê.
Quelques racines en a affaiblissent cette voyelle en î devant le caractère passif ya.
C’est le plus fréquemment employé.
3 En général, le précatif est beaucoup moins usité qrie le potentiel.
Plusieurs dialectes slaves ont encore le duel, notamment le slovène, le bohémien et le serbe.
i Cependant, en slave, le verbe fait à certaines personnes la distinction des genres. Voyez S 697, remarque.
Excepté dans tm «je suis».
Toutes les langues n'ont pas ta première personne dueïie de la forme transitive. Le grec, par exemple, en est dépourvu,
s On a donc rvic-au en regard du sanscrit ttip-i~éyà'-mi (S 664), et, de même, St£)-tya>i àclx-au en regard de ild-syâ'-mî, dd-syiï-mi, s'tâ-syft-tm,
‘dék-éyâ-mt.
Ii sera question plus loin (S ) de la division des verbes sanscrits en deux conjugaisons. La deuxième conjugaison comprend les deuxième, troisième, cinquième, septième, huitième et neuvième classes (S 109 a). Néanmoins, elle ne
compte qu'un nombre de verbes relativement petit, environ deux cents. [La division en deux conjugaisons appartient à M. Bopp; la division en dix classes provient des grammairiens indiens. — Tr.]
II ne peut être question ici que du duel moyen, le duel actif trayant plus de première personne.
Un d radical tombe, en slave, devant les désinences personnelles commençant par m et w. Devant un t, il se change en s (S io3).
Gomme ima-mï est, dans la conjugaison ordinaire, le seul verbe où la désiuence personnelle vienne se joindre à un a, je crois que c’est cet a qui nous a conservé ici la désinence complète. On a vu plus haut que Ta est la plus pesante et la plus énergique parmi les voyelles. De même, en polonais, abstraction faite du petit nombre de verbes qui joignent immédiatement les désinences personnelles à la racine, il n’y a que la conjugaison en a (la première conjugaison suivant la division de Bandtke) qni ait conservé le signe personnel m; exemple : czyt-a-m trje lis”.
Ce sont seulement les manuscrits les plus anciens qui présentent un m. Depuis le ixe siècle, on a un n. À la première personne du pluriel, on a également n au lieu de mê$. Voyez Grimm, Grammaire allemande, 1.1, p. 870.
4 Comparez, pour le sens, vt'-dadâ-tni «je fais».
Les formes entre parenthèses sont celles qui sont restituées par conjecture. —Tr.
* Voyez $ 5o8. Conjuguée d’après la deuxième classe, la racine siâ ferait stâ-mi.
Deuxième et troisième conjugaisons à forme faible, d’après la division de Grimm. Voyez S 109â, 6.
Exemple : bir-u «je porte», pour le sanscrit Mr-a-mi, deuxième personne imv-âsi. L'u du vieux haut-allemand bir-u est l'affaiblissement de l’a du gothique bairn : il ne faut donc pas le comparer à l’a du lithuanien suhu (venant de sukm, S Ü36, i), mais plutôt à Vu des verbes bohémiens comme plet-u «je tresse ». En effet, dans ce dernier verbe, Et* est un reste de l’ancien slave J» un (S 436, a) et il est identique, comme l’e de plet~e-ê «tu tresses», à Va qui sert de caractéristique, en sanscrit, aux verbes tels que hâr-â-mi, tiâr-a-st.
Pour bim-u-mês — sanscrit b'âv-à-mas. Voyez S ao.
ni.
Vovez S 109", 1, a et (>.
Ÿj'j'lôpvv-e supposerait en sanscrit une forme àstrnav-a-t.
A la troisième personne de l’imparfait, on a âvét au lieu de âvêt-t (S §U). La deuxième personne, au lieu de âvêt-s, fait de même avét, ou bien âve-s avec suppression de la consonne radicale et maintien de la désinence, comme dans le latin pe-s, pour ped-s.
Neuvième classe. Voyez S 109*, 5.
Voyez S 333.
3 Pott explique autrement la syllabe mas (Annales de critique scientifique, 1833, page 3a6). Il y voit la réunion des pronoms delà première et de la deuxième personne : le pronom de la première personne serait exprimé par ma; celui de la deuxième par s, comme à la seconde personne du verbe. Mais il faut d’abord faire dériver ce s du t de tvam, au lieu que, en adoptant l’opinion donnée ci-dessus, le s n’a pas besoin d’explication. Il semble d’ailleurs plus naturel que l’expression «nous» associe au moi des personnes autres que celles à qui on adresse la parole, car les récits ne se font pas ordinairement à ceux qui ont pris part aux événements racontés.
Exemple : dadmasi, en zend dadëmahi «nous donnons». [La
b Nous avons cru devoir transporter ici, comme à sa place la plus naturelle, une note qui, dans l’édition allemande, se trouve au S 727. — Tr.
Voyez S 691. — On pourrait objecter qu’à côté de la forme Sev il existe une forme -0e. Mais Buttmann (Grammaire grecque développée, S 116, à, remarque 1) fait observer que les particules qui prennent -de sont celles qui ne répondent plus très-nettement à la question undc. Partout ailleurs, c’est le mètre qui a occasionné le changement de-dev en-de (dv-rpode, Pindare; Kvxpode, Cailimaque; A*&îet0e, /usdv-vode, Tbeocrite). Rappelons aussi la suppression complète du v dans les accusatifs
Compares les impératifs latins en tûte et les impératifs védiques eu tât { deuxième
et troisième personnes du singulier). Voyez S 719.
Comparez les itominaLifs singuliers des thèmes en o avec les nominatifs sanscrits en as (S a55, t. U, p. 86), et les datifs pluriels en MS mü avec les datifs sanscrits en h'ym (S 277 ).
1 Dictionnaire du vieux haut-allemand, 1.1, col. 2t.
De même au pluriel on a bair-a-m (grec Çép-o~fie$) en regard du sanscrit Hâr-â-mas.
On a vu (S 69, 1) que fd, en gothique, est la longue de Tu,* ainsi les thèmes en a font, au nominatif pluriel, os («4- as); exemple : vairos k hommes », en regard du sanscrit varas (venant de tara -f- as)-
Grammaire grecque, 3* édition, S i 63, remarque.
On a vu (S 332) que sma se joint indifféremment au pronom de la première
personne nous»), ou à celui delà deuxième personne (i/«-im^'«vousî>).
hhh. Deuxième personne du duel, en gothique, en ancien slave
et en lithuanien.
Tandis qu’en grec le s de la désinence duelle tas s’est altéré en v, même dans les formes primaires, le gothique étend l’ancien s à toutes les formes, tant primaires que secondaires. C’est là une nouvelle preuve du fait énoncé ci-dessus, à savoir que la nasale que nous trouvons en sanscrit à la deuxième personne duelle des formes secondaires, provient d’un ancien s, et que cette altération est postérieure à la séparation des idiomes. Le gothique a, au contraire, perdu l’a qui précédait le s : cette suppression est conforme à une règle générale de cette langue, qui veut que devant un s final, dans les mots polysyllabiques, Ya soit ou rejeté ou affaibli en t. Ici, l’a a été rejeté, ce qui fait que nous avons ts comme désinence, en regard du sanscrit
Forme védique.
Ou, avec deux s, giw-a-ssi. Voyez mon mémoire Sur ia tangue des Borussiens, pages 9 et 1 o.
En traitant des formes asmai, asrnu, asnlau, Schteiclier (Mémoires de philologie comparée, publiés par Kuhn et Scbleicher, L I, p. 11 h et suiv.) parait n’avoir pas tenu compte du lette mnu, quand il affirme que ni en lithuanien, ni dans aucune langue indo-européenne, il n’existe à la première personne du singulier actif une désinence -mau ou -m«. Si nous ne connaissions la forme intermédiaire asmai, fournie par le borussien, il serait difficile de concevoir comment la désinence mi a pu devenir mu en lette; mais on comprend sans peine comment, d’après le principe du gouna sanscrit, mi devient mai à son tour, mai a pu faire mu, de la même manière que les datifs pronominaux en smâi ont fait smu en borussien et mu eu vieux haut-allemand. Par un nouveau gouna, esrnu devient esmau (comparez le borussien saunai) 'ffilium» au sanscrit winû-m, au lithuanien sunun).
* Le latin présente de même humus en regard du sanscrit Biïmi.
La seule exception est êdï «sois», venant de ad-dh, qui lui-mème est poui as-dû Comparez le grec ïa-81.
Système détaillé de la langue sanscrite (1837),S3i 5, remarque. Gmmmatica mftce, % 3i5. Annales de critique scientifique, i83î, p. 381.
Voyez Rosen, Rig-vedœ specimen, pages fi et 92.
Voyez S 57.
Voyez S loa. On trouve aussi (Yendidad-Sâdé, p. 622) Midi, dans lequel je
Grammaire grecque, principalement pour le dialecte homérique, p. 216.
Ou pourrait supposer, par exemple, le thème *, que nous trouvons dans le zend i-da «ici» (S 4âo).
Ulfilas. Luc. XIX, 91.
A la troisième personne, gaigrôt, en regard du sanscrit cakrând^a «il pleura». La deuxième personne ne s’est pas conservée; mais nous l’avons rétablie d’après l’analogie de la troisième. On peut croire que ce sont surtout les verbes ayant un 6 au prétérit, comme gaigi’ost, qui ont contribué à nous donner les formes comme misôst.
Voyez S 616 et Grimm, Grammaire allemande, I, p. 881 etsuiv.
En arménien, es.
Voyez S A48.
En arménien, wuuu tas.
En arménien, beres.
' La désinence personnelle se joint immédiatement à la racine, comme dans le
sanscrit hibaréi (troisième classe). Voyez S 109 % 8.
On trouve la désinence tâ pour la troisième personne du duel : on en peut inférer presque avec certitude que ia désinence de la deuxième personne, dans les formes primaires, était to.
Comparez fewr bify'-ta (troisième classe).
Avec th pour d (S 446).
S par euphonie pour d (S î o3). Même observation pour ves-tï et dus-tu * Dans du si et tes trois verbes suivants, le s tient la place d'un ancien d (SS îoa et io3).
Compare/, la désinence di en pràcrit.
II permet, à la fin des mots, une sifflante précédée de r, k> f ou nf nous avons, par exemple, les nominatifs dtar-s «feu», drufc-s (sorte de démon femelle), kërtif-s «corps", bnrah-é «portant».
Dans cette hypothèse, Vu répondrait au dernier élément de la diplithongue grecque ou, dans ovm.
* Sur le y euphonique, voyez S 43.
Je divise de cette façon : tek-u-n, parce que l’« du deuxième aoriste slave, lequel répond à la sixième formation sanscrite (S 5y5 et suiv.), est originairement identique avec le C e de tek-e «tu courus, il courut», tek-e-mü «nous courûmes», tek-e-te «vous courûtes», etc. Conséquemment, il est aussi identique avec Va des aoristes sanscrits comme àbu£-a-n «ils surent» et avec Vo des aoristes grecs comme ëhit-o-p. Quant à l’a de la désinence A an, a l’aoriste premier, il joue à peu près le
m ui sayêintê «nascuntur» (Vendidad-Sadé, p. i36), avec ê pour a (S 4 a). Au moyen, je ne connais pas d’exemple de la troisième personne ; mais, sans aucun doute, on a dû avoir barainté, ou peut-être barënté, d’après l’analogie du transitif barënti. L’une et l’autre forme ont pu être usitées simultanément; mais la forme barainté me parait la plus sure, car ou a aussi ainti, à l’actif transitif, à côté de ënti. Après un v, on trouve d’ordinaire ainti : ainsi gvainti «ils vivent» = sanscrit gîvanti, bavainti ttiis sont» *= sanscrit bàvanti. Peut-être la désinence ënti n’était-elle pas usitée après un v. On trouve même, sans un v, yasainti = sanscrit yàganh (Burnouf, Yaçna, notes, p. 74 ) : à moins qu’il ne faille lire yasainté, y as étant surtout employé au moyen.
Voyez $ 435.
Voyez S 4 i.
Au passif, il y a plusieurs exemples de la troisième personne du pluriel. Ainsi :
Système de conjugaison de la langue sanscrite (1816), p. 131, et Annales de littérature orientale (1820), p. 29 etsuiv,
En zend, à la troisième personne du pluriel, nous pouvons attendre une forme moyenne bar-ai-nta, d’après l’analogie de la forme active bar-ay-ën. En sanscrit, nous avons har-ë-ran, qui est, comme je le crois, pour Var-ê-ranta. Cette désinence ran est particulière au sanscrit. Nous trouvons de même un r inséré à la troisième personne de tous les temps spéciaux (S 109“) de la racine « «être étendu, dormir»; nous avons, par exemple, au présent, éê^-ra(n)te — xeï-vrou; au potentiel, éây-î-ran; à l’impératif, ê^ra(n)tâm; au prétérit, âsé-i’a(n)ta — éxetvTo (sur la suppression de n, au présent, à l’impératif et au prétérit, voyez S 45p). Nous verrons aussi plus tard un r au prétérit redoublé moyen. Quant à l’origine de cette lettre, je crois qu’il y faut voir la transformation irrégulière d’un s (S 22), et je suppose que ce * est la consonne radicale du verbe substantif as : ainsi dâd-î-ran (pour dad-î-ranta) aurait la même formation que l’aoriste grec SiSolrjaav, dont le médio-passif, s’il existait, serait hSotriaavto ou ê«5o<oravro.
Comparez, en sanscrit, l’impératif moyen b'âr-a-tmi «ferto» et b'âr-a-ntâm tffernnto».
Vendidad-Sâdé, p. hû, Anquetii traduit les mots : hé tûm tiéasayanha par «lui qui a eu un fils célèbre comme vous». Le vrai sens est : «tu lui fus engendré». La traduction d’Ànquetil méconnaît la valeur grammaticale d’une expression devenue sans doute inintelligible pour ses maîtres parses.
Comparez, dans la déclinaison du même pronom, ia forme tê «de toi, à loi» (S 329). -,
4 “VII, 1, 35.
Formule de respect pour «puisses-tu vivre». _
Sur ia table de Bantia. Comparez les ablatifs osques en ud qui correspondent aux anciens ablatifs latins en o-d (S 181) et aux ablatifs sanscrits et zends en ât et en âd.
C’est un fait à remarquer que, sans connaître tes impératifs védiques en tât,
\ ondidiifï-Sildé, 'i5.
Grammaire allemande, I, p. io3 et suiv.
Parfait redoublé de la racine tap «brûler».
Polt suppose que 1’* de amaris appartient à la désinence primitive si ( Recherches étymologiques, 1 édition, ï, p. i35). Je ne puis admettre celle explication, car je rapporte la formation du passif latin à une époque où l’actif avait déjà perdu son i
L’accusalif du pronom réfléchi, en lithuanien, est sawen; mais à côté de cette forme, et peut-être aussi à côté du datif saw, il paraît y avoir eu une forme secondaire si. Évidemment, c’est ce si qui aura fourni le suffixe des verbes réfléchis : d’ailleurs, à la troisième personne, on trouve également, au lieu d’un simple *, la forme pleine si; on a, par exemple, wadtnas ou wadinasi «il se nomme». Quand le verbe est précédé de certaines prépositions comme at, ap, ou de la négation ne, le pronom réfléchi peut venir s’intercaler sous la forme si, quoiqu’il puisse également être mis à la fin : on a, par exemple, is-si-laikau-s «je me soutiens». Gomme exemple du pronom si intercalé avec le sens du datif, nous citerons at-si-neèu «je m’apporte [quelque chose]». Voyez Nesselmann, p. Z120.
* Comparez SS 388 et 390.
Rapprochez le sanscrit vad «parler», le vieux haut-allemand far-wâzn «male-dico», l’irlandais feadheim «je rapporte».
Venant, par assimilation, de ê<r-fd, comme éftftes, àppes de dvpeç, vapes =* védique asmêyufmé'($ 333).
s Forme irrégulière pour as-si : cW à cette dernière forme que se rapporte le grec èa-ert.
Voyez $ Uln.
â Voyez S 109®, 3.
1 C’est là un des faits qui m’ont permis de reconnaître que l’a long est plus pesant que 17 long, et l’« bref ([ue 17 bref (S (i).
Remarquez le déplacement de l'accent, occasionné par le poids des désinences personnelles (§ A92). Voyez aussi Système comparatif d'accentuation, S 66.
* Je ne connais pas d’exemple, en zend, de la deuxième personne du duel; mais
le tô de la troisième personne (S 464) nous autorise à croire que la deuxième personne faisait té, dans les formes primaires. Dans dasto, le t devait se changer
en f, à cause du » i précédent (S 38). Ce » è lui-mème tient la place d’un^j) d (S 109).
* Voyez S 3o.
Voyez S 10a.
Les verbes réduplicatifs ne déplacent pas l’accent devant les désinences pesantes commençant par une voyelle. En ce qui concerne l'accentuation, le sanscrit traite IV» de la troisième personne du pluriel comme faisant partie de la désinence.
Voyez S A5q.
Voyez S îog8, i.
L'a, qui est déjà la plus pesante des voyelles (S 6), se trouverait encore long par position, à cause de gr.
Comparez le gothique gang» «je vais», où la syllabe principale a perdu sa nasale.
Voyez S 109%
 l'égard du sens, est avec bâ'mi «je brille» dans le même rapport qu'en sanscrit cak§ «parler» avec cakâs «briller», dont il est la contraction. La parole est présentée comme un éclaircissement Voyez Glossaire sanscrit, éd. 18A7, p. 116.
* Le sens causatif vient du redoublement, comme dans le latin sisio, dont le primitif est sto. Au contraire, le verbe redoublé (== aio1-ny.t) joint le sens de «se tenir debout» à celui de «faire tenir debout». Dans ia7yfu, l'esprit rude occupe (et c'est là sa valeur la plus fréquente) la place d'un s ; il n'en est pas de même dans , où l’esprit rude représente l'ancienne semi-voyelle j {ji-jyyu, S 19). Nous trouvons au futur la forme dépouillée du redoublement jf-aa = yâsyâ'mi.
Ce rapprochement a été fait d'abord par Pott ( Recherches étymologiques, 1re dition, t. 1, p. 201).
La forme santï est d'ailleurs usitée (Miklosieh, Théorie des formes, ae édition, S 96A, et Hadices, p. 91). Miklosieh et Schîeicher proposent pour saft^ti une étymologie différente : ils le rattachent à la racine sanscrite îr5PT^ svan «résonner», que je crois, au contraire, retrouver dans 3EMt'fcTH svïnéti (§ 921).
4 Voyez S 109% 5.
Quelquefois le sanscrit, au lieu de changer nâ en ne, le change en nâ, comme le grec. Nous trouvons, par exemple, dans le Mahâbhârata, mat-na-dvam (deuxième personne du pluriel de l'impératif), au lieu de mat-nî-dvatn, et praiÿ-itgrkM tü, au lieu de pralif-agrh-nî-ta. Voyez Grammaire sanscrite, $ 365b.
Avec n au lieu de n, à cause de r (S 17 b). Le grec 'srépvâfu «je vends» a changé
la gutturale en labiale : de là vient Pair de parenté avec «repa# «je traverse»
{= sanscrit pârâifdmi), où le 'ts est primitif.
Voyez, au sujet de Taccenl, S £99, et Système comparatif d'accentuation, S (56.
1 Si, au lieu de diviser de cette façon, on divise ainsi : krî-n-ânti, (ikrî-n’-an (comparez S A58), il faudra admettre que la syllabe caractéristique supprime sa voyelle finale devant toutes les désinences pesantes commençant par une voyelle. C’est ainsi que nous avons au moyen hn-n-é', venant de krt-ni-mê. Au point de vue spécial de la grammaire sanscrite, cette règle peut continuer à être maintenue. Mais si nous voulons nous rendre compte du développement historique de ces formes, ou, en d’autres termes, si nous voulons observer l’altération graduelle de la langue, il faut admettre une autre explication. Je crois que devant nti et n (pour ni), la syllabe nâ est devenue nâ; la langue a évité de placer m, syllabe déjà longue par elle-même, devant deux consonnes. Devant été, âté, âtâm, àtdm, désinences du duel moyen, n« pouvait être maintenu, parce qu’il donnait un son homogène, et, par conséquent, plus léger que si l’en avait eu nt été, qui aurait fait ny-âti.
1 Dans la conjugaison sanscrite, les voyelle* brèves ne peuvent prendre le gouna
Comparez Vocalisme, p. 927 et suiv.
* C’est l’opinion que j'avais exprimée autrefois. Annales de critique scientifique, 1^a7'> P* 270, et Vocalisme, p. 39.
* Ou fer (S t).
La suppression de la voyelle caractéristique « à la première personne du duel et du pluriel, ainsi que dans tout le potentiel, est une irrégularité particulière à ce verbe.
5 Sur l’origine de cet i, voyez S 606.
L’auteur trouve aussi dans les langues romanes des exemples dt^ l’effet exercé par le poids des désinences personnelles sur la voyelle radicale. Voyez S 511, remarque a. — Tr.
La voyelle a remplace Le devant une nasale.
Voyez S 109% 5.
H n’y a pas de désinence personnelle : toute la première conjugaison principale est dénuée de flexion à la deuxième personne du singulier de l’impératif transitif.
Ân lieu des formes usitées ax-nn-mi, m-vd-si, as-nd-fi.
Comparez cinâdmi «je fends» avec le grec crxtS~vji-pi.
* Devant un r, ni devient ne; exemple : ster-ne-re.
1 Voyez S *09% 1.
* Srldeicher, Grammaire lithuanienne, p. 9/Ï0.
Voyez S 7Û9 et suiv.
Voyez S 733 et suiv.
:i Voyez S 109% a.
Ces racines appartiennent à la sixième classe : c’est im principe général, en sanscrit, que les formes monosyllabiques finissant par t, f, u, û, changent celte voyelle en iy, uv, devant une désinence grammaticale ou un suffixe commençant par une voyelle. Ainsi Ht «peur» fait à l’accusatif bty-am, M «terre» fait Vüv-am. La racine nu «célébrer» (sixième classe) fait à la troisième personne du présent
nuv-â-ti. ‘
* Nous avons, par exemple, en russe 6bk> bïj-u «je frappe», vïj-u «je tourne»,
lij-n «je verse» (= sanscrit lî «couler»), Otj-u «je couds» (— sanscrit »tt> «coudre»), gnij-u «je pourris», vo-pij-u «je crie», po-cij-u «je repose» (= sanscrit si, pour M,
«être couché, dormir»).
Voyez Mikïosich, S i6è.
m.
Ces racines sont en petit nombre.
Thème swnw.
Le j inséré devant la voyelle a amené le changement de l’o en e (S 92k ).
Le é de la racine sê tient la place d’un ancien d (S 9ae), et répond à IV de la racine gothique so (prétérit saho) et à IV du latin sê-vi, sê-men (S 5 ).
Voyez S 109®, i.
Remarquez pourtant qu’à la différence des verbes faibles ordinaires» il joint l’auxiliaire immédiatement à la racine.
5o8. Présent des verbes shî crêtre debout», grâ «rsentir».
Parmi les verbes sanscrits de la première conjugaison provenant de w&êm (S 436 ,1).
We£-i pour wez-a-i, venant de wez-asi (S 448).
Pour êyj-e^os (S 97).
Pour vig-a-vas (S 441 ).
Est remplacé par le singulier.
Vaçâmaki, comme dans le dialecte védique: vàhamasi (S 489).
Voyez S 44o.
Voyez S 44q.
Voyez S 458.
Voyez S 109% 3.
* Cet a redevient long à la première personne, d’après ta règle exposée S 636. s Voyez § 109 Y1.
Voyez 8 5n, remarque i.
* La troisième personne bau-i-tk cil demeure» représente le sanscrit bYw-a-tt {pour bô-a-tiy venant de tiau-a-ti) «il est». Voyez Grimm, Grammaire allemande, 3* édition, 1.1, p. î o î.
A C'est par abus qu’en allemand moderne celte forme smt a fini par s'introduire aussi à la première personne (wir sind).
De là l'allemand moderne ich tvar «j'étais», iekwàre «que je fusse».
Au contraire, le présent visa a conservé le sens «je reste». Sur l'affaiblissement de l’a en t, dans visa., visan, visands, voyez S 109% î.
li Nalas, XVI, vers 3o. [La double apostrophe placée devant ”satê indique, sui-
Voyez S ao. Comparez aussi Graff, Dictionnaire du vieux haut-allemand, II, colonne 3a 5.
Je ne crois donc pas qu’il faille identifier la syllabe vt de fuvi avec celle de amavt. :i Ou bist (S /iAB).
ni.
Les formes birint, birent, bimt et bînt, que Notker emploie à la deuxième personne du pluriel, se sont, je crois, introduites par abus dans cette personne; elles appartiennent à la troisième, où birint correspond très-bien au sanscrit havanti. La forme bint a éprouvé la même mutilation que le singulier bim, bis. Au sujet de ce changement de personne, nous rappellerons ce qui sVsl passé en allemand moderne, où 8tnd «ils sont» a pris aussi le sens de «nous sommes».
Comparez S h 8o.
Venant de b'ar-â-mê (SS 467 et 473).
Sur le ai de la racine, voyez S Ai, et sur le ai du gothique bairasa, S 82.
Est remplacé par la troisième personne.
Les désinences fa, da9 nda sont des formes mutilées pour §ai, dai, ndai ($ 466). Remarquez que dans bair-ar-fa, bavr-cfela la caractéristique s'est conservée sous sa forme primitive.
Les formes Hàréiê et b'âréte sont pour Var-a-âte, b'ar-a-âte, qui régulièrement auraient dû faire bâràte, bârâté. Mais dans toute la première conjugaison principale, cet & s'est affaibli en é (= a + t), ou bien l'a de la désinence s'est changé en i ou î, et a donné un é en se combinant avec la caractéristique a. — Sur l'origine probable des désinences âiê, âté, voyez SS U'jh et 47b.
Voyez SS UyU et 476.
Venant de b'ar-d-made (S 47a). Avec la désinence zende maide s'accorde d’une manière remarquable la désinence irlandaise tnaid ou mamd» par exemple dans dagtwwnaid ou daghrOrimmid «nous brûlons =■= sanscrit ââh-â-mahê, venant de ddJirâ-madê.
a Probablement pour tiar-a-ddve ($S h*] h et 476). '
Je ne connais pas d’exemple de la désinence dtve; mais on peut la supposer
Théorie des formes de l’ancien slave, 2e édition, S 25a.
Par exemple dans vê-vê « nous savons tous deux», vê-mü « nous savons», vêd-aniï «ils savent». Au contraire, en sanscrit, nous avons vid-vâs, vid-mâs, vid-ânti.
Voyez ci-dessus, 1.1, p. 17.
li n'y a pas d'exemple du sanscrit vidé1; mais le moyen a eu autrefois une plus grande extension que dans le grec et le sanscrit tels qu'ils nous sont parvenus. Peut-être même tous les verbes avaient-ils à Porigine un moyen.
Exemple : dm-te «vous donnez» (par euphonie pour dad-te) = sanscrit dat-U (S io3).
0 Dans la seconde édition de sa Théorie des formes de l'ancien sjave (page 87 ), Miklosich suppose que les troisièmes personnes du singulier en tu dérivent des formes
Page 73.
Les grammairiens indiens supposent un suffixe primitif lavant, servant a former des participes passés actifs.
a XI, 36.
Par action instantanée j’entends celle qui nous semble telle, soit parce qu’elle vient dans le récit s’ajouter à d’autres actions, soit pour tout autre motif.
Comparez, par exemple, trid-éU «sache» à veL-tu «qu’il sache», yttiig-dt «unis» à yunâktu «qu’il unisse».
Thème dâtiêr ( S 14 4 ).
* Quatre de ces formations répondent plus ou moins, en grec, à l’aoriste premier; les trois autres répondent à l’aoriste second.
en est de même à l’aoriste.
5fi o. L’imparfait employé en zend comme subjonctif présent. — Emploi analogue du prétérit redoublé.
En ce qui concerne l’emploi de l’imparfait, il faut encore re
marquer que le zend se sert très-fréquemment de ce temps
comme de subjonctif présent, et que le prétérit redoublé est
quelquefois employé avec le même sens. 11 semble que dans ces
constructions le passé soit envisagé par son côté négatif, c’est-à-dire comme niant la réalité présente, et que, par conséquent,
ait été trouvé propre [à exprimer le subjonctif, qui manque également de cette réalité. C’est pour une raison du même
dans le verbe est encore venue se joindre celle de la première classe, comme si nous avions en grec éSetx-vv-es, au lieu de eêeix-vô-s.
1 La forme sanscrite est àèi'av-am. Comparez la contraction du sanscrit yâ-vam «oryzam» en <!»«*)•$ yaum. Au sujet du b changé en »*, voyez S 63.
2 Ces deux personnes supposent en sanscrit les formes dbrâ-s, àbrô-t; mais nous avons, avec insertion irrégulière d’une voyelle de liaison, âbrav-î-s, àbrav-î-t.
Vendidad-Sâdc, manuscrit lithographié, p. a33.
3 Nous reviendrons plus loin (S 53a) sur la désinence de anhad.
3 Vendidad-Sâdé, pages a3o et a3i.
k Ibidem, page 198. Je lis raudhyanm au lieu de raudyanm; nous trouvons ailleurs (page 179) la leçon raudayën, qui contient deux autres fautes. s Fargard 2.
À la troisième personne des trois nombres, cet 5 est final, parce que la désinence personnelle est tombée.
* En sanscrit, nous avons partout un a bref : Ump-â-ti, limp-â-ia : âlip-a-t v âlip-a-ta. On a vu (S h3h) que l'allongement de l’a dans limp-à-mi, limp-â-ma$ est dû à une loi phonique particulière au sanscrit.
Au sujet de fô de raudâju, raudâjau et des formes analogues, voyez S 109 ", fi-
Système de conjugaison de ia tangue sanscrite, page i5î et smv.
Venant de dam-tor-m, S 436, 1.
Il est probable que -daw-ia-u s’est affaibli en -dawau à cause de la surcharge résultant de la composition.
J’ai déjà donné cette explication dans la première édition de cet ouvrage (S 5a5 ). Comparez Schleicher, Grammaire lithuanienne, p. 97.
* On verra plus loin (S 54s ) que les aoristes sanscrits en sam contiennent le » du verbe substantif as, avec les désinences de l’imparfait. — Ti\
On a vu (S 275) que le j se fait aussi suivre de IVt dans la déclinaison,
* Comparez $ 5o5, et rapprochez les verbes lithuaniens à conjugaison mkte (§ 5o<k
Voyez S 697.
En sanscrit, le causa tif de ad « manger » fait à Timparfait ad-aya-m.
Comparez à cette forme, après en avoir retranche le verbe substantif annexe, Timparfait du causatif sanscrit : âvêd-aya-m.
9 Ag. Benary est donc dans Terreur, quand il dit. dans sa Phonologie romaine, que le latin bam n’a pas encore été rapproché du sanscrit âbavam. Voyez mon Système de conjugaison de la langue sanscrite, p. 97.
Dans biad me, biadh-maoid, le signe de la troisième personne du singulier est venu faire corps avec la racine. .
L’auleur revient sur cette question au S 556- Tr.
Comparez S 537. .
1 Ces formes sont surtout fréquentes chez Plaute. (Voyez Struve, Do la déclinaison et de.la conjugaison latines, p. 15s et sniv. )
Avec ië = sanscrit aya; c’est la caractéristique de la dixième classe. — Les imparfaits comme sdbamyscSbat, audibant, custodîbaut, qu’on trouve dans Plaute, Lucrèce et Catulle, sont évidemment des contractions pour w.
Si nous appliquions à la langue latine la terminologie de Grimm, nous dirions que ce sont des verbes à forme forte qui se sont introduits au futur dans la conju gaison des verbes faibles (S 109% 6).
Comparez stâ-*, std~mu$p stâ-bam, xtâ-bo, en regard de la racine sanscrite stâ.
;i Voyez SS 621 et 6a3.
Le a est tombé devant le p ; mais il est resté an présent êapév.
Voyez Sas.
Excepté peut-être à la deuxième personne du singulier du présent de Vindicatif (S 53o).
Grammaire grecque, p. a36.
Nous avons expliquées i5a) par le changement du t final en s les neutres comme rerv<p6s, répas (pour rervpôr, répar) et là préposition rspès (ponr ^port — sanscrit prâti).
:t Voyez Abrégé de la Grammaire sanscrite, S 391.
Voyez S 56 \
ÎVifwi, Alphabet, p. 118. '
As est la forme védique; en zend, anhad, as, as; en ancien perse, d/w.
En sanscrit, ya (-ya-si, -ya~ti).
5 La racine is est remplacée par te dans les temps spéciaux.
C’est la classe de verbes la plus nombreuse.
535. Les verbes grecs commençant par i, v, o, ne prennent pas l’augment, mais le redoublement.
En grec, devant les racines commençant par une voyelle,
Comme e est pour a h- i et o pour a + w, le premier élément de ces diphthongues se fond avec l’a precedent en d, ce qui donne ai y du. Pour les racines qui commencent, selon les grammairiens indiens, par 7*, on pourrait dire que la forme âr ne provient pas de r, mais de la syllabe ai* dont t* est la mutilation (Si). C’est ainsi H11 au présent bffîàrmi la syllabe réduplicative n’est pas tirée, comme le dit la grammaire indienne, de #r, mais de la racine véritable bar, dont l’a s’affaiblit en i; l’affaiblissement en question n’a pas lieu au parfait redoublé, où l’on a babara ou babÏÏra "je portai*.
2 Aoriste méisam, L’imparfait se forme de ic.
U est vrai que c’est là un aoriste (S 687), mais on en peut conclure avec assez de certitude la forme de l’imparfait. Ainsi la racine hu (cinquième classe) «extraire» a dû faire ahutiu-sa (S £69). La troisième personne hu-nû-ta répond aux formes grecques comme èSeixvuzo, si l’on fait abstraction de l’allongement inorganique de la caractéristique et de la perte de i’augment.
-î On s’attendrait à avoir âb'ar-a-im (8 £71).
■’ Pour è$ep-e-t1e (S £7£).
‘ Voyez S £7^
■s D’après la troisième classe, SiBr-âtàm. (thiflr-àtàn).
On a vu (S 3o8) que eka esl un pronom.
L’unité marquée par #ka subsiste dans les composés anêka ou nâika, comme le nombre un est compris dans les nombres sept, huit , neuf, etc.
541. L’augment peut-il être considéré comme le resLe d'un redoublement?
— Examen des opinions de Buttmann et de Pott.
Va de l’augment est devenu en grec un e; au contraire, 1Vi
1 Voyez S 165 et suiv. et S 333.
â 11 est d’ailleurs employé souvent comme particule explétive.
3 Voyez mon mémoire Sur la parenté des idiomes malayo-polynésiens avec les langues indo-européennes, p. îoo et suiv.
* En nouveau-zéeïandais et en tahitien, il est employé, sous la forme te, comme article.
5 En longa, he est employé comme article; comparez le grec ô.
Tutô'pa, qui sert à la fois pour la première et la troisième personne, a en réalité perdu toute désinence personnelle ; l’a est l’ancienne voyelle de liaison.
* Grammaire grecque développée, S 8s, 3.
C’est ce que nous voyons, par exemple, dans la syllabe réduplieative des verbes désidératifs. Ainsi l’on a pipas «vouloir boire», pour papas ou papas (racine pd) ; pipatii «vouloir fendre», pour papatié (racine pat). On a, de même, biUârmi «je porte», pour baVarmi (racine b’ar, 6V); lütâmi «je suis debout» (S 5o8), pour tmiâmi (racine sia). Et, en grec, pour êàêapi (sanscrit dâddmi), etc.
Ce dernier fait se présente à l’aoriste second des verbes commençant par une voyelle, qui redoublent la racine tout entière; exemple : yÎpRïï^ âüninam (pour âumïnam), de la racine un « diminuer» (8 586 ).
1 Première édition, t. Iï, p. 73. ,
L’auteur donne ici ce tableau, parce que ces formes vont reparaître en combinaison avec les verbes attributifs. — Tr.
Au sujet de s pour s, voyez $ 2 i b.
Sur la suppression de s, voyez $ 563.
On trouve aussi ânêdvam, car a, devant le ef des désinences personnelles, peut se changer en d ou être supprimé. Enfin, on a encore aned'vam (probablement pour une ancienne forme Mvam, qui vient elle-même de édvam). a Sur la suppression de la lettre n qui appartient a cette désinence personnelle,
voyez $ 29259.
3 Racine vah « transporter », en latin veh. L'an et l’autre idiome a, pour des raisons d’euphonie, changé le h en la tenue gutturale, devant le s du verbe substantif.
En sanscrit, ce s, après un fc, doit devenir s (S aib).
4 Nous avons vu qu’en slave, où il existe un mélange analogue du moyen avec l’actif, le sanscrit tas devient tü ( S 51 a, remarque a).
5 J’avais autrefois identifié ia désinence su du parfait latin avec la désinence ia du parfait sanscrit. Mais j’aime mieux aujourd’hui rapporter toutes les formes du parfait latin à un seul et même temps sanscrit.
La troisième personne scripntest beaucoup plus près de l’aoriste sanscrit âtim-psit que du parfait tutüpa, rèroipr. Ces parfaits ont perdu leur désinence personnelle et il en est de même pour les formes comme saislép, en gothique. Il est onc très-probable qu’avant la séparation des idiomes il n’y avait déjà plus de désinence à la première et à la troisième personne du singulier du parfait actif.
* Les parfaits en n se font reconnaître à première vue comme des aoristes, quoique {a ressemblance soit plus frappante avec le sanscrit qu’avec le grec.
Nous reviendrons plus loin sur ce sujet (S 579).
La première formation ajoute à ia seconde personne la désinence sim (aneàias, âkéiptas pour âkéipstâs) ; ia quatrième formation, si eiie était usitée au moyen, aurait la désinence siéui#.
Dans sa Phonologie romaine, A. Benary explique également les formes comme fêdiyfûdi par un redoublement. Mais il suppose que la syllabe réduplicative est tombée, et que par compensation la syllabe radicale a été allongée; je ne puis souscrire à cette explication, car si je connais des exemples où la suppression d’une partie du mot entraîne, par compensation, l’allongement de la syllabe précédente, je n’ai jamais vu le même effet se produire sur la syllabe suivante.
* J’avais déjà exprimé la même opinion quand je voyais encore dans ces formes de véritables parfaits. Voyez ma recension de la Phonologie romaine de Benary (Annales de critique scientifique, 18B8, p. 10). Pott, dans une recension du même ouvrage (Annales de Halle), s’est prononcé contre mon opinion, mais, selon moi, sans motifs suffisants.
Je n’admets pas l’explication des grammairiens indiens, qui voient dans tmêmui uu aoriste irrégulier de ta sixième formation.
C’est le temps qui correspond à l’optatif aoriste grec (S 700).
En ancien slave, à la deuxième et à la troisième personne de l’aoriste actil, nous avons trouvé la désinence TX tü, qui répond aux désinences moyennes tas> ta du sanscrit (S 5ta, remarque a).
Les désinences de la première formation sont : sam, sis, sit; sva, stem, sldm; stna, sta , sus. Celles de la deuxième formation sont : sam, sassatz sdva. mUtm. sa* tdm; sâma> sata, sait. — Tr.
-1 Voyez S 109304, 1.
1 Par euphonie sa. sd.
Voyez ci-dessus > tome I, page s56, noie. Comparez Lassen, Institutiones lingtuc prâcriticœ, pages 192 et 335 ; Bumouf et Lassen, Essai sur U pâli, page 18 i ; Iloter,
Depracrita dialecto, page t84.
Voyez $S. 707 et 71 o.
Le sanscrit dva « deux v est devenu düa en nou veau-zéelandais, mais ua en ton-gouse. Voyez mon mémoire Sur la parenté des idiomes malayo-poïynésiens avec les langues indo-européennes, p. 11 et suiv.
i Pour ia même raison, le d du nom de nombre -dix- s’aSaihbt en r ou I dans plusieurs langues de l’Europe et de l’Asie (S 819, remarque). Aux formes que j’ai mentionnées ci-dessus, on peut encore ajouter le malais et le javanais las «dix» et le maldive lot. Exemples : dua-b-las (malais) «douze»; javanais ro-las; maldive ro-los.
Voyez S 5ia, remarque a.
* Les formes correspondantes en sanscrit seraient : àdihtàs, (ülâsla : àbôslds, (Woéta (avec gouna). Les racines en â (comme da) ne peuvent prendre la première formation de Caoriste qu'au moyen; les racines en û (comme bd) ne la peuvent prendre ni à l’actif, ni au moyen.
Théorie des formes de l’ancien slave, S 958.
' Nous faisons abstraction du vriddhi qui serait exigé ici eu sanscrit.
Sous t'influence de Tt précédent, le « de sam se change en é (S a î b).
3 La même que nous trouvons, en grec, à l’aoriste premier (S 555).
Vovez S 553.
•j
Dans la troisième édition de sa Grammaire sanscrite (i863), M. Bopp propose une nouvelle explication, qu’il préfère aux deux précédentes. Le premier s des formes comme âyâsisam appartient au verbe substantif; mais il a fini par faire corps avec le verbe principal, de sorte qu’au lieu de yâ, c’est yâs qui est considéré comme racine. En faisant prendre à yâs l’aoriste de la troisième formation, on a eu âyâs-i-sam, comme budfait abnd-i-sam. Grammaire sanscrite, 8 871, remarque. — Tr,
Voyez S 183a, 4, où nous montrons une contraction analogue à l'ablatif singulier des thèmes en t.
Miklosich, 8 a48.
1 Voyez S 5ia, remarque a.
Voyez S 579. — Je rapporte le latin fui à la sixième formation (S 677 ).
Voyez § 109 \ i. .
Comparez le latin rumpo, rùpi, ntptuni. ^
■' Sur les désinences de la première et de la deuxième personne, voyez SS M
et 55a.
Si les racines sanscrites Bîd, cid suivaient l'analogie de lip, lup, elles feraient a l’imparfait àHind-a-t, àcind-a t; mais elles appartiennent à la septième classe, qui devant les désinences légères insère la syllabe 11a (§ 109a, 3). Il y a d ailleurs une proche parenté entre les racines de la septième classe et les racines comme lip, lup.
11 est vrai qu’à côté de luli, nous avons conservé une ancienne forme tetuli ( comparez le sanscrit âtûtulam, de tul, classe 10). Mais cela ne nous oblige point a admettre que tüli vient de Midi : les deux formes peuvent être également anciennes, comme en sanscrit le même verbe peut adopter tour à tour à l’aoriste plusieurs des sept formations. Pou * tetnli, il faut supposer un ancien tntidi (comparez tvtndi), qui aurait pu donner, er. se contractant, tnli.
A côté duquel on trouve l’archaïque scicidi.
C’est ce qu’on voit, par exemple, par ïe supin bib-i-luw.
1 Comparez aAAos pour aAjos ( S i9).
ni.
Comparez, à cet égard, les formes latines comme Jid-i-i = âfiid-a-L
* Aq pour amq (S hho). Petermann explique de la même manière la forme ê-j qu’on trouve, a. la seconde personne du pluriel, à côté de i~q.
Au sujet des aoristes en $[• zi, qui correspondent aux imparfaits sanscrits des verbes de la dixième classe, voyez S i83 b, 2. Sur le même fait en lithuanien, voyez S 59.3.
Voyez S kho*
1 Ou bet'-ê-q. Voyez page 210, note 2, et S h 4p.
;i Miklosich, qui les a le premier mis en lumière, les appelle des aoristesjbrts.
Racine 8tamb\ dont le 1» est supprimé, non-seulement aux temps spéciaux, mais encore à quelques temps généraux. Je soupçonne une parente entre cette racine et le causatif stâp-âyâ-mi «je mets debout», de la racine Ma «être debout» (S 7^7 )* L’aspiration du t aurait passé sur la labiale (/>) qui, de consonne sourde {p), serait devenue sonore (6*) et se serait incorporée à la racine.
Voyez S 697. La diphthongue au s’est changée en otr, comme en sanscrit 1 o (-— au) de go «boeuf» devient au dans gdv-ê «bovî».
ÎK é par euphonie pour g, à cause de Ve suivant.
* Pour frvâ. Voyez S 109% 2.
H est de règle que Vu ou Vû final des thèmes monosyllabiques devienne uv devant une voyelle. On a vu (S 5oo ) un feit analogue pour Pt". Comparez aussi 1 aoriste de la septième formation âdudi'uv-arin a je courus w, de la racine dru.
Fuvimw dans Ennius,/tt®w*ei chez Cicéron.
Comparez diluv-ium, diluv-ies. Au contraire, des formes comme ama-vm, audt-via sont impossibles.
Comparez ie latin ad-ip-i$cor pour ad-ap-iscor.
- Voyez Pott, Recherches étymologiques, i" édition, II, p. 690. t ‘ Comparez le latin ùnda.
* C’est par les formes comme âundidam que j’ai pu constater que Tu, en sanscrit, est plus pesant que IV.
Dans la syllabe réduplicative, les gutturales sont toujours remplacées par des palatales. t
C’est-à-dire avec suppression de la liquide dans la syllabe radicale. — Tr.
a Avadiray renferme, à ce que je crois, la préposition nva; quant à d'îr, je le regarde comme étant de meme famille que dyâi « penser», di «intelligence».
Comparez le gouna dans la syllabe réduplicative des intensifs sanscrits (S 753),
- Première conjugaison de Grinim.
Participe passé halâim. Le présent de l’indicatif prend radoucissement (umlaitt) et fait held.
Sur le t qui, à ta fin des mots, remplace le d, voyez S 93”.
Voyez §69,3.
Participe passé grâtinn, blâsinn. Le présent de l’indicatif prend l’adoucissement et fait gmt, blœs. La suppression des deux consonnes, au milieu du mot, présente quelque analogie avec celle qu’on observe dans le vieux haut-allemand »*or « quatre », en regard du gothique fidvôt\
Comparez les parfaits sanscrits comme nanama «je m’inclinai», pluriel nemimà (pour nanimima). Voyez § 605 et suiv.
Le présent, en vieux haut-allemand, est hmzu (= gothique comme le
parfait.Ater, ît a changé l’ancien a en e.
Voyez $ 598. ,
Voyez GrafF, Dictionnaire du vie^Banl-allemand.
* Nous mettons seulement le thème du parfait, sans désinence personnelle.
* Comparez le latin momordi. Je ne vois pourtant pas dans momordi le représentant du sanscrit màmârda, mais celui d’un aoriste de la septième formation, «pii serait amamardam, nu moyen amamarde (S 546 et suiv\).
Sur l’origine du x de -sreÇÎXvx'i cl de l’aspirée dans têtu®», voyez S 568 etsniv.
Comparez le gothique fi'ijo «j'aime 360, qui est un verbe dénominalif, se rattachant à l'adjectif sanscrit pnj/d«aimé, aimant360.
Un fait analogue se présente au désidéralif sanscrit ; les racines renfermant un « le remplacent par un i dans la syllabe réduplicative.
Sur s changé en ?, voyez S 86, 5.
4 La racine svap se contracte en sup devant tes désinences pesantes : c'est à cette forme sup que se rapporte la syllabe rédupîicative su. Sur le changement de $ en s, voyez ? 21b.
* Il ne s’én trouve pas d’exemple.
Au parfait steti, le redoublement est formé d’après un autre principe qui, s’il avait été suivi au présent, aurait donné stito.
Le redoublement de è'alyxa, est donc plus complet que 11e l’est, en générai, celui des verbes grecs commençant par deux consonnes (à moins que ces deux consonnes 11e soient une muette suivie d'une liquide).
Je ne connais pas d’exemple, en zend, du parfait de la racine éld, ni d’aucune autre racine commençant par une sifflante et une muette. Mais comme stâ prend le redoublement au présent, on en peut inférer la forme du redoublement au parfait.
Douzième conjugaison de Grimm.
â Comparez, en latin, ccdco et conculco, salsus et insuUus (S 7).
Remarquons à ce propos que le dialecte védique supprime quelquefois la syllabe réduplicative du parfait. H fait, par exemple, mnditna «nous blâmâmes». Voyez lîcnfey, Glossaire du Sâraa-véda, page 97, et Grammaire sanscrite développée, page 373, note 9.
C’est l’explication de Grimai, Grammaire allemande, ï, p. 881. — Tr.
1 Dans son écrit intitulé : De l’apophonie ((Jeber den Àbiaut), p. 5o.
' Voyez ie tableau comparatif à la page a3h.
1 Voyez S A86, et Système comparatif d’accentuation, S 66.
«Nous pouvons, dit Holtzmann, rétablir avec assez de certitude les intermédiaires qui manquent entre le sanscrit et le gothique.» Ces intermédiaires seraient : babundimâ, bunditnâ (?) et, avec déplacement de l’accent, bunduma (pourquoi pas Immlimaj* ), bûndum (pourquoi pas bündim ?). L’explication que nous avons donnée |dus haut nous dispense de chercher des intermédiaires et d'avoir égard à 1 accen-luation sanscrite. Partout où la forme est monosyllabique, nous avons a ; partout où elle est polysyllabique, nous trouvons la voyelle plus légère (SS 6 et 7) «. Comparez encore le subjonctif prétérit : humijau, bundeix, etc.
L’est ainsi que nous avons vu plus haut (S 5cjn) la racine dah sbruler» foin* au désidéralif diks (pour dtdaks).
a En sanscrit paprrcimâ et non pretium.
Comparez, par exemple, la contraction de lilaps en lips. 8 59^.
En sanscrit, la racine man «penser» n’est restée usitée qu’au moyen (mène «je pensai, il pensa»). Mais ce n’est pas une raison pour admettre qu’elle n’ait pas eu à l’origine un actif.
* La plupart appartiennent à la catégorie des verbes qui ne souffrent pas la con-(raclion en é (S 6o5, remarque 3).
1 En gothique, qitém~u-m «nous vînmes».
Comparez minla pour iznteTv, ainsi que Paorisle sanscrit âpaptam.
Voyez S 655, page 67, note 5, et comparez le grec ïaBt.
* Comme formations analogues, nous pouvons citer mtâ-vfths (racine mik ccmin-geren ) et dâé-vam (racine dâé «donner* )* Mîd'-vâm vient de mimuï'viïm; les deux 1, en se contractant, ont donné un t long. Quant à daévù'm (pour dadâévâns), comme la voyelle radicale est déjà longue par elle-même, il n’offre pas de trace de la contraction.
C’est-à-dire aux trois personnes du singulier actif.
C’esL-à-dire également les trois personnes du singulier. E11 vieux haut-oilemand, la seronde personne, n’étant pas monosyllabique, ne prend pas le gouna.
Pour baüdami, baiidâmasy bubmida.
a Sur ïe th, voyez S g3a.
Pour Vaut ami.
le nominatif pluriel gothique fadei-s (thème fadi), qui correspond au sanscrit pâlay-as (thèmepot* «maître»), nous présente le même rapport entre IVi gothique et IV sanscrit, avec cette différence seulement que IV, étant suivi d’une voyelle, s’est résolu en ay. Voyez S a3o.
Cette recension, qui avait paru d’abord dans les Annales de critique scionti-lique (1827), est reproduite dans le livre intitulé Vocalisme. — Tr.
Dictionnaire dn vieux liant-allemand, f. I, p. \\r et suiv.
Comparez S a3o.
L'auteur indique de nouveau ici que ce n’est pas tout à fait la même cause qm produit le gouna dans le parfait sanscrit et dans le prétérit gothique : en sanscrit, c’est le poids des désinences; dans les langues germaniques, cVsl le nombre des syllabes. —■ Tr.
Un A A a» vi/>( Anltnl
liicuiü^ au polLiiuct
mâlù, en regard de dadyama
Voyez S 6o5.
' 1, x\xn, h.
î, wiv, i n.
Voir Abrégé de la grammaire sanscrite, S 872, remarque /1.
3 Eu sanscrit, Bram (même sens).
1 Vovez § 608.
Voyez S 468, page 63, note a.
Pânini, VH, i, 7.
Pânini, VH, 1, 8.
Le premier est un aoriste (sixième formation) de la racine daré, drs, qui est inusitée aux temps spéciaux. Quant à àsrgratï, je ne puis y voir, comme le fait Wes-lergaard, un aoriste, parce que les racines de la sixième classe, quand elles n’insèrent point une nasale dans les temps spéciaux, ne peuvent prendre l’aoriste de la sixième formation : celui-ci se confondrait avec l’imparfait. J’explique donc âsrgran (remarquez le g, au lieu du g de la langue ordinaire) comme un imparfait : pourquoi ce temps n’aurait-il pas pu, aussi bien que l’aoriste, remplacer la désinence «Ma par ran ?
Sur le changement de t en voyez § 46a.
È Rig-Véda, I, îx, h.
Au sujet de t ai ou aij des formes spéciales (saia, saijith), voyez S 109% 2.
Lexique des racines grecques, I, p. 390.
Voyez Bôhtüngk, Chreslomathie sanscrite, page385. Weber, Vàjasatiêyi spm-ami, I, p. i3 et suiv. Jîenfey, Glossaire du Sâma-Véda, au mot san.
Nous voyons de même la caractéristique de la neuvième classe nâ abrégée en na dans le zend êtërënai-ta «qu’il répande», potentiel qui répond aux formes grecques comme êdxvot-ro (S 109% 5).
bur la diphtbongue ai que ces racines prennent, en gotlnque, dans les temps spéciaux, voyez S :oQa, 2.
De la racine sa, on trouve, dans les Védas, le désidéra lit* siw-s (voyez Benfey, Glossaire du Smna-Véda), qui est formé comme pipas «désirer boire», venant depû.
En vieux haut-allemand sâ-t (thème sâ-tî).
â L’auteur a montré précédemment (S 109", 2) que les racines qui, suivant les grammairiens indiens, finissent par e, de, d, sont en réalité des racines eu d. — Tr.
C’est ainsi qu’en regard du sanscrit syâm te gothique fait sijau; le lithuanien présente également à ta première personne des formes en au (S 438).
Une confusion de ce genre n’est pas sans exemple : ainsi, au passif gothique, fa première et la troisième personne ont la meme désinence; seulement, c’est ici la troisième personne qui a communiqué sa forme à la première (S fi06).
! 7
Cette voyelle de liaison est tout ce qui a subsisté de la flexion dans les parfaits
ordinaires comme dadâréa (S 610).
4 Par euphonie, pour côrayâ'm-cakàra.
te parfait bab'ûva présente une triple irrégularité : au lieu d’un «, il prend un a dans la syllabe réduplicative; la voyelle radicale s’abstient, à la première et a la troisième personne du singulier, du gouna et du vriddhi ; enfin 1 tt radical se change en ttw (au lieu de tiw) devant une voyelle.
Manuscrit lithographié, p. 198.
l.o texte porte rafofyamn; mais, page 179, nous avons raùdayihi. Ces doux
Ouvrage cité, p. 118. J’ai retiré cette opinion plus tard; voyez Vocalisme, p. 5i.
Nous avons, de même, salbôth# « l’oint», dont le thème salbôda est identique avec salbôda «j’oignis». Une circonstance qui était faite encore pour induire en erreur, c’est que les seuls verbes qui aient des participes en da (nominatif ths) sont ceux qui forment leur prétérit en da. Les verbes qui n’ont pas recours, pour leur parfait, à la forme périphrastique, appelés par Grimm les verbes forts, ont des participes en na (nominatif ns): exemple : bug «plier», prétérit baug, participe bug-a-ns (thème bug-a-na) = sanscrit Bug-na-s «plié».
5 Grimm semble vouloir établir un lien entre le participe passé de la conjugaison faible et le prétérit de l’indicatif. Voyez Grammaire allemande, t. I, t" éd. p. 556, et 2e éd. p. 1009. Comparez aussi mon livre intitulé Vocalisme, p. 5i etsuiv.
Exemples : tyak-tâ-s «abandonné», kr-tâs «fait», b'r-tâ-s «porté».
Avec tiy par euphonie pour m, à cause du c du mot suivant.
5 hn allemand moderne, ich setzte.
1 E11 allemand moderne, ich défaite.
Comparez les verbes latins de la première conjugaison.
J Racine lih «lécher».
■416 En allemand moderne, ick leckte.
1 Comparez la deuxième conjugaison latine (S 109% 6).
II ne faut pas oublier qu’en sanscrit toutes les racines peuvent former un causait, lequel se conjugue d'après la dixième classe.
Peu importe que ia voyelle soit longue par nature ou par position. 11 faut seulement excepter la racine dp et les racines ayant pour voyelle initiale un o long par position.
Comparez em «je suis», î «tu es», im «nous sommes», îd «vous êtes», end «iis sont», avec berem «je porte», bprî « tu portes», berîm «nous portons», berid «vous portez», berend «iis portent». Avec end s'accorde le dorien èvu (pour crevri); avec em , l’anglais am (— em ).
Comparez le h qui est venu se placer, en persan moderne, devant le nom de nombre keét «huit».
i En sanscrit, tûtâmi (S 5o8).
Le h de dehem «je donne» me paraît représenter le d du zend dadami (S 3y). lai déjà montré ailleurs (Annales viennoises, 1838, t. XLIÎ, p. a58) que dans le verbe persan tùhâden «placer» (présent nihem), il n’est resté que l’aspiration du d de la racine dâ; la syllabe ni est une ancienne préposition (en sanscrit, ni «en bas»). Dans la forme dehem, la syllabe réduplicative a pris l’apparence de la syllabe principale : on a vu que pareille chose est arrivée pour l’ancien slave damï (venant de da-dmï, S à36, a) et pour les prétérits allemands hiess, hieh (S 5qû).
Recherches étymologiques, ire édition, 1.1, p. 37/».
Par exemple dans sva ihd «nous sommes tous deux ici2, sia deux ici p.
Excepté à la troisième personne du pluriel.
- Comparez Annales de critique scientifique, 1827, p. a85 et suiv. Vocalisme» p. 53 et suiv. Pott, Recherches étymologiques, tre édition, 1.1, p. 187.
18.
tjd h sert uniquement à indiquer que Fe précèdent est long.
- Voyez Poil, Recherches étymologiques, ire édition, t. 1, p. 1H7. Voyez S 6a 1.
Grammaire comparée, tre édition, p. 122.
» En ancien perse, t devait avoir jusqu’à un certain point la prononciation d une sifflante : ainsi la racine perse i«/i «dire, parler» répond aux racines sanscrites son», im, dont la première signifie «dire, raconter» et la seconde «commander» (peut-être aussi, à l’origine, «dire»). Rapprochez également lancier, perse atam «assyrien». 11 est possible que le t zend ail eu une prononciation analogue.
Yaçna, p.‘3fio. .
Burnouf, Yaçna, p. 36o.
C'est ainsi qu'en sanscrit les formes dê-hi (pour dad~<ti, zend das-di) adonne.75 et de~hi(pour ctad-d'i) «place!7) ne font plus l’effet de formes réduplicatives.
* Voyez Benfey, Lexique des racines grecques, 11, p. 56.
Vendidad-Siîdé, chapitre it. Comparez ci-dessus, S 5ao.
' Ou du moins après une sifflante.
Etudes sur la langue et les textes zends, page 290. La plupart des manuscrits donnent âonkarë.
Voir l’Index du Vendidad-Sâdé, dans l’édition de Broekhaus.
Chapitre m. Manuscrit lithographié, page 223. Je cite le texte donné par Wes-tergaard (page 64).
Manuscrit lithographié, p. 45.
liavainti est un présent employé dans le sens du futur.
Recherches étymologiques, ire édition, I, p. 45.
C’est par l’intermédiaire d’une nasale que le <r s’est changé en * : eVp/ est d’abord devenu par assimilation êfiyif (forme qui est usitée en dorien) et dpp/ a donné eiph comme ndévs est devenu TtOels.
1 Même hors de composition, êopév est devenu eïpév dans le dialecte ionien.
C’est là la forme organique, et non èrerv^eurav.
Sindun, par abus, a été transporté aussi à la première et à la deuxième personne, de sorte qu’il signifie tour à tour «nous sommes, vous êtes, ils sont». À la troisième personne, sind est resté usité concurremment avec sindun,
% G’est la désinence du prétérit qui a été ajoutée à sind-un. Le même fait a eu lieu en gothique, où nous avons sij-u-m «nous sommes», sij-u-th «vous êtes». La seule forme restée simple est s-ind (pour s-ant = sanscrit s-anti] «ils sont».
Les temps et les modes, p. 33a.
D’autant plus que nulle part, en grec, le verbe ès n’a conservé dans sa conjugaison un temps ayant le sens du parfait. -
Cet a bref devient long devant les désinences commençant par un ri ou un v ; 00 a vu (S ft3à) qu’il en est de même pour la caractéristique a de la première conjugaison principale.
1 Page 91.
Gomme exemples, je citerai les racines yag «sacrifier», vac «parler», grah (pour graV) «prendre», qui font au participe passif iitâ, uktâ, grhîtâ. -
* Rapprochez, par exemple, le potentiel actif syât «qu’il soit» du potentiel moyen sîia.
Avec gouna de la voyelle radicale et insertion de la voyelle de liaison i.
Pour fui-ro (S 644). Au parfait, la forme simple pour fue-runt aurait sans doute été fui-nt.
En lithuanien, la deuxième personne du singulier est terminée à tous les temps
par t. -
Voyez SS 436, i, et 438. Comparez S 358, remarque.
Comparez oXéaraoo pour oXéojw.
Prâcritanna. Voyez S 19.
On explique d’habitude le redoublement du <r, dans les formes épiques comme éacroiiat, oAérT&>, par les exigences de la prosodie. Mais je doute que ces formes eussent été employées si elles n’avaient pas déjà véritablement existé dans l’usage.
a Dans cette formation, fi final de syâmi est supprimé. H y a aussi, comme on l’a dit plus haut ($ 65i), une forme en himt, où l’t final reste; mais elle est beaucoup plus rare.
Au sujet du changement de s en é, voyez S a î
Je crois, avec Pott (Recherches étymologiques, îre édition, 1, p. i15), devoir
Système de la langue bohémienne, p. 160 et suiv.
Voyez S 648.
Je cite les traductions données par Miklosich. Voyez Théorie des formes, $107. —■ Dans ùi~ini-éun, éun est pour sjun (S 92L).
Nous ne parlons pas de certains présents qui peuvent être pris dans le sens du futur.
' CA mn signifie proprement «se» (S 36s).
« 467 Comparez l'anglais they tmll corne.
Dobrowsky, Tnstitutiones Itngute slaviece, p. 379.
li en est de même quelquefois en ancien slave; on a, par exemple : MM'fcTM HiWdlUH imeti tmaêi «tu auras ».
a Voyez Grirnm, Grammaire allemande, ÏV, ç)3.
Voyez § 6ft8.
' Marc, ix, 19; ix, 35; x, 8; îx, 19; x, 7.
Depuis que j’ai posé cette question dans la première édition de cet ouvrage» le futur osquefmid ou fuit «il sera» est venu donner encore plus de vraisemblance à la seconde solution (voyez Mommsen» Études osqu es, p. 6i).
9 Au pluriel birumês (pour biwumês = sanscrit Vnvâmas). Voyez S 51 o.
664. Gouna de la syllabe radicale au futur, en sanscrit, en grec et en zend. — Tableau comparatif du futur.
II nous reste à faire observer, en ce qui concerne le futur sanscrit, que la syllabe sya se joint à la racine, soit immédiatement, soit a laide de la voyelle de liaison t2. À cause de cet i, le s de sya se change en s; exemple ; tan-i-êyami « extendam ». Les voyelles radicales susceptibles du gouna le prennent3 : ainsi dis «montrer» fait dêk-êyâmi Ssix-crc*)}; lih «lécher» fait lêk-
1 Voyez S 69a et suiv. Comparez Système de conjugaison de la langue sanscrite, page 98.
2 Comparez la troisième formation de l’aoriste (S 56o). *
3 ba règle, en sanscrit, pour que la voyelle radicale puisse prendre le gouna, est la suivante : si la voyelle est médiale, il faut qu’elle soit brève et ne soit suivie que d’une seule consonne; à la fin de la racine, les voyelles longues peuvent prendre également le gouna.
Voyez Spiegel, dans le Journal de la Société orientale aUemande, t. T, p- aAa.
Burnouf (Etudes sur la langue et les textes zends, p. i35) attribue un autre sens au nominatif pluriel sauêyantâ, qu’il écrit éauekyantâ, d’après une leçon très-probablement fausse. U importe peu, pour notre objet, de savoir si la racine zende éu signifie véritablement « être utile» ; mais ce dont je ne doute pas, c’est que éauéyané ne soit le futur d’une racine éu. Je la rapproche du védique ST éu (venant de évi) «grandir», d’où le substantif Sloi^ édvas «force». [Le mot éauéyané, en persan moderne So-siosh, est le nom donné par les Parses à un ou plusieurs prophètes qui doivent venir à la fin des temps rétablir le pouvoir d’Onnuzd sur la terre. — Tr.]
Le manuscrit lithographié nous présente, au futur, un «g s au lieu de go s ; mais les meilleurs manuscrits nous donnent bien le go *, qui est le représentant régulier du s sanscrit devant les voyelles, ainsi que devant y et v (S 5a).
Sur le groupe zendh* — sanscrit^ hé, voyez SS £7 et 52.
a Dans la première édition de cet ouvrage (p. 1007 ) » j^vaïs proposé d’expliquer comme un futur la forme fravahsyanm ( Vendidad-Sâdé, p. 369). Je retire aujour-d hui cette conjecture et je me range à l'explication donnée par Brockhaus dans son Index du Vendidad-Sâdé (p. 391); ce savant a reconnu que les mois ad fravahsyanm hditim yasamaide doivent se traduire : «nous adorons le chapitre [qui commence par les mots] adfravafcsyâ. J’ajoute seulement qu’à la page 356 les mois tad twâ përësâ «hoc te rogo» forment également une sorte de composé adjectif, à signification possessive : ce composé se rapporte au substantif féminin haiti «chapitre», qui est régi par le verbe yasamaide «nous vénérons». 11 faut donc traduire : «nous vénérons le chapitre [commençant par] tad iwâ përësâv. De même, à la page 392, les mots ad ma yavâ sont construits comme un adjectif à l’accusatif avec le mot hâitîm, régi par yasamaide (ad-mâ-yavanm) «nous adorons le chapitre [commençant par les mots] ad ma yavâv.
L’auteur, sur ce mot büéyamta, adopte l’explication d’Eugène Burnouf (Commentaire sur le Yaçna, p. 533, note). Mais comparez Spiegel, Traduction de l’Avesta, U p. 180, et Commentaire, 1, p. 289. -^Tr.
Yama> p. 533.
a Voyez Burnouf, Yaçna, notes, p. 70 et suiv. Je rappelle à cette occasion la forme étrusque mi «je suis», qui n'a également conservé que la désinence. Mais nous ne savons pas encore s’il y a en étrusque d'autres verbes se terminant en mi, ou si mi
«je suis» est une forme isolée dans cette langue, comme l'est im en gothique et am
en anglais (— sanscrit as-mi, lithuanien es-nd, éolien
Sur l’épenthèse de l'i dans la racine, voyez S ht. — Anquetil traduit ce verbe
tantôt par «affliger», tantôt par «blesser».
Le manuscrit lithographié a toujours la leçon fautive «.
- Le futur de l'indicatif a dû être xaiihyê «je naîtrais.
Vendidad-Sâdé, manuscrit lithographié, p. 89.
La racine sanscrite correspondante da a, entre antres significations, celle de « tenir ».
1 Origine des formes du langage, SS 66 et 67.
Institutioim lingtiœ slavicip, p. 38o.
Luc, 1x1,7.
Matthieu, xi, iù. — Sur la parenté présumée de ftéAAw avec le sanscrit mânyê,
voyez S 661. '
Comparez, au présent, dadmâs — Sîèopev (S 481).
Cette anomalie a également son principe dans la loi de pesanteur des désinences, à laquelle la racine as se conforme très-rigoureusement : voyez S 480.
En arménien, izem, venant de iyem (§ 183 b, a).
Cette particularité de la langue sanscrite est d'autant plus digne d’attention que les désinences actives du duel et du pluriel, étant plus pesantes que celles du singulier, produisent souvent, à d’autres égards, les mêmes effets que les désinences du moyen.
L’ancienne langue présente encore quelques formes sans h (Schleicher, Grammaire lithuanienne, S 108). On a, par exemple, dôdiou dudi, dont l’icorrespond au ya du sanscrit dadyâs et au trt du grec èiSoirts. Dans at-leid « pardonne » et ne-wed «ne conduis pas», IV a été supprime : du reste, ou trouve aussi ne wedi.
1 Nous reviendrons sur ce point ci-après.
Dans la première édition de cet ouvrage (S 678), j’ai dit, en me fondant sur les écrits de Dobrowski et de Kopitar, que l’ancien slave remplaçait la troisième personne du pluriel par la deuxième ; mais cette assertion était inexacte.
Éléments de grammaire lithuanienne, p. 78.
Voyez S 568. Comme exemple d’un k lithuanien correspondant à une sifflante primitive, nous citerons encore juka «soupe» = sanscrit ymâ (même sens), latin
(pour jûs-is), slovène juha, ancien slave jucha. Il y a donc lé même rap-
Voyez S i83b, 2.
2 Vendidad-Sâdé, p. 354; Westergaard, p. 79 : katâ aiâi drugêm dyaiun zaétayô «comment livrerai-je à l’homme pur la Drug' dans les mains?». Ânquetil traduit : «Gomment, moi pur, mettrai-je la main surleDaroudj?». Spiegel traduit (Avesta, II, p. i48) : «Comment par la pureté dois-je obtenir les Drujs eu mon pouvoir?».
3 C’est aussi l’explication d’Aufrecht et de Kirchhoff (Monuments de la langue ombrienne, p. 1A1).
4 Mommsen, Études osques,p. 63.
II ne reste pas d’exemple de cette forme que je restitue par conjecture.
Le y est une insertion euphonique; l’a (pour ma) est la desinence.
En réalité, le précatif moyen n’est pas autre chose qu’un potentiel aoriste moyen. Il suit la première ou la troisième formation de l’aoriste : ainsi héipsîyâ vient de âksipnet bôd-i-éîyâ de âbôMi. Le précatif actif est un potentiel aoriste de la cinquième formation : ainsi dê-rj&t (pour dâyâl) vient de àdâ-l, comme Soin de éSœ. Il est vrai que pour le plus grand nombre des verbes celte formation de 1 indicatif aoriste ne
s’est pas conservée. 501
Nous mettons ici le duel gothique de préférence au pluriel, parce que le duel a conservé la voyelle a, qui au pluriel de l’indicatif (iisith) s’est changée en i.
II est vrai qu’on trouve aussi quelquefois les formes en ait ou eet à l’indicatif;
mais la forme en at est la plus usitée et la seule juste. Au contraire, à l’impératif, on a toujours eet ou ait. Il est difficile de se faire une idée exacte, d’après la description de Rosenberger (Théorie des formes de la langue lette), de la façon dont se prononce la diphthongue lette ee; mais il nous suffit de savoir qu’au point de vue étymologique, elle est une variété de la diphthongue ai, et qu’elle répond comme celle-ci au sanscrit ^ é (— a -4- i). On a, par exemple, deews b dieu» = dévâ-s, de
la racine div «briller»; eet «il van — ^frf êti, de la racine 5" * j smee-t «rire»,
en sanscritf^T smi «rire», et, avec le gouna, ^ smê.
Le grec n’a que le précaüf actif : ainsi êolrjaav, comme nous lavons déjà dit, répond au sanscrit déyüisus (pour ââyâsant) et Soïev au zend g ddyann.
De même au présent famé, rapproché du sanscrit s-mas et du latin sumus.
Voyez $109°.
Féminin winim.
Féminin winnas.
* Voyez Mielcke, Éléments de grammaire lithuanienne, p. i43 b.
687. Explication des subjonctifs lithuaniens comme diïtumbei
rrque tu donnes».
Vi du lithuanien bi correspond sans aucun doute au caractère modal sanscrit et zend yâ, qui, joint à la racine M «être»,
Je ne connais pas d’exempïe de cette forme, que je restitue par conjecture.
ni.
C est 1 o de Ç>ép-o-p,ev. Mais à l’indicatif, cet o ne se trouve que devant les nasales; devant les autres consonnes nous avons e (Çép-e-te).
II n’existe pas de racine finissant par un a bref.
Comparez, 8/189.
Nous avons expliqué (S 109% 6) Va du latin amâ-re par la contraction des deux a de 5RT aya, après élimination de la semi-voyelle. Conséquemment, amas, amd-mus, amâtis ont la même formation que hâm-â(ij)a-si, kâm-J(y)d-mas, kâm-â(y)a-ta.
Slruve, De la déclinaison et de la conjugaison latines, p. 1 é6.
Voyez S 109*, 6.
* Struve, Delà déclinaison et de la conjugaison latines, p. 1&6.
II Voyez S 109% 6.
Ce fait, qui a été admis depuis par Struve, a été indiqué par moi pour la première fois dans mon Système de conjugaison de la langue sanscrite, p. 98.
Voyez $ 109“, t,
- La gutturale du latin fado s’est main tenue dans le mot français magnifique, au lieu que dans fais, faisons, elle s’est altérée en s; on peut même dire que dans fais elle est complètement sortie de la prononciation.
J’ai exposé pour la première fois cette théorie dans les Annales de critique scien -tidque, i836, p. 97 et suiv. ( Voyez Vocalisme, p. 300.) Ag. Benary a adopté la même explication dans sa Phonologie romaine (p. 37 et suiv. ); mais il fait venir la voyelle modale i de la racine * » aller» (S G70).
Voyez S toq\ 1 et a.
A l'indicatif présent, dèl-a-m.
- Le ta du masculin représente le tan 1, tdm du duel sanscrit.
1 Miklosich, Théorie des formes, ac édition, p. 87.
Rapprochez nëmôi du sanscrit nâmas «adoration» (racine nam).
Spiegel (Avesta, II, p. i5a ) traduit par : «où dois-je aller priant?». Contraire -ment à une hypothèse autrefois exprimée par moi, j’adopte aujourd’hui la leçon que Westergaard, d’après un seul manuscrit, a introduite dans son texte. Ce savant lit nëmô (au lieu de nëmôi). Je traduis donc : «ubi adoraiionein faciam ?», littéralement : «ubi [in] adorationem earn?». Rappelons que les verbes marquant le mouvement prennent souvent aussi en sanscrit le sens de «faire». [Spiegel et Justi admettent la même correction. Mais ils considèrent le premier nëmôi comme un présent moyen. Comme exemple d’une première personne de potentiel, dans un verbe de la première conjugaison principale, Justi cite gaidyaiim (Vendidad, III, 5), de la racine gad «invoquer». — Tr.]
* Comparez ce qui a été dit plus haut (S 5o8) de la racine sanscrite stâ.
De môme, à ta troisième personne du pluriel moyen, la désinence assez énigmatique ran (S 6i3) est remplacée en zend par une flexion plus en accord avec les règles ordinaires de formation. Nous y reviendrons plus loin.
Voyez S 6t.
Vovez $ 56a.
«f
Le précatif est beaucoup plus fréquent en zend qu’en sanscrit.
La racine bû abrège sa voyelle au précatif. Comparez Burnouf, Yaçna, notes, page i5a.
Comparez S A80.
2 Rapprochez la première personne du singulier yânm (pour y dm).
■’i On trouve aussi la leçon fautive nidityann. Au sujet du ^ f représentant un d sanscrit, voyez S 637, remarque. Le second i de nidaityann est dû à l'épenthèse Ai ); comparez la forme moyenne paiti ni-daitita «qu'il déposer = UfrT prati nidadîta.
4 Excepté à la deuxième et à ia troisième personne du singulier actif, où les formes deyâss, dêyâst ont du supprimer Tune des deux finales (S 9A); comme elles ont mieux aimé sacrifier le verbe auxiliaire que le caractère personnel, on a eu dey us, dêyâ't en regard du zend dâyào, dâydd.
ni.
D’après le paradigme de âyâsi. Voyez S hUh et suiv. Comparez Abrégé de la grammaire sanscrite, S 35s.
L’aoriste védique akar «il fit», de la racine kar, fer, fait exception, à moins ([ifon ne considère, avec les grammairiens indiens, fer comme la vraie racine. Mais nous avons vu (S t) que la forme primitive est kar.
Abstraction faite, bien entendu, de la voyelle de liaison u. La troisième personne du singulier serait tar-u-iêt.
Voyez mon mémoire Sur la langue des Borussiens, p. a 8 et suiv.
1 Comparez asmu «je suis??, pour asinai (S 648 ).
La forme correspondante, en sanscrit, serait dikêema.
3 Système de conjugaison de la tangue sanscrite, p. 98.
Les racines bhû et os (S 5ot}). — Tr.
Va, en se contractant avec i’t, est devenu ë, comme nous l’avons vu pour amem (S 690).
Ici l'affaiblissement de s en r a pour cause l’accroissement du nombre des
syllabes (S 612). ^
Cette seconde explication me paraît moins vraisemblable que la première.
Abstraction faite du Ut védique (S 713).
3 Benfey, Grammaire sanscrite développée, p. 380.
1 Radices sanscritœ.
Je prenais autrefois ces formes pour des intensifs et j’expliquais, par exemple.
Voyez S 701.
Voyez S 46s.
Voyez S 702.
Voyez S 678.
Voyez S 613.
Voyez S 703.
Dans le sanscrit tel qu’il nous est parvenu, le moyen de ad n’est plus usité ; mais nous le donnons ici d’après l’analogie d’autres verbes.
* Voyez S 67/i.
Voyez 8 676.
Voyez 8 677.
Voyez SS 688 et 689.
s Voyez S 699.
* Voyez S 689.
Voyez SS 691, 692 01693.
Voyez S 694.
0 Voyez S 694.
Voyez S 69g.
Voyez S 696.
<J Voyez S 699.
Voyez S 468.
Voyez S 109*, 6.
Je ne crois pas qu'il faille aussi à l'indicatif expliquer galbas comme étant pour mlbâis, et, à la première personne, salbô comme étant pour salbôa. En effet, dans vig-a-, vig-i-sy vig-i-th (S 5o8), l'a et Pt ne servent pas à l’expression de la personne : ils représentent la syllabe caractéristique de la première classe, exactement comme dans salb-ô-', salb-ô-s, saib-o-ih, Po est la caractéristique de la dixième classe insérée entre la racine et la désinence. Les flexions personnelles sont donc tout aussi complètes dans le second verbe que dans le premier.
1 Les deux a de aya, en se contractant après la suppression de la semi-voyelle, «nt produit un 0 (S 109*, 6).
Voyez Benfey, Grammaire sanscrite développée, p. 355.
4 Cette identité, que j’avais déjà reconnue dans la première édition de cet ouvrage (p, 979), a été admise depuis par Curtius (Formation des temps et des modes, p. sài et suiv.).
Bairam n’est pas dans Ulfilas; mais on y trouve des formes analogues. Grimm avait déjà cité des exemples de la première personne plurielle de l’impératif dans la première édition de sa Grammaire allemande ( l, p. 611), et le nombre de ces exemples a été accru depuis par Von der Gabelentz et Lobe, Grammaire gothique, page 88, remarque h.
' Luc, xv, a3.
Pour pal-ân (S 709).
Comparez en latin les formes die, duc (pour dice, duce). L’impératit fer n est pas tout à fait dans le même cas, si le verbe fero correspond, comme je le crois, à un verbe sanscrit de la troisième classe. Le même rapport qui existe entre fers, Jer-t, fer-lis et bi-Udr-éi, bi-Uâr-ti, bi-lh'-tâ, se retrouve entre fer et biik-Iu (pour
tnliar-d'i). De plus, la désinence personnelle a été supprimée comme dans es = grec h-fii, sanscrit êM (pour ad-d'i, lequel est lui-même pour a$-d'i).
En général, la syllabe ja, quand elle est à la fin des mots, supprime en gothique
sa voyelle et vocalise le j.
3 On a vu ($ 70) que 1’* long est représenté dans récriture gothique par et.
On fait à peu près analogue a lieu en gothique pour tes thèmes lemmms eu on,
qui représentent les thème» sanscrits en ti ( S 16a ).
* Voyez Ahrens, De dia’ectis, t. II, p. 29a, et Curlius, Formation des temps et
des modes, p. 9O9.
■587 Venant de ton, S 463.
(Commentaireswr le Yaçna, note A, p. 17) adopte, d’après les autres manuscrits, la leçon anuha.
C’est le causaüf de la racine sanscrite yas «s’efforcera.
Tous ces exemples sont tirés du xvnT chapitre du Vendidad-Sâdé. Le mauuscrit lithographié donne plusieurs fois la forme anka, au lieu de anuha; mais Bumouf
3 Je regarde énayanuha comme un passif à signification moyenne. C’est ainsi que nous avons (Vendidad-Sâdé, p. 331) : ué tanâm énayaita «qu’il se lave le corps71. Quand la racine énâ est employée dans le sens transitif, on se sert de préférence du composé snâd'a (S 687); exemple : aitâo vaétrâo frasnâdayën «qu’ils lavent ces habits n (Vendidad-Sâdé, p. 2 3 3). Au sujet des formes passives employées dans le sens du moyen, comparez $ 73A.
!i C’est la racine sanscrite yam (dans les temps spéciaux yac ) avec la préposition ÏÏT â.
Vendidad-Sâdé, p. 39,
0 Vendidad-Sâdé, p. 123. Comparez Olshausen, p. 11, et Westergaard, p. 3^7-
E. Bumouf (Journal asiatique, 1 SU h, II, p. A67) me reproche a tort d avoir rap porté le zend hu au sanscrit 3 hu «sacrifier». Je me suis, au contraire, attaché à démontrer que le sf h sanscrit n’est jamais représenté en zend par un o* h.
J’avais traduit de la même façon dans l’édition latine de ma Grammaire sanscrite, p. 33o.
Yaçna, chap. ix, 7.
Burnouf fait observer : f*Nos manuscrits sont très-confus en cet endroit : celui
de Manakdji a mais je ne suis pas sûr du 3ET; le numéro Iï F lit
avec 3ST au-dessus de la ligne.» Mais je ne doute pas que Bumouf n’ait raison de lire
C’est ainsi que lit Bumouf, au lieu de sanmdraya, qui ne présente
point de sens.
Burnouf traduit : «honore-moi comme nourriture». Mais àhâràrtam signifie «à cause de la nourriture», et Mdanâya, qui traduit le zend qarëtée, est comme celui-ci un datif.
ü Elle revient plusieurs fois dans le chapitre ïx du Yaçna.
1 Je regrette que Bumouf n’ait pas donné la traduction de Nériosengh pour ces passages. La forme zende est hunâta (une fois kunvata), c est-a-dire la troisième personne de l’imparfait. [Nériosengh traduit la phrase zende kaéfi iwanm paoiryô hunûta par : kas tvâm pûrvam xatiskrtmân. - Tr.]
Sur le n, au Heu de n, voyez $ 17 b.
- En sanscrit également, on trouve quelquefois la première personne de l’impératif employée dans le sens du futur ou du présent de l’indicatif, pour marquer une ferme volonté ou une action annoncée comme certaine. Voyez, par exemple, dans l’épisode de Sunda el Upasunda, ï, vers 36.
C'est-à-dire que les verbes grecs en fti empruntent leur subjonctif à la conjugaison en . — Tr.
L’a est allongé à la première personne des trois nombres de l'impératif.
Par sa forme, éc-o-\un est un présent.
On trouve aussi îatftew, avec un t tenant la place d'un ancien U" a, comme a la deuxième personne du singulier ta-Oi = zend a*Sx (S 655). Comparez Ahrens, De dialecti*, 1, p. 3ai.
Forme dorienne.
En zend ayêni (S 4a ).
On a vu (S 109*, 1) que P© et l’e des verbes ^mme , Ae/îr-e-re ré
pondent à la caractéristique a des verbes sanscrits de la première et de la sixième classe ; au subjonctif, o et e s’allongent en « et y. a On peut rapprocher, en grec, les formes comme Seixvve.
L é représente le sanscrit os. — Rapprochez, en grec, les formes comme êSeix-
vi-e-s.
Voyez S 109% a et 6.
- Voyez S 636.
' L'ancien slave représente ordinairement Vâ sanscrit par un a, au Lieu que Tu bref devient e ou o (S 92a).
' Comparez l'allongement de l'i et de l'« devant le ^ y de la caractéristique passive ya. Voyez Abrégé de la grammaire sanscrite, S 668.
C’est ce qui ressort aussi du verset suivant, où tes mots qui sont gouvernés par daiâni «je dois donner» indiquent ia récompense promise à Zoroastre.
a Dans la première édition de cet ouvrage (S 726), j’avais expliqué yasâi comme une contraction pour ya?aya (impératif de la forme causative). On a une contraction de ce genre dans nât «conduis!» — sanscrit «W ndya (de la racine îu).
Lassen également reconnaît dans cette forme, et dans les formes analogues, la deuxième personne du subjonctif; mais il suppose que la désinence âi est une fausse leçon pour âhi ( Vendidadi capita quinque priora, p. 58) et il introduit, sans y être autorisé par aucun manuscrit, viiâfii dans le texte, au lieu de visai (p. 7).
Spiegeï, Le xixc fargard du Vendidad-Sâdé, p. 70.
Voyez Spiegel, Le xixc fargard du Vendidad-Sâdé, p. 70 et suiv.
Sur la racine fru (pour le sanscrit plu), voyez $ togh, 1.
726. Première personne de l’impératif, en gothique.
Tableau de l’impératif.
Parmi les langues de l’Europe, il n’y a que le gothique qui possède une première personne de l’impératif, mais seulement
1 Voyez Burnouf, Commentaire sur le Yaçna, p. 627 et suiv.
* Ou ém, sous la double influence euphonique du y précédent et de Vi final
(S 63 )*
5 Ouéné,
* Commentaire sur le Yaçna, p. 53o et suiv, note.
* Vendidad-Sâdé, p# 481,
f Voyez S 726.
Luc, xv, a3.
5 Comparez S 716, remarque.
Excepté au subjonctif, où le gothique a la désinence ma, qui se rencontre avec le n* ma des formes secondaires en sanscrit.
II n'y a pas d'exemple de barâni; mais nous pouvons l'inférer du moyen harânê (S 733 ) et du pluriel barâma ( Vendidad-Sâdé, p. 308).
* Dê-hi pour dad-di y venant de dadâ-hi, qui est lui-même pour dadd-di (S A5o). dasdi pour dad-di (S û5o). Nous lisons deux fois dans le Vendidad-Sâdé (p. 5o) dafdi-mê «donne-moi», avec l'enclitique mê *à moi". De même,
en sanscrit, les formes % mê «mei, mibi» et ^ te «lui, tibi» sont toujours employées comme enclitiques. De même aussi en ancien perse maiy et Il est probable que la locution xjp dalâni te «je te donnerai», qui revient plusieurs
fois dans le Vendidad-Sâdé (pages 5o5,507,5o8), est pour daiànitê, car dans l’écriture zende on sépare souvent les différents membres d’un composé. le regarde le t comme tenant la place d’un d: on a vu (S 637, remarque) qu'en composition la racine dâ, quand elle a son redoublement, change ordinairement le cf radical en f.
Pour ad-di venant de at-dù
Voyez SS ^70 et 719.
* Pour dadàr-sva (S A8i).
II Voyez S 731.
Par euphonie pour Uû-sa ($ a 1b). Voyez cette forme dans Westergaard, Uudurs sanscrite, à la racine U bû, avec préfixe UT â.
Nous avons transporté au S 43g, remarque, la note qui se trouvait ici sur le changement de s en v. — Tr.
11 faut remarquer à ce sujet qu’eu prâcrit la désinence hi (pour Üi) se présente à nous dans des formes où le sanscrit Ta perdue. Voyez Lassen, Inslitutiones lingtav prâcriticœ, p. 338 ; Hofer, De prâeritâ dialecto, p. 185 et suiv.
Sur le changement du t en 0, voyez S 674.
On a vu (S 676) que la syllabe re de l’impératif ama-re appartient au mémo pronom réfléchi dont il ne reste que le r à la première personne amo-r.
Pânini, III, i, 8i. —• Sur le é tenant la place d’un s, voyez S ai h.
6 Voyez Westergaard, à la racine 0u, avec préfixe upa.
4 Rig-véda, l, lxxxvi, 5.
Voyez Petermann, Grammaire arménienne, p. 191. Schrnder donne les formes en question comme des présents de l'impératif.
Dans ïe dialecte védique, tes formes redoublées de l’aoriste peuvent joindre immédiatement les désinences à la racine. C’est là, comme on l’a vu (S 678 ), le caractère propre de la cinquième formation de l’aoriste, laquelle, dans les Védas, s’étend aussi à des racines finissant par une consonne.
* Rig-véda, I, xxxi, t.
■’ Rig-véda, ï, lii, 2. La forme de la langue ordinaire est vavrd'é'.
Rig-véda, I, xxv, 17.
On a vu (S 648) que asyâmi (compares le latin ero, ms, S 65o) n’est plus employé comme verbe simple en sanscrit.
Lois de Manou, VII, ao.
5 Livre VIII, vers 1616.
Pour ârakétiyas, à cause de Vi du mot suivant.
Mahâbhârata, livre VIII, vers 709.
ÏV, 88. Ces vers sont adressés au dieu de l’amour.
Voyez S 109% 3.
3 Remarquons cependant que l’intensif renforce ia syllabe réduplicative et qu’il conserve celle-ci dans les temps généraux; mais on a vu que les verbes de la dixième classe gardent également dans les temps généraux une partie de leur caractéristique.
Voyez S 10&e, remarque 2, et Système comparatif d’accentuation, S 11.
Le moyen, à la différence du passif, prend les caractéristiques des classes.
Voyez S 109*. .
Voyez SS 5oi et 5ia.
Voyez S 659.
VoyezSafc'i.
a Mais au singulier du prétérit redoublé, rogea», à l'infinitif, prâétum ttinterroger».
im
Vendidad-Sâdé, page 2 46 : yahmya naro irësta (lisez iris ta) nidayêinté «in qua [terra] homines mortui deponuntur».
* Avec le sens du moyen : «lave-toi [les mains]». Voyez §721.
Inscription de Béhisioan, IV, 38. Rawlinson et Benfey Usent patipayuwâ; mais je crois que Ta renfermé dans y doit ici faire partie intégrante du mot. La désinence uvâ (pour hitvâ, lequel est lui-même pour hvâ) répond à la désinence de l’impératif sanscrit sva (S 253). La préposition pati représente le sanscrit prati.
Yaçna, p. 361, note. [Il reconnaît dans ya ia caractéristique de la classe.—Tr.]
Yaçna, p. 35g.
” Voir l’Index de Brockhaus.
Abrégé de la grammaire sanscrite, ae édition, S hh6.
Elle n’est régulière que dans les cm très-rares ou giïyê signifie «j’engendre» ou «j’enfante», et est, par conséquent, un vrai moyen.
' 1 VI, T, l95.
a 6.
a En sanscrit, ni-éad «s’asseoir» (par euphonie pour ni-sad). Voyez Windisch-‘ mann, Éléments de l’arménien, p. 4s.
Exemple : gowiur «laudabatur». Selon Scliroder ( Thésaurus iinguœ
armeniacœy p. i4g), la forme en mr doit être employée avec les verbes passiis, la forme en êr avec les verbes neutres et déponents. Cependant, il est certain que les verbes neutres et déponents de la quatrième conjugaison auraient droit à la forme en iur, puisqu’au présent ils suivent l’analogie des verbes passifs. Quoi qu’il en soit, ni dans l’une ni dans l’autre de ces formes, pas plus que dans le simple êr «il était», je ne saurais reconnaître, comme le font les grammaires arméniennes, la présence d’une désinence personnelle.
Schroder, Thésaurus linguœ armeniacœ, p. i48.
Dans mwan-i-m, le « n’est pas une lettre radicale.
Racine lag.
t Racine «as.
Racine sanqv.
Racine drank.
Racine rann.
Comparez la racine sanscrite dvam «tomber» (S 20).
Comparez la racine sanscrite lu «arracher, détacher».
On a vu (S 2) que l’o sanscrit représente la diphthongue au.
En zend vaîdayêmi. Vê sanscrit et zend représente la diphthongue
ai.
En regard des primitifs ich sitze «je suis assis», ich Itcge «je sais couché», tch sinke «je m’abaisse». — Tr.
Voyez S 689.
Voyez SS 691 et 693.
Au point de vue de la grammaire latine, il faudrait regarder necâre tomme un verbe dénominatif venant de ne.v (hcc-s).
Primitif' jlittzu «je coule». Le : qui s’est irrégulièrement introduit dans ce
Recherches étymologiques, ire édition, p. 672.
Formation des temps et des modes, p. 329.
Voyez S 739.
Les membres caucasiques de la famille des langues indo-européennes, p. ‘5 et suiv.
‘2 Annales de littérature orientale, Lombes, p. Oo
Mnâ n'est évidemment qu'une métathèse de inan «penser», avec allongement de la voyelle radicale, comme dans le grec @é€Xyx* (racine /3aX), Wtt7ci>x« (racine 'srer).
Pour âsâsié. Sur le changement de s en i, voir S 21 b.
Pour arariè.
Voyez S 6. Les racines ayant r pour voyelle médiale prennent également i dans
la syllabe réduplicative; mais on a vn que r est pour ar (Si).
Pott (Recherches étymologiques, 1” édition, II, p. 76) et Aufrecht (Journal de Kuhn, I, p. 190) regardent comme un désidéralif, unique en son genre, le latin vîso «désirer voir». Je ne doute pas qu’ils n’aient raison, et je rattache la syllabe st (dans visi-t) ou se (dans vi-se-re) à la syllabe sa du sanscrit vivit-sa (par euphonie pour vivid-sa), par exemple dans vwitsa-ti «R désire voir». Aufrecht suppose que 1 i de vîso a été allongé pour compenser la perte du d (comparez visas, Visio, nsi, divtrsi, S 100). Mais j’aime mieux voir dans vîso une contraction pour viviso, comme tMi est pour vividi (S 5&7). Dans cette dernière hypothèse, il n’y avait pas de compensation possible pour la suppression du d, puisque i’t était déjà long par suite de la fusion des deux i brefs. Comparez, à cet égard, les parfaits latins comme claust, læ-si, où la suppression du d radical ne pouvait être compensée par ï’aiïongement de la voyelle précédente.
Vendidad-Sâdé, même page.
a La conjugaison est celle des verbes de la troisième classe ; le poids des désinences fait sentir son effet sur la syllaLe radicale (S Û86). Devant les désinences legtics commençant par une consonne, on peut insérer un îcomme voyelle de liaison; mais alors le gouna de la syllabe radicale disparaît. On a, par exemple, vêbiéîmi à côté de vêvêémi.
Avec affaiblissement de Va en « dans la syllabe radicale (S 7).
3 Sur Vë inséré dans cette forme, voyeg $ hh.
* Manuscrit lithographié, p. h&3. Anqueîi) (Zend-Avesta, I, p. 607), traduit : trcomme le loup à quatre pieds enlève et déchire Tentant de celle qui a porté (cet enfant) «.
Pânini, Vil, iv, 86.
Voyez Westergaard, Badicrn sanscritæ, à la racine nu ( p. Ü5 ). Quoique ânavtnol puisse venir, en effet, de la racine nu, j’aime mieux, à cause de la signification, rapporter cette forme à la racine nud. Le t ne sera donc pas le signe de la personne : je crois qu’il appartient à la racine ( t par euphonie pour d) et que le signe personnel, qui ne pouvait Se maintenir après une consonne (S 96), est tombé comme dans âyunak «tu lias, il lia» (pour âyunaki, mjunakt). Remarquez que dans â-nav-î-not (pour ânônôt) on a inséré un i : une insertion de ce genre n’a lieu ordinairement qu’après r et n. Voyez S 7 67, et Abrégé de la grammaire sanscrite, SS 5oo, 5o 1 et 5 0 8.
* Rig-véda, I, lxiv, 8, ii ; lxxviu» 1 ; xxxiv, 13 ; V, lxxxvh, 2.
C’esfr-à-dire formés d’un nom substantif ou adjectif. — Tr.
Je cite la deuxième personne parce que la première montre moins clairemen l la caractéristique de la classe. En général, la flexion est plus facile à étudier sur toute autre personne que sur la première.
De sororitis, et non de soror : ce dernier aurait donné nn verbe sororo, et non sororio.
Les grammairiens indiens supposent à tort une racine kumâr «jouer», qui» n'étant pas monosyllabique, est par cela môme déjà suspecte; de cette racine kumâi iis font venir kumârâ «enfant». Je décompose, au contraire, ce dernier mot en ku, préfixe ayant ordinairement le sens péjoratif, mais marquant ici une idée diminu-live, et en mâra, qui n'est pas employé hors de composition, mais qui est de la même famille que màrtya «homme». En général, parmi les prétendues racines données par les grammairiens de l'Inde, on trouve beaucoup de verbes dénominatifs : tel est* entre autres, suit «réjouir» (venant de sufta «bonheur»), qui contient le préfixe su (en grec ev), de même que duKU «doiore afficere» (venant de duHUa «souffrance») contient le préfixe dm — grec 5y*. Mais les grammairiens indiens font également de duhk une racine simple.
a Racine yttg «unir».
Avec gouna de IV
Comme exemples de la conservation d’un t et d’un o, on peut citer xAautn-aw,
oxpi-âofiat, i%dv-dù).
Cet o lui-même provient d’un ancien a.
G. Curtius présente «ne autre explication. De la formation des temps et des
modes, p. 119 etsuiv. , .
a Ce mot ne se rencontre que dans des composés comme ga-skaft’-s «création,
créature», ufarskaft’-s «commencement».
Comparez le sanscrit mâr-âyâ-mi «je fais mourir, je lue». Le suffixe gothique
thra représente le sanscrit Ira (S 817 °).
« Comparez le grec Sdupv, le sanscrit asm (pour daim).
C’est proprement un participe passif, venant de la racine A'k de = sanscrit UT M «poser, faire», en grec 0».
* L’adjectif correspondant manque : son thème a dû être rüâo. Comparez le lithuanien raudà «rougeur», le sanscrit rud'ira «sang», râhitâ (pour rdd'ita) «rouge».
Sur Fit qui remplace un m au présent et à l'aoriste, vovez S A38.
8 D'après l'analogie de giv-âpâyd~m\
1 Sur le son 0\f qui était originairement une diplithongue, voyez S 92 f.
4 La forme eva est employée partout où elle est ou était précédée d’un j ($ 92l).
5 La sixième classe de Miklosich.
ur.
Voyez S 109% 9.
Voyez 819. ,
* Comparez S 769.
Voyez S 20.
Jaba gaskaidnai «éài» ^ojpiedbj». Gorinth. I, vu, 11.
s II n’y a pas d’exemple de iibun{a)9; mais nous avons le mot laibos «restes», venant d’un verbe perdu leiba, taif, Ubum (en vieux haut-allemand bi-lîbu «je reste», bi-leib «je restai», bi-libuwês «nous restâmes»). Au lieu du A, la loi de substitution des consonnes (S 87, 1) devait nous faire attendre un f (comparez le grec Ae/rr&>). [En allemand moderne, bïeiben «rester». — Tr.]
D’un verbe, dont il ne reste pas d’exemple, ga-thairsa, ga-lhars, gu-lhmirmm, 1 Temps principaux : hmupa, hnaup, hrnpum, hnupam.
1 Le primitif a dû faire geisa3 gais, gisutn (Grimm, Grammaire allemande, H, nage i6).
Des primitifs perdus : skreita, skrail, skritum; Unda, tpnd, tundum.
Au lieu de ja, on trouve aussi ai (S 109% 6).
4 Comparez le grec pe^aA/£a>.
En anglo-saxon, àrôf; en allemand moderne, trübe.
Afdumbn Marc, iv, 3g.
- Nous trouvons cependant dans le dialecte védique asvâ-yfôni «equos cupio», venant de asm «equiis». Sâma-véda, II, 1, i : xi, 2.
Employé dans le sens intransitif, asû-yâmi signifie «je suis en colère». Le thème nominal est âsu «vie».
Krôd'âd asûyayitvâ tam «ira exsecrando eum» (Nalas, XIV, 17.)
Au contraire, le causatif ittimâyéyâmi, venant de cMniâyami «fumer», signifie «faire fumer». Mahâbhàrata, III, vers x5A5 ; dumâyayan disait «faisant fumer les régions du monde».
Voyez S 6.
Dans pur-gâs Vi aurait été supprimé.
Au contraire, jur-gâ-s n’aurait point élargi son thème.
Voyez SS s69 et 7 h9. Rappelons aussi le durcissement d’un j primitif en £(S 19).
Excepté quand il appartient à la racine.
Au sujet de/=s sanscrit d\ voyez $ 16.
19 Je rappelle que cette explication a été combattue par Düolzer, Théorie de la formation des mots en latin, p. 160.
Voyez S 77^, et Westergaard, Radices, p. 337.
3 C’est ainsi qu’en borussien, même hors de composition, on a as-mai, as-sai, as-ty tandis que ie lithuanien fait es-mi, e-si, és-ti.
Je ne doute pas que dans ces composés la voyc’.le qui précède le o n’appartienne au verbe principal. En effet, dans l’imparfait simple éxa'Aee, le dernier e appartient encore au Ihème : si à la première personne nous avons exdAeo-u, avec o pour e, cela tient au voisinage de la nasale.
1 Voyez S 109“, 1.
Voyez S 556 et suiv. — L’ossète, même hors de composition, a perdu la labiale du verbe auxiliaire en question. Ii fait, par exemple, wad b qu’il soit», wont b qu’ils soient» = sanscrit b'âvatu, Mvantu. Voyez mon mémoire intitulé Les membres cau-casiques de la famille iudo-européenne, pages 43 et 82, remarque 48. — En persan moderne, le présent du verbe substantif peut entrer en combinaison avec tous les noms substantifs ou adjectifs, ainsi qu’avec les pronoms personnels; exemples : pirem Bsenex sum», menem «ego sam». — Avec le wa de l’ossète wa-d «qu’il soit», on peut comparer l’albanais on, pluriel «a-p, dans les aoristes comme kepkà-vct «je cherchai», kzpk’-üa-fi b nous cherchâmes». Dans ce t>a, wap je reconnais également la racine sanscrite Vu, en latin fu. Mais je ne crois pas qu’il faille admettre pour cela une parenté spéciale entre l’albanais et le latin ou l’ossète. Voyez mon mémoire Sur l’albanais et ses affinités, p. 18 et suiv.
5 Voyez S 770.
Voyez S 67. .
Le suffixe du thème nominal regnd b royaume», littéralement «ce qui est régi», est le même que celui de fullna (en sanscritpûrnâ «rempli»).