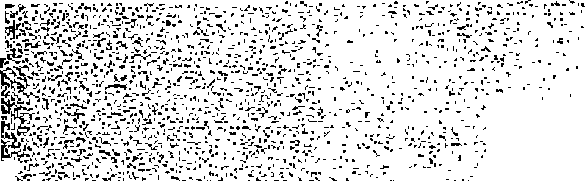
r ju c^r, .. • v. .•-“ , , ' •. , . . -
^s'Vi^/i^V^^vVvs'.. O:.- , ' ' ' '
jr, 7 rv i-jfc' '- A A- ." " —’'i - ' L
-Vf—' <r'~> —--------
{BnF
Gallica
La science du langage : cours professé à l'Institution royale de la Grande-Bretagne en l'année 1861 (3e édition,
revue [...]
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
{BnF
Müller, Friedrich Max (1823-1900). Auteur du texte. La science du langage : cours professé à l'Institution royale de la Grande-Bretagne en l'année 1861 (3e édition, revue et augmentée sur la 8e édition anglaise) / par Max Müller,... ; traduit de l'anglais, avec autorisation de l'auteur, par George Harris,... et Georges Perrot,.... 1876.
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le cadre d'une publication académique ou scientifique est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source des contenus telle que précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus générant directement des revenus : publication vendue (à l'exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit payant, un support à vocation promotionnelle etc.
CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE 2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :
- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.
- des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter utilisation.commerciale@bnf.fr.
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
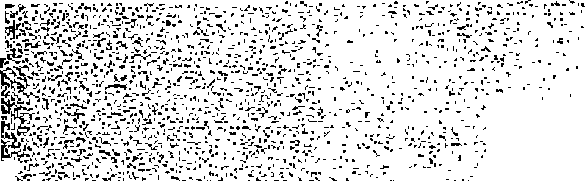
r ju c^r, .. • v. .•-“ , , ' •. , . . -
^s'Vi^/i^V^^vVvs'.. O:.- , ' ' ' '
jr, 7 rv i-jfc' '- A A- ." " —’'i - ' L
-Vf—' <r'~> —--------
•î.w^w * .*
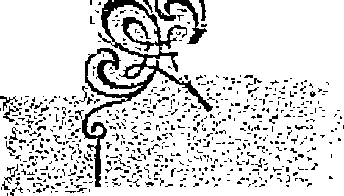
/J! Jr’y'-r ^y_V .r. *V,' ^ ;J. -
ïst
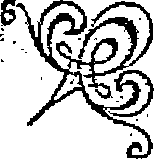

LA
^vô'fî
^-•’-'Vv'
►*,Vv 'ï/-
"îKc-'5'S:
Laa-
iV, r-J"rh^- -; .V -• 'i'v'l t
fcj i ( J -»|" ' * -*
*-.*,•.• r. >
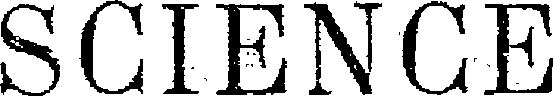
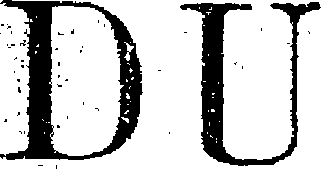
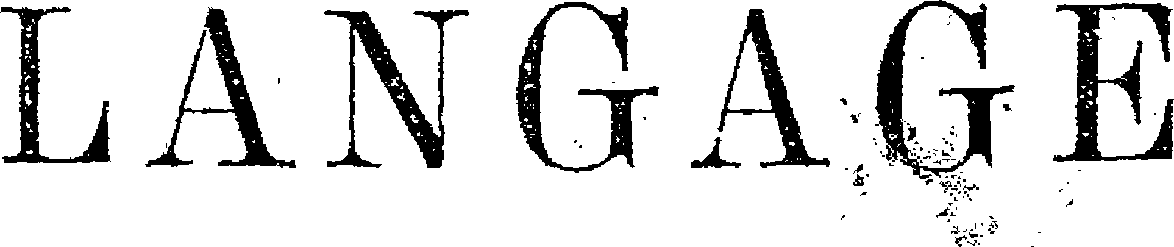
Sî-
J*y.
%ï1
"’X .
i's f1 -•
-A' ,
■&À"
w
&■-
æ.' --'
aîs,* s.
v, ’
'■V-i
V ■■
^ "
V* - J '
* r. v s
jKA ^
PI'
f*2 - ",
fi'} <
&£/. ' ■ -
.
’1- ï ^
t^ V'' •
.<y^--
"li -" ' iV "| i-_^ .
“■j#J ) ' ,'.
't,
i'i %'
-3 . ,
x, r^
i
” .■■’ <■ t‘ ' j
nJ ,*
■r ;. ' ’
«H -' *“"•
l>*Sn ^
r-
i^v
'T:>^
ïü ‘
Cocas PROFESSE A I’IXSTITBTIOS royale de la GRAXDE-BREYAGSE
J i ; '-'.
- -* /
\ en l'année 1861 . P ■
c fl.
H ^ ffr
1 11 h'
£ iv r
' «■ T,
h-
%<&
■rf*
i\' %^v>-
>
MAX MDLLER......
► M - I'. - ■ —^^7 • ]!'■
ASSOCIÉ L T R A X a E j Èj>K yL ACADÉMIE DES INSSiUPTrONS ET BEMrESHÆTT^RES
r r/ÉlV^ PaDVESSEUR a l’dniversïté d'oxforu
.T
V
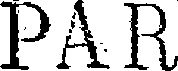
-j^ s ,
? Jj“ ’ A É.
+r1
J
/T,
OUVRAGE OUI k OBTENU DE L’iNSTITUT DE FRâSCE LE PRIX VOLNEÏ. EN 4862
TfiàDtHT BE l'AKOLAIS, AVEC L'AU TOB 1S AT 10 K DE L'AUTEUR
PAR
GEORGE HARRIS
Professeur au lycée Fonianes
|, ET GEORGE PERROT
r ' *‘< "- s \i
■7 ilèintor-e;^^ l'Institut, Professeur1 à la Faculté des Lettres de Paris
TROISIÈME ÉDITION, REVUE ET AUGMENTÉE
Sün LA HUITIEME EDITION ANGLAISE
h
/ J .
• - j
/ ' N-,
■ /V
. A
•* .*S. ti* ^ I T * *
i 4'Wi ■
K^/tc ' " - " ' “*
Cl. 4
A •••
^ -U, '. “
•* V
-É fe
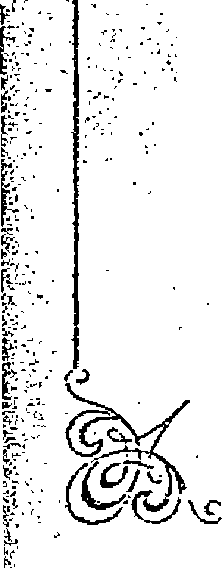
PARIS
A. DURAND ET PEDONE LAURIEL, LIBRAIRES-ÉDITEURS
: RUE CUJAS, 9 (ANCIENNE RUE DES GRÈS)
4 876
r-. r. j
V-s
, -’p, ;> ‘r
‘ \ ï .W
■ 7
1 *J:'
■ /-a
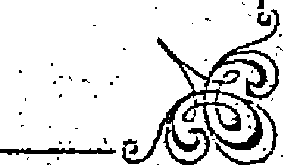
4 , '
ï'* s V
V r • • -r. p.
'&; ■
!s v
^ , ' •
A A: ,lA
•? V-:v-'-
l 5■ ....iV/.;::-?
Hk 's t * y ^ \ ^ ti1 _ v
^ ,-A
V V'. ’V 1T-- ' ?
' ■,v-- 1 -
\
y . ,
K'i'i'v
Èi:*r;--r
t; -
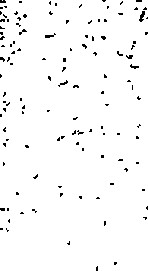
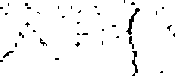
t
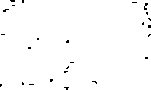
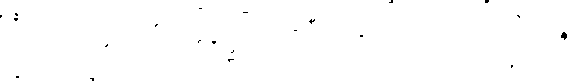
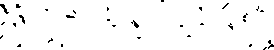
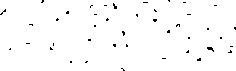
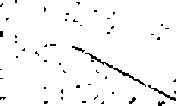
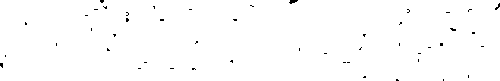
î

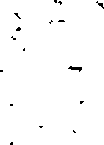
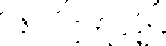
t' -


*
*
• r
I
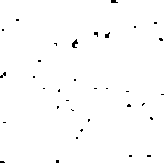
t
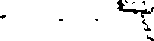
r
&
J
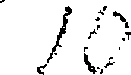
i

T

s
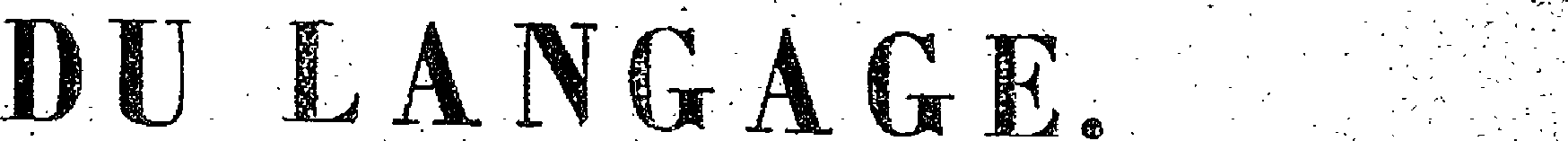

.1 -
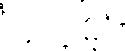
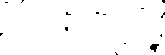
t
AUTRES OUVRAGES DU MÊME AUTEUR
RJotrweEIes ILecons sue* la Science du Langage; ouvrage
traduit en français par les mêmes :
Tome I*r, I^îionétique et Étymologie, avec lune Notice sur l’auteur. Durand et Pedone Lauriel, 18^67, in.8°.
Tome II, Influence du Langage gui* ïa Pensée ; Mythologie ancienne et moderne-
Essais sur PIEistoire dès ï&eiigiôns, traduit par George Harris. Paris, Didier et Cie, 1872.
r *
Essais sue* Sa BfyttioSogie comparée, les TTraditions
et les Coutumes, traduit par George Perrot. Paris, Didier et Cie, 1873. -
T

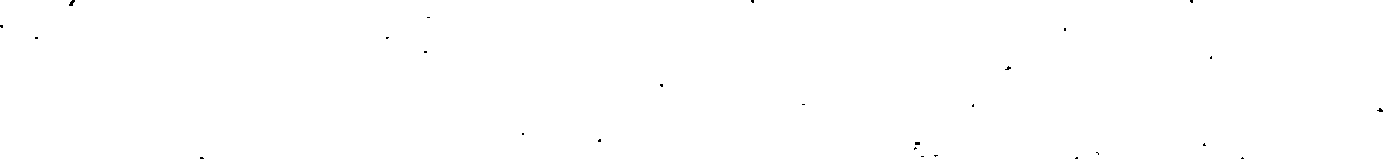
f ''
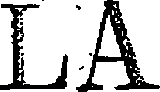
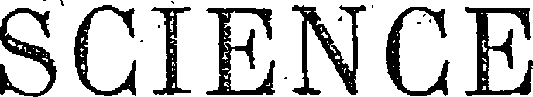
ç-
r
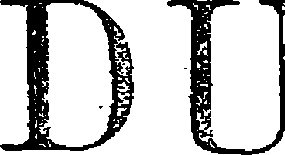
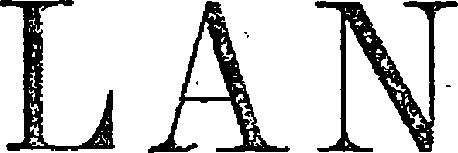
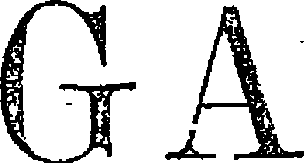
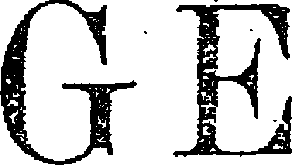
COURS PROFESSE A IMSSTITBTIOS ROYALE DE LA GRANDE-BRETAGNE en l’année 1861
> PAR MAX MÜLLER '
ASSOCIÉ ÉTRANGER DE L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES
■ Aï b
s.
PROFESSEUR A L UNIVERSITE D OXFORD
'V-,
/OUYHAGÉ<DtiîVA ‘OBÏEfe'DE INSTITUT DE FRASCE LE PRIX mm W 1862
k
/
f vV,
- TRAHIT
\ . ' \ C- \ r\Î3E L’MWIj
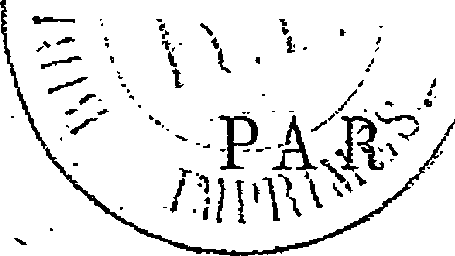
Professeur au lycée Pontanes
A-ftOIiAIS, AVEC L’AUTORISATION DE L’AUTEUR
W # 4 1
f
Membre de U Institut . Professe tu* à la Pacnlté des Lettres de Paris

TROISIÈME EDITION, REVUE ET AUGMENTÉE
SUR LA HUITIÈME ÉDITION ANGLAISE
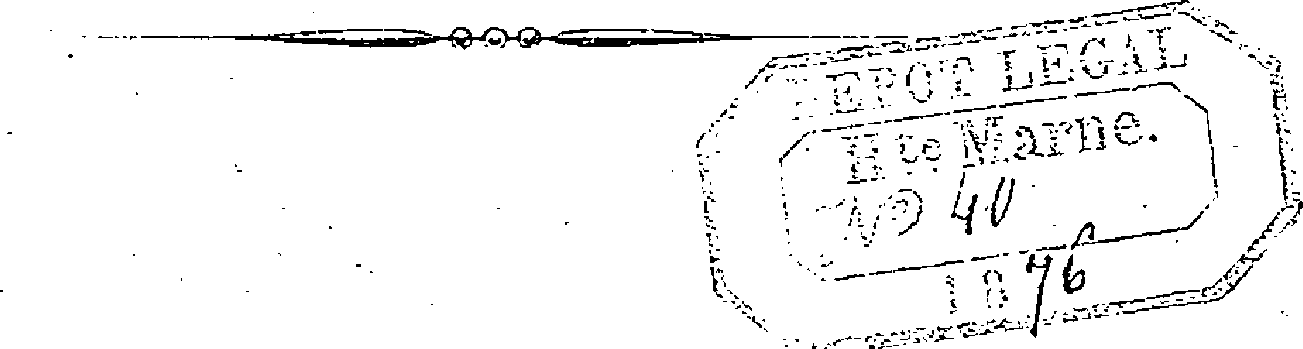
l r
A. DURAND ET BEDONE LAURIEL, LIBRAIRES-ÉDITEURS
HUE CUJAS, 9 (ancienne rue des grès)
\ 876
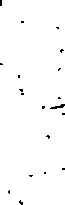
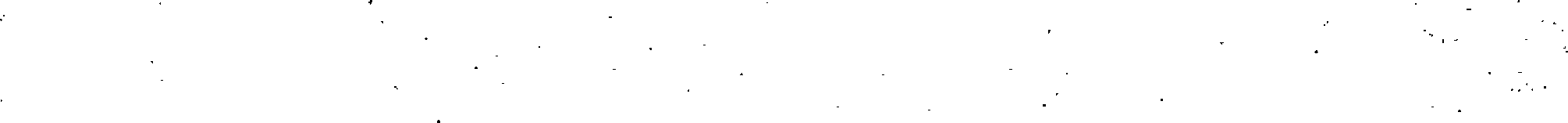
N
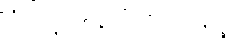
S
S 1
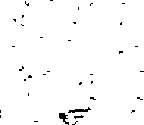
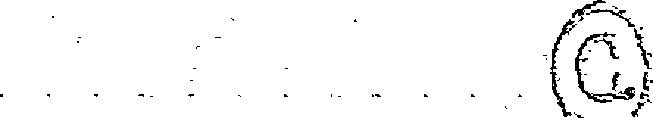
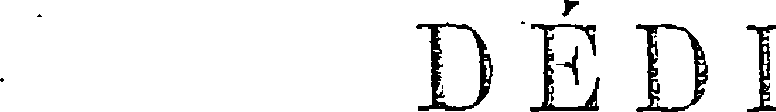
AUX
•r

RÉSIDENTS ET NON-RÉSIDENTS
DE QUI J’AI REÇU TANT DE PREUVES DE SYMPATHIE ET DE BONTE
DURANT LES DOUZE DERNIÈRES ANNÉES
POUR LE GÉNÉREUX APPUI
QU’ILS M’ONT DONNÉ LE 7 DÉCEMBRE 1860.
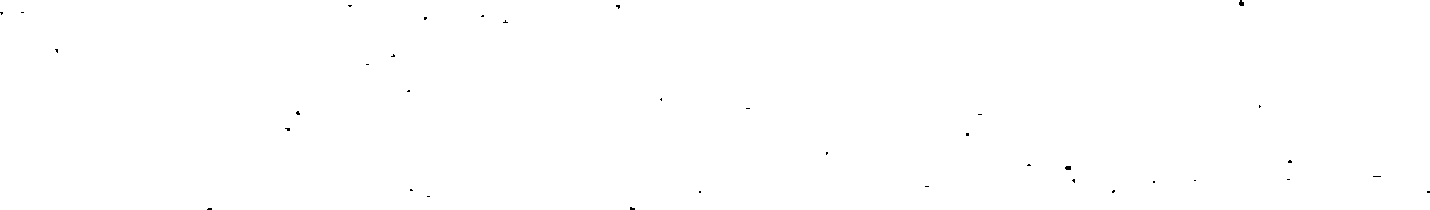
a
z
&
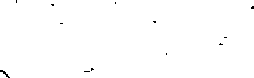
/
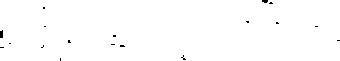


î

î'
lJ '
t’
F

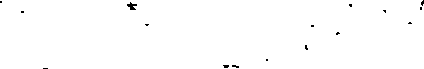
lr
V."
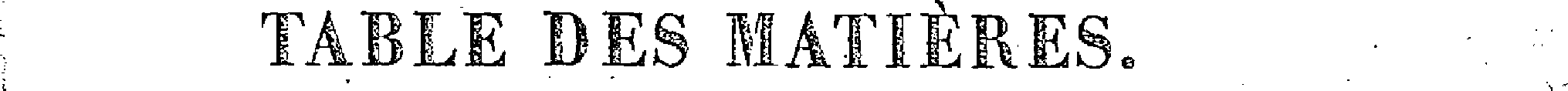
AVANT-PROPOS DE LA TRADUCTION FRANÇAISE. ' (Pages xv à xxix).
. 4
PRÉFACES DE L’AUTEUR.
(Pages xxxi à xliv.)
N PREMIÈRE LEÇON.
[‘ - ■ , “
c
f ^
f A QUEL ORDRE DE SCIENCES APPARTIENT LA SCIENCE DU LANGAGE. .
\ • ,
‘ (Pages \ à 29.) .
| Importance de la science du langage. Sa date récente : les noms divers i qui lui ont été donnés : •philologie comparée, étymologie scientifique,
: linguistique, phonologie, glossologie. — Coup d’œil jeté sur l’histoire
; des sciences indudives. Trois périodes dans celte histoire : période
: empirique, période de la classification, période de la théorie. — Période
empirique. — Humbles débuts des différentes sciences : de la géométrie ; de la botanique ; de l’astronomie ; étymologie du mot anglais ; moon ; des mots Pléiades ou Vergiliæ, Hyades ou Pluviæ. — Nécessité .pour les sciences de rendre dès services pratiques. — La mythologie. Étymologie de Êos, . Tilhonos, Falum, Zeus, Luna, Lucina, Hecale,
! Pyrrha. — Le langage élève une barrière infranchissable entre l’homme, et les bêtes. — La classification dans les sciences. — Rôle de l’imagina-' lion et de la divination dans le progrès de la science: Copernic, Kepler. — La théorie. — Deux grandes divisions des connaissances humaines: les sciences de la nature, qui traitent des œuvres de Dieu ; les sciences : historiques, qui traitent des œuvres de l’homme. — Distinction profonde entre la philologie proprement dite et la philologie comparée ou
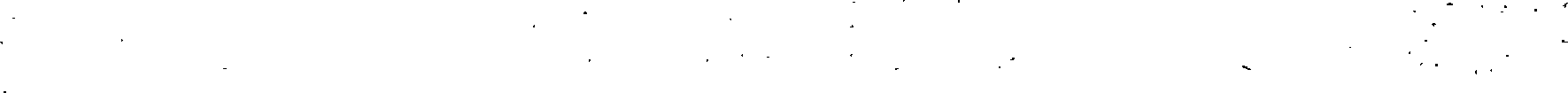
linguistique. Origine du nom de philologie comparée. — Le langage étant l’œuvre de la nature, et non une invention de l'homme, la philo* logie comparée doit être rangée parmi les sciences que nous avons i appelées sciences de la nature. — Nécessité d’étudier la science qui fait l’objet de ce cours dans les trois périodes déjà énumérées, la période empirique, celle de la classification, et celle de la théorie.
DEUXIÈME LEÇON.
O
de la distinction a faire entre le développement du langage ,
ET l’histoire DU LANGAGE.
(Pages 51 à 96.)
Objections contre la théorie qui classe la science du langage parmi les sciences de la nature. Première objection : le langage est l’œuvre arti-, ficielle de l’homme. Opinions de diverses écoles de philosophie sur l’origine du langage. — Deuxième objection : le langage est susceptible de développement et de perfectionnement, et se distingue par là des produits de la. nature. — Le développement du langage résulte de deux opérations distinctes, l’altération phonétique et le renouvellement * dialectal. Ce qu’on entend par altération ou corruption phonétique : étymologie de viginli, vingt, dérivé des deux mots d’où viennent deux et dix; ravages de l’altération phonétique. Renouvellement dialectal. Importance de l’étude des dialectes pour entrevoir la vie réelle du langage. Nombre infini de dialectes dans l’Asie centrale, en .Afrique, en /Amérique, dans la Polynésie et même en Europe. Les patois conservent souvent des formes plus primitives que les langues littéraires. Rapidité extraordinaire avec laquelle les dialectes se transforment, constatée par les missionnaires en Amérique ; même fait observé en Asie et en Afrique. Comment se forment les langues nationales. Dans quel sens les termes de mère et de fille peuvent s’appliquer aux langues : le latin et l’italien. Histoire du latin. Influence des dialectes et des patois sur le développement des langues : le langage porté en Islande par les réfugiés norvégiens est resté presque stationnaire depuis sept siècles, tandis que sur son sol natal il s’est scindé en deux langues distinctes, le suédois et le danois. Richesse des dialectes. Lois qui ont présidé au passage, du latin aux langues romanes. Dans quel sens nous parlons du développement du langage. Le développement du langage comparé non à la végétation d’un arbre, mais à la formation successive des couches terrestres. — Les individus ne peuvent influer en rien sur le développement du langage. — Troisième objection : la science du langage doit être classée parmi les sciences historiques,
- puisque nous ne pouvons nous rendre compte de la vie et du dévelop- ' pement d’aucune langue sans connaître l’histoire du peupie chez qui -elle s’est formée et surtout l’histoire de ses rapports avec les autres peuples. — La science du langage ne dépend aucunement de l’histoire; différence entre l’histoire du langage de l’Angleterre, et l’histoire de l’anglais. La grammaire est l’élément essentiel et la base de toute . /'classification des langues : c’est la grammaire qui nous fait ranger le /turc parmi les langues tartares et touraniennes, et l'anglais parmi les langues teutoniques, malgré l’origine diverse des mots qui composent le vocabulaire de chacune de ces deux langues.
TROISIÈME LEÇON.
PÉRIODE EMPIRIQUE.
(Pages 97 à 150.)
Spéculations métaphysiques sur la nature du langage dans les écoles de-l’Inde et de la Grèce : terminologie cffTpiaton, d’Aristote et des stoïciens.1 — La grammaire proprement dite doit commencer naturellement avec l’étude des langues étrangères; Indifférence des Grecs pour les langues des barbares. Les Interprètes dans l'antiquité. Voyages des; anciens philosophes grecs. — Bérose, Ménandre de Tyr et Manéthon ? écrivent en grec l’histoire de leurs patries respectives, la Babylonie, la Phénicie et l’Égypte. — Étude critique dé la langue grecque dans l’école d’Alexandrie. Les philosophes alexandrins inventent de nouveaux termes grammaticaux. Zénodole. Denys le Thraee, élève d’Aristerque, quitte Alexandrie et s’établit à Rome, vers le temps de Pompée, pour y enseigner le grec: il compose, à l’usage de ses élèves, la première ; .grammaire de la langue grecque. — Influence de la Grèce en Italie.
• dès les temps les plus reculés. Les Italiens reçoivent des Grecs leur’ alphabet, ainsi que les rudiments mêmes de la civilisation. Dès le temps de Caton, tous les Romains instruits savent parler le grec. —La*, première histoire de Borne est écrite en grec par Fabius Pictor. Livius Andronicus, Naevius, Plaute, Ennius, Térence, Poîyhe, les Seipions. Croyances religieuses des Romains. Cratès de Pergame donne les per. rnières leçons de grammaire à Rome, vers l’an 159 av. J.-G. Lucius Ælius Stilon : "Varron, Lucilius, Cicéron. Traité de César de Analogia. Arrivée de Denys le Thraee à Rome : la terminologie grammaticale qu’il emploie dans la grammaire grecque est celle dont nous nous servons encore aujourd'hui. — Les grammairiens des siècles suivants : M. Verrius Flaccus, Quintilien, Seaurus, Apollonius Dyscole, Probus, Donal, Priscien, .
QUATRIÈME LEÇON.
PÉRIODE DE LA CLASSIFICATION.
(Pages -lot à 196.)
Observations sur la grammaire empirique. — Origine des formes grammaticales. Nécessité d'établir la filiation des langues, afin de pouvoir, faire remonter les formes grammaticales jusqu’à leur origine. — L’idée-d’une classification des langues inconnue à l’antiquité. Pour les Grecs, les hommes étaient divisés en Grecs et en barbares. Influence du mot' barbares, chez les Grecs d’abord et plus tard chez les Romains. — Le Christianisme, en enseignant l’origine commune de l’humanité, prépare les voies à l’étude comparée des langues. — Première division des langues, en langue sacrée et langues profanes. — L’étude de l’arabe, du chaldéen et du syriaque conduit à l’établissement de la famille
TABLE DES MATIÈRES. '
• A
sémitique. La philologie au seizième siècle : Bibliander , Henri Eslienne, Roecha, Megiser, Guichard, J. J. Scaliger, Duret, Thomassin. — Les progrès de la science du langage sont empêchés pendant long; temps-par'1e préjugé qui faisait regarder l’hébreu comme la langue primitive de l'humanité. Leibniz combat le premier ce préjugé : ses efforts incessants pour obtenir des spécimens de toutes les langues du monde, afin d’établir la philologie comparée sur les seuls fondements qui soient vraiment solides. — L’impératrice Catherine et ses études philologiques : son Dictionnaire comparé, contenant une liste de deux cent quatre-vingt-cinq mots traduits en deux cents langues, paraît c-n 1785. — Les deux grands ouvrages qui résument, au commencement de notre siècle, tous les travaux antérieurs, sont le Catalogue des tangues, d’Hervas, et le Miihridajte, d’Adelung.- Vie d’Hervas. — Découverte du sanscrit. Histoire, de celte langue, qui cessa d’être parlée. ■ trois cents ans avant Jésus-Christ. Les dialectes qui en sont sortis, le pâli, le prâkrit, lesquels, avec le temps, se sont transformés dans les idiomes modernes de l'Inde, l’indoui, l'hindouslani, le mabralle, le bengali. La haute antiquité du sanscrit est prouvée par les noms sanscrits qui se rencontrent dans les auteurs grecs, latins et chinois; les Voyages des pèlerins bouddhistes. Etude du sanscrit après la conquête de l’Inde par les Mahométans. Sous ie calife Almansour, Mahomined ben Ibrahim Àlfazari traduit en persan le grand Sindhind, vers 771 de Jésus-Christ. Travaux d’Albirouni Traduction de divers ouvrages sanscrits en persan et en arabe. Règne d’Akbar ; il fait traduire en persan le Mahâbhâraia, le Hâmàyana, YAmarakosha, mais il ne peut - obtenir des brahmanes une traduction des Védas. Légende de Feizi. Dârâ, rarrière-petit-fils d’Akbar, donne, en 1657, une traduction en persan des Opànishdds, laquelle fut traduite en français par Anquelil-Duperron, en 1795. — Travaux de saint François-Xavier et de ses compagnons dans l’Inde. Philippo Sassetti. Vie de Roberlo de Nobili, Je premier Européen qui posséda une connaissance approfondie de la langue et de la littérature sanscrites, -r- Heihrich Roth. Correspondance des pères Coeurdoux, Calmette et Pons, avec l’Académie des inscriptions et belles-lettres. — Première grammaire sanscrite publiée, en 1790, par Paulin de Saint-Barthélemy. — Fondation, en 1784, de la Société,asiatique à Calcutta: travaux de William Jones, de Carey, de Wilkins, de Forster, de Colebrooke. Découverte de l’affinité entre Je • sanscrit,' le grec et le latin.— Frédéric Schlegel. Établissement de la ; famille des langues indo-germaniques.
CINQUIÈME LEÇON.
1 \
CLASSIFICATION GÉNÉALOGIQUE DES LANGUES.
> ,
(Pages 197 à 257.)
Travaux deBopp, A.Schlegel, Humboldt, Pott, Grimni; Rask, Burnouf. — Révolution opérée dans l’étude dé la classification des langues par la découverte du sanscrit. La grammaire comparée. La classification généalogique des langues : pourquoi cette classification ne s’applique .pas nécessairement à toutes les langues. — Table généalogique de la famille des langues aryennes. 1° Branche leuionique. Le bas-allemand
auquel appartiennent les dialectes frisons, le hollandais et le flamand. Le haut-allemand, dont l’histoire se divise en trois périodes : le nouveau, le moyen et l’ancien haut-allemand. Le gothique : vie d’Ulfilas, sa traduction de la Bible en gothique. Les dialectes Scandinaves: le suédois, le danois, l’islandais. L’Edda poétique et l’Edda de Snorri Sturluson, les plus anciens monuments du langage Scandinave. La littérature en Islande : les scaldes. — 2° Branche italique. Les six langues romanes: le français, l’italien, l’espagnol, le portugais, le valaque et le romanche. — 3° Branche hellénique. — h” Branche celtique. Le kvmri qui comprend le.gallois, le comique et l’armoricain. Le gadhélique qui comprend l’irlandais, le gaélique d'Écosse et le maux ou dialecte de File de Man. — 5° Branche slave ou wîndique. Le letle, le lithuanien. Le russe, le bulgare, le serbe, le croalien, le Slovène. Le polonais, le bohémien, lelusatien.' —•( L’albanais. — 6° Branche indienne. Le sanscrit, lés dialectes prâkrits, l’indoui, l’hindoustani, Je mahratte, le bengali. —7° Branche iranienne. Le zend, lé pehlvi, le parsi, le persan ; moderne. — Berceau primitif de la famille aryenne.
SIXIÈME LEÇON.
O -
LA GHAJIMAIRE * COMPARÉE.
(Pages 259 à 501.) . ■ '
Objet de la grammaire comparée. — Distinction entre les racines et les formes du langage. •— Théories diverses sur l’origine des formes grammaticales. Les désinences ne sont ni des excroissances produites par une végétation intime du langage ni des signes de convention inventés pour modifier le sens des mots : la grammaire .comparée . démontre qu’elles ont été originairement des mots indépendants qui se sont altérés avec le temps et se sont agglutinés à la fin des mots auxquels ils étaient juxtaposés. Formation de certains cas dans les lan--gués aryennes : le locatif, le génitif, le datif. Formation des désinences des verbes : le futur français, le futur latin, le prétérit anglais. — Hypothèse pour montrer comment les formes grammaticales peuvent - prendre naissance. — Principaux résultats donnés par la grammaire. comparée des langues. aryennes. Lumière inattendue jetée sur les ■ temps auléhistoriques par .l’élude comparative de ces langues; — ' Tableau de la civilisation chez les Aryens avant leur dispersion, d’après les mots communs aux différents membres de la famille. ^ .Pourquoi le nom à'aryennes a été donné aux langues indo-européennes. — Signification du nom Arya; ses pérégrinations à travers Je monde. —-■ Région habitée par les Aryas.
SEPTIÈME LEÇON.
LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU LANGAGE..
(Pages 503 à 552.)
Home Tooke indique le premier le caractère véritable des désinences grammaticales. — Les éléments constitutifs du langage sont les racines
attributives et les racines démonstratives. Définition du terme racine. Racine AR, ârya, avare, apouv, arairum, apoxpov, aralio, a poste;. spot, cari h, armentum, apoupa, arvum, ars, arlis. — Racine SPAG. Respectable, speclare, specere, spy, espion, sxrTCTou.at, cxetitl/.oc, imcx-crcoi;, évêque, respect, répit, dépit, soupçon, auspice, espiègle, espèce, épice, épicier. — Classes de racines : racines premières, secondaires, tertiaires. — Nombre des racines en sanscrit, en hébreu, en gothique, en aile-imand moderne. Nombre des mois en chinois, dans les inscriptions cunéiformes de Perse, dans les inscriptions hiéroglyphiques de l’Égypte, en anglais, dans Shakespeare, Millon, l’Ancien Testament. — Modification du sens des mois chinois, selon leur place dans la proposition. — Origine du s, terminaison de la troisième personne singulière de l’indicatif présent des verbes anglais. — Toutes les langues, sans aucune exception, qui nous sont connues, composées des deux mêmes éléments constitutifs. — Problème de l’origine du langage ; si obscur pour les anciens philosophes, beaucoup plus clair pour nous.
HUITIÈME LEÇON.
CLASSIFICATION MORPHOLOGIQUE DES LANGUES.

(Pages 555-à -î 07.)
Exposé sommaire des langues sémitiques : leur division en trois branches, la branche araméenne, la branche hébraïqueetlabranche arabique.— Le syriaque et le chaldéen, les deux principaux dialectes de l’araméen. Monuments écrits du syriaque du deuxième et du quatrième siècle : cet idiome se parle encore chez les Nestoriens du Kurdistan. Le chaldéen, langue de Jésus-Christ et de ses disciples ; des fragmentsdu livre d’Ezra, et les Targums, nous en donnent des spécimens : les Talmuds de Jérusalem et de Babylone, et la Massore, rédigés en chaldéen altéré. Inscriptions cunéiformes de. Babylone et de Ninive. Livre d'Adam. Les Nabatéens, Agriculture nabatêenne. — Uhèbreu,Tancienne langue de la 'Palestine depuis le temps de Moïse; sa parenté probable avec phénicien et le carthaginois. — L'arabe, sorti de la péninsule arabique. Inscriptions himyaritiques. — L'abyssinien ou le g liez. Les Moallakâl,
■ les plus anciens textes arabes. — Le berber, le haussa, le galla, le copie, dont le caractère sémitique est indécis. — La dénomination de ; familles ne s’applique proprement qu’aux langues aryennes et sémiti-- ques. Divers degrés de parenté entre les langues. — Langues toura-iniennes, celles qui sont parlées par les races nomades de l’Asie, le j longous, le mongol, le turc, le finnois, le samoyède, le tamoul, le bho-J Üya, le iaïen et le malais. Traits caractéristiques de ce groupe de langues. — Histoire abrégée de ces langues et des populations qui les parlent. — Problème de l’unité primitive du langage. .
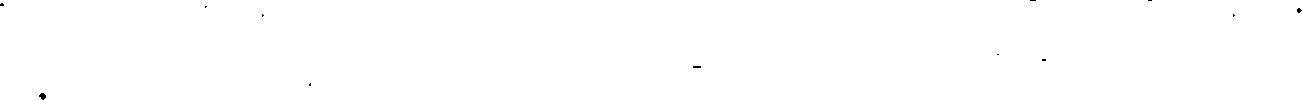
NEUVIÈME LEÇON.
O
PÉRIODE DE LA. THÉORIE. — ORIGINE DD LANGAGE.
(Pages -409 à 4 70.)
Théories diverses sur l’origine du langage — Méthode à suivre pour arriver à la solution de ce problème. Nécessité de pénétrer la nature intime du langage. Différence entre l’homme et les bêtes. Facultés mentales5 des bêtes. L’instinct et l’intelligence chez les bêtes et chez l'homme. Les.bêles ne possèdent ni la faculté de former des idées générales, ni le langage qui est le signe ou la manifestation extérieure de celle faculté distinctive de l'homme. — Les racines, éléments constitutifs du langage. — Comment les racines ont-elles été formées? Deux théories principales proposées pour en expliquer la formation : la théorie de l’onomatopée et celle de l’interjection. — Examen et réfutation de ces deux théories. — La faculté de connaître ou la raison, et la faculté de nom^ mer. ou le langage. Toutes les racines expriment une idée générale, et sont des types phonétiques produits instinctivement:par une puissance inhérente à la nature humaine. — Élection primitive et élimination subséquente des racines. — Rien d’arbitraire dans le langage. —Conclusion. .
APPENDICE.
TABLEAUX GÉNÉALOGIQUES DES LANGUES.
(Pages 471 à 474,) ,
TABLE ANALYTIQUE
(Pages 475 à 498.)
- O
L’ouvrage dont nous offrons la traduction aux lecteurs français a eu, en Angleterre et sur le continent, un succès qui nous dispense dJen faire l’éloge et d’en indiquer longuement les mérites. C’est au printemps de \ 86'1 qu’un public nombreux et choisi se pressait à Londres, dans une des salles du Royal Inslüuie, pour entendre la vive et brillante parole du savant professeur d’Oxford, de cet homme éminent que l'Allemagne a prêté à l’Angleterre sans cesser d’être fière de lui et deThonorer comme une de ses gloires. Çettë année même, les neuf leçons dont s’était composé le cours, soigneusement revues et enrichies de nouveaux développements, formaient un volume qui en est aujourd’hui à sa quatrième édition. D’année en. année, M. Müller n’a cessé de corriger et d’améliorer son
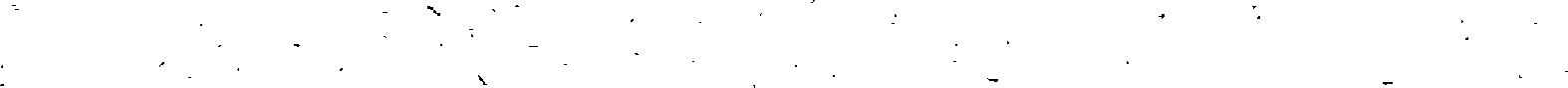
AVANT-PROPOS.
' XVI
travail, d’éclaircir tout ce qui avait pu prêter à de fausses interprétations, d’appuyer sur de nouvelles preuves les assertions qui avaient été contestées. La quatrième édition, qui vient de paraître il y a peu de jours, et dont les épreuves nous étaient communiquées à mesure qu’elles recevaient les corrections de Ml Müller, contient surtout de nombreuses additions et des rectifications importantes.
G’est que l’auteur avait obtenu, de tous les succès, celui qui doit être le plus sensible au cœur d’un savant vraiment digne de ce nom, vraiment amoureux de la recherche et épris de la vérité : il avait eu l’honneur de susciter de nombreux contradicteurs, de provoquer l’effort de critiques instruits et sérieux, qui discutèrent et discutent encore ses idées avec un intérêt, avec une vivacité passionnée que n’excitent jamais des œuvres médiocres. Lui-même reconnaît, dans ses notes, ce qu’il a dû accorder d’attention aux remarques et aux objections qui se sont produites dans les critiques, toujours anonymes, suivant l’usage, que se sont empressées de consacrer à ce beau livre les grandes revues anglaises. En France, M. Barthélemy Saint-Hilaire, dans trois articles du Journal des Savants, a suivi pas à pas notre auteur, s’attachant surtout à faire connaître ses théories aux lecteurs français, et à mettre en lumière toutes ses rares qualités ; ce n’est ■guère que sur des points de détail que portent les dissentiments qu’il signale entre ses propres vues et celles
^ ■ 1
du professeur d’Oxford. M. F. Baudry, dans la Revue archéologique, a fait des réserves plus marquées et a discuté, avec une logique incisive et pressante, la méthode
que M. Max Müîler applique à la classification des langues.
t ,
C’est surtout en Allemagne que l’attention est éveillée par de pareils travaux; au-delà du Rhin les philologues de profession sont peut-être plus nombreux que chez nous les amateurs même et les curieux capables d’ouvrir à leurs moments perdus un livre de philologie ; aussi, dès les premiers jours de 1863, paraissait-il à Leipzick une traduction allemande des Lectures on thescience of language. Enfin, en ce moment même se prépare une traduction italienne qui suivra de près la version française. .
Un pareil succès risque d’étonner des esprits même cultivés, qui sont restés jusqu’ici étrangers à ces éludes et à leurs récents progrès; on se demandera peut-être, surtout en France, qui elles peuvent intéresser, en dehors d’un cercle très-borné de grammairiens et de linguistes. En général, on ne mesure, pas encore toute la portée de ces recherches, on n’en comprend pas tout l’avenir ; aussi convient-il d’indiquer ici en quelques mots à quels graves problèmes conduit naturellement cette belle science, cette histoire naturelle de Ja parole humaine..
Bien mieux encore que. l’enquête archéologique si brillamment inaugurée, il y a une trentaine d’années, par les savants du nord de l’Europe, l’étude des langues et de leurs formes les plus anciennes nous permet de remonter dans ce vague et obscur passé où se dérobent les premiers vagissements et les premiers pas de l’humanité, bien au-delà du point où s’arrêtent la légende et la tradition même la plus incertaine. Ni ces grands amas de coquilles, si patiemment remués et examinés par les antiquaires.
norvégiens ; ni ces lacs italiens et suisses dont Si. Troyon et ses émules explorent les rivages et interrogent du regard et de la sonde les eaux transparentes ; ni les cavernes fouillées par SL Lartet ; ni ces antiques sépultures d’un peuple sans nom qui se retrouvent des plateaux de J’Àtlas aux terres basses du Danemark, ne nous livrent d’aussi curieux secrets que lés riches et profondes couches du langage où se sont déposées et comme pétrifiées les premières conceptions de l’homme naissant à la pensée, les premières émotions qu’il ait éprouvées en face de la nature, les premiers sentiments qui aient fait battre son cœur. Restes des grossiers festins de nos sauvages ancêtres, débris de leurs légères demeures suspendues au-dessus de ces eaux qui les protégeaient et les nourrissaient tout à la fois, monuments authentiques de leur ingénieuse et-opiniâtre industrie, faibles instruments qui les aidaient dans leurs premières luttes contre la nature, armes fragiles et émoussées qui leur servaient à se défendre contre les bêtes fauves, étranges bijoux, gauches et naïves parures où se révèlent des instincts de coquetterie contemporains, chez l’un et l’autre sexe, des premiers rudiments de la vie sociale, tout cela n’est, ni aussi instructif ni aussi clair ni aussi précis, tout cela ne nous en apprend pas autant sur ces longs siècles d’enfance et de lente, croissance que l’analyse même des mots, que l’explication de toutes ces. métaphores hardies dont nous avons hérité et que nous employons encore tous les jours sans plus les comprendre, que l’examen de tous ces termes figurés qui, même dans les plus raffinés et les plus philosophiques de nos idiomes modernes, subsistent toujours - comme les vivants témoins d’un inoubliable passé, et semblent protester, par le rôle qu’ils continuent a jouer
dans la langue, contre les victoires et les conquêtes de
_ - . * . "
l’abstraction. •
C’est ainsi que la philologie comparée, telle que notre siècle l’a le premier comprise, nous aide, mieux que toute autre étude, à nous représenter, tout au moins par conjecturé et par induction, un état d’esprit par lequel l’humanité ne repassera jamais, et que nous ne saurions plus, atteindre par l’observation directe -: en nous faisant : juger les causes par leurs effets encore sensibles, elle nous permet d’entrevoir, elle nous laisse deviner comment purent entrer en jeu des facultés qui avaient d’abord à , créer l’instrument sans lequel nous ne les concevons plus aujourd’hui; nous ressaisissons par ce moyen, au plus profond de notre âme et comme dans je ne sais quels lim-: bes, des forces qui se sont affaiblies et endormies peu à \ peu en nous, n’étant plus sollicitées à l’action. C’est donc j comme un livre perdu de l’histoire de notre espèce, que j retrouve la philologie comparée, qu’elle nous rend, dont elle tourne les feuillets devant les yeux qui savent s’ou-’ vrir et regarder.. • • . -
tl y a plus : mieux que l’anatomie et que toutes les : sciences qui se contentent d’examiner la forme extérieure de l’homme, l’étude des langues concourt avec celle des religions, des philosophies et des littératures à nous fournir les moyens de définir ces dispositions héréditaires, ces diversités innées et persistantes qu’on appelle aujour-
-
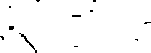
XX
AVANT-PROPOS.
d’hui la race. Le milieu où l’homme est plongé, les êtres extérieurs avec lesquels il entre en relation se révèlent à lui par des attributs variés et en nombre infini. C’est par
un de ces attributs, qui, à un certain moment, le frappe à
*
*
l’exclusion de tous les autres, que l'homme désigne les êtres pour se les rappeler à lui-même et pour les représenter à l’esprit de ses semblables ; comme le démontre à plusieurs reprises M. Max Müller par des exemples très-heureusement choisis, tous les substantifs, tous les noms de choses, ne sont à l’origine que des épithètes, que des adjectifs. Pourquoi, parmi toutes ces qualités sensibles qui se découvraient à l’intelligence de l’homme en affectant de diverses manières sa sensibilité, a-t-il adopté, afin de déterminer les êtres auxquels il les attribuait, tantôt celle-ci, tantôt celle-là, suivant. les lieux et les temps, c’est ce qu’il n’esl pas toujours aisé de dire ; mais, quoi qu’il en soit et quand même l’analyse devrait s’arrêter à ce terme, n’y a-t-il pas une première et éclatante révélation du génie d’une race, du caractère d’un peuple, dans la série des noms qu’il a donnés aux choses, c’est-à-dire dans ce que son idiome a.de plus ancien, de moins variable, de plus significatif et de plus transparent ? Chaque substantif, étant une épithète, traduit ainsi une impression primitive, et entre l’ensemble des impressions qu’expriment et que représentënt les mots dont se compose le dictionnaire d’une langue, on saisit un rapport évident, plus aisé pourtant à sentir qu’à définir: c’est une prédisposition marquée, chez le peuple qui a créé cette langue, à être plus vivement touché par tel aspect, par telles qua-
Jilés des choses que par telles autres, à regarder les objets sous un certain angle. De toutes ces impressions particulières, dont témoignent les mots qui en conservent le souvenir, se dégage une certaine conception générale du monde et de la vie qui ne s’exprimera nulle part plus naïvement et plus sincèrement que dans cette création spontanée, antérieure à toute réflexion, à toute réaction de la conscience, à toute influence individuelle et volontaire. Nous aurions perdu toute la littérature de l’Inde, de la Grèce et de l’Allemagne, nous ne posséderions que les vocabulaires du sanscrit, du grec et de l’allemand, que ces vocabulaires, feuilletés par la main d’un Jacob Grimrn ou d’un Max Müller, nous permettraient peu à peu de définir l’originalité de chacune des grandes races qui ont créé, parlé, écrit ces langues. Qui n’a vu une rose fanée et jaunie, si on la plonge dans certains gaz, redresser bientôt ses pétales et reprendre ses fraîches et vives couleurs ? Il en est ainsi de ces milliers de mots rangés àda file dans
ces gros volumes sur lesquels l’homme fait venge souvent
les rancunes de l’écolier paresseux, dans ces longues
pages dont la seule vue effraye et rebute une superficielle
* ,
frivolité; que le magicien, c’est-à-dire l’étymologiste appuyé sur la grammaire comparée, les touche avec sa baguette, soudain tous ces vieux mots se raniment, et les voici qui brillent de toute la rougeur des premières im-
i- ■
pressions, de tout le feu de ces regards émus que l’homme
■
encore enfant, tout étonné de vivre, promenait, il y a des milliers d’années, sur l’immense, changeante et féconde nature.. Laissez faire nos modernes historiens du langage,
b
et, d’ici a quelque temps, il. faudra chasser de l’usage un
ancien dicton qui, pour ma part, m’a souvent indigné ;
on ne dira plus ennuyeux, mais amusant comme un die.. +
tionnaire !
Ce que nous disons du vocabulaire et des racines qui sont comme la matière des mots dont se compose une langue, n’est pas moins vrai de la grammaire et des for^ mes que contiennent ses paradigmes. Il y a à faire là un travail analogue à celui dont lë lexique est l’objet, niais un travail plus difficile encore et plus délicat ; il s’agit de découvrir l’origine de ces terminaisons où la tradition de nos grammaires classiques nous dispose à ne voir en
- * ■ i -
général que des traductions conventionnelles d’idées
. - - ' C. . „ .
abstraites. Le philologue, suivant la route que M. Max Müller lui trace par l’analyse de quelques formes nominales et verbales, remontera donc; dans l’histoire dé la déclinaison et de la conjugaison, aux combinaisons les plus anciennes, à celles où les parties composantes se laissent le mieux distinguer luné de l’autre ; il s’appuiera sur des analogies empruntées à différentes familles de langues, et tel ou tel idiome, souvent le membre le plus humble et le plus oublié du groupe auquel il appartient, lui révélera le secret que lui auraient longtemps dérobé les grandes langues littéraires ; dans celles-ci, pour avoir plus vécu et avoir subi plus de vicissitudes et d’influences diverses, les mots ont souvent laissé leur physionomie s’altérer profondément. '
Quelque perçant d’ailleurs que soit l’œil de l’observateur, et quelque fine que soit la pointe de son scalpel,.
bien des formes résistent encore à cette espèce de dissec, * r '
lion, et il en est d’autres dont on n’a rendu compte que d’une manière très-conjecturale ; mais, dès maintenant, un assez grand nombre d’entre elles ont été expliquées pour que l’on soit en droit de conclure du connu à l’inconnu, et pour que l’on affirme sans crainte d’erreur qu’il n’y a point dans Je langage, d’élément qui n’ait autrefois vécu de sa vie propre, qui n’ait eu à l’origine sa
signification et sa valeur particulière. Ces lettre s formatives,
# ■
comme nous les appelons, dont l’addition au radical mai-.
■ _ t * •
que le cas, le nombre, le temps, la voix, la personne, etc., ce ne sont pas des signes algébriques, des exposants de rapports qui auraient été arbitrairement adoptés, comme cela s’est fait pour la notation et la langue technique des mathématiques ou de la chimie ; il faudrait supposer là une convention qui n’est possible qu entre des savants déjà munis d’un instrument, de.relation et bornant d’ailleurs leur effort à un ordre déterminé de phénomènes et d’idées. Non certes ; si c’est ainsi que la conjugaison.avait d.û être créée, elle serait encore à naître ! Dans chacune de
ces terminaisons, à y regarder de près, nous reconnais. " _j1j 1
sons une racine démonstrative,. comme dit SI. Max Millier, un mot'jadis indépendant, et qui, pendant un certain
temps, a joué par lui-même et à lui seul un rôle dans là
* , - + ' -
langue. Comme il fallait indiquer les différents rapports que conçoit notre.esprit, l’instinct créateur du langage se sera emparé tantôt d’un substantif d’une signification très-générale, -tantôt d'un pronom personnel, tantôt encore de l’un de ces verbes qui désignent une des manifestations
les plus simples de notre activité ; par un procédé dont la grammaire comparée retrouve la trace dans toutes les langues, et qu’elle peut même montrer encore aujourd’hui à l’œuvre, dans quelques-unes d’entre elles, le mot qui sert de déterminatif sera devenu comme l’appendice du mot qu’il déterminait en le précédant où le suivant ; c’est par cette juxtaposition que se seront formés ce que l’on appelle aujourd’hui préfixes, suffixes, terminaisons. Peu
* i
à peu, certains rapprochements ayant été consacrés par l’usage et étant devenus tout à fait habituels, la prononciation, et plus tard l’écriture, auront fini par fondre les deux mots en un seul, par les réunir en un corps. Par suite de différences de nature que nous devons nous borner à constater sans chercher à les expliquer, chez certains peuples, dans certaines, langues, cette incorporation aura été bien plus complète, bien plus intime que dans d’autres. Ainsi, dan.s les idiomes touraniens, dans le turc par exemple, le mot principal et le mot secondaire, le radical et la particule qui le détermine, semblent n’être rapprochés que par un simple trait d’union, comme deux pièces métalliques collées l’une à l’autre par une soudure à froid ; le regard aperçoit sans peine la ligne de suture, et une forte secousse suffit pour briser le lien et* disjoindre les deux métaux. Ailleurs au contraire, dans toute cette famille de langues à laquelle appartiennent le sanscrit, le grec et l’allemand, les deux éléments en question, la racine et ce qui est. devenu la terminaison, ont adhéré à la manière des tissus vivants que fait entrer en contact la main du jardinier ou du chirurgien ; c’a été comme une greffe tenace et féconde, ou comme une de ces cicatrisations qui se produisent, une fois l’épiderme enlevé, entre les surfaces mises à vif, là où aboutissent les filets nerveux, là où les vaisseaux capillaires apportent et répandent- les sucs plastiques. Cette action et réaction mutuelle modifie ordinairement les lettres que mettent en présence les hasards de ces rapprochements opérés par le langage. Ce n’est point assez : pour satisfaire à certaines conditions d’équilibre, à certaines exigences harmoniques dont il faut étudier la loi dans le sanscrit surtout, la qualité et le caractère tonique du mot secondaire, devenu l’aiïixe, influent sur le noyau et sur le cœur même du mot principal, sur le radical proprement dit. De là toutes ces modiff-
r
cations, si complexes à la fois et pourtant soumises à des lois si. régulières, que subissent les racines dans les langues à flexions ; de là le jeu si varié de la conjugaison sanscrite,. grecque, latine ou allemande, et l’admirable
variété des formes diverses que prend, dans chacun de
* *
ces nobles idiomes, un même thème verbal.
À ce titre, et ainsi comprise, la grammaire devient plus intéressante encore que le- dictionnaire ; elle irrite et satisfait encore plus cette curiosité qui nous pousse à jeter la sonde dans les mystères de notre propre intelligence, et à reprendre conscience du premier éveil et des premières démarches de notre pensée. Est-il rien de plus nouveau et de plus curieux que cette décomposition rétrospective des formes synthétiques dont nous nous servons encore après tant de milliers d’années, et que l’étude de cette espèce de chimie organique de la parole humaine ?
Là, dans cette combinaison des éléments primitifs d’où
# _ " , ■ ■
résulte ce que nous nommons la 'Grammaire, d’une langue. se marque dès le début, avec une singulière netteté, la
r '
différence des races ; une fois adoptés, les procédés que chaque race a choisis pour arriver à exprimer les rapports des êtres persistent, dans ce qu’ils ont d’essentiel, avec une merveilleuse fidélité ; un peuple change plus facilement de costumes, de régime politique, d’arts et de religion qu’il ne change de grammaire. Ainsi, quelque altération et diminution que la déclinaison et la conjugaison aient, subies dans nos langues modernes, ces langues vivent encore sur le fond créé par les antiques Ârvas, et il n’est point de combinaison inventée par ces lointains
ancêtres dont il ne reste quelque chose dans le français
" " 'L_ ‘r ’ - - _ _ . _ »
même et dans l’anglais. Le moule ample et profond ou ces pères de nos pères ont coulé leur pensée, nous l’avons aminci et comme ébréché en divers endroits ; nous n’avons pas encore réussi à le briser, et nous ne comprenons même pas comment ni par quoi nous saurions le remplacer.
L’attrait que présentent ces recherches, aucun livre ne le fait mieux comprendre que le bel ouvrage qui a mis le sceau à la renommée de M. Max Müiler, et qui a popularisé en Angleterre ses vues et ses découvertes. Comme le déclare, dès lè début, l’auteur lui-même, ce n’est point ici un exposé méthodique d’une science qui ne date que d’hier, et qui n’a pu résoudre encore tous les problèmes qu’elle a soulevés ; mais c’est une brillante introduction, bien faite, si nous ne nous trompons, pour séduire et
gagner à ces nobles études tant d'esprits jeunes et curieux qui cherchent leur voie. Seulement, on ne saurait le proclamer trop haut, que ceux qui se sentiraient tentés d’entrer dans ce chemin n’aillent point s’imaginer. qu’ils pourraient, sans danger, débuter par des rapprochements et des vues d’ènsemble comme celles qui les auraient frappés dans l’exposition de M. Max Müllerl 11 n’est pas de science où les généralisations précipitées soient plus à craindre qu’en grammaire comparée. Avant de se hasardera tracer une méthode et à nous ouvrir sur le passé dé si lointaines et si. curieuses perspectives, M. Mtiller a consacré de longues années à explorer en tout sens le vaste domaine des langues indo-européennes et des langues tourantenues ; il est. peu de travaux qui supposent une aussi minutieuse attention et une érudition aussi spéciale qüe les publications par lesquelles il a: fondé sa réputation et préludé à l’ouvrage que nous avons eu l’honneur de traduire les premiers en français.
Quant à cette. traduction, nous n’avons rien négligé pour qu’elle soit aus'si fidèle que possible (i); espérons que l’on y trouvera tout entier l’auteur de Y Essai cle mythologie comparée, avec cet heureux .mélange de qualités
souvent opposées que l’on a déjà signalé chez quelques
' r 1
autres des grands philologues de l’Allemagne. ChezM. Max Muller, comme chez son illustre compatriote Jacob Grimin,
' - - - ■ T ,
(i) La Table analytique est beaucoup plus complète que celte de l’édition anglaise, et facilitera singulièrement les recherches. On y trouvera notamment tous les mots expliqués cl les noms de tous les auteurs et.de tous les ouvrages cités dans le cours du livre. .
le savant du premier ordre, l’indianiste éminent, le laborieux éditeur de tant de textes inédits et d’une interprétation difficile, est doublé d’un poëte. Chez lui, par un rare privilège, une prodigieuse variété de lectures et la pratique d’une science où il faut compter les lettres et peser les accents n’ont rien enlevé à la vivacité et à l’éclat d’une imagination qui réussit, avec un don d’intuition vraiment merveilleux, à deviner, à nous rendre sensibles, à peindre dans leurs nuances les plus fines’ les sentiments et les idées de ceux que l’on peut appeler lés premiers hommes, des naïfs et.profonds créateurs du langage articulé.
Nous ne saurions terminer cet avertissement sans dire tout ce que nous devons aux encouragements et aux conseils d’un maître-dont on ne trouve, jamais ni l’obligeance ni l’érudition en défaut, M. Émile Egger. Au même titre, nous tenons à remercier un savant, M. Michel Bréal, qui paraît appelé à accréditer et à naturaliser enfin chez nous les études que représentent avec tant d’éclat, en Allemagne, les François Bopp, les Adalbert Kübn et tant d’autres, en Angleterre M. Max Millier. C’est pendant que M. Bréal traduisait le grand ouvrage de Bopp, sa G'ram-maire comparée des langues indo-européennes, c’est au milieu des fatigues de ce long et difficile labeur qu’il a bien voulu s’assujettir encore à revoir toutes les épreuves de la présente traduction, à nous aider de ses conseils,. à nous fournir plusieurs des notes que nous avons cru devoir ajouter à celles de M. Max Müller. Qu’il nous permette. donc de lui offrir le témoignage public d’un senti-
ment qui serait de la reconnaissance, si nous n’avions le droit de le nommer d’un autre nom, et de rappeler ici les souvenirs d’une vieille et chère camaraderie, d’une fidèle amitié ! ’ .
GEORGE PERROT.

Juin 1864.
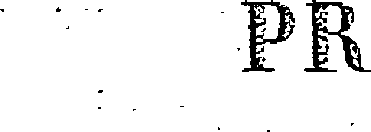
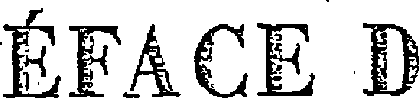
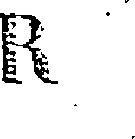
( PREMIÈRE ÉDITION )
; Je livre aujourd’hui au public mes Leçons sur la Science du Langage, telles que je les avais préparées en manus-. crit pour l'Institution royale de la Grande-Bretagne. Lorsque je vins à y faire mon cours, je dus nécessairement omettre une bonne partie de ce que j?avais écrit, et, en publiant ces Laçons, je cède bien volontiers au désir qui
j m’a été exprimé par un grand nombre de mes auditeurs.
| Sous leur forme actuelle, elles résument brièvement les
: cours de philologie comparée que j’ai donnés à différentes
Y " r
reprises à Oxford, et elles n’ont d’autre prétention que de servir d’introduction à une science qui est beaucoup trop ; vaste pour pouvoir être comprise dans un cadre aussi . étroit. .
Quoi qu’il en soit, mon but sera atteint si je suis assez heureux pour attirer l’attention, non-seulement des éru^ dits, mais encore des philosophes, des historiens et des théologiens, sur une science qui les intéresse tous, et qui,
tout en faisant profession de ne s’occuper que des mots, nous apprend qu’il y a dans les mots bien plus que né l’avait soupçonné d’abord notre philosophie. Nous croyons, dit Bacon, que notre raison est maîtresse de nos imots; mais il arrive aussi que les mots réagissent à leur tour sur notre intelligence. Verborum prœsligiœ et incantationes
c .
vim quamclam intelleclui faciv.nl> et impeium siuum (more Tartarorum sagitlaiionis) rétro in inlellectum, unde pro-fecla sunt> rétorquent (t).

De Àugmenlis scientiarium> lib.
Y, cap. iv.
La cinquième édition de mes Leçons sur la Science du ■Langage a été soigneusement revue, mais les traits principaux de l’ouvrage n’ont pas été altérés. J’ai ajouté quelques nouveaux faits qui me semblaient essentiels pour fortifier certains arguments, et j’ai laissé de côté ou changé tout ce qui n’était pas plus longtemps soutenable.
i - *
|Iais je n’ai pas essayé de- récrire aucune partie dé mes leçons, ni de leur donner la forme que je désirerais leur donner si j’avais maintenant à les écrire de nouveau après cinq années écoulées. '
Dans un ou deux cas seulement où ma pensée avait été évidemment mal comprise même par des critiques impartiaux, j’ai essayé de la rendre d’une manière plus claire ît plus précise. C’est ainsi que dans ma dernière leçon où ’avais à parler de l’origine des racines, j’avais cité J’opi-îion de feu M. le professeur Hevse de Berlin, mais je l’avais jamais eu l’intention de faire penser que j’avais
adopté celle opinion. Je la considérais comme un simple éclaircissement et rien de plus, et ne prétendais nullement en prendre la responsabilité.
Je ne songeais pas non plus à attacher aucun sens mystérieux à la définition purement préliminaire que j’ai donnée.des racines en les désignant sous lenom de types phonétiques. Je les aurais tout aussi bien appelées moules phonétiques ou sons typiques que types phonétiques, et tout ce que je souhaitais faire comprendre par cette expression, c’est que ces racines étaient comme des moules solides dans lesquels tous les mots étaient jetés, comme des caractères à vives arêtes dont on a tiré -d nombreux exemplaires ; car, en effet, chaque consonne e chaque voyelle y sont des éléments fixes, et par çonsé-quenl aucune étymologie n’est admissible si elle ne tient pas compte de chaque anneau de cette longue chaîne de métamorphoses qui rattache par exemple la racine sanscrit vid, connaître, à l’adverbe historiquement. C’est le caractère nettement déterminé de ces racines qui seul a donm un but précis aux recherches étymologiques ; c’était c< point caractéristique, ce que les racines ont de clairemen défini, que je .cherchais à bien faire saisir par mes audi teurs, en me servant du terme types phonétiques. Dans le, recherches étymologiques, il importe peu quelle opinioi nous avons sur l’origine des racines, aussi longtemps qu nous reconnaissons que, à l’exception d’un certain nom
bre d’expressions purement imitatives, tous les mots tel que nous les trouvons soit en sanscrit, soit en anglais encombrés de préfixes et de suffixes, et se décomposai
sous faction de la corruption phonétique, doivent être ramenés en dernier lieu, à l’aide de lois phonétiques définies, à ces formes premières que nous avons l’habitude de désigner sous le nom déracinés. Ces racines se dressent comme des barrières entre le chaos et la parole humaine pleinement développée, et peuvent seules prévenir la confusion et le désordre où l’on est tombé partout où l’on a voulu tirer les mots de l’imitation des sons de la nature ou des interjections.
Certes, je reconnais comme appartenant.a un ordre plus élevé l’intérêt qui conduit le philosophe' à rechercher la nature de ces types phonétiques, et qui l’engage à dépasser les étroites limites où la science du langage se renferme tant qu’elle veut rester une science positive. J’apprécie autant que personne les travaux de M. ’Wedg-wood et du Révérend F. W. Farraiy et leurs efforts pour
suivre les racines jusqu’aux interjections imitatives, jus-+ * ' qu’à ce qu’ils appellent les gestes vocaux. Je crois que
l’un et l’autre ont. répandu beaucoup de lumière sur un problème très-difficile, et, tant que leurs recherches se borneront à la genèse des racines, sans toucher à l’étymologie, c’est-à-dire à la fondation et à l’histoire des mots,
- i
M. Farrar sera pleinement en droit de me considérer non
' *
pas comme un adversaire, mais comme un neutre, sinon comme un allié. .
Sàùit-Ioes, Cornwall, 20 septembre 1866.



v
SIXIÈME EDITION)
Eu revoyant une fois de plus, en vue de l'impression, mes Leçons sur la Science du Langage, j’ai amplement profilé du secours et des conseils de mes nombreux critiques et correspondants. Mes leçons ayant élé réimprimées en Amérique et. traduites en allemand, en français, en italien et en russe, -le nombre de comptes rendus et d’essais dont. elles ont fourni la matière est devenu considérable ; elles ont même provoqué la naissance de plusieurs ouvrages spéciaux. Examiner tous ces écrits qui, de près ou de loin, se rapportaient à mon livre n’a point été une tâche aisée ni qui fût toujours agréable. Cependant j’ai bien rarement'lu un compte-rendu, sympathique ou non, sans qu’il me fournît les moyens de corriger une erreur,
ou sans me sentir appelé à éclaircir une phrase qui avait
_ « r
été mal comprise, à adoucir une expression qui avait
choqué, à insérer un fait nouveau, à*faire allusion à une
* -
théorie nouvelle. L’ensemble de mes vues sur la science
du langage n’a point changé ; mais, à lui seul, le nombre des pages montrera combien d’additions ont été faites, tandis qu’un lecteur attentif découvrira aisément combien de détails ont été changés dans ces leçons depuis le moment où elles ont été professées à l'Institution royale en t861 et -1863. J’ose espérer quelles n’ont point perdu à
ces changements.
Quoique j’aie déjà protesté, je dois protester encore contre une fausse interprétation de ma pensée qui a trouvé quelque crédit. On se rappelle la théorie sur l’origine du langage que j’ai expliquée à la fin de mon premier cours ; je l’ai très-nettement présentée comme appartenant au professeur Eeyse de Berlin : mais je n’ai point dit que je la fisse mienne en l’adoptant.-C’est une théorie qui, bien comprise,.contient quelque vérité, mais qui, tout en éclairant quelques-unes des données du problème, n’en offre pas ce que l’on peut appeler une vraie solution. Je me suis abstenu, dans mes leçons, de proposer aucune théorie sur l’origine du langage. C’est d’abord que, selon moi, la science du langage peut eu toute sûreté partir des racines comme défaits irréductibles, les derniers qu’il lui soit donné d’atteindre ; ce qui est au delà, elle le laissera au psychologue et au métaphysicien. C’est de plus que, selon moi, une théorie sur l’origine du langage ne petit être exposée à fond qu’à condition d’être étroitement rattachée à la théorie de l’origine de la pensée, c’est-à-dire des principes fondamentaux de la philosophie de l’esprit. En traitant de l’histoire de la science du langage, j’ai cru nécessaire d’examiner quelques-unes des théories par lesquelles on a essayé d’expliquer l’origine de la parole, et j’ai dû montrer combien, dans l’élat présent de notre science, elles étaient insuffisantes ; mais je me suis soigneusement abstenu de dépasser les limites que je m’étais tracées. On a beaucoup écrit, dans les dix dernières années, sur l’origine du langage; mais le seul écrivain qui
i jy *■
me paraisse avoir abordé ce problème dans un esprit indépendant et en même temps vraiment scientifique, c’est le DrBleek, dans son essai Über den Ursprung der Sprache (sur l’origine du langage), publié dans la colonie du Cap, en 4867. Je ne suis pas surpris que cet essai ait été reçu avec une faveur marquée par les plus éminents physiologistes; mais pourtant, si je ne me trompe, il laissera les' lecteurs tant soit peu philosophes fortement convaincus que les recherches sur l’origine du langage dépassent le domaine du physiologiste aussi bien que celui du philologue, et qu’elles exigent de qui prétend arriver à une solution, qu’il soit complètement maître des problèmes de la psychologie. En tout cas il semble aujourd’hui généralement admis que se contenter de faire revivre la théorie qui explique l’origine du langage par l’imitation; par l’onomatopée, ce serait un anachronisme
' ' ■ X '
dans l’histoire de notre science. Que M. Darwin, dans son séduisant ouvrage, Sur la- descendance de 'l’homme, incline vers la théorie de l’imitation, rien de plus naturel: et pourtant, ce'me semble, fût-il possible de ressusciter les théories de Démocritéel d’Epicure, le langage articulé, le langage où chaque mot a son sens propre, lé langage qui dérive, comme on l’a démonlréj mon pas des cris arrachés à la sensibilité, mais des racines, c’est-à-dire d’idées générales, , le langage resterait encore, ainsi que je l’ai dit dans mon premier cours, notre Rnbicon que ri osera franchir aucune bête.
Sur d’autres points, je pense que ceux qui m’ont fait l’honneur d’examiner soigneusement et de critiquer librement mes leçons trouveront qu’aucune de leurs remarques n’a été négligée. Je puis dire avec sincérité que là où j’ai maintenu mes propres opinions à l’encontre des objections .présentées par d’autres savants, je ne l’ai point fait sans y avoir soigneusement réfléchi. Dans quelques cas, mes critiques verront que j’ai abandonné des positions qu’ils avaient montré n’être plus défendables; ailleurs j’ai indiqué, par quelques courtes additions, que je m’attendais d’avance à leurs objections, et que j’étais en mesure d’v répondre ; ailleurs le fait que la rédaction n’a subi aucun changement suflit à indiquer que les objections m’ont paru futiles. Il est tels critiques, un peu trop pleins de confiance en eux-mêmes, auxquels i.1 eût été aisé de répondre, et j’avoue qu’il est parfois difficile de résister à cette tentation, surtout lorsqu’on se voit, blâmé, ce qui n’est point rare, pour avoir suivi Copernic plutôt que Ptolémée. ’OJhgaôetç quam sint insolentes non ignoras. Mais rien de plus stérile que la controverse, surtout que celle qui se poursuit en public. Je puis maintenant jeter mon regard en arrière sur vingt-cinq ans d’activité littéraire, et, quelque désappointement que je puisse éprou-*
ver en voyant combien peu a été fait et. combien plus reste encore à faire que je n’aurai probablement jamais le
'temps d’accomplir, au moins ai je cette satisfaction, que jamais je n’ai perdu une heure en polémiques personnelles. J’ai lutté contre les opinions, jamais contre les hommes qui les avaient, mises en avant. Si j’ai pesé avec soin toute réfutation sérieuse de mes doctrines, jamais je ne me suis arrêté à ce qui n’était que mots et assertions dénuées de preuves ; encore moins ai-je tenu compte des injures. . -
le premier volume (i), p. 253,
Peut-être me sera-t-il permis d’appeler -l'attention sur quelques-uns des plus importants parmi les passages où Je lecteur de cette nouvelle édition trouvera des renseignements nouveaux. Dans les détails donnés sur le rapport du pehlvi au zend ont été: remaniés d’après les nouveaux résultats qui ont été obtenus au moyen d’une étude plus attentive des
textes et des inscriptions pehlois. Dans le second vo-
- + ■ * .
lüme (2), la question de l’origine du participe en ing a rëçii plus de développement. Page 33, on trouvera une lettre intéressante deM, Stanislas Julien sur les pronoms de cè
(J) Dans l'édition anglaise, les premières et les secondes leçons sur la Science du Langage, celles de 1861 et celles de 1863, ne forment pins qu’un ouvrage en deux volumes et ne se séparent point. [Tr.j . .
(2) Nous espérons donner bientôt une nouvelle édition de la traduction française des secondes leçons, où seront comprises ces additions et corrections de la sixième édiLion anglaise. En attendant, nous n'avons pas voulu omettre ces indications. Ceux qui se servent de L’édition française seront au moins ainsi avertis des end roi Ls où
M. Max Müller a cru devoir ajouter ou corriger quelque chose à sa pensée première et pourront, au. besoin, recourir au texte an-* glais. [Tr.j .
rémonie en chinois. L’anaïvse et la classification des voyelles et des consonnes ont été soigneusement révisées de manière à mettre toute cette théorie au courant des plus récentes recherches sur ce sujet si curieux. Pages i39-444, on trouvera ma réponse à l’important essai du professeur Czermak, liber den spirilus asper und Unis. L’affirmation à laquelle il est arrivé par ses propres recherches (4), que les émissions de souffle (les sifflantes, etc.), subdivisées, exactement comme les arrêts de souffle (les mulœ), en douces et en dures, montrera que la division que j’avais moi-même adoptée pour ces sons n’était pas sans fondement, tandis que l'expérience instituée par lui (p. 159 et 160, éd. anglaise) explique et, dans une certaine mesure, justifie l’emploi des termes dur et doux à côté de sourd et de sonnant. (2) ..... ’
(1) Page 143, oote 79 de l’édition anglaise. .
(2) Comme spécimen des critiques présomptueuses et étourdies auxquelles j’ai fait allusion plus haut, je cite quelques extraits de la Norlk American Review, qui, si je ne me trompe, est à beaucoup d’égards une des meilleures revues de l’Amérique : « On doit surtout réjeter la théorie que donne le professeur Max Muller du spirilus asper et du spirilus lenis, ainsi que son explication de la différence qui distingue des sons tels que v, b, d’une part, et, de l’autre, s, /, p Nous avons le droit de nous étonner que, pour ces deux classes de lettres, il reprenne les vieux termes doux et dur, qui commençaient heureusement, depuis quelque temps, à tomber en dcsuéLude, et qu’il adopte pleinement la distinction que ces termes impliquent, quoique il ait été prouvé plus d’une fois qu’elle n’était point fondée, et que la différence des deux groupes consiste dans l’intonation ou la. non intonation du souffle pendaul l’émission de ces sons. C’est en vain que, pour défendre sa théorie, il en appelle aux grammairiens de l’Inde; ils sont unanimes contre lui; pas un d’entre eux qui ne sache reconnaître et définir correctement la
Dans la cinquième leçon sur la loi de Grimm, j’ai tenté de rendre plus claire encore mon explication-des causes dont le jeu rend raison de cette loi, et j’ai répondu à quelques objections sérieuses qui avaient été faites à ma théorie, notamment à celle qui était fondée sur les changements, constatés par l’iiisloire, qu’ont subis les noms de certaines localités, changements coraraeStrataburgum et Straspuruc. Mes étymologies de Earl, Graf, et King, qui avaient été attaquées, ont été défendues (pp. 280, différence qui sépare les lettres sonnantes et les lettres sourdes. » Je ne puis en vouloir à un rédacteur de la Nortk American Review pour ignorer que j'ai moi-même, rompu des lances contre la terminologie qu'il critique, que j’ai signalé comme non-scientifique (unwissenschaftlich) l'emploi de ces expressions, consonnes dures, consonnes douces, et que j'ai été l’un des premiers à publier et à traduire en i 856, la classification plus scientifique que fournit le Rigveda •prâtisàkhjm , la division en consonnes sourdes et consonnes sonnantes. Mais le rédacteur aurait pu tout au moins lire la leçon dont il a donné un compte-rendu; il y aurait lu ce passage : « La distinction qui, par rapport à l’aspiration ou à l’esprit élémentaire, est d’ordinaire marquée par les termes asper et lenis, répond à celle qui, pour d’autres lettres, est désignée par les termes dur et doux, sourd et sonnant, lenuis et media. »
On lit dans la même revue : « C’est, croyons-nous, une erreur évidente que , la définition donnée du wh dans tohen. où M. Max Millier le regarde comme une simple contre-partie 'murmurée de iv dans wen au lieu d’un w avec une aspiration qui le précède. » Sur une question qui concerne la prononciation correcte de l’anglais, il pourrait sembler impertinent de ma part de ne pas m’incliner devant l’autorité de la JS1ortfi American Review. Pourtant le rédacteur de l’article aurait pu soupçonner que sur un tel point un étranger n’avait pas dù écrire au hasard. S'il avait consulté ceux qui font vraiment autorité en matière de phonéLique en Angleterre et, je crois, aussi en Amérique, il aurait reconnu que ces auteurs sont d’accord avec moi dans la description que j’ai donnée des deux sons et wk. Voyez Lectures, 1.11, p. 448, note 55.
28-1 et 284) et lu question de savoir si le-digamma initial dans le nom d’Hélène rend impossible la comparaison entre Helena et Saramâ a été pleinement discutée p, 516 et suivantes.
En dernier lieu, je désire appeler l'attention sur une lettre dont m’a honoré M. Gladstone (l. n, pp. 440-444) et où ses opinions sur les éléments constituants de la mythologie, grecque, que je n’avais pas tout à fait saisies, sont exposées avec une grande précision. .
Oxford, Avril 1871.
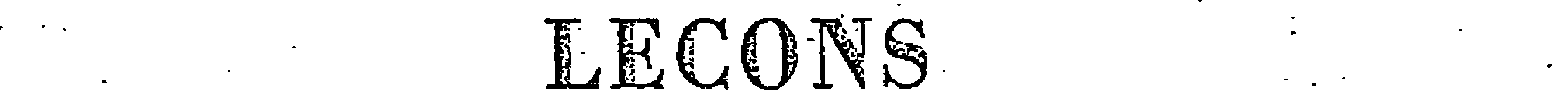
SUR LA
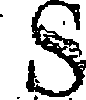

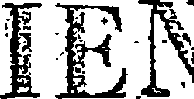
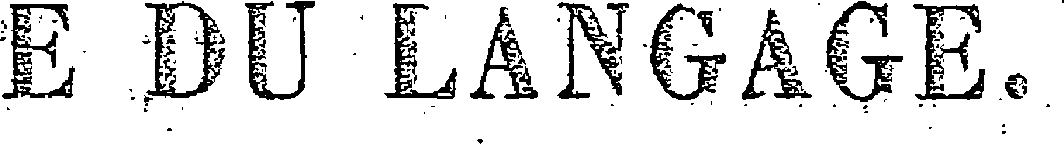

D
A QUEL ORDRE DE SCIENCES APPARTIENT LA SCIENCE
DU LANGAGE. . . '
Importance de la science du langage. Sa date récente : les noms divers qui lui ont été donnés : philologie comparée, étymologie scientifique, linguistique, phonologie, glossologie. — Coup d’œil jeté sur l'histoire des J sciences inductives : Trois périodes dans cette histoire; période èmpi-rique, période de la classification, période de la théorie. — Période empirique. — Humbles débuts des différentes sciences : de la géométrie ; de la botanique; de l’astronomie; étymologie du mot anglais moon; des mots Pléiades ou Vergiliæ, Hyades oyrPluviæ. — Nécessité pour les sciences de rendre des services pratiques. — La mythologie. Etymologie de Eos, Titlionos, Fatum, Z eus, Luna, Lucina, Hecaie, Pyrrha, — Le. langage élève une barrière infranchissable entre l’homme :et;les bêtes..—: La classification dans lès sciences. — Rôle de l’imugi-nationet.de la divination dans le progrès de la science : Copernic,v Kepler.- r— La théorie. — Deux grandes, divisions des connaissances humaines : les sciences de la nature, qui traitent des œuvres de Dieu ; tes sciences historiques, qui traitent des œuvres de l’homme. -^ Distinction profonde entre la philologie proprement dite, et la philologie comparée .ou linguistique. Origine du nom Je .philologie comparée. —
• Le langage étant l’œuvre de. la nature, et non une invention de Ihommè, la philologie comparée doit être rangée parmi les sciences
que nous avons appelées sciences de la nature, — Nécessité d’étudier la science qui /ait l'objet de ce cours dans les trois périodes déjà énumérées, la période empirique, celle de la classification, et celle de la théorie.
Quand on m’a demandé, il y a quelque temps, de donner, devant le public qui fréquente les cpurs de cette Institution, une série de leçons sur la Philologie comparée, je me suis empressé de me rendre à ce désir (t). J’étais convaincu que les recherches qui ont été faites depuis cinquante ans en Ânglèterre, en France et en Allemagne, sur l’histoire des langues et la nature du langage, méritaient d’attirer plus d’attention et de rencontrer plus de-sympathie qu’elles n’en ont obtenu jusqu’ici ; et, autant que je pouvais en juger, .il me semblait que les résultats obtenus dans cette nouvelle mine de la science ne le cédaient en rien, ni pour la nouveauté, ni pour l’importance, aux plus brillantes découvertes de notre époque. Ce n’est qu’après avoir commencé à écrire mes leçons que je connus toutes les difficultés de la tâche que je m’étais imposée. La science du langage est si vaste, qu’on ne peut guère, en neuf leçons, en donner plus qu’un exposé fort sommaire; et, comme un des plus grands charmes de la philologie comparée consiste dans l’analyse
(1) L'Institution royale de la. Grande-Bretagne est une sorte d’Athénée où sont professés des cours sur toute espèce de sujets, mais surtout des cours de sciences naturelles. Fondé par Georges IV, il y a plus de trente ans, cet établissement réunit un auditoire très-choisi et très-sérieux. Les savants les plus distingués en tout genre y sont appelés tour à tour pour y exposer devant un public bienveillant, mais fort bon juge, le résumé de leurs travaux et de leurs théories. C’est à ce public que sont adressées les neuf leçons qui composent l’ouvrage de M. îîax Müüer. (Rote de M. Barthélemy Saint-Hilaire aux trois remarquables articles où il rend compte, dans le Journal des Savants, de l’ouvrage dont nous offrons aujourd’hui la traduction au public ; les articles sout de juillet, septembre et octobre 1862.) minutieuse de chaque dialecte, de chaque mot et de çha-que forme grammaticale, je sentis qu’il me serait presque impossible de ne point rester au-dessous de mon sujet, et de mettre dans tout leur jour les travaux de ceux qui ont créé et fait grandir cette science. Une autre difficulté vient de l’aridité de beaucoup des questions que j’aurai à discuter. Les déclinaisons et les conjugaisons, ne peuvent guère être rendues amusantes, et je ne puis profiter des avantages qu’ont d’autres professeurs qui animent leurs cours par des expériences et des figures. Si, nonobstant ces difficultés et ces désavantages, je me décide à commencer aujourd’hui ces leçons sur les mots, sur les verbes, les noms et les particules ; si j’ose m’adresser à un auditoire accoutumé à écouter, dans ce lieu'même, les récits merveilleux du physicien, du chimiste et du géologue, et à voir les derniers résultats des sciences inductives revêtus par l'éloquence de tous les charmes de l’imagination et de la poésie, c’est que, tout en me défiant de moi-même, j’ai une entière confiance en mon.sujet. Il peut être pénible pour l’écolier d’étudier les mots, comme pour le cantonnier de casser les pierres sur les chemins ; mais, pour l’œil attentif du géologue, ces pierres sont pleines d’intérêt : il voit des prodiges sur la grande route, et. dans chaque tranchée, il lit une page d’histoire. Le langage a également ses merveilles qui lui sont propres, et qu’il révèle aux regards scrutateurs du travailleur laborieux : il y a des fastes cachés sous sa surface, et chaque mot contient un enseignement. On a dit que c’est un sol sacré, parce que c’est le dépôt de la pensée. Nous ne pouvons encore déterminer ce qu’est le langage ; ce peut être l’œuvre de la nature, une invention de l’art humain ou un don céleste ; mais, à quelque sphère qu’il appartienne, rien ne semble le surpasser ni même l’égaler. Si c’est une création de la nature, c’est son
chef-d’œuvre, le couronnement de tout le reste, qu’elle a réservé pour l’homme seul ; si c’est une invention artificielle de l’esprit humain,. elle semblerait élever l’inventeur presque au niveau d’un divin créateur; si c’est untlon de Dieu, c’est son plus grand don, car par là Dieu a parlé à l’homme, et l’homme parle à Dieu dans la méditation, la prière et l’adoration. .
Quelque longue et pénible que soit la route qui s’ouvre devant nous, le but auquel elle mène semble digne de tout notre intérêt ; et je crois pouvoir vous promettre que le tableau qui se déroulera devant nos yeux, quand nous serons arrivés au sommet de notre science, dédommagera amplement de leurs fatigues les voyageurs patients, et vous décidera peut-être à excuser la hardiesse de celui qui a osé entreprendre de vous servir de guide.
La science du langage est de date très-récente : elle né remonte pas beaucoup au-delà du commencement de notre siècle, et les autres sciences, ses sœurs aînées, -l’admettent à peine sur un pied d’égalité. Son nom même est encore indéterminé, et les dénominations diverses qu’elle a reçues en Angleterre, en France et en Allemagne, sont si vagues et si mobiles quelles ont donné lieu-, dans le public, aux idées les plus confuses sur fes sujets réels de cette nouvelle science. Itou s l’entendons appeler la -Philologie comparée, YElymoiogie scientifique, la Phonologie et la G-lossologie. En France, elle est connue sous le nom commode, mais un peu barbare, de Linguistique. -Sri nous faut absolument une dénomination grecque, nous pourrions la tirer soit de myihos, mot, soit'de logos, discours : mais mythologie a déjà son acception particulière,, et logologie choquerait trop les oreilles classiques. Il est inutile, d'ailleurs, de perdre notre temps à faire la critique de ces. noms, aucun d’eux n’ayant ^encore reçu-celte
PREMIERE LEÇON. 5
’ £
sanction universelle qui a été donnée à ceux des autres
sciences modernes, comme la Géologie et VAnatomie com* . t
parée; et il n’y aura pas grande difficulté à trouver un nom pour notre jeune science, aussitôt que nous en aurons constaté l’origine, la parenté et le caractère. Pour ma part, j:e préfère la simple désignation de Science du langage, bien que, dans ce siècle de titres sonores, ce nom modeste n’ait guère chance d’être généralement accepté.
Du nom, nous passons maintenant au sujet de notre science; mais, avant d’en donner une définition, et de tracer la méthode à suivre dans nos recherches, il sera utile de jeter un regard, sur l’histoire des autres sciences, parmi lesquelles la nôtre vient, pour la première fois, réclamer sa place, et d’examiner leur origine, leur développement graduel et enfin la manière dont- elles se sont définitivement constituées. L’histoire d’une science en est, pour ainsi dire, la biographie, et, comme l'expérience
la-moins coûteuse est celle que nous acquérons en étu-
, * .■
diaht la vie des autres, nous ferons bien de tâcher de préserver notre jeune science de quelques-unes des folies et des excès inséparables de la jeunesse, en profitant des leçons que d’autres ont payées plus chèremenL Il y a une certaine uniformité dans l’histoire dë la plupart des sciences. Si nous lisons des ouvrages comme Y Histoire des sciences inductives, de Whewell, ouïe Cosmos, de Humboldt, nous trouvons que l’origine, le développement et les causes de prospérité ou d’insuccès ont été les mêmes pour presque toutes les branches des connaissances humaines: il y a,.pour chacune, trois périodes ou âges bien distincts, que nous appellerons la période de Yempirisme, celle de la classification et celle dé la théorie. Quelque peu flatteur que ce soit a dire, nous pouvons faire remonter toutes les sciences, qui portent aujourd’hui des noms si beaux, aux occupations les plus humbles et. les
6 LEÇONS SUR LA. SCIENCE DU LANGAGE.
O
plus vulgaires de tribus demi-sauvages. Ce n’est pas par l’amour du vrai, du bien et du beau, que les premiers philosophes ont été poussés aux profondes recherchés et aux découvertes hardies. Les fondements des plus nobles édifices que le génie de l'homme devait élever dans les siècles à venir ont été jetés par les besoins impérieux d’une société patriarcale et presque barbare. Les noms mêmes de plusieurs des plus anciennes sciences nous en montrent le point de départ: la géométrie se proclame maintenant affranchie de toutes les impressions des sens, et envisage ses points, ses lignes et ses plans, comme des conceptions purement idéales qui ne doivent pas être confondues avec leurs représentations grossières et imparfaites qui frappent nos yeux sur le papier.; mais, comme Linéique son nom, dérivé de <70, terre, sol, etdeme£mi, mesure, elle a commencé par mesurer un champ ou un jardin. La botanique, la science des plantes, était originairement la science de botanè, qui ne signifie pas en grec plante en général, mais herbe, fourrage, de boskein, nourrir : la science des plantes eût été appelée phytoiogîe, de phyton, plante (4). Les inventeurs de l’astronomie n’ont été ni les poêles ni les philosophes, mais les marins et lès laboureurs. Les premiers poêles ont pu admirer le choeur.des planètes et ses gracieux entrelacements ; les philosophes ont pu spéculer sur les harmonies des cieux ; mais c’était pour le marin seul que la connaissance de ces guides qui brillent au firmament devenait une question de vie et de mort. C’est lui qui calcula leur lever et leur coucher avec l’exactitude d’un commerçant, et la sagacité d’un explorateur de régions inconnues ; et les noms que portaient les astres et les constellations montrent clairement qu’ils furent donnés par-ceux qui sillonnaient les
, ■ .4
(1) Voyez Jessen, Was hcisst Bolanik ? 1861.
flots et la terre. La lune, par exemple, qui se détache comme une aiguille éclatante sur le sombre cadran du ciel, était appelée par les premiers pères de la race aryenne, l’astre qui mesure, le mesureur du temps ; car le temps a été compté par les nuits, les lunes et les hivers, avant de l’être par les jours, les soleils et les années. Moon, le mot anglais pour lune, est très-ancien (1) : c’était môna en anglo-saxon, où ce nom était du masculin, ainsi que dans toutes les langues teutoniqués ; ce n’est que par imitation des langues classiques qu’on afait??îoo?i du féminin et sun du masculin, et Harris n’a pas été fort heureux quand il a avancé, dans son Hermès, que, chez tous les peuples, le soleil est du masculin, et la lune du féminin (2)1 Dans la mythologie de l’Edda Mâni, la lune, est le fils,
— . -— . — t ■ ■ ■ — ^ ■ .
Sôl, le soleil, la fille de Hundüfori. En gothique, mena, la lune, est du masculin, sunnâ, le soleil, du féminin. En anglo-saxon, aussi, le mot mena, ja lune, continue à être
employé comme masculin ; suivie est encore féminin
' ' , • *
dans Chaucer. En suédois, mane, la lune, est masculin,
i ■«
sol,de soleil, est féminin. Les Lithuaniens prêtent aussi le
O . ,
genre masculin à la lune, menu, le genre féminin au soleil, saule, et, en sanscrit, quoique le soleil soit ordinairement regardé comme une puissance mâle, les noms de la lune les plus souvent employés, tels que Eandra, Soma,
Indu, Yidhu, sont masculins. Les noms de la lune sont
T * ' ' -
souvent employés dans le sens de mois, et ceux-ci, comme
(1.) Kuhn, Zeitschrift fur .vergleichende Sprachforschung, t. IX, p. 404. Dans l’Edda ta lune est appelée drtali. celle qui compte les années. Un des noms que porte en basque la lune, c’est argi-izari, « mesure par la. lumière. » V. Dissertation critique et apologétique sur la langue basque, p. 28. ,
(2) Horne Tooke, p. 27 ,mte. — Pott, S tudieu zur grieschischen Mythologie, 4859, p. 304. — Grimm, Deutsche Grammatik, III, p. 349. Bleek, Ueber den Vrsprung der Sprache, p. xvm (Kaps-ladl, 1867). .
, r •■■■■■_ ■*“ T
lès autres termes employés pour désigner lé mois, gardent lé même genre. Pour mois, nous avons, en anglo-saxon, mônâdh, èt en gothique inehoüi, tous deux du masculin . En grée, mèn, riiois, et l’iônien, meis} sont toujours du masculin' ; éri latin, nous trouvons le dérivé mensis, et en sânscrit, mas, luné, et mas a, mois, qui. sont tous du masculin (i). Ce sanscrit mas vient évidemment de la racine mâ, mesurer: je mesure se dit en sanscrit mâ^ mi, tu mesures mâ-si, il mesure mâ-ti oumi-mî-té, ét un instrument de mesurage mâ-tram, lé grec metfon, notre mètre, Si la luné était appelée primitivement le mesureur des jours, dés semaines et des saisons, le régulateur des fêtes èt des marées, et le héraut des assemblées publiques, il était tout naturel que cet astre fût envisagé comme un être viril, et non pas comme la rêveuse jeune bile que la poésie moderne à mise à la place de l’antique conception de nos pères. ; '
C’était lé marin qui, avant de confier sa vie et sa fortune aux venté et aux vagues, attendait le lever dé ces étoiles qu’il appelait les étoiles de la navigation ou Pléiades, de plein, naviguer. La navigation dans les eaux grecques était regardée comme sûre après le retour dès Pléiades, èt elle cessait quand elles disparaissaient. Le nom latin des Pléiades est Yergiliœ, de virgd, poussé ou petite branche. Ce nom leur fut donné par les cultivateurs italiens; parce qu’en Italie, où elles devenaient visibles, vers lé mois de mai, elles marquaient le retour de l’été (2). Une autre constellation, les sept étoiles placées Sur le front du
(1) Voyez Gurtius, Griëéhische Etymologie, rt° 471.. •
(2) Ideler, Handbueh der Chronologie, lib. i, sec. 241, 242. EL F. Perthes, Die Plejctdèn, p. 14, note. — ■ Daus Piiiscriptib'n ;osque d’Agnone, se rencontre un Jupiter Yirgarius (djovei verehasioi, dat. singd; nom que M. Àüfrecht rapproche dé Jupiter Viininius, Jupiter qui protège les jeunes pousses. (Kuhn, Zeitschrift, i, p. 89.) —
t !
Tàureaii, reçut le nom de Hyàdes (en latin Pluviæ), parcè que, quand elle se -levait avec le soleil, on croyait quelle annonçait la pluie. ‘
L’astronome a conservé ces noms et bien d’autres ; il parle encore des pôles du ciel* des étoiles errantes ou fixés; mais il oublie trop facilement que ces termes n’étaient pas lé résultat d’observations et de classifications scientifiques, mais dés emprunts à la langue de ceux qui erraient eux-mêmes sur la mer ou dans le désert, et pour qui les étoiles fixes étaient bien réellement ce que leur nom implique, des étoiles fixées au ciel et immobiles, auxquelles ils pouvaient s’attacher sur l’océan comme à dés ancres célestes (1).
& ■
Mais bien que, historiquement parlant, nous ayons le droit de dire que le premier géomètre fut un laboureur* le premier botaniste un jardinier, et le premier minéralogiste un mineur, on pourra nous objecter avec raison que-, dans cet état primitif, une science ne mérite pas ce nom, que le mesurage d’un champ n’est pas la géométrie, que la culture des légumes est bien loin d’être la botanique,
^ -V ■ t
ét qü’un boucher n’a aucun droit au titre d’anatomiste. Cette Objection est parfaitement fondée ; jl est bon cependant de rappeler à chaque science ses humbles débuts et lès besoins pratiques que, dans l’origine, elle était destinées satisfaire. Une science doit être, pour me servir de l’expres-
Voyez, cependant, sur Jupiter Viminius et ses autels, près de la Porta Viminalis, lïarlung,* Religion ,der Rômer, n, 61. Les Zoulous appellent les Pléiades les isUiméla, les étoiles du bêchage, parce que, lorsqu’elles paraissent, on commence à bêcher. Voyez Ca-laway, le Système religieux des Amazulu, partie III, p. 397.
(1) Dès le temps d’Anaximène de l’école ionique, et d’Àlcm'éon le pythagoricien, les étoiles avaient été divisées en errantes (aerr-pa i&a-vtüf/Æva, ou TiXavrjTa) et non errantes (d'ïdvaveîç dcTfpsç, ou dTtXavîj aaTpa). Aristote, le' premier, employa la dénomination derrpoe iv.oeos-txfva, ou étoiles fixes. fVOÿez ïïuftïboldt, Cosmos t vol. Ilï, p. 28.) îloXoç, c'est le pivot ou le pôle du ciel. •
. t
sion de Bacon, un riche magasin pour servir à la gloire de Dieu et au' bien-être de l’homme: et, quoiqu’il semble que, dans notre civilisation avancée, les personnes studieuses puissent consacrer leur- temps à l’investigation des faits et des Lois de la nature, ou à la contemplation des mystères du monde de la pensée, sans songer aux résultats pratiques de leurs, travaux, il ne faut pas oublier qu’aucune science et aucun art n’ont longtemps prospéré et fleuri dans le monde, à moins de servir d’une façon ou d’une autre les intérêts matériels de la société. Il est vrai que le botaniste recueille et arrange, que le physicien pèse et analyse, que l’anatomiste dissèque et compare, que l’astronome observe et calcule, sans qu’aucun d’eux pense au résultat immédiat et appréciable de ses labeurs ;
mais il y a un intérêt générai qui soutient et anime leurs
► ,
recherches à tous, et cet intérêt repose sur les avantages pratiques que la société tire de leurs études scientifiques. Qu’il soit prouvé que la succession des couches terrestres, telle que la comprend et l’expose le géologue, ne sert qu’à égarer le mineur ; que les tables astronomiques
t *
ne sont d’aucune utilité pour le navigateur ; que la chimie n’est qu’un amusement coûteux, inutile au fabricant et à l’agriculteur, et l’astronomie, la chimie et la géologie ne tarderont pas à partager le sort de l’alchimie et de l’astrologie. Tant que la science égyptienne entretint les espérances du malade et de l’infirme par des prescriptions mystérieuses (et je ferai observer en passant que Cham-pollion a fait remonter les signes hiéroglyphiques de nos prescriptions modernes aux véritables hiéroglyphes ' de
N
l’Egypte) (4), et tant quelle excita l’avidité de ses protecteurs par la promesse de la découverte de l’or, elle ren-
(4) Bunsen, Egyptens Stellung in-.der WeUgeschichte, vol. IV, p. 408.
contra des encouragements généreux à la cour des princes
'
et sous le toit des monastères ; mais si l’alchimie n’a pas trouvé-l’or, elle a préparé la voie à des découvertes beaucoup plus précieuses. Il en est de même pour l'astrologie, qui n’a pas été seulement une grossière imposture, comme on le suppose généralement : elle passait pour une science aux yeux d’un savant aussi profond et aussi sage que Mélanchthon, et même Bacon lui assigne sa place parmi les connaissances humaines, tout en admettant « quelle s’adresse à l’imagination de l’homme plutôt ,qu’à sa raison ». Bien après la condamnation que Luther prononça
■ . j- _ " ■
contre elle, l’astrologie continua à influer sur les destinées de l’Europe, et cent ans plus tard l’astrologue était encore le conseiller des princes et des généraux,tandis que le fondateur de l’astronomie moderne mourait dans la pauvreté et dans le désespoir. De notre temps, les rudiments mêmes de l’astrologie sont perdus et oubliés (1). Même des arts pratiques s’éteignent. dès qu’ils cessent d’être utiles, et leurs secrets disparaissent, quelquefois
pour toujours. Quand, après la réforme, les églises furent
■ • ” .
dépouillées de leurs ornements artistiques, afin de rappeler, jusque dans la forme extérieure, la simplicité des premiers temps du christianisme, les-teintes, des vitraux peints commencèrent à se ternir, et . n’ont jamais repris leur ancienne vivacité et leur ancienne harmonie. L’in-
(1) D’après un écrivain, dans Notes and Q urnes, 2e série, vol. X, p. £00, l’astrologie n’a pas disparu aussi entièrement qu’on le suppose. « Un de nos principaux auteurs, dit-il, un de nos premiers avocats, et plusieurs membres des différentes sociétés d’antiquaires, .sont, à Pheüre qu’il est, d’habiles astrologues : mais aucun d’eux ne se soucie de laisser connaître ses études, tant sont profondément enracinés les préjugés qui confondent avec le jargon des diseurs de bonne aventure un art qui demande, la plus haute instruction. » Voyez aussi H. Phillips, fils, Medicine and Astrology, un article lu devant la Société des Antiquaires et Numismatistes de Philadelphie, le 7 juin 1866. ' ' _ . •
vention de l’imprimerie à été le coup de mort pour l’art; des lettres historiées et pour la peinture en miniature appliquée à l’eiiluminure des manuscrits ; el les 'meilleurs artistes de notre époque désespèrent d’égaler la perfection, la délicatesse et -l’éclat que savait réunir l’humble pinceau qui ornait les missels du moyen âge.
l’insiste un peu sur la nécessité pour toutes les sciences d’avoir un objet pratique, car je sais que la science du langage n’a pas beaucoup à offrir à l’esprit positif de notre siècle. Elle ne fait, pas profession de nous aidera apprendre les langues plus promptement, et elle ne nous donne aucun espoir de voir jamais se réaliser le rêve d’une langue universelle : elle veut seulement nous faire connaître la nature du langage, ce qui semble suffire à peine pour concilier à une science naissante.la sympathie et la faveur du public. Il y a, cependant, dès problèmes qui, bienqu abstraits et purement spéculatifs en apparence,
ont exercé une grande influence, soit en bien, soit en mal,
, *
sur l’histoire de l'humanité. Avant nous les hommes ont
; _ fr . ’
déjà combattu pour une idée, et ont donné leur vie pour un. mot’; et beaucoup de ces problèmes qui ont agité le monde depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos joürs appartiennent proprement à la science d.u langage.
j t r
La mythologie, ce fléau dé l’antiquité, est en réalité une
maladie du langage. Ün mythe signifie un mot, mais Un
t , * '
mot qui n’était d’abord qu’un nom ou un attribut, et auquel on a laissé prendre ensuite une existënce plus substantielle. La plupart des divinités grecques, romaines, indiennes et autres ne sont que des noms poétiques, auxquels on a laissé prendre graduellement une personnalité divine qui n’avait jamais été dans la pensée de leurs premiers inventeurs. Eos était un nom de l’aurore, avant de devenir une déesse, femme de Tithonos, le jour expirant . Fatum, la. fatalité, signifiait primitivement ce qui a été.
* PREMIÈRE LEÇON. 4 3
E - ' ■
5 dit ; et, avant que la fatalité devînt une puissance supé-; rieure au maître des dieux lui-même, ce mot signifiait ce \ qui a été dit par Jupiter, et que Jupiter même ne pouvait i jamais changer. Z eus signifiait dans l’origine. le ciel bril-! lant, en sanscrit Dyaus ; et beaucoup des récits dont il est le héros chez les poètes ne peuvent s’expliquer que si . on les rapporte au ciel brillant, dont les rayons, comme : une pluie d’or, tombent sur le. sein de la terre, la Danaé
f antique, retenue par son père dans la sombre prison de l’hiver. Personne ne doute que Luna, pour Losna, origi-
, ' ta " ^
I nairement Louzna, ne fût simplement un nom de la lune.;
mais cela est également vraide Lucina, et les deux noms ; sont dérivés de lucere, briller. Becate était aussi un ancien ■ nom de la lune, et le féminin de Hekatos et Hekatebolos, le soleil qui darde au loin ses traits.; Pyrrha, l’Ève des Grecs, n’était qu’un nom de la terre rouge, qui s’appliquait tout particulièrement au sol de la Théssaiie. Cette maladie mythologique, si l’on peut ainsi parler des mots, quoique moins violente dans les langues modernes, est loin d’avoir complètement disparu (1). ‘ .
'■ Pendant le moyen âge, la lutte entre le nominalisme et | le réalisme, qui agita l’Eglise pendant des siècles, et qui
r ' 1 .
| finit par préparer les voies à la.réforme, était aussi,
! comme les noms mêmes l’indiquent, une controverse sur les noms, sur la nature du langage, et sur la relation entre les mots et nos conceptions d’un côté, et les réalités du monde extérieur, de l’autre. On qualifiait d’hérétiques des hommes qui croyaient que des mots comme justice et vérité n’expriment que des conceptions de notre esprit et non pas des êtres réels existant au grand jour.
Dans les temps modernes on en a appelé à la science t .
la Science du Langage, deuxième série,
(1) Voyez Leçons sur 4:2? leçon. • :
14 LEÇONS SUR LA SCIENCE DU LANGAGE.
O
duîangage, pour décider quelques-unes des questions politiques et sociales les plus compliquées. «Les nations et les langues contre les dynasties et les traités, » voilà ce qui a refait, et ce qui refera encore la carte de l’Europe ; et en Amérique on a encouragé la philologie comparée à prouver l’impossibilité de l’unité primitive des langues et des races, afin de justifier, par des arguments scientifiques, la théorie impie de l’esclavage. Il ne me souvient pas d’avoir jamais vu la science plus dégradée que sur le titre d’une publication américaine, où, parmi les profils des différentes races des hommes, était introduit le profil du singe, auquel on avait donné une apparence plus humaine qu’à celui du nègre. - - •
Enfin, le problème de la position de l’homme sur les
t H;
confins du monde de la maiière et du monde de l’esprit a occupé, de nos jours, une très-grande place parmi les problèmes des sciences physiques et psychologiques. II a absorbé toutes les pensées de savants qui, après une longue vie passée à recueillir des faits, à les observer et à les analyser, ont consacré à l’étude et à la solution de cette question des facultés et un ensemble de connaissances comme n’en avaient pas encore vu les âges précédents ; et, à en juger par la chaleur qui a animé des débats que l’on conduisait ordinairement avec le calme d’un juge et non pas avec la passion de plaideurs, il semblerait, après tout, que les grandes questions de notre être, de la vraie noblesse de notre sang, de notre origine divine ou terrestre, bien qu’elles ne se rattachent pas immédiatement à tout ce qu’on est convenu d’appeler pratique, ont néanmoins leur charme propre, qui ne perdra jamais son empire sur l’esprit et le cœur de l’homme. Or, quelque loin qu’on ait avancé les limites du règne animal, si loin même que, pour un moment, la ligne de démarcation entre l’homme et l’animal semblait dépendre d’un pli de plus
ou moins dans le cerveau, il y a une barrière à laquelle personne ira encore osé loucher, c’est celle du langage. Même ces philosophes pour qui penser c’est sentir (4), qui réduisent toute pensée à la sensation, et soutiennent que les facultés qui engendrent les idées nous sont communes avec les bêtes, sont obligés d’avouer que jusqu’à présent aucune race d’animaux n’a produit un. langage. Lord Mon-boddo, par exemple, admet que jusqu’à ce jour on n’a découvert aucun animal en possession du langage, qui .n’existepas même chez le castor; et pourtant, dit-il, « de tous les animaux que nous connaissions, et qui ne sont pas, comme les orangs-outangs, de notre espèce, c’est le castor dont la sagacité approche le plus de celle de l’homme. » : . • ’ .
Locke, qui est généralement rangé au nombre de ces philosophes matérialistes, et qui, certainement, revendiquait pour les sens une grande part de ce qui avait été
attribué à l’intelligence, reconnaissait cependant:très-
, 1 + . % .
explicitement la barrière que. le langage élève entre les bêtes et l’homme. « De ceci je suis bien assuré, dit-il, c’est que la faculté de l’abstraction n’existe pas du tout chez les bêtes, et que la possibilité d’avoir des idées générales ètablitune complète distinction entre l’homme et les bêtes. Car il est évident que nous n’observons chez ces dernières aucune trace de l’emploi de signes généraux pour des idéès universelles ; d’où nous avons lieu de penser qu’elles n’ont pas la faculté de i’abstraction ou
(t) « L’homme a deux facultés, ou deux puissances passives, dont l’existence est généralement reconnue: premièrement, la faculté de recevoir'les différentes impressions causées par les objets extérieurs, la sensibilité physique; secondement, la faculté de conserver les impressions causées par ces objets, et qui est appelée la mémoire, ou la sensation affaiblie. Ces facultés* causes productives de la pensée, nous sont communes avec les bêtes..... Tout peut se réduire à la sensaLion. »—Helvétius. . .....
d’engendrer des idées générales, puisqu’elles ne se servent pas de mots ni d’autres signes généraux. »
Si donc la science du langag-e nous fait pénétrer dans ce qui, de l’aveu de tous, distingue liiomme de tous les autres êtres vivants ; si elle creuse entre nous et les bêtes un abîme que rien ne pourra jamais combler, elle semble
avoir, de nos jours, des droits particuliers à rattention de ceux qui, tout en suivant avec une sincère admiration lés progrès de la physiologie comparée, regardent comme un devoir de protester- de toutes leurs forces contre un .retour des misérables théories de lord Monboddo.
» h
Mais revenons à notre étude de i histoire des sciences
_ . ' _ , k ■ t
physiques. Nous avons examiné la période empirique que chaque science doit traverser; nous avons vu quen botanique, par exemple., un homme qui a Voyagé dans lés contrées lointaines, qui a réuni nombre de plantes, qui en connaît les noms, l’anatomie et les propriétés médicales, n’est pas encore un botaniste, mais seulement un
' . , t ? ' '
herboriste, un amateur déplantés, ou ce que les Italiens appellent un dilettante^ de düettare, réjouir. La véritahie science des plantes, comme toutes les autres, commence par le travail de la classification : la connaissance pratique des faits s’élève jusqu’à la science, aussitôt que :sous fa multiplicité des faits individuels, l’esprit découvrel unité -d’un système organique. Cette découverte se fait au moyen de la comparaison et de la classification : nous cessons d’étudier chaque fleur pour elle-même, et, ,en agrandissant sans cesse la sphère de nos observations,
. ■ s t
nous tâchons .d’apercevoir les caractères essentiels et -communs à plusieurs, sur lesquels nous pouvons fonder les groupes ou les classes naturelles : puis, nous comparons ces classes entre elles, dans leurs traits plus généraux; de nouveaux points de ressemblance ou fie différence apparaissent à la vue et nous permettent de décou-
vrir des classes de classes ou des familles. Après avoir étudié de la sorte tout le règne végétal, et jeté sur le jardin de la nature un simple tissu de noms, quand nous pouvons, pour ainsi dire, le ramasser et le ramener à nous, pour contempler, dans notre esprit, toutes les plantes comme formant un ensemble et un système.bien défini et complet, nous parlons alors de la science que l’on appelle aujourd’hui la botanique : alors aussi,, nous entrons dans une nouvelle sphère de connaissances, où l’individu est subordonné au général, les faits aux lois : nous découvrons la pensée, l’ordre et le dessein répandus dans la nature tout entière, et nous voyons le sombre chaos de la matière éclairé par le reflet de l’esprit divin. De .telles divisions .peuvent être vraies ou fausses-; des rapprochements précipités, des distinctions trop étroites ont pu empêcher l’observateur de saisir les larges contours du plan de la nature; néanmoins tout système, quelque insuffisant qu’il devienne par la suite, est un progrès véritable. Une fois que l’homme s’est pénétré de cette conviction, que Tordre et la loi doivent régner partout, il iTa plus de repos qu’il n’ait éliminé tout ce qui semble irrégulier, qu’il n’ait contemplé toute la beauté et l’harmonie de l’univers. Les échecs du passé préparent . les triomphes de l’avenir. .
Ainsi, pour revenir à notre premier exemple, l’arrangement systématique des plantes qui porte le nom de Linné, et qui repose sur lé nombre et le caractère dés organes de la reproduction, n’a pas réussi à faire ressortir Tordre naturel répandu dans tout ce qui végète et fleurit : de larges lignes de démarcation qui réunissent ou divisent de grandes classes et familles de plantes, étaient invisibles pour qui se plaçait à son point de vue ; mais, pourtant, son oeuvre n’a pas été inutile. Le fait fut établi,
une fois pour toutes, que les plantes dans toutes lés ré’ 2
gions du globe appartiennent à un seul grand système ; et même dans les méthodes ultérieures, la plupart de ses classes et de ses divisions ont été conservées, parce que la conformation des organes reproducteurs des plantes s’est trouvée correspondre régulièrement à d’autres signes plus caractéristiqùes dune véritable parenté.
L’histoire de l’astronomie nous offre un exemple semblable. Bien que le système de Ptolémée fût erroné en ce qui concerne le centre du monde, il n’en fit pas moins découvrir les lois qui règlent les mouvements réels des corps célestes. La certitude qu’il reste encore quelque chose à expliquer ne peut manquer d’amener la découverte de l’erreur commise. Dans la nature, toute erreur'
- * . ■ *
est impossible; si elle existe quelque part, ce doit être dans notre esprit. Cette conviction vivait dans le cœur d’Aristote, quand, malgré sa connaissance imparfaite delà nature, il déclarait « qu’il n’y a dans le monde aucune pièce de rapport, sans lien avec le reste, comme dans une mauvaise tragédie, » et, depuis son temps, tous les nouveaux faits et tous les nouveaux systèmes ont prouvé la vérité d e sa croyance.
L’objet de la classification est manifeste : nous comprenons les choses si nous pouvons les saisir, c’est-à-dire si nous pouvons embrasser et réunir les faits isolés, -rassembler les impressions éparses, distinguer entre ce qui est essentiel -et Ce qui n’est qu’accidentel, affirmer
ainsi de l’individu les caractères généraux qu’il possède, et le ranger dans la classe que déterminent ces caractères; telle est la condition nécessaire de toute connaissance scientifique. Beaucoup de sciences, en traversant cette seconde période, celle de la classification, reçoivent la dénomination de comparées. Quand . l’anatomiste a terminé la dissection de corps nombreux, qu’il a donné un nom à chacun des organes et découvert leurs fonctions
PREMIÈRE LÉCON. 4 9
' ^ , 1 ’
distinctives, il est amené à apercevoir la. similitude là où d’abord il n’avait vu que la dissemblance. Il découvre chez les animaux inférieurs des linéaments de l’organisation plus parfaite des animaux supérieurs, et il se pénètre de la conviction qu’il y a dans le règne animal le même ordre et le même dessein que nous trouvons dans la variété infinie des plantes ou dans tout autre règne de la nature. Il apprend, s’il ne le savait pas déjà, que le monde n’a pas été créé au hasard ni en bloc, mais qu’il y a une échelle qui'conduit par des degrés imperceptibles depuis les derniers infusoires jusqu’à l’homme, le roi de la création ; que toutes choses reflètent une seule pensée créatrice, et sont l’œuvre d’un Dieu de sagesse infinie. ■ '
De la sorte, la période de la classification nous conduit naturellement à la troisième et dernière, celle de la théorie ou de la métaphysique. Si l’oeuvre delà classification est exécutée comme elle doit l’être, elle nous apprend que rien n’existe dans la nature comme par accident ; que chaque individu appartient à une espèce, et chaque espèce à un genre ; qu’il y a des lois cachées qui régissent la liberté apparente et la variété qui nous frappent dans la création. Ces lois, nous révèlent la présence d’un dessein dans l’esprit du Créateur; et, tandis que les anciens philosophes regardaient le monde matériel comme une pure illusion, ou' comme une agglomération d’atomes ou bien encore comme l’œuvre du principe du mal, nous y lisons, comme dans un livre, la révélation de la puissance, de la sagesse et de l’amour de Dieu, L’étude de la nature a pris ainsi un caractère tout nouveau: quand l’observateur a recueilli ses faits, et que le savant les a classés, le philosophe se demande quelles, en sont l’origine et la ' signification ; et, au moyen de l’induction et quelquefois même de la divination, il tâche de s’élever dans des
20 LEÇONS SUR LA SCIENCE DU LANGAGE. .
£ 1
régions oùle simple collectionneurne peut jamais atteindre. Dans cette tentative, l’esprit humain a, sans doute, éprouvé souvent îe sort de Phaéton, mais, sans se laisser décourager par ses chutes, il redemande toujours les coursiers de son père. On a dit que cette prétendue philosophie de la nature n’a jamais rien accompli : qu’elle a seulement prouvé que les choses doivent être exactement telles que l’observation nous les montre ; cependant les sciences physiques ne seraient jamais arrivées au point où elles en sont, sans l’impulsion que leur ont donnée les philosophes et même les poètes. « Aux limites des connaissances exactes, dit Eumholdt, comme du haut d’un rivage élevé, l’œil aime à se porter vers les lointaines régions. Les images qu’il voit peuvent être des illusions : mais, comme -ces images trompeuses que croyaient apercevoir, bien avant le temps de Colomb, les habitants des Canaries ou des Açores, elles peuvent amener la découverte d’un nouveau monde. »
Copernic, dans la dédicace de son ouvrage au pape Paul III (il fut commencé en 1517, terminé en 1530 et publié en 1543), avoue qu’il fut conduit à la découverte de la position du soleil au centre du monde, et du mouvement diurne de la terre, non pas par l’observation ni par l’analyse, mais par ce qu’il appelle le sentiment d’un manque de symétrie dans le système de Ptolémée. Mais qui lui avait appris qu’il doit y avoir de la symétrie dans les mouvements de tous les corps célestes, ou que la complication n’est pas plus sublime que la simplicité ? La symétrie et la simplicité, avant d’être découvertes par l’observateur, furent supposées sans preuve par le philosophe. La première idée de la révolution qu’il devait opérer dans les cieux fut suggérée à Copernic, comme il nous le dit lui-même, par un ancien philosophe grec, Philo-laüs îe pythagoricien. Sans doute, chez Phiîolaüs, le mou-
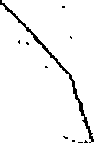
vement de la terre n’était qu’une conjecture, ou, si vous le.voulez, une heureuse intuition : ce n’était point, comme chez Tycho-Brahé ou son ami Kepler, le résultat de longues et fatigantes observations faites sur l’orbite de la planète Mars. Néanmoins, si nous devons en croire Copernic, il est très-possible que, sans cette espèce de divination, nous n’aurions jamais entendu parler de son système. On n’arrive pas à la vérité seulement par l’addition et la multiplication. En parlant de Képîer, dont la méthode de raisonnement a été regardée comme dangereuse et chimérique par ses contemporains et par des astronomes postérieurs, sir David Brèwster remarque avec beaucoup de vériLé « que, comme instrument de recherche, l’influence de .l'imagination a été négligée par ceux qui ont entrepris de donner des lois à la philosophie » (1)'.
Dans l’histoire des sciences physiques, les trois périodes que nous venons de décrire se présentent généralement dans l’ordre chronologique. Je dis généralement, car il y a eu des cas, comme dans l’exemple que j’ai cité de Philo-laüs,.où les résultats appartenant proprement à la troisième période ont été pressentis dans la première. Pour l’œil perçant du génie, un seul fait, peut en valoir mille, et une expérience bien choisie peut amener la découverte d’une loi absolue. Et puis il y a de grandes lacunes dans l’histoire de la science : la tradition des générations est interrompue par les convulsions des Etats et des peuples, et l’œuvre, sur le point d’ètre achevée, a dû être refaite en entier, quand une nouvelle surface s’est formée pour porter une civilisation nouvelle- Toutefois la succession de
- /i . ^
ces trois périodes est, sans aucun doute, conforme à l’ordre
(3) Voir sur le rôle joué par l'imagination dans les découvertes de l’astronomie la belle Notice. sur la vie et les travaux de Kepler, lue par M. Joseph Bertrand, membre de l’Institut, dans la séance publique du 28 décembre 1^63. [Tr.]
22 LEÇONS SUR LA SCIENCE DU LANGAGE.
de la nature, et c’est avec raison qu'on la suit dans l’étude de chaque science. Le futur botaniste commence par recueillir des plantes ; il les étudie chacune à part, il en observe les caractères, la région où elle pousse, la saison où elle fleurit, et son nom populaire. Il apprend à distinguer les racines, la tige, les feuilles, le calice, les étamines et les pistils ; il s’exerce, pour ainsi dire, à la grammaire pratique avant de pouvoir commencer les comparaisons, les arrangements et la classification. On ne peut, ensuite, aborder avec succès la troisième période d’une des sciences de la nature qu’après en avoir .traversé la seconde : personne ne saurait étudier la plante en elle-même, ni comprendre la portée d’un ouvrage comme celui de M. Schleiden sur la Vie de la plante (1), sans avoir étudié la vie des plantes dans la merveilleuse variété, et l’ordre, encore plus merveilleux, de la nature. Ces derniers résultats de la philosophie inductive, plus admirables que tous les autres, ne sont possibles que quand la voie a été dégagée par la classification : le philosophe doit commander à ses classes, comme un général à ses régiments ; c’est seulement ainsi que la bataille peut être gagnée et la vérité conquise.
Après ce coup d’œil jeté sur l’histoire des autres sciences physiques, nous revenons maintenant à celle qui nous occupe, pour voir si elle mérite réellement ce nom, et si elle peut rentrer dans la catégorie des sciences inductives. Nous voulons nous demander si elle a traversé ou si elle traverse encore les trois phases des recherches physiques ; si sa marche a été régulière ou irrégulière, sa méthode bonne ou mauvaise. Mais, avant de répondre à ces questions, nous avons, je crois, encore quelque chose à faire. Vous avez probablement remarqué que j’ai toujours sup-
(I) Die Pflanze und ihr Leben> von M. T. Schleiden, Leipzig, 1858.
i PREMIÈRE LEÇON. . - 23
s -A
; posé que la science du langage, mieux connue dans ce
: pays sous le nom de philologie comparée, est une des
: sciences de la nature, et que, par conséquent, sa méthode
doit être identique à celle qui a été suivie avec tant de succès en botanique, en géologie, en anatomie et dans les : autres branches de l’étude de la nature. Pourtant, dans
; l’histoire des sciences physiques, nous chercherions en ; vain une place assignée à la philologie comparée ; son nom
même semblerait indiquer quelle appartient à une toute
autre sphère des connaissances humaines, qui, d’après ; leur objet, se partagent en deux grandes divisions : les
J 4 ’ H
sciences de la nature et les sciences historiques, les premières
■■ ■■ ■ " -
traitant des œuvres de Dieu, et les dernières des œuvres del'homme (4). Or, à en juger par son nom, la philologie comparée, comme la philologie elle-même, semblerait se ! ranger parmi les sciences historiques, et la méthode qu’il convient d’y appliquer semblerait être celle qui est suivie dans l’histoire de l’art, du droit, de la politique, et delà religion, il ne faut cependant pas nous laisser égarer par ce nom de philologie comparée : il est difficile d’établir à
qui on le doit, mais tout ce qu’on peut dire en sa faveur,
1 1 . ■
i c’est que les créateurs de la science du langage furent : principalement des humanistes ou des philologues, et que
i leurs recherches sur la nature et les lois du langage furent fondées sur la comparaison d’autant de faits qu’ils pouvaient en rassembler dans le cercle restreint où s’enfermaient leurs études. Cette dénomination h’a été adoptée ni dans cette Allemagne, qu’on peut bien appeler le bér
yl) C’èst ainsi que la science de l’optique, qui embrasse tontes les lois de la lumière et de la couleur, est une science naturelle, tandis que la science de la peinture, avec tous ses-procédés de manipulation et les différents moyens employés pour obtenir la. couleur, se rapportant à un art inventé par l’homme, est.une science purement historique. {Intelleçiual Reposüory, p. 247.) . ' ,
\

24 leçons sur la. science du langage.
■ - . 0 ' . .
ceau de cette science, ni en France où elle a été cultivée avec un brillant succès, et il ne sera pas difficile de prouver que, quoique la science du langage doive beaucoup aux humanistes, et leur ait, en retour, rendu de grands services, la philologie comparée n’a absolument rien de commun avec la philologie dans le sens ordinaire du mot. La philologie classique ou orientale, qu’elle s’occupe des langues anciennes ou des langues modernes, des langues cultivées ou des langues barbares, est une science, historique, et ne traite le langage que comme un instrument. L’helléniste se sert du grec, l’orientaliste de l’hébreu, du sanscrit ou de toute autre langue, comme d’une clef pour l’intelligence des monuments littéraires ■ que nous a légués l’antiquité, et comme d’une formule magique pour évoquer du tombeau les pensées des grands hommes qui ont honoré des contrées et des siècles différents ; par l’étude de ces idiomes-et des-monuments, qu’ils nous .ont conservés,, il se propose de remettre l’historien à même de retracer d’une manière définitive la marche sociale, intellectuelle, morale et religieuse de l’humanité. De même, dans l’étude des langues vivantes, nous n’apprenons pas les grammaires et les vocabulaires pour eux-mêmes, mais pour leur utilité pratique : nous nous en servons comme de lettres d’introduction auprès de la meilleure société et de la meilleure littérature des principales nations de l’Europe. 1 .
Dans la philosophie comparée, le cas est tout différent : là, le langage n’est plus considéré comme un moyen, mais comme l’objet même de la recherche scientifique ; des patois qui n’ont jamais produit d’œuvre littéraire, les jargons de tribus sauvages, les modulations vocales des Indo-Chinois et les claquements de langue des Hottentots sont aussi importants, et, pour certains problèmes, plus importants que la poésie d’Homère ou la prose de Cicéron.
. PREMIÈRE LEÇON. 26
- ^ -
Nous avons à étudier le langage et non pas les langues ; nous voulons savoir ce qu’il est et comment il peut servir d’organe à la pensée; nous voulons en connaître l’origine, la nature et les lois, et c’est en vue d’arriver à cette connaissance que nous réunissons, pour les arranger et les classer, tous les faits du langage qui sont à notre portée.
Ici je dois protester, au début même de ces leçons, contre la supposition que, pour étudier le langage, il faille nécessairement être un grand linguiste. J’aurai à vous parler, dans le cours de ces entretiens, de centaines de langues, dont quelquefois les noms mêmes vous seront peut-être inconnus : n’en concluez pas que je sache ces langues comme vous savez le grec bu le latin, le français ou l’allemand; dans ce sens, je ne sais que bien peu de langues, et je n’ai jamais aspiré à la renommée d’un Milhridate ou d’un Mezzofanti. Il est impossible pour celui qui étudie la philologie comparée d’acquérir une connaissance pratique de toutes les langues dont il a à s’occuper : il n’a nul désir de parler la langue kachikaie, dont on vient de fonder une chaire à l’Universiié de Guatémala (-1), ni d’apprendre les délicatesses de l’idiome des Tchéré-rnisses; son ambition ne le pousse pas non plus à explorer la littérature des Samoyèdes ou des habitants de la Nouvelle-Zélande : c’est la grammaire et le dictionnaire qu’il étudie et qu’il soumet à une analyse minutieuse; mais il ne se charge pas la mémoire de paradigmes de noms et de verbes, ou de longues listes de mots qui n’ont jamais été employés dans une œuvre littéraire. Il est bien vrai qu’aucune langue ne révélera jamais toutes les merveilles de son mécanisme qu’au savant qui l’aura étudiée à fond, et d’une manière critique, dans un certain nombre d’œuvres littéraires représentant les différentes périodes
(4) Sir J. Sloddart, Glossology, p. tt. ......
LEÇONS SUR LA SCIENCE Dü LANGAGE.
•a '
de son développement; mais il est vrai aussi que de courtes listes de mots et des esquisses incomplètes de la grammaire sont, dans bien des cas, tout ce que nous pouvons nous attendre à posséder pour nous aider dans nos recherches. De ces renseignements épars et bornés, la linguistique doit apprendre à tirer le meilleur parti possible, comme l’aria-tomie comparée profite des débris d’ossements fossiles, ou des dèssins imparfaits d’animaux que rapportent les voyageurs étrangers à la science. S’il nous fallait avoir une connaissance critique ou pratique de toutes les langues qui serviront à nos recherches, la science du langage serait tout simplement impossible ;■ mais le botaniste n’a pas besoin d’être un habile jardinier, ni l’ichthyologiste. un pêcheur adroit. 11 ne serait pas raisonnable, non plus, de refuser à notre science la division du travail, sans laquelle on ne saurait traiter avec succès des sujets bien moins étendus. Quoiqu’une grande partie de ce que nous pouvons appeler le règne du langage soit à jamais perdue pour1 nous, que des périodes tout entières, dans son histoire, échappent nécessairement à notre observation, néanmoins la masse de mots que nous découvrons, soit dans les couches pétrifiées des littératures anciennes, soit dans la variété'infinie des langues vivantes, nous offre un champ aussi vaste, sinon plus vaste, qu’aucune autre branche, des sciences de la nature. Il est impossible de déterminer le nombre exact de langues connues, mais il ne peut guère s’élever à moins de neuf cents (1). Qu’une aussi riche matière n’ait jamais, avant le commencement de notre siècle, excité la curiosité des philosophes qui étudient la nature, c’est là un étrange phénomène ; on a le droit d’en être en-coreplus surpris que de l’indifférence avec laquelle les gé-
* r ‘
(1) Batbi, dans son Atlas, en compte 860. Cf. Pott, Rassen, p. 23 Etymologische Forschungen, II, 83 (seconde édition).
nérations antérieures avaient traité les enseignements que les pierres mêmes semblaient offrir sur la vie qui bat encore dans les veines de notre planète et qui déborde à la surface du sol. Le vieux dicton que « la.familiarité engem dre le mépris » ne s’appliquait que trop au sujet de ces deux sciences. Le gravier de nos chemins ne paraissait guère digne d’occuper les savants, et il fallait un effort pour élever à la dignité d’un problème scientifique le langage que savent parler les campagnards illettrés. L’homme avait étudié toutes les parties de la nature, les trésors minéraux dans les entrailles de la terre, les fleurs de toutes les saisons, les animaux de tous les continents, les lois des orages et les mouvements des corps célestes; il avait analysé toutes les substances et disséqué tous les corps organisés ; il connaissait chaque os et chaque muscle, chaque nerf et chaque fibre, jusqu’aux derniers éléments dont se composent sa chair et son sang; il avait médité sur la nature de son âme, sur les lois de son esprit, et tâché de pénétrer jusqu’aux causes finales de toutes choses; et cependant le langage, sans l’aide duquel le premier pas n’aurait pu être fait dans cette voie glorieuse, n’était étudié par personne : comme un voile tombant trop près des yeux, il restait presque inaperçu. Dans un temps où l’étude de l’antiquité attirait les intelligences les plus vigoureuses, ou l’on passait au crible les cendres de Pompéi pour y retrouver les bijoux qui avaient orné la tête des dames romaines ou les jouets dont s’amusaient leurs enfants, où des procédés chimiques faisaient reparaître sur le parchemin les pensées effacées des écrivains grecs, où l’on fouillait les tombeaux de l’Egypte pour en tirer leurs dépôts sacrés, et où l’on forçait les palais de Babylone et de Ninive à livrer les journaux d’argile de Nabuchodonosor, où, en un mot, on recherchait avec ardeur et on conservait pieusement, dans les bibliothèques et les musées, tout ce
28 ' LEÇONS SUR LA. SCIENCE DU LANGAGE.
qui semblait nous apporter quelque vestige de la vie primitive de l'humanité, le langage, qui, par lui-même, nous reporte bien au-delà de la littérature cunéiforme de l'Assyrie et de la Babylonie, ainsi que des documents hiéroglyphiques de l’Egypte-, qui nous relie, par une chaîne non interrompue, aux premiers ancêtres de notre race, et dont la vie se rattache encore, par une transmission héréditaire et continue, aux premières articulations sorties de la bouche de l'homme, le langage, enfin, qui est le témoin vivant et parlant de toute l’histoire de notre race, n’a jamais été étudié par l’historien, ni contraint de révéler ses secrets, jusqu’à ce qu’il fût interrogé et, pour ainsi dire, rappelé à la conscience de lui-même, dans ces cinquante dernières années, par le génie de Humboldt, de Bopp, de Grimm, de Bunsen et d’autres encore qu’il serait, trop long de citer. Si vous considérez que, quelques vues que nous adoptions sur l’origine du langage et sur la manière dont il s’est répandu, rien de nouveau n’a été ajouté à sa substance, que tous ses changements ont porté sur la forme, qu’aucune racine, aucun radical n’a été inventé par les générations postérieures, pas plus qu’un seul élément n’a été ajouté au monde matériel où nous vivons; si vous vous rappelez qu’en un sens et en un sens parfaitement vrai, nous nous servons des mots mêmes qu’employa le premier homme, lorsque, au sortir des mains de Dieu, il donna des noms à « tous les bestiaux, aux oiseaux de l’air, et à tous les animaux des champs, » vous penserez, je crois, que la science du langage a des titres à votre attention, tels que peu de sciences peuvent en produire de supérieurs ou même d’égaux.
Après avoir ainsi expliqué la manière dont je me propose d’étudier notre science, je compte examiner, dans ma prochaine leçon, les objections des philosophes, qui regardent le langage comme ayant été inventé par l’esprit
PREMIÈRE LEÇON. ■ 29
. * ■ , .
humain pour fournir aux hommes les moyens de se communiquer plus rapidement leurs pensées, et qui voudraient le voir traiter, non comme un produit de la nature, mais comme une œuvre artificielle de l’esprit humain (1).
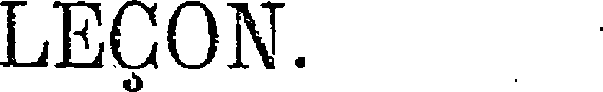
DE LA DISTINCTION A FAIRE ENTRE LE DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE ET L’HISTOIRE DU LANGAGE.
Objections contre la théorie qui classe la science du langage parmi les sciences de la nature. Première objection : le langage est l’œüvre arli-cielle de l’homme. Opinions de diverses écoles de philosophie sur l'origine du langage.— Deuxième objection : le langage est susceptible de développement et de perfectionnement, et se distingue par là des produits de la nature. — Le développement du laugage résulte de deux opérations distinctes, l’altération phonétique et le renouvellement dialectal. Ce qu’on entend par altération ou corruption phonétique : étymologie de oiginii, vingt, dérivé des deux mots d'où viennent deux et dix ; ravages de l’altération phonétique. Renouvellement dialectal. Importance de l’étude des dialectes pour entrevoir la vie réelle du langage. Nombre infini de dialectes dans l’Asie centrale, en Afrique, en Amérique, dans la Polynésie et même en Europe. Les patois conservent souvent des formes plus primitives que les langues littéraires. Rapidité extraordinaire avec laquelle les dialectes se transforment, •constatée par les missionnaires en Amérique; même fait observé en Asie et en Afrique. Comment se forment les langues nationales. Dans „ quel sens les termes de mère et de fille peuvent s’appliquer aux langues : le latin et l’italien. Histoire du latin. Influence des dialectes et des patois sur le développement des langues : le langage porté en Islande par les réfugiés norvégiens est resté presque stationnaire depuis sept siècles, tandis que sur son sol natal il s’est scindé en deux langues distinctes, le suédois et le danois. Richesse des dialectes. Lois qui ont présidé au passage du latin aux langues romanes. Dans quel sens nous parlons du développement du langage. Le développement du langage comparé non à la végétation d’un arbre, mais à la formation successive des couches terrestres. Les individus ne peuvent influer sur le développement du langage. — Troisième objection : la science du langage doit être classée parmi les sciences historiques, puisque nous ne pouvons nous rendre compte de la vie et du développement d’aucune langue sans connaître l’histoire du peuple chez qui elle s’est formée et surtout l’histoire de ses rapports avec les autres peuples. — La
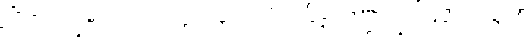
t
lk
*- : ■

LEÇONS SUR LA SCIENCE DU LANGAGE. ,
science du langage ne dépend aucunement de l’histoire ; différence entre l’histoire du langage de l'Angleterre, et l’histoire de l’anglais. La grammaire est l’élément essentiel et la hase de toute classification des langues : c’est la grammaire qui nous fait ranger le turc parmi les langues tartares et louraniennes, et l’anglais parmi les langues teuto-niques, malgré l’origine diverse des mots qui composent le vocabulaire de chacune de ces deux langues. -
En réclamant pour la philologie comparée une place parmi les sciences .que j’ai appelées sciences naturelles, j’étais préparé à rencontrer bien des objections. Il semblait que le cercle de ces sciences fût fermé, et il n’était pas présumable qu’une nouvelle venue fût accueillie avec empressement parmi les membres reconnus de la vieille aristocratie de la science (i).
La première objection qu’on ne pouvait manquer de soulever, de la part des -sciences, telles que la botanique, la géologie ou la physiologie, est que le langage est l’œuvre de l’homme, qu’il a été inventé par fihomme, comme moyen de communiquer ses pensées, quand les regards et les gestes devinrent insuffisants et que, progressivement et par les générations successives, il a été amené à ce degré de perfection que nous admirons dans l’idiome de .la Bible, des Yédas, du Eoran, et dans la poésie
. (1) Le docteur Wheweil classe la science du langage parmi les sciences qu’il appelle pa-laitiologiques, mais il établit une distinction entre.celles de ces sciences qui traitent des choses matérielles, par exemple la géologie, et d’autres qui s’occupent des produits de la puissance imaginative et des facultés sociales de l’homme, par exemple, la philologie comparée. 11 exclut ces dernières du cercle des sciences naturelles proprement dites, mais il ajoute : « Nous avons commencé nos recherches avec la conviction que les idées ■ claires auxquelles nous pourrions arriver concernant la nature de la vérité dans les. sciences physiques et le mode de la découvrir, contribueraient à jeter de la lumière sur la nature et l’avenir des autres branches de nos connaissances, et nous aideraient dans nos études morales, politiques et philologiques. Telle était la conviction que nous avons exprimée, et déjà les résultats viennent confirmer notre croyance. Nous avons vu que la biologie mène à la psycho-iogie, si nous voulons seulement marcher en avant ; ainsi le passage
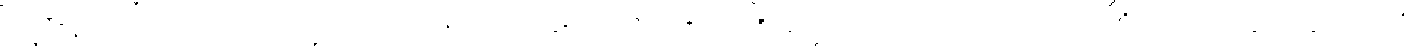
DEUXIÈME LEÇON. 33
d’Homère, de Virgile, de Dante et de Shakespeare. Il est parfaitement, vrai que si le langage était l’œuvre de l’homme dans le sens où le sont une statue, un temple, un poème ou une loi, la science du langage devrait être classée parmi les sciences historiques. Nous aurions une histoire du langage, comme nous avons une histoire de l’art, de la poésie et de la jurisprudence, mais nous ne pourrions pas prétendre à ranger le langage à côté des diverses branches-de l’histoire naturelle. Il est vrai aussi que, si vous consultez les philosophes modernes les plus distingués, vous trouverez que toutes les fois qu’ils parlent du langage, ils prennent pour dit que c’est une invention humaine, que les mots sont des signes artificiels, et que les. variétés du langage viennent de ce que les nations diverses se sont arrêtées à des sons différents pour représenter leurs idées. Cette explication de l’origine du langage fut soutenue avec tant de force par les principaux philosophes du dernier siècle, qu’elle est encore acceptée sans discussion, même par ceux qui, sur presque tous les autres points, sont les adversaires déclarés de la philosophie du dix-huitième siècle. Quelques voix, il est vrai, se sont élevées pour protester contre celte-théorie ; mais, du monde matériel au monde immatériel s’ouvre sur un point, devant nous, et nous découvrons maintenant plusieurs vastes sciences qui n'ont affaire qu’à la nature spirituelle dé l’homme et qui sont régies par les mêmes lois que les sciences naturelles proprement dites. Nous ne voulons pas nous étendre sur les espérances que notre philosophie nous fait ainsi enLrevoir; mais nous pouvons nous permettre, au terme de notre pèlerinage à travers les fondements des sciences plwsiques, de nous, réjouir de ce rajmn, tout faible qu’il soit, qui brille pour nous encourager, en venant â nous des hauteurs d’une région plus lumineuse. ■> Indications of the Creator, p. 1 -in. Voyez aussi 1 ouvrage inliLulé Darwinism lested by the science of Idnguage, traduit de l’allemand du professeur A. Schleicher par le docteur Al. V. W. H. Bikkers (Londres, Ilolten, '1869) et le compte-rendu que j’ai donné de cet ouvrage dans le Recueil périodique qui a-pour titre : Nature, n° 10, 6 janvier 4870.
3

dans leur zèle pour prouver l’origine divine du langage, elles semblent s'être laissé emporter jusqu’à contredire je texte formel de la Bible, car dans la Genèse, ce n’est pas le Créateur qui donne des noms à toutes choses, mais Adam : « Le Seigneur Dieu, y est-il dit, ayant formé de la terre tous les animaux des champs et les oiseaux de l’air, les amena vers l’homme, pour que celui-ci vît comment il les appellerait, et tous les noms que l’homme leur donna, ce sont leurs noms (1). » Mais, excepté chez cette classe, peu nombreuse, de philosophes plus orthodoxes que la Bible elle-même, l’opinion généralement reçue est ■celle qui fut suivie par Locke, qui. fut défendue avec vigueur par Adam Smith dans Y Essai sur V origine du langage ajouté à son Traité des sentiments moraux, et qui fut adoptée, avec de légères modifications, par Dugald Stewart (2). Selon ces philosophes, l’homme a dû vivre pour un temps dans un état de mutisme, ses seuls moyens de communication étant certains mouvements du corps et certaines expressions de la physionomie, jusqu’à ce qu'enfin, quand, les idées s’étant multipliées, leurs objets
(1) Gen., 11,19.
(2) Saint Basile fat accusé par Eunomius de nier la Providence,
parce qu’il ne voulait pas admettre que Dieu eût créé les noms de toutes choses, mais qu’il attribuait l’invention du langage aux facultés que Dieu avait mises dans l’homme. Saint Grégoire, évêque de Nyssa en Cappadoce (331-39Ô), défendit saint Basile. « De ce que Dieu a donné à la nature humaine ses facultés, il ne s’ensuit pas, écrivait-il, que Dieu produise toutes les actions que nous accomplissons. 11 nous a donné la faculté de bâtir nue maison et de faire tout autre ouvrage ; mais c’est assurément nous qui' sommes les constructeurs, et non pas lui. De même la faculté de parler est l’œuvre de celui qui a ainsi formé notre nature-; mais l’invention des.mots pour nommer chaque, objet, est l’œuvre de notre esprit. » Voyez Ladevy-Roche, de' VOrigine du Langage, Bordeaux, -1860, p. 4-1; Horne Tooke, Diversions of Purley, p. 49. (Consulter -aussi E. Renan, de /’Origine du Langage, pp. 80-85. Paris, in-8°. [Tr.]) . . • : .
DEUXIEME LEÇON.
' O
ne purent plus être indiqués avec le doigt, « on sentit la nécessité d’inventer des signes artificiels dont la signification fut déterminée d’un commun accord. » Il est inutile défaire ressortir toutes les nuances que nous trouvons dans les opinions de ces philosophes sur la marche exacte qu’a suivie la formation de ce"'langage artificiel. Adam Smith voudrait nous faire croire que les verbes ont été créés d’abord : il regarde les noms comme étant d’une nécessité moins urgente, attendu que les choses peuvent être indiquées ou imitées, tandis que de simples actions, comme celles qu’expriment les verbes, ne le peuvent pas. Il suppose donc qu’en voyant venir un loup, on le montrait du doigt en s’écriant seulement : « Il vient. » Dugald Stewart, au contraire, pense que les premiers mots artificiels furent des noms, et que des gestes suppléaient aux verbes ; que, par. conséquent, en voyant venir un loup, on ne s’écriait pas: «il vient! » mais: « Loup 1 loup i » en laissant rimagination faire le
reste (O-
Il nous importe bien peu de déterminer si le nom a été créé avant le verbe, ou le verbe avantîle nom, et il nous est impossible, au commencement de nos recherches sur la nature du langage, d’entrer dans un examen approfondi d’une théorie qui le représente comme inventé par les hommes et établi, d’un, commun accord, comme moyen de communication. Tout en admettant pleinement que, si cette théorie était vraie, la science du langage ne rentrerait pas dans le cercle des sciences naturelles, je dois mé contenter, pour le moment, de faire remarquer que personne n’a encore expliqué comment la discussion qui a dû, dans cette hypothèse, précéder le choix de chaque mot, était possible sans le langage lui-même. Mais,
(1) Dugald Stewart, Works, vol. III, p. 27.
comme c’est le but de ces leçons de prouver-que le langage n’est pas une invention dans le même sens que la. peinture, F architecture, l’écriture ou l’imprimerie, on me permettra de protester simplement, dans cette introduction à nos études, contre une théorie qui, tout enseignée qu’elle soit encore dans nos écoles, ne peut citer, que je sache, un seul fait à l’appui de ses assertions. '
Mais il y a d’autres objections qui semblent refuser à notre science une place parmi les sciences naturelles. On a fait observer, avec une grande apparence de vérité, que, quelle qu’ait été son origine, le langage a sa propre histoire, comme Fart, le droit et la religion, et que, pour cette raison, la philologie comparée doit être rangée parmi les sciences historiques ou morales, ainsi qu’on les appelle communément, par opposition aux sciences physiques. C’est une vérité bien connue, qui n’a pas été ébranlée par les recherches récentes* que la nature n’est pas susceptible de progrès ou de perfectionnement: la fleur que le botaniste étudie aujourd’hui était aussi parfaite dès le principe ; les animaux qui sont doués de ce qu’on appelle un instinct artistique n’ont jamais porté cet instinct à un plus haut degré de perfection ; les cellules hexagonales de l’abeille ne sont pas plus régulières au dix-neuvième siècle qu’à aucune époque précédente, et nos rossignols n’ont pas un chant plus harmonieux que la Philomèle des Grecs. « L’histoire naturelle traitée systématiquement, dit le docteur Whewell, exclut tout ce qui est historique, car elle classe les objets d’après leurs propriétés permanentes et universelles, et n’a rien à faire avec le récit de faits particuliers ou àccidentels (1). » Or, si nous considérons le nombre prodigieux de langues qui se parlent dans les. différentes'.parties du monde, avec
(I) History of inductive sciences, vol. ill/p. o3I.
H,
DEUXIÈME LEÇON. 37 -
-, ' ■ ■ fr ■ *
toutes leurs variétés de dialectes et de patois ; si nous : observons les grands changements que chacun de ces
idiomes a subis dans le cours des siècles, comment le ; latin est devenu l’italien, l’espagnol, le portugais, le fran-: çais, le valaque et le roumain ; comment le latin, le grec,
; le celtique et les langues teutoniques et slaves, ainsi que les anciens dialectes de l’Inde et de la Perse, ont dû sortir ; d’une langue primitive, la .mère commune de toute la ; famille indo-européenne ou aryenne; si nous remarquons que l’hébreu, l’arabe, le syriaque et d’autres dialectes : moins importants, ne sont que des reproductions d’un même
: type, et ont eu nécessairement une même origine, la lan- ■
gue primitive de la race sémitique ; si nous ajoutons à ces : deux familles, aryenne et sémitique, au moins un autre
groupe très-bien déterminé, le groupe touranien, qui comprend les dialectes des races nomades éparses dans le nord et le centre de l’Âsie, le tongouse, je mongol, le . turc, le samoyède et le finnois, qui sont tous comme des . rayons partant d’un centre commun : si, remontant vers les origines obscures, nous contemplons ce grand fleuve .
; du langage se déroulant à travers les âges, partagé entre ; ces trois bras immenses, qui, avant de disparaître à î’ho-\ rizon lointain, nous laissent voir clairement qu’ils déri- vent d’une source commune ; il semblerait presque qu’il y s ait une vie historique inhérente au langage, et que la , volonté de l’homme et la puissance du temps puissent influer sinon sur sa substance, du moins sur sa forme. Et quand même les variations purement locales ne seraient pas regardées comme des raisons suffisantes pour exclure .
4 Æ
le langage du domaine des sciences naturelles, il resterait toujours une difficulté plus grande, la tâcbe de concilier les principes reconnus de ces sciences avec les changements qui modifient, à la longue, chacun de ces dialectes. Toutesles parties de la nature, les minéraux, les plantes

ou les animaux, restent les mêmes dans leur espèce, depuis le commencement jusqu’à la fin de leur existence, tandis que peu de langues seraient reconnaissables après un laps seulement de mille ans. La langue d’Alfred est si différente de l’anglais moderne, qu’il nous faut l’étudier comme nous étudions le grec ou lé latin. Nous pouvons lire Milton et Bacon, Shakespeare et Hooker ; avec de l’attention, nous pouvons arriver à comprendre Wycliffe et Chaucer ; mais quand nous en venons à l’anglais du treizième siècle, nous pouvons seulement en deviner le sens, ce que nous ne pouvons même plus faire pour les textes antérieurs à l’Ormulum et à Layamon. Ces changements que le temps opère dans le langage, sont plus ou moins rapides, mais ils existent à toutes les époques et dans tous les pays : ils ont. réduit la langue.riche et énergique des poètes des Védas au pauvre et insignifiant jargon dès Gipayes d’aujourd’hui; ils ont transformé l’idiome du Zênd-Avesta et des annales de la montagne de Behistoun en celui de Firdusi et des Persans modernes ; la langue de Virgile en celle de Dante, la langue d’ülfiîas en celle de Charlemagne, et la langue de Charlemagne en celle de Goethe. Nous avons lieu de croire que des changements analogues se font, avec encore plus de violence et de rapidité, dans les dialectes des tribus sauvages, bien qu’en l’absence d'une littérature écrite il soit extrêmement difficile d’obtenir des renseignements dignes de foi :
mais, dans les quelques cas où des observations exactes
r
ont été faites sur cet intéressant sujet* on a trouvé que chez les tribus sauvages et illettrées de Sibérie, d’Afrique et de Siam, deux ou trois générations suffisent pour changer tout l’aspect de leurs dialectes. Les langues des nations très-civilisées tendent., au contraire, à se fixer de plus en plus, et paraissent quelquefois presque perdre la faculté de se modifier : là où il ÿ a une littérature classi-
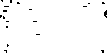
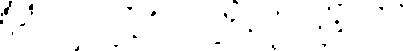
39
DEUXIEME LEÇON
if 1
que dont la langue se répand dans toutes les villes et tous les villages, les changements semblent devenir impossibles. Cependant, la langue de Rome, qui fut, pendant tant de siècles, maîtresse du monde civilisé, a été comme destituée et remplacée par. les. dialectes romans," et 1 ancien grec a'uni par être supplanté par le romaïque moderne. Chez nous, quoique l’art de-l’imprimerie et là circulation étendue des journaux et des livres aient servi de digues au courant du langage, nous voyons que les livres publiés il y a trois cents ans n’ont pas été écrits dans la langue que nous parlons aujourd’hui. 'Dans : le Scripture and Prayer-book Glossary^ ) de fîooker, le nombre des mots ou des significations ;de mots qui ont vieilli
Æ R4 Æ- c’Alp'ïrn o ponf rprpf
LiUjJlxLo t O-t i , o Ciü t t ül M Oi«3 Uolif v^w.CLylO Tilxgu J-xct-x |Jl v d’un cinquième-des mots employés dans la traduction anglaise de la Bible (2). De plus faibles changements, des changements d’accent et de sens, l’introduction dans la langue de nouveaux mots et la disparition des mots: anciens qui sortent peu à.peu dé la langue, voilà des, phénomènes qui se passent encore tous les jours sous nos yeux, et que nous pouvons saisir au passage. Rogers (3) dit : « Con'templale est assez mauvais,-mais bal'cony
■ l'" ' .t', - '' • -M •>
me fait mal au cœur»; tandis que maintenant aucune oreille n’est choquée par contemplât!} au lieu de contem'-
{ï)-A Scripture and Prayer-book glossary, being an explanaliori of obsolète words and-phrasés in the english Bible, Apocrypha, and Book of Comffion:Prayer;.by Lhe Rev. J. Booker ; Dublin, 1862. The Bible Word-book, à glossài\y of old english Bible words, by J. Easlwood and W. Aldis Wright. Cambridge; 1866. .
(2) Lectures on lhe English Language, by G. P. Marsh, New-
York, 1860, pp. 230 et 263. Ges leçons .résument beaucoup de recherches curieuses, et sont pleines d’observations précieuses. Elles ont été publiées dernièrement en Angleterre, avec des omissions et des additions utiles, par le docteur Smith, sous le litre de Handbook of lhe English Language. - ' - • :
(3) Marsh, p, 632, note. • .....- . - -,
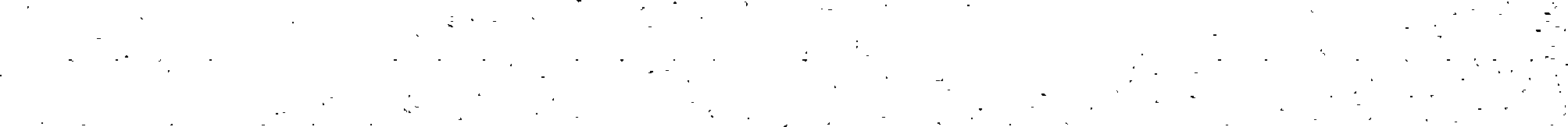
iO LEÇONS SUR LV SCIENCE DE LANGAGE.
* . *
plate et que bal1 cony est devenu plus .usitéque balco'ny. C’est ainsi que les prononciations Roome, chcmey, layloc et goold. n’ont fait place que tout récemment à Rome, china, lilac et gold ; quelques vieillards, représentants attardés de la politesse d’autrefois, persistent à se dire obleeged et non obliged (t). Force, dans le sens de chute d’eau, et gill, dans le sens de ravin, n’étaient pas employés dans l’anglais classique avant Wordsworth (2). Bandbook, quoique ce soit un vieux mot anglo-saxon, n'a remplacé que depuis peu de temps manual (3), et un grand nombre de mots,, tels que càb pour cabriolet, buss pour omnibus, et même des verbes, comme lo shunt {4), flottent encore sur la frontière qui.sépare la langue écrite de la langue parlée par le peuple (5). Quoique les changements grammaticaux
(-1) Trench, English Pdst and Présent, p. 210, mentionnerez qui se prononçait greêt du temps de Johnson, et lea, que Pope fait rimer avec obey...... . .
Iiere lhouf gre*t Anna 1 whom tbrce realms ôbey.
Dost sometimcs counscl take - and somctîmes tea*
-....... (The Râpe of the Lock, canio III.) . .
(2) Marsh, p. 580.
(3) J. Stoddart, Glossology, p. 60.
(4) Dans Halliwel], Dlctionary of archaims, « to shunt » est donné dans le sens de retarder, de remettre :
Sliape us an ansuere, and sclmnle you no lengere.
Morte Arthure> Ms. Lincoln, f. 67-
et aussi dans le sens d’éviter une chose, de s’en éloigner :
Then I drew me down ïnto a dale, wliereas ihe dumb deer
Dïd shîver for a shower ; but I shunted from a fre^ke, ,
Lïttle John N^body^ c. 1550,
Dans Sir Ga/wayne and îhe Green knight, éd. R. Morris, Sir Gawayne est dit avoir shunt from a blom, c’esL-à-dire avoir évité un coup (v 2280; voyez aussi 2268,1902). Dans les Early English allilerative poems, ed. 11. Morris, Abraham est dit rester assis shunt, c’est-à-dire à l’écart (B. GOu, p. 56). Voyez les remarques de M. R. Morris dans le Glossaire, p. 190, et Herbert Coleridge, Glossary, s. v.
(5) Pour les mots semblables à ceux-ci, que crée l’usage populaire, et dont quelques-uns finissent par passer de l’argot dans la
qui ont eu. lieu depuis la publication de la version autorisée des saintes Écritures soient moins nombreux, nous pouvons pourtant encore en indiquer quelques-uns. La terminaison de la troisième personne du singulier en tk est maintenant partout remplacée par s. On ne dit plus jamais dans la langue usuelle, lie liveth; mais seulement lie lives. Plusieurs dès imparfaits et des participes irréguliers ont pris une nouvelle forme. Personne n’emploie maintenant lie spcike et lie drave au lieu de lie spoke et lie drove ; hoïpen est remplacé par helped, holden par held, s/iapen par shccped. L’anglais moderne a de même laissé tomber la distinction qui se faisait autrefois entre ye et y ou; la première de ces formes servant alors pour le nominatif, la seconde pour tous les autres cas ; un mot qui paraît bien être une nouvelle forme grammaticale, le pronom possessif its, a pris naissance depuis le commencement du dix-septième siècle. O11 ne le trouve jamais dans la Bible, et, quoiqu’il se rencontre trois ou quatre fois dans Shakespeare, Ben Jonson ne le reconnaît pas encore dans sa grammaire anglaise (4). .
langue parlée et même dans là langue écrite, voir Lorédan Larchey, les Excentricités de la Lanque française. 5e édition, Paris, in-12,180S (Tr.) ' . * '
(1) « Foure possessives : My or Myne ; Plurall, Our, ours. Tliy thine ; Plurall, Tour, yours. His, Ilers, b.oLh in the Plural! making Their, theirs.» Voyez The English Grammar made by Ben Jonson, 1640, chap. xv. '
Nous.avons tenu à traduire exactement le passage qui précède, les remarques qu’il contient pouvant avoir beaucoup d’intérêt pour ceux qui connaissent la langue anglaise et qui savent la prononcer. Il eut d’ailleurs été facile de substituer aux mots indiqués par M. Mül!er pour l'anglais des mots français qui auraient montré des changements analogues s’opérant sans cesse dans notre propre langue sous l’influence de causes semblables et avec une aussi grande rapidité. Nous nous contenterons de donner ici quelques exempLes. pris un peu .au hasard parmi ceux qu'il serait aisé de réunir. ;
Oh ne pourrait, je crois, citer en français aucun exemple du
LEÇONS SUR LÀ SCIENCE DU LANGAGE. :
- ^ ' l “ ^
On soutient donc que le langage était sujet, à changer avec le temps, et différant par là de tous les autres pro-_ déplacement de l’accent tonique; c’est que la règle qui commande, dans notre langue, d’élever la voix sur la dernière syllabe du mot ou sur celle qui précède immédiatement la finale muette lie souffre aucune exception et par suite ne laisse place à aucune variation. Cette règle est si absolue, qu’à la différence de l’anglais et de l’allemand.; le français impose son accentuation à tous les mots étrangers, noms propres ou noms communs, qu’il admet dans l’usage. Mais la prononciation a sensiblement varié depuis le moment même où les grammaires, les dictionnaires, la tradition ininterrompue du . théâtre et de la chaire chrétienne ont semblé concourir à la fixer. Ainsi, à la fin du dix-septième siècle, on prononçait ou du moins on pouvait encore prononcer léger de la même manière qu'enfer, comme on le voit dans ces vers du Tartufe (iv, 6), qui ne rimeraient plus aujourd’hui :
. Kon, rien deplus méchant n’est soriï de Yenfer, '
: _ hîon Dieu? on ne doit point croire trop de léger.
Régnier Desmarais nous dit d’ailleurs {Gramm. franc., tr. 1), qu’alors on faisait sonner IV dans ce dernier mot. Nous ferons la même remarque sur ces-vers.de Boileau : .......
-j _ ■ ■' * ,
La coîcre est superbe et veut dés mots allierst ,
L'abattement s'explique en des termes moins fiers.
L’usage confondait encore dans beaucoup de mots, au dix-séptièmé siècle, les diphthoiigues ou et eu (je trouve, pour je trouve, rime dans Molière avec veuve), et l’on écrivait par la diphthongue oi beaucoup de finales que tout le monde, depuis Voltaire, écrit par la diphthongue ai, et qui aujourd’hui présentent uniformément le .sou de Yé ouvert.
Pour ce qui est de l’orthographe, on n’a qu’à ouvrir un livre imprimé dans le courant même du siècle dernier ; on sera tout aussitôt frappé de sensibles différences, et ces différences seront bien plus nombreuses encore si l’on remonte jusqu’au dix-septième siècle. Les mots enfin, considérés en eux-mêmes, soit dans leur sens, soit dans leurs accidents grammaticaux, soit dans leur emploi, nous donnent encore la preuve de l’instabilité des choses. On sait combien de mots tirés du grec et du latin ont introduits dans nôtre langue les écrivains érudits du seizième siècle, et combien le travail qui se fit ad dix-septième siècle a exclu de mots qui sont familiers à Amyot, à Pasquier et à Montaigne. Certaines expressions ne sont arrivées jusqu’à nous qu’après avoir eu comme une période d’éclipsé, pendant laquelle elles étaient mai vues et fort en péril de disparaître ; il n’est besoin , que de rappeler ici, avec M. Littré (.Préface du Dictionnaire), sollicitude que les puristes Philaminte et Bélise, dans les Femmes savantes, trouvent puant étrangement
duits de la nature, il ne doit pas être traité comme les objets des autres sciences naturelles. Il y a quelque chose de fort spécieux dans cette objection, mais si nous y regardons de plus près, nous trouverons qu elle repose entièrement sur une confusion de termes. Il faut. distinguer entre le changement qui se fait avec le temps, et le développement naturel: Fart, la science, la philosophie et la
son ancienneté, et contre lequel nul n’a plus les préventions de ces dames. D’autres mots, qui semblent avoir dû toujours exister, tant ils sont expressifs et bien faits, datent d’hier : bienfaisance a été introduit par l’abbé de Saint-Pierre; c’est dans un opuscule de lui, intitulé Projet pour1 rendre les sermons utiles, que ce mot paraît pour la première fois ; Mme de Staël dit, dans la Préface de là 2e édition de son ouvrage De la Littérature, qu’elle a « employé la première un mot nouveau;-Za vulgarité ; -r, popularité s’employait aidrefois -dans ce même sens, qu’il a perdu : la popularité d’un mot, pour dire sa bassesse, l’usage qu’en fait le peuple. Commepopulariié, beaucoup de mots, en restant dans l’usage, ont changé d’accéptio h; ainsi, suicide, mot qui ne se trouve pas encore dans le Fnreüèré de i 690, s’in troduil un peu plus tard avec le double sens de suicida et de suicidium,et ce double sens est indiqué dans VÂbrègè du Dictionnaire de rréuow#, par Berthelin, 1762, in-40, et dans le Grand Vocabulaire français, 1773; dans ce der^-: nier ouvrage, l’auteur, pour commenter ce mot, dit : ceux qui se sont homicides eux-mêmes; or, aujourd’hui, suicide n'a plus que.le sens de meurtre de soi-même. Un dernier exemple : le mot spéculation, dès qu’on PentendaiL prononcer, éveillait autrefois l’idée.de la recherche philosophique et désintéressée.; il. n’a point d’autre sens dans le Dictionnaire de l'Académie, édition de 1762. Aujourd’hui, quand on parle de spéculation, on entend une entreprise tentée en vue de. gagner de l’argent, une opération de bourse ; spéculation désigne, dit l’Académie en 1762, « la théorie, et\en ce sens.il est opposé à la pratique. » Aujourd’hui, depuis • le .dévelôppemén t qu’a pris chez; nous la fortune mobilière,: spéculation,, dans son emploi lé plus usuel, rappelle, âu contraire, les triomphes et les abus de l’esprit pratique, et, si on veut rendre à ce mot son ancien sens, ce qui ne se fait d’ailleurs guère que dans le style soutenu, il faut y joindre quelque épithète ou complément qui le détermine, comme dans cette phrase : « Les hautes spéculations de la pensée grecque; » Un mot qui a retenti à toutes les oreilles depuis quelques années, annexion, n’est pas encore dans le Dictionnaire de l’Académie, sixième édition, 1835- Voir, sur celle instabilité des langues, sur ce perpétuel devenir, un excellent chapitre du Cours supérieur de Grammaire, de B. Julien . partie LI, p. 3 6,, et la Préface . du Dictionnaire, de M Littré (Tr.) \ ^ : • :
religion ont une histoire qui contient leurs variations et leurs progrès ; le langage comme les autres produits de la nature, n’admet que le développement.
Remarquons d’abord que, bien qu’il y ait dans le langage un changement continu, il n’est au pouvoir de l’homme ni de le produire, ni de l’empêcher. Autant vaudrait songer à modifier les lois qui règlent, la circulation de notre sang, ou à ajouter un pouce à notre taille, qu’à changer les lois du langage ou à inventer de nouveaux mots selon notre bon plaisir. De même que l'homme n’est le roi de la création qu’autanl qu’il en connaît les lois et s’y soumet, le poëte et le philosophe ne deviennent les rois du langage, que s’ils en connaissent les lois ét s’y soumettent aussi. Quand l’empereur Tibère, s’étant trompé sur un mot, fut repris par Marcel lus, un autre grammairien, du nom de Capito, qui se trouvait présent, fit observer que le mot employé par l’empereur était latin, et que, s’il ne l’était pas, il 11e tarderait point à le devenir. Mareellus. plus grammairien que courtisan, reprit : Capito est un menteur car, Gésar, tu as le pouvoir de donner le droit
1 t .
de cité aux hommes, mais non pas aux mots. » On raconte une anecdote semblable de l’empereur d’Allemagne Si~ gismond. Quand il présidait le concile de Constance, il prononça devant l’Assemblée un discours latin, où il l’exhorta à extirper l’hérésie des Hussites : « Yidete, Patres,, dit-il, «ut eradicetis schismam Hussitarum. » Un moine ne sè gêna pas pour le rappeler à l’ordre, en s’écriant : « Serenissime Rex, schisma est generis neutri (1). » L’em- 1
. DEUXIÈME LEÇON.
. «3
pereur , sans perdre sa présence d’esprit, demanda à son audacieux interrupteur: « Qui te Ta dit! — Alexander Gallus, reprit le vieux maître d’école bohémien. — Et qui est cet Alexander Gallus ? demanda l’empereur. — C’est un moine. ;— Eh bien ! dit Sigism.ond, je suis empereur de Rome, et j’espère que ma parole vaut bien celle d’un moine. » Les rieurs furent sans doute du côté de F empereur ; mais, malgré tout, schisma est resté du neutre, et pas même un empereur ne put en changer ni le genre, ni la désinence. .
L’idée que le langage peut être modifié et perfectionné par l’homme n’est rien moins que nouvelle. Nous savons que Protagoras, un des anciens philosophes grecs, après avoir donné des règles sur les genres, se mit à critiquer les règles d’Homère, parce qu’il n’y trouvait pas ses règles observées. Mais là, comme partout, l’entreprise échoua. Essayez de changer la moindre règle en français ou en anglais, et vous verrez que c’est matériellement impossible. Il n’y a, en apparence, que peu de différence entre beaucoup et fort, comme entre much et ver y, et cependant l’un ne peut presque jamais être substitué à Eau-
^ ■ Æ
tre ; on dit : «je suis fort heureux, » et non « je suis beaucoup heureux ; » et « cet enfant grandit beaucoup, » et non « cet enfant grandit fort. » De même, les dialectes romans occidentaux, l'espagnol et.le portugais,.de même qu’aussi le valaque, peuvent seulement employer le mot latin magis pour former les comparatifs : Esp. mas duîce; port, mais doce ; val. mai dulce ; tandis que le français, le provençal et l’italien n’admettent que plus dans les mêmes cas : ital. piu dolce ; prov. plus dous ; franc, plus doux. Il est loin d’être impossible, cependant, que cette distinction entre very, qui ne précède que des adjectifs, et much,. qu’on n’emploie qu’avec des participes, disparaisse avec le temps ; et, en fait, very pleased et very delighted sont des
locutions que Ton commence déjà à entendre, en Angle-, terre dans plus d’un salon ; mais si ce changement-se fait un jour, ce ne sera pas par la volonté d’un individu, ni du commun accord d’un grand nombre d’hommes ; il se fera plutôt malgré les efforts des grammairiens et des académies. Ici donc, vous voyez'la première différence entre les .'■.changements opérés par le temps et le développement naturel. Un empereur peut modifier les lois de la société, les formes de la religion, les règles de l’art ; il est au pou-
■ ^ " - r- _ k
voir d’une seule génération, ou même d’un individu, d’élever un art au plus-haut, degré de perfection, d’où la génération suivante pourra le dàisser déchoir jusqu’à ce qu’un nouveau génie le relève par un nouvel élan. Dans tous ces cas, nous avons affaire à des actes réfléchis d’individus, et nous nous • trouvons, par conséquent, sur le terrain de l’histoire. Si nous comparons, les créations de
■ r p . f , 4
Michel-Ange ou de Raphaël avec les statues et les. fres-'qüeS de là Rome antique, nous pouvons parler d’ünè histoire de l’art. Par les œuvres de ceux qui ont transmis de siècle en siècle les traditions de l’art, nous pouvons rattacher l’une à l’autre deux époques séparées par des milliers d’années ; mais le développement continu et spontané, ■quirattache la-langue de Plaute à celle de Dante, nous échappera toujours..Dans l’opération par laquelle une langue se fixe et dans celle qui la fait varier, se combinent les deux éléments contraires de la nécessité et du libre
i. 1
arbitre. Quoique l’individu semble jouer le rôle d’agent principal dans la production de nouveaux mots eide nouvelles formes grammaticales, il n’a ce pouvoir que dans
" ■'i- ■-■•-i 9 ' .
le cas où son individualité s’est comme confondue dans l’action commune de la famille, de la peuplade ou de la nation à laquelle il appartient. Seul, il ne peut rien, et la première impulsion pour la création d’une nouvelle forme dans le langage, bien que donnée par un individu, l’est
généralement,, sinon toujours, sans préméditation et sans conscience de cet acte. I/individu, en, tant qu’individu, est impuissant, et, les effets, quil paraît produire dépendent de lois non soumises a son contrôle,: et de la coopération de tous ceux qui forment avec lui une;seule classe, un seul corps ou un. ensemble organique. , ; ,
Mais, bien qu’il soit facile de montrer, comme nous venons de le faire, que le langage ne peut être changé., ni
jeté dans un nouveau moule par le goût, le bon plaisir ou
■. . - - . _
le génie de l’homme, il est,fort difficile d’expliquer les causes du développement du. langage. Depuis le temps d’Horace, on s’èst accoutumé à comparer la végétation des langues à celle des arbres ; mais, les; comparaisons sont perfides : que savons-nous des causes dont l’action fait; . pousser un arbre, et que pduvons-nous gagner : à comparer des choses, que nous ne comprenons pas bien à d’autres que-nous compr.enons encorë moins ? Beaucoup de gens parlent, par exemple,.desdésinences.du verbe comme si elles sortaient du radical de la même manière que les branches sortent du tronc (4) ; mais; quelles, idées peuvent-ils attacher a de telles expressions ? Si nous .voulons à toute force comparer le langage: à l’arbre j il.y. a un point qui peut être éclairci.par cette comparaison, c’est que ni le langage ni l’arbre ne peuvent exister ou croître tout seuls. Sans le sol, sans, l’air' et la lumière, l’arbre ne pourrait’vivre ; nous ne pourrions même pas le concevoir comme vivant sans ces. conditions. Il en est de même, du langage, .qui ne peut exister.seul iL.lui faut un sol. pour y
% ■ ■ f •- m ■* t ’ ■
pousser, et ce sol est Lame humaine.. Parler du langage comme d’un être isolé, qui vivrait d’une vie propre, qui
(i) Horne Tooke., p. 629, note, attribue cette opinion à Castelvetro, saùs donqer toutefois aucune preuve que le savant italien ait soutenu cette opinion. CettéMoclrine, sous sa forme la plus extrême, a été soutenue par Frédéric Schlegel, , - - -arriverait à la maturité, qui se reproduirait et qui mourrait
de îui-même, c’est faire de la pure mythologie ; nous ne
■%. *
pouvons, il est vrai, éviter les expressions métaphoriques, mais nous devons toujours nous tenir sur.nos gardes, et, dans des recherches comme celles qui nous occupent, ne pas nous laisser égarer par les mots mêmes que nous employons. *
Or, ce que nous appelons le développement du langage résulte de deux opérations qu’il faut distinguer soigneusement l’une de l’autre, quoiqu’elles agissent simultanément. Je nomme ces deux opérations :
■1. Le renouvellement dialectal,
2. U altération 'phonétique. ;
Je commence par la dernière, comme étant la plus apparente, hien quelle soit généralement postérieure à la régénération dialectale, et,, pour le moment, je dois vous prier de supposer, sans le prouver, que tout dans le langage avait originairement une signification. Comme le langage ne peut avoir d’autre objet que d’exprimer nos idées, la conséquence presque nécessaire de ce principe semblerait être qu’il ne peut contenir ni plus ni moins que ce qui est indispensable pour cette fin. Il semblerait aussi s’ensuivre que, si le langage ne contient que ce qui est indispensable pour exprimer certaines idées, il serait impossible d’en modifier aucune partie sans par là lui faire manquer son but même, et c’est ce qui arrive pour quelques langues. En chinois, par exemple, dix se dit shi; si on apportait la moindre modification à shi, cette syllabe ne pourrait-plus signifier dix : prononçons, par exemple, tsi au lieu de si, et ce mot ne signifiera plus dix, mais sept. Mais supposons que nous voulions exprimer la quantité
doublé de dix, deux fois dix ou vingt; nous prendrions en chinois eül, deux, et, le plaçant devant slüt nous dirions eül-shl, vingt. La même précaution qui était nécessaire pours/u, l’est également pour etii-s/iZ ; dès que vous modifiez ce composé, en ajoutant ou en laissant tomber une seule lettre, il ne veut plus dire vingt; il a quelque autre signification, ou bien il n’a plus aucun sens. Nous trouvons exactement la même formation de mots dans d’autres langues qui, comme le chinois, sont appelées monosyllabiques : en tibétain chu signifie dix, nyi deux, nyi-clm vingt ; en birman she signifie dix, nkit deux ; n hit-she, vingt.
Mais comment les choses se passent-elles en français
ou en anglais, en grec, en latin ou en sanscrit? Nous ne
disons pas deux-dix en français, ni two-ten en anglais, ni
duo deùem en latin, ni d vi-dasa en sanscrit. Nous trouÉ (
vous en : '
sanscrit grec latin français anglais (1),
vmsatî eikali -viginti vingt twenty.
Ici, nous voyons d’abord que les formes citées pour le sanscrit, le grec, le latin et le français, ne sont que des modifications locales d’un seul, et même mot primitif, tandis, que l’anglais twenty est un composé nouveau (le gothique tvai tigjus signifie deux décades, et de là est sorti l’anglo-saxon tuêntig), formé de. matériaux teutoni-ques, et produit, comme nous le verrons plus tard, par l’opération que nous avons appelée le renouvellement dialectal. .
Nous, remarquons, en second lieu, que la première
(l) Bopp, Grammaire comparée, § 320 (traduite en français par 11.‘Michel Bréal, Paris, Hachette, 4866}.; Schicicher, Deutsche Spraôhe, S. 233.
A.
partie du latinviginti et celle du sanscrit vinsati renferment le même nom de nombre, qui de dvi s’e.st réduit àyi. 11 n’y a dans cette altération rien d’extraordinaire, car le latin bis, deux fois, remplace la forme primitive dvis, le grec dis. l’anglais twice. Nous trouvons encore ce dis en latin, comme préposition, avec le sens de en deux; ainsi, par exemple,, discussion signifie, en réalité, l’action de casser un noyau pour arriver à l’amande, comme percussion signifie proprement l’action de frapper de part en part. Eh bien, c’est ce même mot dvi ou vi que nous, voyons dans le latin viginti, et dans le sanscrit vinsati.
Nous pouvons également prouver que la seconde partie de viginti est une corruption du mot qui signifie dix. Dix . se dit, en sanscrit, dasan, d’où est dérivé .d as a ti, décade; ce dasati s’est réduit par la suite à sali, ce qui, avec vi pour dvi, deux, nous donne le sanscrit vins'ali pour visati, vingt. Le latin viginti, le grec eikati doivent leur origine à la même opération. ... -
Remarquez, maintenant, la différence considérable, je ne veux pas dire de son, mais de nature, entre le chinois eûl-shï, deux-dix ou vingt, et ces mots défigurés et estropies .que nous avons trouvés en sanscrit, en grec et en latin. En chinois, il n’y a ni trop, ni trop peu; le mot parie par lui-même, et n’a pas besoin de commentaire : en sanscrit, au contraire, les parties les plus essentielles des deux éléments-constitutifs ont disparu, et ce qui reste est si complètement transformé, qu’il ne se comprend plus qu’à l’aide d’une minutieuse analyse. Nous aurons donc
■ V 11 ’
ici un exemple de ce qu’on entend par Y altération phonétique, et nous pourrons voir comment elle corrompt et détruit non-seulement la forme, mais la nature même des mots. Une langue où l’altération phonétique commencé à se montrer perd immédiatement ce que nous avons regardé comme le caractère le plus essentiel de toute
langue, à savoir, que chacune de ses parties ait une signification. Les gens qui parlaient sanscrit ne savaient pas plus que vin 5 ali signifiait deux fois dix, qu’un Français ne reconnaît dans vingt les restes des racines de deux et dix. Le langage entre donc dans une période nouvelle aussitôt qu’il se laisse envahir par l’altération phonétique; la vie s’affaiblit et. s’éteint dans les mots ou portions de mots où celte corruption fait ses premiers ravages : désormais ces mots ou portions de mots ne peuvent plus être conservés qu’artificiellemenl ou par la tradition, et, ce qui est surtout important à observer, une distinction s’établit dès ce moment entre ce qui d’une part est substance et radical, et ce qui de l’autre est grammatical ou de pure forme. .
Prenons un autre exemple, qui nous fera voir encore plus clairement comment la première apparition de ce qu’on appelle les formes grammaticales est due à l’altération phonétique. Nous n’avons pas l’habitude de regarder vingt comme le pluriel ou le duel de dix; mais comment un pluriel était-il formé originairement ? Dans le chinois, qui, dès le principe, s’est préservé avec plus de soin que toute autre langue de toute altération. phonétique, le pluriel se forme de la manière la plus raisonnable. Ainsi, gin signifiant homme,, et Mai le tout ou la totalité, le pluriel d'homme s’exprime par gin-kiai. II.y a en chinois
A
d’autres mots qui sont employés à cette même fin, par exemple, péi, classe : î, étranger, suivi de péi, nous donne î-péi, des étrangers. Nous avons des pluriels analogues en anglais, mais nous neles comptons pas comme des formes grammaticales distinctes. C’est ainsi que man-Jdnd (espèce humaine) est formé absolument comme t-péi (espèce étrangère) et que ckristen-dom (la chrétienté), répond à la-périphrase : ensemble des chrétiens. Nous retrouvons le même procédé dans d’autres langues congénères : en tibétain, le pluriel se forme par l'addition dë mots tels que kun, tous, et t’sogs, multitude (1), et meme à l’aidé des noms de nombre neuf et cent. Ici également, tant que ces mots sont parfaitement, compris et en pleine vie,- l’altération phonétique n’a sur eux aucune prise ; mais aussitôt qu’ils perdent, pour ainsi dire, la conscience d’eux-mêmes, la corruption phonétique apparaît, et dès lors les portions de mots qu’elle atteint ne consèrveni plus qu’une existence artificielle ou une valeur de convention, et se réduisent à des désinences grammaticales.
Je craindrais d’abuser de votre patience, si je commençais ici l’analyse des désinences grammaticales en sanscrit, en grec ou en latin, afin de vous montrer comment elles sont sorties de mots indépendants que le frottement, continuel du langage et l’usure ont comme réduits en poussière. Mais, pour comprendre comment le principe de l’altération phonétique produit la formation des terminaisons grammaticales, jetons les yeux sur des langues qui nous sont plus familières, et examinons, par exemple, là désinence ment, qui termine la plupart des adverbes français (2). Cette terminaison n’existë pas en latin, où nous trouvons toutefois . des expressions comme bona mente, de bonne foi (3), et où nous lisons dans Ovide : « insistant forti mente, j’insisterai avec un esprit, une volonté forte, fortement. » Les gloses dans les manuscrits du moyen âge sont amenées par les mots aut, vel, seu, id est, hoc est ou par in alia mente, et celle dernière locution arrive ainsi à être synonyme de l’adverbe français (4) au-
(t) Foucaux, Grammaire tibétaine, p. 27, et Préface, p. x.
(2) Voyez Fuchs, Uomanische Spractien, p. 3o5.
(3) Quintilien, V, 10, 52. Bona mente factum, ideo palam; mata, ideo ex imidiis.
(4) Grimm, Rechtsalterthümer, p. 2.
■trementâ dérivé de altéra mente. Voici donc ce qui est arrivé dans révolution naturelie du latin, ou dans le passage du latin au français : dans des phrases telles que forti mente, le dernier mot finit par ne plus se faire sentir .connue mot indépendant, et perdit en même temps sa prononciation distincte ; mente, l’ablatif dé mens, se changea en ment, qui cessa d’être un mot indépendant et n’exista plus que comme terminaison des adverbes, même, dans des cas où le souvenir au sens original de mente (avec un esprit) en aurait rendu l’emploi parfaitement impossible. Si nous disons en français qu’un marteau tombe lourdement, nous ne nous doutons guère que nous prêtons à un morceau de fer un esprit lourd. En italien, bien que la désinenee1?2e«/a, dans L'adverbe chiaræniente
(pour çlara mente) ait perdu son caractère de mot indépendant, elle n’a pas, jusqu’à présent, subi l’altération phonétique ; en espagnol, elle’ s’emploie encore comme, mot indépendant, quoiqu’on ne puisse plus dire qu’elle ait conservé une signification distincte-: ainsi, au lieu de « claramente, . conçisamente, y elegantemente, » il est mieux de dire, en espagnol« clara, concisa y elegante mente. » . ..... .
Il est difficile de se figurer jusqu’à quel point toute la surface d’une langue peut être changée parce que nous. avons appelé Valtération phonétique : songez que dans vingt vous avez les mêmes éléments que dans deux et dix : que la seconde partie de douze représente le latin decim dans duodecim : que Je te final de4rente fut originairement le latin ginla dans Iriginta, lequel.ginta avait.été une dé-rivàtion et une. abréviation du sancrit dasa ou dasati.
dix. Considérez, ensuite, combien .cette maladie phoné-
■ * * ' * -
tique a dû se montrer de bonne heure ; car, de même que
vingt en français, vernie en espagnol et penii en italien présupposent la forme plus primitive viginti, que nous trouvons en latin, ainsi ce-latin viginli, le grec eikati et le sancrit viusati, présupposent une langue première d’où ils ont été dérivés, et qui devait contenir la forme plus primitive dvi-ginti, qui, elle aussi, a dû être précédée d’un autre composé aussi clair et aussi intelligible que le chinois eül-slû, et formé des vieux noms aryens pour deux et dix, dvi et dasati. Telle est la force destructive de cette corruption phonétique, quelle ronge quelquefois tout le corps d’un mot, et n’en laisse plus subsister que quelques restes méconnaissables. Ainsi le sanscrit svasar (1), seur, se trouve en pelhvi et en ossète sous la forme eho. Le sanscrit duhitar, en grec thu gâter, en anglais daughier, fille, s’est réduit en bohémien à dci} qü’on prononce tsi (2). Qui croirait que l’anglais tear et le français larme ont une origine commune; que le français même contient le latin semetip-sissimus ; que dans auj ourd ’ h ui n ou s avons. deux fois, le mot latin dies (3) ; ou que to dowal, verbe qui est d’un usage courant parmi les menuisiers du Yorkshire, ést le même mot que l’anglais to dovetaü ? Qui reconnaîtrait le français père dans l’arménien hayrf Pourtant, nous identifions sans peine père avec pater; et comme un h initial correspond souvent, en arménien, à un p primitif (Jiet = pes, pedis, pied ; hing= gr. pente, cinq ; hour = gr. pyr, feu), il s’ensuit que hayr est identique avec paie?* (4).
Nous sommes accoutumés à appeler ces changements Yévolution naturelle du langage ; mais il serait plus exact
(1) L’s du sanscrit = TA persan; donc, svasar = hvahar, qui devient chohar, chor et cho. En zend, qanha, acc. qanharem,. en persan, khafier. Bopp, Gram, comp., §35.
(2) Schieicher, Beürage, i. II, p. 392 : dci = dugie\ gén. dcere
= dugtere. Voyez Poncei, Du Langage, p. 208. ’
(3) Hui = hodiè, italien oggi et oggidi: jour = diurnum, de dies.
(4) Voyez Max Muller, Lettre à Bunsen sur les langues lourd-
niennes, p. 67. . . . .
55
de leur donner le nom de .dépérissement, pour les distinguer de l’autre opération, que nous avons nommée le renouvellement dialectal, c’est-à-dire la régénération d’une langue par ses dialectes. C’est de cette seconde opération que nous allons maintenant nous occuper, et nous y trouverons un principe plus réel de développement. ' <
Pour bien comprendre la signification de l’expression renouvellement dialectal, il faut commencer par bien coin-prendre ce que nous entendons par dialecte. Nous avons déjà vu que le langage n’a pas d’existence indépendante en soi : il existe dans l’homme; il vit en étant.parlé, il meurt avec chaque mot qui est prononcé et qu’on n’entend , plus. Que le langage ait jamàis éié mis par écrit et soit devenu l’expression d’une littérature, ce n’est là quun fait accidentel ; aujourd’hui encore, la plupart des langues n’ont produit aucune œuvre littéraire. Chez les innombrables peuplades du centre de l’Asie, de l’Àfriqüe, de PAmérique . et de la Polynésie, le langage existe à l’état naturel, dans une continuelle révolution : et c’est là qu’il faut aller, si . nous voulons observer le développement du langage avant qu’il soit gêné et arrêté par des monuments écrits. •Les idiomes littéraires de la Grèce, de Rome et des autres nations civilisées, pour, lesquels nous réservons ordinairement le nom de langues, doivent être regardés comme des formes artificielles plutôt que naturelles du langage ; c’est dans les dialectes que se manifeste la vie réelle, la vie élémentaire et naturelle du langage, et malgré la ty-’ rannie des idiomes classiques ou littéraires, le jour est encore bien éloigné où l’on verra disparaître entièrement les dialectes même de langues aussi cultivées que ritalien . èt le Français. Une vingtaine des dialectes italiens ont été écrits, et sont représentés aujourd’hui par des textes imprimés; Champollion-Figeac . fait monter à quatorze le:

nombre des dialectes français -les plus '-marquants (4).' Quelques ailleurs comptent jusqu’à soixante-dix dialectes du grec moderne ; beaucoup ne doivent guère être que des variétés locales ; quelques-uns, néanmoins, comme le tzaconien, diffèrent de la langue littéraire autant que le dorien différait de l’altique (2). Dans File de Lesbos, des villages qui ne sont pas à plus de deux ou trois heures de marche les uns des autres ont souvent des mots qui leur sont particuliers et leur prononciation propre (3). Mais prenons une langue qui, bien que non dépourvue d’une littérature, a moins subi rinfluence des auteurs classiques que; l’italien où le français, et nous verrons immédiatement combien les dialectes se multiplient. Le frison, qui se parle depuis plus de deux mille ans dans un espace fort limité, sur la côte nord-ouest de rAlle-magne, entre l’Escaut et le Jutland et dans les îles adjacentes, et qui possède des œuvres littéraires remontant au douzième siècle, s’est divisé en patois innombrables fi). « Les noms les plus communs, dit Kohl dans ses Voyages, qui sont presque identiques dans toutes les contrées de l’Europe, diffèrent complètement dans les diverses îles du Friesland : ainsi, père se dit aatj dans î’îie d’Àmrum. baba ou babe.ôans les îles ïïalligs, foder ou vaar dans I’île de -Sylt, taie dans bien des districts sur le continent, et oit ou ohüj dans la partie orientale de l’île de Fohr. Bien
(1) Sir John Sloddart, Glossology, p. 33.
(2) Ibid.) p. 29. (Sur ce dialecte, les renseignements les pins nouveaux et tes pins complets sent contenus dans la thèse soutenue en 1866 devant la Faculté de Paris par M. Gustave Deville ancien membre de l’Ecole française. d’Athènes, et intitulée : Etude du Dialecte tsaconkn, in-3°, Laine et Bavard. Tr.) .
(3) Nea Pandora, i 839, irs 2i7, i;2U; Zeitschrift fur vergleidiende
Sprachforsclmhy, X, p. 190. .
(4) -Grîmm, Geschichle dèr deutsche Sprache, -p. 668 ; Marsh, p. 379,
que ces populations soient à deux milles ollemandsles
unes des autres, ces mots different plus entre eux que
' L £ -, - ' .
l’italien padw et l'anglais falher. Les noms mêmes de leurs dislricls et de leurs îles sont complètement dissein-
f - . . r - - ' . J.-J i T 1 ■ - j." .F - * j
blables dans differents dialectes : l’île de Sylt s’appelle Sol, Sol et Sol. » Chacun de ces patois, bien qu’à la.rigueur un. savant frison puisse .s’y retrouver, n’est intelligible que pour les paysans de r étroit district où il a cours. Par conséquent, ce qu’on appelle la langue frisonne} dont les grammaires frisonnes nous donnent.les formes et les règles, n’est, en réalité, que la grammaire du plus important de ces nombreux dialectes : et c’est ce qui arrive également pour toutes, les langues qui ont reçu la dénomination de littéraires. \.
-Klaus Grolh écrit ce qui suit : « C’est une véritable énigme, un miracle dans l’histoire du langage que cet îlot de langue frisonne qui se trouve sur le continent du Scbl.eswig, entre Iîusum et Fondera : l’étrangeté de ce phénomène n’a pas attiré jusqu’ici une suffisante attention . Comment se fait-il que, seules, les deux extrémités de toute la côte frisonne entre la Belgique et le Julland aient gardé leur, vieille langue? Les Frisons orientaux, dans le duché d’Oldenbourg, parlent simplement flotte deutscà comme les Weslphaiiens et nous-mêmes. Le prétendu dictionnaire du Frison oriental, composé par Tirck-II in ri ch Sliiremburg, n’a pas plus de droit à çe litre de frison que le dictionnaire du dialecte de Brême. À moins d’admettre que toute une côte a été envahie et recouverte par la mer, comment expliquer que tout montre Husum, dans un pays pial aussi monotone qu'une jmsto hongroise, sans qu’il y ait là aucune frontière ou barrière naturelle, le voyageur, entrant dans la première auberge venue, puisse à la vérité se faire, comprendre en parlant le haut ou le b as-allemand, qu’il puisse même, dans les deux cas.
LEÇONS SUR LA SCIENCE DU LANGAGE.
tS
r 4
recevoir une réponse faite en bon allemand, mais qu’il entende l’hôte et ses domestiques se parler entre eux dans un idiome qui surprend son oreille et lui est toul-à-fait étranger ? Ce qui ne paraît pas moins singulier, c’ëst la frontière nord delà Wiede-au, où le danois prend brusquement la place du frison. Qui peut expliquer par quelle suite .de circonstances cet idiome s’est maintenu jusqu’à cette ligne et ne Ta pas franchie, cet idiome dont le domaine ne dépasse point quelques huit ou dix milles carrés? Comment se fait-il que ces quelques milliers d’hommes n’aient pas renoncé depuis longtemps à « ce reste inutile d’un dialecte que n’enseigne point le maître d’école? » On s’en étonne d’autant plus que ceux qui lé parlent apprennent en même temps le bas et le haut-allemand, ou le bas-allemand.et le danois? Dans les villages de ce district, dont les maisons sont éparses sur un
, ri
vaste espace de. terrain, une maison habitée par..une famille qui parle bas-allemand est quelquefois isolée parmi des maisons frisonnes, et vice versa; les choses se sont passées ainsi pendant une longue suite de générations. Dans les familles saxonnes, on trouve inutile d’apprendre le frison, car tous les voisins savent parler bas-allemand; mais dans les familles frisonnes, on n’entend pas parler l’allemand, hors quand il y a des visiteurs allemands. Depuis le dix-septième siècle, rallemand a conquis à peine une seule maison ; il n’a certes pas gagné un village (i). »
C’est une erreur de s’imaginer que les dialectes sont partout des corruptions de la langue littéraire. Même en Angleterre (2), les patois ont bien des formes qui sont
(1) lllustrite Deutsche Monatshefle, 1869, p. 330. ,
(2) « Quelques personnes, qui se sont habituées à regarder le dialecte du Dorseishire comme ayant.été produit par la corruption-
plus primitives que la langue de Shakespeare, et la richesse de leur vocabulaire surpasse, dans beaucoup de . cas, celle du vocabulaire des auteurs classiques de réimporte quelle période (1). Les dialectes ont toujours été les sources jaillissantes où a puisé la langue littéraire plutôt que des canaux dérivés qui étaient alimentés par elle; on peut dire tout au moins qu’ils ont été comme des courants parallèles qui coulaient' l’un à côté de : l’autre, bien avant le moment où l’un d’eux prit sur les autres cette primauté qui est le résultat de la culture littéraire. ’
Ce que Grimm dit de l’origine des dialectes en général ne s’applique qu’à ceux qui sont produits par l'altération phonétique. « Les dialectes, dit—il (3), se développent pro-gressiveinent, et plus nous remontons dans l’histôire du langage, moins ils sont nombreux et moins leurs caractères sont déterminés. Toute multiplicité provient graduel-
r ‘ T , 1 . _
lement d’une unité primitive. » C’est bien ce que nous sommes amenés à croire, si nous fondons exclusivement nos théories sur les matériaux que nous fournissent des idiomes littéraires, comme le sanscrit, le grec, le latin et le gothique. Mais qu’étaient ces idiomes mêmes, avant que la culture littéraire les eût fixés? Devons-nous sup-de l’anglais littéraire, 'seronL peut-être surprises d’apprendre que non-seulement c’est un rejeton indépendant de Tauglo-saxon, mais que c’est un dialecte plus pur, et dans certains cas plus riche que celui qui a été adopté comme la langue nationale. » Barnes, Poems in Dorset Dialecte préface, p. xiv. — « En général, l’hébreu a beaucoup plus de rapports avec l’arabe vulgaire qu’avec l’arabe littéral, comme j’aurai peut être l’occasion de le montrer ailleurs, et il en résulte que ce que nous appelons l’arabe vulgaire est également un dialecte fort ancien. » Munk, Journal asiatique, 4850,
(1) Sur les patois dans le français, voir Littré, Histoire de la
Langue française, II, 91-169 (Tr.) *
(2) Geschichte der deulsche Sprache, p. 833. ;
N
S
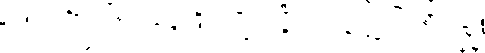
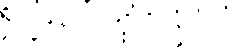
%
t
i

60 LEÇONS SUR LA. SCIENCE DU LANGAGE.
* ' - ■ V , - ■
poser que dans l’Inde, contrée qui a presque l'étendue
' - _ 4 ■ s -
de l’Europe, et que coupent des montagnes, des forêts et des déserts, un seul et. même langage était parlé à l’époque où les poètes du Yéda chantèrent leurs premiers hymnes pour célébrer le pouvoir de leurs dieux ? La Grèce ne nous montre-t-elle pas, même dans sa littérature, une grande diversité de dialectes locaux, et ce que-nous appelons le latin classique peut-il passer pour autre chose que l’un des nombreux dialectes du Latium, celui que parlaient les familles patriciennes de Rome? Les dialectes existent avant que se forment les langues littéraires, car toute langue .littéraire n’est qu’un dialecte qui a pris îe pas sur ses congénères, par'suite de circonstances plus favorables ; il n’en résulte d’ailleurs point que, lorsqu’un dialecte a été élevé ainsi à la dignité de langue littéraire, les autres soient réduits au silence ou étouffés comme les frères, d’un sultan turc à son avènement.
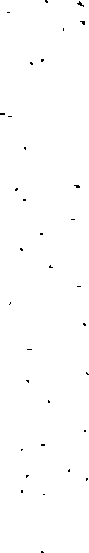
M contraire, ils continuent à vivre en pleine.vigueur, quoique dans une obscurité relative; à moins que les idiomes, employés, par. les lettrés et par .les cours, ne se rafraîchissent et ne reprennent vigueur dans des rapports sans cesse renouvelés, avec leurs anciens compagnons, tôt ou tard, les dialectes populaires ressaisiront leur ascendant. Les idiomes littéraires, tels que le sanscrit, le grec, le latin, ce sont les têtes couronnées qui jouent les premiers rôles dans l’histoire du langage ; mais, de même que -i’histoire politique doit contenir autre chose que les annales des maisons souveraines, l’historien du langage ne doit jamais perdre de vue les cou-► .
ches plus humbles d.u langage populaire d’où'sont sortis les idiomes privilégiés, et qui seules les soutiennent et les nourrissent..
Mais ici une difficulté se présente: comment suivre
■ ? ' ~ T ~ ~ Æ- ' "■ L t ’ y - r
l’histoire, des dialectes ? L’an liqu.it é ne nous fournît de
s
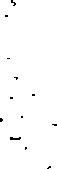
documents que sur les idiomes littéraires, c’est à peiné si les. auteurs anciens mentionnent même l’existence des dialectes qui n’étaient que parlés. . : •
Il est vrai que Pline nous dit que dans la Coîchide il y axait plus dé trois cents tribus parlant des dialectes differents, et que les Romain s étaient obligés d’employer cérit
trente interprètes pour commercer et traiter avec ces peu-
■ ■ . ■ s . \
/
pladès (I). C’est là probablement Une exagération ; niais nous n’avons pas de raison de mettre en doute l'exactitude de ce que nous dit Strabon (2) sur les soixante dix tribus habitant cette contrée, qui, de nos jours encore, est appelée « la montagne des langues ». De plus, dans les temps ' modernes, quand les missionnaires se sont adonnés à l’étude des langues de tribus illettrées et sauvages, ils ont rarement réussi à apprendre plus d’un seul dialecte sur un grand nombre, et, quand leurs efforts étaient couronnés de succès, le dialecte qu’ils^avaient mis' par éCrit, et. qui était devenu entre leurs mains un instrument de civilisation, ne tardait pas à prendre une sorte de .suprématie littéraire sur les autres, qui demeuraient dans une situation inférieure et qui restaient à l’état dé jargons barbares. Néanmoins, c’est aux missionnaires que nous devons, en très-grande partie, sinon entièrement, ce quë nous savons sur les langues des sauvages, et il est bien à désirer que leur attention se reporte, sans cesse sur cet intéressant problème de la vie des dialectes, qu’eux seuls ont l:e: moyen d’éclaircir. Gabriel Sagard, qui fut envoyé en qualité de missionnaire chez les ïïurons, en 46M, et' qui pu-
» , ■
(1) Pline, VI, 5; Hcr vas, Catàlogo, I, iîS.
(2) Pline s’appuie sur l’auLctrité de Timosthène que Strabon
déclare indigne de confiance (lî, p. 93, éd. Cnsaiib,). Strabon dit lui-mcme de Diosctirias, cruvsp^scôai îç auxvjv s§ïog.;^y.bvfa, ci oè .xài 'rptaxbctà e6vY] (paclv oiç oi/Ssv ttbv ovtojv geXei (.X, p. 49S). LéS dérnicrs mois se rapportent probablement à Timosthène........
62. LEÇONS SUR LA SCIENCE DU LANGAGE.
blia à Paris, en 4634, son Grand Voyage au pays des Eurons, affirme que parmi les tribus de l’Amérique du Nord c’est à peine si l’on peut trouver deux villages parlant la même langue, et que dans un même village il n’y a pas deux familles dont la langueme diffère plus ou moins.. Il ajoute (ce qui est important à remarquer) que leur langage change sans cesse, au point que leur langue actuelle ne ressemble presque plus à celle des anciens Eurons.. Un autre auteur prétend que, pendant les deux cents ans qui viennent de s’écouler, les langues des Eurons et des Iroquois n’ont pas varié du tout (1). Dans l’Amérique centrale, certains missionnaires cherchèrent à mettre par écrit le langage des tribus sauvages et' composèrent avec grand soin un vocabulaire de tous
les mots qu’ils pouvaient saisir.. Revenant dans la même
* - s *■
tribu après un laps seulement de dix ans, ils trouvèrent que ce vocabulaire avait vieilli et était devenu inutile (2);
(1) Du Ponceau, p. HO.
(2) S. R. Waldeck, Lettre à M. Jomarcl des environs de Pa-lenquè, Amérique centrale. ïl ne pouvait se servir, en 183S, d’un vocabulaire composé avec beaucoup de soin dix ans auparavant.
« Telle est la tendance des langues chez les peuplades qui vivent de leur chasse à s’écarter rapidement l’une de l’autre, qu’en dehors de ces mots primitifs dont nous venons de parler, on trouve une plus grande diversité dans des dialecles indiens que l’on sait issus d’une source commune, que dans les langues congénères de l'Europe. Ainsi, bien que les Minsi soient une tribu des Dela-wares et leurs proches voisins, plusieurs même de leurs noms de nombre sont.différents. » — Archæoloqia Àmericona, vol. II,
p. 160. '
« La plupart des hommes marquants onl un style qui leur est propre. Si la société est nombreuse et que beaucoup de ses membres fassent une étude du langage, les innovations qui ont un mérite réel sont les seules qui demeurent. Si la société est petite, un seul homme éminent, surtout là où l’écriture est inconnue, peut introduire de grands changements : personne n’étant à même de contester la valeur de ses innovations, elles commencent par être à la mode et finissent par être consacrées par l’usage.
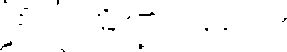
/ -
>
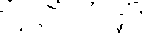
63
DEUXIEME LEÇON.
d’anciens mots étaient tombés en désuétude, de nouveaux mots avaient paru, et, selon toute apparence, J a langue était entièrement changée. .
Rien ne surprit autant les missionnaires jésuites que le nombre infini des dialectes parlés par les indigènes de l’Amérique. Loin d’être une preuve d’une civilisation avancée, cette multiplicité de langues montrait bien, plutôt que les diverses races de l’Amérique ne s’étaient jamais soumises, pendant un certain espace de temps, à une puissante centralisation politique ÿ et quelles n’avaient jamais réussi à fonder de grands empires nationaux. Hervas, il est vrai, réduit tous les dialectes de l’Amérique à onze familles, quatre pour le sud, et sept pour le nord (1) ; mais cette distribution n’a pu être faite qu’au .moyen d’une comparaison attentive et minutieuse, et grâce à cette, méthode qui permet
L’ancien vocabulaire, qui est le meilleur, disparaît. Si l’Angleterre, par exemple, avait été un petit pa)rs, sans autre écrivain distingué que Caiiyle, il n’est pas douteux qu’il n’eût beaucoup modifié notre langue : dans- le cas présent, bien que Caille ait ses imi-taleurs, il n'est guère probable qu’il exerce sur la langue corn-i mune une influence sensible. Voilà pourquoi, dans les pays où ■ l’écriture est inconnue, si la société se divise en petites tribus, la langue change rapidement et toujours pour se détériorer. Les fractions qui se détachent d’une peuplade indienne arrivent, après quelques générations, à parler une langue .qui n’est plus comprise par la tribu dont elles sont sonies. De là vient le nombre considérable de langues qui sont parlées par les petites tribus de chasseurs indiens de l’Amérique septentrionale et méridionale, et qui ont évidemment une origine commune, car leurs principes sont identiques. En conséquence, plus une société est nombreuse, plus la langue qu’éîle parie a de durée; moins la société est nombreuse, moins la langue est durable, et plus la décadence en est rapide. Plus la société est petite, plus le nombre des idées est restreint, et, par suite, moins il y à de mots nécessaires, et plus le vocabulaire y diminue facilement et y perd un grand nombre de termes. » Le docteur Rae. Polyne-sian, n° 23,1862. ' .
(1) Catalogo, !) 393. . . .......
de classer dans la même famille les idiomes parlés
"■ ■ 1
dans l’Islande et dans l’île de Cevlan. Bans.la pratique et pour tout autre qu’un habile philologue, les dialectes de l'Amérique sont distincts ; les tribus qui les parlent ne peuvent se comprendre entre elles. '
Kous entendons faire les mêmes observations partout où la végétation libre et luxuriante des dialectes a été étudiée par des observateurs intelligents. Si nous nous tournons vers l’empire birman, nous trouvons que le birman a produit une littérature considérable, et que c’est lâ langue généralement, adoptée non-seulement dans le Birman proprement dit, mais aussi dans le Pégu et dans l’Àrracan. Mais les montagnes presque inaccessibles de la péninsule de l’Iraouaddy offrent un asile sûr à beaucoup de peuplades indépendantes qui parlent des dialectes qui leur sont propres (1), eh dans le seul voisinage de Manipura, le capitaine, Gordon n’a pas recueilli moins de douze dialectes distincts, « dont quelques-uns, dit-il, ne sont pas parlés par plus de trente ou quarante familles , et qui sont pourtant si differents des autres, qu’ils sont complètement inintelligibles pour les plus proches voisins de ceux qui les emploient. » Brown, l’excellent missionnaire américain, qui a passé toute sa vie à prêcher l’Évangile dans cette partie du monde, nous raconte que plusieurs bandes d’émigrants qui avaient quitté leur village natal pour aller s’établir dans une autre vallée ne pouvaient plus se faire comprendre de la tribu mère, après deux ou trois générations (2).
Dans le nord de l’Asie, au dire de Messerschmidt, les Ostiâks, bien que pariant une langue qui est. au
(î) Max Muller, Lettre'sur les Langues tour antennes, p, Ü4. (2) Id., ibid,, p. 223.
fond, la même partout, ont créé tant de formes et de mots particuliers à chaque tribu, qu’à la distance de douze ou vingt mille allemands, les rapports deviennent très-difficiles entre eux. Caslrèn, le courageux explorateur des contrées et des langues de l’Asie septentrionale et centrale (1), nous assure que plusieurs des dialectes mongols commencent à entrer dans une nouvelle période de vie grammaticale, et que, tandis que la langue littéraire des
Mongols n’a pas de désinence pour les personnes du
* . * • ^ . verbe, ce trait caractéristique de la famille touranienne
s’est montré dernièrement dans les dialectes parlés des Buriates et dans les idiomes tongous, près de Kjertschinsk, en Sibérie. . .
Citons encore une observation analogue, que nous lisons dans les Tableaux et travaux de la vie d'un mission-’■ naire dans le -sud de l’Afrique, par Robert Moffat : « La pureté et Tharmonie de'leiir langage-, dit-il, sont conservées par Jeurs/^e/ms ou assemblées publiques, par leurs fêtes et leurs cérémonies, aussi bien que parleurs chants et par leurs relations journalières. La position est bien ; différente pour les habitants épars du désert; chez eux, i ces réunions n’existent pas, et bien souvent ils sont for' cés de quitter leur village natal et de s’en aller a une ■ grande distance à travers la solitude; dans ces occasions, les pères, les mères et tous ceux qui peuvent porter un fardeau partent fréquemment pour des semaines tous à la fois, laissant les enfants aux soins de deux ou trois vieillards infirmés. Parmi ces enfants, les uns commencent à balbutier quelques mots, d’autres savent, déjà s’exprimer et faire des phrases entières, et, jouant tous ensemble du
matin jusqu’au soir, ils s’habituent à un langage à eux; les
*
plus avancés se mettent à la portée des plus jeunes, et de (1) Max Millier, p. 30.
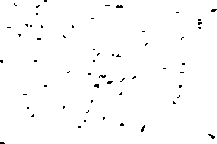
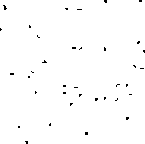
66 LEÇONS SDR LA. SCIENCE'DU LANGAGE.
. iT - . , . ' " -
.celle Babel naît un dialecte nouveau, composé de mots hybrides joints ensemble sans aucune règle, èt ainsi,-dans le cours d’une seule génération, tout le caractère de la -langue se trouve changé. » '
Telle est la vie du langage à l’état dénaturé (î), et nous sommes en droit de conclure qu’ainsi se sont développées les langues qu’il nous est impossible d’observer avant qu elles aient subi le joug de la littérature. Il n’est pas besoin d’une littérature, écrite ou classique pour donner à un dialecte la primauté sur beaucoup d’autres, et à ses caractères particuliers une légitime influence ; les discours prononcés dans les. assemblées publiques, les ballades populaires, les lois nationales, les oracles religieux produisent le même effet, bien qu’à un moindre degré ; ils servent comme de digues au courant du langage et Fera-pêchent de se répandre sans cesse dans les innombrables
canaux des dialectes, et ils donnent la permanence à cer-
■ % . * * . -
laines formes qui; sans ces influences extérieures, n’auraient eu qu’üne existence éphémère. Quoique le moment, ne soit pas encore venu d’approfondir le problème de l’origine du langage, il y a une chose que dès maintenant nous pouvons voir clairement, c’est que, quelle qu’ait été cette origine, la première tendance du langage a été vers . une variété sans bornes. Contre cette tendance, cependant, il y a eu, dès le principe, un frein naturel qui a préparé le développement des langues nationales et littéraires ; la langue du père devint, celle d’une famille, la langue d’une famille devint celle d’une tribu (2). Dans une seule et même tribu les différentes familles conservaient entre
' (i) Voyez Schelling, Œuvres, t. i,p. 114. .
■ (5) Derham mentionne le cas d’n ne femme qui mourut à quatre-vingt-treize ans, et qui avait donné naissance à seize enfants, dont onze se marièrent. A sa mort, elle avait cent quatorze petits-enfants, deux cent vingt-huit arrière-petits-enfants, et neuf cents arrière- :

elles leurs expressions et leurs formes familières; elles créaient de nouveaux mots , dont quelques-uns si étranges et si bizarres que le reste de la communauté pouvait à peine les comprendre. De telles expressions étaient naturellement supprimées dans les grandes réunions ou tous les membres de la tribu venaient discuter les intérêts généraux, comme les locutions de nos provinces, sont exclues de nos salons ; mais cela même était une raison pour qu’on s’affectionnât d’autant plus à ces mots, autour du feu de chaque tente, à mesure que le dialecte général de la tribu prenait un caractère plus déter
miné. Puis apparaissaient les dialectes des différentes' classes, des domestiques, des palefreniers, des bergers, des soldats ; les femmes avaient aussi leurs mots pour le ménage, et une génération nouvelle ne manquait pas de se faire une phraséologie plus vive et où elle avait mis sa marque. Nous-mêmes, dans ce siècle littéraire, et séparés . comme nous le.sommes, par des milliers d’années, de ces premiers pères du langage, s nous ne parlons pas chez nous comme.nous parlons en public. Les mêmes circonstances d’où sort la langue générale d’une tribu, en. tant qu’elle diffère des dialectes des familles, produisent, sur une plus vaste échelle, les langues de confédérations de
"r‘ «■ L
tribus, de colonies ou de nationalités naissantes. Avant
■ ■ * ■ , ■ ’■ , ■■
qu’il y ait une langue nationale, il y a toujours des cen* +
taines de dialectes ou de patois, dans les districts, les villes, les villages, les tribus et les familles; et, bien que les progrès de la civilisation et de la centralisation tendent à en réduire le nombre et à en affaiblir les traits, ils ne les ont pas encore fait disparaître, même de notre temps.
arrière-petits-enfants. Supposant qu'elle se fût mariée, à dix-sept ans, elle avait donc, dans l’espace de soixante-seize ans, été la souche de douze cent cinquante-huit descendants. Lobscheid, EngUsh and Chinese Dictionary, 186G. . . . .
Maintenant examinons de nouveau ce qu’on appelle communément l’histoire, mais ce qui devrait être appelé le développement naturel du langage, et il nous sera facile de voir que ce développement est en grande partie le résultat des deux opérations que nous venons d’étudier, l'altération phonétique et le renouvellement ou le développement dialectal. Prenons les six langues romanes, qu’on a l’habitude de nommer les filles du latin. Je ne vois pas d’inconvénient à appliquer aux langues ces noms de mère et de fille, pourvu que nous ne laissions pas des termes en apparence si clairs et si simples couvrir des conceptions vagues et obscures; or, si nous appelons la langue italienne fille du latin, nous ne voulons nullement attribuer à l’italien un nouveau principe de vie, car pas un seul radical nouveau n’a été créé pour le former; c’est du latin sous une nouvelle forme, du latin moderne, ou bien encore le latin est de .l’italien ancien. Les noms de mère et de fille ne marquent que des périodes dans le développement d’une, langue dont le fonds est le même. Dire que le latin est mort en donnant naissance à sa fille, c’est encore faire de la mythologie, et on pourrait facilement.prouver que le latin était encore une langue vivante quand depuis longtemps déjà l’italien avait appris à voler de ses propres ailes. Tâchons seulement de voir clairement ce que nous entendons par le latin. Le latin classique est un.des nombreux dialectes parlés par les habitants aryens de l'Italie ; c’était le dialecte du Latium, dans le Latium le dialecte de Rome, à Rome le dialecte des patriciens. Il fut fixé par Livius Androniciis, Ennius, Kævius, Caton et Lucrèce, et poli par les Scipions, les Hortensius, les Cicéron ; ce fut la langue d’une classe limitée, d’un parti politique et d’une = école littéraire. Avant l’âge où brillèrent ces poètes et ces orateurs, la langue de Rome a dû éprouver des fluctuations et des changements considérables : Polvbe nous dit (II,
- J.
23). que les Romains les plus instruits ne pouvaient traduire sans difficulté les anciens traités eutre Rome et Car-
^ T ■ _ ' ' ’
thage; Horace avoue ([BpII, i, 86) qu’il ne comprenait pasles vieuxpoëmes saliens, et il donne à entendre qu aucun de ses contemporains n’était plus avancé que lui à cet égard ; Quintilien (I, vi, 40) nous assure que les prêtres saliens eux-mêmes pouvaient à peine comprendre leurs hymnes sacrés. Si les plébéiens avaient eu le dessus au lieu des patriciens, le latin eût été fort différent de ce qu’il est dans Cicéron, et nous savons que Cicéron lui-même, avant été élevé à.Arpinum, fut obligé, quand il commença à fréquenter la haute société et qu’il eut à écrire pour ses nouveaux amis les nobles, de se corriger de quelques provincial i s mes, parmi lesquels on cite l’habitude qu’il avait de laisser tomber l’s à la fin des mots (1). Après avoir été adopté comme la langue de la législation, de la religion, de la littérature et de la civilisation générale, le latin classique devint fixé et immobile. Il ne pouvait plus se développer, parce qu’il ne lui était plus permis de changer ni de dévier de sa correction classique ; il était comme poursuivi par son propre fantôme. Lès dialectes littéraires, ou ce qu’on appelle généralement les langues- classiques, achètent leur empire temporaire au prix d'un dépérissement inévitable. On pourrait lés comparer à des lacs
d’eau stagnante qui. s’ouvriraient à côté de grands fleuves
* - J ^
et leur serviraient, de déversoirs ; ce s'ont comme de vastes réservoirs qui reçoivent et retiennent tout ce qui était jadis vive et courante parole ; le puissant flot du langage
(1) Quintilien, IX, 4. « Nam neque Lucilium -putantuli eadem (s) , ullima, cum dicit Serenu fuit, et Dignu loeo. Quin eliam Cicero in Oratore plures anliquorum liadil sic locutos. » Dans certaines phrases î’s finale était omise dans la conversation: abin, pour abisne : viden, pour videsne: opu’st, pour opus est ; conabere, pour conaberis, etc. ... . . ..
a cessé d’entraîner avec lui, de pousser en avant ces ondes immobiles et comme endormies. Il semble parfois' que le fleuve tout entier se perde dans ces lacs, et c’est à peine si nous pouvons distinguer les maigres filets d’eau qui coulent encore au fond du lit principal ; mais si plus bas, c’est-à-dire plus tard dans l’histoire, nous trouvons un nouveau lac immobile, tout formé, ou en train de se former, nous pouvons être sûrs que ses affluents ont été ces mêmes petits ruisseaux qui s’étalent presque dérobés à notre vue.
Il serait peut-être plus exact de comparer un idiome classique ou littéraire à la glace qui se forme à la surface d’un fleuve, et qui. est transparente et unie, mais dure et froide. C’est, le plus souvent, à la suite de commotions politiques que cette glace des langues cultivées et polies est brisée et emportée par les eaux qui grossissent au-dessous : quand les classes supérieures de la société sont écrasées dans des luttes religieuses et sociales, ou quelles s’allient aux classes inférieures pour repousser l’invasion étrangère; quand les travaux d’esprit sont découragés,.les palais brûlés, les monastères pillés et les demeures de la science détruites; alors les dialectes populaires, ou vulgaires. ainsi qu’on les appelle, qui n’avaient jamais cessé de former un courant d’eau vive sous la surface diaphane du langage littéraire, montent tout à.coup, et charrient, comme les eaux au printemps, les lourds glaçons de l’époque précédente. Dans des temps plus tranquilles, il surgit une littérature nouvelle et populaire dans une langue qui semble devoir son existence aux conquêtes et aux révolutions, mais qui, en réalité, existait et se développait depuis longtemps déjà, et que les événements historiques n'ont fait que produire au jour quand' elle était toute formée. De ce point de vue, il nous est facile de voir qu’aucune langue littéraire ne peut jamais être appelée la mère d’une
autre langue. Aussitôt quune langue se préoccupe de ses formes et de ses mots perdus,, qu’elle cesse de pouvoir se modifier .indéfiniment et de pouvoir répondre sur-le-champ à tous les besoins de l’esprit et du .cœur, sa vie naturelle se change en une existence purement artificielle. Elle peut encore vivre longtemps, mais, tandis qu’on la considère comme le tronc de l’arbre, elle n’est réellement qu’une branche rompue et fanée qui se sépare insensiblement de la tige d’où elle était sortie. Ce n’est pas dans la littérature classique de Rome, mais dans les dialectes populaires de l’Italie, quil faut chercher les sources de l’italien. L’anglais n’a pas seulement été formé de l’anglo-saxon du Wessex, mais des dialectes parlés dans toutes les parties de la Grande-Bretagne avec toutes leurs différences locales
iT . - ' ' , , ■ . " , , - ■ 1
et-les modifications qu’y a apportées, à diverses époques,
. ^ .
l’introduction d’éléments étrangers, du latin, du danois, du normand et du français. Plusieurs des patois qu’on parle aujourd’hui en Angleterre sont d’une grande importance pour l’étude critique de l’anglais, et un prince français, qui habite en ce moment l’Angleterre (1), s’est fait beaucoup d’honneur en recueillant ce qui peut encore être sauvé des patois anglais. La langue connue sous le nom d’hindoustani n’est pas fille du sanscrit tel que .nous le trouvons dans les védas oü dans la littérature postérieure
r m ‘
des brahmanes : c’est une branche de l’idiome parlé de l’Inde, sortie de la même tige d’où sortait le sanscrit au moment où il conquit son indépendance littéraire.
En tâchant,' comme je l’ai fait, de montrer clairement comment les dialectes alimentent et renouvellent le langage, je paraîtrai peut-être à quelques-uns de mes auditeurs en a voir, exagéré l’importance". Sans doute, si mon but avait été différent, il m’eût été facile de prouver que
(1) Le prince Lucien Bonaparte.
sans la culture littéraire le langage n’aurait jamais pris ce caractère déterminé qui est essentiel pour la communication de la pensée; qu’il n’aurait jamais atteint sa fin la plus noble, mais qu’il serait resté toujours le jargon de sauvages troglodytes : mais, comme il n’est pas à craindre que l'importance des langues littéraires soit méconnue, tandis que personne n’avait encore fait ressortir i’impor-tance des dialectes en tant qu’ils contribuent au' développement. du langage, il m’a semblé préférable de m’étendre sur les avantages que les langues littéraires tirent des dialectes, plutôt que sur les services rendus à ces derniers par les langues littéraires. Eli outre, mon principal objet aujourd’hui était d’expliquer le développement, du langage, et pour cela il est impossible d’exagérer l’importance de la végétation incessante, quoique à peine apparente, des dialectes. Arrachez un idiome de son sol natal,, éloignez-le des dialectes qui le nourrissent; et vous en arrêtez immédiatement la croissance. L’altération phonétique fera encore ses ravages, mais l’influence réparatrice de la régénération dialectale ne se fera plus sentir. La langue que les réfugiés norvégiens portèrent avec eux en Islande n’a presque pas varié depuis sept siècles, taudis que sur-son sol natal et entourée de patois elle s’est développée et s’est scindée en deux langues distinctes, le suédois et le danois. On croit que, dans le onzième siècle, le langage était identique en Suède, en Danemark et en Islande (!), et il n’y a pas eu de conquête ni de mélange de sang étranger pour expliquer les modifications que ce langage a su' 1 ■■ - r .
bies en Suède et en Danemark, tandis qu’en Islande il n’en éprouvait aucune (2). •
(1) Marsh, Lccturesi p. 133, 368.
(2) « II y a moins (3c locutions et de prononciations particulières à cei Laines localités, dans le vaste territoire des États-Unis, que
Il est presque impossible de nous faire une idée de l’intarissable fécondité des dialectes : là où les langues littéraires ont stéréotypé un ternie général, leurs dialectes nous en offrent cinquante ayant chacun leur nuance de
signification.
Si de nouvelles idées naissent, et se développent par suite du progrès de la société, les dialectes fournissent immédiatement les termes nécessaires qu’ils puisent dans les trésors de leurs mots prétendus inutiles. Il n’y a pas seulement les dialectes dès localités et des provinces, mais encore des . classes et des professions, comme, par exemple, des bergers, des chasseurs, des soldats, des fermiers : (4) . .
Parmi ceux qui m’écoutent il y a peut-être bien des personnes qui ne pourraient pas dire quelle est la signification exacte du garrot, du tronçon, du paturon, du boulet, de la couronne d’un cheval; et, tandis que la langue littéraire parle des petits de toutes sortes d’animaux, les fermiers, les bergers etles chasseurs rougiraient
d’employer un terme aussi général.
«. L’idiome des tribus nomades, dit Grimm, est bien riche en expressions diverses pour désigner les différentes espèces d’épées et d’armes dont elles se servent, et pour indiquer les différentes périodes de la vie de. leur bétail. Dans une langue plus cultivée, ces expressions deviennent
sur le soi comparativement étroit de la Grande-Bretagne. « Marsh, p. 667. (Qn pourrait faire la même observation à propos du français Lcl qu’il s’est conservé et qu’il est parlé aujourd’hui encore au Canada. Tr.) . ' '
(J)-Nos mots nobles qui-remplissent les dictionnaires ne sont pour les gens sans éducation que des sons vides, qui ne réussissent pointa évoquer dans leur esprit l’image de rien de réel et de vivant. Aussi créent-ils pour leur propre usage des termes nouveaux, qui, ijoul2 la plupart, on ne saurait le nier, appartiennent à la catégorie du grotesque,.mais qui ont autant de vie et d’énergie que toute une bande de polissons des.rues..
Pour eux, une clïosë . n’est pas overpowering (accablante), c’est
fatigantes et superflues; mais le-paysan conserve des termes particuliers pour désigner la gestation, l'accouchement et l’abattage, suivant qu’il s'agit de tel ou tel animal, de même que le chasseur aime à donner des noms différents aux allures et aux membres des différentes espèces de'gibier. Les yeux des bergers, qui vivent en plein air, sont plus perçants, leur oreille est plus line que les nôtres ; comment leur langage n’aurait-il pas pris ce caractère de vivante exactitude et cette Variété pittoresque^)?» ,
a stunner, ce qui répondrait assez au mot étourdissante ou renversante du Français. On ne dit pas qu’elle marche d’une manière satisfaisante, mais qu’elle, m comme une heure (it goes like one o’ dock), c’est-à-dire avec autant de célérité qu'un ouvrier en met à aller diner quand la cloche de l'usine sonne une heure. Par suite de la même disposition à chercher des rapprochements grotesques, des images imprévues et familières, Je matelot anglais appelle tiger (tigr-e)-le- morceau de lard que rayent- des .bandes de gras-et- de maigre, et le cocher de fiacre parisien, quand il parle de prendre un verre d absinthe, faisant allusion à la couleur verte du liquide, dit qu’il va étrangler le 'perroquet. Parce que ces expressions sont vulgaires, refuser d'y voir de la poésie, c’est comme si l’on disait d’un morceau de houille que ce n’est point du carbone, parce qu’il n’est pas du diamant. Beaucoup des images des vieilles sagas norvégiennes peuvent être traitées d'argot au même litre que bien des alliances de mots chères au gamin des rues de Londres ou au membre du congrès américain. Pour ne prendre.qu’un exemple, un poêle islandais désigne ainsi le commencement de la bataille : « C’ést le moment où commencent à-s'agiter les jambes noires. » Les dites jambes noires ne sont là ni plus ni moins que les poignées des haches de batailles. ' . 2
Toutefois ce que j’avais surtout à cœur de montrer dans cétte leçon, c’est que ni l’une ni l’autre des causes qui produisent le développement, ou qui constituent, selon d’autres, l’histoire du langage, ne dépendent de la volonté de l’homme. L’altération phonétique des langues n’est pas un résultat fortuit; elle est régie par des lois précises,, comme nous le verrons quand nous, viendrons à étudier les principes de la grammaire comparée ; mais ces lois n’ont pas été faites par l’.homme; l’homme a dû, au contraire, s y soumettre avant même d’en connaître l’existence. • • ; .
/
. Dans le passage du latin aux langues romanes modernes nous pouvons apercevoir non-seulement une propension générale à la simplification et une disposition naturelle à éviter l’effort que nécessite ]a prononciation de. certaines consonnes et encore plus des groupes de consonnes ; mais nous pouvons découvrir pour chacun des dialectes romans des lois qui nous permettent de dire : par exemple, que le latin patrem devait naturellement donner père en français. Les langues romanes laissent toujours tomber Ym finale, comme, du reste, cela avait aussi lieu en latin ; nous obtenons donc, d’abord, paire au lieu de patrem : maintenant, un t latin entre deux voyelles, dans des mots
' de grandes foules, mais dire : « a congrégation of people, a hoost. of men, a fetyshvppj'nge of yomen, and a bev}7 of ladies; aherde of dere, svrann37s, cran y s or/wrenys, a sege of hérons or bytourys, a muster of pêcockes, a watche of nyghlyngales, a flyghte of doves, a claterynge of chougbes, a piyde of lj^ons, a slewthe-of . beeres, a gagle of ge3rs, a-skulke of foxes, a sculle of frerys, a pon-tifîcality of preslys, a bomynable S37ghl of montes, and a superfluyte of nonnes. « De même en dépeçant le gibier, « a dere was broken,. a gose reryd, chekyn frusshed, a cony unlaced, a crâne d}7spia3red, a curlewe unio3rnied, a quidyle wyngg3rd, a swanne ïyfLe, a Ïambe sholdered, a héron dysmenbiyd, a pecocke dysfygured, a samon chyn}rd, a hadoke syd3Td, a sodé loynvd, and a breme splayed. « [Celte sjmonymie est intraduisibie-i Tr.] . . .:
commepaler, est. 'invariablement supprimé en français ; c’est là une loi constante qui nous permet de dire sur-le-champ que catena doit donner chaîne, fata (forme féminine plus récente du vieux; neutre fatum) fée,, pr aluni, pré. De pratum nous dérivons prataria qui devient le français prairie; de fatum falaria, l’anglais fairy. De même tous les participes latins en alus, comme amalus, doivent se terminer en français par é, aimé. La même loi a donc changé pâtre (prononcé palere) en paere, ou père : malrem en mère, fratrem en frère. Ces changements se font d’une manière insensible, mais irrésistible, et. ce qui est surtout important-à remarquer, ils ne sont en aucune façon soumis au caprice ou à la volonté de l’homme. .
Le développement des dialectes est encore plus indépendant delà volonté des individus; car, quoiqu’un poète puisse inventer sciemment et avec intention un mot nouveau, le succès de ce mot et son admission dans l’usage dépendent de circonstances sur lesquelles l’inventeur n’a aucun empire. Il y a certains changements dans la grammaire qui, à première vue, sembleraient devoir être attribués en grande partie au caprice ; tout en accordant, par exemple, que la perte des désinences latines fût. le résultat d’une prononciatioii plus négligée, et que le signe moderne du génitif français, du, est une corruption naturelle du latin de illo, cependant le choix de de, au lieu de tout autre mot, pour exprimer le génitif et le choix de illo, au lieu de tout autre pronom, pour exprimer l’article, sembleraient prouver que l’homme a agi librement dans la formation du langage : mais cela n’est pas. Aucun individu n’aurait pu se mettre, de propos délibéré, à abolir le vieux génitif latin pour le remplacer par la périphrase de illo. Il fallait que l’inconvénient de n’avoir aucun signe distinctif pour le génitif se fît sentir au peuple qui parlait un dialecte latin. vulgaire. Il fallait que le même peuple
eût déjà employé la préposition de en perdant complètement de vue sa signification originale d’adverbe de lieu (nous voyons dans Horace, par exemple, una de multis-, une sur beaucoup). Il fallait encore que le même peuple eût senti le besoin d’un article, et employé déjà üle dans une foule de locutions où ce mot semblait avoir perdu sa force primitive comme pronom. La réunion de toutes ces conditions était nécessaire avant qu’un individu, et après lui un autreyet ensuite des centaines, des milliers et des millions d’hommes, pussent employer die Mo comme signe du génitif, et le changer en l’italien dello, deî, et le français du. .
Les tentatives des grammairiens et .des puristes pour
■ - j
perfectionner le langage sont entièrement vaines, et il est probable que nous n’entendrons plus parler de projets pour émonder les langues et les débarrasser de leurs irrégularités. Il est bien, probable, cependant, que la disparition graduelle des déclinaisons et des conjugaisons irrégulières est due, dans les langues littéraires comme dans celles qui ne sont pas cultivées, au parler des enfants. Leur iangue, en effet, est plus régulière que la nôtre : qui
n’a entendu des enfants, en Angleterre, dire badder et
^ * Æ
baddest, au lieu de worse et worst, 1 comd au lieu de I came, ou se servir, en France, d’expressions comme plus bon, ü venira, il a ouvri la porte f Dans Purdù, le suffixe de l’adjectif possessif était anciennement rà, ré, ri. Maintenant c’est kà, hé, là, excepté dans hamarà mon, notre, et dans lumhàrà votre, ainsi que dans un petit nombre d’autres mots, tous pronoms. Mon ami, le Dr Filz Edward Hall, me dit avoir entendu dans l’Inde des enfants créer et employer les formes hamhà et tumhà. C’est ce sentiment de justesse grammaticale, ce généreux instinct de ce qui devait être, qui, dans le cours des siècles, a éliminé un si grand nombre de ces formes qu’on appelle irrégulières.
Ainsi, le verbe auxiliaire en latin était fort irrégulier : si sumus est la première personne du pluriel, et sunt la troisième, la seconde, du moins selon la logique rigoureuse des enfants, aurait dû être sutis. Il est vrai que cette . forme sonne comme barbare à une oreille classique accoutumée à estis, et nous voyons que le français a conservé exactement les formes latines dans nous sommes, vous êtes, ■ils sont: mais en espagnol nous trouvons somos, sois, son, et ce sois remplace sutis. Nous trouvons des traces semblables de nivellement grammatical dans Filaiien siamo, siete, sono, formé d’après l’analogie des verbes réguliers comme crediamo, credete, credono. La seconde personne sei, au lieu de es/est également, de la grammaire à la mode des enfants, ainsi que les formes valaques sîintemu, nous sommes, simteii, vous êtes, qui tirent leur origine de la troisième personne du pluriel sunt, ils sont : et que dire d’une monstruosité comme essendo, gérondif dérivé d’après des principes parfaitement justes, d’un infinitif essere, comme credendo de credere (1 ) 1 II ne faut pas, cependant, trop nous en étonner, car nous trouvons de semblables barbarismes en anglais. Même en anglo-saxon, la troisième personne du pluriel, sind, a, par une fausse analogie, prêté sa forme à la première et à la seconde personne, et a pris une nouvelle terminaison, on, qui appartient proprement au pluriel de l’imparfait. Dans l’ancien dialecte northumbrien., la première personne du pluriel a été employée pour la seconde et la troisième, avec cette même terminaison en on de l’imparfait (2).
(1) Des formes analogues, qui se rencontrent dans les patois français, ont été recueillies par le comte .Jaubert, dans son Glossaire du Centre cle la France, deuxième édition, p. XII.
(2) Grimm, Geschichte der deuischen Sproche, p. 666.
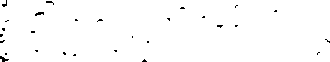
h
s.
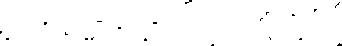
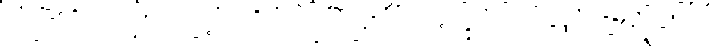

DEUXIÈME LEÇON
Anglais Northumbrien Ancien nordique Anglo-Saxon Gothique
we are aron ër-um siud(on), beo-u sijum (1)
you are aron ■ ër-ô sind(on), beo-Ô sijuth
theyare(2) aron ër-u sind(on), beo o sind
" * . _ . ■
. *
IS’ous entendons dans les patois 1 be pour 1 am, comme en France, favions pour f avais,. et mille formes semblables. . .
Les remarques suivantes, empruntées à un journal américain et signées Marcel, décrivent les changements que l’anglais a subis dans la bouche des nègres, sur les plantations des états du sud. Elles jettent beaucoup de jour sur la. manière dont changent les langues, surtout les langues qu’une race inférieure emprunte à une race plus civilisée. ' . . '
« Le parler .nègre, tel que nous le trouvons dans les livres, lie ressemble guère, à celui dès- nègres de Port-Royal, qui étaient si isolés qu’ils semblent s’être créé un dialecte qui leur est propre. Dé fait, chaque plantation a son usage particulier, et les connaisseurs prétendent pouvoir reconnaître, au langage d’un_ nègre, à quelle partie
: 0) Les formes gothiques sijum et sijuth ne sont pas organiques.
: Elles ont été dérivées par une fausse analogie de la troisième per
! sonne du pluriel sind, ou bien une nouvelle base sij a été formée du subjonctif sijau, le sanscrit syâm. '
(2) L’origine Scandinave de ces formes anglaises , a été bien prouvée par le docteur Loltner, Transactions of the Philological Society, 4861, p. 63. La troisième personne du pluriel-sous la forme aran au lieu de aron, se trouve , dans ILemble, Codex diplomaticus ævi saxonici, vol. I, p. 235 (À. IL 805 861) ; les invasions danoises commençant vers 787, il n’est guère admissible que aran ait été emprunté à la conjugaison danoise. Aron ne se trouve pas dans Layamon. Nous voyons cette forme écrite arm dans POrmulum, mais.’ même dans Cbaucer, elle ne se rencontre que deux fois, quoique, bienLôt après, ce soit devenu la forme consacrée du pluriel. Voyez Genesius, De Lingua Chauceri, p. 72 ; Monicke, On the « Ormulum, » p. 35. .
80 ■ LEÇONS SUR LA SCIENCE DU LANGAGE.
£ ■ .
de l’une des îles il appartient, ou même, dans quelques cas, sur quelle plantation il est établi. Mes observations personnelles ont été limitées à quelques plantations dans le district nord de l’île de Sainte-Hélène. .
s - *■
« Chez ces gens la marche de l’altération phonétique paraît être allée aussi loin peut-être qu’il est possible, et avec elle la plus extrême simplification des formes grammaticales et de la syntaxe. On observe chez eux l’adoucissement ordinaire de th et de v en d et b, ainsi qu’une fréquente confusion de v et de tu; on dit veeds et vell pour weeds et well. De mile sinner may return, pour the viles t, etc.; le plus misérable pécheur peut se convertir. Cette dernière phrase fournit aussi un exemple du goût qu'ils ont pour des syncopes qui retranchent des syllabes entières, ainsi leë pour Utile, plant’shcen pour plantation. Ces deux mots nous offrent un exemple de l’allongement des voyelles brèves; a, par exemple, n’a jamais le son bref anglais, mais a toujours le son plus-ouvert qu’on lui donne en italien. Les observations précédentes trouvent leur vérification dans l’hymnè suivant : •
Meet, o Lord, on de mille white horse,
An’ de nineteen wile [vial] in bis han\
Drop on, drop on de crown on my head,
An’ rollv in my Jésus’ arm.
%, '
E’en [in] dat mornin’ail day,
When Jésus de Chris’ bin born.
« Les images de cet hymne sont évidemment tirées de l'Apocalypse, comme le prouve encore la seconde stance, où nous trouvons un curieux exemple du tour que les idées et la phraséologie de l’écriture prennent dans ces esprits ignorants :
« Moon went into de poplar tree,
. « An’ star vent into blood . »
« Observons, en passant, que ces cantiques ne suffisent pas à montrer jusqu’où est allée l’altération de la langue. Etant généralement empruntés, par lambeaux de phrases, à l’écriture ou aux hymnes que ces pauvres gens ont entendu chanter par.lés blancs, ces chants conservent des mots et des formes grammaticales que l’on entend rarement dans la conversation. Le parler ordinaire de ces nègres , avec ce qu’il y a de bizarre, dans ses mots et. sa prononciation, dans ses abréviations et ses modulations rhÿthmiques, sonne à l’oreille qui n’y est pas habituée comme une langue étrangère/ ; : .
. « Ces mots étranges sont cependant moins nombreux que l’on ne serait disposé à le croire. Il y a yedde pour. heard, comme dans le plus touchant de leurs cantiques :
« O my siri is forgiben and my soûl set -free, u An’ I yedde from heaben to-day. »
Sh’uin, corruption de seem pour sec lhem, s’applique aux trois genres et aux deux nombres. Huddy (pour how d'ye do ?) est prononcé how-dy par les puristes. Ce n’est pas l’irrévérence, mais une affectueuse dévotion, qui a inspiré le naïf cantique :........
« In de mornin’ when I rise,
« Tell my Jésus huddy O, - ■ -
- « Wash my han’ in de mornin’ glory. »
Etcetc. . .
« Studdy (pour steady, ferme, constant) est employé
pour désigner toute action continue ou habituelle. île
studdy'buse an cuss iiie; il ne fait que m’injurier et me dire
des sottises ; » c’est en ces termes qu’un des enfants de
l’école se plaignait, d’un autre. Ce mot de cuss (pour curse,
jurer) ils remploient dans un sens très-large pour toute
espèce d’expression injurieuse. « île cuss me « git oui »,
6

— lia eu l’insolence de rae dire '<< veux-tu bien t’en aller, » disait un autre. « Âhvy (Abby : dans ce cas le b est devenu un v) do eus s me. — Ahvy me dit des gros mots; » c’est ainsi qu’une petite fille accusait sa camarade de banc.
Ils se servent rarement du mot bolh « tous les deux; » en général ils disent « ail two, » ou quancî ils veulent insister, « all-two boff togelher. » One pour alone. « Me one an God, moi seul et Dieu, » fut la réponse d’un vieillard de Charles ton à qui je demandais s’il s’était échappé tout seul de sa plantation. « Eeaben ’nuff for one one,de ciel me suffit, » dit un de leurs hvmnes. -Talk est un de leurs
‘ - , - kJ
mots les plus ordinaires, là où nous nous servirions de speak ou de onean. « Talk nie, sir? Est-ce à moi que vous
' N
parlez, monsieur? » demande un enfant qui ne' sait pas bien si c’est à lui ou à son camarade que vous vous adressez. Je m’informais si un certain maître avait l’habitude dé fouetter ses esclaves : « Talk lickfsïrt hufftn but liék, il ne connaît que les coups, monsieur, rien que les coups.» me répondit-on.
« Les lettres net y sont souvent introduites par euphonie. Je ne me souviens en ce moment de n que devant un u long, comme dans n’Europe, oïUnited siales, no n’use; mais je pense qu’on l’emploie encore avec d’autres voyelles. De cet y euphonique je ne me rappelle qu’un exemple ; j’aurai l’occasion de le citer un peu plus loin. Voici d’ailleurs, ce me semble, la plus curieuse de toutes les particularités que présente leur langue. Les nègres, on le sait,
■■ æ ~
dans tout le sud, parlent des gens âgés de leur condition en leur donnant les titres d’one/e et de tante, habitude qui provient d’un scrupule de politesse; il semblait irrespectueux d’employer le nom tout sec, et lès termes Mister, et Mistress étaient réservés aux blancs. Dans les Antilles, la même préoccupation a conduit les nègres à se servir, avec
\

83
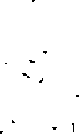
DEUXIEME LEÇON.
leurs égaux, du mot cousin. L’abrégeant à leur manière,
i* A t ■
ils obtiennent co’n ou co (l’o ayant là le son de Vu bref anglais ou deeu français), et c’est ainsi qu'ils sèdésignent l’un l’autre. C’Abram, Co’Robin, Co’n Emma, C’Isaac, Co’Bob, voilà ce qu’on entend à tout moment. J’ai entendu, mais rarement, employer de la même manière Bro* (brofher, frère); ainsi dans le cantique
Bro’ Bill, y ou ought to know my came, Mv name is wrillen in de book of life.
« J’en-viens maintenant à la grammaire, et je pourrais être tenté de répéter à ce sujet une très-vieille plaisanterie, de dire qu’il n’y a point de grammaire ; il n’y à probablement point de langue qui ait moins de flexions que celle de ces nègres. Pas de distinctions de cas, de nombre,
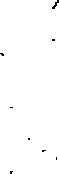
; de temps ou de voix; à peine en fait-on pour les genres. Peut-être ai-je tort de dire qu’il n’y a point de nombre, car on fait cette distinction dans les pronoms, et queîques-uns des plus intelligents la font, par moments, aussi dans ! les noms. Mais d’ordinaire Sandy liai signifiera indifle-; rem ment Sandy’s liai ou hais, le chapeau ou les chapeaux ! de Sandy; dem cow est pluriel, dalcoio, singulier; nigger house veut dire un groupe de maisons nègres et fait un vrai pluriel. Pour ce qui est des cas, je ne crois point avoir jamais entendu un génitif possessif marqué par le s, mais ils ont commencé à créer une manière d’indiquer ce rapport qui jette un jour curieux sur le procédé par lequel les flexions se sont, développées dans d’autres langues. S’ils désirent insister sur le fait de la possession, ils emploient, en le mettant après le nom du possesseur, l’adjectif own, propre à. C’est ainsi qu’ils diront Mosey house, la maison Moïse ; mais si on leur demande à qui est cette maison, la réponse est Mosey own, Moïse en pro-
84 LECOJVS SUR LÀ. SCIENCE DU LANGAGE.
&
pre. Co’ Molsy y’ oion, telle fut la singulière réplique que lit une petite fille, comme on lui demandait à qui était l’enfant qu’elle portait. Co’ c’est le titre dont nous avons parlé, y la lettre euphonique dont nous avions signalé l’emploi.
« Presque tous les pronoms de l’anglais existent dans ce patois, sauf peut-être us. C’est we que l’on emploie d’habitude en place de us. She et lier sont rares ; Mm est le pronom ordinaire pour la troisième personne du singulier, pour tous les genres et tous les cas. Hîm Uck we, elle nous tape, c’est ainsi que quelques petits enfants se plaignaient d’une grande fille. Um est encore plus commun, comme cas indirect, pour tous les genrës et tous les nombres ; ainsi SIi um - (see 'em pour see thenï). . . .
« Ce serait trop dire que d’affirmer que lés verbes n’ont plus de flexions ; mais il est vrai que celles-ci ont presque complètement disparu. Vous demandez à un jeune garçon où il va ; la réponse est gwine crick for ketch crab (going into the creek to catch crabs), allant à la crique pour attraper. des crabes ; -remarquez encore for qui est en général employé au lieu de to, pour marquer l’intention. Yous demandez à un autre où peut bien être le garçon dont vous remarquez l’absence, et la réponse est la même, avec gone au lieu de gwine. Le présent est marqué par l’auxiliaire do ou du, comme dans les refrains Bell da ring (the bell rings), la cloche sonne, Jéricho da vjorry me, Jéricho me tourmente (!). Le passé est exprimé par done, comme dans d’autres- parties du Sud. L'è passé n’est que rarement indiqué, s’il l’est jamais. Ole man call John, um vieux appelé Jean, telle est la ré-
- *
(l) Voyez J.-J. Thomas, Theory and practice of Creole Grammar, 1869, et ies Remarques du même.
V 3
i
DEUXIEME LEÇON.
• Ü
pou se quand vous demandez qui est tel ou tel. Evm mix wid- Mm own fût, on les mêle avec leur propre graisse, c’est ainsi quon me donnait la formule d’une pâte faite de noix de terre écrasées, l’huile même de la noix fournissant le liquide nécessaire au mélange, »
Ces influences diverses qui président au développement et aux changements du langage sont comme les vagues et les vents qui emportent des dépôts au fond de la mer ; là ces dépôts s’amassent et s’accumulent, ils finissent enfin par paraître à la surface de la terre après avoir formé une couche, dont nous pouvons parfaitement analyser les parties constitutives. Cette couche n’a pas été produite, il est vrai, par un principe interne décroissance, et l’ordre où s’y sont déposées les différentes matières n’a point été réglé par les lois immuables de la nature ; mais on ne peut dire pourtant qu’il y ait là un effet du hasard, ou le résultat du caprice et de forces aveugles. Nous ne pouvons apporter trop de soin à bien définir le sens que nous entendons donner aux mots que nous employons. À parler rigoureusement, ni le mot Mstoire, ni le mot développement ne, peuvent s’appliquer aux changements de la mobile surface de la terre.Histoire s’applique aux actions d’agents libres ; développement à l’expansion naturelle d’êtres organiques. Nous parlons toutefois du développement'de la croûte terrestre, et, quand nous parlons du développement du langage, ce mot exprime dans notre pensée quelque chose comme la formation successive des couches terrestres, et nullement comme le mode d’accroissement de la plante. S’il nous est permis d’appeler développement la modification qui se fait avec le temps par des combinaisons toujours nouvelles d’éléments donnés, qui se soustrait.à l’influence d’agents libres, et peut finalement être reconnue comme le produit des forcés de la nature: alors nous pourrons appliquer ce mot
au langage, et nous serons autorisés à classer la philologie comparée parmi les sciences naturelles, et non pas parmi les sciences historiques ou morales.
Il y a une autre objection que nous avons à examiner, examen qui nous aidera encore à comprendre plus clairement le caractère réel du langage. Les grandes périodes que l’on distingue dans la formation des couches terrestres, périodes dont les limites ont été fixées à- l’aide des recherches géologiques, se terminent à peu près quand nous découvrons les premières traces de.la vie humaine,
et quand commence rhistpire.de l’homme dans le sens le
T r ’■ ■'
plus étendu du mot. Les périodes à distinguer dans le développement successif du langage, commencent, au contraire, avec l’histoire de l’homme et sont parallèles à cette histoire. On a donc dit. que, bien que le langage ne soit peut-être pas purement une œuvre artificielle, il serait néanmoins impossible de comprendre la vie elle développement d’une langue quelconque sans la connaissance historique des temps où celte langue s’est développée (4). 11 faut savoir, nous dit-on, si la langue que nous voulons étudier sous la loupe de là grammaire comparée, s’est développée sans culture, chez des peuplades sauvages dépourvues de toute littérature orale ou écrite, en prose ou en vers ; ou bien si elle a été cultivée par des poêles, des; prêtres et des orateurs, et si elle a reçu et conservé fiem-preinte d’un âge classique. En outre, ce sont seulement
les annales de J'histoire politique qui peuvent nous ap. V
prendre si une langue est entrée en contact avec une-autre, combien ce contact a duré, laquelle des deux nations était la plus avancée en civilisation, laquelle fut conquérante el laquelle conquise, laquelle fonda les lois, la religion elles arts du pays, et laquelle a produit le plus
(I) Talis hominibuo oralio, qaalis vüa. Senec., Epist114. [Tf.j
. . DEUXIÈME LEÇON. 87
grand nombre dé philosophes et de poêles populaires, et de démagogues heureux. Toutes- ces questions sont d’un ordre purement historique, et là science qui a tant à demander à l’histoire pourrait bien être considérée comme une anomalie dans le cercle des sciences naturelles.
Si nous cherchons maintenant quelle réponse on peut faire à cette objection, il faut reconnaître d’abord que parmi les sciences naturelles aucune ne se rattache aussi -étroitement à l’histoire de l’homme que la science du langage : mais on peut prouver qu’une connexion semblable existe, bien qua un moindre degré, entre l’histoire de l’homme et d’autres branches des connaissances physiques. En zoologie, par exemple, il n’est pas sans importance de savoir à quel moment de l’histoire, dans quel pays et pour quels usages certains animaux furent apprivoisés et rendus domestiques. Dans l’ethnologie qui est, pour le dire en passant, une science tout à fait distincte de celle du langage, il serait difficile d’expliquer l’existence du type caucasieu chez la race mongole en Hongrie, ou chez la race tartare en Turquie, si les documents écrits ne nous apprenaient les migrations et rétablissement en Europe de tribus mongoles et tartares. Un botaniste qui aurait à comparer ensemble divers échantillons de seigle aurait de la difficulté à se rendre compte de leurs qualités différentes, s’il ne savait pas que dans certaines régions du globe celte plante est cultivée depuis des siècles, tandis que dans d’autres, par exemple dans le mont Caucase, elle croit encore à l’état sauvage. Les plantes ont leur domaine propre, leur berceau naturel, aussi bien que les races, et la culture du concombre en Grèce, de l’orange et de la cerise en Italie, de la pomme de terre en Angleterre et de la vigne au cap de. Bonne-Espérance, ne peut être expliquée que par l’historien. Les rapports plus intimes qui existent entre l’histoire du
QO
CO
langage et rhistoire de l’homme ne suffisent donc pas pour exclure ' notre science du cercle des sciences naturelles.
Nous pourrions même montrer que, si on la définit rigoureusement, la science du langage peut se proclamer complètement indépendante de rhistoire. Si nous parlons du langage de l’Angleterre, une certaine connaissance de rhistoire politique des Iles-Britanniques est, sans aucun doute, nécessaire pour comprendre l’état actuel de celte langue. Son histoire commence avec les anciens Bretons, qui parlaient un dialecte celtique ; elle nous conduit ensuite à rétablissement des Saxons dans l’île, aux invasions des Danois et à la conquête des Normands, et nous voyons comment chacun de ces événements politiques a contribué
à former le caractère de la langue. On peut dire, que le
* .
langage de l’Angleterre a été successivement celtique, saxon, normand et anglais ; mais, si nous parlons de l’histoire de la langue anglaise, nous marchons sur un terrain tout à fait différent. La langue anglaise n’a jamais été celtique, le celtique n’a jamais passé, au saxon,' ni le saxon au normand, ni le normand à l’anglais. L’histoire de la langue celtique se poursuit encore aujourd’hui : il importe peu quelle soit parlée par tous les habitants des Iles-Britanniques ou par une faible minorité du pays de Galles, de l’Irlande et de l’Ecosse ; tant qu’une langue est parlée, ne fût-ce que par une seule personne, elle vit et a son existence propre : la dernière vieille femme qui parlait le comique et à la mémoire de laquelle un tombeau a été élevé à Paul, représentait à elle seule l’ancienne langue de la Cornouaille. Un Celte peut devenir un Anglais ; l‘é sang celtique et le sang anglais peuvent se mélanger, et qui pourrait dire à l’heure qu’il est, avec quelque exactitude, ce que chacun d’eux a fourni au sang mêlé qui coule dans les veines de notre population ? Mais les lan-
. ■ DEUXIÈME LEÇON. 89
» O ■
gués ne se mêlent jamais. N’importe le nom donné à la langue qu’on parle dans les Iles-Britanniques, qu’on l’appelle l’anglais, le breton ou le saxon, pour la philologie comparée l’anglais est teutonique et rien que teutonique. Le physiologiste aura beau protester, et montrer que dans bien des cas le crâne, qui est le siège matériel de la langue anglaise, appartient au type celtique ; le généalogiste aura beau protester et prouver que les armoiries de maintes familles anglaises sont d’origine normande : notre philologue devra poursuivre son chemin. Il pourra faire son profit des indications que lui fournit l’histoire sur cette race celtique qui forme comme la couche primordiale de la population de nos îles,.puis sur les invasions qui conduisirent dans la Grande-Bretagne les Saxons, les Danois et les Normands ; mais, quand toutes les archives seraient brûlées et tous les crânes tombés en poussière, la langue'angîaise, dans la bouche du dernier paysan, révélerait sa propre histoire, si elle était analysée d’après les règles de la grammaire comparée. Nous n’aurions pas besoin de l’aide de l’histoire pour reconnaître que l’anglais est teutonique; que, comme le hollandais et le frison, il appartient à la branche du bas-allemand ; que celle branche, avec le haul-âllémand, le gothique et les langues Scandinaves, constitue la classe teutonique ; que cette classe teutonique se réunit aux langues slaves, celtiques, helléniques, italiques, iraniennes et indiennes, pour former la grande famille indoeuropéenne ou aryenne. Dans le vocabulaire anglais, la science du langage peut découvrir, par ses propres procédés,. les éléments celtiques, normands, grecs et latins, mais il n’est pas entré une seule goutte de sang étranger dans le système organique de la langue anglaise. La grammaire, qui est l’âme même du langage, est restée aussi pure de tout mélange, dans l’anglais qu’on parle aujoui-
LEÇONS SUR LA SCIENCE DU TANGAGE,
V W *
d’hui d’un bout à l'autre desIles-Brilanniques, qu’elle l’était dans cette même langue à l’époque où la parlaient, sur les bords de l’océan Germanique, les Angles, les Saxons et les Jutes du continent.
En considérant et en réfutant comme nous l’avons failles objections que l’on a apportées ou que l'on pourrait apporter contre l’admission de la science du langage dans le cercle des sciences naturelles, nous sommes arrivés à certains résultats qu’il sera peut-être, utile de résumer maintenant, avant de continuer nos éludes.
Nous avons vu, d’abord, que, tandis que la philologie proprement dite se. sert du langage comme d’un instrument, la philologie comparée en fait l’objet même de ses recherches scientifiques : le but que se propose celte nouvelle science, ce n’est pas l’étude d’un seul idiome, mais l’étude de beaucoup de langues, et, à la longue, de toutes les langues de la terre ; et, dans l’examen scientifique du langage, la langue d’Homère n’a pas plus d’importance ni d’intérêt que les dialectes des Hottentots. •
Nous avons vu, en second lieu,, qu’après avoir commencé par recueillir et analyser soigneusement les faits et les formes d’une langue quelconque, la chose la plus importante à faire ensuite, c’est de classer toutes les variétés du langage': ce n’est qu’après cette classification
■ N
qu’on peut aborder sans péril les grandes questions de la nature, de l’origine et'de la raison d’être du langage.
Nous avons vu, en troisième lieu, qu’il y a une distinction entre Y histoire et ce que nous appelons le développement. Nous avons précisé la signification exacte du mot développement appliqué au langage, et nous avons vu que ce développement ne dépend pas du caprice de l’homme, et qu’il est réglé par des lois qu’une observation attentive peut découvrir et faire remonter enfin à des lois d’un ordre supérieur qui gouvernent les organes de la pensée
. DEUXIÈME LEÇON. 94
■ - t> - ' '
et de la voix * humaine. Tout en. reconnaissant que la science du langage se rattache plus étroitement qu’aucune autre science physique à ce qu’on appelle l’histoire politique de l’homme, nous avons trouvé qu a la rigueur notre science pourrait fort'bien se passer de ce secours, et que pour analyser et classer les langues il suffit' des
indications qu’elles fournissent elles-mêmes, surtout de
" * + ' T ' '
leur conformation grammaticale, sans que l’on ait besoin de s’occuper des individus, des familles; des peuplades, des nations .ou des races qui les parlent ou qui les ont parlées. . . .
Dans le cours de ces études nous avons dû poser deux axiomes auxquels nous aurons souvent à renvoyer dans la suite de nos recherches. Le premier affirme que la grammaire est l'élément le plus essentiel, et par conséquent, la base de la. classification dans toutes les langues qui ont produit un système grammatical déterminé : le second nie qu’une langue mixte soit possible.
_ Ces deux.axiomes n’en font, en réalité qu’un seul, ainsi que nous le verrons quand nous les examinerons de plus. près. C’est à peine s’il .y a une langue qui ne puisse, en-un sens, être appelée mixte : aucune nation ou tribu n’a jamais été si complètement isolée, quelle n’ait laissé s’introduire chez elle un certain nombre de mots étrangers.. Dans plusieurs cas; ces mots ont changé tout l’aspect primitif delà langue et l’ont emporté,- même en nombre, sur l’élément indigène : ainsi, le turc est un dialecte touranien, et la grammaire en est purement tartare ou touranienne. Or la langue turque, telle, que les hautes classes la parlent aujourd’hui à Constantinople, et telle surtout quelles J’é-, crivent, contient un si grand nombre de mots persans et arabes, qu’un paysan de l’Ànatolie ne comprendra pour ainsi dire rien à celte langue qui est censée la sienne, bien que la grammaire de l’idiome parlé par les chefs de. la
race des Turcs Osmartlis soit la même que celle qui à été transmise au paysan par la tradition de son grossier patois tartare.
La présencë dans la langue turque de ces mots persans et arabes doit être expliquée bien plutôt par des influences littéraires et politiques que par des influences religieuses. La civilisation persane influa sur les Arabes dès leurs premières conquêtes religieuses et militaires: et, quoique les Persans aient dû nécessairement accepter un grand nombre de termes religieux et politiques d’origine arabe, c’est-à-dire sémitique, un examen attentif des différents mots persans adoptés en arabe nous montre que Tancienne civilisation aryenne de la Perse, à laquelle les Sassanides donnèrent un élan nouveau, exerça une réaction puissante, bien que moins apparente, sur les mœurs primitives des Arabes nomades. Le Coran même contient des expressions persanes,, et nous y trouvons une condamnation des romans persans qui circulaient chez les musulmans let très (-1). Les Turcs embrassèrent une religion sémitique et adoptèrent en même temps une terminologie religieuse sémitique, mais cette religion n’arriva chez eux qu’après avoir passé par la Perse : de là le grand nombre de mots persans que nous rencontrons en turc, et l’ern-preinte évidente dé la construction et de l’idiome persans que portent les mois arabes usités dans la langue turque. Des mots aryens tels que clin, foi,: gaur, infidèle, oruj, jeûne, namas, prières, employés par une race touranienne qui adopte dans son culte les formules d’une religion sémitique, en disent plus sur l’histoire de la
(1) Reinaud, Mémoire sur l'Inde, p. 310. Renan , Histoire des Langues Sémitiques, p. 292, 379. Spiegcl. Avcslci, (traduction allemande, vol. 1, p. 39 .) • ;
civilisation que des médailles, des inscriptions ou des chroniques (-1).
De toutes les langues, l’anglais est peut-être celle qui contient le plus grand nombre de mots évidemment dérivés des sources les plus différentes. Toutes les régions du globe semblent avoir contribué à l’enrichir: des mots
latins, grecs, hébreux, celtiques, saxons, danois, français, espagnols, italiens, allemands, et même indiens, malais et chinois, sont mêlés dans le vocabulaire anglais. Si nous n’avions que les mots seuls pour nous guider, il serait impossible de rattacher l’anglais à aucune des branches connues du langage. Laissons de côté les éléments moins importants, et comparons les mots teutoniques de l’anglais avec ses mots latins, néo-latins ou normands; nous trouverons que cette seconde catégorie l’emporte certainement par le nombre sur celle qui se compose des termes d’origine saxonne. Ce fait peut, paraître incroyable, et si nous nous contentions de prendre au hasard une page d’un livre anglais, et d’y compter les mots dérivés du saxon et du latin, il est bien sûr que l’élément saxon aurait la majorité: les articles, les pronoms, les prépositions et les verbes auxiliaires, qui sont tous d’origine saxonne, reviennent sans cesse dans une même page ; ainsi, ïïickes soutenait que les neuf dixièmes du lexique anglais venaient du saxon, parce qu’il n y a que trois mots dans l’oraison dominicale qui dérivent du latin. Sharon Turner,
(1) Il est fort douteux que les Arabes, dans leur état de civilisation très-élémentaire, eussent fait par eux-mêmes des progrès, bien rapides ; des- faits qui rendent cette hypothèse très-invraisemblable, c’est que la plupart et les plus fameux de leurs savants furent d’origine étrangère et surtout persane. C’est encore la coïncidence du commencement de la littérature arabe avec la victoire des Abbassides, qui représentent l’influence de l’élément persan dans l’Islamisme. Ibn Thaldun, dans la Préface de Slane à Ibn Thalikan, vol. II, traduction anglaise. .
qui étendit ses observations sur un champ plus vaste, arriva à la conclusion que le rapport du normand au saxon était comme de quatre à six. Un. autre auteur, qui évalue à 38,000 le nombre total des mots anglais, en rapporte 23,000 au saxon et 15,000 aux langues classiques. En dressant, cependant, un inventaire plus exact, et en comptant tous les mots des Dictionnaires de Webster et de Robertson, M. Thommerel a établi le fait que sur le total de 43,566 mots, 29,853 viennent des langues classiques, 4 3,230 des langues teutoniques, et le reste de sources diverses (1). Par conséquent, si nous n’en jugions que d’après son vocabulaire, et en traitant l’anglais comme une langue mixte, nous devrions le classer avec le français, l’italien et l’espagnol, parmi les dialectes romans ou néo-latins. Si, cependant, le vocabulaire d’une langue peut, être mixte, sa grammaire ne peut jamais l’être : c’est ainsi que des missionnaires racontèrent à Her va s, au milieu du dix-septième siècle, que les Àraucaniens n’employaient presque plus un seul.mot qui ne fût espagnol, bien qu’ils eussent conservé la grammaire et la syntaxe de leur ancienne langue nationale (2). Yoiià pourquoi on prend la grammaire pour critérium de la parenté, et pour base de la classification, dans presque toutes les langues;
(1) Une excellente statistique du nombre proportionnel des .mots saxons et latins qui se trouvent dans différents auteurs anglais, nous est fournie par Marsh, Lectures on the English language, p. t20 et suiv., 381 et suiv.
(2) «, « En este estado, que es el primer paso que las naciones dan para müdar de lengua, estaba cuarenLa anos ha la araucana en las isîas de Chiloue (como lie oido â los jesuitas sus misioneros), en donde los Araucanos apénas proferian palabra que no fuese espanola ; mas la proferian con el artiftcio y orden de su lengua nativa, Ilamada araucana. » — Hervas, Catalogo, t. I, p. IG. « Este arlificio ha sido en mi observacion el principal medio de que me lie valido para conocer' la afinidad 6 diferencia de las lenguas conocidas, y redurcilas â determinadas classes. » — Ibid., p. 23.
et il s’ensuit, corame conséquence nécessaire, que, dans la classification et dans la science du langage, il est impossible d’admettre l’existence d’un idiome mixte. Nous.pouvons former en anglais des phrases tout entières composées uniquement de mots latins ou romans; néanmoins
' ^ - J
tout ce qui reste de grammaire en-anglais porte, de là manière la plus évidente, la marque teutonique. Ce nom de grammaire ne peut guère, dans la langue. anglaise, s’appliquer qu’aux désinences du pluriel et du génitif singulier des noms, clés degrés de comparaison et de quelques personnes et de certains temps du verbe ; et cependant la seule lettre s, usitée comme signe de la troisième personne du singulier de l'indicatif présent, est une preuve incontestable que dans une classification scientifique des langues, quand même, l’anglais n’âurait-pas conservé un seul mot d’origine saxonne, il devrait néanmoins être considéré comme venant du saxon et comme formant
■ h ,
une branche de la grande tige teutonique de la souche
aryenne. Dans les langues primitives, qui ne sont pas for-
■ + _
mées de la décomposition de langues plus anciennes et qui n’ont pas subi d’influences aussi diverses, la grammaire, et nous entendons par là toute la partie formelle du langage, est bien plus développée et plus riche qu’en anglais ; elle est, alors, un indice bien plus sur pour découvrir la ressemblance entre les membres épars d’une même famille. Il y a des langues, l’ancien chinois, par exemple, où il n’existe: aucune trace de ce que nous avons l’habitude d’appeler la grammaire ; il y en a d'autres dans lesquelles nous pouvons encore suivre le développement de la grammaire, ou, pour parler plus correctement, la transformation graduelle des radicaux en formes purement grammaticales. Dans ces langues, il. faudra recourir à de nouveaux principes de classification, tels que l’étude de riiistoire naturelle peut en suggérer ; et nous devrons
nous contenter des indices que suggère une ressemblance de formes, quand nous ne pourrons pas découvrir les preuves d’une parenté réelle.
J’espère avoir répondu à quelques-unes des objections qui prétendaient refuser à la science du langage la place à laquelle elle prétend dans l’ordre des sciences naturelles. Nous verrons dans notre prochaine leçon quelle a été
l’histoire de notre science depuis sa naissance jusqu’à nos
» ^
jours, et nous verrons aussi jusqu’à quel point on peut dire qu’elle a traversé les trois périodes de l’empirisme, de la classification et de la théorie, qui représentent l’enfance, la jeunesse et la maturité de chacune des sciences naturelles. '
PÉRIODE EMPIRIQUE..
Spéculations métaphysiques sur la nature du langage dans les écoles de l’Inde et de la: Grèce : terminologie de Platon, d’Aristote et des stol-ciens. — La grammaire proprement dite doit commencer naturellement avec l’étude des langues étrangères. Indifférence des Grecs pour lés langues des barbares. Les interprètes dans l’antiquité Voyages des anciens philosophes, grecs. Bèrose, Ménandre- de Tyr et Manélhon écrivent en Grec l’histoire de leurs patries respectives, la Babylonie, la. Phénicie et l’Egypte. — Etude critique de la langue grecque dans l’école d’Alexandrie. Les philosophes alexandrins inventent de nouveaux ternies grammaticaux. Zénodote. Denys le Th race, élève d’Aristarque, quitte Alexandrie et s’établit à Rome, vers le temps de Pompée, pour y enseigner le grec : il compose, à l’usage de ses élèves, la première grammaire de la langue grecque. — Influence de la Grèce en Italie dès . les temps les plus reculés. Les Italiens reçoivent des Grecs leur alphabet, ainsi que les rudiments mêmes de la civilisation. Dès le temps de Caton tous les Romains instruits savent parler le Grec. — La première histoire de Rome est écrite en grec par Fabius Pictor. Livius Ahdroni-eus, Nævius, Piaule, Eunius, Térence, Polybe, les Scipions. Croyances . religieuses des Romains. Gralès dePergame donne.les premières leçons, de grammaire à Rome, vers Tan 159 av. J.-G. Lucius Ælius Slilon, Varron, Lucilius, Cicéron. Traité de César de Analogia. Arrivée de Denys.le Thrâce à Rome : la terminologie grammaticale qu’il emploie dans .sa grammaire - grecque est celle, dont nous nous servons encore aujourd'hui. — Les grammairiens des siècles suivants : M. Verrins - Fiaccus, Quintilien, Scaurus, Apollonius Dysc-ole, Probus, Donat, Pris-çien. ‘ -
Nous commencerons aujourd’hui à étudier l’histoire dé la science du lang|§e-d€ins ses trois périodes, la période
de l'empirisme, Be^k^cîassi/îcation, et. celle de la
' '0'\ - - '■-■■■
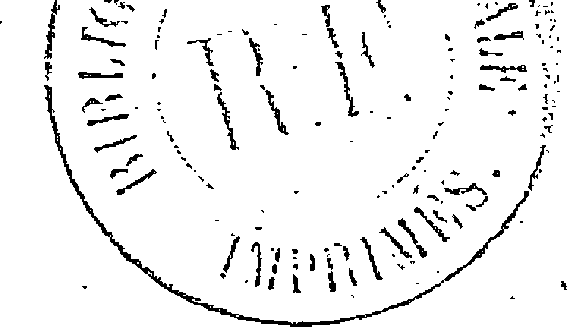
, i ,
théorie. C’est une règle générale, que toutes les sciences naturelles commencent par l’analyse, passent ensuite à la classification et finissent par la théorie ; mais, ainsi que je l’ai fait observer dans ma première leçon, il y a a cette règle de fréquentes exceptions, et il est assez ordinaire de trouver que des spéculations philosophiques, qui appartiennent proprement à la période-de la théorie, ont été tentées dans les sciences naturelles longtemps avant qu’on eût recueilli ou arrangé les faits qu’il eût été nécessaire de connaître. C’est ainsi que la science du langage dans les. deux seuls pays où . nous puissions .en examiner l’origine et l’histoire, dans l’Inde et dans la Grèce, se jette, dès le principe, dans des théories sur la nature mystérieuse du langage, et s’occupe aussi peu des faits que ce naturaliste qui écrivit la description du chameau sans avoir jamais vu ni l’animal ni le désert. Les brahmanes, dans les hymnes des védas, élevèrent la parole au rang d’une divinité, ainsi qu’ils le faisaient pour toutes les choses dont la nature leur était inconnue. Ils lui adressaient des hymnes où il est dit quelle a habité avec les dieux dès le commencement, accomplissant desGhoses merveilleuses, et qu’elle n’a jamais été révélée à l’homme si ce n’est en partie. Dans les Brâhma^as, la parole est appelée la vache, le souffle est appelé le taureau, et l’esprit humain présenté comme.leur progéniture (1). Il est dit que Brâhman, le plus grand des êtres, est connu par la parole, et la parole elle-même est appelée le Brâhman suprême. Cependant les brahmanes revinrent de bien
(1) Colebrooke, Miscellaneous Essays, I, 32. Lés versets suivants sont prononcés par Vâk, déesse de la parole, dans l'hymne cxxv du livre dixième du Rig-Yéda : « C’est moi-même qui dis ce « qui est agréable aux dieux et aux hommes : celui que j’aime je • « le fortifie, je le fais brahmane, je le fais grand prophète et sage.
« Pour Rudra (dieu dè la foudre) je bande l’arc, pour tuer
99
TROISIEME .LEÇON.
bonne heure de l'enthousiasme que leur inspirait le langage, et se mirent avec une étonnante habileté à en disséquer le corps sacré. Leurs travaux d’analyse grainmatir cale qui datent du sixième siècle avant Jésus-Christ nont pas encore été surpassés par les travaux du même genre chez aucune nation. L’idée de réduire une langue tout entière à un petit nombre de racines, qu’en Europe Henri Etienne tenta le premier dè réaliser, au seizième siècle (1), était parfaitement familière aux brahmanes au moins cinq’ ; cents ans avant Jésus-Christ.
Les Grecs, sans élever le langage au rang d’une divinité, lui rendaient, néanmoins, les plus grands honneurs dans leurs anciennes écoles philosophiques. Il y a à peine un de leurs sages qui n’ait laissé quelque pensée sur la nature du langage. Le monde extérieur, ou la nature, et le monde intérieur, ou l’esprit, n’ont pas causé chez les premiers philosophes de la Grèce un étonnement plus grand, et ne leur ont pas fait rendre de plus frappants oracles que ne Ta fait le langage, où la nature et l’esprit se reflètent tous deux. « Qu’est-ce que le langage? » fut une question qu’ils se posèrent d’aussi bonne heure que les ideux autres : « Que suis-je? » et « Qu’est-ce que cet uni-« l’ennemi qui hait les brahmanes. Pour le peuple, je fais la « guerre : je remplis le ciel et la terre. Je porte le père au sommet « dè ce monde : je suis née de Peau, née de la mer ; de là, je « m’avance au milieu de tous les êtres, et j’atteins à ce ciel par ma « hauteur. Je souffle comme le vent, embrassant toutes choses; « dépassant ce ciel, dépassant cette terre, telle suis-je en gran-« deur. » Voyez aussi Atharva-Yeda, IV, 30; XIX, 9, .3. Muir, Sanskrit Texts, part. III, p. 108, 150.
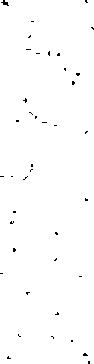
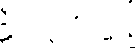
(1) Sir John Stoddarfc, Glossology, p. 276. La première grammaire hébraïque complète et le premier dictionnaire de la Bible furent l’œuvre de Rabi Jonâ, ou Àboul Walid Meridân Ibn Djanàh, au milieu du onzième siècle. La théorie des racines hébraïques avait été ébauchée avant lui par Abou Zaccariya ’Hayoudi, qu’Ibn Eyfa appelle le premier grammairien. Cf. Munir, notice sur Aboul-Walid, Journal asiatique, 1850, avril. .

N

4 00 LEÇON S SUR LA SCIENCE DU LANGAGE.
- a . r
vers qui m'environne?» Le problème du langage fut, en réalité, une lice toujours ouverte aux différentes écoles philosophiques de la Grèce, et nous aurons occasion de voir quelles ont été leurs conjectures sur un sujet aussi intéressant quand nous viendrons à étudier la troisième période de l'histoire de notre science.
À présent, il nous faut chercher les plus anciennes traces de la première période, dite période empirique. Ici on pourrait avoir quelques doutes, et se demander ce qu est en réalité le travail qui, dans l’iiistoire du langage, représente cette période. Quel est le sens du terme empirisme appliqué au langage ?
Quels furent les hommes qui firent, pour le langage ce que le marin fit pour ses étoiles, le mineur pour ses minéraux, le jardinier pour ses fleurs? Qui fut le premier à s’occuper du langage, à en distinguer les parties constituantes, les noms et les verbes, les articles et les pronoms, le nominatif et l’accusatif, l’actif elle passif ? Qui inventa ces termes, et à quelle fin furent-ils inventés ? .
Nous ne saurions apporter trop .de soin à répondre à ces questions, carj ainsi que je l’ai déjà dit, l’analyse purement empirique du langage fut précédée en Grèce de recherches plus générales sur la nature de la pensée et du langage, d’où il est arrivé que beaucoup des termes techniques qui composent la nomenclature de la grammaire empirique existaient dans les écoles philosophiques, longtemps avant que le grammairien les reçût, tout formés. La distinction entre le nom et le verbe, ou pour parler plus correctement, entre le sujet et l'attribut, fut l’œuvre des philosophes. Même les termes techniques pour cas, nombre et genre, furent inventés à une époque très-reculée afin de pénétrer la nature de la pensée, et non pas afin d'atteindre un but. pratique, en analysant les formes du langage ; ce fut une génération postérieure qui les appli-

qua à la langue parlée de la Grèce. Le premier qui compara les catégories de la pensée avec l’ensemble de faits dont se composait le grec, ce futle professeur de langues ; ce fut lui qui transporta la terminologie d’Àristote et des stoïciens de la pensée au discours, de la logique à la grammaire, et qui par là ouvrit les premières routes dans l’immense' et impénétrable désert du langage parlé. En ce faisant, le grammairien dut modifier l’acception rigoureuse de beaucoup des termes qu’il empruntait au philosophe, et en inventer d’autres avant de pouvoir saisir, même de la manière la plus imparfaite, tous les faits du langage, dont l’analyse scientifique n’est pas beaucoup avancée par là distinction entre le verbe et le nom, entre l’actif et Je passif ou entre ïe nominatif et l’accusatif. L’emploi de ces termes ne nous fait faire qu’un premier pas ; on ne peut les comparer qu’à ce qu’i] y a de plus élémentaire dans la terminologie: des autres sciences. Ce fut néanmoins un commencement et un commencement bien important; et, si nous conservons dans ïios histoires les. noms des Thalès, des Ànaximëneet des Empédocle, auxquels la tradition attribue la découverte des éléments du mondé physique, nous ne devrions pas oublier les noms de ces premiers grammairiens, qui ont découvert les éléments du langage, et fondé une des parties les plus utiles et les plus fécondes de la philosophie.
La grammaire donc, dans le sens ordinaire du mot, ou l’analyse empirique des formes du langage, doit son origine, Comme toutes les autres sciences, à un besoin naturel et pratique. Le premier grammairien pratique fut le premier qui enseigna une langue étrangère, et, si nous voulons connaître les commencements de la science du langage, il faut tâcher de déterminera quelle époque de l’histoire du inonde et dans quelles circonstances les hommes songèrent, pour la première fois, à apprendre
LEÇONS SUR LÀ SCIENCE DO LANGAGE.
- -ti . _ ,
une langue autre que la leur: c’est à celte époque-là, et non auparavant, que nous rencontrerons la première grammaire. Sans doute,r'la voie avait pu être préparée par les recherches plus désintéressées des philosophes, et aussi par les études critiques des savants alexandrins sur les formes anciennes de leur langue qui étaient conservées dans les poèmes homériques ; mais les règles de. la déclinaison et de la conjugaison, les paradigmes des noms et des verbes réguliers et irréguliers, les observations sur la syntaxe, tout cela fut l’œuvre des maîtres de langues, et de personne autre. Or cette profession, qui occupe aujourd’hui tant de gens instruits, est de date relativement récente. Jamais un ancien Grec ne songea à apprendre une langue étrangère, et comment j eût-il songé ? Pour lui le monde tout entier se ‘ divisait en Grecs et Barbares, et il aurait cru s’abaisser en adoptant le costume, les mœurs ou la langue des Barbares ses voisins. Il regardait comme un privilège de parler grec, et même des dialectes étroitement apparentés au sien étaient traités par lui de purs jargons. Il faut du temps avant que les hommes conçoivent l’idée qu’il est possible de s’exprimer autrement que dans la langue de leur enfance : les Polonais appelaient les Allemands leurs voisins .AHemiec (iiiemy signifiant muet) (1 ), tout à fait comme les Grecs appelaient les Barbares Aglossoi, ou ceux qui n’ont point de langue, On sup-
(i) Les Turcs appliquaient aux Autrichiens le nom polonais de Nicmiec. Dès le temps de Constantin Porphyrogénète, était le nom usité pour la race allemande des Bavarois (Pott, Indo-Germ. Sp., p. 44; Léo, Zeitschrift fur vergleichende Sprachfor-schungy liv. Il, p. 258). Le russe njemez\ le slovénien nëmec, le bulgare nemec, le polonais niemiec, le lusalien njemc, sont autant de termes qui, dans chacune de ces langues, désignent, les Allemands, et le russe njemo signifie indistinct. Muet se dit en russe njemi, en slovénien nëm, en bulgare ntmy en polonais njemy, en lusalien njeiny.
pose que le nom que donnaient les Germains à leurs voisins les Celles, walh en ancien haut-allemand, vealh en anglo-saxon, d’où dérivent l’anglais welsh et le français gaulois, est identique au' sanscrit inle/sMa, et que ce mot signifie une personne qui parle d’une manière indistincte (4). ■
Même quand les Grecs commencèrent à comprendre la nécessité de communiquer avec les nations étrangères, et à se sentir le désir d’apprendre leurs idiomes, le problème était loin d’être résolu ; car comment apprendre une langue étrangère tant.que des deux côtés on ne parlait que sa propre langue ? Il est à présumer que les Grecs apprirent d’abord les langues étrangères à peu près comme les enfants apprennent la leur.. Les interprètes
dont les historiens anciens font mention étaient probables -T- . ■■
ment des enfants de parents qui parlaient deux langues différentes. Cyaxare, roi de Médie, à l’arrivée dans ses États dune tribu de Scythes, envoya des enfants chez eux pour apprendre leur langue et s’exercer à tirer de l’arc (2). Le fils d’un Barbare et dune Grecque apprenait naturellement le parler de son père et. de sa mère, et le profit qu’il tirait des services qu’il pouvait rendre comme interprète devait engager d’autres personnes à marcher sur ses traces. ]STous savons, mais par la. légende plutôt que par l’histoire, que les Grecs furent étonnés de la multiplicité de langues qu’ils rencontrèrent pendant l’expédition des Argonautes, et qu’ils furent très-embarrassés faute d’interprètes habiles (3). Il n’y a là rien qui doive nous sur-
(1) Léo, Zeitchrift für vergl. Sprachf., îiv. IL p* 252. Belutcli
est le nom que Ton a donné dans l’Inde aux tribus qui en occupent la frontière occidentale, au sud de l’Afghanistan; or, on a prouvé qu’il fallait encore. reconnaître dans ce mot le sanscrit mlekk ha. '
(2) Hérodote, I, 73; . "
(3; Ilumboldt, "Cosmost II, p. 141. . •’ -prendre, car souvent l’armée anglaise n’a guère été plus heureuse que celle de Jason ; et telle est la diversité .des dialectes parlés dans l’isthme caucasien, que les habitants l’appellent encore aujourd’hui « la montagne des langues. » Si nous détournons les yeux de ces âges fabuleux pour les porter sur les âges historiques de la Grèce, nous trouvons que le commerce donna les premiers encouragements à la profession d’interprète. Hérodote nous raconte (IY, 24) que les caravanes des marchands grecs qui remontaient le cours du Volga jusqu’aux monts Ourals étaient accompagnées de sept interprètes parlant sept langues différentes, parmi lesquels devaient être compris des dialectes slaves, tartares et finnois, qui étaient certainement pariés dans ces contrées du temps d’Hérodote comme ils le sont de nos jours. Ce furent les guerres médiques qui, les premières, familiarisèrent les Grecs avec l’idééquè les autres nations possédaient aussi des langues qui méritaient ce nom. Thémistocle étudia le perse, et on dit même qu’il parvint à le parler avec facilité. L’expédition d’Alexandre contribua bien davantage à faire connaître à la Grèce les nations elles langues étrangères; mais quand Alexandre eut à converser avec les brahmanes, qui, même alors, étaient regardés par les Grecs comme les dépositaires d’une antique et mystérieuse sagesse, leurs réponses durent être traduites par tant d’interprètes, qu’un des brahmanes fit observer qu’elles devaient être comme de l’eau qui aurait coulé dans bien des canaux impurs ('!). On nous parle, il est vrai, de voyageurs grecs plus anciens, et il est difficile de comprendre comment, dans ces âges.recu-
(I) Ce fait montre combien il serait difficile d’admettre une influence exercée par l’Inde sur les philosophes grecs. S’il faut en croire Alexandre Polyhistor, Pyn lion aurait accompagné Alexandre dans son expédition de l’Inde, et l’on est tenté de rattacher son scepticisme au système de philosophie bouddhique qui avait
TROISIEME. LEÇON.
1 0.5
■ s
\
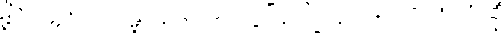
4
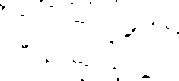
lés, on aurait pu voyager sans une certaine connaissance de la langue du peuple dont il fallait traverser les camps, les villages et les villes : mais beaucoup de ces voyages, ceux surtout que l’on prétend s’être étendus jusqu’à l’Inde, ne sont que des contes inventés par des auteurs plus récents (t). Lycurgue a pu voyager en Espagne , et en Afrique, mais il n’alla certainement pas jusque dans l’Inde, et fa première mention que nous trouvions de ses rapports avec les gymnosopliistes indiens est dans Aristocrate, qui vivait environ cent ans avant Jésus-Christ; Les voyages de Pytbagore ont aussi un caractère purement fabuleux ; ils furent inventés par les écrivains alexandrins, qui pensaient que toute sagesse avait dû émaner de l’Orient. .Nous avons de meilleures raisons pour croire que Démo-erite visita l’Egypte et Babyione, mais.son lointain voyage dans riridè appartient également à la légende. Quoique Hérodote ait voyagé dans l’Egypte.et dans la Perse, il ne
nous donne nulle part à entendre qu’il sût parler aucune
. ■■ 1 « ' ■
langue étrangère. . • .
D’après ce que nous savons, il semble que les barbares, aient eu en général plus de facilité, pour apprendre les langues, que les Grecs ou les Romains. Peu de temps
alors cours dans l’Inde; mais Tignorahce réciproque de leur langue devait élever entre Pyrrhon et les penseurs indiens une barrière presque insurmontable. (Fragmenta Rist. Græc., édit. Millier, t. IÎI, p. 243, b; Lassen, Indische Aller thumskunde, 1 iv. III, p. 380. . - ..
(i) Sur les voyages supposés des philosophes grecs jusque dans l’Inde, voyez Lassen, Indische Alterthumskunde, liv. III, p. 379; Brandis, Randbuch. der Geschichle der Philosophie, liv. I, p. 423. Bans mon Essai sur la logique indienne publié dans Thomson's Laws of thoughl, j'ai examiné l’opinion du B. Stewart et de Niebuhr qui supposaient que les philosophes indiens avaient fait des emprunts aux Grecs, et celle de Goerres et d autres qui pensaient, au contraire, que les Grecs avaient quelquefois été disciples des brahmanes........
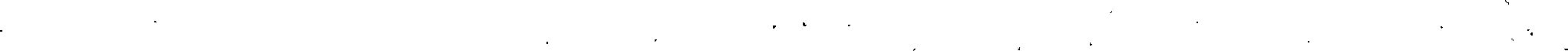
4 06 LEÇONS SÜll-LA. SCIENCE DU LANGAGE. ■
xà
après la conquête macédonienne, nous trouvons Bérose à Babylone (4),- Ménandre à Tyr et Manélhon en Égypte, compilant, d’après les documents originaux, les annales de leurs patries respectives (2). Ils écrivirent en grec et pour des Grecs, mais la langue maternelle de Bérose était le babylonien, celle de Ménandre le phénicien, et celle de Manélhon l’égyptien. Bérose savait lire les documents cunéiformes de la Babylonie aussi couramment que Manélhon lisait les papyrus d’Égypte. C’est un fait fort significatif que de voir paraître en même temps ces trois hommes, barbares de langue et de naissance, qui désiraient sauver de l’oubli chacun l’histoire de son pays en la confiant à la garde de leurs conquérants : mais ce qui n’est pas moins significatif, ce qui n’est nullement à l’honneur de ces conquérants grecs ou macédoniens, c’est le peu de cas. qu’il s semblent avoir fait de ces écrits, qui sont tous perdus et ne nous sont connus que par des fragments; pourtant, il n’est guère douteux que.l’ouvrage de Bérose n’eût été d?un secours inestimable pour l’étude des inscriptions cunéiformes et de l’histoire de Babylone, et que celui de Manélhon, s’il nous était parvenu dans son intégrité, ne
(4) Voyez Niebuhr, Yorlesungen über aile Geschiohte, liv. I, p. 47:
(2) La traduction du traité de Magon sur l’agriculture a été faite plus tard. Rien ne prouve que Magon, qui écriviL en langue punique vingt-huit livres sur l’agriculture, véeûL cinq cents.ans avant Jésus-Christ, ainsi que le suppose HumboldL, Cosmos, vol. II, p. 484. Varron, De R. R. î, 4, dit : « ïïos nobilitate Mago Carlha-giniensis præteriit Pœnica lingua, quod res dispersas comprehendit libris xxiix, quos Cassais Dionysius Uticensis verlit libris xx, græea lingua, ac Sextilio prætori misit : in quæ volumina de græcis libris eorum quos dixi adjecit lion pauca, et de-Magonis dempsit instar librorum viir. Hosce ipsos uliliter ad vi libros redegit Diophanes in Bithynia, et misit Dejotaro régi. » Ce Cassius Dionysius d’üti-que vivait vers l’an 40 avant notre ère. La traduction en latin fut faite sur l’ordre du Sénat, peu de temps après la troisième guerre punique.
nous eût épargné bien des volumes de polémique sur la chronologie égyptienne. Toutefois la publication presque simultanée de ces trois écrits nous montre que, peu de temps après l’époque des conquêtes d’Alexandre dans l’Orient, la langue grecque était étudiée et cultivée par des écrivains d’origine barbare; mais nous chercherions en vain-un Grec de ce temps-là qui ait composé des ouvrages en langue étrangère. Nous n’entendons parler d’aucun commerce intellectuel entre les Grecs et les barbares avant l'époque d’Alexandre et d’Alexandrie. À Alexandrie se trouvaient rassemblées diverses nations, étrangères les unes aux autres pour la langue et pour les croyances religieuses. Bien que la spéculation commerciale fût le premier motif de leur réunion, à leurs moments de loisir, tous ces marchands devaient naturellement converser ensemble de leurs patries, de leurs dieux, de leurs rois, de leurs poètes et de leurs législateurs. Puis il y avait à Alexandrie des Grecs qui se livraient à l’étude de l’antiquité, et qui savaient chercher des renseignements auprès des étrangers de n’importe quel pays. Les prétentions des Égyptiens à une antiquité fabuleuse, la croyance des Juifs au caractère sacré de leur loi, la foi des Perses dans les livres de Zoroastre, étaient bien propres à être discutées dans les écoles et dans les bibliothèques d’Alexandrie. C’est probablement à cet esprit de curiosité littéraire, entretenu et favorisé par les Ptolémées, que nous devons la version de. l’Ancien Testament dite des Septante (4). Les. écrits de Zoroastre, le Zend-Avesta, semblent aussi avoir
(i) On raconte que Ptolémée Philadelphe (287-246 avant J.-G.), à la recommandation de son principal bibliothécaire, Démétrius de Phalère, envoya à Jérusalem un Juif du nom d’Arisléas demander au. grand prêtre un manuscrit de la Bible et soixante -dix interprètes. D’autres auteurs prétendent que les Juifs hellénistes qui habitaient Alexandrie, et qui avaient oublié leur, langue,
' *
■ - ■ ■ -, ■ ■■ '
été traduits en grec vers la même époque; car cet Her-mippus, qui, au dire de Pline, traduisit Zoroastre, était, selon toute probabilité Hermippus le philosophe péripa-léticien, disciple de CalJimaque et un des savants alexandrins les plus profonds (4).
Mais, quoique nous trouvions à Alexandrie ces traces et d’autres semblables d’un intérêt général excité par les littératures des autres nations, rien ne peut nous faire supposer que leurs langues fussent aussi devenues l’objet de recherches scientifiques. Ce n’est pas par l’examen des langues étrangères, mais par celui des anciens dialectes de leur propre langue, que les savants grecs d’Alexandrie furent amenés d’abord à ce que nous appelons les études critiques et philosophiques. L’étude critique du grec prit naissance à Alexandrie, et fut fondée principalement sur le texte d’Homère. Une sorte d’ébauche de la grammaire. .. existait, .comme je J’ai déjà dit, aune époque antérieure.: elle était due aux écoles des philosophes grecs (2). Platon connaissait le nom et le verbe comme étant les. deux parties constituantes du discours. .Aristote y joignit les . conjonctions et les articles ; il observa également les dis
firent faire cette traduction pour leur usage. Toujours est-il que, . vers le commencement du troisième siècle avant Jésus-Christ (285), nous trouvons une grande portion de la Bible hébraïque traduite en grec par différentes mains. ■
(1) Plin., XXX, 2. « Sine- dubio ilia orta in-Perside a Zoroastre, ut inter auçtores convenit, Sed unus hic fueril, an postea et alius, non satis constat. Eudoxus qui inter sapientiæ sectas cla-rissimam utîlissimamque eam intelligi voluit, Zoroastrem hune sex millibus annorum ante Platonis mortem fuisse prodidit. Sic et Àristoteles. Hermippus qui de tota ea arle diligentissime scri* psit, et vicies centum millia versuum a Zoroastre condila, in-dicib'us quoque voluminum ejus positis, expîanavit, præçeptorem a quo instilutum discéret, iradidit Azonacem, ipsum quoque quin-que millibus annorum ante Trojanum bellum fuisse. » Voyez Bunsen, Ægyptens Stellung in der WeUgeschichle, v. a, 101.
(2) Max Müller, History of ancient sanskrit Littérature, p. 463.
tinctions de nombres et de cas: mais ni Platon ni Aristote ne firent grande attention aux formes du langage qui répondaient à ces formes de la pensée; rien ne les engageait, d’ailleurs, à ramener ces formes du langage à des règles pratiques (1).
Pour Aristote, le verbe ou rhèman’est pas beaucoup plus que l’attribut, et, dans des phrases comme « la neige est blanche ». il aurait appelé blanche un verbe. Les premiers qui établirent un certain ordre daais les formes réelles du langage furent les savants d’Alexandrie. Leur principale occupation étant de donner des textes corrects des classiques grecs, et surtout d’Homère, ils étaient forcés de faire attention aux formes de la langue, en cherchant à les déterminer avec la plus grande exactitude possible. Les manuscrits envoyés à Alexandrie et à Per-game des différentes parties de la Grèce contenaient des variantes fort nombreuses, et une éludée minutieuse pouvait seule décider quelles étaient les formes à conserver dans Homère. Leurs éditions de leur poète n’étaient pas seulement des ehdoseis, mot grec traduit littéralement en latin par editio (à peu près comme si l’on disait des émissions de livres), mais diorthôseis, c’est-à dire des éditions critiques. Il y avait des écoles différentes, opposées les
(1) [Cf. Séguier de Saint-Brisson, la Philosophie du Langage exposée d'apres Aristote. Paris, 1838, in-S°. Voyez aussi, pour plus de détails sur toute cette histoire de la formation des théories grammaticales chez les anciens, E. Egger, Apollonius Dyscole, Essai sur l'Histoire des théories grammaticales de VAntiquité, Paris, 4864, in-b°, dont on peut rapprocher utilement l’étude du même auteur sur Arislarque, dans ses Mémoires de Littérature ancienne, pp. 441 et suivantes.; ainsi que ses Notions élémentaires de Gh'ammaire comparée, 5e édition, 4857, pp. 44 et suivantes. Enfin on pourra encore consulter avec profit les ouvrages suivants : L. Lersch, Sprachphilosophie der Allen, Bonn, 4839-4853, 3 parties, in-8°; G. F. Schoemann, Die Lettre von den Redetlieilen nach den Allen, Berlin, 1862, in 8°; J. Glassen, De Grammalicæ græcæ priniordüs, Bonn, 1829, in-8°. Tr.J
unes aux autres dans leurs idées sur le texte d’Homère. Il fallait défendre chaque leçon adoptée par Zénodote ou par Àrislarque, et pour cela il fallait établir des règles générales pour la grammaire des poèmes homériques (i). Homère connut-il h article ? remploya-t-il devant les noms propres ? Telles étaient les sortes de questions à résoudre, et, selon l’avis qu’adoptaient les éditeurs, ils changeaient les textes de ces vieux poèmes, en leur faisant plus ou moins de violence. De nouveaux termes techniques devenaient nécessaires pour les nouvelles parties du discours dont on admettait l’existence, pour l’article, par exemple, distingué du pronom démonstratif. Article est la traduction littérale du mot grec arthron (le latin arlus) qui signifie l’articulation où la jointure des os. Nous trouvons ce terme, pour la première fois, dans Aristote; chez qui il ne pouvait exprimer que les mots qui servent, pour ainsi dire, de jointures aux membres d’une phrase. Dans une phrase comme « quiconque l’a fait, il le.paiera », les grammairiens grecs auraient appelé le pronom démonstratif il la première jointure, et le pronom relatif qui la seconde jointure (2) ; et avant Zénodote, le premier bibliothécaire d’Alexandrie (250 ans avant Jésus-Christ), tous les pronoms étaient simplement classés comme articulations ou articles du discours. Ce fut Zénodote qui le premier imagina une distinction entre les pronoms personnels ou autonymiai, elles simples articles auxquels on affecta dorénavant le nom de arthra. Cette distinction était très-nécessaire, et elle fut salis doute suggérée à son inventeur par ses corrections du texte d’Homère, car c’est par lui que l’article fut rétabli devant les noms propres
(1) [Cf. H. Dunlzer, De Zenodoti sludiis homericis. Gottingæ, 1848, in-8\ Tr.] ■
(2) vÀp9pov TiporacrcoLf-EVOV, àpôpov uTroTac’cop.svov.
t r
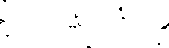
4M
TROISIEME LEÇON.
dans YTlliade et dans Y Odyssée. Qui de nous songe aujourd’hui quand il parle de l’article défini ou indéfini, à l’origine et à la signification primitive de ce mot, et au laps de temps qu’il fallut avant qu’il devînt ce qu’il' est à. présent, un terme technique familier à tous les écoliers? •
Passons.maintenant à un autre exemple de l’influence que l’étude critique d’Homère à Alexandrie a eue sur le développement de la terminologie grammaticale. Nous avons vu que la première idée des nombres, d’un singulier et d un pluriel, fut conçue et définie par le philosophe : mais Aristote ne connaît pas ces termes techniques de singulier et de pluriel, et il ne fait même pas allusion au duel. Il parle seulement des cas qui expriment un ou plusieurs, quoique pour lui cas ou ptosis eût une signification bien différente de celle que nous y attachons. Les termes de singulier et de pluriel ne furent inventés que quand le besoin s’en fut fait sentir aux premiers grammairiens. Zénodote, l’éditeur d’Homère, fut le-premier à remarquer l’emploi du duel dans les poèmes homériques, et, avec la faiblesse ordinaire qu’ont les hommes pour leurs propres découvertes, il a changé, dans le. texte dont il donnait une récension, bien des pluriels en duels sans aucune nécessité. .
Les savants d’Alexandrie et. leurs rivaux de l’école de. Pergame furent donc les premiers qui étudièrent le grec d’une manière critique, c’est-à dire qui analysèrent la langue, la distribuèrent en catégories générales, distinguèrent les différentes parties du discours, inventèrent des termes techniques pour les différentes fonctions des mots, observèrent la correction. plus ou moins grande du style de certains poètes, séparèrent les formes vieillies. des formes classiques, et publièrent sur tous ces sujets de longs et doctes ouvrages. Leurs traités
fixent une ère importante dans l’histoire de la science du langage. Mais il y avait encore un pas à. faire avant que le moment fût venu où l’on pourrait s’attendre à voir paraître une véritable grammaire grecque pratique ou élémentaire. La plus ancienne de. toutes est celle de Denys le Thrace, et elle est parvenue jusqu a nous..: il est vrai que quelques auteurs en ont contesté l’authenticité, mais on a répondu victorieusement à leurs objections. .
Qu’était-ce que ceDenys le Thrace? Son père, comme
son nom l’indique,, était Thrace ; mais Denys lui-même
*
habitait Alexandrie, et il avait suivi les leçons du célèbre
critique et éditeur d’Homère, Aristarque (1). Plus tard il
vint à Rome, où il enseignait vers l’époque de Pompée.
Voici donc un trait nouveau dans ITiistoire : Un Grec, dis, . - *
- *• • m
ciple d’Àristarque, s’établit, à Rome, et compose une grammaire pratique de la langue grecque, à l’usage, bien en. tendu, des jeunes Romains ses élèves. Il ne fonda pas la science grammaticale : presque tout le cadre de la grammaire lui était fourni, ainsi que nous l’avons vu, par les travaux de ses prédécesseurs depuis Platon jusqu’à Àris-tarque ; mais il fut le premier à appliquer à un objet pratique les découvertes des anciens philosophes et des critiques d’Alexandrie, à se servir de leurs observations et. des catégories qu’ils avaient établies pour enseigner le grec, et, ce qu’il faut surtout remarquer, pour enseigner le grec, non pas à des Grecs qui savaient déjà leur langue et à qui il ne manquait plus que d’en connaître la théorie, mais à des Romains à qui il fallait apprendre les déclinaisons et les
conjugaisons, régulières et irrégulières. Son traite devint
- ■ . ' ' &
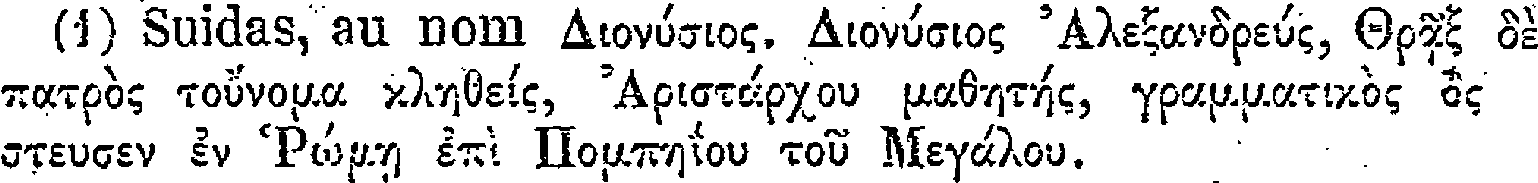
•3
GTTtO
icoz/i-
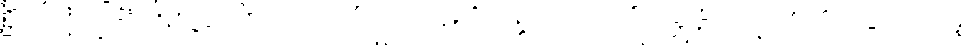
TROISIÈME LEÇON. 4 43
.* «) ,
un des canaux principaux par lesquels la terminologie grecque, après avoir passé d’Athènes à Alexandrie, fut portée à Rome pour se répandre de là dans tout le monde civilisé.
Cependant, quoique Denys eût composé la première grammaire pratique, il s’en fallait de beaucoup qu’il fût le premier professeur de langue établi à Rome. De son temps on parlait plus généralement le grec à Rome qu’on ne parle de nos jours le français à Londres. Les enfants des familles riches apprenaient le grec avant presque d’apprendre le latin, et Quintilien, dans son traité sur l'éducation, tout en désapprouvant que pendant longtemps on n’enseigne aux enfants que le grec, « ainsi, ajoute-t-il, que c’est la mode presque générale aujourd’hui », recommande néanmoins d’apprendre aux enfants le grec d'abord, et le latin ensuite (4). Ce fait, peut paraître étrange, mais la vérité est. que, depuis les temps les plus reculés où l’Italie nous soit connue, nous y trouvons le grec installé comme chez lui, presque au même titre que le latin. L'Italie dut presque tout à la Grèce, non-seulement dans des temps plus voisins de nous, quand le soleil couchant de la civilisation grecque confondit ses rayons avec l’aurore de la grandeur romaine, mais dès ces âges reculés où les premiers colons grecs prirent la route de l’Occident, à la recherche d’une nouvelle patrie. Ce furent les Grecs qui donnèrent aux Italiens leur alphabet, et leur apprirent à lire et à écrire (2). Les noms de la balance, de la règle d’arpenteur, des machines en général, de la mon-
- (1) Quint., I-, 4,42. •
(5) Voyez Mommsen, Romische Gescfnchle, liv. I, p. 197, « L’alphabet latin est le même que l’alphabet moderne rie la Sicile; Pal-pliabet étrusque est le même que l’ancien alphabet altique. Epi-slola. lettre ; charta, papier, et stüus (?), sont des mots empruntés au grec. » — Mommsen, liv. X, p. î84.
naie (1), beaucoup de termes de marine (2), le mot. qui désigne le mal de mer, nausea ou plus anciennement nautea, sont tous empruntés au grec, et montrent jusqu à quel point il est vrai de dire que les Italiens durent aux Hellènes les rudiments mêmes de la civilisation. Les Italiens, on n’en saurait douter, avaient leur religion, et quelques-uns des noms de leurs divinités, étant la propriété commune des nations aryennes, sont à peu près les mêmes en latin et en grec ; mais il y a en latin et en osque, sinon en ombrien et en sabellien, d’autres noms qui sont clairement empruntés au grec. Tels sont Apolîo (l'osque ’À-TTcD.oûy) et Hercules (i’osque Heraclo). Suivant Mommsen il y avait un dieu italien, appelé Herechts, et plus tard on l’identifia avec le Herakles grec. On a supposé que son nom venait de hercere, et qu’il exprimait la même idée que le.grec épmoç, le protecteur des enclos; mais cette hypothèse pst pleine de difficultés. Hercere . n’existe pas en, latin ; s’il existait, il ne viendrait pas de. là même racine que Ipxoe ; en dernier lieu, le suffixe diminutif lus nous donnerait herculus ou herclus, mais non, tant quon resterait sur le terrain propre au latin, here-
(1) Mommsen, Romische Geschichîe, liv. I, p. *186. Slatera, la balance, le grec <TTai:r,p ; machina, machine, ; nwnus, monnaie d’argent, vop.oç, le sicilien voïïu(u.oç ; gromâ, instrument d’arpentage, le grec - yvwjxwv ou yvoip.a ; clalhri, barreaux, traverses, grille, le mot grec yXrfipa ; le mot italien indigène pour traverses est claustra. Libra ne peut pas passer pour une corruption latine de Akpa, quoique les deux mots aient la même origine. Voyez le Journal de Kuhn, xvi, 159.
(2) Gubernare, gouverner, de xuéspvav ; anchora, ancre, de ây-xupa ; prora, proue, de -âpwpa. Navis, remus, vélum, etc , sont des mots aryens communs aux deux langues, et qui n’ont pas été empruntés par les Romains aux Grecsils prouvent que les Italiens connaissaient la navigation, avant que l’établissement des premières colonies grecques et les hardis vo}7ages des Phocéens eussent mis la Grèce en relation avec les populations ilalioles. Voyez Lottner, dans le Journal de Kuhn, vu, 167.
dus (4). Castor et Polhiæ, tous deux d’origine purement grecque, furent acceptés sans difficulté par lesmarins italiens, comme dieux des navigateurs ; ce sont les premiers dieux grecs qui eurent leur temple à Rome : ce temple fut élevé en 485 après la bataille du lac Régille(2). En 431, les Romains érigèrent un autre temple en l’honneur d’Apollon, dont l’oracle à.Delphes avait toujours été consulté par les Italiens depuis l’arrivée en Italie de la première colonie grecque. Les oracles de la fameuse sibylle de Cumes étaient écrits én grec (3), et l'on accordait aux prêtres (duoviri sacris façiundis) deux esclaves grecs pour traduire ces oracles (4).
Dans d’autres cas les dieux grecs étaient identifiés avec les dieux italiens. Gomme Jupiter était clairement la même divinité aryenne que Zeus, Juno, sa femme, était identifiée à liera. Dans Mars, on reconnut Ares, Kephaistos dans Yulcanus, Athenc dans Minerva, etc.; qui plus est, Sâturnus (Saëlurnus), qui était primitivement, à ce qu’il semble, une divinité agricole italienne (5), fut identifié à Kronos, et, comme Kronos était fils d’Uranos, une nouvelle divinité fut aisément inventée, et on raconta que Sâturnus était fils de Ccelus.
(1) Voir Grassmann dans le Journal de Kohn, xn, p. 103. Si
Herculus était un mot purement latin, on pourrait, l’identifier avec For-cuïus. -
(2) Ibid., I, 408.
(3) Ibid., I, 165.
(4) . Sibylla ou sibulla est un diminutif d’une forme italienne sabus ou sabius, sage, mot qu’on ne trouve pas dans les auteurs classiques, mais qui a dû exister dans les dialectes italiens. Le français, sage suppose un italien sabius, car il. ne peut dériver ni de sapiens ni de sapius. — Diez, Lexicon etymologicwn, p. 300. Sapius s’est conservé dans nesapius, insensé. Sibulla signifiait donc une sage vieille femme.
(5) Voyez, pourtant, Sehweizer-Siedler (dans le Journal de Kuhn, xvi, 1391; il voit dahs Saeturnus un développement italien du Sayitar védique, le soleil, envisagé comme pouvoir fécondant. A
Quand les Romains, en 454 avant Jésus-Christ, voulu-
■ ' ■* . p ■ ^ -
rent se donner un code de lois, ils commencèrent par envoyer des délégués en Grèce pour étudier les lois de Solon à Athènes, et la législation des autres cités grecques (4). À mesure que Rome grandissait en, puissance politique, elle accueillait avec empressement les arts, les mœurs, la langue et la littérature de la Grèce (S). Avant le commencement des guerres puniques, beaucoup des hommes d’État romains comprenaient et parlaient même le grec : les enfants Rapprenaient pas seulement l’alphabet romain avec leurs maîtres les Uteraiores, les caractères grecs leur étaient enseignés en même temps ; ..on appelaitgrain-matici ceux qui donnaient des leçons de grec, et c’étaient généralement des esclaves ou des affranchis grecs.
Pour la génération nouvelle que Caton voyait se former autour de lui, savoir.le grec était la marque de l’homme de bonne société : ces jeunes gens lisaient des livres grecs ; ils conversaient, ils écrivaient même en grec. Tibérius Gracchus, consul en 477 avant notre ère, prononça à.Rhodes un discours en grec, et il le publia ensuite (3)'. Quand les Grecs complimentèrent Flamininus èn latin, il leur rendit leur politesse en composant des vers grecs en l’honneur de leurs dieux. La première. histoire romaine fut écrite à Rome en grec par Fabius Pictor vers l’an §00 avant Jésus-Christ (4); et c’était probablement
Rome, Saturne était considéré comme un dieu de l’agriculture, et la faux qu’il tenait à la main rappelait peut-être celle que Kronos avait employée contre son père. Voyez Plutarque, Annoi. roman. 42:
il ort xapTTtov ap&Tïjç ystopytocç ^yeu.fov ô Gsoç ; 7; yàp apTîr, touto ŒT,uatvsi * xat oux, ojç yé/’paç-EV ÀvTtua^oç Rctootp 'TtstGou.svoç.
(1) Mommsen, 1, 256. ■
(2) Ibid-., I, 425, Ml. - .
(3) Ibid., 1,857. . ■.
(4) Mommsen, I, 902..
comme pour protester contre cet ouvrage et contre cëux de Lucius Cincius Alimentus et de Publius Scipion, que Caton écrivit en latin son Histoire romaine. Les classes inférieures s’empressèrent de suivre l’exemple des hautes classes, et c’est ce que prouvent bien les pièces de Plaute; car l’emploi affecté de mots grecs y est parfois aussi évident que le ridicule étalage de mots
français dans les auteurs allemands du dix-huitième siècle.. Certes, tout n’était pas bon dans l’héritage que la Grèce légua à Rome; mais qu’eût, été Rome sans les leçons de la Grèce ? Les pères mêmes de la littérature romaine furent des Grecs, qui gagnaient leur vie à donner des leçons et à traduire des livres de
O ■
classe ou des pièces de théâtre. Livius Àndronicus, envoyé de Tarente comme prisonnier de guerre, "en
l’an 272 avant Jésus-Christ, se fixa à Rome en qualité de professeur de grec. Sa traduction de l’Odyssée en vers latins, qui est comme le début de la littérature romaine, fut bien certainement écrite par lui à l’usage de ses- élèves. Son style, quoique embarrassé et dur au dernier point,‘ passait pour un modèle de per
fection aux yeux des jeunes poètes de la capitale. Nævius et Plaute furent ses contemporains et ses successeurs immédiats. Toutes les pièces de Plaute n’étaient que des traductions ou des remaniements de
comédies grecques , et on ne lui permettait même pas de transporter la scène de la Grèce à_Rome. Le public romain voulait contempler les mœurs et la dépravation des Grecs; on aurait puni le poète qui eût osé mettre sur la scène un patricien ou une matrone romaine. Les tragédies grecques furent également traduites en latin. Ennius (239-169), contemporain de Nævius et de Plaute, mais un peu plus jeune qu’eux, fut le premier qui traduisit Euripide. C’était, comme Àndronicus, un
Grec d’Italie, qui s’établit à Rome comme professeur de langue et traducteur de grec. Il trouva des protecteurs
"V
dans le parti libéral, dausPublius Scipion, dans Titus Quinc-tius Flamininus et dans Marcus Fulvius Nobilior (1), et il devint citoyen romain. Mais Ennius était plus qu’un poète et qu’un professeur: on Ta appelé un novateur, et dans de certaines limites il l'était certainement. Il traduisit en latin deux écrits composés dans l’esprit le plus hostile contre la religion de la Grèce et contre l’existence même des dieux grecs (2). L’un était la philosophie d’Epicharme (470 avant Jésus-Christ, à Mégare), qui enseignait que Zeus n’était que l’air, et les autres dieux des noms donnés aux forces de la nature ; l’autre écrit était celui d’Évhé-mère de Messène (300 avant Jésus-Christ), qui prouvait sous forme de roman que les dieux grecs n’avaient jamais existé, et que ceux qu’on honorait sous leurs noms n’avaient été que des hommes. Ces deux ouvrages ne furent pas traduits san s dessein, etieurs arguments, bien que de la dernière faiblesse, étaient la ruine des-systèmes plus superficiels encore de la théologie romaine. Le nom de grec devint synonyme d’impie, et Ennius n’aurait peut-être pas échappé au châtiment infligé à Nævius pour ses satires politiques, s’il n’avait pas joui de la protection et de l’estime des personnages les plus considérables de Rome.
- +
Même Caton, l’implacable ennemi de la philosophie (3) et delà rhétorique grecques, était l’ami du dangereux Ennius ; et telle était l’importance croissante de la langue grecque à Rome, que Caton lui-même dut l’apprendre dans sa
(•J) Mommsen, 1, 892.
(-2) lbid.,l. 843, 194. On s’est demandé si l'ouvrage d’Ennins était bien une traduction d’Epicharme. Voyez Ennius, éd. Yablen, p. xcnr. Sur Epicharme, voyez Bernavs, Rlieimsches Muséum, VIII, p 280 (1833). * • . .
(3) Mommsen, 1, 9H.
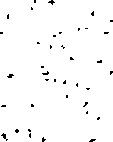
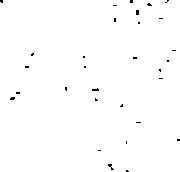
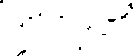
TROISIÈME LEÇON. . 449
vieillesse, pour faire lire' à son fils les parties de cette.littérature qu’il considérait, sinon comme utiles, au moins
1 à
comme inoffensives. On a souvent tourné en ridicule l’opposition hargneuse, que fit Caton à tout ce qui était grec,
■ ^ . ■
mais ses invectives n’étaient que trop légitimes. Nous aussi, nous avons souvent entendu parler dujeune Bengale, de ces jeunes Hindous qui-lisent Byron et Voltaire, jouent au billard, tournent leurs prêtres en dérision, protègent les missionnaires, et ne croient arien : la description que nous donne Caton de la jeunesse désœuvrée de Home nous
T , . . " p B
rappelle, par plus d’un trait, notre jeunè Bengale.
Quand Home prit des mains défaillantes de la Grèce le flambeau de la science, il avait cessé de jeter son plus
vif éclat. Chrysippe.et Carnéade avaient succédé à Platon
* " t/ J. X _ , 4 ,
* ? ’ .
et à Aristote ; Eschyle et Aristophane avaient été. remplacés par Euripide et Ménandre. En devenant gardienne de l'étincelle deProméthée, qui avait d’abord jailli en Grèce, et. qui était destinée à éclairer non-seulement l’Italie, mais toute l’Europe, Rome perdit beaucoup de cette vertu native qui avait été la source de sa grandeur. La frugalité et la gravité, le dévouement et le patriotisme, la pureté et la piété du peuple romain, furent remplacés par le luxe et la légèreté, l’intrigue et l’égoïsme, le vice et l’impiété des Grecs. Le blâme et la réprobation ne servirent de,rien, car les idées grecques ne parurent jamais aussi séduisantes que quand elles eurent été condamnées par Caton et par -ses amis. Toutes les générations nouvelles furent pénétrées de plus en plus par l’élément grec. En 131 (4), nous
entendons jDarler d’un consul, Publius Crassus, qui,
■ ’ , ^
comme un autre Mezzofànli, savait parler les différents dialectes du grec. Sylla permit aux ambassadeurs étran-
1 ■ ■ v
(1) Mommsen, II, 407.
gers de parler grec devant le sénat romain (1). Le philosophe stoïcien Panætius fut l’hôle des Scipions (2), dont la maison fut pendant longtemps le rendez-vous de tous les écrivains célèbres de Rome. Là„.l’historien grec Polybe et lé philosophe Glltomaque, Luciliüs le satirique, Térence le poète africain (4 96-159) et l’improvisateur Ârchias (4 02 av. J.-C.), étaient toujours assurés d’un accueil amical (3). Dans cette réunion choisie, les chefs-d’œuvre de la littérature grecque étaient lus et commentés ; les problèmes de la philosophie grecque étaient discutés, et les plus graves intérêts de la vie humaine formaient le sujet des conversations sérieuses. Bien que cette, société n’aitprodurt aucun poète de génie, elle ne laissa pas d’exercer une puissante influence sur les progrès de la littérature romaine : elle constitua un tribunal de bon goût, et la correction, la simplicité et la vigueur du latin classique sont dues en grande partie à cette sorte de cercle cosmopolite qui se réunissait sous; le toit hospitalier des Scipions.
Avec les générations nouvelles, la connaissance du grec se.répandit de plus en plus à Rome. Cicéron harangua en grec devant le Sénat de Syracuse, et Auguste dans la ville d’Alexandrie. Ovide nous raconte que les jeunes
(1) Ibid,, II, 410. Au temps de. Tibère, Yalère Maxime demande : « Quis ergo b nie consueludini, qua nunc græcis aetionibus au res cu-riæ exsurdan lor, januam patefecit? » (Lib. II, cap. 41,3). Dion Cassins raconte (I, vu, 45) qu’on plaidait en grec devant Tibère, et que 1 empereur adressait des questions en grec i IIoitXàç (uèv outoeç !v
T/; S[a)»?XTCj.J TCtj-y, xql êxs: )v£ybgeys>:ç àxouwv, ttoLXocç Ss xeà aètbç
fecpcoToiv. V. Roberts, Discussions on llis Gospels, p. 29. Cependant Suétone, en parlant de Tibère, dit : « Sermone græco, quanquam alias promptus et facilïs, non tamen usquequaque nsus est, absti-nuitqne maxime in jsenalu, adeo quidem, ut « monopolium » nomi-naturus, prius veniam postulant, « quod sibi verbo peregrino ulen-dum esset. » « Militent qnoque græce interrogatum, nisi latine respondere vetuit. » Suét.. Tib., cap 71.
(2) Ibid,, 11, 403.. . ..
(3) Ibid,, II, 437, note; II, 430.
' TROISIÈME LEÇON. 424
' *
gens et les jeunes filles lisaient les pièces de Ménandre : « Solet pueris yirginibusque legi et Juvénal s’écrie :
« Omnia Græce
Cum sit turpe rnagis nostris nescire Latine. .
Hoc sermone pavent,'hoc iram, gaudia, curas,
- Hoc cuncta effundunt animi se.creta. s
(Sal., vi, 186, seqq.)
La vie religieuse de la société romaine, à la fin des guerres puniques, tenait plus de la Grèce que de Rome. Tous ceux qui avaient réfléchi sérieusement sur les questions religieuses étaient disciples de Zénonou d’Epicure, ou bien ils embrassaient les doctrines-de la Nouvelle Académie, niant là possibilité d’avoir aucune connaissance de Tinfini,, et mettant la probabilité à là place de la vérité (4). Quoique- les doctrines d’Epicure et de la Nouvelle Académie fussent toujours considérées comme des innovations .dangereuses , on- tolérait la philosophie stoïcienne, et Une sorte d’accommodement se fit entre la philosophie et la religion :• il y eut une philosophie d’État aussi bien qu’une religion d’État. Les prêtres romains, tout en ayant réussi à faire chasser de la cité, en .164, tous les rhéteurs et les philosophes grecs , comprirent qu’il fallait en venir- aux concessions. On reconnut ouvertement que, pour lés classes éclairées, la philosophie devait prendre laplacë-de la religion, mais que la croyance aux prodiges et aux oracles était nécessaire pour maintenir l’ordre dans les. masses (2). Caton lui-même, le chef du parti religieux, natio.-naî et conservateur, se demandait comment un aruspice pouvait rencontrer un de ses collègues sans éclater de
(1) Zénon mourut en 263, Épicure en 270, Arcésilas en 241., Carnéade en 129.
(2) Mommsen, II, 417, 418. .
122 LEÇONS SUR LA SCIENCE DU LANGAGE.
*
rire (4). Des hommes comme Scip ion Émilien et Lélius faisaient profession de croire aux dieux populaires ; mais pour eux Jupiter n’était que l’âme de l’univers, et les statues des dieux des œuvres d’art (2). Leurs dieux> comme le peuple leur en faisait le reproche, n’avaient ni corps, ni esprit, ni passions. Le philosophe stoïcien et le prêtre orthodoxe vivaient cependant en paix, faisant profession tous deux de croire aux mêmes dieux, mais réclamant la liberté d’y croire chacun à sa manière. .
Je me suis étendu un peu.longuement sur des change-’mentsque subit l’atmosphèreintellectuelle de Rome vers la fin des guerres puniques, et je me suis efforcé de montrer combien elle était imprégnée d’idées grecques, afin d’expliquer, ce qui autrement aurait paru presque incompréhensible, l’ardeur avec laquelle non-seulement quelques savants et quelques philosophes, mais les premiers hommes d’État de Rome se livrèrent à l’étude de la grammaire grecque. Pour nous, il nous est difficile de ne pas associer aux discussions sur les noms et les verbes, sur les cas, les genres, les conjugaisons régulières et irrégulières, le souvenir de l’ennui que nous causaient ces questions quand nous étions au collège, et nous ne comprenons pas sans peine comment la grammaire proprement dite aurait pu, à Rome, exciter l’intérêt général et former un sujet de conversation dans la société la plus distinguée. Sans doute, les études grammaticales des Romains pouvaient être animées par des citations des auteurs classiques de la Grèce (3); néanmoins leur objet principal
(1) Mommsen, I, 845. Cicero, de Divincitione, IL 24 ; « Mirari se aiebat (Cato) quod non rideret haruspex iiaruspicem cum vidisset. »
(2) Ibid., II, 415, 417.
(3) Suétone, de Illustr. Gramm., cap. 2.

était purement le langage. Quand, un des premiers grammairiens de l’époque, Cratès, de Fécole de Pergame, fut envoyé à Rome, comme ambassadeur du roi Attale, il fut reçu avec les plus grands honneurs par tous les personnages lettrés de la capitale. Il était élève de Diogène le Babylonien, qui avait été élève de Chrysippe ; Chrysippe soutenant résolument la théorie de Y Anomalie, la philosophie du langage, telle que l’enseignait Cratès (aipz<n,q KparriTsioc), avait le même caractère (1). Comme il se promenait un jour sur le mont Palatin, son pied s’étant engagé dans la grille d’un égout, il tomba et se cassa la' jambe (2). Se trouvant donc forcé de rester à Borne plus longtemps qu’il n’en avait eu l’intention, il consentit à donner sur la grammaire quelques leçons publiques, ou
ahroaseis, et de ces leçons, nous dit Suétone, date Tétude
de la grammaire, à Rome. Cela se passait vers l’an 459 avant Jésus-Christ, entre là seconde et la troisième guerre
(1) « In quo fuit Craies nôbilis grammaticus, qui reliquil s ex îibros TrepV avwp.a)iac 3 heîs libris contra àvaXoytav àtque Âristarchum est nixus, sed iia, ut scripla indicarent ejus, ul neutrius videalur peryidisse voluntatem ; quod et Chi^sippus de inæquaîitate cum
: scribil sermonis, propositum habet ostendere similes res dissimi-îibus verbis et dissimilibus similes ipse vocabulis notalas (id quod est verum); et quod Aristarehus, de.æqualilate cum scribit et de verbornm similitudine, quorumdam. inelinationes sequi juhet, quoad latiatur consuetudo. » — Varro, De- Lingua Latina, ed. O. Muller, i ib. IX, c. 1.' ' .
(2) « Primus igitur, quantum opinamur, studium grammatieæ in Urbem intulit Craies Malloles Aristarchi æqualis, qui missus ad senaLum ab Attalo rege inter secuodum et tertium Punicum beilum sub ipsam Ennii mortem, cum regione Palatii prolapsus in eloaeæ foramen crus fregisset,. per omne légationis ’ simul et valetudinis tempus plurimas acroasis subinde fecit assidueque disseruit , ac nostris exemplum fuit ad imitandum. » Suetonius, De viris inlu-slribus, de grammaticis et rlietoribus, c. 2, ed. Reifferscheid. Lipsiæ, 1860. Scioppiüs, dans son introduction à sa Grammatica, pliüosophica (1628), dit : « Hæc ergo ut legi, minime jam mirandum mihi visum est, tanti flagitii erroribus inquinalam èsse veterem grammaticam, quæ ex eloaeæ foramine una cum claudo magistro emerserit. »
punique, peu de temps après la mort d’Ennius, et deux ans après la fameuse expulsion des rhéteurs et des philosophes grecs (16Î). Quatre ails plus tard, Carnéade, qui avait été également envové à Rome en qualité d’ambassadeur, fut empêché par Caton de donner des séances de philosophie. .
Après ces leçons de Cratès, les études grammaticales et philosophiques devinrent extrêmement populaires. Nous trouvons Lucius Ælius Slilo faisant un cours de langue latine, comme Cratès en avait fait un de grec (1): parmi ses élèves, on comptait. Yarron, Lucilius et Cicéron, Yarron composa vingt-quatre livres sur la langue latine, et en dédia quatre à Cicéron. Cicéron lui-même est cité comme faisant autorité en matière de grammaire, quoique nous ne connaissions de lui aucun traité purement grammatical. Lucilius consacra le neuvième livre de ses sati-
„ + *
res à.la réforme de l'orthographe (2). Blais rien ne montre pliïs clairement le vif intérêt porté aux études grammaticales par les plus hautes classes de la société romaine que le traité de César sur la langue latine. Il le composa pendant la guerre des Gaules, et le dédia à Cicéron, qui pouvait bien être fier de l'hommage que lui rendait le grand capitaine et le grand homme d’Élat (3). La plupart de ces traités sont perdus pour nous, et nous n’en pouvons juger que par quelques citations éparses. Ainsi, un fragment de l’ouvrage de César, de Ànalogia, nous conduit à croire que c’est peut-être à lui que nous devons le terme ablatif. Ce moine se rencontre dans aucun écrit antérieur, et il n’a pas pu, bien entendu, être emprunté, comme les noms
(1) Mommsen, II, 413. 426, 448, 437. Lucius Ælius Stilo écrivit un traité sur Télymologie et un index des pièces de Plaute. — Lersch, Die-Sprachphilosophie der Alten, II, lll.
(2) Lersch, II, 113, 114, 143. . '
(3) Cicero. Brut, c. 72. • .
des autres cas, aux grammairiens grecs, puisque la grammaire grecque n’avait pas admis d’ablatif. Si nous nous représentons César combattant les barbares de la Gaule et de la Germanie, suivant à distance les mouvements des partis politiques à Rome, prêt à saisir le sceptre du monde, et poursuivant en même temps ses études philosophiques et grammaticales avec son .secrétaire, le Grec Didyme (4), cet homme extraordinaire s’offre à nous sous un jour nouveau, et nous comprenons mieux l'époque où il vivait. Quand César devint tout-puissant, un de ses projets favoris fut de fonder à Rome une bibliothèque grecque et latine, et il en offrit la direction à Yarron, le premier savant du temps, bien que ce dernier se fût battu contre lui et pour Pompée (2). .
Nous voici donc arrivés à l’époque où. ainsi que nous, l’avons vu tout à l’heure, Denys le Thrace publia à Rome la. première grammaire grecque élémentaire. La grain-' maire empirique se trouvait ainsi transportée à Rome, la terminologie grecque était traduite en latin, et c’est sous cette forme latine que depuis près de deux mille ans. elle parcourt tout le monde civilisé. Même dans l’Inde, où une terminologie différente, et sous certains rapports plus parfaite que celle d’Alexandrie et de Rome, avait pris naissance dans les écoles de brahmanes, on entend employer de nos jours, par des maîtres européens parlant aux indigènes quils ont pour élèves, des mots tels que cas, genre, actif et passif. Le sort des mots est en vérité curieux ; et,
(1) Lersch, III, iM. [Voir, pour plus de détails sur Didyme,
Didymi fragmenta quæ supersunt omnia collégit et disposait JL schraidt, Lipsiæ, 4854, in-8°. M. Schmidt ne paraît pas avoir connu le fait qu’avance M. Millier sur l’autorité de Lersch.,. ces fonctions de secrétaire que Didyme aurait rem plies auprès de César. Consulter aussi, sur ce même Didyme, E Egger, Mémoires d'histoire ancienne, p. 258. Tr.] .
(2) Mommsen, III, 557. L’an 4S avant notre ère.
en parcourant dernièrement quelques listes des questions posées aux examens des collèges du gouvernement dans l’Inde, il me semblait qu’une demande comme celle-ci : « Quelle est la forme de Siva au cas du génitif? » résumait
*
en une seule phrase des volumes, d’histoire. Comment ces mots, cas du génitif, sont-ils parvenus dans l’Inde ? Ils y sont, arrivés d’Angleterre, et ils sont venus en Angleterre de Rome, à Rome d’Alexandrie, à Alexandrie d’Àthè-
. + ^ -
/ -
nés. À Athènes, le terme de cas ou plôsis avait une signification philosophique ; à Rome, casus n’était qu’une traduction littérale : la signification première de chute était perdue, et le mot était réduit à n’être qu’un terme purement technique. À Athènes, la philosophie du langage faisait le pendant de la philosophie de l’esprit. La terminologie des formes logiques et celle des formes grammaticales se confondaient. La logique des stoïciens se divisait en deux parties, la rhétorique et la dialectique, et cette dernière traitait en premier lieu « de ce qui signifie, ou du langage ; » en second lieu,' « de ce qui est signifié, ou des choses (1). » Dans leur langue philosophique, ptosis, que les Romains traduisirent par casus, signifiait réellement chute, c’est-à-dire le rapport d’une idée à une autre idée, l’acte par lequel un mot tombe et s’appuie sur un autre mot. De longues et vives discussions s’engageaient sur la question de savoir si le terme de ptôsis ou chute était applicable au nominatif ; et tout bon Stoïcien eût rejeté bien loin l’expression de casus reclus, parce que,’ selon les grammairiens de cette école, le sujet ou le nominatif ne tombait et ne s’appuyait sur rien,, mais se dressait pour servir de point d’appui aux autres mots de la proposition. Tout cela est perdu pour nous,
(4) Lersçh, II, 28. Hepi crijj.atvovTuv, OU rapt cpwvrîç ; et Trspi GTjij.oci-
VOp.EVCOV OU TOpl 7ïpaY[AaT(OV.
quand nous parions de cas (1). Nous voyons Cobbet, dans sa Grammaire anglaise, hasarder son explication. à lui du mol cas, en ces termes : « Le mot cas, appliqué aux événements de la vie, a une grande variété de sens ou de nuances de sens ; mais son sens général est état de choses,
ou Vétat de quelque chose. C’est ainsi que nous disons:
* " ' ' 1 ' _ .
dans ce cas, je suis d’accord avec vous. Ce qui revient à-: « tel étant l’état des choses, ou l’état de la chose en question, je suis d’accord avec vous. » On dit des légistes « qu’ils comprennentou qu’ils ne comprennent pas le cas, c’est-à-dire Vétat, la nature des choses qu’ils ont entrepris d’élucider. » Ainsi quand nous disons d’un malade que son cas est grave, nous voulons dire que son état est grave. Les noms peuvent être dans des états, ou des situations différentes, par- rapport à d’autres noms ou à d’autres mots. Par exemple, uii substantif peut être le nom d’une personne qui frappe un cheval, ou d’une personne qui possède un cheval, ou d’une personne qu’un cheval atteint d’un coup de pied. Ce.s* différentes situations, ces différents états sont, par conséquent, appelés cas (â). »
El comment les jeunes Hindous de nos collèges de l’Inde peuvent-ils deviner la signification du mot génitif ? Le latin genitivus est une véritable bévue, car le mot grec genikë n’a jamais pu signifier genitivus. Si ce cas avait été destiné à exprimer l’origine ou la naissance, il eût été nommé en grec gennêtikë, et non genikë. Le génitif n’exprime pas non plus le rapport du fils au père; car, si nous pouvons dire « le fils, du père, » nous pouvons dire également « le père du fils. » Genikë, avait en grec un sens
(-1) [Cf. R. Schmidt, Stoïcorum grammalica, 1839, Halis, in-8°. Tr.] . ‘ . .
(2) William Cobbet, .4 Grammar of lhe English language, lettre'V, § 44. . ■ '
bien plus étendu et bien plus philosophique (4). Il signifiait casus generalis, le cas général, ou plutôt le cas qui exprime le genre ou l’espèce : telle est la force réelle du génitif. Si je dis « un oiseau .de l'eau, » de l’eau détermine le genre auquel un certain oiseau appartient, il le range dans la catégorie des oiseaux aquatiques. « L’homme ‘ des montagnes » signifie un montagnard. Dans ces phrases, « fils du père, » ou « père du fils, » les génitifs ont exactement le même effet : ils affirment quelque chose du fils ou du père ; et si nous distinguions les fils du père et les fils de la mère, les génitifs exprimeraient la classe ou le genre auquel -les fils appartiennent, respectivement, et répondraient aux adjectifs paternels et maternels. Nous pouvons prouver, par l’étymologie, que la désinence du génitif est généralement identique avec ces suffixes déri-v-alifs à l’aide desquels les substantifs sont changés en adjectifs (2). ■
(1) Schoemann, was bedeulet yevixr, TCTwctç dans. le Journal- de lïofer pour la science du langage (Zeitschrift für die Wissenschaft der Sprachc, 4816,1, p. 83, II, p. 426\ Beitrage zur Geschichte der Grammatik, von Dr K.-E. Schmidt. Halle, 4839. Ueber den Begriff der y£vtx-)i TiTwstç, p. 320.
(2) Dans les langues tibétaines, la règle est « que les adjectifs se forment des substantifs par l’addition dn signe du génitif; » on pourrait donc renverser la règle et dire « que le génitif se forme du nominatif par l’addition du signe de l’adjectif. » Ainsi, shing, bois ; shing-gi, du bois, ou fait de bois ; ser, or ; ser-gyi, de l’or, ou fait d’or; mi, homme; rni:yi, de l’homme ou humain. C’est ce qui arrive aussi dans le garo, où le signe du génitif est ni; nous avons là mànde-ni jak, la main de l'homme ou la main humaine ; ambal-ni-kethâli, un couteau en bois, ou un couteau de bois. Dans l’indoustani, le génitif est si évidemment un adjectif, qu’il prend, même les marques du genre selon les mots auxquels il se rapporte. Mais que se passe-t-il en sanscrit, et en grec? En sanscrit, nous pouvons former des adjectifs .par l’addition de lya (voy. ma Lettre sur les Langues tour antennes, p. 41 et suiv.; et mon Essai sur le bengali, p. 333) : par exemple, daksfiinâ, le midi ; dakshmâ-tya, méridional. Il est clair que ce tya est un pronom démonstratif, identique au sanscrit syaSÿ syâ, tyad, celui ci ou celui-là. Tya est
h .. V
s
, ^ p'
Il n’est guère nécessaire de continuer, hors de Rome, l’histoire de ce que j’appelle l’étude empirique, ou l’analyse grammaticale du langage. Avec Denys le Thrace, le cadre de la grammaire était achevé î les écrivains postérieurs l’ont amélioré et perfectionné, mais ils n’y ont rien ajouté de vraiment neuf et original. Nous pouvons suivre le développement de la science grammaticale depuis Denys le Thrace jusqu’à notre temps, dans une succession non interrompue d’auteurs grecs et romains. Nous trouvons M. Yerrius Flaccus, précepteur des petits-fils d’Auguste, et Quintilien, au premier siècle ; au deuxième, ScauruSi Apollonius Dyscole et son fils Hérodien ; au quatrième, Probus et Donat, le maître de saint Jérôme. Après que, sous Constantin, Rome eut cessé d’être le siège une base pronominale, et par conséquent des adjectifs comme dakshina-tya, méridional, ou âp-tya-, aquatique, de âp\ eau, ont dû être conçus originairement comme « èau-là, » ou « sud-là «Suivi d’une désinence du nominatif singulier qui était aussi un pronom dans lé principe, âpiyas signifierait âp-tya-s, eau-là-ii. Or il importe peu -que je dise un oiseau aquatique ou un oiseau de l'eau. En sanscrit, le génitif de l’eau serait, en prenant udaka, udaka-sya : cette désinence sya est la même base pronominale que la désinence des adjectifs iya ; seulement sya ne prend pas. de signe pour le genre, comme l’adjectif. Le génitif uclakasya répond donc à un adjectif sans genre. Jetons maintenant les yeux sur le grec. En grec, nous formons des adjectifs à l’aide du suffixe cnoç, qui est identique au sanscrit tya ou sya : ainsi de S'Tjuoç, peuple, les Grecs formèrent
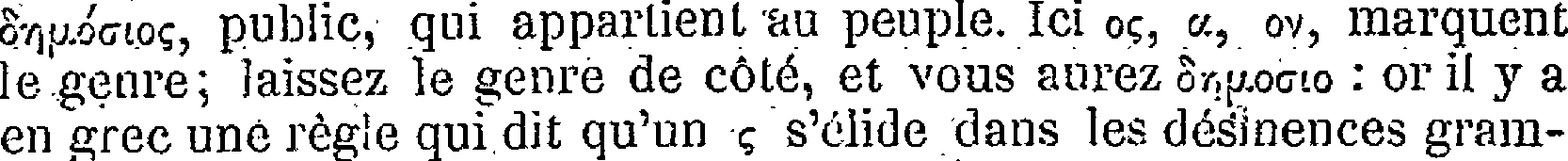
maticales, quand il se trouve entre deux voyelles ; aivisi le génitif de ysvoç n’est pas *('£V£t7oç, mais yévEoç ou ysvouç; par conséquent, oyuuocio serait devenu nécessairement o-<fy-oto (rapp. rjocicç = vjoioç), et £75-txoïo n’est autre que le génitif régulier dans Homère de ovjyoç, lequel, plus tard, fut remplacé par o-rju-ou. Ainsi nous retrouvons aux débuts du sanscrit et du grec les mêmes principes qui ont réglé la formation des adjectifs et des génitifs dans le tibétain, le garo etHiindous-tani ; et nous voyons avec quelle précision les anciens grammairiens grecs déterminèrent la valeur réelle du génitif, en Pappelant le cas général ou attributif, tandis que les Romains gâtèrent le terme par leur traduction erronée de genüivus.
du gouvernement, la science grammaticale trouva une nouvelle, patrie dans l’école de Constantinople. Il y eut jusqu’à vingt grammairiens grecs et latins qui occupaient des chaires dans la capitale de l’empire. Sous Justinien, au sixième siècle, le nom de Priscien jeta un nouvel éclat sur les études grammaticales, et son ouvrage a fait autorité durant le. moyen âge, et presque jusqu’à nos jours.. On nous a enseigné la grammaire à nous-mêmes d’après la méthode suivie par Denys à Rome, par Priscien à Constantinople, par Alcuin à York ; et quoiqu’on dise, des améliorations apportées à notre système d’instruction, les grammaires grecques et latines en usage dans nos collèges sont fondées principalement sur la première analyse empirique dù langage, préparée par les philosophes d’Athènes, accomplie par les savants alexandrins, et appliquée par les professeurs grecs de Rome à une tâche toute pratique, à l’enseignement d’une langue étrangère.
r
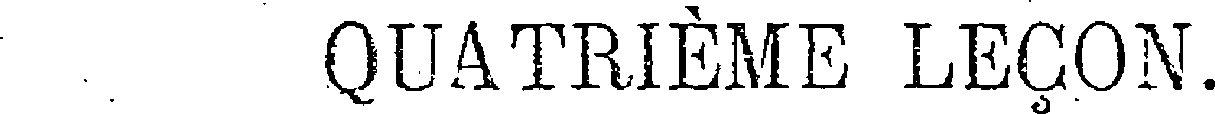
PÉRIODE DE LA CLASSIFICATION.
" ' L " ■*'
Observations sur la grammaire empirique. — Origine des formes grammaticales. Nécessité d|établm la filiation..des langues, afin de pouvoir faire . remonter les formes grammaticales jusqu’à leur origine. — L’idée d’une classification des langues inconnue à l’antiquité. Pour les Grecs, les hommes étaient divisés en Grées et en barbares. Influence du mot barbares, chez les Grecs d’abord, plus tard chez les Romains. — Le Christianisme, en enseignant l’origine commune de l’humanité, prépare les voies à l’étude comparée des langues. — Première division des langues, en langue sacrée et langues profanes. — L’étude de l’arabe, du chaldéen et du syriaque conduit à l’établissement de la famille sémitique. La philologie au seizième siècle : Bibliander, Henri Eslienne, Roccha, Megiser, Guichard, J.-J. Scaliger, Duret, Thomassin. — Les progrès de la science du langage sont empêchés pendant longtemps par le préjugé qui faisait regarder l’hébreu comme la langue primitive de l’humanité. Leibniz combat le premier ce préjugé : ses efforts incessants pour obtenir des spécimens de toutes les langues du monde, afin d’établir la philologie comparée sur les seuls fondements qui soient vraiment solides. — L’impératrice Catherine et ses études philologiques : son Dictionnaire comparé, contenant une liste de deux: cent quatre-vingt-cinq mots traduit en deux cents langues, paraît en 1785. — Les deux ouvrages qui résument, au commencement de notre siècle, tous les travaux antérieurs, sont le Catalogue des langues, d’Hervas, et le Mithri-date, d’Adelung. Vie d’Hervas. — Découverte du sanscrit. Histoire de , cette langue, qui cessa d’être pariée trois cents ans avant Jésus-Christ. Les dialectes qui en sont sortis, le pâii, le prâkrit, lesquels, avec le temps, se sont transformés dans les idiomes modernes de l’Inde, l’hin-doui, l’hindoustanijle mahratle, le bengali. La haute antiquité du sanscrit est prouvée par les noms sanscrits qui se rencontrent dans les auteurs grecs, latins et chinois; les Voyages des pèlerins boudhisi es. Etude du sanscrit après la conquête de l’Inde par les Mahométans. Sous le calife Almasour, Mohammed ben Ibrahim Alfazari traduit en persan le grand Sindhind, vers 771 de Jésus-Christ. Travaux d’Albirouni. Traduction de divers ouvrages sanscrits en persan et en arabe. Règne d’Akbar ; il fait traduire en persan le Mahâblirâraia, le Râmâyana,
VAmaralîosha, mais il ne peut, obtenir des brahmanes une traduction des Védas. Légende de Feizi. Dara, l’arrière petit-lils d’Akbar, donne, en 1657, une traduction en persan des Upanishads, laquelle lut traduite en français par Anquetil-Duperron, en 1795. — Travaux de saint François-Xavier et de ses compagnons dans l’Inde. Filippo Sassetti. Vie de Roberlo de Nobili, le premier Européen qui posséda une connaissance approfondie de la langue et delà littérature sanscrites. — ïïeinrich Roth. Correspondance des pères Cœurdoux, Calmette et Pons, avec l’Académie des inscriptions et belles-lettres. — Première grammaire sanscrite publiée, en 1790, par Paulin de Saint-Barthélemy. — Fondation, en 178", de la Société asiatique à Calcutta : travaux de William Jones, de Carey, de Wilkins, de Forster, de Colebrooke. Découverte de l'affinité entre le sanscrit et le grec et le latin. —- Frédéric SchlegeJ Etablissement de la famille des langues indo-germaniques.
Dans notre leçon précédente, nous avons tracé le tableau de l’origine et des progrès de l'étude empirique des langues, depuis le temps de Platon et d’Aristote jusqu’à notre propre enfance. Nous avons vu à quelle époque et dans quelles circonstances fut faite la première analyse grammaticale du langage, comment les diverses" parties du discours reçurent leurs dénominations, et comment,
o è ' + y
à l’aide d’une terminologie demi-philosophique et demi-empirique, on composa, en Yue de l’enseignement des langues, un Système grammatical qui, quelle que soit sa valeur intrinsèque, a eu du moins le mérite de remplir l’objet pour lequel il avait été imaginé.
La manière dont fut élaboré ce système de science
■ V
grammaticale ne nous permet pas d’en attendre une grande lumière sur la nature, du langage. La division en noms et en verbes, en articles et en conjonctions, les tableaux des déclinaisons et des conjugaisons n’étaient qu’un'simple réseau artificiel jeté sur le corps vivant du langage. Ce n’est pas à la grammaire de Denys le Thraee qu’il faut demander de reproduire et de nous montrer * avec toute la variété de ses articulations, le squelette du langage humain. Il est curieux, cependant, d’observer les coïncidences frappantes que nous trouvons entre la ter-
minologie grammaticale des G-recs et celle des Hindous, coïncidences qui semblent prouver que le système, si souvent critiqué, de la grammaire classique, doit reposer sur quelque chose de réel et avoir ses racines dans la nature même de notre intelligence. Les Hindous sont la seule nation qui ait cultivé la science grammaticale, sans avoir reçu directement ou indirectement aucune impulsion des Grecs. Pourtant, nous trouvons en sanscrit le même système de cas, appelés vibliakti ou inflexions, les voix, active, passive et moyenne, les temps, les modes el les personnes, qui y sont distribués, non pas exactement, mais à peu près de la même manière quen grec(4).-
i _ _ '
En sanscrit, la grammaire est appelée vyâkarana, ce qui signifie analyse ou décomposition. De même que la grammaire grecque dut son origine à l’examen critique d’Homère, la grammaire sanscrite sortit- de l’étude des Yédas, les plus anciens poèmes des brahmanes. Les différences entre le dialecte de ces hymnes sacrés et le sanscrit littéraire des âges postérieurs furent notées.et conservées avec un soin religieux. Nous avons encore les premiers essais des brahmanes dans la science grammaticale, les prâtisakhyas : ces traités, tout en faisant profession seulement de donner des règles sur la prononciation correcte de l’ancien dialecte des Yédas, nous offrent en même temps. des observations de l’ordre grammatical, et surtout ces précieuses listes de mots irréguliers ou remarquables pour toute autre raison, les Ga?ias ; c’est sur cette base solide que les générations successives des savants hindous élevèrent cet édifice prodigieux, dont la grammaire de Pânini a été le couronnement. Il n’y a pas dans toute la langue sanscrite de forme régulière ou irrégulière, qui ne trouve sa place et son explication dans la
(1 ) - Mrx Muller, Bistory of ancicnl sanskrit littérature, p 158.
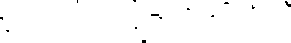

43i LEÇONS .SUE LÀ'SCIENCE DU LANGAGE. .
o .
grammaire de Pânini et dans ses commentateurs. C’est la . perfection d’une analyse purement empirique du langage, et la littérature grammaticale des autres nations n’offre rien de supérieur, rien même de comparable à ce travail. Néanmoins, sur la nature réelle et sur le développement, naturèl du langage, la grammaire de Pâuini ne nous apprend absolument rien.
. Que savons-nous donc du langage, après avoir appris la grammaire du grec ou du sanscrit, ou après avoir jeté sur notre propre langue le réseau de la grammaire classique? •
- Nous connaissons certaines formes du langage, qui répondent à certaines formes de la pensée. Nous savons que le sujet doit prendre la forme du nominatif, et le complément celle de l’accusatif; que le complément indirect peut être mis au datif, et que l’attribut, sous sa forme la plus, générale, peut être rendu par le génitif. On • nous dit que, tandis qu’en anglais le génitif est marqué par un s final ou par la préposition of, comme il l’est en français par la préposition de, ce cas est exprimé en grec par 1a. désinence os, et en latin par la désinence is : mais que représentent cet os et cet isf d’où leur vient le pouvoir de changer un nominatif en un génitif, un sujet en un attribut? tout cela reste une énigme pour nous. Il va sans dire que toutes les langues, pour atteindre leur but, doivent pouvoir distinguer le sujet du complément, le nominatif de l’accusatif; mais qu’ün simple changement de terminaison suffise poür.exprimer une distinction-aussi importante , c’est là un phénomène qui semble presque incompréhensible. Si/ pour un instant, nous portons les yeux au-delà du grec et du latin, nous voyons qu’il n’y a, en réalité, que fort peu de langues qui aient des formes distinctes pour ces deux catégories de la pensée. Même en grec et en latin il n’y a pas de distinction

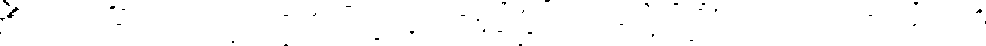
QUATRIÈME LEÇON. 435
. a ’ ■
apparente entre le nominatif et Paccusatif des substantifs neutres. On dit communément que le chinois n’a pas de grammaire du tout, c’est-à-dire qu’il n’a pas d’inflexions, de déclinaisons ni de conjugaisons, dans le sens que nous donnons à ces mots ; il n’établit aucune distinction
7 ïj *
dé formé entre les différentes parties du discours, le nom, le verbe, l’adjectif, l’adverbe, etc.; et pourtant il n’est pas de nuance de la pensée que cette langue ne puisse rendre. Les Chinois n’ont pas plus de peine à faire la différence entre « Pierre bat Jean » et « Jean bat Pierre, » que n’en avaient les Grecs et les Romains, ou que nous n’en avons nous-mêmes : ils n’ont pas, il est vrai, de désinence particulière pour marquer l'accusatif, mais ils obtiennent le meme résultat en plaçant toujours le sujet avant, et le régime après le verbe, ou bien en employant, avant ou après le nom, des mots qui- indiquent clairement qu’il doit être regardé comme complément (4). Il y a d’autres
(1) Je dois la note suivante, ainsi que plusieurs autres, à l’obligeance du premier sinologue de l’Europe, M. Stanislas Julien, membre de l’Institut. '
Les Chinois ne déclinent pas leurs substantifs, mais ils en indiquent distinctement les cas,
4° Au moyen de particules, . - .
' . 2° Par la position dans la phrase.
4 . Le nominatif ou le sujet est toujours placé au commencement de la proposition. .
2. Le génitif peut être marqué :
(a) Par la particule tchi placée entre les deux noms, dont le premier est au génitif, et le second au nominatif. Ex. jin-tchi-kiun (hominum princeps, mot à mot, homme, signe du génitif, prince);
(b) Par la position, en plaçant d’abord le nom. au génitif, et ensuite au nominatif. Ex., houe (royaume) jin (homme), c’est-à-dire un homme du royaume. ‘
3. Le datif peut être exprimé : .
(а) Par la préposition yu, à. Ex., sse (donner) yen (argent) yu (à)
jin (homme) ; - _
(б) Par la position, en plaçant d’abord le verbe, puis le mot au datif, et enfln le mot à l’accusatif. Ex., yu (donner) jin (à
langues qui sont plus riches en désinences que le grec même et le latin. En finnois il y a quinze cas qui expri-
un homme) pe (blanc) yu (jade) hoang (jaune) km (métal) c’est-à-dire or. . .
.4. Quant à l’accusatif, ou bien on le laisse sans aucune marque distinctive; par exemple, pao (protéger) min (le peuple), ou on le fait précéder de certains mots qui avaient originairement un sens plus facile à saisir, mais qui se sont réduits graduellement à n’être que de simples signes de l’accusatif. [C’est M. Stanislas Julien, qui, le premier, découvrit cés mots,, et en donna l’explication exacte dans ses 1 indiciæ philologicæ in linguam sinicàm, Paris. 1830. Les Vindiciæ philologicæ in linguam sinicam se trouvent à la fin du Meng-lseu ou Mencius traduit en latin par M. Stanislas Julien.] Les -particules les plus usitées à. cet effet, chez- les auteurs modernes, spnt pa .et Isiang, saisir, prendre-. Ex., pa (prenant) tchoung-jin (foule des hommes) l'eou (furtivement) lîlan (il regardait), c'est-à-dire il regardait furtivement la foule des hommes (hominum turbam furtim aspiciebat). Dans le chinois plus, ancien {kou-wen), les mots consacrés pour le môme usage sont i (employer, etc.), iw, hou. Ex. i (employant) jin (humanité) fsun (il conserve) sin (dans le cœur), c’est-à-dire humanitatem conservât corde, / .(prenant) tchi (droit) wgï (faire) k’io (courbe), c’est-à-dire rectum facere curvum. Pao (protéger) hou (signe de l’accusatif) min (le peuple). •
5. L’abiatif s’exprime :
(a) Au moyen de prépositions telles que thsong, yeou, tseu, hou. Ex., thsong (ex) thien (cœlo) lai (venire) ; te (obtinere) hou (a) ihien (cœlo) ; _ . ...... .
ir la position : en plaçant avant le verbe le mot qui est à
]
Tchi
placerait après le mot auquel il se rapporte ; comme si l’on disait : du-ciel-les-descendues-calamilés, pour les calamités que le ciel envoie aux hommes. ,
6. L’instrumental est exprimé :
{a) Par la préposition i, avec. Ex., i (avec) kim (l’épée) cha (tuer) jin (un homme) ; , V .
(b) Par la position, en plaçant le nom qui se trouve au. cas dé l’instrument avant le verbe qui, à son tour, est suivi du subs-
lantif à l’accusatif. Ex., i (par la pendaison) cha (il tua) tchi (le,, ilium). .
7. Le locatif peut être exprimé en plaçant simplement le nom avant le verbe. Ex., si (dans l’Orient ou Orient) yeou (il y a) sou-
iou-po (un sthûpa) : ou par des prépositions, ainsi qu’il a été dit dans le texte.
L’adjectif est toujours placé devant le. substantif qu’il qualifie. Ex., meï-ÿm, une belle femme.
OTJATRIÈMlE leçon.
4 37
- O
ment tous les rapports possibles entre le sujet et le complément; mais il n’y a pas d’accusatif, il n’y a pas de cas qui soit consacré uniquement au régime direct (1). En anglais et en français, les désinences distinctives du nominatif et de l’accusatif ont disparu par suite de l’altération phonétique, et ces langues sont obligées, comme le chinois. de marquer le sujet et Je complément par la position des mots. Ce que nous apprenons au collège, quand on nous dit que le nominatif reæ fait regem à l’accusatif, n’est donc qu?une règle toute pratique. Nous savons dans quel cas il faut dire, rex, et dans quel cas il faut dire regem ; mais pourquoi le roi,, en tant que sujet, doit être appelé rex, et, en tant que régime, regem, c’est ce qui reste sans aucune explication. On nous dit, de même, que amo signifie j’aime, etamavi j’ai aimé; mais comment ce changement du cœur, ce passage, de l’amour actuel au .souvenir de l’amour passé et peut-être éteint, peut-il être indiqué par le simple changement de o en avi, ou en anglais, par l’addition d’un d, c’est une question qui n’est ni posée ni résolue. Or, s’ily a une science du langage, c’est
de ces sortes de questions qu’elle doit donner la solution :
s 3 1 +
si elle ne le peut pas, s’il faut, nous contenter de para. ’digraes et de règles, et.regarder les désinences des noms et des verbes soit comme.dés signes de convention ou comme des excroissances mystérieuses,.alors la science
du langage n’existe pas, et il faut nous en tenir à ce qu’on a appelé l’art (ré^vr,) du langage ou la grammaire.
Avant d’entreprendre la solution d’un problème quelconque. ou d’y renoncer, il convient de déterminer si l’on a les éléments nécessaires pour mener l’entreprise à bonne fin. A commencer par l’anglais, il faut nous demander s’il nous est possible de découvrir pourquoi Ilove signifie j’aime en ce moment, tandis quei lovecl indique que.ce sentiment n’existe plus. Ou bien, en prenant, des langues plus riches en flexions que l’anglais, il faut tâcher d’expliquer par suite de quelle opération et dans quelles circonstances le latin amo, j’aime, a été transformé par la simple addition d’un r en amor, je suis aimé; Les déclinaisons et les conjugaisons, ont-elles poussé et se sont-elles épanouies comme les fleurs d’un arbre?
4
L’homme les a-t-il reçues toutes faites de quelque puissance mystérieuse? Ou quelques sages les ont-ils inventées, en assignant certaines lettres à certaines phases de la pensée, de même que les mathématiciens expriment les quantités par des signes algébriques, auxquels iis donnent une valeur arbitraire ? Nous voici en présence du plus important et du plus difficile problème de notre science, l’origine du langage; mais nous ferons bien, pour le moment, de détourner, les yeux des théories, pour nous occuper uniquement des faits.
Tenons-nons-en au prétérit anglais I lovecl comparé au présent I love. Il nous est impossible d’embrasser d’un seul coup d’œil toute la grammaire anglaise; mais, si nous pouvons faire remonter une de ses formes à sa source véritable, nous verrons probablement la route à suivre pour découvrir l’origine de toutes les autres. Si nous nous demandons comment l’addition d’un d final a pu exprimer le passage de l’amour à l’indiflérence, la première chose à faire, avant de hasarder aucune explication, c’est de re-
QUATRIEME LEÇON.
^ _ ' r-i
trouver la forme la plus ancienne de I loved, la forme vrai. ment primitive du prétérit anglais. C’est là une règle que Platon lui-même reconnaissait dans sa philosophie du langage, quoique, il faut bien l’avouer, il s’y conformât
rarement. Nous savons quels ravages l’altération phonéti-
. ■ * * ■ , Æ
que peut faire dans le vocabulaire et dans la grammaire dame langue, et nous aurions tort de nous perdre en conjectures sur l’origine d’une forme dont nous pouvons trouver l’explication en consultant l’histoire de la langue. Or une connaissance même superficielle de la langue anglaise nous apprend que la grammaire de l’anglais moderne n’est pas la même que la grammaire de Wyclifie. La langue de Wyclilfe appartient à ce que nous appellerons, avec Sir Frederik Blad.den, l’anglais de la période intermédiaire (4500-4330); nous remontons ensuite à l’anglais de la première période (4 330-1330); de 4230 à 4400 nous rencontrons le semi-saxon qui avait été précédé par l’anglo-saxon (4). Il est manifeste que, si nous devons découvrir la signification première de la syllabe qui change 1 love en I loved, ce sera en examinant la forme originale de cette syllabe à quelque époque que nous la trouvions. On n’aurait jamais su que prêtre signifiait primitivement un ancien, si on ne l’avait pas fait remonter à sa forme originale presbyter, dans laquelle toute personne sachant le grec reconnaît immédiatement le comparatif de presbys, âgé (2). Si nous n’avions pour nous guider que le français moderne, nous pourrions chercher à rattacher 'prêtre à prêcher ou a prier, mais nous n’arriverions pas à sa véritable dérivation. Nous ne voyons pas non plus la signification littérale
(t) V037-. quelques critiques sur cette division dans Marsh, Lectures onthe english language, p. 43.
(à) Dans une charte grecque de 1139, nous trouvons -âo^e Jtepoç changé en TcpEbiTs, qui est déjà presque l'italien moderne jjrele. Yo \\ Trmchera, Sytlabus. Græcarwn Membranarum , p. 136. ..
T , + "
du mot anglais moderne gospel; mais aussitôt que nous le faisons remonter à sa forme première goddspell, nous voyons que c’est une traduction exacte de evangelium ou bonne nouvelle (4). Lord ne serait qu’un vain titre en anglais, si nous n’en découvrions pas la forme et la signification originales dans l’anglo-saxon hlâf-orcl, source de pain, de hlâf, pain, et ord, place (2). ■*
Mais quand nous avons suivi cette voie et que nous avons fait remonter à l’anglo-saxon un mot anglais moderne, il
(I) « Goddspell onn Ennglissh nemmoedd iss Godd word, amid god tithenude, God. errnde. » etc. — Ormulum, prcf. 157. «And beode ther godes godd-spel. » Layamon, lit, 182, v. 29, 508.
(2) Grimm, Deutsche Grammaîik, I, p. 229, n, p. 405.. Lady en anglorsaxon est hlâf-dige.
Je dois les remarques suivantes sur le sens primitif de lord ou donneur de pain, l’allemand Broiherr, à l’obligeance du Rév. Dr Boswortlî, professeur d’anglo-saxon à Oxford : .
« Lord vient de l’anglo-saxon lilâf-ôrd, composé de'-hlâf, un pain (l’a long a le son qu’a dans l’anglais moderne oa, ainsi/dm, bât, aujourd’hui foam, beat), et ôrd, -es, s.m., origine, cause, auteur. Ainsi ôrd moncynnes, origo humain generis, Cd. 55. De là, le sens de lord, l’anglo-saxon hlâf-orcl; l’origine, la cause, l’auteur du pain, celui qui eutreiient la vie.
« Lady vient de l’anglo-saxon hlœf-digc, -die. Hlœf ou hlâf, -es, s. m., un pain, du pain ; et dige, die, -an, s. f., de dugan, digan, s’occuper de, pourvoir, servir. Par suite, lady veut dire celle qui procure, qui sert le pain à la famille. Dans le psaume exxir, v. 3, nous trouvons livre hlefdigean, ou hlœfdian, suæ dominæ R. Glouc., pour hlœf die, écrit leuedie, leuedy ; Gower et Spenser écrivent Zadfe-, on écrit aujourd’hui lady. » J. B. •
Toutefois, jusqu’à ce qu’on montre en anglo-saxon d’autres composés où ord, origine, prenne le sens d’auteur ou de donneur, j’avoue qu’il me semble plus naturel de faire dériver hlâf-ord de hlâf-weard, loaf-ward, gardien du pain. Voyez Seconde série de Leçons, traduction française, t. ï, - p. 322. Historiquement, cette idée que le don du pain est un des attributs de la souveraineté, on la retrouve dans les panes palatmi ou gradües, les pains qui étaient quotidiennement distribués sur les marches du palais impérial par Constantin le Grand, et, même avant lui, par l’empereur Aurélien. C’est à Dieu, le souverain du monde, que, dans l’oraison dominicale, nous demandons « notre pain quotidien. » Voyez Paulus Cassel, Der Grâl und sein Namc, Berlin, 1855, p. 18.

ne s’ensuit aucunement que nous devions en trouver dans anglo-saxon la forme et la signification premières. L’anglo-saxon n’est pas une langue originale ou indigène : son nom même nous reporte aux Saxons et aux Angles du continent. Il nous faut donc suivre notre mot anglo-saxon à travers les différents dialectes du saxon et du bas-allemand, jusqu’à ce que nous arrivions à la plus ancienne période de l’allemand où nous puissions atteindre, le gothique du quatrième siècle après Jésus-Christ. Même alors nous ne pouvons pas encore nous arrêter; car, bien qu’il nous soit impossible de rattacher le gothique à* une langue teutoni-que plus ancienne, nous pouvons découvrir à première vue que c’est aussi une langue moderne, et qu’il a dû traverser bien des phases diverses avant de devenir tel que
nous le: trouvons dans ce qui nous reste des écrits de l’évêque Ulfilas.
Que faire alors? ce que nous faisons quand il s’agit des langues romanes modernes. Si nous ne pouvions pas faire remonter au latin un mot français, nous chercherions en
O +
italien la forme correspondante, et nous tâcherions de la suivre jusqu’à sa source latine. Si, par exemple, nous étions dans le doute, touchant l’origine du mot feu, nous n’aurions qu’à nous rappeler l’italien fuoco, pour voir immédiatement que les deux mots dérivent du latin focus. Ce rapprochement est possible parce que nous savons que le français et l’italien sont des dialectes congénères, et que nous nous sommes assurés à l’avance du degré exact de parenté qui les unit. Si nous avions cherché dans Lallemand et non dans l’itaiién l’explication dumot/ew, nous aurions fait fausse route; car l’allemand feuer, bien que ressemblant plus à feu que l’italien fuoco, n’aurait jamais pu donner en français la forme feu. .
Nous pouvons également déterminer l’étymologie de la préposition hors, quand nous savons que hors répond à
l’italien fuora et à l’espagnol fuera. Le latin ne jette aucun lumière sur le mot fromage; mais dès que nous en rapprochons Litalien fromaggio_ (1 ), nous voyons que fromag-gio et fromage sont dérivés de forma, le fromage se faisant, en Italie comme partout ailleurs, dans des moules ou formes, où le lait s’égoutte et se durcit peu à peu. L’adjectif faible est évidemment dérivé du latin, mais ce n’est qu’en voyant l’ilaÜen fievole que nous songeons au latin flebilis. On n’aurait jamais trouvé l’étymologie de payer qui a donné l’anglais Ig pay, si on n’avait pas consulté les dictionnaires des dialectes congénères, tels que l’italien et l’espagnol. Là, nous voyons que payer se dit en italien pagare, en espagnol pagar, tandis qu’en provençal nous trouvons les deux formes pagar et payar. Or pagar nous reporte.immédiatement au latin pacare, qui signifie pacifier apaiser. Joinville emploie payer à la fois dans lè sens d’apaiser et dans le sens de payer (2). Apaiser un créancier, c’était le payer : c’est ainsi que quittance a pour forme originale quietantia, de quietus, tranquille (3).
e
Si nous voulons donc continuer nos recherches, si. non contents d’avoir suivi un mot anglais jusqu’au gothique, nous voulons en connaître la forme à une époque antérieure de son. existence, il nous faut rechercher s’il y a des dialectes qui soient par rapport à l’anglais ce que sont l’italien et l’espagnol par rapport au français ; il nous faut rétablir, autant que possible, l’arbre généalogique des
(1) Diez, Lexicon comparativum. Coîiuneila, Vil, 8.
(2) Joinville, éd. Fr. Michel, p. 45 : « Il s’agenouilla devant l’éuesque et se tint bin pour paiez. » p. 117 : « que se les dix mil livres ne sont paiés, que vous les facez paier. »
(3) Dans le latin du mo37en âge fredum signifie « composilio qna fisco exsoluto reus pacem a principe exsequitur. » C’est l'allemand fridu, paix, avec une forme latine. De là, le français les frais et défrayer. Yoy. Icheler, Dictionnaire d'étymologie française. .
différentes familles des langues. Nous entrons par là dans la seconde période de notre science, celle de la classification ; car la généalogie, quand elle est possible, est la forme
#■
la plus parfaite de la classification (-1).
Avant d’arriver aux résultats qu’ont donnés, dans cette branche de la science du langage, les travaux récents de Schlegel, Humboldt, Pritchard, Bopp, Burnouf, Grimm, Pott, Benfey, Kuhn, Curlius, Schleicher et d’autres savants, il est bon de jeter un coup d’œil sur ce qui avait.été accompli avant leur temps pour la classification des innombrables dialectes de l’humanité. .
Les Grecs n’ont jamais songé à appliquer les principes de la classification aux variétés du langage. Ils ne faisaient de distinction qu’entre le grec, d’une part, et, de l’autre, toutes les langues différentes du grec, qu’ils comprenaient sous le nom commode de langues barbares. Ils réussirent, il est vrai, à classer quatre de leurs propres dialectes avec 4 assez de précision (4), mais ils appliquèrent si généralement cette dénomination de barbares aux autres langues moins étroitement apparentées au grec (les dialectes des Pélasges, des Cariens, des Macédoniens, des Thraces et des ïllyriens), quil est presque impossible de faire servir à une classification scientifique les renseignements que nous fournissent les écrivains de Tantiquité sur ces idiomes qu’ils appellent barbares (2). îl est vrai- que Pla-
(']) Strabon, VIIr, p. 833i Trv p.sv 5laça ta TtaXaia 'ÂtOigi tvjv aurr,v ©apiv, T'/jv Vz Àojpioa Tr, ÀioXiot. Le même auteur, qui vivait au commencement de Père chrétienne, fait la remarque suivante sur les nombreux dialectes parlés en Grèce : cyjchv o4 tri xa\ vuv, xazà TroXeiç, oc),aot aXXoç oiaAsyoVTai * ooxouct SI owpltciv c’tîkvteç ota try guia-
oaaa.aav I-ty-paxeiav. Voyez Romaic and Modem Greek, par James Clyde, 1855, p. 28, ‘ .
(2) Hérodote (VII, 94, 509) dit que~ Pélasges était l’ancien nom des Éoliens et des Ioniens du Péloponnèse et des îles. Il conclut cependant (I, 57) du dialecte parlé de son temps par les Pélasges des villes de Kreston, de Plakia et de Skylake, que les anciens Pélasges parlaient une langue barbare, (papëapov. xr,v yXwowv leVrsç)-. Il est, par conséquent, obligé d’admettre que la race attique, d’origine pélasgique, avait oublié sa langue (to ’Attixov IOvgç Iov lïcXaaytxov, apa Trj g.zzcf.oéXrl Trj éc ^EXXrjVaç, xai xrjV yXtoccav p.£T£u,aOe.). Voy, Die-fenbach, Origines Europææ, p. 59. Denys d’IIalicarnasse (I, 17) évite* cette difficulté en déclarant que les Pélasges furent dès l’origine une race hellénique ; ce n’est là, cependant, qu'une hypothèse qui lui est propre. Les Cariens sont, appelés fiapëaco-cptovot par Homère (IL, Y, 867); mais Strabon (XIV, 662) a bien soin de faire observer qu’il ne faut pas pour cela les considérer comme papëapot. Il distingue entre [fep&xpûtpovEÎv, c’est à-dire xemoç IXX^vtÇeiv, et xapujxt XaXstv, xapt^siv xai SapêapiL£tv( Mais le même Strabon dit que les Cariens étaient appelés anciennement ÂïÀeysç (XII, p. 572), et il regarde ces Lélèges, ainsi que les Pélasges et les Caucones, comme ayant été les premiers habitants barbares de la. Hellade. Dans un autre passage (VII, p.. 321), il considère .avec Aristote et'Denys d’Halicarnasse les Locriens comme descendants des Lélèges, bien que les Locriens pussent à peine être appelés barbares.
Les Macédoniens sont cités par Strabon (X, p. 460) parmi « les autres Hellènes. « Démosthène parie d’Alexandre comme d’un barbare ; Isocrate en parle comme d’un Héraclide. A en juger d’après quelques mots qui nous en restent, le macédonien a dû être un dialecte grec (Diefenbach, Orig. Europ., p. 62). Justin (VII, 1) dit des Macédoniens : « Popuius Pelasgi, regio Pæonia
Ion, dans le Cratyle (c. 36), laisse entendre que les Grecs avaient peut-être reçu leurs mots des barbares, puisque
ces derniers étaient plus anciens que les Grecs : mais il
. ^ . ■ ■
ne pouvait voir lui-même toute la portée de cette remarque. Il fait seulement observer que certains mots, tels que les noms du feu, de Yeau.ei du chien, étaient identiques en phrygien et en grec, et il suppose que les Grecs les avaient empruntés aux Phrygiens (ibidc. 26); mais l’idée que la langue des Grecs et celle des barbares pouvaient avoir une source commune ne s'est jamais présentée à dicebalur. » Une tradition disait que le pays occupé par les Macédoniens avait appartenu autrefois en partie à des Thraces ou à des Piériens (Thuc., Iï, 99; Strabon, VU, p. 321), en partie à des Thessaliens (ibid.) .
Hérodote (V, 3) appelle les Thraces le plus grand peuple après Indiens. Strabon les distingue des Illyriens (Diefenbach, p. 65) et des Celtes (ibid.) \ Thucydide les distingue des Scythes (11, 96). Tout ce que nous savons sur leur langue repose sur ce que nous dit Strabon (VII, 303, 305) que les Thraces parlaient la même langue que les Gètes', et que la langue des Gèles, était identique avec celle des Daces, Nous avons quelques débris de la langue dacique dans les noms de botanique recueillis par Dioscoride ; et ces noms, d’après l’interpréta lion de, Grimni, sont évidemment aryens quoiqu’ils ne soient pas grecs. Strabon donne le nom de barbares aux Daces, ainsi qu'aux IÜvriens et aux Epirotes (VII, p. 321). "
Aux yeux des Grecs, les Illyriens passaient pour des barbares ; maintenant ils sont considérés comme une branche indépendante de la famille aryenne. Hérodote rattache les Vénèles aux Illyriens (I, 196); et les Vénètes, selon Polybe (II, 17) qui les connaissait, parlaient une langue différente de celle des CeiLes : il ajoute . qu’ils étaient une race antique, et qu’ils ressemblaient aux Celtes pour les moeurs et pour le costume. C’est pourquoi ils ont été, à tort, pris pour des Celtes par des écrivains qui négligeaient le critérium du langage, sur lequel Polybe s’appuie comme il devait le faire. Les Illyriens étaient une race très-répandue ; on comprenait au nombre des. Illyriens les Pannoniens, les Dalmates et les Dardaniens, dont vient le nom des Dardanelles (Diefenbach, Origines Ew'opææ, p. 74-, 75). C’est peine perdue que de chercher à tirer aucun renseignement positif de ce que nous disent les Grecs et les Romains concernant la race et la langue dè leurs voisins barbares. ' . .
son esprit. Il est extraordinaire qu’un génie aussi vaste que celui d’Aristote n’ait pas aperçu dans les langues un peu de cette règle et de cet ordre qu’il tâchait de découvrir dans tous les règnes de la nature : mais il n’est pas étonnant qu’un fait qui avait échappé à Aristote n’ait frappé personne pendant deux mille ans. Les Romains, en tout ce qui concernait les sciences, n’étaient que les imitateurs des Grecs. Après avoir été appelés barbares eux-mêmes, ils s’habituèrent bientôt à donner le même nom à toutes les autres nations, excepté, bien eDtendu, aux Grecs, leurs maîtres. Or barbare, est une de ces épithètes d’application facile, qui, en semblant tout, dire, ne disent, en réalité, absolument rien ; et ce terme fut prodigué autant que celui d'hérétique au moyen âge. Si les Romains n’avaient pas reçu tout fait ce nom commode de barbare,
ils auraient traité leurs voisin s, les Celtes et les Germains,
' * . '
avec plus d’égards et de sympathie : en tous cas,-ils les auraient considérés avec plus d’attention, et, s’ils, rayaient fait; ils auraient découvert que, malgré les différënces ap, parentes, ces barbares étaient pour eux, après tout, d’assez proches parents. La langue de César ressemblait autant à celle des barbares qu’il combattait en Gaule el en Germanie qu’à la langue d’Homère; et c’est ce qu’un homme de
, f ■
la sagacité de César n’aurait pas manqué de voir, s’il n’avait pas été aveuglé par la phraséologie traditionnelle. Pour prouver qu’il n’y a rien d’exagéré dans mon assertion, prenons un exemple : si nous examinons un verbe d’un usage aussi fréquent que le verbe avoir, nous en . trouverons les. paradigmes presque identiques en latin et en gothique :
En latin :
j’ai,
tu as, il a.
habeo,
habes,
habel,
En gothique :
haba,
habais,
habailh,
En latin : En gothique ;
nous avons, vous avez, ils ont,
habemus, liabam,
habetis, habailh,
habent, habant.
pas

Il fallait assurément être aveugle ou plutôt sourd pour ne pas remarquer une telle ressemblance, et je suis convaincu que la cause unique en était le seul mot barbare. Ce n’est que quand ce mot fut rayé du dictionnaire de l’humanité et remplacé par celui de frère, quand on reconnut le droit qu’ont toutes les nations du inonde à être regardées comme faisant partie d’un même genre ou plutôt d’une même espèce, que put naître notre science : ce changement est dû au christianisme. Pour les Hindous, tout homme qui n’était pas né deux fois, c’est-à-dire qui n’était de haute caste, était un îvAekkke; pour les Grecs,
celui qui ne parlait pas leur langue était un barbare; pour les Juifs, les incirconcîs étaient des gentils; pour les
musulmans, tous ceux qui ne croyaient pas en Mahomet
f ' * ■ .
étaient des Iciâfirs, incrédules, ou des ghiaours, infidèles adorateurs du feu. C’est par le christianisme que furent abaissées les barrières qui séparaient les Juifs et les gentils, les Grecs et les barbares, la race blanche et la race noire. Vhumanitéest un mot que vous chercheriez en vain dans Platon ou dans Aristote : l’idée de l’humanité formant une seule famille, composée des enfants d’un même Dieu, est une idée chrétienne, et, sans le chrislia-r
nisme, la science de l’humanité et dès langues qu’elle parle «
n’aurait jamais pris naissance. Quand on eut appris à regarder tous les hommes comme des frères, alors, et alors seulement,, la variété du langage humain se présenta comme un problème qui exigeait une solution aux yeux des observateurs intelligents, et c’est là ce qui fait que je date du premier jour de la Pentecôte le début réel de la science du langage. À partir de ce jour où les langues de
/
%
feu se séparèrent et descendirent sur les apôtres, une lumière jusqu'alors inconnue se répand dans le monde et jette ses clartés sur des objets qui étaient restés invisibles pour l’antiquité. De vieux mots prennent un sens nouveau, de vieux problèmes un nouvel intérêt, et de vieilles sciences un* nouvel objet. L’origine commune de l’buma-nité, les différences entre les races et les langues, la possibilité pour toutes les nations d’arriver au plus haut degré de la culture intellectuelle, sont des problèmes qui, dans le monde nouveau où nous vivons, préoccupent les savants par cela même qu’ils sont d’un intérêt supérieur à la science. Ce n’est pas une .objection sérieuse que de rappeler le long espace de temps qui s’écoula avant que l’esprit dont le christianisme a animé toutes les recherches scien-titiques ait produit des résultats apparents. Dans la flotte de chêne qui vogue sur l'Océan/ notre pensée sait retrouver le petit gland qui fut confié à la terre il y a. plusieurs .siècles,et,c’es.t ainsi que. dans la philosophie. d’Albert le Grand (/1), venu près de douze cents ans après la mort de Jésus-Christ, dans les aspirations de Kepler (2), et dans les travaux des plus grands philosophes de notre époque, nous
(l) Albert, comte de Bollstadten, ou Albert le Grand, ainsi qu’on l’appelle généralement, qui fut le pionnier des sciences physiques modernes, écrivait : « Dieu a donné à l’homme son esprit et en môme temps rintelligence, afin que l’homme s’én serve pour arriver à la connaissance de Dieu. L’âme trouve Dieu par la foi que lui donne la Bible, 'et par l’intelligence que lui "donne la nature. » Et ailleurs : « C’est pour la gloire de Dieu et pour le bien de nos frères que nous étudions la nature des choses créées. Dans l’univers tout entier, non-seulement dans l’harmonie des organisations individuelles, mais aussi dans la variété des formes différentes, nous pouvons et nous devons admirer la majesté et la sagesse de Dieu. » .
(à) Yoici la conclusion de l'Harmonie clu Monde, de Kepler : « O toi qui, par la lumière de la nature, nous as fait soupirer après la lumière de ta grâce, afin de nous révéler la lumière de ta ■ gloire, je te rends grâces, mon Créateur et mon Dieu, de ce que
reconnaissons l’écho de celle- parole.que fil entendre pour la première fois l'apôtre des gentils : « Car les
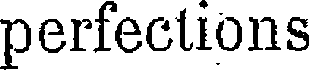
tu me permets d’admirer et d’aimer tes œuvres. J’ai maintenant terminé le travail de ma vie avec la force d’intelligence que tu m’as accordée. J’ai raconté aux hommes la gloire de tes œuvres aussi
i - f , . ' s ,
bien que mon esprit en a pu comprendre l’infinie majesté- Mes sens se sont éveillés pour chercher la vérilé, autant qu’il m’a été possible, avec droiture et avec sincérité. Si moi, qui ne suis qu’un ver à tes yeux et né dans les liens du péché, j’ai rien avancé qui soit contraire à tes desseins, que ton esprit m’inspire pour que je le corrige. Si la merveilleuse beauté de tes ouvrages a enflé, mon âme, et si j’ai cherché mon propre honneur parmi les hommes à mesure que j’avançais dans le travail qui n’était destiné qu’à te glorifier,, pardonne-moi dans ta bonté et dans ta miséricorde, et fais par ta grâce que mes écrits tendent à ta gloire et contribuent au bien de tous les hommes. Louez le Seigneur, ô harmonies célestes, et vous qui comprenez les nouvelles harmonies, louez te Seigneur. Que mon âme-loue mon Créateur pendant toute ma vie. C’est par lui et en lui que tout existe, le monde matériel comme le monde spirituel, tout ce que, nous savons et tout ce que nous ne .savons pas encore, car il nous reste beaucoup à-faire que nous laissons inachevé. » . ; •
Je termine par un extrait d’un des plus distingués des naturalistes contemporains ; « L’archéologue reconnaît tout-d’abord les traces de l’intelligence dans les ruines d’une anLique civilisation. Peut-être lui sera-t-il impossible de préciser l’âge de ces monuments,-ou de déterminer l’ordre dans lequel ils ont été construits successivement, mais le caractère de l’ensemble lui révèle que ces restes 'des siècles passés sont des ouvrages d’art, sortis des mains d’hommes semblables à lui-même. C’est aiosi que le naturaliste intelligent aperçoit immédiatement, dans les tableaux que lui offre la nature, l’empreinte d’une intelligence supérieure : dans les cellules délicatement creusées des conifères, si différentes de-celles des autres plantes, il lit les hiéroglyphes d’une époque particulière ; dans leurs feuilles en forme d’aiguilles, les armes d’une dynastie particulière ; dans la facilité avec laquelle ils se prêtent aux milieux les plus variés, une adaptation qui sup' pose la réflexion et qui l’éveille. 11 .contemple, il est vrai, les œuvres d’un être qui, comme lui, a la pensée.; mais il sent, en même temps, qu’il est aussi inférieur à rinteîligence suprême eu sagesse, en puissance et en bonté, que les œuvres de l’art le sont aux merveilles de la nature. Que . les naturalistes étudient le monde avec cette idée, et ils verront de toutes parts éclater la preuve que toutes les créatures sont L’expression de la pensée de cet Être que nous connaissons, que nous aimons et que nous adorons bien que nous ne le voyions pas. » -
invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, sont devenues visibles depuis la création du monde, par la connaissance que ses créatures nous en donnent (4). » Mais nous verrons que le christianisme a fait plus encore pour la science du langage, et quil ne s’est pas contenté de lui donner la première impulsion. Les pionniers de notre science ont été ces mêmes apôtres qui reçurent l’ordre de prêcher dans le monde entier, et leurs successeurs, les missionnaires de toute l’Eglise chrétienne ; et encore aujourd’hui les traductions de la Bible et de l’oraison dominicale dans toutes les langues de la terre fournissent à la philologie comparée ses plus précieux matériaux. Tant qu’on ne connut qu’un petit nombre de langues, on ne songea guère à les ranger par groupes ou familles, car le besoin d’une classification ne sé fait sentir que quand l’esprit se perd dans la multiplicité des faits. Lorsqu’on n’étudiait que le grec, le latin et l’hébreu, on pouvait se -contenter de là simple division-en langue sacrée et langues profanes, ou en langues classiques et langues orientales. Mais, dès que les théologiens eurent étendu leurs études à l’arabe, au châîdéen et au syriaque, un avait fait un grand pas vers l’établissement, d’iine classe ou d’une famille de langues (2). Il est évident pour tout le monde que
r '
(1) Epitre aux Romains, I, 20. V. Locke, Essai sur l’entendement humain,T Y, 40, 7.
(2) Hervas (Cataïogo, I, 37). cite les ouvrages suivants, publiés au seizième siècle, et qui avaient pour objet la science du langage : — Inlroductio in Chaidaicam ■ linguam, Syidacam, aîque Ârmenicam, et decem alias linguas, a Theseo Âmbrosio, Papiæ, J539, in-4°. De Ratione commumi omnium Linguarum et Litterarum Commentarius, a Tbeodoro Bibliandro, Tiguri, 1548, in-4°. Ce dernier ouvrage contient l’oraison dominicale en quatorze langues. Bibliander dérive du grec la langue, du pâj^s de Galles et celle de Cornouailles ; le grec aurait été porté dans ces contrées de Marseille, en traversant la France, il nous assure que l’arménien diffère peu du châîdéen, et il cite Pôstel qui faisait venir les Turcs des Arméniens parce que
ces langues étaient très-étroitemént apparentées les unes avec les autres, et qu’elles différaient du grec et du latin sur tous les points où elles s’accordaient entre elles. Dès 1606, nous voyonsjjuichard, dans son Harmonie étymologique, ranger à part l’hébreu, le chaldéen et le syriaque comme formant une famille séparée,, et distinguer en outre les dialectes romans des dialectes teutoniques (1).
le turc était parlé en Arménie. Il regarde les Perses comme des descendants. de Sem, et il ratlachejleur langue au syriaque et à l’hébreu : pour lui le serbe et le géorgien ne sont que des dialectes du grec. .
Voici les titres de quelques autres ouvrages sur le langage, qui furent publiés au seizième siècîe' : *— Perion, Dialogorum de Linguæ Gallicæ origine ejusque cum græca cognoMone libri quatuor, Parisis, 4554-, 11 dit que le français n’étant pas compris parmi les soixante-douze langues sorties de la tour de Babel, il doit dériver du grec, il cite César- {de Béllô .Gaiiico, Yi; .44), pour prouver que les Druides parlaient le grec, d’où il^ fait ensuite venir le français moderne !
Les travaux de Henri Étienne (1528-4598) ont une base bien autrement solide. On l’a accusé injustement d’avoir prétendu dériver le français du grec : voyez son Traiclê de la conformité du Langage françois avec le grec, publié vers 1566. Ce livre conlient principalement des remarques de syntaxe et de grammaire, et il a pour objet de montrer que des tournures et des expressions grecques qui semblent irrégulières et difficiles se comprennent parfaitement bien quand on les rapproche d’expressions analogues en français.
L’oraison dominicale avait été publiée en 4548, en quatorze 'langues, par Bibliander; elle fut publiée en 1591, en vingt-six langues, par Roçcha (Bibliolheca Apostolica valicana, a fratre An-gelo Roccha, Romæ, 4591. in-4°); en.1592, en quarante langues, par Mégiscr (Specimen XL Linguarum et Dialectorum ab Hieronymo Megisero a cliversis auctoribus collcctorwn quibus oratio Dominica est expressa, Francofurti, 1592): en 1593, en cinquante langues par le môme auteur (Oratio Dominica L cliversis linguis} cura II. Megi-seri, Francofurti, 1593, in-8°.) . •
(1) Au commencement du dix-septième siècle, parut le Trésor de THistoire des Langues cle cet univers, par Claude Duret, 2e édition, Iverdon, 4649, in-4°. ïïcrvas reproche à Duret de répéter les erreurs de Postel, de Bibliander, et d’autres écrivains du seizième siècle.
Duret avait été précédé par Eslienne Guichard : L’Harmonie étymologique des langues hébraïque, chalctaïquc, syriaque, — grec-
Toutefois, ce qui empêcha pendant longtemps les progrès de la science du langage, ce fut la conviction que l’hébreu avait été la langue primitive de l’humanité, et que, par conséquent, toutes les autres langues ont dû dériver de l’hébreu. Sur ce point les Pères de l’Eglise n’avaient jamais exprimé le moindre doute. Saint Jérôme dit dans une de ses épîtres à Lama sus : « L’antiquité tout entière (universa antiquités) nous apprend que l’hébreu, qui est la langue de l’Ancien Testament, fut le commencement de tout langage humain (1). » Origène, de même, dans sa onzième homélie sur le livre des'Nombres, ne craint pas d’affirmer que « la langue hébraïque, qui avait été donnée primitivement à l'homme en la personne d’Adam, se conserva dans .cette partie du genre humain, que Dieu garda pour son héritage et qu’il n'abandonna pas à un de ses anges (2). »
; Bien des peuples commettent une erreur analogue ; ils prennent la langue de leurs livres saints soit pour la langue la plus ancienne,.soit pour le langage naturel de l’hu-que, — latine, française, italienne, espagnole. — allemande, flamande^ anglaise, eLc., Paris, 460(5.
Ilervas n’en connaît que la seconde édition, Paris, 4618, et il pense que la première fui publiée en 4608. Le titre de cet ouvrage montre que Guichard distinguait quatre classes de langues auxquelles nous donnerions aujourd’hui les noms’de sémitique, hellénique, italique et teutonique : il fait, cependant, dériver le grec de l’hébreu. . .
J.-J. Scaliger, dans sa Diatribe de Europæorum Linguis (O pus eu la varia, Parisiis, 4640), p. 110, distingue onze classes de langues : le latin, le grec, le .teuton, le slave, l’épirote ou l’albanais, le tartare, le hongrois, le finnois, l’irlandais, le breton parlé .dans le pays de Galles et en. Bretagne, et le basque ou le cantabre.
(1) « ïnilium oris et communis eloquii, et hoc omne quod loquimur, Ilebræam esse linguam qua velus Teslamentum scriptnm est, universa antiquitas tradidit. » Et dansmn autre passage (Isaïa, c.-7), il dit : « Omnium enim fere linguarum verbis utuntur He-bræi « Voir aussi Journal asiatique-, juillet, p. 20.
(2) « Mansit lingua per Adam primitus data, ut puiamus, Hebræa, in ea parte hominum, quæ non pars alicujus angeli, sed qnæ Dei portio permansit. «
inanité. Pour les Brahmanes, le sanscrit est la langue des dieux. Il y a plus : chez les Bouddhistes, le Pâli ouMagadhi, l’idiome dont se servait Bouddha et dans lequel sont rédigés les livres de leurs écritures saintes ou du Tripitaka, idiome qui se rattache au sanscrit aussi clairement que l’italien au latin, est considéré comme la racine de toutes les langues. Le grammairien Pâli Kalyâyana dit: «Il y a une langue qui est la racine (de toutes les langues); les hommes et les 'brahmanes., qui n’avaient jamais proféré auparavant une parole articulée, Font parlé au commencement du Kalpa et même le Bouddha supérieur Fa parlé : c’est le Mâgadhi (4). » .
Quand donc on s’occupa d’abord de la classification des langues, voici sous quelle forme lê problème se présenta à des savants tels que Guichard et Thomassin : l’hébreu
(I) Voyez Spcnee Hardj^, Legencls of the Budclhüts. p. 23, citées d’après Ahvïs, Lectures on Buddkism, p. bb. L’extrait suivant est du Wibhanga Atuwawa. « Les parents placent leurs enfants, quand ceux-ci sont jeunes, dans un berceau ou sur un siège, et, devant eux, prononcent différents mots, font différents actes. Leurs enfants se fixent ainsi (dans l’esprit) les mots qu’ils ont entendus de leurs parents; ils se souviennent que telle parole a été dite par le.père, •telle autre par la mère, et avec le.temps ils apprennent ainsi toute la langue. Qu’un enfant, né d’une mère Damila et d’ùn père Au-dakha, entende sa mère parler la première, il parlera la langue Damila; si c’était son père qu’il avait entendu le premier, il parlerait l’Andakha. Si toutefois il n’entendait parler ni l’un ni l’autre, il parlerait le Mâgadhi. Supposons un être humain élevé dans une forêt inhabitée, où n’est entendue aucune langue; si, par intuition, il tentait d’articuler des mots, ce serait le Mâgadhi qu’il parlerait. Cet idiome prédomine dans toutes les régions, telles que l’enfer, le règne animal, la sphère des pellas (prêtas, en sanscrit) ou ancêtres, le monde des hommes et le monde des devas (lès-dieux). Les dix-huit autres langues, le Kiràla., l’Andakha, le Yonaka, le Damila, subissent'des changements, mais pas le. Mâgadhi, qui seul est im: mnable, étant la langue du Brahmane et des Aryas. Bouddha lui-même, qui a Lraduit en doctrines les paroles du Tepitaka, l’a fait aumoj'en du Mâgadhi même, et pourquoi? Parce que c’était à l’aide de cet idiome qu’il était certain de donner à ses révélations leur sens véritable. »
étant, sans aucun doute, l'origine de- toutes les autres langues, comment expliquer le procédé par lequel il s’est scindé en. tant de dialectes divers, et comment faire rémonter tous ces dialectes, comme le grec, le latin, le copte, le persan et le turc, à l’hébreu, leur source commune? . . ; '
' ' , J Æ
On nè se figure pas tout ce qui a été dépensé de science et de talent sur "cette; question, au dix-septième et au dix-huitième siècles, et tout cela eu pure perte; Nous ne pouvons, peut-être, trouver rien d’analogue que dans les
constructions et les calculs laborieux des anciens astro-
- ■ '■ - * *■
nomes qui avaient à rendre compte des mouvements des corps célestes, en supposant toujours que la terre restait, immobile au centre de notre système planétaire. Mais, •quoique nous sachions maintenant que.les travaux de ces philologues n’ont été et n’ont pu être que stériles, ce serait une manière bien peu encourageante d’envisager le progrès :de:L’humanité:que:de considérer Jes efforts .de nos illustres devanciers, alors même qu’ils étaient engagés dans une fausse direction, comme n’ayant été que vanité et torture d’esprit. Il ne faut pas oublier que l’échec d'hommes aussi éminents contribua, plus que tout le reste, à faire porter l’attention sur le fond même de la question, jusqu a ce qu’enfin un génie plus hardi rétourna le problème, et par là le résolut. Quand livres après livres eurent été composés pour montrer comment le grec, le latin, ainsi que toutes les autres langues, étaient dérivés de l’hébreu, et que chaque système dut être abandonné successivement, on finit par se demander pourquoi toutes les langues devaient nécesscdrementeXiLQ dérivées de l’hébreu, et cette seule question trancha la difficulté (1). Nous pouvons comprendre
(1) Guichard allait jusqua soutenir que l’hébreu étant écrit dé droite à gauche, et le grec de gauche à droite, on- peut
■4-55
QUATRIEME LEÇON.
parfaitement bien que les théologiens du quatrième et du cinquième siècle, dont beaucoup ne connaissaient niliié-
■ h + ■,
breuni aucune autre langue, excepté la leur, aient supposé que l’hébreu était la source de tout langage ; mais il n’y a pas, ni dans l’Ancien ni dans le Nouveau Testament, un seul mot d’où cette doctrine d écoule nécessairement. Concernant la langue d’Adam, nous ne savons absolument rien; mais si Thébreu, sous sa forme actuelle, est né de la confusion des langues à la tour de Babel, il est difficile d’admettre que ce fut la langue d’Adam ou de toute la terre, « alors que toute la terre n’avait encore qu’un seul parler:(1). »
: C’est pourquoi, si les savants sémdisants du dix-septième siècle ont rendu-certains services à la classification des langues,.ils ont "d’un autre côté retardélès progrès de cette classification, en la dépouillant de son.caractère:purement scientifique, et.en propageant des idées erronées dont l’influence se fait encore sentir de nos jours. ,
Le prem ier qui se défit réellement du préjugé qui faisait de l’hébreu l’origine de tout langage, fut Leibniz, le contemporain et l’émule de Newton (2). Il y a autant de rai-
iairc remonter les mots grecs à l’hébreu en les lisant - de droite à gauche. . ^
(1) Parmi les différents systèmes d’exégèse rabbinique, il y en a un.qui réduit toutes les lettres en hébreu à-leur valeur numérique, et qui explique; ensuite les mots par d’autres mots représentant la même quantité ; ainsi de ce passage : « Et tous les habitants de la terre ne parlaient qu’une même langue » (Gen., XI, 1),-on. déduit qu’ils parlaient tous l’hébreu, n£T£? étant remplacé par son syno
nyme, qr&b et (S -p 100 4 -f- 300 = 409) est substitué à
, ' 'r ' ‘
S
' ■ S‘
son équivalent jnn& (l -f- 8 -f- 400 = 409). Coheleihj édit. Ginsburg,
■ ■ . ^ _ ’1 ( ‘ -s
p. 31. Y. Qnalremère, Mélanges, y. 138.
. (2) Comme on m’a plusieurs fois ‘pris à partie pour avoir écrit Leibniz sans t, il me sera permis de dire, pour ma défense personnelle, que, si j’aLadopté cette orthographe, ce n’a été ni par négligence, ni par ignorance, ni par affectation, reproches qui m’ont toujours été adressés, mais par la simple raison que jamais Leibniz
4 56 LEÇONS sun LA science du langage.
O
son, disait-il, pour regarder l’hébreu comme la langue primitive de l'humanité, que pour adopter l’opinion de Goropius qui publia un ouvrage à Anvers, en 1580, pour
prouver que le hollandais fut la langue parlée dans le
, * 11
Paradis (1). Dans une lettre à Tenzel, Leibniz dit : « Appeler l’hébreu la langue primitive, c’est comme si l’on appelait primitifs des troncs d’arbres, ou que l’on dît que dans certaines contrées il pousse des troncs au lieu d’arbres. De telles idées se peuvent concevoir, mais elles ne sont pas en harmonie avec les lois de la nature ni avec lui-même, ni dans ses lettres ni dans ses ouvrages imprimés, n’écrivit son nom Leibnitz. Y. Die Werke von Leibniz, ed. Onno Kiopp,
Hanovre, 1864, tome I, p. XXIY. -
* ■
(1) Hermathena Joannis Gorodii Becani : Antuerpiæ, 1580. Origines Antverpianæ, 1569. Dans son ouvrage sur la langue du paradis, André Kempe soutient que Dieu parla à Adam en suédois, qu’Adam répondit en danois, et que le serpent parla à Eve en français. .
J ■
. -Chardin raconte que, d’après la tradition persane, trois langues furent parlées dans le paradis, l’arabe par le serpent, le persan par Adam et Eve, et le turc par l’archange Gabriel.
J.-B. Erro dans son EL Mundo primitive) t Madrid, 1814, veut que le basque ait été la langue d'Adam. .....
Il y a environ deux cents ans, il s’engagea dans le chapitre métropolitain de Pampelune une discussion curieuse, dont voici les conclusions conservées dans les minutes du chapitre : — 1. Le basque a-t-il été la langue primitive de l’humanité? Les savants membres avouent que, quelle que soit à cet égard leur intime conviction, ils n’osent donner à cette question aucune réponse affirmative. — 2. Le basque a-t-il été la seule langue parlée dans le paradis par Adam et Eve? Sur ce point, les opinants déclarent qu'il ne saurait exister de doute dans leur esprit, et « qu’il est impossible d’avancer contre cette opinion aucune objection sérieuse ou raisonnable. » V. liennequin, Essai sur Vanalogie des langues, Bordeaux, 1838, p. 60.
Je me sens tenu, en bonne conscience, à insérer ici une note tirée des Eludes sur Vorigine des Basques, de M. Bladé, Paris, 1859, p. 533 : « Les archives civiles et religieuses de Pampelune ont été explorées minutieusement par des savants tels que Garibay, le P. d< Moret, Yanguas Y Miranda, et pas un ne confirme, que je sache, le dire de M. Hennequin J’ai fait moi-même et j’ai fait faire, sur.ee point, des recherches demeurées sans résultat. » .
l’ordre de 1 univers, c’est-à-dire avec la: sagesse divine^).» . .
Mais Leibniz ne se contenta pas de débarrasser le seuil de notre science de ce grand obstacle. Le premier, il appliqua les principes d’une induction rigoureuse à un sujet que jusqu’alors on avait étudié sans méthode. Il signala la nécessité de commencer par recueillir le plus grand nombre possible de faits (2). Il s’adressa aux missionnaires, aux voyageurs, aux ambassadeurs, aux princes et aux empereurs pour leur demander leur concours à une œuvre qui lui tenait tant au cœur. Les jésuites en Chine durent travailler pour lui. Witsen, le voyageur, lui envoya un présent d’un prix inestimable, la traduction de l’Oraison dominicale dans le jargon des
(1) « Linguam ïïebraicam primigeniam dicere idem est ac dicere truncos -arbomm esse primigenios, seü région em dari ubi Iran ci pro arboribus nascantur. Talia fingi possunt, sed non conveniunl legibus naturæ et harmoniæ rerum, id est, sapientîæ divinæ. » (Leib. Opéra, Geneyse, 1760, VI, 232.) . .
(2) Guhrauer. Vie de Leibniz, vqî. il. p. 127. Dans sa Dissertation sur l'origine des nations, 1710, Leibniz dit : « L’étude des langues ne doit être dirigée que par les principes des sciences exactes. Pourquoi, en effet, commencer par Tinconuü plutôt que par le connu ? Il est manifeste que nous devons étudier d’abord les langues modernes qui sont à notre portée, afin de les comparer les unes avec les autres pour en découvrir les différences et les affinités, passer ensuite aux langues qui les ont précédées, afin d’établir leur filiation et leur origine, et remonter ainsi de proche én proche jusqu’aux dialectes les plus anciens dont l’analyse nous donnera les seuls résultats certains. » .
[Voici Je titre complet de cette dissertation : Brevis designatio meditationum de originibu-s geniimn duetis poiissimum ex indicio linguarum. Cette dissertation commence par cette phrase remarquable : « Cum remotæ gentium origines historiam transcendant, linguæ nobis præstant velerum monumentorum vicem. » Leibniz semble avoir ici prévu et indiqué d’avance quels secours la science moderne emprunterait à la philologie comparée pour éclaircir les obscures questions d’origine, et pour remonter avec certitude jusqu’à ces époques primitives où nous font.défaut et les monuments écrits et la tradition même. Tr.j • . ..
Hottentots (1). Après avoir fait la connaissance de Pierre le Grand, Leibniz lui écrivit la lettre suivante datée de Vienne, 26. octobre 1713 ;
. « Je me suis permis de suggérer que les nombreuses langues, jusqu’ici presque entièrement inconnues et non étudiées, qui se parlent dans l’empire de Votre Majesté et sur ses frontières, soient mises par écrit ; je voudrais aussi que l’on réunît, des dictionnaires ou tout au moins de petits vocabulaires, et que l’on se procurât dans ces idiomes des traductions des dix Commandements, de l’Oraison dominicale, du Symbole des Apôtres, et d’autres parties du Catéchisme, ut omnis lingua laudet Dominum. Tout cela augmenterait la gloire de Votre Majesté, qui règne sur tant de nations, et qui désire si vivement les voir marcher dans la voie du progrès ; en même temps, en comparant ces différents langages, nous serions mis à même de découvrir l’origine de ces nations qui; de la Scythie qui vous est soumise, s’avancèrent dans d’autres pays. Mais surtout cela aiderait à répandre le Christianisme parmi les nations qui parlent ces dialectes, et, dans celte idée, j’ai écrit sur le.même sujet au révérendissime Métropolitain (2). » Leibniz dressa une liste des termes les plus simples et les plus usités, qui devraient être pris comme points de comparaison entre les différentes lan-
i ’ ,
gués.- Dans sa propre patrie, pendant qu’il était occupé de ses recherches historiques, il recueillit tout ce qui pouvait jeter quelque lumière sur l’origine de la langue
(1) Nicolas Vfttsen,bourgmestre dAmsterdam, voyagea en Russie, 4666-1G72; en 4677, il publia ses Voyages qu’il dédia à Pierre le Grand. Une seconde édition parut en 4705. Cet ouvrage contient de nombreuses listes de mots.
(2) Catherinens der grossen Verdiensie um die vergleichende Syraclikunde, von F. Adelung, Pétersbourg, 4815. Une autre lettre de Leibniz au vice-chancelier, le baron Schafflroffj est datée de Pirmônt, 22 juin 4746.
QUATRIEME LEÇON.
s*'*' - dQ
allemande, et il encouragea Eccard et d’autres savants au même travail.-XÎ fit.-ressortir, l'importance des dialectes et même des patois locaux, pour éclaircir les questions relatives à F origine des langues et à l’étymologie de leurs mots (f). Leibniz n'entreprit jamais une classification systématique de tout le domaine du langage, et il ne fut pas heureux quand - il voulut classer les dialectes qu’il avait pu étudier. Il distingua, il est vrai, une classe japhé-tique et une classe araméenne, la première occupant le nord , et M seconde le midi dès deux continents, de l’Asie et de l'Europe ; il crut à l’origine commune des langues et à la migration de la race humaine de l’Orient à. l’Occident; mais fine sut pas déterminer.les degrés exacts de parenté entre les langues, et il confondit avec les langues japh étiques plusieurs dialectes touraniens, tels que. le finnois et le tartare. Si Leibniz avait èu le temps d’exécuter tous les plans conçus par son vaste et fertile génie, ou s’il avait été compris et -soutenu par les savants contemporains, la science du langage, en tant que science inductive, .aurait pu être fondée un siècle plus tôt. Mais un tel ■ " ■ \ . , ■ ' -
esprit, qui s’occupait en même temps et avec un égal succès de l’érudition, de la théologie, de la jurisprudence, de l’histoire, de la philosophie et des mathématiques, ne pouvait guère que donner des aperçus sur la méthode à suivre dans l’étude du langage. Leibniz découvrit le calcul différentiel, et il fut un des premiers à observer, à l’aide de la géologie naissante, les couches
i ■■ T 1 - * ■
terrestres. Il construisit une machine à'calculer, dont la première idée lui était venue dans son enfance, et il élabora un projet d’expédition en Egypte, qu’il soumit à
;upenoi Otfridi Franciscis. »
(1) Côllecîaneà Myinologica, il, 25b. « Malin) sine discrimine Dia-iectorum corrogari Germanicas voces. Pato quasdam origines ex superioribus dialectis melius apparituras ; utexülfilæPoptogothicisj
■'■V. ; ; V.‘ V>
t ‘ T
' " f * ■ r. "
Louis XIY afin de détourner son attention des frontières de rÀllemagne.\Le même homme entretint une longue correspondance avec Bossuet pour amener une réconciliation entre les protestants de l’Église de Rome, et, dans sa Théodicée et d’autres ouvrages, il s’efforça de défendre la; cause de la vérité et de la. religion contre les-envahissements de la philosophie matérialiste qui tendait à se développer en France et . en Angleterre. On a prétendu que les découvertes de Leibniz n’ont jamais été fécondes en résultats, et qu’il a fallu, presque toujours,. les refaire ; mais cela n’est certainement pas vrai pour ce qui concerne la science du langage. La curiosité qu’il éveilla pouf l’étude des langues ne s’est jamais éteinte depuis lors, et n’a cessé de devenir plus vive et plus ardente. Depuis
qu’on a reconnu combien il importe de réunir, si l’on peut
. , + ■
ainsi paider, comme un herbier complet des langues de l’humanité, les missionnaires et les voyageurs ont .toujours regardé comme un devoir de former des listes de .'mots ët'dé composer des grammaires, chaque fois qu’ils se sont trouvés en contact avec une- race nouvelle. Les deux grands ouvrages, du commencement de notre siècle
■ ' ► ► __ ‘ » ► - ► 1 î - ► 1 1 t 1 _ ■- i 1 , <■ _ 1 L_' J L - 1 / r ► ' ► '
qui nous présentent les résultats de ces recherches (je veux parler du Catalogue des langues, par Hervas, et du Mithridalei d’Âdelung), relèvent directement de l’infliience' de Leibniz. Hervas avait lu Leibniz avec le plus grand soin, et, bien qu’il en diffère sur certains points,-il recon- . naît pleinement tout ce que lui doit l’étude philosophique des langues. Du Mithridate d’Àdelung, et des obligations qu il a eues à Leibniz, nous aurons bientôt à nous occuper. , ,;
Hervas, né en Espagne en \735, mourut en \809. Il entra dans la société des jésuites, et tandis qu’il prêchait l’Évangile, comme missionnaire, parmi les Indiens d’À-mérique qui parlent d’innombrables dialectes, son atten-
tion se porta sur une étude systématique des langues. À son retour, il'résida ordinairement à Rome, au milieu des nombreux missionnaires jésuites, qui, à cette époque, avaient été rappelés de toutes les parties du monde, et les renseignements qu’ils lui fournirent sur les dialectes des peuples, à la conversion desquels ils venaient de travailler, lui furent d’un précieux secours dans ses recherches. . • \ ■
A
La plupart de ses ouvrages furent écrits en italien et traduits ensuite en espagnol. Il nous est impossible de nous occuper ici de tous'ses travaux littéraires qui embrassent les plus vastes sujets, et dont il voulait former une sorte de Cosmos auquel il donna le titre de Idea del Universo. Ce qui est intéressant pour nous, ce sont les ouvrages où il traite de l’homme et du langage comme faisant partie d
luüivers, et surtout son Catalogue des langues en six volumes, publié en espagnol en l’année 1800. •
Si nous comparons l’ouvrage d’ïïervas avec un autre du même genre qui fit grand bruit vers la fin du siècle dernier, je veux parler du Monde primitif (1 ) de Court de Gébeiin, dont, aujourd’hui encore, le nom est plus connu que celui d’ïïervas, nous verrons immédiatement toute la supériorité du jésuite espagnol sur le philosophe français. Gébeiin regarde le persan, l’arménien, le malais et le copte comme des dialectes de l’hébreu ; il parle du. basque comme si c’était une branche du celtique, et il tâche de découvrir des mots hébreux, grecs, anglais et français dans les idiomes de l’Amérique. ïïervas, au contraire, bien que comprenant dans son catalogue cinq fois plus de langues que n’en connaissait Gébeiin, a le plus grand soin de ne jamais se laisser aller à aucune théorie qui ne re-
(1) Monde primitif analysé et comparé avec le monde moderne. Paris, 1773.
pose sur des faits. Il est facile maintenant de citer des erreurs et des inexactitudes dans lier vas, mais il me semble que ses plus sévères critiques ont été ceux qui avaient le plus sujet de reconnaître les obligations qu’ils lui avaient. Ce n’était pas un service sans importance que de réunir'des spécimens et des notices de plus de trois cents langues ; mais Hervas ne s’en tint pas là : il composa lui-même les grammaires de plus de quarante idiomes (l), et il fut le premier à montrer que la véritable affinité des langues doit être déterminée surtout par les faits grammaticaux, et non par une simple ressemblance des mots (2). Il prouva, par un tableau comparatif des déclinaisons et des conjugaisons, que l’hébreu, le chaldéen, le syriaque, l’arabe, F éthiopien et l’amharique ne sont tous que des dialectes d’une même langue primitive, et composent une même famille de langues, la. famille sémitique (3), Il rejeta bien loin l’idée de dériver tous les idiomes, de l’humanité de l’hébreu. Il avait découvert des traces évidentes d’affinité entre le hongrois, le lapon et le finnois, trois dialectes qui sont maintenant rangés dans la famille touranienne (4). Il avait prouvé, contrairement à
(1) Catalogo > i, 63. . '
(2) « Mas se deben consultar gramàlicas para conoeer su ca-
racter proprio por medio de su artiücio gramalical. « — Caîalogo, I, 65. Le même principe fut posé par lord .Monboddo, vers 4795, dans Ancient Metaphisics, vol. IV, p. 326. « Voici maintenant ma dernière observation, c-esl que le mécanisme d’une langue étant moins arbitraire et mieux réglé que la prononciation ou que la signification des .mots, nous y trouvons un excellent critérium pour déterminer l’affinité des langues entre elles. C’est pourquoi, quand nous voyons deux langues employer de la même manière ces grands procédés du langage, la dérivation, la composition et l’inflexion, nous pouvons, à mon avis, en conclure avec certitude que l’une dérive de l’autre, ou qu’elles sont toutes deux des dialectes d’une même langue primitive, o .
(3) Catalogo, II, 468.
(4) Catalogo, 49. Dans une lettre à Leibniz, datée du 22 mai
A
l'opinion commune, que le basquefrétait pas un dialecte celtique, mais une langue indépendante que parlaient les premiers habitants de.l'Espagne, ainsi que le prouvent les noms des montagnes et des rivières de cette contrée (f). Bien-plus, une des belles découvertes de la science du langage, rétablissement de la famille des langues malaises et polynésiennes s’étendant sur 208 degrés de longitude, depuis l’île de Madagascar, à l’est de l’Afrique,
* ’ - ■ * - ' ' - " ■ t - ",
jusqu’à l’île de Pâques, à l’ouest de T Amérique, fut faite
par Mervas longtemps avant d’être annoncée au monde par Humboldt (2). .. . .
Hérvas n’ignorait pas non plus la grande conformité grammaticale qui unit le sanscrit elle grec ; mais les ren-
4 698, Witsen fait également allusion à l’affinité entra î mongol. « On m’a dit que ces deux langues (la langue moegale et là langue tartare) sont différentes à peu près comme l’allemand l’est du flamand, et qu’il est de même des Kalmuçs et Moegals. » Collectanea etym:, II, 363. : . . v
(1) Leibniz soutenait la même opinion (voir ïïervas, Catalogo % I,
SO), bien qu’il considérât les Celtes d’Espagne comme dés descendants des Ibères. - . .
(2) Catalogo, I, 30, « Yerâ que la lenguà ïlamada malayair la
quai se hablaen la peninsula de Malaca, es. inalriz de innumerables dialectos de naciones islenas,. que desde dicha peninsula se extien-dien por mas de doscienlos grades de longitud en los mares Oriental y PacifiCo. » . ; . •
Catalogo, H, 40. « De esta peninsula de Malaca ban salido enjam-bres de poblâdores de las islas del mar Indiano y Pacifico, en las que, aunque parece haber otra nacion, que es de negros, la malaya es generalmente la. mas dominante y extendida. La lengua. ma-lâya se habla en dicha peninsula, continente ,del Asia,. en las islas Maldivas, en la de Madagascar (pertenéciente al Africa), en las de Sonda, en las Molucas, en las Filipinas, en las del archi-piélago de San-Lâzaro, y en muchisimas del mar del Sur desde dicho archipiélago hasta islas, que por su poca distancia de América se creian pobladas por American os. La isla de Madagascar se pone à 60 grados de longitud, y â los 268 se pone la islà de Pasqau b de Davis, en la que: se habla otro dialeclo malayo ; por lo que la extension de los dialectos raalayos es de 208 grados de longitud;. » .

saignements incomplets que put lui donner son ami, le missionnaire carmélite Fra Paolino a Santo Barlholomeo, auteur de la première grammaire sanscrite, publiée à Rome en 4790, ne lui permirent pas de connaître toute la portée de cette découverte. Nous pouvons comprendre combien Hervas approcha de la vérité, quand nous le voyons comparer ' des mots comme Theos, Dieu, en grec, et Deva, Dieu, en sanscrit. Il reconnût l’identité du verbe auxiliaire grec eimi, eis, esti, je suis, -tu es, i.1 est, avec le sanscrit a s m i, a s i, asti; il montra mêm e que les désinences des trois genres, en grec, os, ë, on, sont les mêmes, que le sanscrit a s â, am, (4) ; mais, comme il croyait que la philosophie et la mythologie grecques avaient eu leur source dans Flnde, il supposa que les Grecs avaient aussi emprunté aux Hindous quelques-uns de teurs mots, et même L’art de distinguer les genres (2). ' : : .
Le second ouvrage qui représente la science du langage aii 'commencement de ce siècle, et qui est dû bien plus encore à l’impulsion donnée par Leibniz, c’est le Mithri-date d’Àdelung (3). L’ouvrage d’Adelung est fondé en partie sur le Catalogue d’Hervas, en partie sur les listes de
mots recueillies sous les auspices du gouvernement
. . . ' ■ ■ " ■ - ■ r '
russe, grâce aux instigations de Leibniz. Quoique Pierre
(1) Catalogo, 11,134. . .
(2) Caialogo, II, 135. D’après ce que j’ai dit plus haut de Guichard , Scaliger, Leibniz et d’autres, il est bien clair que je n’ai pas considéré Hervas comme le premier inventeur de ces théories linguistiques. J’ai seulement désiré appeler l’attention sur ses mérites réels , qu’avaient passé sous silence d’autres historiens. Voyez Benfey, Geschichte der Sprachwissenschaft, p. 270.
(3) Le premier volume parut en 1806. Adelung mourut avant la publication du second volume que Vater fit paraître en 4809. Les volumes III et IV suivirent en 4816 et 1817 ; ils eurent pour éditeurs Vater et le fils d’Adelung.
le Grand n’eût ni le loisir ni le goût de s’occuper d’études philologiques, le gouvernement de Russie ne perdit jamais
de vue le projet d une vaste collection de tous les idiomes
■■ • ' + " ■
de l’empire (4). La science du langage devait cependant voir des jours encore meilleurs : elle avait eu le patronage de César à Rome, m ais elle trouva une protectrice bien autrement dévouée dans la grande czarine du Kord, la grande Catherine (4762-4796). Lorsque Catherine n’était encore
-J pf -.1 . s ^ . ' '
que grande-duchesse, elle donna toutes ses pensées à la la.compilation d’un dictionnaire universel, d’après le plan proposé par Leibniz. Elle encouragea Daniel Dumaresq, chapelain de la factorerie anglaise à Saint-Pétersbourg, à entreprendre ce travail, et on dit qu’il, publia, sur son invitation, un Vocabulaire comparatif des langues orientales, -in-quarto. Toutefois, si cet ouvrage a jamais existé, il est complètement perdu aujourd’hui. L’auteur supposé mourut h Londres, dans une vieillesse avancée, en 4 805. Quand Catherine monta sur le trône, ses études philologiques recoupèrent presque autant que ses projets de conquête ; et elle s’enferma une fois pendant près, d’une année, pour se consacrer tout entière a son dictionnaire comparatif. On pourra lire avec intérêt une lettre qu’elle écrivit, à cette époque, à Zimmermann, et qui est datée du 9 mai 4785: , ;
« Votre lettre ma tirée delà solitude dans la quel le.près de neuf mois je m’étais presque confinée, et dont j’ai eu de la peine à sortir. Vous ne vous douteriez guère de ce que j’y faisais : pour la rareté du fait, je vous le dirai.
- . . , ■ , - - - '-H
(1) Nous en trouvons la preuve dans l’ouvrage de Strâhlenberg, le Nord et l'Est de VEurope et de l'Asie,, 1730, avec table polyglotte ; dans Messerschraidt, Voyages en Sibérie, de 1729 à 4739 : dans Bâchineîster, Idea et desideria de colligendû linguarum spe-ciminibus, Petropoli, 1773 ; daDS Güfdenstadt, Voyage dans le Câu-
G0/S(sj etc. . ....... . . .. ..... ;
J’ai fait un registre de deux à trois cents mots radicaux de la langue russe ; ceux-ci, je les ai fait traduire dans autant de langues et. jargons que j’ai pu trouver ; le nombre déjà en dépasse la seconde centaine. Tous les jours je prenais un de ces mots, et je 1 écrivais dans toutes les langues que je pouvais ramasser. Ceci m’a appris que le celte ressemble à Yostïaque; que ce qui veut dire ciel dans une langue signifie nuage, brouillard, «ouïe, dans d’autres; qüe le mol Dieu, dans de certains : dialectes, signifie le très-haut ou le bon. dans d’autres, le soleil ou le feu.
, ■ f * s V.
. J'_ "-«î . - ■ .
Dieses, Steckenpferdchens lourde ich überdrüssig, nachdem das Buch von der Einsamkeit durchgelesen war (1). Mais comme cependant j'aurais eu du regret de jeter au feu une si grande masse de papier ; la salle de dix toises de long, que j’habitais en guise de cabinet dans mon ermitage, était d’ailleurs assez chaude ; je fis prier le professeur Pal3as de venir chez moi, et, après la confession exacte dè ma part de Ce péclié'; nous sommes convenus; de rendre par l’impression ces traductions utiles à ceux qui auraient envie de s’occuper de l’ennui d’autrui ; on n’attend plus pour cet effet que quelques dialectes de la Sibérie orientale. Y verra ou n’y verra pas qui voudra des choses lumineuses de plus .d’un genre, cela dépendra de la disposition d’esprit respective de ceux qui s’en occuperont, et ne me regarde pas du tout. » '
Quand une impératrice a un dada(qu’on nous passe le
mot, il rend exactement l'expression allemande dont se
■■ \ - ■■■
sert Catherine), il ne manque pas de gens pour l’aider à se mettre en selle. 3NTon-seulement tous les ambassadeurs
russes furent invités à rassembler, des matériaux, non-
< ■ * »
seulement des professeurs d’Allemagne fournirent des
.• (1) « Je me suis fatiguée dé mon dada, apiès avoir lu votre livre sur la Solitude. »
grammaires et des dictionnaires. (4); mais Washington lui-même, pour faire plaisir à l'impératrice, envoya sa liste de mots à tous les gouverneurs et à tous les généraux des États-Unis, avec l’ordre d’en donner les équivalents dans les dialectes américains. En 4787, parut le premier volume du dictionnaire impérial, contenant une liste de deux cent quatre-vingt-cinq mots, en cinquante et une langues de l’Europe et en cent quarante-neuf langues de l’Asie (3). Sans méconnaître tout le mérite de Catherine, il est juste de ne pas oublier le philosophe qui, près de cent. ans.auparavant, sema la graine .qui était tombée dans une bonne terre. .
Comme collections de mots, les ouvrages d’Hervas, de l’impératrice Catherine et d’Âdelung ont une grande valeur, et pourtant la science de la classification des langues a fait de tels progrès, depuis cinquante ans, que peu de personnes les consultent de nos jours. Le principe sur lequel est fondé leur travail de classification mérite à peine d’être appelé scientifique, puisqu’ils adoptèrent la division géographique, distribuant les langues en langues de l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique, de l’Amérique et de la Polynésie, tout en reconnaissant cependant des afïî-
j ■"
nités naturelles entre les dialectes parlés à deux cent huit degrés l’un de l’autre. Les différents idiomes semblaient
(1) L’impératrice écrivît à Nicolaï, à Berlin, pour lui demander un catalogue de grammaires et de dictionnaires. Le manuscrit de ce travail fut envoyé à Catherine, de Berlin, en 1785.
(21 Glossariwn compcirativum Linguarum toiius Or bis, Peters -bourg, 4787. Une seconde édition, dans laquelle les mots sont rangés par ordre alphabétique , fut publiée en quatre volumes en 4790-1791, par Jankiewitsch de Miriewo. Cet ouvrage contient 279 langues, à savoir :/ 171 pour l’Asie, 55 pour l’Europe, 30 pour l’Afrique et 23 pour l’Amérique. Selon Pott, Ungleichheit, page 230, il contient 277 langues, 485 pour l’Asie, 22 pour l’Europe, 28 pour l'Afrique et 45 pour l'Amérique; ce qui donnerait 230. La première édition est un livre fort rare. . . - -
LEÇONS SUR LA SCIENCE DU LANGAGE
flotter comme des liés sur l’océan du langage humain ; ils ne s’aggloméraient pas pour se former en plus, vastes continents. C'est là une période fort critique:dans This-loire de toute science ; et s’il n’était pas survenu un heureux . accident qui, comme une étincelle électrique, fît cristalliser en formes régulières tous ces éléments flottants, il est plus que douteux que ces longues-listes de langues et de dialectes énumérés et décrits dans les ouvrages d’Heryas et d’Âdelung eussent pu continuer à exciter longtemps l’intérêt des philologues. Celte étincelle électrique fut la découverte du sanscrit.

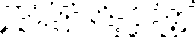
*
i

I




.+
\ v
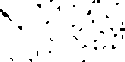
Le sanscrit est l’antique langue des Hindous, qui cessa d’être parlée au moins,trois cents ans avant Jésus-Christ. À cette époque, les habitants de l’Inde parlaient différents dialectes qui étaient à l’ancien sanscrit védique ce qu’est ritalien au latin. Quelques-uns de ces dialectes (car il y en avait, plusieurs dans diverses contrées de l’Inde) nous sont connus pâr les inscriptions que 1 e. célèbre roi Âsoka . fît graver sur les rochers de Dhauli, de Girnar et de iia->'iri, et qui ont été déchiffrées par Prinsep, Noms, Wilson, et -Burnouf. Nous pouvons suivre le développement dé ces dialectes locaux dans le pâli, langue sacrée du bouddhisme dans l’île de Geyîan, et autrefois idiome populaire du pays qui fut le berceau de cette religion ; c’est le Behâr moderne, l’ancien Magadha (t). Nous re-
(î) Dans la littérature primitive des Bouddhistes de Ceylan, la langue des livres sacrés admis dans leur canon est appelée simple -ment 5ina va/cana, la parole dé Bouddha. Dans le Mahâvansa, Pâli est. employé dans le sens de texte ou d’écriture sacrée, plutôt que dans celui de langue sacrée. Tanti est quelquefois employé dans Je même sens. Voyez AJtûs, Pâli grammar, p. v. Là, l’idiome que nous appelons le Pâli est appelé* i’idiôme des Mâga-dhas, et il en est parlé comme de la langue mère de toutes les autres. Voyez aussi les passages des écritures. bouddhiques où l’idiome des Mâgadhas.ou le Mâgadhî, est appelé le Mûlabhâsâ,
. la langue racine. Aîwis, PUi grammar, p. cvn. C’est de Magadha
v
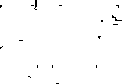
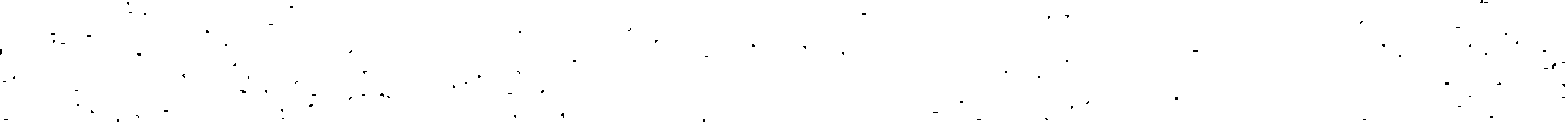
\ '
trouvons les mêmes dialectes dans ce qu’on appelle les idiomes prâkrits, employés plus tard dans le drame indien, dans la littérature sacrée des Djainas, et dans un petit nombre de compositions poétiques; et nous voyons enfin tous ces dialectes se modifier, au contact des différents conquérants de l’Inde, par l’adoption de mots arabes, persans, mongols et turcs, et par la corruption de leur système grammatical, jusqu’à ce qu’ils deviennent à la longue l’hindoui, l’hindoustani, le mahratte et le bengali, langues modernes de la péninsule. Pendant toute cette période, le sanscrit resta la langue littéraire des brahmanes. De même que le latin, cette langue n’expira pas en donnant .naissance à ses nombreux rejetons, et aujourd’hui encore un brahmane lettré écrit plus couramment en sanscrit qu’en bengali. Le sanscrit a été absolument ce que furent le grec à Alexandrie et le latin au moyen âge : c’est à la fois la ‘ langue sacrée et la langue classique des brahmanes, dans laquelle furent composés leurs hymnes sacrés, les Yédas, ainsi que les ouvrages postérieurs, tels que les lois de Manou et les Purânas.
De tout temps on a connu l’existence de la langue qui avait été l’ancien idiome de l’Inde et l’instrument d’une riche littérature ; et, s’il reste encore sur son antiquité et son authenticité quelques doutes, comme- en exprima .. Dugald Stewart dans ses Conjectures concernant VOrigine du sanscrit (4), il suffit pour les lever de jeter un regard sur
l’histoire de l’Inde, et sur les récits que nous ont laissés
# t
les auteurs des différentes nations qui connurent le langage et la littérature de cette contrée.
que Mahinda, ciwait-on, avait apporté à Ceylan les livres sacrés. Voyez Barthélemy Saint-Hilaire dans son rapport sur la Collection de manuscrits Grimblot, publié dans le Journal des Savo/nis de 1866 (p. 26 du tirage à part).
(1) IforA's, vol. 111, 72.
Le fait que presque tous les noms de personnes et de lieux mentionnés par les auteurs grecs et latins sont du pur sanscrit a déjà été si complètement mis en lumière par l’érudition moderne, que sur ce point nous ne saurions rien ajouter.
'La plus ancienne nation, après les Grecs, chez laquelle nous trouvions la connaissance de la langue et de la littérature- de l’Inde., ce sont les .Chinois. Bien que le bouddhisme n’ait pas été reconnu comme une troisième religion d’Etat antérieurement à l’an 63 avant Jésus-Christ, sous l’empereur Ming-ti (1), des missionnaires bouddhistes étaient venus de l’Inde en Chine, dès le troisième siècle avant notre ère. Dans les annales de la Chine il est fait mention d’un missionnaire bouddhiste en l’année 247; et vers l’an 4 20 avant Jésus-Christ, un général chinois, après avoir mis en déroute les tribus barbares, au nord du désert de Gobi, rapporta, comme trophée de sa victoire, une statue d’or, la statue de Bouddha. Le nom même de Bouddha, changé en chinois en Fo t’o et Fo (2), est du sanscrit tout pur, et vient de l’Inde, ainsi que chaque mot et chaque pensée de cette religion. C’était le sanscrit que les pèlerins chinois allaient étudier dans l’Inde, afin d’avoir la clef de la littérature sacrée du bouddhisme, ils appellent cette langue fanj mais fcm, comme M. Stanislas Julien l’a démontré, est une abréviation de fan-lan-?no, la seule traduction possible en chinois du. sanscrit brahmâ (3). On
(1) ilaxMülIer, Buddhism and.Buddhist Pilgrimsi p. 23.
(2) Méthode pour déchiffrer et transcrire les noms sanscrits qui se rencontrent dans les livres chinois, inventée et démontrée par M. Stanislas Julien ; Paris, 1861, p. 403.
(3) « Fan-chou (brahmâkshara), les caractères de l’écriture indienne, inventée par Fan, c’est-à-dire Fan-lan-ïno (Brahmâ)'. » — M. Stanislas Julien, Voyages des pèlerins bouddhistes, vol. II, p. SOS. .
raconte que l'empereur Ming-ti, de la dynastie des Han, envoya Tsaï-in et d’autres hauts fonctionnaires dans l’Inde,
b , 1
pour s’y instruire de la doctrine de Bouddha. Avec, l’assistance de deux savants bouddhistes, Matânga et Tchou-fa-lan, ils traduisirent en chinois quelques-uns des ouvrages les plus importants du bouddhisme. Les relations intellectuelles entre la péninsule indienne et les régions septentrionales de l’Asie continuèrent sans interruption, pendant plusieurs siècles. Des savants étaient envoyés de la Chine dans l’Inde, pour eiy étudier la géographie, -la religion, l’état politique et social ; mais c’était, avant tout, la religion de Bouddha qui faisait l’objet de leurs études et qui attirait les pèlerins chinois au-delà de l’fîimalaya.
Ce fut environ trois cents ans après la reconnaissance publique du bouddhisme par l’empereur Mihg-ti, que les flots des pèlerins bouddhistes commencèrent à se porter de la Chine dans l’Inde. La plus ancienne relation de ces pèlerinages qui nous soit parvenue se trouve dans le voyage de Fa-hian, qui visita l’Inde vers la tin du quatrième siècle de notre ère (1). Après Fa-hian nous avons les voyages de Hoeï-seng et de Song-yun, qui furent envoyés dans l’Inde, en 54 8, par ordi*e de l’impératrice, pour y recueillir des reliques et des livres sacrés. Puis vint Hiouen-thsang, dont la vie et les voyages, de 629 à. 645, ont été rendus si populaires par l’excellente traduction de M. Stanislas Julien; Après Hiouen-thsang, les principaux ouvrages des pèlerins chinois ce sont l’itinéraire des cinquante-six moines, publié en 730, et les voyages de Khi-nie, qui visita L’Inde en 964, à la. tête de trois cents pèlerins, Que pendant toute cette période le sanscrit était la langue savante de l’Inde, c’est un fait qui nous est prouvé, non-
(1) îfous devons à M. A. Réiiiusat une traduction française de cet ouvrage.
seulement par les noms propres et tous les termes de philosophie et de théologie cités dans les-voyages des pèlerins chinois , mais aussi par un court paradigme de déclinaison et de conjugaison sanscrites que Hiouen-lh sang a inséré dans son journal. ■
Aussitôt après l’entrée des mahomélans dans l’Inde, nous voyons traduire des ouvrages sanscrits eh persan et en arabe (.4).. Dès le règne du second calife abasside Àlmansour (2), en l’année 773 de J.-C,, un Indien versé dans l’astronomie visita la cour du calife, apportant avec lui des tables des équations des planètes, calculées d’après les mouvements moyens, et aussi des observations relatives aux éclipses de soleil et de la lune, ainsi qu’au lever des signes du zodiaque, qu’il disait avoir puisées dans les tables astronomiques d’un prince indien, que l’auteur arabe appelle Phfghar. Le calife, s’empressant de profiler de cette bonne fortune, ordonna qu’on traduisît le traité indien, afin qu’il servît de guide aux Arabes dans leur étude des astres. Cette traduction, due â Mohammed-ben-Ibrahim-Àlfazâri, est connue des astronomes sous le titre de grand Sind-hind ou Hind-sind, car on rencontre le mot écrit des deux manières (3).
(1) Sir Henri Elliot, Hislorians oflnclias p. 2S9.
(2) Colebrooke, Miscellaneous Essays, II, p. 504, cite la préface des tables astronomiques de Ben-al-Adami , publiées par son continuateur, Al-Casera, en 290 de Jésus-Christ. Sur les chiffres sanscrits, voir Stracliej7, Asiaiic Researches, XII, 1 Si, et Colebrooke, Algebra, p. lu. (Une excellente étude sur l’histoire des chiffres in-dietis et sur la manière dont ils se sont propagés a été donnée par M. Wœpke, Journal asiatique, 1863. Tr.) •
(3) Selon Ben-al-Adami, sind-hind signifie la révolution des siècles; Casiri le traduit par perpetuum ælernumque. Colebrooke propose de lire siddhânta, et suppose que l’original fut l’ouvrage de Brahmagupta, le Brahmasiddhdnia. M. Reinaud, dans son Mémoire sur l’Inde, p. .312, cite le passage suivant du Taryk-al-Hokama: « En Tannée 136 de l’hégire (773 de J.-C.), il arriva de
. QUATRIÈME LEÇON. 473
m *
Vers la meme époque, Yacoub, fils de Tharec, composa un traité d’astronomie fondé sur le Sind-hind(4). ïïaroun-' al-Rashid (786-809) avait à sa cour deuxmédecins indiens, Manka et Saleh. Manka traduisit du sanscrit en persan le traité classique de médecine, intitulé Susruta (2), et un traité des poisons, attribué à Chânakya (3). Sous le calife Al-Mâmoum, un traité célèbre d’algèbre fut- traduit du sanscrit en arabe par Moliammed-ben-Musa (4).
Yers l’an 4 000, Âbou-Rihan-al-Birouni (né en 970, mort en 4038) passa quarante ans dans l’Inde, et composa son excellent ouvrage, le Tarikhu-l-Hind, qui nous présente un fidèle tableau de la littérature et des sciences des Hindous à cette époque. Le sultan Ehawarazm adjoignit l’Inde à Bagdad un homme fort instruit dans les doctrines de son paj'S. Cet homme possédait la méthode du Sindhind, relative aux mouvements des astres et aux équations calculées au moyen de •sinus de quart en quart de degré. Il connaissait aussi diverses manières de déterminer les éclipses, ainsi que le lever des signes du zodiaque. Il avait composé un abrégé d’un ouvrage relatif à ces matières qu’on attribuait à un prince nommé. Fygar. Dans cet écrit* les KaTdagia (i. e. Krama^yâ; V.. Sùrya-siddhân ta, éd. Burgess et Whilne}^, p. 57 et p. 59) étaient calculés par minutes. Le khalife ordonna qu’on traduisît le traité indien en arabe, afin d’aider, les musulmans à acquérir une connaissance exacte des étoiles Le soin de la traduction fut confié à Mohammed, fils d’ibrahim-al-Fazary, le premier entre les musulmans qui s’était livré à une étude approfondie dé l’astronomie : on désigna plus tard cette traduction sous le titre de Grand Sindhind. » Albirouni place cette traduction en 771.
(1) Reinaud, Mémoire sur l’Inde, p. 314. _ .
(2) Y Steinschneider, Wissenschaflliche Blàtler, vol. I, p. 79.
(3) V. M. Flügel, dans lo Journal' de la Société asiatique alle-
mandei XI, p. .148 et 325. Steinschneider, Wissenschaflliche Blàtler, vol. I, p. 65, cite un traité en hébreu sur les poisons, attribué à l’indien Zanick. Dans Albirouni, il est fait mention de l’indien Kankah, astrologue d’Haroun-al-Rashid (Reinaud, Mémoire sur l'Inde, p. 315). On lui donne également le titre de médecin, üa autre médecin indien d’Haroun-al-Rashid se nommait Mankha. (Idem, ibid.) .
(4) M. F. Rosen en a donné une édition en 4831.
Albiromii à une ambassade qu’il envoya à Mahmoud le Ghaznévide et àMasoud de Lahore et dont le savant Avicenne refusa de faire partie. Albirouni dut posséder à-fond la langue sanscrite, car non-seulement il traduisit du sanscrit en arabe deux traités, dont l’un sur la philosophie San k h y a, et l’autre sur la philosophie Yoga, mais encore il lit passer deux’ ouvrages de l’arabe en sanscrit (1). ’
‘ Vers l'ISO, Ab ou Saleh traduisit du sanscrit en arabe un écrit sur l’éducation des rois (2).
On raconte que deux siècles plus tard, après la prise de Kagarcote, Firoz Shah lit traduire par Maùlâna Izzu-d-din Khalid Ehani plusieurs traités de philosophie composés en sanscrit. En 4381, on traduisit également du sanscrit un traité de médecine vétérinaire, attribué à Sâlotar, qui aurait été précepteur de Susruta (3). La• Bibliothèque
(1) Elliot, Eistorians of India, p. 96. Albirouni connaissait le H.arivan sa, et fixe lai.date des .cinq Siddhântas. C’est fil. Rei-naud qui le premier indiqua la grande valeur de l’ouvrage d’Al-birouni, dans son excellent Mémoire sur l’Inde, Paris, J 849.
(2) Dans l’ouvrage persan Mujmalu-t-Tawârikh, il y a des
chapitres traduits de l’Arabe d’Abu-SaIeh-ben-Shib-ben-Ja\va, qui lui-même les avait extraits, en les abrégeant, d’un ouvrage sanscrit intitulé VÉducation des rois ( Râganiti?) Le traducteur persan vivait vers 1150. Y. Elliot, ibicl. ‘
(3) Ori ne connaît point dans l’Inde de Sâlotar qui ait écrit un traité de ce genre. Dans Râga Râdhakant se rencontre 5àIo-lârîya au lieu de Sâlâturîya; mais Sâlâturîya est un nom. de Pâîiini, et l’on dit que le précepteur de Susruta se nommait Divodàsa. Le professeur Weber dans son Catalogue de manuscrits sanscrits, p. 298, a indiqué Sali ho ira, qui est mentionné dans le Pan datant ra comme enseignant l’art vétérinaire, et qui est cité par Garga dans le Asvày ur - Veda. Salotri est le terme usuel pour médecin vétérinaire, dans Phindoui et Purdu. Le professeur Aufrecht a découvert un traité de médecine par Salihotra 'dans la bibliothèque de VEasi India House, à Londres. Dans le Catalogue des manuscrits sanscrits du collège du Fort William, nous trouvons un ouvrage de médecine par Salinâtha. Hadji Chalfa, voir p. 59, fait mention d’un traité
royale de Lucknovv possédait un exemplaire de cet ouvrage. .
En descendant de deux autres siècles, nous arrivons au règne d’Àkbar (1556-1605), et nous pouvons dire que jamais homme plus extraordinaire n’occupa le trône de l’Inde. Après avoir été élevé, dans le mahométisme, il renonça à la religion du Prophète comme étant une vaine superstition, et consacra toute sa vie à la recherche de la vérité (1). Il appela à sa cour des brahmanes et des adorateurs du feu, et leur ordonna de discuter en sa présence les preuves de leur religion avec les docteurs mahomé-tans. Quand il apprit la présence des jésuites à Goa, il les invita à se rendre dans sa capitale, et, pendant bien des années, on pensa qu’il s’était.converti, en secret au christianisme. Mais, en réalité, il ne fut qu’un déiste, et il déclara lui-même qu’il h’avait. jamais rien cru, en dehors de ce que sa raison pouvait comprendre. La religion dont il fut le fondateur et qu’on a appelée llaJii est simplement le déisme auquel il -ajouta le culte du soleil, considéré comme le plus pur et le plus noble emblème de la divinité (2). Bien qu’Àkbar lui-même ne sût ni lire ni écrire,
de médecine vétérinaire composé en sanscrit par K â n a k y a. Une traduction du Aaraka, du sanscrit en persan et du persan en arabe, est citée dans le Fihrist (terminé en 9B7) et aussi par Albirouni (Reinaud,' Mémoire sur l’Inde, p. 316) ; celte traduction fut entreprise, dit-on, par les Barmécides. Les noms des personnes qui sont supposées avoir transmis les doctrines contenues dans ce traité, doivent être rétablis dans Albirouni de la manière suivante : Brahman , Pra^âpati , les As vin au , Indra, les ûls d’Atri, Agnivesa; V. AsliZangahridaya, inlrod'. (Ms. Wilson, 298). .
(i) Cf. Tans Kennerty, Notice respeciing the religion introduced by Akbar, dans les Transactions of lhe Hierary Society of Bombay, 1820* vol. II, p. 242-270..
(2) Êlliot, Ristorians of India, p. 249.
[Voir sur ces sectaires, très-nombreux encore de nos jours dans l’Iran, de Gobineau, Trois ans en Asiei p. 338 et suivantes. On
sa cour fut le. rendez-vous des savants de toutes les croyances (4). Tous les livres, dans quelque langue qu’ils fussent écrits, dont il pouvait espérer tirer quelque lumière pour éclaircir les problèmes qui lui tenaient le plus au cœur, étaient traduits par son ordre en persan. Il avait des traductions du Nouveau Testament (2), du Maliâ-bliârata, du Ramâya??a, de l'Àmarakosha (3), et d’autres ouvrages classiques de la littérature sanscrite : mais, malgré tout son désir de posséder les livres sacrés des différentes nations, il ne paraît pas qu’il ait réussi à obtenir des brahmanes une traduction, des védas. Il est vrai que Hadji Ibrahim Sirhindi traduisit pour l’empereur l’Àtharva-veda (4); mais outre que ce Yéda n’a jamais joui de la même autorité que les trois autres, il est même trouve, jusque dans l’Anatolie, désignés là par le nom de KisiU Bachi, des groupes mj'stêrieux qui paraissent se rattacher aux religions secrètes de l’Iran. (Cf. G. Perrot, Souvenirs d'un voyage en Asie Mineure, pp. 433 à 431.) Ces religions secrètes remontent vraisemblablement plus haut qu’Akbar, lequel semble avoir été plutôt encore un Soufi, ou libre penseur, qu’un véritable novateur religieux. Tr.J
(!) Mülbauer, Geschichte der katholischen Missîonen Oslindiens, p. 134. <
(ü) Elliot, Hisiorians of India, p: 248.
(3) Elliot, p. 259, 560. Le. Tarikh-i-Badauni, ou MmUakluibu-l-Tawdrikh, composé par Mulla Abd-ul-Kâdir Maluk, shah de Ba-dâun, et terminé en 1595, est une hisloire générale de l’Inde depuis l’époque des Ghaznevides jusqu’à la quarantième année d’Akbar. L’auteur est un mahométan fanatique, et il juge sévèrement Akbar qui, cependant, avait été pour lui un bienfaiteur généreux. Akbar l’avait chargé de faire des traductions de l’arabe et du sanscrit-en oersan ; c’est ainsi qu’il traduisit le Kâmâyana-, deux des dix -huit sections du Maliâbhârata, et une histoire abrégée du Cachemire. Ces traductions furent faites sous la direction de Faizi, frère du ministre Abou-1-Fazl. « Aboulfacel, ministro de Akbor, se valiô del Amarasinlia y del Mahâbhârata, que traduxo en persiano el ano de 1586. » Hervas, II, 136.
(4) Voir Max Müller, Bislory of Ancient sanskrit Literature, p. 327.
douteux que par Àtharva-veda on ait entendu autre chose que les Upanishads, dont plusieurs ont pu être composés pour l’édification d’Àkbar. La légende suivante nous montre de quelle façon les brahmanes gardaient le dépôt sacré de leur, religion sous les empereurs mogols. On raconte que, prières et menaces n ayant pu arracher aux brahmanes le secret de leur religion, Àkbar résolut d’avoir recours à la ruse. Par ses ordres, on fit confier aux soins de ces prêtres un jeune enfant du nom deFiezi, qu’on prétendit être un pauvre orphelin de la caste sacer-. dotale, laquelle seule peut être initiée à leurs rites sacrés. Fiezi, ayant été préparé au rôle qu’il devait jouer, fut c'on-duit secrètement à Bénarès, le centre des études dans l-Hindoustan ; là .il fut accueilli dans la maison d’un savant brahmane qui l’éleva comme s’il avait été son fils. Quand le jeune homme eut passé dix ans dans l’étude, Àkbar voulut le rappeler auprès de lui : mais il s’était épris de la fille de son maître. Le vieux brahmane .vit cet attachement sans déplaisir, car il aimait Fiezi, et il lui offrit sa fille en mariage. Partagé quelque temps entre
M- . - k ’
l’amour et la reconnaissance, le jeune homme se décida enfin à tout avouer, et, se jetant aux pieds dii brahmane, il lui dévoila le stratagème auquel il s’était prêté, eu le suppliant de lui pardonner son offense. Le prêtre, sans lui adresser de reproches, saisit un poignard qu’il portait à sa ceinture, et le lui aurait plongé dans le cœur, si Fiezi Savait retenu son bras. Le jeune homme chercha par tous les moyens à le fléchir, se déclarant prêt à tout pour expier sa perfidie; Le brahmane, fondant en larmes, promit de lui , pardonner à condition qu’il ferait serment de ne jamais traduire les Védas ou livres sacrés, et de ne jamais révéler à personne.au monde le symbole de la religion de Brahma. Fiezi fit le serment sur-le-champ : rhistoire ne dit pas jusqu à quel point il y fut fidèle, mais toujours est-
LEÇONS SUR LA. SCIENCE Dü LANGAGE.
478
y
il, ajoute l’auteur à qui nous empruntons ce récit, que jusqu a présent « les livres sacrés des Indiens mont jamais été traduits (4). » : ,. : .
Nous venons de constater l’existence du sanscrit comme . langue de la littérature et de la religion de l’Inde, depuis l’époque d’Alexandre jusqu’au règne d’Akba'r. Cent ans après Akbar, le fils aîné du shah Jehan, l’infortuné Dârâ, s’adonna aux études religieuses avec l’ardeur qui avait distingué son ancêtre. Il apprit le sanscrit, et, en 4657, un an avant d’être mis à mort par son jeune frère le fanatique Aurengzebe, il traduisit, en persan les Up a ni s ha d s, ces traités philosophiques qui font suite aux Védas. La traduction de ce prince fut retraduite en français par An-quetil Duperron, en 4795, et pendant longtemps elle fut la source principale ou les savants d’Europe puisaient leur
connaissance de la littérature sacrée des brahmanes.
. ■ " ■■ . . ■ ■_ -
Au temps où nous sommes maintenant arrivés, c’est-à-dire sous le règne d’Aurengzebe (4 657-4 708),. le contemporain et l’émule de Louis XIY, l’existence de la langue et delà littérature sanscrites était connue, sinon dés savants de l’Europe, tout au moins des Européens, qui résidaient dans l’Inde et surtout des missionnaires ; mais quel est le premier Européen qui ait appris le sanscrit, c’est ce qu’il
est difficile de déterminer. Quand Yasco de Gama débar' . s ' . * ' , - ■
qua à Calicut, le 9 mai 4498, le P. Pedro commença immédiatement à prêcher aux Indiens, et il avait souffert le
■ T r , ^ S ' ' '
martyre avant que l’explorateur de ces lointains parages fût de retour à Lisbonne. Chaque vaisseau qui arrivait dans l’Inde amenait de nouveaux missionnaires ; mais, pendant longtemps, leurs lettres et leurs rapports ne font aucune mention du sanscrit ni de la littérature sanscrite.
(i) Histoire des établissements des Européens dans les Indes orientales et occidentales, publiée au dernier siècle, par l’abbé Raynal. -
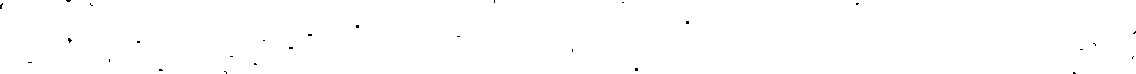

Le premier qui .organisa'la grande œuvre de la prédication
H T jT + * _ s
de l’Evangile dans l’Inde fut saint François Xavier (15£â); et tels furent son zèle, son dévouement et son succès à gagner tous les cœurs, ceux des riches comme ceux des pauvres, qu’entre autres dons miraculeux, ses amis lui attribuèrent le don des langues (4). Kéaumoins, ce n’est qu’en l’année 1559 que nous voyons les missionnaires, à Goa, étudier, avec l’assistance d’un brahmane converti, la littérature' théologique et philosophique, du pays, et défier les brahmanes a des disputes publiques (2). : .
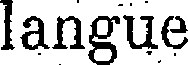
-- a. i ' ,1
, e
De 1581 à 1588 vécut à Go a un savant italien, Filippo Sasseti, qui occupait une place éminente parmi les érudits de l’époque. Ses lettres, ont été récemment publiées à Florence, et dans l’une d’entre elles il affirme que tous les. livres de science que possèdent les Indiens sont écrits ' dans Une seule et même langue, qui porte le nom de . S an scruta. Ce terme, ajoute-t-il, signifie « une langue bien articulée. » On l’apprend, poursuit-il, comme nous apprenons le grec et le latin, et il faut six ou sept ans pour arriver à la posséder. Personne ne sait quand cette a été parlée, mais elle a beaucoup de mots qui lui sont communs avec les idiomes parlés dans le pays et même
(1) Müllbauer, p. 67.
(2) Müllbauer, p. 80. Selon Roberto de Nobili, ces brahmanes appartenaient à une classe inférieure et n’étaient pas initiés à la littérature sacrée. Ils ignoraient, dit-il,’ « les livres Smarta , Aposlamba et Sutra. * (Müllbauer, p. 188.) Robert lui-même, dans sa défense, cite rÂpastambarSûtra, ibid, p. 192. Il .cite aussi Skanda Purâna, p. 193; Kadambari, p. 193. Rircher (China illustrata. 1667; p. 152) cite un ouvrage de Roberto de Nobili ; mais cet ouvrage ne paraît avoir existé qu’en manuscrit. Kircher dit : « Légat, qui volet, librum quem de Brahmanuni theologiaP. Robertus Nobilis Societalis Jesü, missionis Madürensis in India Malabarica fundator, nec non linguæ et Brahmamcæ gënea-logiæ consultissimus, summa sane eruditione ..... conscripsit. >» Cet ouvrage pourrait être encore d’un grand intérêt, et il serait à
. désirer qu’on en retrouvât le manuscrit. . • . .
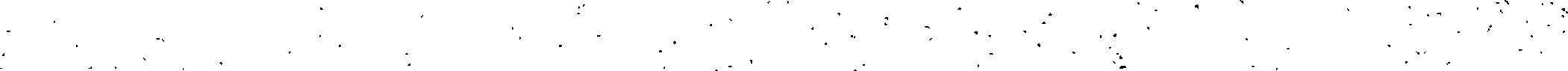
avec ritalieii. Ce dernier rapport est frappant surtout pour
' r ' - ' T ■ .
lès noms de nombre 6, 7, 8, 9* pour les termes qui désignent ï)ieu, le serpent, et pour bien d’autres mots encore. Puis il ajoute : « J’aurais du venir ici à dix-huit ans, afin de retourner en Europe avec quelque connaissance de toutes ces belles choses (1). » .
Le premier missionnaire européen qui ait réellement possédé à fond la langue sanscrite appartient à une période plus récente, quon peut appeler l’époque de Ro-berto de Nobili, pour la distinguer de celle que domine le génie de François Xavier. Robêrto de Nobili se rendit dans l’Inde en 4606. Etant lui-même de noble famille et d’un esprit délicat et cultivé, il comprit facilement l’éloignement qu éprouvaient lés castes supérieures, et en particulier les brahmanes, pour les communautés chrétiennes établies à Madura, et ailleurs, et presque entièrement composées de pauvres gens sans éducation ni culture-d’esprit. Il conçut alors le projet hardi de se présenter comme brahmane,- afin d’avoir accès auprès des savants et- des grands du pays. Il s’enferma pendant des années, se livrant à une étude approfondie non-seulement du tamoul et du teluga, mais aussi du sanscrit; et quand, après une étude patiente, de la langue et de la littérature des brah-
* . i
mânes, il se sentit de force à lutter avec ses antagonistes, il se montra en public, avec le costume des brahmanes, portant leur ceinture et leur marque au front, suivant leur régime de vie, et se soumettant même aux mille observances de leur caste; Malgré les persécutions des brahmanes, qui le redoutaient, et de ses compagnons, qui ne savaient pas le comprendre, ses efforts furent couronnés
(1 ) Leilere édité e inédite di Filippo Sassetti, racolte ed annoîate da Ettom Marcucci, Firenze, 1855, p. 417. Je dois de connaître Sasselli à l'obligeance du professeur Maggi de Milan, qui m’a donné un exemplaire de ses lettres. . .
de succès. Sa vie dans l’Inde, où il mourut aveugle et dans un âge avancé, est. pleine d’intérêt pour le.missionnaire; mais ici il ne peut nous occuper que comme étant le premier Européen qui ait surmonté toutes les difficultés du sanscrit. Celui qui pouvait citer Manou, les Purâ?ias et même des écrits tels que les Âpastamba-Sûtras, qui ne sont encore connus, de notre temps, que par le petit nombre d’indianistes qui peuvent lire les manuscrits sanscrits, a dû avoir une connaissance bien étendue de la langue et de la littérature des brahmanes; et quand il annonça qu'il venait prêcher un nouveau et quatrième Yéda qui avait été perdu (1), cette idée prouvait combien il connaissait le fort et le faible du système théologique qu’il voulait renverser. C’est un fait surprenant que les mémoires qu’il adressa à Home pour së 'défendre de l’accusation d’idolâtrie formée contre lui, et dans lesquels il lit un fidèle tableau de la religion, des coutumes et de la littérature des brahmanes, n’aient pas attiré l’attention
<*■ i
des savants. La question des accommodements, comme on l’appelait, occupa les cardinaux et les papes pendant des années, mais personne d’entre eux ne semble avoir compris l’intérêt extraordinaire qui s’attachait à une antique civilisation assez vivace et . assez puissante pour que
(t) L’Ezour-Véda n’est pas. de Roberlo de Nobili, mais probablement de quelque brahmane qu’il avait converti. Ce poème, écrit en vers sanscrits, dans le stjde des P u r à. n a s, offre un étrange amalgame des idées hindoues et des idées chrétiennes. La traduction française en fut envoyée à Voltaire, et publiée par lui en 1778, sous ce titre V Ezour-Yedamtraduit du sanscritam par un Brame. Voltaire déclara que l’original était de quatre siècles antérieur à l’époque d’Alexandre, et que c’était le don. le plus précieux que TOrient eût jamais fait à l’Occident. M. Ellis découvrit l’original en sanscrit à Pondichéry ( Asiaüc Research es, vol. XIV). Rien ne prouve que cet ouvrage doive être attribué à Roberlo, et il n’en est pas fait mention dans la liste de ses œuvres. (Bertrand, la Mission du Madurè, Paris, 1817-50, t. llï, p. 11(5; Müllbauer, p. 205, note.)
LEÇONS SUIl LA. SCIENCE DU LANGAGE
même les missionnaires de Rome crussent devoir user de ménagements envers elle. A un moment où. la décou; verte d’un seul manuscrit grec eût été saluée avec joie par tous les savants de T Europe, la découverte de toute une grande littérature passa inaperçue. L’heure du sanscrit n’avait pas encore sonné. ‘
Il y a un autre missionnaire jésuite du dix-septième siècle qui réussit à apprendre le sanscrit, Heinrich Roth. Tandis qu’il était fixé à. Àgra, il parvint, à force d’ins-‘ tances, à se faire enseigner par un brahmane les éléments du sanscrit ; après six ans de laborieuses études, il arriva à posséder à fond cette langue difficile. Il était à
. Rome dans l’année 4666, et ce fut lui qui rédigea cet in-
1 ■ , * . ■ ■ ■, ■ , .
l
.482
, ’ 1L *
*
téressant compte-rendu de l’alphabet sanscrit qu’Àtha-nasius Kircher publia dans sa China ülusirata (4667). Nous approchons maintenant du. dix-huitième siècle (4),
. et c’est alors enfin que;nous voyons les savants européens : commencer à porter, leur attention sur cette découverte ■ extraordinaire dont il‘n’y avaitplus moyen de douter, sur la découverte de l’existence dans l’Inde d’une riche litté-
■ 1 ' - " "■ i- ^ .
rature, littérature dont l’antiquité paraissait dépasser celle de toute autre littérature connue. Les jésuites français que Louis XIY envoya dans l’Inde après le traité de Rvs-wick entretinrent une correspondance littéraire avec des membres de l’Académie, des. inscriptions et b elle s-lettres. Des questions leur furent adressées par des membres de ce corps savant, et leurs réponses, furent imprimées soit ' . dans les Mémoires de VAcadémie (ancienne série); soit dans les Lettres édifiantes. Les réponses que le Père Cœurdoux, en 4767, fit aux questions que lui avait posées l’abbé Barthélemy et la correspondance qu’il entretint ensuite avec
(1) En 4677, un certain M. Marshall passe pour avoir poussé très-loin l’étude du sanscrit. Elliot, Ristorims.of India, p. 265.
Anquetil Duperron contiennent beaucoup de matériaux intéressants (4). Nous aurons à reparler de ce savant missionnaire comme de l’un des premiers qui saisirent le
t
véritable caractère de là ressemblance entre l’ancienne langue de l’Inde et les différents idiomes de l’Europe. Un de ses collègues, le Père Calmetle, dans une lettre datée de Yencataguiry, dans le royaume de Carnate, le 24 janvier -1733, nous informe (2) qu’à cette époque les jésuites avaient des missionnaires qui non-seulement possédaient bien les éléments du sanscrit classique, mais qui même étaient en état de lire quelques parties des Yédas. Ils étaient en train de former une bibliothèque orientale dont ils commençaient, dit-il, à tirer grand parti dans l’intérêt' de leur propagande religieuse. C’est de cet arsenal du Paganisme qu’ils tiraient,!es armes qui faisaient aux brah-mânes les plus profondes blessures. Ils possédaient leur philosophie, leur théologie, et particulièrement les quatre Yedas qui contiennent la loi des brahmanes, et que-les Indiens, depuis un temps immémorial, regard aient comme leurs livres sacrés, comme des livres d’une autorité irréfragable, et inspirés par Dieu lui-même.
« Depuis qu’il y a des missionnaires dans l’Inde, » continue-t-il, « on n’a jamais cru qu’il fût possible de trouver ce livre si respecté des Indiens. Et, en effet, nous n’aurions jamais pu en venir à bout, si nous n’avions eu des brames chrétiens cachés parmi eux. Car comment l’au-raientnls communiqué à l’Europe et surtout aux ennemis de leur culte, eux qui, à la réserve de leur caste, ne le communiquent pas à l’Inde même?... Ce qu’il y a de merveilleux, c’est que la plupart de ceux qui sont les déposi-
(i) Mémoires de littérature de l’Académie royale des Inscriptions, l. XLIX, p. 647. .
(“2) Lettres édifiantes^ Paris, d785, vol. Xill, p. 390.
taires du Yédam, n’en comprennent pas le sens ; car il est écrit dans une langue très-ancienne, et le Samouscrou-iam, qui est aussi familier aux savants que le latin l’est parmi nous, n’y atteint pas encore, s’il n’est aidé d’ùn commentaire, tant pour les pensées que pour les mots, qu’ils appellent Maha bachiam, ou «.le grand commentaire. » Ceux qui font leur étude de cette dernière sorte de livres sont parmi eux les savants du premier ordre. Tandis que les autres brames font le salut, ceux-ci seuls donnent la bénédiction. »
Plus loin (p. 437) il dit encore : « Depuis que le Veclam qui contient leurs livres sacrés, est entre nos mains, nous en avons extrait des textes propres à les convaincre des vérités fondamentales qui ruinent l’idolâtrie ’ car l’imité de Dieu, les caractères du vrai Dieu, le salut et la réprobation, sont dans le Vedam ; mais les vérités qui se trouvent dans ce livre n’y sont répandues que comme des paillettes d’or sur des monceaux de sable... »
Dans une autre lettre, datée du 16 septembre 4 737, le même missionnaire écrit : « Je pense comme vous, mon Piévérend Père, qu’il eût été à propos de consulter avec plus de soin les livres, originaux de la religion des Xndes ; mais jusqu’ici ces livres n’étaient pas entre nos mains, et l’on a cru longtemps qu’il n’était pas possible de les trouver, surtout les principaux qui sont les quatre Yédan. Ce n’est 'que depuis cinq ou six ans qu’à la faveur d’un système de. bibliothèque orientale pour Je roi on me chargea de rechercher des livres indiens qui pussent la former. Je lis alors des découvertes importantes pour la . religion, parmi lesquelles je compte les quatre Yédan ou livres sacrés. Mais ces livres, qu’à peine les plus habiles docteurs entendent à demi, qu’un brame n’oserait nous expliquer de peur de s’attirer quelque fâcheuse affaire dans sa caste, et dont l’usage du Samscroutam ou de la
langue savante ne donne pas encore là clef, parce qu’ils sont écrits en une langue plus ancienne, ces livres, dis-je, sont à plus d’un titre des livres scellés pour nous. On en voit pourtant des textes expliqués dans leurs livres de théologie. Quelques-uns sont intelligibles à la faveur du Samscroutam, particulièrement ceux qui sont tirés dès derniers livres du Védan, qui, pour la différence de la langue et du style, sont postérieurs aux premiers de plus de cinq siècles. ».
Quelques années après Calmette, le père Pons chercha à présenter, dans un tableau d’ensemble, l’indication de tous les trésors littéraires des brahmanes, et son rapport, daté de Kârikal, dans le Maduré, 2-3 novembre 1740, et adressé au père Qu Halde, fut publié dans les Lettres édifiantes (4). Le père Pons y donne une- description fort intéressante et, en général, très-exacte des différentes branches de la littérature sanscrite, des quatre Yédas, des ■ 4 . . „
traités grammaticaux, des six systèmes de philosophie, et de l’astronomie des Hindous. Il devance, sur plusieurs
points, les recherches de sir William Jones.
« - * r
Les lettres des pères Pons, Coeurdoux, Calmette et autres excitèrent un vif intérêt, mais cet intérêt devait nécessairement rester stérile tant qu’on n’avait ni grammaires, ni dictionnaires, ni.textes qui permissent d’étudier le sanscrit comme on étudiait le grec et le latin. L’abbé Barthélemy, en 4763, avait demandé au père Coeur-doux de lui envoyer, avant toute autre chose, une grammaire de la langue sanscrite, quoique alors déjà, à ce qu’il semble, la Bibliothèque royale de Paris possédât une grammaire sanscrite écrite en latin, et qui donnait les
(!) Lettres édifiantes, Paris, 1781, vol. XIV, p. 65. Voyez un excellent résumé de cette lettre dans un article de M. Biot, au Journal des Savants de 1861, ainsi que dans Hervas, Catalogo de las lenguas, II, p. 125. .
mots sanscrits en caractères bengalis, La seule partie qui manquât était la syntaxe, eb postérieurement, cette lacune fut comblée par le père Gœurdoux. À Rome aussi, il
- - 1 ■■ r-r - - " - ' - T
- - ' h ' - . » • H
semble avoir existé dans la bibliothèque du Collège romain les matériaux d’une grammaire sanscrite, dus à la plume de H. Roth (4) ; des documents de même nature se seraient aussi trouvés parmi les précieux papiers qu’avait laissés le jésuite J, ÏÏanxîeden, : auquel renvoient souvent Paulinus a Santo-Bartholomeo, ïïervas (2) et autres. Le premier toutefois qui réussit à publier en Europe une grammaire sanscrite, ce fut un carmélite allemand, Johann Philip Wesdin, plus connu sous le nom de Paulinus a Santo-Bartholomeo. Il habita l’Inde de 4776 à 4789, et if publia à Rome la première grammaire sanscrite en 4 790. Quelques années plus tard, il imprima une grammaire plus complète. et; il écrivit aussi plusieurs essais sur les ; antiquités, la mythologie et la religion de l’Inde; dans tous ses écrits, il. se servit des papiers laissés par-, Hanx-leden, qui, à en juger par lès citations que donne Paulinus, doit avoir eu. du sanscrit une Connaissance très-profonde (3). Quoiqu’on n’ait pas épargné les critiques à ce travail, et qu’on ne le consulte plus guère, il est juste de nous’rappeler que la première grammaire de n’importe quelle langue est incomparablement plus difficile à composer que toutes Celles qui la suivent (4). • -
(J) Hervas, Catalogo de las lenguas. ; : . *
(2) Hervas, Catalogo de las lenguas, II, p. 132. « Este jesuila, se-gun me ha dicho.el referidô Frav Paulino, llegô â hablar la lengua malabar,.y à eütender la samscreda çon mayor pérfeccion que ios Brahmanes, eome lo demuestran sus insignes -manuscrites en di-
chas lenguas. »
(3) Vyacarana seu locwpletissima Samscrdamicæ linguæ insliluiio, a P. Paulino a S. Bartholomeo. Romæ, 1804. '
. (4) Sidharubam seu Gràmmatica Samscrdamica^ cui accedit dis-sertatio historico-critica in linguam Samscrdamieam, vulgo Samscret
Nous avons donc vu que l'existence de la langue et de la littérature sanscrites était connue depuis la première découverte de l'Inde j)ar Alexandre et son armée. Mais ce qu’on ne savait pas, c’était que cette langue, telle qu’elle était parlée au temps d’Alexandre et au temps de Salomon, et pendant des siècles avant lui, était étroitement apparentée au grec et au latin, et leur était exactement ce qu’est le français à l’italien et à l’espagnol. L’histoire de ce quon peut appeler la philologie sanscrite chez les Européens date de la fondation de la Société asiatique à Calcutta en 4784 (4). Quoique quelques-uns des anciens missionnaires paraissent avoir eu du sanscrit une connaissance bien plus sérieuse qu’on ne le supposait jadis, ce furent pourtant les travaux de William Jones, de Carey, de-.-Wilkins, de Forster, de Colebrcoke, et d’autres membres de cette illustre compagnie, qui ouvrirent aux savants de l’Europe l’accès de la langue et de la littérature des brahmanes, et il serait difficile dé dire si ce fut la langue ou bien la littérature qui excita l’intérêt le plus profond et le plus durable. .
Il était impossible, même après le regard le plus
rapide jeté sur les déclinaisons et les conjugaisons, de ne pas être frappé de la ressemblance extraordinaire,
dictam, in qua hujus linguæ existe ntia, origo, præstantia, antiquitas, extensio, maternitas ostenditur, libri aliqui in ea exarali crilice re-censentur, et simul aliquæ antiquissimæ gentilium orationes Iitur-gicæ paucis attinguntur et explicanlur.auctore Paulino a S. Bartho-lomæo. Piomæ, 1790. . .
(1) Les premières publications de la Société forent la Bhaga-vadgiLa, traduite par Wilkins, 1785 : le Hitopadesa, traduit par Wilkins, 1787; et la Sakunlalâ, traduite par W. Jones, 1789. Des grammaires originales, sans parler des simples compilations, furent publiées par Colebrooke, 1805; par Carey, 1S06 ; par Wilkins,'1808; par Forster, 1810, par Yates, 1820 ; par Wilson, 1841. En Allemagne, Bopp publia ses grammaires en 1827, 1832, 1834, 18G3 ; Benfey, en 1852,1855 et 1863.
ou, parfois, de la parfaite identité entre les formes grammaticales en sanscrit, en grec et en latin. Nous avons vu que dès- \ 588 Filippo SasseUi avait été frappé par la ressemblance des noms de nombre de l'italien et du sanscrit; ainsi que des termes qui désignaient Dieu, le serpent, et beaucoup d’autres choses. La même remarque doit avoir été faite par d’autres , mais jamais cette ressemblance 11e fut mieux, mise en lumière que par le père Cœurdoux. Dans l’année -1767, ce jésuite français écrivit de Pondichéry à l’abbé Barthélemy à Paris, qui lui avait demandé une grammaire et un dictionnaire du sanscrit, ainsi que des renseignements généraux sur l’histoire et la littérature de l’Inde, et il ajouta à sa lettre un mémoire, qu’il désirait voir mettre sous les yeux de l’Académie. Ce mémoire portait le titre suivant : Question ' proposée à M. l’abbé Barthélemy et aux autres membres de- l’Académie des Belles-Lettres et Inscriptions : « D’ou vient que dans la langue sanscroutane il se trouve un grand nombre de mots qui lui sont communs avec le latin et le grec, et surtout, avec le latin? » Le missionnaire jésuite cite d’abord ses faits , dont quelques-uns sont très-intéressants. Il compare, par exemple, de va et deus, dieu; mrityu et mors, mort; granit a m et genitum, produit; ganu el genu, genou ; vidhavâ, devi, sans, et dhava , homme avec vidua, veuve ; na et non, pas ; m a dhy a et médius, moyen ; dattam et datum, donné; dânam et donum, don, ainsi que beaucoup d’autres rapprochements qu’ont faits de nouveau les philologues postérieurs. Quelques-unes de ses comparaisons, il faut l’avouer, sont mal fondées ; mais, à tout prendre, cette note méritait plus, d’attention qu’elle ne semble en avoir obtenu de l’Académie. Les rapprochements qu'il fait entre les formes grammaticales, particulièrement, .lui
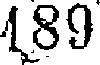
QUATRIEME LEÇON.
font honneur. Il compare l’indicatif et le subjonctif du verbe auxiliaire en sanscrit et en latin : _
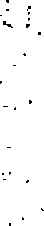
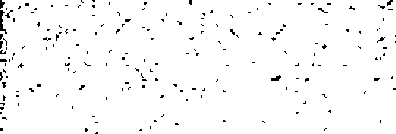
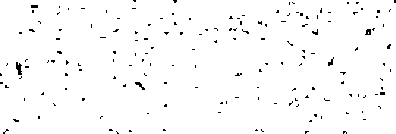
Sanscrit, *
asmi
asi
asti
smas
s t h a.
santi
Latin,
sum
es
est
sumus
estis
sunt
Sanscrit,
s y âm s vas syàt syâma .s y âla san tu
Latin,
sim
sis
sit.
simus
sitis
sint
Parmi les pronoms il compare a h a m eiego, me et me, m ahy a m et mihi, s va et suus, t'vâm et tu, tu b h y am et tibi, k a s et quis, k e et qui, kam et quem. Il fait aussi ressortir les analogies frappantes que présentent les noms de nombre de un à. cent, en sanscrit, en grec et en latin. ^ ; .
■ Mais,".ne se contentant pas d’établir ces concordances, i] procède à l’examen des différentes hypothèses qui se présentent à l’èsprit pour expliquer ces faits ; il montre qûë ni le commerce, ni les relations littéraires, ni le
prosélytisme, ni la' conquête, ne suffiraient à rendre
j ■ " ■- - ' * ’ * " + 4 " ■ _ _
compte de ce fonds commun de mots qui se trouve dans le sanscrit, le grec, et le latin ; il conclut én disant qu’il . faut regarder, ces mots communs comme des restes du langage primitif de l’humanité, restes conserves par les différentes tribus dans leurs migrations vers le nord et le
1 " ) ' . s ,
sud, après la grapde catastrophe de la confusion des langues à Babel.- . .
Quand on songe que cet essai a été écrit il y a une
centaine d’années, on est confondu qu’il ait excité si peu d’attention, et qu’il n’àit été, en fait, jamais remarqué et cité jusqu’au moment où M. Michel Bréal l’a déterré dans les Mémoires de l’Académie des Inscriptions, et a réclamé pour ce modeste missionnaire l'honneur qui lui appartient certainement d’avoir devancé, au moins de
1 \K r V / J
, S
cinquante ans, quelques-uns dès plus importants résultats de la philologie comparée. . . .
«Dès 4778, Haîhed signalait ces rapports dans la préface de sa grammaire du bengali (1) : « J’ai été bien étônnn, disait-il, de rencontrer cette similitude entre des mots sanscrits et des mots persans et arabes, et même entre des mots sanscrits et des mots latins et grecs, et cela, non. pas dans des termes techniques ou métaphoriques dont on pourrait expliquer, la présence par des emprunts faits aux arts ou aux sciences d’autres pays, mais dans le fonds même de la -langue, dans des monosyllabes, dans les noms de nombre et dans les noms, de ces choses qui ont dû recevoir une appellation; distincte à l’aurore même de la civilisation. » Sir William Jones (mort en 4794) déclara, après le premier coup d’œil qu’ildonna au sanscrit, que, quelle que fût son antiquité, cette langue avait im mécanisme merveilleux ; quelle était plus parfaite que le grec, plus abondante que le .latin, plus polie.et plus .délicate que ces deux .langues avec lesquelles, pourtant, elle avait une grande affinité,
. . " - . j - .i ■ _ , 1
« Aucun philologue, dit-il, ne saurait examiner le sanscrit, le grec et le latin, sans penser qu’ils sont issus d’une source ■ commune, laquelle, peut-être, n’existe plus. Jj y a une raison du même genre, quoique moins évidente, pour supposer que le gothique et le celtique ont eu la même, origine que le. sanscrit. Nous pouvons .aussi comprendre l’ancien persan dans cette famille. »
Mais comment expliquer cette affinité ? C’était la question à laquelle personne, n’était préparé à . répondre. Les théologiens n’auguraient rien de bon des études nouvel -
(!) Halhed -avait publié, en 1776, le Code des lois Gensoo, digeste des plus célèbres recueils de . lois sanscrites „ que onze brahmanes avaient composé par ordre de Warren Itastings et que Halhed traduisit sur une traduction persane de l’original.
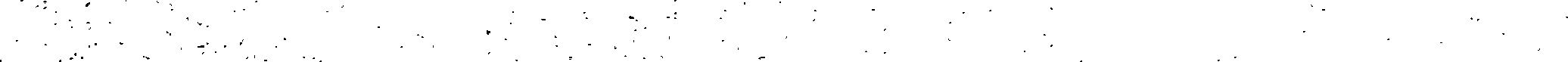
les ; les humanistes affectaient l'incrédulité ; les philosophes se livraient aux conjectures les plus extravagantes, afin d’échapper à la seule conséquence qui pût être déduite des faits connus, mais qui menaçait de renverser leurs petits systèmes sur l’histoire du monde. Lord Monboddo venait d’achever son fameux ouvrage (4), dans lequel il tire tout le genre humain d’un couple de singes, et tous les dialectes du monde d’une langue formée dans l’origine par des dieux de l’Égypte (2), quand la nouvelle de là découverte du . sanscrit arriva comme un coup de foudre. À son honneur, cependant, il-faut dire qu’il comprit sur-le-champ l’extrême importance de cette découverte. C’eût été lui demander beaucoup que de le faire renoncer à ses singes primordiaux ou à ses idoles égyptiennes ; mais, à cela près, les conclusions qu'il sut tirer des faits nouveaux que* lui fit connaître son ami Wilkins, auteur de l’une de nos premières grammaires sanscrites, honorent bien certainement la. perspicacité du juge écossais. « Il existe, dit:il en 4792 (3), chez les
■ - ri
brahmanes de l’Inde, une langue, qui est plus riche et plus belle, sous tous les rapports, que même le grec d'Homère. Tous les autres. dialectes de l'Inde ont-une grande ressemblance avec cette langue qu’on appelle le sanscrit, et dont ils sont tous dérivés. Sur ces faits et
(1) On ihe Origin and Progress of Language, 6 vol.: 2e éd. Edimbourg, 1774. ' .
(2) « J’ai supposé que le langage n’a pu être inventé sans un
secours surnaturel, et, en conséquence, j’en, ai attribué l’invention aux dieux de l'Égypte, lesquels étant supérieurs à la nature humaine ont' commencé par apprendre à articuler des mots, et ont ensuite enseigné aux hommes Part du langage. Mais je suis persuadé que ce langage primitif a dû se perfectionner par degrés, et qu’une langue telle que le sanscrit n’aurait pu être créée tout d’un coup. » — Monboddo, Ancient Mètaphysics, vol. IV, p. 357. . . -
(3) Origin and Progress of. languagei vol. VI, p. 97.
t ■■ •
- 'Vj. , h y-. - ^ - . 7 s
v ' j ' 1 ' V,
t . t
-V V
192
LEÇONS SUR LÀ SCIENCE DU LANGAGE.
certains autres qui s’y rapportent, j’ai reçu de Un de des renseignements si précis* que si je vis assez longtemps pour terminer l’histoire de l’homme commencée dans le troisième volume de mon ouvrage sur la Métaphysique ancienne, je pourrai prouver clairement que le grec est
* , " r , f " " " ‘ , " - "
dérivé du sanscrit, 1 ancien.idiome de l’Egypte, lequel fut 'porté par les Égyptiens dans l’Inde, en même temps que tous leurs arts, et dans la G-rèce par les colonies qu’ils y établirent. »
Quelques années plus tard, en 1795, nous le trouvons avec des. notions plus exactes sur le rapport entre le sanscrit et le grec : « SI. Wilkins, dit-il (t), a démontré invinciblement'une telle ressemblance entre le’ grec et le sanscrit, quil faut que l’un soit un dialecte de l’autre, ou qu’ils dérivent tous deux d’une langue originale. Or le grec n’est certainement pas un dialecte, du sanscrit, ni le sanscrit du grec. Ce sont donc des dialectes d’une même langue, laquelle ne peut être que la langue de l’Égypte,
. qui fut: portée ; dans l’Inde par :Osù*is et dont., sans aucun doute, le grec est dérivé, ainsi que je pense l’avoir prouvé. »
Nous n’avons pas à discuter ici les théories de lord Moriboddo' sur l’Égypte et sur Osiris, mais on nous permettra de citer un dernier passage de cet auteur, afin de montrer avec quelle, sagacité il. savait démêler la
■ 'i. - . i s * - t - ii- ’
vérité: à travers tous les faits qui l'enveloppaient, alors qu’il n’était pas égaré par quelques-unes de ses. théories favorites : . . -
. « Appliquons maintenant ces observations aux ressemblances que M, Whlkins a découvertes entre le sanscrit elle grec. Je commencerai par les mots qui ont dû être des mots primitifs dans toutes les langues, les choses
(1) Ancient Metapliysics, vol. IV, p. 322.
qu’ils signifient ayant été, nécessairement, connues et nommées dès le commencement de toute société ; si bien qu’une langue n’a pu les emprunter à une attire langue, à moins qu’elle n’en soit dérivée. Tels sont les noms des nombres, des membres du corps humain, des parents, comme père, mère et frère. Prenons d’abord les nombres, dont les dix premiers se disent en sanscrit : ek, dwee , tree, chatoor, panch, shat, sapt, aght, nava, das : l’affinité n’est-elle pas évidente entre ces mots et les mots latins et grecs qui y correspondent ? Le sanscrit dit ensuite dix et un, dix et deux, et ainsi de suite jusqu’à vingt, car la numération des Indiens est décimale, comme la nôtrè. Yingt se dit en sanscrit vinsati ; trente, trinsat, dans la composition duquel entre le mot qui exprime trois, ainsi que cela a lieu dans l’équivalent grec et latin. Nous voyons les mots signifiant quarante, cinquante, etc., formés de la même manière, jusqu’à ce que nous arrivions à cent, qui se dit sat, et qui diffère du nom grec et latin. Mais il y a une particularité bien digne de remarque, c’est que, dans aucune des trois langues, rien dans le nom signifiant vingt ne rappelle deux qui, multiplié par dix, donne ce nombre : en effet, ce.nom, en grec, .est eikosi, qui n’exprime aucun rapport-avec deux, pas plus que le latin vigmti (1), lequel se rapproche -davantage du sanscrit vinsati. C’est ainsi que, jusque dans leurs anomalies, nous apercevons la conformité du grec et du latin avec le sanscrit. »
Lord Monboddo rapproche le sanscrit pada du grec pous, podos ; le sanscrit n a s a du latin nasus ; le sanscrit de va, dieu, dugrecTAeos et du latin deus ; le sanscrit ap, eau, du .latin aqua; le sanscrit vidhavâ du latin vidua,
(I) Voir, sur Terreur que commet ici lord Monboddo, notre deuxième leçon, page 49-50.
, r . f
veuve. Il cite des mots sanscrits, tels que go nia pour angle, kentra pour centre, hora pour heure, comme étant évidemment d’origine grecque, et comme ayant passé du grec en sanscrit. Il énumère ensuite les points de ressemblance entre la grammaire du sanscrit et celles des langues classiques. Il fait remarquer des mots composés, tels que tripada, de tri, trois, et pada, pied, un trépied. Il appuie sur .le fait extraordinaire de remploi de Va privatif en sanscrit de même qu’en grec ; et il cite enfin , comme étant le don le plus précieux que M. Wilkins eût pu lui faire, les formes sanscrites a s mi, je suis, asi, tu es, asti, il est, santi, ils sont, qui ont incontestablement [a même origine que les formes correspondantes eimi, eis, esti, en grec, et sunt, en latin. . .; • - .
: Un autre philosophe écossais, Dugald Stewart, n’accueillit pas d’aussi bonne grâce la découverte nouvelle,
■ * ^ .. s ■■ ■" , r " - 1
Il fallait assurément un grand effort pour, qu’un homme, accoutumé toute ,sa .vie à ..regarder le latin., et le grec comme des langues primitives ou comme des modifications dé l’hébreu acceptât la doctrine révolution-
r " ■ . ' " V ' - ■ . - _ - - ( "
naire qui établissait une étroite parenté entre les langues classiques et un jargon de sauvages,; car, à cette époque, on ne se faisait pas une autre des sujets du Grand-Mogol. Toutefois Dugald Stewart avait l’esprit trop juste pour ne pas voir que, si l’on admettait les faits allégués-concernant le sanscrit, il
/
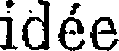
fallait de toute nécessité admettre les conséquences qui
- ^ _ _ - ' ■ r ' - ^ " ' T r ' "
en étaient déduites : il nia donc complètement l’exis-
- - - - ■ . . f ' ■ . J . . ■ ■- . - . . .. - ; \ X - ' _ ■ .
tence de la langue sanscrite, et il écrivit l’essai que
" „ i ‘ * ‘ ’ '
nous avons déjà cité pour prouver que cette langue avait été composée, sur le modèle du grec et du latin, p ar d’as tucieux b rahman es , et que to ut e. la. littéra-t-ure sanscrite était une fourberie, insigne. le men-
&

lionne ce fait parce qu’il montre, mieux que tout ce que je pourrais dire, quel coup- la découverte du sanscrit vint porter à un des plus chers préjugés des hommes instruits,, auprès desquels les arguments les plus absurdes trouvaient faveur pendant quelque temps, pourvu qu’ils leur permissent d’échapper à cette pénible conclusion, que le grec et le latin étaient de la même famille que la langue des noirs habitants, de l’Inde. ... ■ ’ .• .
Le premier qui, au grand jour de la science euro-
t î 1 ■ .
péènne, osa regarder en face; les faits: nouveaux et toutes
^ - - _ —‘ r <
leurs conséquences, fat le poète allemand Frédéric Schle-gél. S’étant rendu en Angleterre pendant îa paix d’Amiens (180!-1802), iî avait reçu les premières notions de sanscrit de M: Alexandre Ïïamilton. Après avoir poursuivi ses
études à Paris, il publia, en 1808, son livre "Surla langue
■ ■ ' * . 1 f ^ , " * ■ - ■■
et la sagesse des Indous, qui devint, la base de la science du langage. Quoique publié deux ans seulement après le premier volume du Mithridate d’Adelung, l’ouvrage de Schlegel en est séparé de toute la distance qu’iî y a entré le système de Copernic et celui de Ptolémée. Schlegel n’était pas un grand savant ; beaucoup de ses assertions étaient erronées, et rien ne serait plus facile que d'analyser son essai et de le tourner en ridicule ; mais c’était
- y . ' . - -
un /homme de génie, et quand il s’agit de créer une science nouvelle, l imagination du poète y est encore plus nécessaire que l’exactitude du savant. Il- fallait assurément le regard du génie pour embrasser d’un seul coup
d’oeil les langues de l’Inde, de la Perse, de da Grèce, de
, m ■ ’ , . ■■ +
l’Italie et de l’Allemagne, et pour les comprendre toutes sous la simple dénomination d’indo-germaniques. Telle fut l’œuvre de .Schlegel, et, dans Thislôire de l’intelligence, on Ta appelée en toute vérité « la découverte d’un nouveau monde. » ‘
Bans notre prochaine leçon, nous verrons de quelle fa. çon l’idée de Schlegel fut accueillie et poursuivie en Allemagne, et comment elle eut pour résultat presque immédiat la classification généalogique des principales langues de l’humanité.
■■
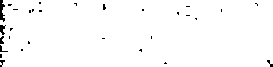
CLASSIFICATION GÉNÉALOGIQUE DES LANGUES.
Travaux de Bopp, A‘. Schlegel, Humboldl, Polt, Grimm, Rask, Burnouf. Révolution opérée dans l’étude de la classification des langues par la découverte du sanscrit. La grammaire comparée. La classification généalogique des langues : pourquoi celte classification ne s’applique pas nécessairement.à toutes les langues. — Table généalogique de la famille des langues aryennes'. 1° Branche ieutonigue. Le bas-allemand, auquel appartiennent les dialectes frisons, le hollandais et le flamand. Le haut-allemand, dont l’histoire se divise en trois périodes : le nouveau, le moyen et l'ancien haut-allemand. Le gothique : vie d’Ul-filas, sa traduction de la Bible en gothique. Les dialectes Scandinaves : le suédois, le danois, l’islandais. L’Edda poétique et l’Edda de Snorri Slurluson, les plus anciens monuments du langage Scandinave; La littérature en Islande : les scaîdes. — 2° Branche italique. Les six langues romanes : le français, l'italien, l’espagnol, le portugais, le valaque et le romanche. — 3° Branche hellénique.
— 4° Branche celtique. Le kymri qui comprend le gallois, le cor-nique et l’armoricain. Le gadhélique qui • comprend l’irlandais, le gaélique d’Écosse et le manx ou dialecte de l-ile de Man. — 5° Branche slave ou windique, Le lelie, le lithuanien. Le russe, le bulgare, le serbe, le croatien, le slovénien. Le polonais, le bohémien, le lusatien.
— L’albanais. — 6“ Branche indienne. Le sanscrit, les dialectes prâkrits, l’hihdoui, l’hindoustani, le mahratle, le bengali. — 7° Branche iranienne. Le zend, le pehlvi, le parsi, le persan moderne. — Berceau primitif de la famille aryenne.
.Dans notre dernière leçon nous avons exposé les diverses tentatives faites pour arriver à une classification des langues, jusqu’en 4809, l’année où parut l’essai de Frédéric Schlegel sur la Langue et la Sagesse des Indiens.
■ De même qu’une baguette magique, cet ouvrage indi-
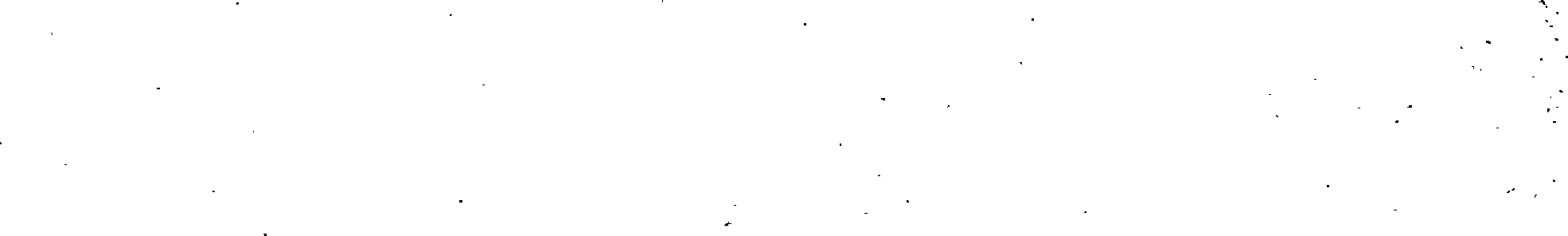
qua ï’endroit où Ton devait ouvrir une mine nouvelle ; et bientôt, plusieurs des premiers savants de i’époque se mirent avec ardeur à fouiller cette mine et à en arracher les trésors. '
Pendant quelque temps, tous ceux qui voulaient apprendre le sanscrit durent venir en Angleterre. Bopp, Sohlegel, Lassen, Hosen, Burnouf, y firent tous quelque séjour, copiant des manuscrits dans la bibliothèque de la Compagnie des Indes orientales, et recevant les conseils de Wilkins, de Coîehrooke, de Wilson et d’autres membres distingués : de l’ancienne administration civile dë l’Inde. C’est à François Bopp que l’on dut, en 1816, la première comparaison détaillée et vraiment scientifique qui ait été établie entre la grammaire du sanscrit et celle du grec, du latin, du persan et de l’allemand (4). Ce travail fut suivi d’autres essais du même savant, et en 1833 parut le premier volume de sa Grammaire comparée dit, sanscrit, du zend, du grec, du latin, du lithuanien, , de Vancien slave, du gothique et de Vallemand, qui ne fut terminée que près de vingt ans plus tard, en 4 852 (2), et qui restera toujours la base solide et inattaquable sur laquelle repose l’édifice de la philologie comparée. Auguste-Guillaume Scnlege'l, frère de Frédéric Schlegel, exerça Fin-fluence qu’il s’était acquise comme poète, pour populariser en Allemagne l’étude du sanscrit.. Son Indische Bï-blioihek fut publiée de 4 819 à 4 830, et bien que spécialement destiné à la littérature sanscrite, ce recueil consacra aussi plusieurs articles à la philologie comparée. La nouvelle; science trouva bientôt un protecteur plus- puissant
(1) Conjugationssystem^ Frankfurt, 1816. .
(2) [Une nouvelle édition, avec de nombreuses améliorations, a
été publiée en 4856, et traduite en français par M. Michel Bréal. Paris, Hachette, 4866. Tr.] . '
encore dans Guillaume de Humboldt, le.digne frère d’À-îexandre de Humboldt, et à cette époque l’un des premiers hommes d’Etat de la Prusse. Ses essais sur la philosophie du langage attirèrent l’attention du public pendant sa vie ; et il laissa un'monument plus durable de ses études dans son grand ouvrage sur la langue kawi., qui 11e fut publié qu’après sa mort, eu -1836. Un autre savant que nous devons citer parmi les fondateurs de la philologie comparée est M. Pott, dont les Recherches étymologiques parurent d’abord en 4833 et en 4836 (4). Kous ne pouvons pas oublier non plus l’œuvre vraiment colossale deGrimm, sa Grammaire teutonique, plus spéciale dans son objet, mais fondée sur les mêmes principes généraux, et dont la publication a pris près de vingt années, de 4849 à 4837. C’est ici également le lieu de rappeler'le nom d’un éminent Danois, Erasme Rask, qui se livra à l’étude des langues du nord de l’Europe. Il partit pour la Perse et l’Inde en 4 846:, et fut le premier qui trouva, la clef du zend, la langue du Zend-Àvesta ; mais il mourut avant d’avoir eu le temps de publier tous les résultats de ses savantes recherches. U avait prouvé toutefois, que la langue sacrée des Parsis avait de grands rapports avec la. langue sacrée des brahmanes, et qu elle avait conservé,-ainsi que le sanscrit, plusieurs des formes primitives du langage indo-européen. Ces recherches. sur l’ancienne langue de la Perse furent continuées par un des plus grands savants que la France ait jamais produits, Eugène^ Burnouf. Les livres de Zoroastre avaient déjà été traduits par Ânquetil Duperron, mais cette traduction avait été faite sur une traduction persane de l’original. Ce fut Bur-
(4) Seconde édition, 4859 et 4861. Voir aussi les ouvrages du même auteur, La Langue des Bohémiens, 4846, et Les Noms propres i 1856. .
S - H
\ .
■'"s. ' r * "
-G- ^
■F" . *
f "
J
200
LEGO.NS SU K LA S CIE NC E D U LA KG A G E
nouf qui, à l’aide de sa connaissance du sanscrit etde la grammaire comparée, déchiffra le premier le texte original de l’ouvrage attribué au fondateur de l’antique reli-; gion de la lumière. Le premier aussi, il appliqua la même-clef, avec un véritable succès*. aux inscriptions cunéi-
i . ■ , 1 , ,
; formes de Darius et deXerxès; et sa mort prématurée sera'longtemps déplorée, non-seulement par ceux qui, comme moi, ont été, assez heureux pour le connaître personnellement et pour suivre ses leçons* mais encore par tous ceux qui ont à cœur les intérêts de la littérature et de la philologie orientales.
Il serait trop long d’énumérer ici tous les savants qui ont marché sur les traces de Bopp, Schlegel, Humboldt,
’ Grimm et Burnouf. On.ne peut se faire une meilleure idée
- - 1 ■ ■ ■ ' - ' A. ' .
des progrès qu’a faits la science du langage et des fruits merveilleux quelle ;a portés, qu’en parcourant des veux la bibliothèque d’un linguiste. Depuis dix ans, il se publie en Allemagne un .journal spécial de philologie coim parée.- .La- Société philologique de Londres fait paraître chaque année un volume d’excellents mémoires ; et dans la plupart des universités de l’Europe nous trouvons un professeur de sanscrit, dont les leçons portent en même temps sur la grammaire comparée et sur la science du langage. ; /
Ici on peut fort naturellement se demander comment il sefait que la découverte du sanscrit ait Opéré un changement aussi complet dans l’étude de la classification
' * s * _ ,l ■ -
des langues. Si le sanscrit avait été la langue primitive de
, , * "■ ,
'd’humanité ou, au moins, la.source du grec,, du latin,et de l’allemand, on comprendrait que la découverte de. cette langue ait dû amener lés savants à classer ces idiomes autrement qu’ils, ne;l’avaient fait jusqu’alors. Mais la langue sanscrite n’est pas au grec, au latin, au" gothique, au celtique et au slavon ce qu’est le latin au français, à
204
r 1 1
; f. ■
■ > '
-s \fc
- % V
CINQUIÈME LEÇON.
l’italien et à l’espagnol ; elle ne saurait être appelée leur
■ " _ /*■ •
ni ère, mais seulement leur sœur aînée, et elle occupe à l’égard des langues classiques une situation analogue à celle qu’occupe le provençal à l’égard des dialectes romans modernes. Toutes ces -observations' sont parfaitement justes/mais'‘il est facile d’y répondre. Ce fut préci-
sèment la nécessité de déterminer d’une manière nette et
- ■ ■ ■ •- 1 - ■ ' ■ , ■ * * ■' ■'
exacte les rapports du sanscrit avec les, autres membres de la même famille, qui produisit ces importants . résultats, et qui fit découvrir, en particulier, les lois des ch anS! ‘ ■■■ '■ '■ f ^ '
gements phonétiques, par lesquelles seules nous pouvons . constater sûrement les degrés exacts de parenté entre les dialectes congénères, et rétablir de la sorte l’arbre généalogique du langage humain. Une fois qu’on eut déterminé la vraie place que le sanscrit doit occuper dans la série, ët/qiT6nrse:i’anse avëc cêtfë idée qu’il a du exister
' % - w ' f -
un idiome plus ancien que le sanscrit, que le grec et que le latin, dont cet idiome primitif, avait été la souche commune, ainsi que des branches teutonique, celtique.et slave, toutes les langues semblèrent prendre, comme d’elles-mêmes, leur rang véritable. La clef de la difficulté était trouvée ; tout le reste n’était plus qu’affaire de temps et
■ ■■ ' 1 , i - - ’ t _ ■ ■
de patience. On comprit, que les arguments par lesquels on avait prouvé que le sanscrit et le grec s’étaient développés parallèlement, s’appliquaient avec non moins de force à la position relative du latin et du grec; et quand on eut montré que dans bien des- cas le latin avait un'ça-- raclère plus primitif que le grec, il était facile de voir
que les langues teutoniques, celtiques et slaves conte- - . - ■ ' ■ ■ r ■ 1 1 * ’
liaient aussi nombre de formes qu’il était impossible de
i . ■= . ' -> ■
dériver du sanscrit, du grec ou du latin. Il devenait dès-lors manifeste que toutes ces langues devaient être'regardées comme des branches collatérales issues d’une seule\
et même tige.
i
i , - -. ■ - ^
202 LEÇONS SUR LA SCIENCE DU LANGAGE. '
- ' ' \ ; C ■ É ' - j " H
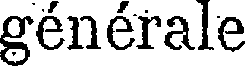
" h
.y . .
'""-'K
; Le prenner service que la découverte du sanscrit rendit à l’élude de la classification des langues, fut donc d’empêcher les savants de se contenter, comme ils Pavaient fait jusqu alors, d’une Certaine affinité vague et et de leur faire préciser les divers degrés de parenté exis-; tant entre les différents membres d’une même classe. Âu
- ' ' . ' ■ , ’ ■ ■ - w
lieu de classes de langues, on entendit parler, pour la première fois, de familles bien déterminées.
Ce premier progrès fut suivi par un autre qui en était la conséquence naturelle. Tandis que pour constater, d’une manière générale, T origine commune de plusieurs langues, il avait suffi de comparer entre eux les noms de nombre, les pronoms, les prépositions, les adverbes, les substantifs et les verbes les plus usités, on trouva bientôt qu’il : fallait un critérium plus exact pour reconuaîtré tous
1 , ' ' " " ■ ■ . - . - i
les degrés de parenté de ces langues entre-elles. Ce crite-
- 1 1 " ti- 1 P J A .
rium fut la grammaire comparée, c’est-à-dire la comparaison des formes grammaticales des langues qu’on supposait ' être congénèrescette comparaison étant faite d’après certaines lois qui régissent les permutations phonétiques des lettres. : .
Tout cela' nous paraîtra beaucoup plus clair si nous
' ■ H1 ■ "■ ' ' ■
jetons les yeux sur l’histoire de nos langues modernes. On ne pouvait douter que les dialectes appelés romans, l’italien, le valaque, le provençal, lé français, l’espagnol et le portugais, ne fussent apparentés de très-près les uns aux autres, et il était non moins évident qu’ils dérivaient lotis du latin. Mais un des plus grands philologues de la France, Raynouard, qui a contribué plus que personne à faire connaître l’histoire de la littérature et des langues romanes, soutenait que la langue provençale seule était fille du latin, et que toutes les autres étaient filles du provençal. Il prétendait que du septième au neuvième siècle il y eut pour le latin une période de transition, dans
203
A %
Tu1
rv..


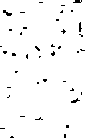
s
*
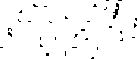
N
s.*
J
- ' /
\
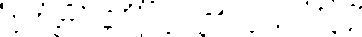
t
■v _ *
CINQUIEME LEÇON.
laquelle celle langue devint le roman dont il s’efforcait de prouver Tidëntité avec le provençal du midi de la France, la langue des troubadours. Selon Raynouard, ce n’est :qu’après avoir Subi cettè; métamorphose uniforme repré-seniée par la langue romane ou provençale, que le latin
I " *■ >
•a donné.naissance aux divers dialectes romans de l’Italie,
■ ' ■ y ' - y ' ' • ‘ - ; * ■ ^ •• • .
de la France, de l’Espagne et du Portugal. Celte théorie qui fut attaquée vigoureusement par Auguste-Guillaume Schlegel, et combattue ensuite ..dans tous ses détails par > Cornewall Lewis, ne peut être réfutée que par la comparaison de la grammaire provençale avec celle des autres dialectes romans. . .
Si.vous prenez le yérbe auxiliaire être, pour en çompa-
. . t . 1 -' - . . , ’ . ’ ' ; -*
rer les formes en provençal et en français^vous verrez au premier coup d’œil que plusieurs personnes ont con-
_ i — 1 — ' — " «Jk- T JS __ ^ j t s _ Jk T ■ , _ +. ^
servé en français une forme qui reste bien plus'près.idu latin que la forme correspondante en provençal, et que par conséquent la langue française ne saurait être classée comme une fille du provençal et petite-fille du latin.- Nous trouvons en provençal : .
serti) répondant au.français'-nous sommes, etz, — . . — vous êtes, '
soti) ’ — ils sont,
et ce 11e serait rien moins qu’un miracle grammatical si des mots estropiés tels que sem, -els et sonavaient pu re-prendis les formes plus saines, plus primitives' et plus ■ latines de sommes, êtes et sont; suiiïus, estis,sunî.
Si .maintenant nous appliquons’ le. même critérium au sanscrit, au grec et au latin, nous verrons que nous pouvons déterminer leurs relations généalogiques par la comparaison de leurs formes grammaticales. Il est tout' aussi impossible de dériver le latin du grec, ou le grec du
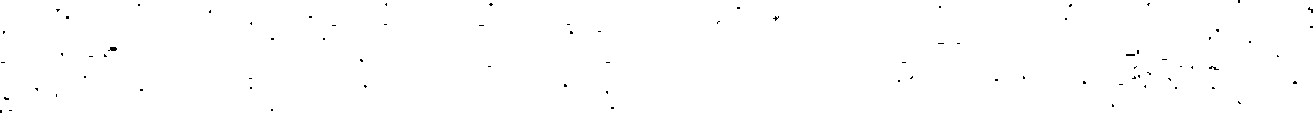
204 LEÇONS SUR LA SCIENCE DU LANGAGE.
■ - ' O ■ ■ _ _
sanscrit, que de regarder le français comme une modification du provençal. Pour ne nous occuper que du verbe auxiliaire être, nous trouvons que je suis se dit en
. sanscrit: grec: lithuanien :
a s m i, csmi, esmi,
la racine étant as, et la désinence mi.
Or la désinence de la seconde personne est si, ce qui, ajouté à as ou es, donnerait .
es-si.
a s - s i, es-si
Mais à quelque époque de son histoire que nous remontions, nous trouvons que lë sanscrit, a réduit as si à a s i ; et il est impossible de supposer que la forme parfaite ou organique, ainsi qu’on l’appelle quelquefois, du grec ou-d u lithuanien ..essi ait pu sortir de la forme mutilée du sanscrit a si.
La troisième personne est la même en sanscrit, en grec et en lithuanien, as-ti ou es-ti ; et en laissant tomber IV final, nous reconnaissons le latin est, le gothique ist elle russe est'. . .
. De ce même verbe auxiliaire nous pouvons également tirer la preuve que le latin n’a jamais pu traverser la période grecque ou pélasgiquè, comme on disait autrefois, et que le grec ét le latin sont -tous deux des modifications indépendantes'dune même langue originale. Au singulier, le latin est moins primitif que le grec, car sum est pour es-um, es pour es-is, est pour es-ti. De même à la première personne du pluriel sumus est pour es-umus; c’est le grec es-mes, le sanscrit ’smas. La seconde personne es-lis, qui équivaut au grec es-te, est une forme plus primitiv

que 3e sanscrit s Ilia. - Blais, à la troisième personne du pluriel, la forme latine est plus primitive que la.grecque: La forme régulière serait as-anti, devenu en sanscrit sailli ; le grec a laissé tomber Fs initiale, etFéolien enti a fini par se réduire à eisi; le latin, au contraire, a con-serv éYs du radical, et il serait complètement impossible de dériver sunt du grec eisi.
, Les formes I am\ tJiou art, heis, de l’anglais moderne, ne sont que des modifications secondaires du même verbe primitif. Nous trouvons en gothique : .
îm, pour mi,
Î5, — Î55,
ist. '
et nous donne ainsi
L’anglo-saxon change Fs eh ?/,
En soumettant toutes les langues à cette même épreuve, les fondateurs de la philologie comparée arrivèrent bientôt à diviser les principales langues de FEurope et de l’Asie en certaines familles,, dans chacune desquelles ils purent distinguer différentes branches composées à leur tour de nombreux dialectes tant ancien s que modernes.
Toutefois, il y a encore beaucoup de langues qui'n’ont pu être classées par familles, et quoique nous ayons tout lieu de penser que plusieurs d’entre elles trouveront un jour leur place dans un système de classification généalogique, il est bon de nous .mettre en garde, dès le début, contre cette supposition très-commune, mais purement gratuite, que le principe de là classification généalogique doive nécessairement pouvoir s’appliquer à toutes les
C1 >■ -,
3 -U, ' r '
■; ” - ’
s - - -
, ' K
206
LEÇONS SUR LA. SCIENCE DU LANGAGE.
langues. Celle classification est assurément la plus par-' faite de toutes, mais il y:a bien peu de branches des sciences physiques où on puisse l’adopter, excepté sur une très-petite échelle. Dans la science du langage, la classification généalogique doit être fondée principalement sur les éléments grammaticaux ou formels, lesquels ne peuvent'être conservés que par une tradition non interrompue, une fois qu’ils ont subi l’altération-phonétique. Nous savons que l’italien, le français, l’espagnol et le portugais ont dû avoir une même origine, parce qu’ils ont en commun des formes grammaticales qu’aucun de ces dialectes n’aurait pu créer avec ses propres ressources, et qui ny ont plus de signification, ni, en quelque sorte, de vie. La désinence de l’imparfait ba en espagnol, m en italien, par laquelle canto,: je chante, se changé en cantaba et ca?itava,ria. pas de signification ni d’existence indépendantes dans ces deux-dialectes modernes. L’espagnol; et l’italien n’ont pu la tirer de leur propre fonds, et, elle a dû venir de quelque époque précédente dans laquelle Un sens s’attachait à cette syllabe ba. Il nous est facile de la faire remonter au latin - ôam de cantabam, et nous pouvons alors prouver que bam était dans l’origine un verbe auxiliaire indépendant que nous retrouvons dans le sanscrit bhavâmi, et dans l’anglo-saxon beom, je suis. La classification généalogique ne s’applique donc proprement qu’aux langues qui dépérissent, aux langues dont le développement grammatical a été arrêté par Tin-
J ’ ^ j '
fluence de la culture littéraire, qui n’augmentent guère leurs richesses et gardent le plus longtemps possible ce .qu’elles possèdent déjà, et dans lesquelles, enfin, ce que nous appelons développement ou histoire n’est plus que la marche.de la corruption phonétique. Mais, avant de dépérir, les langues ont eu leur période de croissance, et les linguistes semblent avoir négligé ce fait important
que les dialectes qui sont arrivés pendant cette période à une existence indépendante, doivent naturellement échapper à la classification généalogique. Si vous vous rappelez la manière dont le pluriel, par exemple, a été formé en chinois et dans d’autres langues que nous avons examinées dans une leçon précédente, vous verrez que quand chaque dialecte a pu choisir son.propre terme pour exprimer la pluralité, soit masse, classe,. espèce, troupeau, nuage, etc., il serait déraisonnable de s’attendre à trouver des ressemblances entre les terminaisons grammaticales de ces langues, après que la corruption phonétique a réduit les termes précités à notre plus que des exposants dé pluralité. Mais on serait tout aussi peu en droit d’induire de telles dissemblances que ces langues n’ont pu avoir une . même origine : car il est manifeste, que, si des.
* T ' J J “ ' ' r
dialectes ayant une origine .commune '.ont'.adopté, dès leur
. ' - ■ v T ■- ■ L 7 '
première séparation de la langue-mère, des mots différents pour exprimer les cas, les nombres, les personnes,
les temps et les modes,, la philologie comparée aura beau
.* ■ - * +
analyser leurs désinences grammaticales, elle n’en pourra jamais tirer aucune preuve de la fraternité de ces dialectes. Leur classification généalogique est donc, par la nature même des choses, tout simplement une impossibilité, du moins si cette classification doit reposer principalement sur les formes .grammaticales.
On pourrait, cependant, supposer que ces langues,
- ... ^ - _ " " .
tout en différant entre elles par le mécanisme de leur grammaire, révéleraient néanmoins leur communauté d’origine par l’identité de leurs radicaux ou de leurs racines ; et effectivement, c’est ce qui arrivera bien souvënt. Les noms de .nombre, plusieurs des pronoms, quelques-uns des mots les plus usuels de la vie seront probable-.ment identiques dans ces diverses langues : mais, même sur ces points, il ne faut pas s’attendre à rencontrer des
\
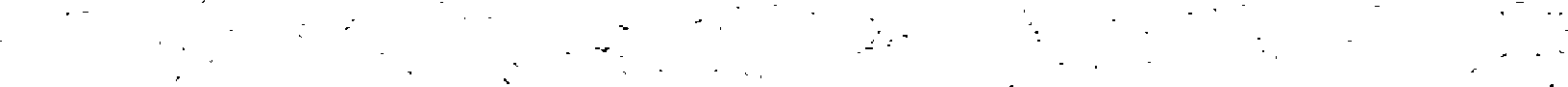
208 LEÇONS SUR LA SCIENCE DU LANGAGE.
w
ressemblances nombreuses, ni s’étonner si l’on en trouve bien moins encore qu’on n’espérait. Nous avons déjà vu combien le mot père varie dans les différents dialectes frisons. Au lieu de fraier, le mot latin pour frère, nous trouvons en espagnol hermano, de même que le latin ignis a été remplacé en français par feu, et en italien par fuoco. Personne ne doute que L’allemand et l’anglais n’aient, eu une origine commune, et pourtant le nombre ordinal anglais, ihe first, que nous retrouvons dans Fürst, p r in cep s, prince, ne rappelle aucunement l’allemand der ersle, pas plus que ihe second ne rappelle der zweiie; et il n’y a nulle connexité entre le pronom possessif iis et l’allemand sein. Cette liberté dans l’adoption des mots est bien autrement grande et puissante dans des idiomes anciens et sans littérature; et plus on aura étudié avec soin le développement naturel des dialectes, moins on s’étonnera de voir des langues qui ont eu une origine commune différer non-seulement dans leur structure grammaticale, mais aussi dans , beaucoup, de ces mots dont on a bien raison de se servir, comme de points de comparaison, pour découvrir la parenté des langues littéraires. Nous verrons plus tard jusqu’à quel point il est possible de constater les rapports de parenté qui existent entre ces langues : pour le présent, mon but aura été atteint, si j’ai pu montrer clairement que le principe de la classification généalogique ne s’applique pas nécessairement à toutes les langues, et qu’en second lieu, l’impossibilité de comprendre certaines langues dans une même table généalogique ne prouve nullement que ces langues n’aient pas eu une origine commune. Les linguistes qui s’en vont répétant que l'impossibilité de dresser une table généalogique de toutes les langues démontre clairement que le largage humain n’a pas pu avoir une origine commune, ne font là qu’une de ces asseyions, dogmatiques qui entravent, plus
P-':
■l-
\
que tout le reste, la libre marche de la science indépem dante. ■ ' . .
Voyons maintenant quels progrès ont été faits dans la classification généalogique des langues, et en combien de familles il a été possible de diviser le vaste règne du langage humain. Mais, d’abord, rappelons-nous ce qui nous avait suggéré la nécessité d’une classification généalogique. Nous voulions connaître le sens primitif et la raison d’être de certains mots et de certaines
, ' „ " , . . ' - . 'v p
formes grammaticales en anglais, et nous avons vu qu’avant, de chercher à découvrir l’origine du d dans 1 loved, il fallait commencer par remonter à la forme la plus: ancienne de ce mot. : En portant lés yeux sur l’histoire des dialectes romans , nous avons remarqué qu’un même mot conserve souvent dans un de ces dialectes une forme plus primitive que dans les au-, très, et, par suite, nous avons compris toute Tim-portance qu’il y a à établir, pour les autres lan-gués, ces rapports de parenté qui réunissent le français,
l’italien , ’ l’espagnol et. le portugais dans une. même
> __ J ■ " - " - ■ ■* " "
famille. ' , , •
• K--
En prenant la langue actuelle de l’Angleterre, nous , n’avons pas eu de peine à la rattacher à l’anglo-saxon ; ce qui nous conduit au septième siècle après Jésus-Christ, car c’est à cette date que Kemble et Thorpe placent le vieux poème épique anglais, le Beowulf : il nous, est impossible de remonter au-delà du septième siècle, si nous restons sur le sol anglais. Mais nous, savons que les Saxons, les Angles et les Jiites sont venus en Angleterre du continent, et de nos jours leurs descendants* sur là côte du nord de l’Allemagne., parlent encore le bas-allemand ou Meder-Deuisch, que plus d’un matelot anglais a pris pour un patois corrompu de son pays, en l’entendant parler dans les ports d’Anvers, de Brème et de ïïam-
, : . ■ .■ u
bourg (L). Le bas-allemand comprend beaucoup de dialectes du nord ou des basses-terres de l'Allemagne ; ruais dans l'Allemagne propre ces dialectes.ne sont presque jamais employés pour des compositions littéraires. Au bas-allemand appartiennent les dialectes frisons ainsi que le hollandais et le flamand. Le frison a. eu sa littérature dès
’ b-
le douzième siècle ou peut-être plus tôt (§). Le hollandais, qui est encore une langue nationale et littéraire, bien que parlée sur un espace fort limité, possède des monuments
écrits du seizième siècle. À cette même époque, le flamand
■*
était la langue parlée à la cour de Flandres et de Brabant, et il subsiste encore aujourd’hui malgré les envahissements de la langue officielle de la Hollande et de celle, de la Belgique. La plus ancienne œuvre littéraire du bas-allemand, sur le continent, est le poème épique chrétien, le Heljand (ïïeljand = Heiland, « le Sauveur »), qui nous a été.conservé dans deux manuscrits du huitième siècle, et qui fut composé, à cette époque, pour les Saxons, nouvellement convertis. A partir du huitième siècle jusqu’au dix-septième, nous pouvons découvrir des traces de compositions littéraires écrites en saxon ou bas-allemand, mais il en. est bien peu qui soient parvenues jusqu’à
(1) « Het echt engelsch is oud ncderduitsch, » le véritable an
glais est de l’ancien bas-allemand. — Bildeqryk. V, Delfortrie, Analogie des Langues, p. 13. . . ' ;
(2) « Quoique les monuments de l’ancien frison se rapportent,
pour la date, à l’allemand de l’époque moyenne plutôt qu’à l'ancien allemand, la langue dans laquelle ils sont écrits se rapporte évidemment à une période bien plus primitive qui se rapproche beaucoup de l’ancien haut-allemand. L’isolement politique des Frisons et léur! noble attachement à leurs droits héréditaires ont imprimé à leur langue un caractère conservateur. Après le quatorzième siècle, nous voyons le frison se dépouiller rapidement de toutes ses flexions, tandis qu’au treizième et au douzième siècle, elles n’y étaient pas moins nombreuses que dans l’angio-saxon du neuvième et du dixième. » Grimm, Grammaire allemande, lrc édition, vol. I, p. lxvhi, ■ .
CINQUIÈME LEÇON. 211
_ «I .
nous, et la traduction de la Bible en haut-allemand par Luther fut un coup de mort porté à la littérature du bas-allemand.
La véritable langue littéraire de l'Allemagne a toujours été, depuis le temps de Charlemagne- jusqu’à nos jours, le haut-allemand, dont les divers dialectes se parlent par tout le pays (1). Son histoire se divise en trois périodes : le nouveau haut-allemand date de Luther; le moyen remonte depuis le seizième siècle jusqu’au douzième, et Y ancien depuis le douzième siècle jusqu’au septième.
. Nous voyons donc qu’il nous est possible de suivre ces deux rameaux du langage teutonique, le haut et le bas-allemand, jusqu’au septième siècle de notre ère ; mais il ne faut pas supposer qu’avant cette époque il y ait eu une langue teutonique commune, parlée par toutes les tribus germaniques, et qui se scinda plus lard en deux branches principales. Il n’a jamais existé de langue teutonique commune à toute la race germanique, et rien ne prouve qu’il y ait jamais eu un haut-allemand ou un bas-allemand uniformes, d’où leurs dialectes respectifs seraient sortis parla suite. Il est impossible de dériver l’anglo-saxon, le frison, le flamand, le hollandais et 1 e plati-deuisch de l’ancien bas-allemand tel que nous le trouvons, au neuvième siècle, dans le saxon du continent. Nous pouvons seulement dire que ces divers dialectes du bas-allemand, en Angleterre, en Hollande, dans la Frise et dans la basse Allemagne, ont passé, à differentes époques, par les mêmes phases, ou par les mêmes degrés de développement grammatical. Nous.pouvons ajouter qu’à mesure que nous remontons dans le passé, la convergence de
(1) Il y a les dialectes de la Bavière et de l'Autriche, .de la Souabe (l’alémanique), de la Franconie sur les bords du Mein, de la Saxe, etc. . ■
ces dialectes devient de pins en. plus marquée;., mais rien ne nous autorise- à admettre l'existence hisorique d'un dialecte bas-allemand primitif et unique, jui aurait été la source de tous les autres ; c’est là me pure invention de grammairiens, à qui la multiplicié des langues paraît incompréhensible sans F existent d’un type commun. Ces mêmes grammairiens-voudraient également nous faire croire à un dialecte haut-aïemand primitif d’où seraient venus non-seulement l’ncien , le moyen et le nouveau haut-allemand, mais encore tous les dialectes locaux de l’Autriche, de la iavière, de la Souabe et de la Franconie ; et ils nous leman-dent d’admettre qu’à une époque antérieure il y a eu une véritable langue teutonique, qui n’était eicore ni le haut ni le bas-allemand, niais qui contenait éjà les germes de ces deux dialectes. Ce système peut êîe commode pour les objets de l’analyse grammaticale,mais il devient dangereux dès qu’on essaye de prêter à e telles abstractions .une réalité historique.. De même qu’i y a eu des familles, des peuplades et des confédération:de tribus avant qu'il y ait eu une nation ; de même k langue nationale a été précédée par les dialectes. Le gammai-rien qui pose comme un fait historique l’existent d'un seul.type primitif pour toutes les langues teutoniqes, n’a pas de fondement plus solide pour sa croyance qe l’historien qui croit à Francus, petit-fils d’Hector et pétendu ancêtre de tous les Francs, ou à Brutas, père mthique de tous les Bretons. Quand les races germaniqueslescen-dirent, les unes après les autres, des bords de la Baltique ou du Danube pour s’emparer de l’Italie et des povinces romaines ; quand les G-oths, les Lombards, les Yudales, les Francs et les Bourguignons, sous la. conduitede leurs rois respectifs, et différant entre eux par les lo; et par les mœurs, vinrent s’établir en Italie, en Gaui et en
Espagne, pour prendre part au dénoûment delatragédiè romaine, nous n’avons aucunement lieu de supposer qu’ils parlaient tous un seul et même dialecte. Si nous avions entre les mains des documents écrits de ces vieilles races germaniques, nous y verrions bien certainement quelles parlaient toutes, des idiomes différents, dont les uns devaient se rapprocher du bas-
ip _ .
allemand et les autres, du haut-allemand. Cette assertion n’est pas fondée sur une pure conjecture, car un hasard heureux nous a conservé la traduction gothique de la Bible par l’évêque Ülfilas, dans laquelle nous pouvons étudier le dialecte d’un de ces peuples. .
Je ne puis prononcer le nom d’TMlas sans dire quelques mots de cet homme remarquable. Les historiens
ecclésiastiques sont bien loin de s’accorder sur. les dates
' ■ - , - + k
et sur les principaux événements de sa vie ; ces obscurités proviennent en grande partie de ce qu’Ulfflas était un évêque arien, de sorte que les récits de sa vie sont fournis par des hommes des deux camps opposés, par des historiens ariens et par des historiens orthodoxes. Si nous avions à porter un jugement sur son caractère, il nous faudrait nécessairement peser tous ces témoignages contradictoires ; mais quand il s’agit seulement de dates et de simples faits, il. semble juste de supposer que .les amis , ont dû posséder, des renseignements plus exacts que les adversaires: c’est donc dans les écrits des partisans d’Ulfilas que nous chercherons la chronologie et les événements les plus importants de sa vie. ' .
Les principaux auteurs à consulter sont Philostorge et Àuxence, dont le premier nous a été conservé par Photius, et,-le second par Maximin dans un manuscrit récemment découvert par ML Waitz dans la Bibliothèque nationale de
Paris (supplément latin, n° 594) (4), et clans lequel sont également contenus certains écrits-de saint Hilaire, les deux premiers livres de saint Ambroise de Fide, et les actes du concile d’Aqüileja (384). Sur la marge de ce manuscrit., Maximin a recopié le commencement des actes du concile d’Aquileja, en y ajoutant ses propres remarques pour montrer combien saint Ambroise avait été injuste pour Palladius. Il exprime ses propres idées sur la doctrine d’Arius, et (fol, 282, seq.) il nous donne une vie d’Ulfilas écrite par un de ses disciples, Auxence, évêque de Dorostorum (Silistria sur le. Danube). Puis viennent quelques dissertations de Maximin, ét (fol. 314-327) un traité adressé à saint Àmbrbise par un semi-arien , sectateur d’Eusèbe, et qui pourrait bien être Prudence lui-même ; ce traité est copié par Ma xi min, et un peu abrégé en certains endroits, pour les besoins de sa causé.
C’est Auxence qui nous apprend qu’Ulfilas mourut à .Constantinople, .où II,avait .été .convié par .l’empereur à une discussion Idéologique. Cet événement n’a pu être postérieur à l’année 381, car ie même Auxence nous apprend qu’tlîiilas mourut après quarante ans d’épiscopat, et nous savons par Philostorge qu’il avait été sacré, évêque par Eusèbe. Or 34-1 est l’année de la mort d’Eusèbe de Nicomédie, et comme Philostorge nous dit qu’ülfilas fut sacré par « Eusèbe et les évêques qui étaient avec lui, » on a fait cette supposition fort vraisemblable, que son sacre avait eu lieu au commencement de l’année 344, alors qu’Eusèbe présidait le synode d’Antioche. Puisqu’Ulfdas avait trente ans quand il fut élevé à l’épiscopat, no.us devons prendre l’année 314 comme date de sa naissance; et
(1) U cher das Lebcn und die Lehre des Utfüa, Hannover, 1840; üeber das Leben desülfüa, von DrBesseI, Gœltingen, 1860.
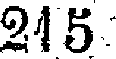
puisqu’il avait soixante-dix ans quand il mourut à Constantinople, sa mort doit être placée en 384.
M. Waitz, en rapportant la mort d’Ülfilas à Tannée 388, se fonde sur ce fait, rapporté par Àuxence, que d’autres évêques ariens avaient accompagné Ulfilas dans son dernier voyage à Constantinople, et qu’ils venaient d’obtenir des empereurs là promesse d’un nouveau concile, quand leurs adversaires eurent assez d’influence pour faire promulguer une loi nouvelle défendant toute espèce de discussion sur les matières, de foi, soit en public, soit en particulier. À propos de ce passage, Maximin, à qui nous devons la relation d’Auxence, cite deux lois du code théodosien qui se rapportent, selon lui, à cette controverse, et qui sont datées de 388 et de 383 ; Ce qui prouvé que Maximin lui-même n’était pas bien fixé sur la date précise.
Mais M. Bessell a -démontré clairement que ces deux lois
« .
n’ont rien de commun avec la controverse des évêques-
■ - *
ariens; ce rapprochement n’est donc qu’une erreur de
Blaximin. Si nous rapportions la mort d’Ulfilas à l’année 388,
. - * ' ^
il nous faudrait abandonner le fait important rapporté par Philostorge du sacre d’Ulfilas par Eusèbe, et supposer qu’en 388, Théodose était encore en pourparler avec les Ariens : nous savons, au contraire, qu’après l’année 383, quand Théodose eut échoué dans ses dernières tentatives de réconciliation, on ne garda plus de ménagements avec le parti d’Ulfilas et de ses amis. .
Si, au contraire, Ulfilas est mort à Constantinople én 3M, il a très-bien pu y. être appelé par l’empereur Théo-dse, pour assister, non pas à un concile, mais à une dispute (acl disputationem), selon la conjecture iugénieuse duiocieur Bessell, contre lesPsathyropolistæ, qui venaient de muer à Constantinople une nouvelle secte arienne (1).
_ i
(I)V. Bessell, loc. cin, p. 38.
Vers la même époque, en 380. Sozomène rappelle les ef* ' i . .
forts des Ariens pour gagner la faveur de Thèodose. (1), Il s’accorde avec Àuxence pour dire que tous, ces efforts furent vains, et qu’une ldi fut publiée pour interdire toute discussion sur la nature de Dieu. Nous trouvons cette loi dans le code théodosien, à la date du i 0 janvier 381. Mais ce qu’il importe surtout de remarquer, c’est que cette loi révoque un rescrit que les hérétiques ariens avaient obtenu par fraude, et vient confirmer par là le témoignage d’Auxence au sujet du nouveau concile que l’empereur lui avait promis, ainsi qu’à son parti.
Revenons maintenant à Ulfilas, qui est né, ainsi que nous l’avons vu, en 311. Au dire de Philoslorge, ses parents étaient originaires de la Cappadoce, et ils avaient été emmenés en captivité par les Gotlis, d’un endroit nommé Sadagolthina, près de la ville de Parnassos. Ce fut sous
Valérien et Gallien (vers 267) que les Goths firent cette in-
r ■* ,
cursion en Galatie et en Cappadoce, et les captifs: chrétiens
qu’ils ramenèrent, avec eux .furent les; premiers qui por- .
■■ * .
tèrent la lumière de l’Evangile sur les bords du Danube. Comme- Pbilostorge était lui-même Cappadocien. nous avons tout lieu ducroire que ce qu’il rapporte concernant les parents d’Ulfilas est exact, ülfîlas naquit chez les Goths, et le gothique fut la langue de son enfance, bien que plus tard il ait su parler et écrire le latin et le grec. Après avoir /
. . * . . i
rapporté la mort de Crispus (326),. et avant de raconter les/
dernières années de.. Constantin, Philostorge nous dit que
ce fut « vers cette même époque » qu’Ulfilas fit traversa ’ -. -■ ~ ^ \ le Danube à ses Goths., et les mena sur les terres de Petf-
- 9 j + - L - - - ^ - - - - < - - /
.pire romain. Les persécutions auxquelles ils étaient n
butte depuis leur conversion au christianisme les avaiiil
forcés à quitter leur patrie, et ülfilas, qui s’était mis àl/ur
(l) Sozomenus, Hisloria ecclesiastica, VJ, 6.
tête, vint porter leurs griefs aux pieds de. Constantin. Tout ceci a dû se passer avant 337, l’année de la mort de Constantin; peut-être était-ce en -328, après la victoire remportée sur les Goths par cet empereur; et bien qu’ülfilas n’eût que dix-sept ans en 328, ce ne serait pas là une raison suffisante pour rejeter le témoignage de Philostorge
qui raconte que Constantin traita Ulfilas. avec le plus -# ■grand respect, et l’appela le Moïse de son temps. Gomme
il avait fait traverser le Danube à sa bande fidèle et l’avait conduite .en Mésie, il pouvait fort bien être comparé par T empereur à Moïse qui avait fait sortir les Israélites de l’Egypte et leur avait fait traverser la mer Rouge. Il est vrai qu Àuxence établit. celte même comparaison entre Ulfilas et Moïse, après avoir raconté qu’Ulfilas fut reçu avec les plus grands honneurs par Constance, successeur de Constantin. Mais le récit, d’Auxence concerne évidemment la réception faite à Ulfilas en 348, quand il était déjà depuis sept ans évêque chez les Goths, et ne saurait infirmer enfrien le'témoignage de Philostorge concernant les relations anterieures entre Ulfilas et Constantin. Sozomène distingue nettement le premier passage du Danube par les Goths sous la conduite d’Ulfîlas, des attaques postérieures d’Athanaric contre Fridigern ou Fritiger, attaques qui amenèrent rétablissement définitif des Goths dans l’empire romain (4). Noüs devons supposer qu’après avoir passé le Danube, Ulfilas résida pendant quelque temps au inilieu de son peuple ou à Constantinople. Auxence raconte qu’il remplit d’abord les fonctions de lecteur, et qu’il ne fut sacré évêque par Eusèbe qu’en 341, quand il eut atteint Page de trente ans, exigé par les lois ecclésiastiques. Les. sept premières années de son épiscopat furent passées chez les Gotlis, et les trente-trois dernières in solo Roina-
(1) Historia eçclesiastica, VI. 3/7.
niæs où il avait accompagné Fritiger et les Thervingi. il y a une certaine confusion dans les dates des différentes migrations des Gotlis, mais il paraît fort probable qu’Ul-filas servit de guide à ses compatriotes en plus d’une occasion.
Tels sont à peu près tous les renseignements qu’il est possible de recueillir sur tllfflas. Nous ne pouvons accepter les jugements dé quelques historiens ecclésiastiques sur les motifs qui l’auraient porté à .abandonner la Toi dans laquelle il-avait été élevé, pour embrasser la doctrine d’Ârius : lui-même nous assure qu'il n’avait jamais eu d’autres croyances que l’arianisme (semper sic credidi). L’assertion de Socrate, d’après laquelle Ullilas aurait assisté au synode de Constantinople en 360, peut être vraie, quoique Æixence et Philoslorge ne fassent aucune mention de ce fait. L’auteur des Actes de Nicétas-cite Ullilas comme ayant été présent au concile 'de Nicée, en compagnie de Théophile. Il est vrai que Théophile signa les actes de ce concile, comme évêque des Golhs, .mais il.semble assez douteux qu’il fût accompagné d’Ulfilas, qui n avait à cette époque que quatorze ans.
À l’exception des livres des Rois, Ullilas traduisit toute, la Bible, l’Ancien Testament sur la version des Septante, et le nouveau sur le texte grec, mais ce leste différait un peu de celui que nous avons aujourd’hui. Malheureusement ia plus grande partie de sa traduction est perdue; il ne nous en reste que des fragments étendus des Evangiles, toutes les épîtres canoniques de saint Paul moins quelques passages, et quelques parties d’un Psaume, du livre d’Es-dras, et du livre de Néhémie (4). .
(4) Voici en quels termes Àuxence parle d’Ulfiîas ( Waitz, p. 19.) : « Et [ila praedic]ante et per Cristum cum dilectione Deo patri gralias agente, liaec et his similia exs.equente, quadraginta.annis in episcopatu gloriose ftorens, apostolica gratia Graecam et La-
Quoique Ulülas appartînt aux Golh's occidentaux; sa traduction'fut. adoptée par toutes les tribus de cette race et portée par elle en Espagne et en Italie. Le gothique s’éteignit. au neuvième siècle, et après la chute des grands em-
linam et Goticam linguam sine intermissione in una et sola ecle-sia .Cristi predicavit...... Qui et ipsis tribus linguis plures tra
cta tus et multas interpretationes volentibus ad ulilitatem et ad aediücationem, sibi ad aeternam memoriam et mercedem post se dereliquit. Quem condigne laudare non sufflcio et penitus tacere. non audeo; cui plus omnium ego sum debitor, quantum et amplius in me laboravit, qui me a prima étalé mea a paren-libus meis discipulum suscepit et sacras liiteras docuit, et verità-tem manifesta vit et per misericordîam Dei et gratiam Cristi et car-naliter et spiritaliter ut ülium suum in fide educavit.
> Hic Dei.providentia et Cristi misericordia propter multorum salutem in gente Gothorum de lectore triginta annorum episko-pus est ordina'tus , ut non solum esset heres Dei et coheres Cristi, sed et in hoc per gratiam Cristi imilator Cristi et san-ctorum ëjus, ut quemadmodum sanctus David triginta annorum rex et profeta est constitutus, ut regeret et doceret populum. Dei et filios Hisdrael, ita ët ipse beatus tanïquam profela est manifesta-tus et sacerdos Cristi ordinatus, ut règeret et'côrrigêret et doceret et aedi fi caret gentem Gothorum; quod et Deo volonté et Cristo aucsiliante per ministerium ipsius admirabiliter est adinpletum, et sicuti ïosëf inAegypto triginta annorum est manifes[tàtus èt] quemadmodum dominus et Deus nosler Ihesus Cris lus filius Dei triginta annorum secundum -carnem co'nstitutüs- et baptizatus, coepit evangelium predicare et animas hominum pascere : ita et iste san-clus, ipsius Cristi dispositione et ordinatione, et in famé et penuria predicalionis indifferenter agentem ipsarn gentem-Gothorum-secun-? dum evangelicam et apostolicam et profeticam regulam emendavit et vivere [Deo] docuit, et cristianos, vere eristianos esse, manifesta-vit et mulüplieavit. . . ■
« Ubi et ex invidia et operalione inimici thune ab inrêiigioso et sacrilego indice Gothorum lyrannico terrore in varbarico cristia-norum persecutio est excitata, ut Satanas, qui male facere cupie-bal, nolen[s] faceret bene, ut quos desiderabat prevaricatores fa-çere et deserlores, Cristo opitulaute et propugnante, fièrent martyres et confessores, ut persécuter confunderetur, et qui persecu-tionem patiebantur, coronarentur ut hic, qui temtabat vincere, victus erubesceret, et qui temtabanlur, vie tores gauderent. Ubi et post multorum servorum et ancillarum Cristi gloriosum martyrium, imminente veliementer ipsa persecutione, conpletis septem annis tanlummodo in episkopalum, supradictus sanctissimus. yir bealus ülfila cum grandi populo confessorum de varbarico pulsus,
pires fondés par ces barbares, la traduction d’UMIas fut perdue et oubliée. Blais on en avait conservé un manuscrit du cinquième siècle dans l’abbaye de Werden, et vers la fin du seizième siècle, Arnold Mercator, attaché à.la maison de Guillaume IV, landgrave de liesse, tira de l’oubli ce vieux parchemin qui contenait de grands fragments de la traduction d’XMlas. Ce manuscrit, connu sous le litre de Cod.ex argenteus, fut plus tard déposé à Prague, et lors1 que le comte Kônigsmark.s’empara de celte ville en 1648, il emporta le précieux manuscrit'.à Upsaî, en Suède, où il
. in solo Komanie a thu[n]c beate memorie Constantio principe ho-norifice est susceptus, ut sicuti Deus per Moysem de poLenlia et violenüa Faraonis et Egypiorum pofpulum "s]uum 3[iberav]it [et .rubrum] mare transire feeit et sibi servire providit, ita et per sepe dictum.Deus confessores sancti filii sui unigeniti de varbarico libe-ravit et per Damibium transire fecit, et in montibus secundum .
sanctoruni imitationem sibi servire de[crêvit]...... eo populo in
solo Romaniae, ubi sine illis septem annis triginta et tribus annis veritatem predicavit, ut et in hoc quorum sanélorum imita tor erat [similis essel], quod quadraginta annorum spàtiûm et tempus ut multos. :. :.r‘ê étï... r an[h]drum..i. ."e vila. ...»\ t 'Qù[i] c[um] precepto imperiali, completis quadraginta annis, ad Conslantino-
politanam urbem ad disputationem.. :.. contra p.....ie [p]. Estas
perrexit et eundo in.... .nn.... .ne.... .p.....ecias sibi ax.... .to
docerenl et contestarent[ur]..... abat, et inge.e..... supradictam
[ci]vitateim recogilato ei-im----. de statu concilii, ne arguerentur
miseris miserabiliores, proprio judicio daixmati et perpetuo suppli-cio plectendi, stalim cœpit inflrmari ; qua in infîrmilatè susceptus est ad similitudinem Elisei prophète. Cônsiderare modo.oportet meritum viri,qui ad hoc duce Domino obit Constantinopolim, immo vero Cristianopolim, ut sanctus et immaculalus sacerdos Cristi a sanctis et consacerdotibus, a dignis dignus digne [per] tantam mul-titudinem cristianorum pro meritis [suis] mire et gloriose honora-retur. » — (Bessell, p. 37.) .
« Unde et cum sancto Hulfila ceterisqüe consortibus ad alium comitalum Constantinopolim venissent. ibique eliam et iropera-tores adissenl, adque eis promissum fuissel coneiflijum, ut sauctus Aux[en]tius exposuil , [a]gnita promiss[iô]ne prefaLi pr[ejpositi hereticfi] omnibus viribu[s] instilerunt u[l] lex daretur, q[uæ] concîlium pro[hi]beret, sed nec p[ri]valim in domo [nec] in pu-blico, veî i[n] quolibet loco di[s]pulalio de ûde haberetur, sic[ut] textus iridicat [le]gis, etc- » (Waitz, p. 23 ; Bessell, p. 15.)
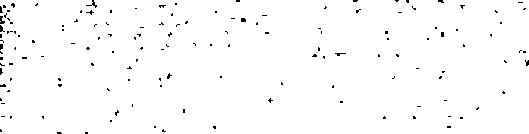
\
- -V.
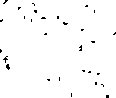
. CINQUIEME LEÇON
' -c
est encore conservé comme un trésor d’un prix inestimable. Le parchemin est pourpre, les lettres d’argent, et la reliure en argent massif. . ■
. - ' r
- En 1818, le cardinal Mai et le comté Castiglione découvrirent d’autres fragments de la Bible d’Ulfilas dans le monastère de Bobbio, où ils étaient sans doute restés depuis la destruction de l’empire goth de Théodoric le Grand en Italie. . .
«■ S
ülfilas a. dû être un homme d’une.rare vigueur d’esprit pour-avoir eu, le premier, l’idée de traduire la Bible dans
la langue vulgaire de son peuple. De son temps, il n’exis-
. P - * ■ m * ,
tait en Europe que deux langues qu’un évêque chrétien dut se croire autorisé à employer, le grec et le latin : toutes les autres passaient encore, pour barbares. Il fallait un pressentiment des glorieuses destinées de ces tribus demi-sauvages, et de la chute prochaine des empires de Rome et de Byzance, pour qu’Ulfilas se décidât à traduire la
‘ s ’ ’ , t
Bible dans le dialecte vulgaire des barbares, ses compatriotes. Peu de temps après sa mort, le nombre des Goths. chrétiens avait tellement augmenté dans la capitale de l’empire que saint Jean-Chrysoslome, qui occupa le siège de Constantinople de 397 à 405, leur üt bâtir une église où le service devait se faire en langue gothique (1).
La langue d’Ulfilas se rattache par sa structure phonétique à la classe du bas-allemand, mais, à peu d’exceptions près, sa grammaire est bien plus primitive que l’anglo-saxon du Beowulf, ou que l’ancien haut-allemand de Charlemagne. Toutefois ces exceptions sont fort importantes, en ce quelles prouvent que la grammaire, non moins que l’histoire, nous empêche de dériver soit l’anglo-saxon soit le haut-allemand du gothique (2). Ainsi, pour
(t) Theodoret, H. EY, 30. .
(2) Pour des exemples de formes plus primitives en ancien haut-
\

222 LEÇONS SUR LA. SCIENCE Dü LANGAGE. .
, . . ^ _ i , .
* - T ' " - -
ne citer qu’un exemple, il serait impossible de regarder la première personne du pluriel de l’indicatif-présent, l’ancien haut-allemand nerjamês, comme une corruption du gothique nasjam; car nous savons par le sanscrit masi, le grec mes, le latin mus, que c’était bien là la désinence originelle de la première personne du plu-, rieL .
Le gothique n’est qu’un des nombreux dialectes parlés parla race germanique, dialectes dont quelques-uns ont fourni les matériaux des langues littéraires de la Grande-Bretagne, de la Hollande, de la Frise, et deda haute et ■ basse Allemagne, tandis que d’autres ont complètement disparu, et que d’autres encore ont continué leur cours à travers les âges,, sans être connus même- de nom, et sans
i . .
avoir jamais produit une œuvre littéraire. C’est parce que le gothique est le seul de ces dialectes que nous puissions faire remonter jusqu’au quatrième siècle, tandis que nous perdons tous les autres de vue dès le septième, que certains.linguistes l’ont regardé à tort comme la source de ' tout le langage teutohique. Mais les arguments dont nous nous sommes servis contre Jtaynouard, pour prouver que la langue provençale n’a pas pu être la mère des six dialectes romans, s’appliquent avec non moins de force à la langue gothique et nous empêchent de lui assigner d’autre rang, parmi les langues teutoniques, que celui d’une sœur aînée. • .
Il y a même une troisième branche du langage leutoni-que, dont l’existence indépendante est aussi bien constatée que celle du bas et du haut-allemand, et qui a dû nécessairement se. développer parallèlement à ces deux
allemand qu’en gothique, V. Schleieher, Zeitschrift fur 7.. S,/t. IV, p. 266 : Bugge, ibid,, t. Vj p. 69; Pott, Êiym. ForschII, p. 67, note. ■ . ' '
dialectes et au gothique. Je veux parler de la brandie Scandinave, qui côniprénd. actuellement trois dialectes littéraires, ceux de la Suède, du Danemark et de l’Islande, et divers dialectes locaux que l’on trouve surtout dans les vallées retirées de la Norvège dont la langue littéraire est Je danois (1). t ' .
On suppose communément que jusqu’au onzième siècle l’idiome parlé en Suède, en Norvège et en Danemark
était identiquement le même, et que cette langue nous a
- » +. 1 ^ ' .
été conservée presque intacte en Islande, tandis qu elle s’est modifiée en Suède et a fini par j former deux nouveaux dialectes nationaux (2). Effectivement il est hors de doute que le scalde islandais récitait ses poëmes en Islande, en Norvège, en Suède, en Danemark et même devant ses compatriotes établis en Angleterre et à Gardariki (3), sans avoir à craindre de ne pas être compris, jusqu a ce que, nous dit-on, Guillaume eût introduit le gallois, c’est-à-dire le français, en Angleterre, et que les langues slaves eussent envahiTest de l’Europe (4). Néanmoins,; quoique une même langue (appelée alors danois ou norrain) pût être intelligible dans ces diverses contrées, je doute fort
(1) V. Schleicher, Deutsche Sprache, p. 94. .
(2) V. id., 1. c., p. 60. . ..
(3) [Le Garderige on royaume des Gaarde (Gaard au singulier signifiant une cour, la curtis des Mérovingiens, —la cour de nos Normands actuels, c’est-à-dire Une maison ou plusieurs maisons d'habitation, avec verger et clôture ; •— par extension sans doute ici bourgs, villages habités ; peut-être pays, contrées; le royaume des pays, qui comprend les pays) faisait une partie importante de ce que les habitants de la péninsule et de l'Islande, aux dixième,. onzième, douzième et treizième siècles, appelaient les pays de l’Est, j QEsterlanden, ou OEsterleden. C'est à peu près ce qu’on a appelé: ensuite la Grande et la Petite Russie. Cf. Werlauff, Symbolæ ad geo-graphiam medii ævi, et Suhm, Dànemarks Historié, première partie, p. 86 et seqq. Tr.) ,
(4) Weinhold , Allnordisches Leben, p. 27;» Gunnlaugssaga,
ch. yii. ‘ .
LEÇONS SUR LA SCIENCE DU LANGAGE.
qûe tous les Norlhmans aient jamais parlé un seul et même idiome, et il me paraît très-probable que les premiers germes du suédois et du danois existaient déjà, bien avant le onzième siècle, dans les dialectes des nombreuses tribus de la race Scandinave. Cette race se divise en deux branches--bien distinctes, celle des Scandinaves, de l’est, et celle des Scandinaves deTouest, ainsi que les appellent les savants suédois.; l’idiome des premiers serait représenté par l’ancienne langue de la Norvège et de l’Islande, et celui des derniers par le suédois et le danois. Celte séparation des peuples Scandinaves avait précédé leur établissement en Suède et en Norvège. Les Scandinaves . occidentaux, s’étant embarqués sur la côte de Russie, naviguèrent vers l’ouest , traversèrent la mer Baltique en passant par les îles d’Àland, et s’établirent ensuite sur. la cote méridionale, de la Suède; tandis que leurs frères
„ T . , . . k.- " - J '
longèrent le golfe de. Bothnie et arrivèrent par le pays-, des Finnois et des Lapons jusqu’aux • montagnes du nord de la péninsuie, d’où ils se répandirent au sud et a
l’ouest. . ,.. ; . ... .. .. .. • ... ,\. . •
- Les plus anciens fragments du langage Scandinave nous sont conservés dans les deux Eddas, i’Edda poétique composé de vieux poèmes mythiques, et i’Edda de Snorri, qui est de date plus récenie et qui résume en prose les récits de l’ancienne mythologie.. Les deux Eddas furent
. ■ é _ * * * _ ^ m '
. <
tu
r » h r*
' i ■ '
/
N - '
composés, non en Norvège, mais en Islande. L’Islande est une île à peu près de la grandeur de l’Irlande;-'elle: fut révélée à l’Europe par quelques moines; irlandais qui s’ÿ établirent au huitième siècle (1). Au neuvième siècle (860-870), Naddoda, Gardar et Fokki firent: en Islairdë des voyages de découverte, et bientôt cette île lointains servit
L t/ - W . ■ - ‘ , - '
d’asile aux républicains de la péninsule Scandinave,
(l) Y. Basent, Burnt Njal, Introduction.
. CINQUIEME- LEÇON. : '
h) . -
comme plus lard l’Amérique aux Puritains de l’Angleterre. Après avoir vaincu la plupart des rois norvégiens, Harald Haarfagr (850-933) conçut le projet d’asservir les populations libres du nord de la Norvège. Ceux qui étaient trop faibles pour lutter contre lui ou trop fiers pour accepter sa domination, quittèrent leur patrie et émigrèrent en France, en Angleterre et en Islande (874). C’étaient, en grande partie, des nobles et des hommes de condition libre, et ils ne lardèrent pas à établir en Islande une république aristocratique ; c’était la forme de gouvernement sous laquelle iis avaient, vécu dans leur pays avant le temps de Harald. La petite république fut bientôt florissante, ■ et les Islandais embrassèrent le christianisme en l’an 4000. Ils fondèrent, des écoles, érigèrent deux évêchés, et apportèrent-à l’étude de la littérature classique la même ardeur que les savants et lès historiens de leur patrie avaient mise à réunir et à interpréter leurs dois et leurs poèmes nationaux. Ils se distinguèrent aussi par l’amour des. voyages, et non-seulement les principales villes de l’Europe mais encore les saints lieux étaient visités par ces voyageurs hardis. Au commencement du douzième siècle, la population de l’Islande s’élevait à cinquante mille habitants.
t .
Leur activité intellectuelle et littéraire dura jusqu’au commencement du treizième siècle, quand l’île fut conquise par Hakbn YI, roi- de Norvège. En 4 380, la Norvège et l’Islande furent réunies au Danemark; et lorsqu’en 4844-la Norvège fut cédée à la Suède, le Danemark conserva l’Islande qui lui appartient encore de nos jours.
La vieille poésie qui florissait en Norvège au huitième siècle, et qui fut cultivée par les scaldes au neuvième, eût disparu à tout jamais sans les soins jaloux des émigrés d’Islande. La branche la plus importante de leur poésie
15
traditionnelle se compose de courts chants qu’ils appelaient ou Quida, et qui célèbrent les gestes de leurs dieux ou de leurs héros. Quelle est la date précise de ces vieux poëmes, c’est ce qu’il nous est impossible de déter-minèr ; mais nous savons du moins qu’ils existaient déjà avant l’émigration des Norvégiens en Islande, et il paraît même probable qu’on peut les faire remonter jusqu’au septième siècle, date de nos plus anciens fragments d’anglo-saxon et de haut et de bas-allemand. Ces chants furent réunis vers le milieu du douzième siècle par Saemund Sigfusson, qui mourut en 'H33. En 1643, un recueil du même genre fut découvert dans des manuscrits dû-treizième siècle et fut publié sous le titre d’Edcla ou l’Àïeulè. Ce recueil est' appelé l’ancien Edda ou l’Edda en vers, pour le distinguer d’un ouvrage plus récent attribué àSnorri Sturluson (mort en 4341), et appelé l’Edda en prose. L’Edda de Snorri se compose de trois parties : la fascination de Gylfi, les discours de Bragi, et le Skalda, ou. Art poétique. Le titre d’Hérodote de VIslande a été donné à Snorri Sturluson/ dont l’ouvrage principal, le Eeimsknngla- ou Cercle du monde, contient i’histoirè des peuples Scandinaves depuis les âges mythiques jusqu’au temps du roi Magnus Erlingsson qui mourut en'M 77. Ce fut probablement pendant qu’il, était occupé à réunir les matériaux de cette histoire, que Snorri Stur-luson, comme Cassiodore, Saxo Grammaticus, Paul Diacre et d’autres historiens de la même famille, recueillit les vieux chants.de son peuple; car son Edda, et en particulier le Skalda, sont pleins de fragments des anciens poëmes. ... ...
Le Skalda et les règles qui y sont données sont une image fidèle des poëmes du treizième siècle; et on ne peut rien imaginer de plus artificiel, ni qui rappelle moins la poésie naturelle et vraie de l’ancien Edda que
cet Art poétique de Snorri Sturlüson. 'Une des règles fondamentales de cette poésie artificielle, c’est que rien ne doit y être appelé par son nom. Les scaldes ne devaient pas parler d’un navire, mais de la bête de la mer ; ni du sang, mais de .la rosée de la douleur, ou de. Veau que fait jaillir le glaive.. Un guerrier lie s’appelait plus que Varbre armé,;.l’arbre de la bataille; et l’épée était remplacée par la flamme qui blesse. Cette langue poétique, ; qui était le langage obligé de tous lés scaldes, ne possédait, pas moins de cent quinze noms pour Odin, et de cent vingt synonymes pour signifier une île.' Les extraits poétiques cités par Snorri sont pris dans les poèmes des scaldes qui vécurent du dixième au; treizième siècle, èt dont: les : noms sont bien connus dans l’histoire. Jamais il ne cite aucun des chants contenus dans l’ancien Edda (1),: soit qu’il les considérât comme appartenant à une époque littérairej.' beaucoup plus ancienne et toute différente, nu.qu’ils, né pussent servir d’exemples pour éclaircir les préceptes poétiques des scaldes, puisque rien n’eût été plus propre à confondre ces préceptes . que la. simplicité de. la poésie nationale qui ' exprimait toutes ses pensées sans effort et sans circonlocution.
Nous avons donc rattaché les dialectes teuloniques modernes à quatre rameaux principaux : le haut-allemand, le bas-allemand, le gothique et le Scandinave, lesquels, ainsi que plusieurs idiomes moins importants, ont dû se
■ 4 ■ s
développer parallèlement dès le commencement, comme
, ' * w
(1) Le ïiôm.d'Eddâ ne se'rencontre pas avant le quatorzième siècle. Snorri Sturluson ne connaît ni le mot Edda, ni aucun recueil d’anciennes poésies attribué à Saemünd ; et quoiqu’il soit possible que Saemund ait été le premier à réunir les chants nationaux, il semble douteux que nous devions le regarder comme l’auteur du recueil qui porte aujourd’hui son nom.
autant de variétés du langage teutonique. On peut, pour plus de commodité, parler de ce langage comme ayant eu une existence individuelle, et comme formant une branche de cette grande famille indo-européenne à laquelle nous avons vu qu'il appartient; mais il ne faut pas oublier que ce langage primitif et uniforme n’a jamais eu d’existence historique qui puisse être l’objet de nos recherches ; aussi loin que nous puissions remonter dans son passé, la langue des peuples germaniques, de même que toutes les autres, nous apparaît comme débutant par des dialectes qui ont formé, avec le temps, des langues nationales distinctes. •
11 nous faut maintenant laisser de côté les recherches minutieuses, et nous contenter de jeter un coup d’œil rapide sur les langues qui composent, avec la branche teutonique, la grande famille indo-européenne ou aryenne.
Prenons d’abord les langues romanes ou néo-latines. Sans parler des dialectes locaux, nous avons à présent six modifications littéraires du latin ou plutôt de l’ancien italien: les langues du. Portugal, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de la Yalachie (1), et celle des G-risons
(I) Les populations que nous appelons valaqnes s’appellent elles-mêmes Romani, et leur langue Romania.
Cette langue romane est parlée en Yalachie, en Moldavie, et dans certaines parties de la Hongrie, de la Transylvanie et de la Bessarabie. Sur la rive droite du Danube, elle est répandue dans une partie de l’ancienne Thrace, de la Macédoine et même de la Thes-saiie. Elle est divisée par le Danube en deux rameaux, celui du nord ou le.daco-roumain, et celui du midi ou le macèdo-roumain ; le premier est resté plus pur et a même reçu une certaine culture littéraire ; le second a emprunté un plus grand nombre de mots albanais et grecs, et sa grammaire n’est pas encore bien fixée. La langue valaque moderne est fille de l’idiome parlé dans la province romaine de la Dacie. .
Les premiers habitants de la Dacie étaient des Thraces, et leur langue était l’illyrien. De cet ancien illyrien il nous reste à peine
N
de la Suisse, connue sous le nom de romanche ou rouman-
che (4). Le provençal qui est arrivé de très-bonne heure,
# "
dans les poésies des troubadours, a un haut degré de per-
quelques débris, et ceux que nous avons sont tout à fait insuffisants pour déterminer à quelle famille de langues nous devons le rattacher. Les Romains s’emparèrent de l’illyrie en l’an 219, et de la Mésie en Pan 30 avant Jésus-Christ ; en l’année J 07 de notre ère, l’empereur Trajan. fit de la l)acie une province romaine. A cette époque la population thrace avait dû se retirer devant - les tribus sarmates, surtout devant les lazyges. Les colons romains apportèrent avec eux la langue latine, et la Dacie resta colonie de l’empire jusqu’en 272, quand l’empereur Aurélien dut la'céder aux Goths, et alors une partie de la population romaine émigra et alla s’établir au sud du Danube. .
En 4S9, les tribus slaves entrèrent en Mésie et en Thrace. Nous les trouvons définitivement établies dans la Mésie en 678, et quatre-vingts ans plus tard une province fut fondée en Macédoine sous le nom de Slavinie< . .
., [Moins connus quedeurs frères des Principautés danubiennes, ces Valaques de l'Olympe, du Pindè et de i’Acarnanie seraient très-curieux à étudier, et pour leur langue et pour leurs usages ; sans doute dans leur idiome se sont introduits bien des mots étrangers, dus au contact des populations parmi lesquelles ils errent depuis des siècles ; mais là où ils emploient le vieux mot roumain, il est souvent plus rapproché de sa forme primitive, plus voisin du mot latin correspondant, que dans le valaque des rives du Danube, modifié par le travail réfléchi des écrivains et soumis d’ailleurs à des influences de voisinage qui se sont exercées d’une manière plus régulière et plus suivie. La cérémonie du mariage a conservé des rites qui reproduisent avec une singulière fidélité quelques-uns des traits les plus frappants des antiques s}Tmboles de l'Italie ; ainsi, à l’instant où la jeune femme, descendue de sa monture, va entrer dans la maison de son époux, on lui présente du beurre ou quelquefois du miel, et elle en frotte la porte, marquant ainsi que sa venue amènera dans la maison douceur et joie; c’est Vuxor romaine, « quasi unxoi\ » dit Servius, « quod moris erat, ut nu-ben tes puellæ, simul venissent ad limen marin, postes, antequam ingrederentur.oleo ungerent. » Sur ces Valaques -du Pinde, qui, au douzième siècle, avaient fait donner à la Thessalie le nom de Grande Vlakhie% voir Pouqueville, Voyage de la Grèce, t II 1. 6, et surtout L. ïïeuzey, le Mont Olympe et V Acarnanie, pp. 267 et 280. Leur langue a été étudiée dans l'ouvrage intitulé : Golinlizanu, ÇalUorii Romanéi din Macedonia sin muntele À tos san Santa
Agora. Tr.] . '
_ , „ ’■
(1) Le romanche ou roumanche, idiome des Grisons, est parlé
leçons suit la science dü langage. .
- . ^ ■
fection littéraire,-n’est plus de nos jours qu’un simple patois ('1 ). On rapporte généralement au dixième siècle le plus ancien poème provençal, le Chant de Boèce, que Lebeuf faisait remonter seulement au onzième. Mais la découverte récente du Cantique de Sainle-Eulalie nous a donné un monument de la langue d’oïl, ou ancien français du nord, antérieur aux plus vieilles poésies que nous possédions en langue d’oc-, l’ancien provençal (2). Une des meilleures préparations à l’étude de la grammaire comparée des langues classiques de la famille aryenne, est la lecture attentive de la Grammaire comparée des six langues romanes, par le professeur Diez (3).
Bien qu’il soit possible, d’une manière générale, de faire remonter au latin ces six idiomes romans, nous dans la vallée de l’Inn, PEngadine, el dans la vallée du Rhin, l’Ober-land. Les habitants de PEngadine sont protestants ; ceux de l’Ober-land, catholiques. Le dialecte des premiers est appelé le rouman-che : celui des derniers, le ladinique. Il y a toute une littérature religieuse du .seizième siècle, qui consiste surtout en traductions de la Bible, en catéchismes et en cantiques. La bibliothèque bodiéienne possède une Iraduction du Nouveau-Testament dans cet idiome : « L’g Nuof Saine Testamaint da nos Signer Jesu Christi, prais our delg Latin et our d’oters laungüax et huossa da nœf mis in Aru-mannsch très Jachiam BiiTum d’Agnedina. Schquïscho ilganMDLX.» La société biblique a publié une traduction complète de la Bible dans chacun de ces dialectes.
(1) [Les principaux dialectes du provençal nous ont offert, dans ces derniers temps, le curieux spectacle d’une véritable renaissance littéraire, d'une floraison nouvelle aussi brillante qu’inattendue. Il suffira de citer ici deux noms que le succès d’œuvres écrites en languedocien et en provençal a rendus célèbres dans la France entière, Jasmin, le perruquier d’Agen, et Mistral, l’auteur de Mi-rèio. Tr.] . . .
(?) [Voir aussi, dans la Bibliothèque de B Ecole des hautês études (Viesveg), le septième fascicule, la Vie de saint Alexis, textes des onzième, douzième, treizième cl quatorzième siècles, publiés par G. Paris et L: Pannier. Tr.] ‘
(3) [MM. Gaston Paris, Auguste Bracbet et Môrel-Fatio ont entrepris de donner de cet ouvrage une traduction française. Le tome Ie a paru en 1873, le tome II en 1874. Tr. J ’
avons cependant déjà fait observer que le latin classique ne saurait nous fournir l’explication complète de leur origine. C’est dans les anciens dialectes, de l’Italie et de ses provinces, qu’il faut chercher beaucoup des éléments des langues néo-latines. Avant la fondation et l’agrandissement de Rome, plus d’un dialecte du latin était parlé en Italie, et des inscriptions nous ont conservé des fragments importants de l’ombrien, parlé au nord, et de l’osque, parlé au sud de Rome. L’osque, qui était l’idiome des Samnites, et que nous comprenons aujourd’hui, grâce aux travaux de Mommsen, avait produit" une littérature avant le temps de Livius Andro.nicus .(4); et les tables d’Igu-
viura, qu Àufrecht et Kirchhoff ont étudiées avant tant de
. ' ■ *
science, et de persévérance, nous prouvent qu’il j avait une littérature sacerdotale chez les Ombriens à une époque très-reculée. L’osque était encore" parlé sous les empereurs romains,.et il en était de même, d'autres dialectes locaux moins importants au sud et au nord de l’Italie. Le moment où la langue littéraire de Rome devint classique et immuable fut le commencement d’une ère nouvelle pour ces dialectes, qui, même au temps de Dante, sont encore appelés vulgaires ou populaires (2) : c’est à partir
(t) [La dernière édition anglaise des Leçons sur la Science du Langage était déjà imprimée. quand a paru l’œuvre capitale de M. Michel Bréal, qui pousse plus loin qu’on ne l’avait fait jusqu’à lui le déchiffrement des tables eugubines et n’en laisse inexpliqués que bien peu de mots. L’ouvrage a pour titre : Les Tables eugubines, texte, traduction et commentaire, avec une Grammaire et mie Introduction historique, Vieweg, 1875, grand iu-b°. 11 est accompagné d’un album in-40 qui contient quinze planches où les tables sont reproduites, d’après des photographies, par le procédé héhogra-phique de Dujardin. Ti\] .
(2) « E lo primo, che cominc.io a dire siceôme poêla volgare, si mosse perô che voile fare intendere le sue parole a donna, alla quale era malagevole ad intendere versi latini. » — Daine, Vita ,nuova\ opéré mineri di Dante AlighieH, t. 111, p. 327. Fi-reiize, 1837. , - ,
s
de cet instant que commencent à sè développer ces idiomes néo-latins. Yoici, je n’en doute pas, la principale cause de l'apparente dégradation que présentent ces idiomes, tels qu’ils s’offrent à nous soüs la forme la plus ancienne que nous puissions atteindre, vers le huitième siècle ; ce sont bien des dialectes néo-latins adoptés par des barbares d’origine teutonique, et, par conséquent, ayant subi l’influence de ceux qui se les étaient appropriés ; on y trouve en abondance non-seulement des mots, mais des phrases, des constructions et des idiotismes teutoniques. Le français est du latin de province qui a passé par la bouche des. Francs, une des races tectoniques; et celle même influence du parler barbare s’est fait sentir, bien qu’avec moins de force, dans tous les autres dialectes romans. Fl me paraît certain aussi que le fond primitif des langues néo-latines n’était.pas lé latin, classique, mais les dialectes vulgaires et locaux qui étaient parlés dans les provinces, par la bourgeoisie et parles basses.classes de l’empire romain. Beaucoup de ces expressions qui donnent au français et à l’italien leur air de ressemblance avec le latin classique, sont des importations bien plus récentes des savants, des jurisconsultes et des théologiens du moyen âge, qui traitèrent les
% ?
mois latins avec plus de respect que les conquérants teutons n’en avaient eu pour les dialectes populaires qu’ils s’étaient appropriés (1).
Cl) [Un phénomène qu’il importe de signaler, c’est que, dans les idiomes néo-latins qui ont reçu une culture littéraire très profonde, et particulièrement en français, le même mot latin se trouve parfois avoir produit deux dérivés, l’un populaire et souvent en apparence presque méconnaissable, l’autre introduit de propos délibéré dans la langue par quelque savant ou écrivain des trois derniers siècles, et différant à peine du mot latin par le changement de la finale. Ge qui est curieux, c’est que, dans le dérivé populaire, quelque altéré et défiguré que le mot. puisse sembler à l’œil le plus expérimenté,
Nous passons maintenant à une autre branche de la famille indo-européenne, la branche hellénique dont l’his-loire nous est bien connue depuis le temps d’Homère jusqu à nos jours. La seule remarque que la philologie comparée ait à faire sur les idiomes de la Grèce, c’est qu’il serait encore plus- absurde de vciuloir regarder la langue grecque comme mère du latin, que de dériver l’anglais de l’allemand ; en effet, nous trouvons en latin beaucoup de formes plus primitives que les formes correspondantes en grec. L’ancienne hypothèse,, d’après laquelle les Pélasges. auraient été les ancêtres communs des Grecs et des Romains, -n’èst' Mtre chose ' qu’un mythe grammatical qui ne demande plus aujourd’hui de réfutation sérieuse.
La quatrième branche de notre famille est celle des
la tradition de l’accent latin est toujours fidèlement gardée, et la syllabe qu'il frappait conservée et mise en relief ; dans le dérivé moderne, au contraire, dans l’emprunt réfléchi et savant, le mot français étant tiré du latin écrit et non plus du latin parlé, Paccént français passe sur une sjdlabe qui, le plus souvent, en latin, n’était qu’une finale sur laquelle glissait la vois. Supposé que le latin fût oerdii, et que nous connussions seulement, par des grammaires bien faites, les règles de dérivation telles que les ont appliquées chacune des langues néo-latines, il serait en quelque sorte plus facile de remonter au mot latin à l’aide des dérivés anciens et spontanés qu’à l’aide des dérivés réfléchis et modernes. Sur ces deux procédés, sur leurs résultats différents, et sur ce qu’ils ont donné à notre langue, voir Egger, Notions élémentaires de grammaire comparée, p. 166 et note 99, et,.du même auteur, les Observations sur im procédé de dérivation très fréquent dans la Langue française et dans les autres idiomes néo-latins (Mém. Acad. Inscr:2e partie). Cette distinction avait déjà été reconnue et signalée par Catherinot, dans l’opuscule, aujourd’hui très-rare, qui a pour titre : les Doublets de lu langue, Bourges, 4683. M. Siméon Luce prépare un dictionnaire complet des doublets de notre langue, dictionnaire dont il a donné la préface dans le Journal général de Vinstruction publique. -29 aviil et 4 8 mai 4863. — Nous ne pouvons parler du rôle qu’a joué laccent latin dans la formation de la langue française, sans citer le remarquable travail où M. Gaston Paris a approfondi ceLte question. Dans son Elude sur le rôle de L'accent latin dans la langue française, l’auteur a consigné les plus importantes découvertes de ses devanciers, en y joignant de précieuses recherches personnelles. Tr.]
P ^ * s . , ■ . __ langues celtiqiies (4). Les Celtes semblent avoir été les
premiers Aryens qui soient arrivés en Europe; mais les migration s subséquentes, celles Surtout des tribus teuto-niques, les ont constamment refoulés vers l’Occident, et, de nos- jours encore, les Celtes d'Irlande traversent d'Atlantique a la rechercbe d’une nouvelle patrie. Les seuls dialectes celtiques qui se soient conservés jusqu’à nous sont le kymri et le gadhélique. Le kymri comprend le gallois, parlé dans le pays de Galles, le. comique qui s’est .éteint, il y a peu d’années, et Y armoricainparlé dans la Bretagne: française. Le Gadhélique comprend Y irlandais, le gaélique parlé sur la côte occidentale de l’Ecosse, et le manx, dialecte de Vile de Man. Quoique ces langues celtiques soient encore vivantes, les Ce!tes eux-mêmes ne peuvent plus prétendre à former une nation indépendante, comme la race germanique ou slave.:Xj fut cependant un temps où les. Celtes jouissaient de l’autonomie politique ; les Germains et les Romains tremblèrent plus d’une fois devant, leurs armées victorieuses. La Gaule, la. Belgique et la Bretagne leur appartenaient, et ils formaient la majeure partie de la population du nord de l’Italie. Au temps d’Hérodote, nous trouvons des Celtes en Espagne/; et la Suisse, le ïyrol et les contrées au sud .du Danube furent, aune époque, les demeures de tribus celtiques. Mais, après avoir fait de fréquentes incursions dans les contrées qui étaient alors le siège de la civilisation, incursions qui familiarisèrent les écrivains grecs et latins avec lés titres que portaient alors leurs rois, ils disparaissent
(1) Le nom dé Celte est un mot cellique. César le dit expressément : Qui ipsorum lingua Celtæ, nostra Galli appellanlur. Les Grecs ein puaient les deux formes K^tki et KeXtol. 11 se peut que, dans l’ancien idiome de la Gaule, le mot Kel-tos ait signifié « élevé, droit, fier, » comme le latinceIsus et excelsus. Voir Gluck, dans les Beilræge de Iîuhn, vol. v,.p. 97. .
entièrement de Test de l’Europe. On suppose que Bren-nus signifiait roi, et on l’a identifié avec lé gallois brennin,. Uo Brennus se rendit maître de Rome 390 avant J.-C.; un autre: Brennus menaça Delphes en 280. Ter s. cette même époque, une colonie celtique s’établit en Asie Mineure, dans la Galatie, où Eididme parlé au temps de S. Jérôme était encore celui des Gaulois (i). Il se trouve certainement des mots celtiques.en allemand, en slavon et. même en latin, mais il n’v ont été admis que comme des-termes étrangers, et le nombre en est bien moindre qu’on ne le suppose communément. Un nombre beaucoup plus considérable de mots latins et allemands se sont intimduits, avec le temps, dans les dialectes celtiques modernes, et ont été pris par certains enthousiastes des études celtiques pour les types originels de ces mêmes mots, que le latin "eti’ailemand auraient primitivement empruntés au fonds celtique. : : : • : '
La cinquième branche des langues aryennes, qui est ordinairement appelée la branche slave, me paraît être
désignée plus exactement par le nom de windique, le
: . _ *
terme winidœ étantune des appellations les plus anciennes et les plus générales qui servent aux premiers histo^ riens de l’Europe pour désigner les tribus. dont nous avons maintenant à nous occuper. Nous devons diviser ces peuples en LeUes et en Slaves, et subdiviser ces der-
f _ N ■%.
nièrs en Slaves du sud-est, et en Slaves de l ouest. . »
Le rameau lette se compose de langues qui ne . sont
(1 ) [La persistance de l’idiome celtique en Galatie jusqu’au quatrième siècle de notre ère ne repose que sur le témoignage de saint Jérôme, qui ne parait pas avoir jamais visité cette province; c’est là un fait singulier, que plus d’un indice semble contredire; on peut craindre que saint Jérôme n’ait été trompé par quelque assertion inexacte, ou qu’il, n'ait confondu les époques. Voir G. Perrot, De Gala lia provincia, (Paris, 1866, in-S°) in fine. .Tiv] .
guère connues des littérateurs, mais qui sont p]eines d’intérêt et d’une grande importance pour le linguiste.
' ' - * ' v " ' " " ' ■ , %F , ■ , 1 . " ' ' -
Le lette est parlé aujourd’hui dans la Courlande et dans la Livonie. Le lithuanien est l’idiome d’une population d’environ 200,000 âmes dans la Prusse orientale, èt de plus d’un million dans les parties limitrophes de la Russie. Le plus ancien monument écrit du lithuanien est un petit catéchisme composé en 1547 (1). Dans ce catéchisme, et même dans le parler actuel du paysan lithuanien, nous trouvons quelques formes grammatical es plus p rimitives, et qui avoisinent plus le sanscrit que les formes corrélatives en grec et en latin.- :
. U ancien prussien, qui se • rapprochaitbeaucoup du lithuanien, s’est éteint au dix-septième. siècle, ne nous laissant dautre monument écrit qu’un vieux catéchisme.
Le telle, ainsi que nous venons de le dire, est l’idiome de la Courlande et de,la Livonie : sous le rapport de la grammaire, il est beaucoup plus moderne que le lilhuè*-nien, dont cependant -il ne. dérive pas immédiatement.. ..
Nous’ arrivons maintenant aux langues slaves proprement dites, qui se divisent en deux .rameaux distincts, ainsi que nous l’avons fait observer un peu plus haut.. Le
rameau oriental comprend le russe avec divers dialectes;
* , + ■
; locaux,de bulgare et Yillyrien. Le plus ancien document de ce groupe de langues est la version de la bible en ancien bulgare, appelé aussi quelquefois le slave ecclésiastique, faite par Cyrille et Méthodius au milieu du neuvième siècle, et qui.est encore adoptée aujourd’hui par toute la race slave (2). Dans l’étude des langues slaves, l’ancien
■ , - . r J - r - -Z '*■ ' p, H t - - -■ ’ t - - — +■■ - -■ "
(•]) Schleiclier, Beiiræge, ï, 19. •
(2) Le plus ancien manuscrit de celle traduction qui porte une date est celui qui fui écrit en -1056, pour le prince Ostromif. Il en existe cependant d’autres plus anciens, écrits en lettres glagolitiqucs; Schleiclier, Btilræge, vol. I, p 20.
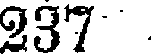
bulgare occupe le même rang et donne les mêmes lumières que le gothique dans l'étude des langues germaniques.. Le bulgare moderne, au contraire, est le plus pauvre en formes grammaticales de tous les dialectes de cette classe.
: Villyrien est un. nom plus ou moins commode pour comprendre le serbe, le croate et le slovénien. Du Slovénie)! , il nous reste des fragments qui remontent au dixième siècle (1). . : . \
Le rameau occidental des langues slaves comprend les dialectes de là Pologne, de là Bohême et de la Lusace. Le plus ancien monument du polonais, le Psautier de Marguerite, appartient au quatorzième siècle..Naguère encore on croyait posséder des fragments du bohémien du neuvième siècle ; mais aujourd’hui là plupart de ces vieux poèmes bohémiens sont regardés comme apocryphes, et
n TViÀvnp plp^rp rlpq rlnillpc O Tir» 1 ,QT1 i T fTll ï f P ^ Si n p l Ajil U îiiUil-tv. LaO T U uX/O vZuLttiVO uUjl a uilvi.Cj UacU O UiiC Uii
ciénne traduction interlinéaire de l'évangile de saint Jean, qui était rapportée au dixième siècle (2). . .
Le dialecte de la Lusace est parlé par une population d’environ 150,000 aines, que Ton .connaît en Allemagne
sous le nom de Wendes:
■ _ ■ 1 ’ ’ \ v
Nous avons maintenant passé en revue tous les dialectes delà famille aryenne qui sont parlés en Europe, à la seule exception de ïalbanais. On ne peut douter que cet idiome ne soit sorti de la même souche que. les autres langues européennes, mais comme les. différences bien •marquées le séparent du grec, ainsi que de tous les membres reconnus de la famille aryenne, on l’a fait remonter f -au langage des anciens lllyriens, et on a cru y voir îe seul représentant qui soit parvenu jusqu’à nous de ces '
(1) Idem, ibidn p. 22.
(2) Schleicher, Deutsche Sprache, p. 77.
LEÇONS SUR LV SCIENCE DU LANGAGE.
<j -
langues dites barbares, qui étaient parlées sur les frontières de la Grèce, et qui s’infiltrèrent dans les dialectes grecs ('!).
V i , ^
De l’Europe nous devons maintenant passer en Asie, et là nous commencerons à l’extrême sud, par les langues de l’Inde. Comme j’ai exposé sommairement dans une leçon précédente, l’histoire du sanscrit, je me contenterai aujourd’hui d’en indiquer les différentes périodes. Kous pouvons faire remonter à environ quinze cents ans avant notre ère le dialecte des védas, lequel fut suivi du sanscrit moderne; plus tard, nous trouvons les dialectes vulgaires du troisième siècle avant Jésus-Christ, les dialectes prâkrils, employés dans le drame indien, et enfin les idiomes parlés encore de nos jours, tel que l’hindoui, î’hindoustani, le mahratte et le bengali. Dans la longue histoire du langage de l’Inde, le linguiste peut trouver.les plus précieuses lumières, et l’on a dit avec raison que le sanscrit est à la philologie comparée ce que les mathématiques sont à l’astronomie: mais puisque ces leçons doivent seulement servir d’introduction à notre science,
- I - r * ' '
le moment n’est pas venu d’étudier dans ses détails l’organisme grammatical de cette langue par excellence.
(1) [L’ouvragé capital pour l’étude de l'albanais.est le livre de J.-G. Hahn, longtemps consul d’Autriche à Janiaa; il a été publié en 18S4, sous le Litre de Albanesîsche Studien, in-8°, trois parties. Il y a là une grammaire et un dictionnaire de l’albanais, avec ses variétés dialectales, dressés par un homme initié à la vraie méthode philologique et bien au courant de la science. Nous ne citerons que pour mémoire un ouvrage plus ancien : Osservazioni grammaücati délia lingua albanese, del P. "Francesco Maria da Lecce; Rome, 1716, in-4°, 248/pages. Rédigée à. une époque où les recherches philologiques étaient, encore dans l’enfance, faite d’ailleurs d’après la langue des Albanais établis dans le royaume de Naples, langue , déjà altérée sans doute par son contact avec l’italien, cette grammaire ne doit inspirer qu’une médiocre confiance ; mais elle a, si je ne me trompe, le mérite d’être le plus ancien travail dont ce singulier idiome ait été l’objet. Ti\]
Il .y a, cependant, un point sur lequel il iné sera permis de dire quelques mots. On m’a souvent demandé Blais comment pouvez-vous prouver que la littérature sanscrite ait cette antiquité que vous lui supposez? Comment est-il possible de fixer des dates dans l’hisloire de l’Inde avant la conquête d’Alexandre ? Quelle confiance peuvent inspirer des manuscrits sanscrits qui ont pu fort bien être altérés ou fabriqués à une époque bien postérieure à la date qu’ils portent ? '=— Il est plus facile de faire de telles questions que d’y répondre, et surtout que d y répondre brièvement et intelligiblement. Pourtant j’espère que l’argument suivant satisfera, en partie, à ces difficultés et prouvera que le sanscrit était la langue parlée de l’Inde, au moins plusieurs siècles avant le temps de Salomon. .
Dans les hymnes des védas, qui sont les plus anciennes compositions littéraires, en sanscrit, Chorizon géograpbi-
qnio rjoc ooi wr»ûcrrnp 1 niiinii rc nrn â pii ]"inrrl_nppct
UD clOiJ . jj Uw tv)3 vu l jv/i u O vp U.y ‘ vO ttj ^ Lti u w t j-I w ^.vL -1—L wJ. v
de l’Inde. Il y a très-peu de passages qui contiennent des allusions à la mer ou à la côte, tandis que les montagnes neigeuses, les rivières du. Pendjab et les paysages de la haute vallée du Gange sont des objets faihiliers aux anciens bardes. En un mot, tout nous montre que la race qui parlait le sanscrit est entrée dans l’Inde par le nord',, et s’est ensuite répandue graduellement ou sud et à l’est. Or nous pouvons prouver qu’à l’époque de Salomon, lé sanscrit, avait pénétré au sud jusqu’à l’embouchure de
l’Indus. . • •
• Vous vous souvenez des navires que Salomon construisait à Ezion-Gebeiy qui est près d’Eloth, sur la côte de la mer Rouge, dans la terre d’Edom. Cette flotte était montée parles serviteurs de Salomon et. par les serviteurs de
■ sT m
fîiram, roi de T3T ; elle allait à Qphir y chercher de l’or, quelle rapportaitau-roi Salomon {Rois, I, ch. 9, v. 20-28), Il est dit que de ce même Ophir la flotte de Hiram rap-
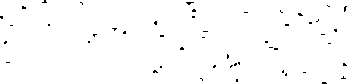
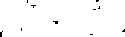
J-
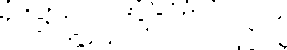
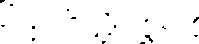
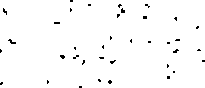
240 LEÇONS SUR LÀ SCIENCE DU LANGAGE.
O _ ' ’
portail non-seulement de l’or, mais une grande quantité de.bois d’algum et des pierres précieuses (ibid., X,A4)_. Le port d’où partait la flotte de Salomon est appelé
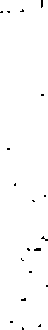
Ezion-Geber, et cet Ezion-Geber a été identifié par la plupart des savants avec le port moderne d’Akala à l’extrémité nord-est de là mer Rouge. Ce fut dans ce même havre de Ezion-Geber que furent brisés ces navires de Tharsbisli que Jo s ap h at .envoyait à .Ophir y chercher de l’or (ibid., XXII, 48). Il est difficile de dire ce que désigne l’expression « navires de Tharshish », mais si nous lisons (ibid., X, 22) que Salomon avait sur mer une flotte de Tharshish avec la flotte d’ïïiram, et que. la flotte de Tharshish venait une fois tous les trois ans apportant non-seulement de -l’or, mais de l’argent, de l’ivoire, des singes et des paons, la conclusion naturelle paraît être que Salomon ne possédait qu’un port, celui d’Ezion-Geber, et que c’était de là que partaient ces navires, à la fois pour aller chercher à Ophir de l’or, du bois d’aigum et des pierres précieuses, et pour rapporter d’un pays non spécifié de l’or, de l’argent, de l’ivoire et des paons. ’ - '
Il v a eu de-longues discussions sur la situation d’Ophir;
mais nous ne pouvons douter que ce ne fut une partie de la.côte de l’Inde (I), ou, sur la côte sud-est de l’Arabie, quelque port qui entretint avec i’Inde des relations coin-merciales, actives et régulières. Les noms employés pour désigner les singes, les paons, Vivoire et le bois.d’algum sont en hébreu des mots étrangers, absolument comme gutta-percha et tabac sont des mots étrangers en français. Or, si nous voulions savoir de quelle partie du monde le gùlla-percha fut d’abord importé en Europe, nous ne ris-
(1) Un résumé excellent de tonte îa controverse se trouve dans les articles Ophir et Tarshish du Dictionary of the Bible de Smith, articles fournis par PHonorable S. T.. B. Twisleton.

►
. CINQUIÈME LEÇON. 241
. ^ ’ "
querions-pas beaucoup de nous tromper en supposant que cette substance a dû nous venir du pays où le mot gutta-percha faisait partie de la langue parlée (1). De même, si nous pouvons trouver une langue à laquelle '.appartiennent ces noms du singe, du paon, de l’ivoire et du bois d’algum, qui étaient étrangers en hébreu, nous serons endroit de conclure de là que le pays où cette langue était parlée a dû être l’Ophir de la Bible. Il ne s’ensuivrait pas encore, comme l’a montré M. Twisleion, que les autres denrées, l’ivoire, les singes et les paons, ont dû venir aussi d’Opliir, car la Bible ne dit nulle part quelles venaient d’Opbir. Mais s’il arrivait que les noms de ces denrées appartinssent à la langue que l’on peut prouver avoir été la langue d’opbir, il y aurait, à ce qu’il semble, en l’absence de toute preuve du contraire, de bonnes raisons de supposer que toutes ces denrées devaient venir d’un même pays. La langue où le nom du bois à'algum, aussi bien que ceux qui désignent Yivoire, les singes, et les paons, trouvent leur étymologie n’est autre que le sanscrit, et si cette langue était, parlée à Opliir et dans un autre
- i
endroit non désigné, il est probable qu’Opbir aussi bien que ce pays sans nom étaient situés dans l’Inde et accessibles par mer. - ■ . =
Or le bois d’algum, ou, comme on l’appelle ailleurs le bois d'almug, serait, à ce qu’on suppose, le bois de san-dal. Je suis forcé d’avouer que rien n’était moins prouvé (2) jusqu’au moment où on a découvert que l’un des nombreux noms que porte en sanscrit ce bois est valguka. Ce terme « valguka », qui suppose une forme primitive
. * - *
(1) Gutta en malais signifie gomme ; percha est le nom de l’arbre (■isonandra gutta), ou d’une île d’où l’arbre fut d’abord importé {pulo percha).
(2) Voyez l’article de- M. Twisleton sur Ophir, dans le Diciionary of the Bible de Smith, t. Il, p. 640.
LEÇONS SUR LÀ SCIENCE DU LANGAGE.
* ■ .
valau, peut aisément avoir été altéré par les marins juifs
' - J ' ' ' " ‘ . , " ' ' ' " m . ’ - " ’ ’
et phéniciens et changé en algum, forme qui, dans un passage au moins de l’Ancien Testament, aurait subi un pou-veau degré d’altération, et serait devenue ctlmug. Le bois de sandal ne.pousse que dans l’Inde, et: surtout sur la côte de Malabar. •
Si nous n’avions toutefois d’autre indice que le mot
- , ^ sfc- ' - , H . i ■ a. p
'cdgum, peut-être île serions-nous pas encore autorisés à reconnaître dans Ophir un pays où on parlait le sanscrit. Mais si nous examinons les mots employés pour désigner les paons, les singes et l’ivoire, et que nous arrivions au même résultat, c’est-à-dire à reconnaître qu’ils sont étrangers à l’hébreu, et explicables par le sanscrit, les présomptions deviennent bien plus fortes, et nous sommes autorisés non-seulement à supposer que c’est dans l’Inde qu’il faut chercher Ophir, mais encore' à admettre comme probable que le pays inconnu d’où, provenaient les noms de ces denrées était aussi celui qui fournissait ces denrées, que ce pays était à portée de la flotte d’Ezion-Geber, et pas loin d’.Ophir............ . .. ... . . . .
Or les singes sont appelés en hébreu koph, m'ot dont il est impossible de trouver l’étymologie dans les langues sémitiques, mais qui est presque identique pour le son avec.le nom sanscrit du singe, kapi.. .
Vtvoire est appelé soit karnolh-shen, cornes en dent, soit shen habbim. Il est également impossible de trouver en hébreu la dérivation de ce mot habbim, qui est fort probablement une. corruption du nom sanscrit pour éléphant, ihha , précédé de l’article sémitique (4). .
Les paons sont appelés en hébreu iukhi-irn, dont nous trouvons l’explication dans l’ancien nom classique du paon, en tamoul, tôkei, prononcé vulgairement tôgei.
(!) Voir Lassen, îndischr AllerIhumskunde, liv. I, p. 537.

Dans le tamoul moderne, tôkei ne signifie généralement que la queue du paon ; mais, dans l’ancien tamoul classique, il signifie le paon lui-même (I). :
L’ivoire, l’or, les singes et les paons sont indigènes dans l’Inde, bien qu’on pût également les trouver dans d’autres contrées. Mais il n’en est pas de même du bois d’qlgum, du moins si nous devons penser avec les interprètes, que ce motalgum ou almug signifie le bois de san-dal ; il n’en est pas de même non plus du paon.. Le bois de sandal, comme nous l’avons indiqué, est particulier à l’Inde, ainsi que le paon, suivant la remarque de M. Twis-leton (9).
Si donc Opbir, c’est-à-dire le pays du bois $ algum, doit être cherché dans l’Inde, et si le point d'où;la flotte de Salomon rapportait des paons, des singes et deLivoire, doit être aussi cherché dans une contrée ou on parlait sanscrit, l’endroit auquel il est le plus naturel de songer. 5 6
}. r
c’est l'embouchure de flndus (1). Ce fleuve offrait aux habitants du nord toutes les facilités pour porter jusqu'à la côte leur or et leurs pierres précieuses, et les marchands du sud et du centre de l’Inde pouvaient bien désirer profiter d’un marché aussi avantageusement situé pour y vendre leurs paons, leurs singes et leur bois de sandal. Dans cette, même localité, Ptolémée (Yll, 4) nous donne le nom d’Àbiria, au-dessus de PaMalène, et les géographes hindous y placent une population qu’ils appellent ■Àbhfra ou ÀbMra. Non loin de là, Mac-Murdo trouva, ainsi qu’il le raconte dans sa description de la province de
Coutcb, une race à5Ahirs(^)i qui sont, selon toute probabi-
■ * 1 ■ ■
lité, les descendants de ceux qui vendirent à Hiram et à Salomon leur or et leurs pierres précieuses, leurs singes, leurs paons et leur bois de sandal (3).
Si donc, au temps où nous reporte le Yéda, le peuple qui parlait le sanscrit était encore établi dans le nord de l’Inde, tandis qu’au temps de Salomon, la langue de ce peuple était étendue jusqu’à Coutch et même jusqu’à la côte de Malabar, cela montrera qu’en tout cas le sanscrit n’est pas d’hier, et qu’il est aussi ancien
(!) Æois, liv. Ht, ch. x, vers. îi.
. (2) Cf., Sir Henry EHiot, Supplementary Glossciry, au mot Aheer.
(3) Dans son Mémoire sur le pays d’Ophiï\ M. Qualremèrea cherché à établir qu’Ophir ne pouvait pas être une partie de. la côte de Dinde, mais ses arguments ne sont pas concluants. Il ne connaissait pas la preuve que nous offrent les noms des objets exportés d’Ophir. Je fais cette remarque à cause de la grande autorité qu’ont les opinions de M. Qualrémère, et parce que son mémoire sur Ophir vient d’être réimprimé dans la Bibliothèque classique clés célébrités contemporaines ^ 1861. L’identiÜeatibn d’Ophir avec un point quelconque de l’Inde n’est pas une conjecture moderne. La Vulgale traduit: « Cela ne peut pas être mis en balance avec l’or d’Ophir » (Sopliir chez les Septante, Job, XXVIII, 16) par: « Non conferetur tinctis Indice colonbus. » En copLe Sofir est le nom de l’Inde : c’est le mot même par lequel les Septante ont traduit l’Ophir hébreu. ’
- CINQUIÈME LEÇON. 2io
O
au moins que le livre de Job, où For d’Ophir est men-lionne (1). . .
(i) Job, XXII, 24; XXVIII, 46. Quelques-uns de mes critiques ont refusé d’àdmellre cel argument, en alléguant que les Livres des Rois ne sont pas contemporains de Salomon. Ces denrées, toutefois, doivent avoir eu un nom au temps de Salomon, et il n’a jamais été prouvé qu’elles eussent alors des noms sémitiques, et que ces noms eussent été remplacés par des noms d’origine indienne, à une époque postérieure, quand toute relation commerciale avait cessé entre l’Inde et la Palestine. Quant au nom du bois de sandal, mes critiques auraient dû savoir que les deux, formes, atgmn aussi bien qu’almug, se rencontrent l’une et l’autre dans la Bible. Dans un article qui a paru dernièrement dans le Dictionnaire biblique du Dr Smith, M. Twisleton a résumé et discuté avec un soin et une impartialité extrêmes les différentes opinions qui ont été émises sur la position géographique d’Ophir. M. Twisleton lui-même incline à l’avis de ceux qui, avec Michaelis, Niebuhr, Gosselin et Vincent, placent Opbir sur la côte d’Arabie ; et il remarque fort ingénieusement que si Ophir n’a été qu’un simple lieu d’entrepôt, ce fait détruirait immédiatement la principale objection contre l’avis qui lui paraît le plus probable, objection qui est fondée sur ce que l’or et les autres objets rapportés d’Ophir en Palestine ne sont pas indigènes en Arabie. Cela est vrai. Mais pourquoi chercher Ophir en Arabie? Le seul argument spécieux que l’on puisse invoquer en faveur de cette h}7pothèse est celui que l’on tire de la table généalogique con tenue dans le dixième chapitre de la Genèse, où.Ophir est donné comme le onzième des fils de Joktan. J’accepte tous ces faits allégués par M. Twisleton ; mais je ne vois aucune difficulté à admettre qu’à une époque très-ancienne, il ait pu y avoir un échange de population entre les rivages du golfe de Coutch et la côte méridionale de l’Arabie. .(Renan,'.Histoire des Langues sémitiques, î358, p. 3H). Si Tarshish en Espagne peut être appelé un fils de Javan, pourquoi Ophir, nom d’une population établie dans l’Inde, ne représenterait-il pas un fils de Joklan? L’expression « de Mesha, quand on vient en Séphar, nîontagne d’Orient, » sur laquelle appuie fortement M. Twisleton en soutenant qu’elle limite aux côles de l’Arabie la position géographique de tous les fils de Joklan, cette expression, disons-nous, est très-vague, on ne saurait le nier, et il n’a pas été possible de reconnaître et de placer, dans la sphère si vaguement indiquée par la Iradilion géographique, tous les noms de la race de Joktan. D’antre part, je ne veux point nier la force des arguments de M. Twisleton. On doit admettre que sur la côte sud-ouest de l’Arabie, ceux qui échangeaient les uns contre les autres les produits de l’Inde et les produits de la Palestine durent nécessairement fonder des entrepôts de commerce. Ces comptoirs existaient au temps de Diodore de Sicile : après avoir décriL les grandes richesses de Saba
Très-étrôiteiïienl apparentée au sanscrit, surtout au
en or, en ivoire, et en pierres précieuses, il raconte (III, 47) qn’ii y avait tout auprès plusieurs îles, où abordaient des marchands de tonies les parties du monde, et surtout de Potana (Pattana?) qu’Alexandre avait fondée près du-fleuve Indus. K^oo* o euâa^iovïç
'îtXvjÇ'iov 0”ap7.oùartv, eyovàat aoXstç.' àtstyperouç.. •.. tiç t<5c<aûcç o tü-ttodol TîtxvToOcv y.a~ÿ.~Xéo\>m, uaX'.GTa 8 ex lloTKVaç, TjV Â)<.£tavcpoç toxtce -rasa tov Tvobv -TTOTaubv, vauG"iaG[j.ov l^stv. [3ou)».op.svoç ir^
iapà tov Qxsavbv 7iapâ)aôu. \Que celle même côte fût le siégé dune civilisation et d’un commercé qui remontent à une très-haute antiquité* c’est ce qu’attestent jusqu’à nos jours dès ruines et des inscriptions magnifiques, ainsi que lès fragments épars d’mïê tradition qui s’est répandue au loin et dans différentes direc-lions. Voir A. von Kremer, Die Südarabische Sage, f 866. Il est inutile, Iqntefois, d’entrer ici dans une discussion détaillée dé tous les points controversés de cette question, car quand même il serait prouvé qu’Ôphir était en Arabie, il n’en serait pas moins certain que les noms des singes et dés paons se rattachent au sanscrit et n’out pu être apportés à Ophir d’aucun autre pays que dé l’iDde. Tous lés bons hébraïsànts admettent que ces noms tels qu’ils se rencontrent dans l’Ancien Testament ne sont pas d’origine sémilique. Ce sont des mots étrangers adoptés en hébreu, et sitr lesquels ni les dialectes de l’Arabie, y compris l’idiome des inscriptions himyarïtiques, ni les langues africaines parlées sur la côte de Mozambique, où certains écrivains pensent qu’Ôphir était située, ne nous apprennent absolument rien. On a pu ràLtacber plusieurs de ces mois au sanscrit et aux idiomes parlés sur la côté de Malabar, dans le Dèlckan-; et quoique leur forme originelle ait été très-altérée dans le parler dé matelots: ignorants, néanmoins il n’a pas été possible, tout en faisant la plus large part à là corruption phonétique inévitable, de les faire remonter à aucun autre groupe de langues. J’ajouterai que s’il était établi qu’Ophir fut seulement un lieu d’entrepôt situe, non dans l’inde. mais en Arabie: ou en Afrique, nous aurions une nouvelle raison dé croire à la haute antiquité du sanscrit, èn trouvant dés mots de celte langue transplantés, à une époque aussi reculée, dans des contrées aussi lointaines, où ils seraient nécessairement venus avec ces produits naturels de l’Inde qu'ils servaient à désigner. Si maintenant on considère qu’aucune langne, excepté le sanscrit, nè peut revendiquer les noms précités; qu’il n’v a aucun pays, excepté l’Inde* où toits les objets rapportés par la flotte de Tarsbish (qu’elle revînt d’Ophir ou d’ailleurs) soient indigènes ; que le bois de saiidal (ainsi qu’on a interprété lé mot algùmêm, indépendamment de toute théorie sur la position d’Ophir) n’a pu être exporté en Palestine, dans les temps anciens,- que de la côte de Malabar seulement; si à ces coïncidences frappantes qui nous reportent toutes à l’Inde ôn ajoute ce fait signalé pàï Lassen, que les noms du coïo%â:\inâi%
sànscrildes Yédas, est l’antique langue du Zend-Avesta (4), lé %md, ainsi qu’on l’appelle, qui est ïa langue sacrée des Zoroastriens, adorateurs d’Ormuzd. En effet, c’est en grande partie par la connaissance du sanscrit et à l’aide de la philologie comparée que l’on est parvenu à déchiffrer l’ancien dialecte des Parsis ou adorateurs du feu: tes manuscrits de ces livres sacrés avaient été conservés par les prêtres parsis à Bombay, où une colonie d’adorateurs ,du feu s’était réfugiée au dixième siècle (2), et où et probablement du bdellium, ont également passé du sanscrit en hébreu, on sera disposé, je crois, à admettre, avec Lassen, fritter et d’autres savants que des relations commerciales ont existé de trèsr bonne heure entre l’Inde et la Palestine, quelque opinion que l'on adopte sur l’emplacement d’Ophir.
(1) Zend-Avesta est le nom usité dans Chapâni et les autres écri
vains mahométans, et il semble qu’il est maintenant trop tard pour le modifier. Lés Parsis disent « Avesta et Zend, » prenant Avesta (le pehivi avastâk) dans lesens de texte, ei Zend, ou Zand, comme le titré du commentaire pehivi. •
Avesta, ou avastâk, dérivait, suivant J. Millier, de la racine qui a donné en sanscrit ava-slhâ, dont le participé, ava-slhita, signifierait « posé, établi : » D’après cette étymologie, on aurait voulu, par ce nom d’Avestâ, désigner le texte établi des Ecritures sacrées. Aujourd’hui M. Ilaug préfère le dériver de â vid, prenant avesta dans le sens de « ce quia été connu, connaissance, » litre assez analogue au sanscrit V eda, excepté que dvisla ou avesta signifierait plutôt « notifié, proclamé, » que « connu. » Quand au mot Zand, la plupart des savants le regardent maintenant comme une altération de zainii « connaissance. » le sanscrit gnâli, ^vwcnç, conservé dans le zehd âzdinü, ancien perse âzandâ. Il aurait signifié originairement « explication, commentaire, » sans désigner en aucune façon Jâ langue dans laquelle cette explication était donnée. Plus tard, cependant, quand l’Avesta eut été traduit én pehivi, Zand, devint le nom de ceUe traduction, ainsi que de la langue pehlvie dans laquelle la traduction était écrite. (Voir Ilaug, Pahlavi-Pazénd Dictionary, p. 239.) L’opinion que j’avais moi-même avancée, à savoir, que Zand était originairement le même mot que khandas, langue mesurée et cadencée, langue du Yéda, n’est plus.soutenable, a moins que nous ne considérions l’identification de zand, avec zainii « connaissance » comme une pensée venue après coup, et -cdmme une explication savante d’un mot dont la signification originelle s’était perdue. .
(2) « D’après le Kissai-i-Æa^j/dî^ ouvrage qui n’a toutefois' prés-
leurs descendants possèdent aujourd’hui une'influence et des richesses considérables. On trouve d’autres établissements de Guèbres à Yezd et dans diverses parties du
v ¥
Kerman. Ce fut un Français, Anquetil Duperron, quilepre-
- ■ i
mier traduisit le'Zend-Àvesta ; mais sa traduction fut faite
#
sur une version en persan moderne, et non sur le texte original. Le premier Européen qui entreprit de lire les paroles mêmes de Zoroastre fut le Danois Rask, et, après sa mort prématurée, Eugène Dura ouf, en France, obtint un des plus glorieux triomphes de la science moderne, en déchiffrant la langue du Zend-Àvesta, et en établissant son étroite parenté avec le sanscrit. Les doutes qui avaient été exprimés sur l’antiquité et sur l’authenticité des Yédas furent répétés pour le Zend-Àvesta par d’illustres orientalistes et même par sir William Jones et Wilson. Mais les arguments de Burnouf, quoique fondés sur les faits grammaticaux seulement, étaient irrésistibles ; et la découverte récente des inscriptions cunéiformes de Darius et de Xerxès est venue leur donner une confirmation éclatante.
Bien avant Burnouf, on connaissait l’existence dfim ancien sage nommé Zoroastre. Platon parle d’un philosophe qui enseignait la magie (Ma.yüa) de Zoroastre, et il appelle Zoroastre fils ô’Oromasde (i). Ce nom d’Oromasde est inique aucune valeur comme histoire des premiers siècles du parsisme, les adorateurs du feu se réfugièrent dans le Khorassan, quarante-neuf ans avant l’ère de Yezdegerd (632 de J.-C.), vers l’année 583. Après être restés cinq ans dans ce pays, ils en sortirent, en l’année •fiâ t, pour se rendre dans la ville d’Iiormaz (Orimis, sur le golfe Persique), qu’ils habitèrent pendant quinze ans. En 6v*8. ils émigrèrent dans Pile de Diu, au sud ouest de Kaliawar, et ils y séjournèrent dix-neuf ans, jusqu’en 717, époque où ils quittèrent Pile pour la ville de Sanjan, située à environ huit lieues au sud de Damaun. Après une période de trois cents ans. nous les voyons se répandre dans les villes voisines du Guzerale, et établir successivement le feu sacré à Barsadah, à Nausari, près de Surat, et à Bomba}7. » Bombay Quarterly Review, 1856, n6 yiii, p. 67.
(1) Ale., I, p, 122, a. eO f/lv uaycècv oiSacxst tt)v ZiopoacTpou tou

portant, car il est évidemment mispour Ormuzd, dieu, des Zoroastriens. Le nom de ce dieu, tel que nous le lisons dans les inscriptions de Darius et de Xerxès, est Auramazda, forme qui se rapproche beaucoup de l’Oromasde de Platon (1). Ainsi Darius dit dans un passage : « Par la grâce d’Auramazda, je suis roi ; Auramazda m’a donné le royaume. » Si maintenant nous cherchons à découvrir la signification d’Auramazda, nous sommes mis sur la voie par un passage des inscriptions achéménides dans lequel Auramazda est écrit en deux mots, qui sont déclinés tous deux. Nous y trouvons Aurahya mazdâha, comme génitif d’Auramazda. Biais cette forme est encore inintelligible et n’est, après.tout, qu’une corruption phonétique de Ahurô mazdâo (nom.), le nom de la divinité suprême, tel que nous le trouvons à chaque page du Zend-Avesta. Les deux parties de ce nom se déclinent aussi ; et au lieu de Ahurô mazdâo, nous rencontrons aussi Mazdâo ahurô (2). Ahurô mazdâo est représenté dans le Zend-Avesta comme étant le créateur et le gouverneur du monde ; comme étant bon, saint et véridique, et comme luttant contre tout ce qui est mal, ténèbres et mensonge. « Les méchants succombent devant la sagesse.et la sainteté de l’esprit, sage et vivant. » Dans les plus anciens hymnes, le démon des !£ipogaÇou * £gt'. os touto Gswv Gepa;-£ia. Aristote ne connaissait pas seulement Oromasde comme principe du bien, mais aussi Ahrinian, le principe du mal. selon la'doctrine des mages. Cf. Diog. Laer.,
I, 8. 'ÂpiG'TOTeXr.ç. d’iv -TrpioTtp IWi ÆhXocosiaç xat Trpsffêu-epouç (tovç May ou ç ) GYjcr'.v s»ve« tcov Atyu-jrTojv xal ouo xax «utoliç sivca ap/aç ayaOov oatp.ova xai xaxov ôaip.ova, xai to> jxev qvoaa sïvai Zsùc xa; ’Qpof/.ajO'/jç,
toî O* Atov-ç xal 3Apst;j.avioç. Cf. Bernays. Die Dialoge des Arisloieks, Berlin, 1863, p. 95. [Cf. M. Bréal, De persicis nonvnïbus apud scri-plores græcos, Paris, in-8°, 1863. Tr.]
(1) Dans les inscriptions, nous trouvons ce nom décliné ainsi : N. Auramazda, G. Auramazdàha, A. Auramazdam.
(2) G. Ahurahe mazdâo, D. mazdài, A. mazdam. _
iénëBïës,- qui est Opposé 'à ’A'/mrô )MMdÔy n’à pas encore reçu Son vrai nom, Ângrâ MinÿuSj lequel devint plus tard Ahrïrndüi mais bà êfî parlé comme étant une puissance, comme Drukhs où lé mensonge ; et la principale doctrine que Zordàslre était Yënù prêcher, c’était qu’il nous faut choisir entre ces deux puissances, que nous devons être bons et non méchants. Yoici ses paroles : . « AU commencement, il y avait deux jumeaux, dëux esprits, ayant chacun leur activité propre : le bon ét lè méchant en pensées, en paroles et en actions. Choisissez
. !■•-■* i 1 1 1 „ ^ -
entré ces deux esprits. Soyez bons et non méchants (1). »
' , ' ' *
« Àhuramazda est saint et véridique: il faut Thonorer
par la véracité et par de saintes actions... Tous ne pouvez servir les deux esprits. »
Or, si nous voulions prouver que l’anglo-saxon a existé Bien réellement, et avant l’anglais, il nous suffirait de comparer ensemble quelques mots tels que lord (2) ét hlà-fordj gospel et godspel. Comme hlaford a une signification et que lord n’en a pas, nous pouvons êlre assurés que,
(1) Haug, Lecture on the. origin of theparsee religion, p. il. Cf. aussi Bunsen, Ægyplens Stellung, etc.
(2) Je dois lés remarqués suivantes sur la significationpremière
de lord (le donneur de pain, l’ail, brotherr), au docteur Bosworth, professeur d’anglo-saxon à l’université d’Oxford : ..
Lord vient de l’anglo-saxon hlâf-ôrd, composé de hlâf (l’anglais loaf), un pain, et de ôrds — es, origine, cause, auteur. C’est ainsi que. nous lisons dans Çaedmon, au vers 35, ôrd moncynnes, origo humani generis. Lord signifie donc l’origine ou la cause du pain ou de la nourriture. • , . . . . , . .
Lady dérive de l’anglo-saxon Jvldef-digei —rfié; lilétëf ou M&f si-
sans ce composé hlaford, nous n’aUrions jamais êü le mot lord. Nous trouvons un fait analogue en comparant la langue du Zend-Avesta avec celle des inscriptions cunéifor-
" # ^
mes de Darius. Âwramazdâ êsl évidemment une corruption de Ahurô mazdâo, et, si là langue où sont écrites les annales de la montagne de Behisl'oun est une langue véritable, à plus forte raison devons-nous croire à l’existence de là langue du Zend-Avesta, telle quelle fut déchiffrée par Burnouf, longtemps avant qu’il déchiffrât celle de Cyrus et de Darius.
’ * ■
Mais que signifie Ahurô mazdâo? Le zend île nous en
donne pas l'explication ; il nous la faut donc demander au sanscrit, la plus primitive des deux langues, comme nous avons cherché dans l’italien la forme et la signification originelles du mot feu français. D’après les lois qui régissent les-cliangements des mots communs.au zend et au sanscrit, Ahurô mazdâo répond au sanscrit Asura niedhàs (1), ce qui signifierait Y Esprit sage, et rien autre.
Burnouf, Brockhaus, Spiegel et Weslergaard ont donné des éditions, des traductions et des commentaires du Zend-Avesta ; mais il reste encore beaucoup a faire, el le docteur ÏÏaug, qui a vécu pendant plusieurs années avec les Parsis de Bombay, vient de reprendre l’œuvre inachevée de Burnouf. Ce savant a montré que le texte du Zend-Avesta, tel que nous le possédons, contient des fragments gnifiant pain, ainsi que nous Venons de le voir, et dige^.die, venant^ de dugan, digan, heo digc, s’occuper de, servir. Lady signifie donc celle qui sert le pain à la famille. Au psaume CXX1I, 3, nous lisons /dre. kLaefdigan on hlefdian, suæ ancillæ. Robert de Glouce'ster écrit leùedie ou leuedy pour hlaefdie; GoSvér et Spenscr écrivent ladie;\ l’orthographe moderne est lady.
(J) Telle est l’explication de mazdâo proposée par Berifey. Burnouf pensait que ce mol éLait composé de mas « grande » et dâo «science, » et cette opinion ést soulenüepar Spiegel’,• Ccmvnièntâr über das Avesta, vol. I, p. 3. -
_ _■■ . ■ +
252 LEÇONS SUR LA SCIENCE DU LANGAGE.
. rfl -
d’époques très-diverses,’ et dont nous ne. pouvons attri-
■ r
buer à Zarathustra que les plus anciens, qui sont appelés les Gâthds. « Cette partie, dit-il dans un discours prononcé à Pounah en.4 861, est minime, si on la compare à toute la masse des fragments zen ds; mais onia distingue nettement du reste, à cause de la différence de dialecte. Les morceaux les plus importants écrits dans ce dialecte particulier sont appelés Gâlhâs ou chants, et sont divisés en cinq recueils de peu d’étendue : ils sont composés en vers de differents mètres, qui répondent, pour la plupart, aux mètres des hymnes védiques, et ils sont écrits en un dialecte qui se rapproche beaucoup de celui des Yédas (1). »
L’époque où vivait Zoroastre est une question plus difficile, qu’il nous est impossible d’examiner aujourd’hui (2). Ce qu’il importait d’établir dès maintenant, c’est, que Zoroastre a existé bien réellement, ainsi que le zend, la langue qu’il a employée, et que cette langue est antérieure à celle des inscriptions cunéiformes. •
En poursuivant notre étude de l’histoire de la langue persane, nous voyons le zènd devenir le dialecte dans le-
(1) La dérivation du nom de Zarathustra du mot védique para
da s h îi, proposée par M. Ilaug, n’est pas admissible. Voir sur ce même sujet J. H. C. Kern, Over hel woord Zarathustra en den my-thischen persoon von dvn naarn. Amsterdam, 1867. •
(2) Bérose, qui nous a été conservé dans la traduction arménienne
Aristote et Eudoxe, selon Pline (Hisi. nat.% XXX. 1). plaçaient Zoroastre 6,000 ans avant Platon ; Hermippe le plaçait 5,000 ans avant la guerre de Troie. (Diog. Laert, Proœm.) .
Pline (fHsl. natXXX, 2) dit que Zoroastre vivait plusieurs milliers d’années avant Moïse le Juif, qui fonda une autre sorte de magie.
quel sont écrites les inscriptions de la dynastie des Aché-ménides. À .partir-de ce moment nous perdons de vue la langue iranienne parlée parles populations de la Perse, et dans les inscriptions des rois sassanides, ainsi que dans les traductions du Zend-Avesta faites durant la période de leur domination en Perse .(226-65i), nous trouvons une langue, appelée quelquefois le pehlvi, quelquefois, mais improprement, le huzvaresh. Sur le caractère de cette langue les opinions sont fort partagées. Pour M. Baug, le pehlvi, malgré un mélange de mots iraniens, est incontestablement. un idiome sémitique ; il le regarde comme
la continuation d’un dialecte araméen parlé dans l’ancien
*
empire d’Assyrie, mais différant du dialecte des inscriptions assyriennes (t). D’autres savants pensent que c’est un dialecte qui s’est formé sur les confins de l’Iran et de la Chaldée pendant les deux premiers siècles de notre ère, et qu’il est iranien dans sa structure . grammaticale, tout en possédant un nombre considérable de vocables sémitiques. Je n’ose exprimer une opinion positive, mais la solution du problème me semble dépendre de l’explication exacte du système graphique adopté en pehlvi, beaucoup plusque.de l’analyse des formes grammaticales de cette langue. Le point le plus curieux c’est que la traduction pehlyie, qui était la version officielle au temps des rois sassanides, mais qui date peut-être d’une époque bien antérieure, était lue par les prêtres en substituant des mots iraniens aux mots araméens : c’est ce mode.ffe lecture, encore observé aujourd’hui, qui est désigné proprement, par le nom de Huzvaresh (2). Cette manière de lire le pehlvi, en substituant des mots iraniens aux mots araméens, explique le fait que, dans les manuscrits des
(!) Itaug, Pahlavi Pazcind Diclionary, p. J42. (2) Ibicl., p. 37. • .
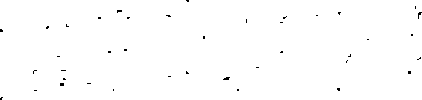
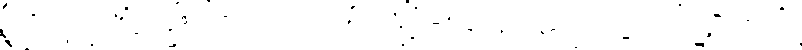
251 LEÇONS SUR LA. , SCIENCE DU LANGAGE.
*) . ••
textes pehlvis, des désinences iraniennes se trouvent ajoutées aux mots pehlvis, changeant ainsi ie pehlvi, qui, sous sa forme écrite, présente une apparence sémitique, en un idiome parlé ayant un caractère véritablement aryen. .
Bien que le pehlvi fût, sous la dynastie sassanide, la langue de là cour et des hommes instruits, l'ancien perse n’en continua pas moins à être la langue parlée par le peuple (I), et plus tard, après avoir supplanté le pehlvi réel ou artificiel, redevint, encore, sous le nom de Parsi, la langue littéraire de la Perse. Celte langue, quand elle est employée pour l’interprétation du Zend-Àvesta, est quelquefois appelée le Paz-end, et diffère peu de la langue de Firdusi, le grand poète épique de la Perse, l’auteur du Shâ-nameh (vers l’an'1000 de J.-C.).'Depuis cette époque, nous n’avons à constater que le nombre toujours croissant de mots arabes qui pénétrèrent dans la langue de la Perse, après la conquête de ce pays et la conversion de ses • habitants à la religion de Mahomet.
Les autres langues asiatiques, dont la grammaire et le vocabulaire témoignent d’une manière générale de leur parenté avec le sanscrit et le persan, mais qui portent une empreinte trop distincte et trop nationale pour que nous puissions les ranger parmi les simples dialectes, sont la langue de-P Afghanistan (2) ou le pou s h tou, celle des Kurdes, celle des Ossètes, dans le Caucase, enfin Y arménien: la langue de Bokhara n’est qu’un dialecte du persan, et ne mérite pas de figurer séparément dans le tableau des lap- ■ gués aryennes. Il y aurait beaucoup à dire sur chacune . '
, t
■ ' ■ t
(1) Ibid., p. 13. . ;
(2) Voir Trumpp (dans le Journal de la Société orientale aile- ;
mande, vol. XXI et XXII), qui signale une parenté plus étroite entre : le poushtou et les langues parlées dans l’Inde. M. Trumpp a publié ; une Grammaire poushloueen 1873. . .
" r ~ ■ 1 ■ T ■ ■"
CINQUIEME LEÇON. : ' . . ZÜQ
de ces Langues et sur les titres qu’elles ont à une place parmi les membres indépendants de la famille aryen,ne ; mais notre temps est limité, et d’ailleurs aucune d’elles n’est encore arrivée à l’importance qu’ont les idiomes d_e l’Inde, de la Perse, de la Grèce, de l’Italie et de l’Allemagne et d’autres rameaux du langage aryen, qui ont été soumis à une analyse critique, et dont on peut étudier L’histoire aux différentes époques de leur existence littéraire.
■ * . * . ,
Il n’y a plus qu’une seule langue aryenne dont nous:
avons omis la mention; c’est celle des Bohémiens ou,
comme ou ïes appelle dans tout l’Orient, Les Tziganes, et
elle appartient également à l’Asie et à l’Europe. Quoique
’ ■ . * l T . . . ■
cette langue ait perdu presque toutes ses formes grammaticales, et que son vocabulaire soit composé de mots dérobés à tous les pays , que les Tziganes ont traversés, nous reconnaissons encore clairement les liens qui la
rattachent à LHindoustan, la patrie d’où elle est exilée. .
■ ■ " * ‘
Par le tableau que je vous mets en ce moment devant les yeux (I), vous verrez qu’il est passible de diviser la famille aryenne tout entière en deux grandes, branches : celle du smZ/qüi comprend les rameaux indien et.iranien, et celle du nord ou du nord-ouest, qui comprend tous les autres, Le sanscrit et le zend ont en commun certains mots et certaines formes grammaticales qui n’existent dans aucune des autres langues, de cette famille ; nous pouvons donc en conclure avec certitude que les ancêtres des poètes védiques èt ceux des adorateurs, de Àhiiro mazdâo. sont restés ensemble pendant quelque, temps, après avoir quitté, le berceau primitif de toute la race aryenne ; car comprenons ceci bien clairement : la classification généalogique de ces langues, telle quelle, est
(1) Voir l’Appendice de ce volume. *
LEÇONS SDR LA SCIENCE DD- LANGAGE,
^ - r
établie dans ce tableau, a un sens historique. Aussi sûre-mentquelessix langues romanes nous reportent à l’idiome ides bergers italiens qui s’établirent sur les sept collines de Rome,, l’étude comparée de toutes les langues aryennes'nous fait remonter à une époque plus primitive du langage, alors que les premiers pères des. Indiens, des Persans, des Grecs, des Romains, des Slaves, des-Celtes et des Allemands, habitaient ensemble dans les mêmes 'enclos et sous le même toit. Il y eut un moment où. sur le grand nombre de vocables possibles pour signifier
père, mère, frère, sœur, chien, vache, ciel et-terre, les noms
. 4 "
que nous trouvons dans toutes les langues aryennes furent formés, et l’emportèrent dans cette lutte vitale qui n’existe pas moins dans le domaine du langage que dans le règne végétal et le règne animal. Jetez les veux sur le tableau comparatif du. verbe auxiliaire AS, être, dans les diverses langues aryennes. Le choix de AS, entre toutes les racines qui auraient aussi bien pu exprimer l’idée de l’existence, et l’addition à cette racine d’une série de désinences personnelles qui étaient toutes originairement des pronoms personnels, ont été des actes individuels, ou, si vous le voulez, des faits historiques. Ils se sont accomplis un jour, h une certaine date, et en un certain lieu ; et, puisque nous trouvons ces mêmes formes chez tous les membres de cette famille, il s’ensuit qu’avant que les ancêtres des Indiens et des Perses se fussent . dirigés vers le.sud, et que ceux des Grecs, des Romains, i des .Celtes, des Teutons et des Slaves eussent fait leur première étape vers les rivages de l’Europe, il existait un , petit clan d’Aryas établis probablement sur le plus haut plateau de l’Asie centrale, et parlant un lângage qui n’était encore ni le sanscrit, ni le grec, ni l’allemand, mais qui •contenait les germes de tous ces dialectes. Ces Aryas étaient, agriculteurs et étaient déjà parvenus à un certain
degré de civilisation ; ils avaient reconnu les liens du sang, et consacré les liens du mariage : et iis invoquaient ; l’Être qui donne au ciel la lumière et la vie, sous le même nom que l’on entend encore aujourd’hui dans les temples de Bénarès et dans nos églises chrétiennes. .
Quand cette petite peuplade se dispersa, les aïeux des Indiens et des Zoroastriens ont dû rester ensemble pendant quelque temps dans leurs migrations ou leurs nouveaux établissements ; et je crois que ce fut la réforme de Zoroastre qui amena enfin la rupture entre les adorateurs .des dieux védiques et les adorateurs d’Ormuzd. Serait-il' maintenant possible de déterminer par le même critérium (la communauté de certains mots et de certaines formes) les époques successives où les Teutons se séparèrent, des Slaves, les Celtes des Italiens ou les Italiens des Grecs? C’est ce qui me paraît plus que douteux. Les savants qui ont cherché à résoudre ce problème sont arrivés à des résultats différents et nullement satisfaisants (1). Le plus sage, quaut à présent, est. de remonter, pour chacun des groupes qui forment la classe septentrionale, à la forme la plus ancienne et la plus pure de son idiome national ; : quant aux ressemblances plus marquées que l’on trouve
J h
entre les langues slaves, par exemple, et les langues teu-toniques, on les expliquera en admettant que les ancêtres de ces races conservèrent, dès le commencement, perlai-
j
nés particularités dialectales qui existaient avant aussi bien : qu’après la dispersion de la famille-aryenne.
( I ) CL Schleicher, Deutsche Sprache, p. 81.

17


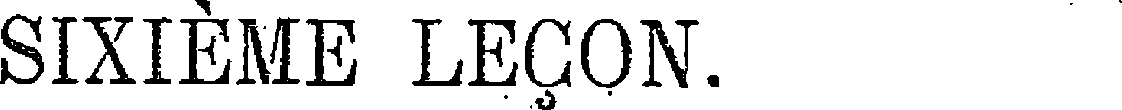
LA GRAMMAIRE COMPARÉE.
Objet de la grammaire comparée. — Distinction entre les racines et les formes du langage.— Théories diverses sur l’origine des formes grammaticales. Les désinences ne sont ni des excroissances produites par une végétation intime du langage ni des signes de conven-. tion inventés pour modifier le sens des mots : la grammaire comparée démontre qu’elles ont été originairement des mots indépendants qui se sont altérés avec le temps et se' sont agglutinés à là fin des mots auxquels ils étaient juxtaposés. Formation de certains cas dans les îan-gués aryennes : le locatif, le génitif le datif. Formation des désinences des verbes le futur français, le futur latin, le prétérit anglais.— • Hypothèse pour montrer comment les formes grammaticales peuvent prendre naissance.— Principaüx résultats donnés par la grammaire comparée des langues aryennes. — Lumière inattendue jetée sur les temps autéhistoriques par l’étude comparative de ces langues. — Tableau de la civilisation chez les Aryens avant leur dispersion, d’après les mots communs aux différents membres de la famille. — Pourquoi le nom d'aryennes a été donné aux langues indo-européennes. — Signification du nom Arya ; ses pérégrinations à travers le monde. — Région habitée par les Aryas. '
La classification généalogique de la famille aryenne fut fondée, ainsi que nous Lavons vu, sur la comparaison détaillée des principales formes grammaticales de chacun de ses membres ; et des ouvrages tels que la Grammaire comparée de Bopp ont pour objet de démontrer que le mécanisme grammatical du sanscrit, du zend, du grec, du latin et des dialectes celtiques, teutoniques et slaves, fut produit une fois pour toutes ; et que les dissemblances
2!60 LEÇONS SUR LA SCIENGE DU LANGAGE.
£ ... '
apparentes entre les désinences, sanscrites, grecques et latines, doivent trouver leur explication dans les lois de l’altération phonétique, particulières à chaque dialecte, lesquelles ont modifié l'antique type aryen et Font transformé en un si grand nombre de langues nationales. Il semblerait donc que l’œuvre de la grammaire comparée
r „ , * F_
fût achevée, dès qu'elle aurait déterminé d une manière exacte la filiation généalogique des différentes langues et leurs rapports de parenté entre elles ; et les philosophes qui ne se préoccupaient que des plus hauts problèmes de la science du langage, n’ont pas hésité à déclarer qu’à leur sens les déclinaisons, les nombres, les cas et les genres des noms ne sauraient fournir matière à des discus-
- ■ -r ' * ■
sions sérieuses et fécondes. Nous reconnaissons sans peine que la grammaire comparée n’est qu’un instrument, et qu’elle nous a déjà donné, du moins en ce qui concerne la famille aryenne, à peu près tout ce que nous pouvons en attendre; mais nous espérons bien, néanmoins, que dans la science du langage, elle ne perdra jamais cette importance quelle doit aux admirables travaux des Bôpp, des. G-rimm, des Pott, des Benfey, des Curtius, des Kuhn et de tant d’autres philologues distingués. — La grammaire comparée ne s’en tient pas, d’ailleurs, à un simple travail de comparaison. Sans doute rien ne serait plus facile que de mettre en regard les paradigmes des déclinaisons et des conjugaisons en.sanscrit, en grec, en latin,, ainsi que dans les autres dialectes aryens, et d’en noter les différences et les analogies. Mais quand cela est fait, et que nous avons ensuite découvert les lois phonétiques qui ont conduit la langue, du type arien primitif, à cette variété d’idiomes nationaux que nous admirons dans le sanscrit, dans le grec et dans le latin, alors nous voyons
surgir des problèmes d’un intérêt plus grand encore.
: ■ ■ . r ■■ ■ ■ -
Nous savons que ces terminaisons que nous appelons
maintenant désinences grammaticales étaient à l’origine des mots indépendants qui avaient leur signification propre. Est-il possible, après que la grammaire comparée a reconstitué les formes originelles des désinences aryennes, de retrouver en elles des mots indépendants, et d’en pénétrer le sens primitif? Tous vous rappellerez que cette question fut notre point de départ dans notre étude du langage. Nous nous sommes demandé comment le d final dans le prétérit anglais I loved, avait pu changer un acte présent en un acte passé ; et nous avons vu qu’avant'de résoudre ce problème, il nous fallait retrouver la forme la plus primitive de cette désinence, en la faisant remonter de l’anglais au gothique, et ensuite, si cela était nécessaire, du gothique au sanscrit. Nous revenons maintenant à notre première question : Qu’est-ce donc que le langage pour qu’un simple changement de forme, tel que
a a1-ii * /ri “i i v, rt n vi rt , 1 a l'v a a a o <rvA fl A T /aU a n T*- /a/»* a/7■
C61II1 c^LLi aiulLô ixappo udlio 16 pdbsagc lio x oi)V& a. ± ùvuoü/j
puisse avoir des conséquences aussi importantes ?
D’abord rendons-nous bien compte de la distinction
’ , , 1 , 7 . " h 1 J .
que nous voulons établir entre les éléments radicaux et les éléments formels d’une langue ; et par les éléments formels j’entends non-seulement les désinences des déclinaisons et des conjugaisons, mais aussi toutes les lettres, toutes lés syllabes qui servent à. marquer la dérivation, tout ce qui, en un mot, n’est pas un radical. Nôtre théorie de l’origine du langage devra dépendre en grande partie de l’idée que nous nous ferons de ces éléments formels,, en tant qu’opposés aux éléments radicaux du langage. En effet ceux qui regardent le langage comme un signe artificiel oü un produit de convention fondent leurs principaux arguments sur ces éléments formels. Les flexions des. mots, nous disent-uls, sont la meilleure preuve que le
t r 1
langage articulé a été inventé d’un, commun accord par certains hommes, afin de suppléer à l’insuffisance du
r ~ f v. I ■■ *,■>. '■■Jt' ■■■■■. ' ’ ■
. . .. ■ J T - t ■ - ■ 1 ■ - - \
_„l" ■ ' -..S Æ < 1 r| l. r - '
1 -S -■ . - - ■ . 'r-rt
* - \ i
262 LEÇONS SUR LA SCIENCE DU LANGAGE.
> ‘ , ' - " , ' " i ' - - ■ ' - , 1 ‘ . . .
langage naturel de l’humanité, c’est-à-dire des gestes du corps, dû jeu de la physionomie,, et des différents cris que nous arraché la douleur ou la joie. Pour ces philosophes, toutes les flexions ne sont que des lettres ou des syllabes dénuées de signification propre ; et quand on leur demande pourquoi un d ajouté à 1 love change, un amour présent en un amour passé, ou pourquoi Tat qui termine les futurs français indique qu’il est question de l’avenir, ils répondent que c’est parce que, à une époque très-reculée de l’histoire du monde, certaines personnes, ou certaines familles,, ou certaines pètites peuplades, étaient tombées d’accord pour vouloir qu’il en fût ainsi. .
D’autres penseurs ont pris le langage comme un tout organique^ doué en quelque sorte d’une vie propre, et ils ont expliqué ses éléments7 formels comme étant:produits par une végétation intérieure et naturelle; Les langues, disent-ils, doivent-être comparées,' non au. cristal qui se forme par agglomération autour d’un noyau, mais au germe qui se développe par sa force intime. Toutes les parties essentielles du langage existaient dans le germe
- ■'i ’ " T ~
s,
primitif aussi réellement (quoique seulement à l’état
- ",s - _ _ ■ ' " _ " æ
embryonnaire), que les pétales existent dans le bouton avant que le bouton s’épanouisse à l’air et au soleil (f). Dette hypothèse fut proposée pour la première fois par Frédéric Schlegel, et elle est encore en grande. faveur auprès de beaucoup de personnes pour qui les phrases poétiques tiennent lieu du raisonnement solide et sévère (2). -,
La science du langage n’adopte ni l’une ni l’autre de ces 7 8
SIXIEME LEÇON.
. ' - O
deux hypothèses. Quant à ceiie qui nous représente un groupe d’hommes discutant ensemble sur les exposants qu’il conviendrait d’employer pour exprimer les rapports marqués par Je nominatif, le génitif, le singulier, le pluriel, l’actif et le passif, le simple bon sens semble nous
- _ -i
dire que si des questions aussi abstruses avaient pu être traitées dans une langue dépourvue de flexions, on n’avait plus de motif pour imaginer un moyen de communication plus parfait. Quant à l’autre supposition, d’après laquelle il existerait dans le langage, c’est-à-dire dans les noms et dans les verbes, -un principe de végétation intérieure, tout ce que nous pouvons dire, c’est qu’une telle conception s’évanouit dès qu’on y regarde d’un peu près. Nous pouvons concevoir le langage comme étant un produit, mais nous ne pouvons le concevoir comme étant une bien comme des éléments dépourvus de signification propre, mais employés arbitrairement ou conventionnellement pour modifier le sens des mots. Les langues à flexions, dit Schlegel, sont des langues organiques, parce qu’elles contiennent un principe vivant de développement et d’accroissement, et que seules elles ont, si je puis m’exprimer ainsi, une végéLation féconde et abondante. Le merveilleux mécanisme de ces langues apparaît en ce que, après avoir créé une variété infinie de mots, ellès peuvent marquer la connexion des idées qu'ils expriment, à l’aide d’un petit nombre de syllabes, lesquelles, prises séparément, n'ont aucune signification, mais qui déterminent avec précision le sens des mots auxquels on les attache. En modifiant les lettres radicales, et en ajoutant aux racines certaines syllabes formatives, on obtient des dérivés de diverses sortes, d’où on peut encore tirer d’autres dérivés. En réunissant plusieurs racines, on forme des mois composés pour exprimer les idées complexes. Enfin c’est aussi à l’aide de désinences dépourvues de toute signification propre, que les substantifs, les adjectifs et les pronoms, sont déclinés avec leurs genres à leurs différents cas et nombres, et que les verbes sont conjugués à toutes leurs voix, à tous leurs modès, à tous leurs temps et à,toutes leurs personnes. De telle sorte qu’on a ce grand avantage d’énoncer en un seul mot l’idée principale, si complexe qu’elle puisse être, avec toutes les modifications qu’y apportent les idées accessoires ét les relations mobiles qui l’accompagnent. » — Transactions of tke Phi-lological Society, vol. 11, p. 39,
y

264- LEÇONS sua LA. science du langage.
substance douée elle-même de la faculté de produire. D’ailleurs la science du langage n’a pas à s’occuper de simples hypothèses, qu’elles se puissent ou non concevoir. Elle recueille les faits, et son seul objet est d’en découvrir la raison, et l’explication, en tant què cela est ' possible. Au lieu de regarder les flexions en général comme des signes de convention ou des excroissances naturelles, elle prend chaque désinence séparément, et quand, au moyen de la comparaison, elle en a rétabli la forme la plus ancienne, elle traite celte syllabe primitive comme elle traiterait n’importe quelle partie du langage, c’est-à-dire comme un mot qui a eu dans le principe sa signification propre. Quant à. la possibilité de saisir la pensée qui a présidé à la création première de chacun des éléments du langage, c’est là une tout autre question; et il faut bien reconnaître que beaucoup de formes grammaticales échappent encore à nos explications même après que nous en avons retrouvé le type le plus primitif. Mais puisqu’une induction pénétrante nous révèle toujours de plus en plus les Secrets intimes du langage, et
. -j - ’ - - l ■■ ■ ■ ' 1
que chaque année de nouvelles découvertes viennent couronner les travaux des linguistes, nous n’avons aucune raison de douter que l’analyse grammaticale ne donne avec le temps des résultats aussi certains et aussi complets que l’analyse chimique. Sans doute, quand nous considérons la grammaire telle que l’a faite le travail de tant de siècles, elle nous paraît parfois bien compliquée et obscure ; mais elle était à l’origine beaucoup plus simple et plus claire qu’on ne le suppose communément. Qu’est-ce que la grammaire, après tout, si ce n’est la déclinaison et la conjugaison ? et, originairement, la déclinaison n’a pu être autre chose que la juxtaposition, à la fin d’un nom, de quelque autre mot exprimant le nombre et le cas. Dans une leçon précédente, nous avons vu com-
ment on exprima lés nombres : là formation des cas résulta d’un procédé entièrement analogue.
En chinois le cas locatif est formé de diverses manières ; par exemple, en ajoutant au nom certains mots tels que cung, « le milieu », ou néi, « intérieur » (1). Ainsi on trouve kuô-cung, « dans l’empire », i sûi cung, « dans î’espace d’une année ». Le cas instrumental est formé à l’aide de la préposition ÿ, qui est une vieille racine signifiant se servir. Ainsi le chinois dit y ting, « avec un bâton, » là ou le latin emploierait l’ablatif et le grec le datif. Or, quelque compliquées que soient en grec et en latin les déclinaisons régulières et irrégulières, nous pouvons être certains qu’elles ont été formées dans le principe par ce simple procédé de la juxtaposition. '
Dans toutes les langues aryennes il y a eu primitivement un cas marquant le lieu et que les grammairiens ont appelé le locatif. En sanscrit tout substantif a son locatif, aussi bien que son génitif, son datif et son accusatif. Ainsi,, cœur se dit en sanscrit hrid; dans le cœur sq dit hrid-i. Ici donc la désinence du locatif est tout simplement un i bref. Cèt i bref est une racine démonstrative, et selon toute probabilité la racine même qui a donné en latin la préposition in. Le sanscrit hrid i représente donc un ancien mot composé, signifiant cœur-dedans, et cette désinence, en s’agglutinant au nom, finit par prendre place parmi les cas reconnus des substantifs terminés par une consonne. En nous reportant au chinois (2), nous trouvons qu’on y
forme le locatif de la même manière, mais en avant le
/ ' . . choix entre plusieurs mots pour exprimer le lieu. Nous
avons v-u que dans Vempire se dit kûô-cung, et que dans
l’espace d'une année se dit i sûi cung : mais on peut aussi
(1) Endlicher, Chinesische Grammalik, p. 172,
(2) Ibid. - . -
remplacer cimg par d’autres termespar exemple, par néi\ intérieur. .
On nous objectera peut-être que la formation d’un cas aussi primitif que le locatif n’offre guère de difficulté, mais que ce procédé de la juxtaposition ne saurait expliquer l’origine de cas plus abstraits, tels que le génitif, le datif et l’accusatif. En effet,' si c’est à la grammaire générale ou philosophique qu’on demande l’intelligence des différents cas, il sera difficile d’admettre qu’un procédé aussi simple que celui que nous venons d’indiquer, ait pu réaliser toutes les abstractions qui sont censées exprimées par les désinences du génitif, du datif et de l’accusatif. Mais rappelons-nous bien que ce ne sont là que des catégories générales dans lesquelles les philosophes et les grammairiens se sont efforcés de ranger tous les faits du langage. Les. hommes primitifs, au milieu desquels le. langage prit naissance et se développa, n’ont jamais connu ni le datif, ni l’accusatif, car tout ce qui est abstrait aujourd’hui dans le langage a été concret à l’origine.. Là où nous dirions le Roi de Rome, ils.auraient dit le Roi à Rome, en employant naturellement le cas que nous avons appelé le locatif ; tandis que l’idée plus abstraite du géni-. tif ne serait jamais entrée dans leur système de pensée. Bien plus, nous pouvons prouver qu’en fait le locatif s’est quelquefois substitué au génitif. En latin, par exemple, l’ancien génitif des noms terminés par. a était en âs, ainsi que nous le voyons dans pater familids, au lieu àepaler familial, ou poXev familiæ. L’ombrien, et l’osque ont toujours conservé Es comme signe du génitif des noms terminés par a. L’œ du génitif latin de la première déclinaison était primitivement a-i, c’est-à-dire l’ancien locatif en
i. Rex Romæ signifiait donc en réalité Roi à Rome. Et ici vous remarquerez que la grammaire, qui devrait être la plus logique de toutes les sciences, en est souvent la plus
illogique. •’L;enfant apprend au collège que s’il veut traduire en latin cette phrase, « je demeure à Rome », il devra mettre Rome au génitif. Ce n’est pas à nous à demander comment le grammairien peut torturer le sens du génitif de façon à lui faire exprimer le repos en un lieu : quoi qui!en soit, l’élève emploiera nécessairement, dans des circonstances analogues, le génitif de Carthage .(Car-thaginis) ou celui d’Athènes (À thenarum), et alors il faudra lui dire que ces génitifs ne peuvent pas être employés comme le génitif des noms en a. Nous ne savons comment la4grammaire générale explique cette contradiction, mais la grammaire comparée lève immédiatement toute la-difficulté. Elle nous apprend que le locatif ne s’est substitué au génitif que dans la première déclinaison seulement ; tandis que Carthaginis et À thenarum, étant de véritables génitifs, n’auraient jamais pu être employés pour désigner le lieu.'Un cas particulier, tel que le loeatif, peut etre généralisé et exprimer de la sorte l’idée plus générale du génitif, mais le phénomène inverse ne saurait se produire. •
Quand j’ai adopté l’opinion de feu le docteur Rosen et de M.‘Bopp, qui voient dans la terminaison latine du génitif singulier des noms féminins en a une ancienne terminaison du locatif, je n’ignorais pas les objections que l’on avait opposées à cette manière de voir; mais je ne me sentais pas ébranlé par ces objections, pas plus que M. Bopp, qui, dans la seconde édition de sa Grammaire comparée, maintient l’explication qu’il a d’abord donnée, de ce cas. Que la relation exprimée par le génitif puisse-être rendue par un locatif, c’est là un point qu’on ne saurait contester, car il est bien connu qu’au duel une seule terminaison, en sanscrit, sert pour les deux cas, le locatif et le génitif. Comme il serait difficile de soutenir, qu’un véritable génitif primitif ait pu être employé pour donner
„ ■
„ '/ s - '
; M-* »
268 LEÇONS SUR LÀ SCIENCE DU LANGAGE. • ;
- ~ , . L . r ■ f
/■
l’idée dun rapport de lieu, il semblerait s'ensuivre que. la terminaison du lobatif et génitif duel en os exprimait originairement un rapport d e lieu, et que graduellement elle a pris un sens attributif plus général. Il n’y a point à douter que le latin n’ait possédé, comme le grec, le génitif régulier en s, car nous trouvons.des formes archaïques telles, que escas, monetas, terras, fortunas ; et la form e familias est restée dans pater familias. En.osque, eii ombrien et en
sabellien les mêmes génitifs se rencontrent. (Gorssen, I,
" ‘ r * . » 1 .
769 ; II, 722.) Il est vrai aussi que, par le témoignage d’inscriptions anciennes, Ritschel a prouvé l’existence de génitifs latins en ais : ainsi l’on trouve Proserpnais au lieu ’ de Proséî'pinœ (voyez .Kuhn’s Zeitschrift, t. XÏI, p. 234, t. XIII, p. 445). Des formés affaiblies en: aes, telles que Dianaes, Juliaes, sont, plus fréquentes, et continuent à se rencontrer dans les inscriptions, même sous les derniers empereurs.. Toutefois il est maintenant prouvé que ces génitifs sont plutôt des formes grecques que latines (1), . et quand il en serait autrement, on ne pourrait pas les regarder comme lès formes originelles qui ont donné le génitif ordinaire en âi et âs. Sans doute le 5 latin est sujet à tomber, mais, autant qùe nous en pouvons juger dans l’état actuel de nos Connaissances, il ne peut le faire qu’a-près les voyelles brèves (2). C’est ainsi que nous trouvons
(1) Gorssen , Aussprache der Lateinischen. Sprache, 2e édition,
I, 686. . . ' : ;
. t ■ , ^ P 1 " , " ' -
(2) Je iie puis accepter l’explication que propose mon savant ami, le professeur Kuhn, de Berlin, dans l’essai qu’il vient de' publier (1866) sous ce litre : « Ueber einige geniliv und dâtiv Bildun-gen. » Sa théorie me parait contredire trois règles phonétiques bien établies : 1° Qu’aucun s final du sanscrit ne se perd devant une cohsonne sourde; 2° qu’aUcun s final en latin ne se perd après Une voyelle longue ; 3° qu'aucun s, au milieu d’un mot, en sanscrit, ne se perd devant y. Le verbe ojàya te ne constitue pas une exception à. cette dernière règle, car le thème réel en est oja, et non ojas. Voir aussi la Revue anglaise, The Academy, Jan. 1871, p. 403.
6 au lieu de -iis, amare au lieu de amans, pote au lieu de potis; mais nous në trouvons jamais mensî au datif: ou mensâ à l’accusatif pluriel au lieu de mensîs ou de mensâs. Le seul cas où Fon suppose qu un s final aurait été perdu après une voyelle longue, c’est le nominatif pluriel de la seconde .déclinaison. Ici. également, on ne saurait douter que des formes telles que magistreis n’aient existé dans le latin archaïque, au lieu de magistrî. Mais que la forme régulière magistrî ait dû son origine à la chute d’un s final, c’est ce qui n’a jamais été prouvé. Au contraire magistrî appartient à une date plus ancienne que magis-trîs (1), qui est probablement formé d’une base secondaire magistri, au lieu de magistro., comme nous trouvons la base acri à côté de la base acro (2). •
Ce seul exemple vous montre comment ce que les.gram-mairiehs appellent un génitif fut formé par le même procédé de composition que nous pouvons étudier dans le • chinois, et dont nous pouvons prouver l’existence dans le langage originel des Aryens. Le datif fut formé exactement de la même manière. Si l’on dit à un enfant que le datif exprime une relation d’un objet à un autre, moins, directe que; celle qui est marquée par l’accusatif, il aura sans doute de la peine à comprendre, cette hiérarchie de rapports ; mais il sera plus surpris encore si, quand .il aura , saisi cette abstraction grammaticale, ou lui dit que pour rendre en grec l’idéé très-bien définie de l’existence en un lieu, il doit mettre certains noms au datif ; qu’il doit dire, par exemple, Saldmînï dans la traduction de cette phrase « je demeure à Salamine ». Si vous cherchez la raison de cette règle, la grammaire comparée peut seule vous la donner. La désinence du datif grec en % était ori-
(•l)-Corssèn, Ausspracfie, 2eéd., i,p. 763. (2) Ibid., I, p. 736. . . . .
ginairement celle. du locatif. Le locatif peut très-bien exprimer une des relations que le datif réunit un peu confusément dans son domaine assez mai déterminé ; mais les traits effacés du datif ne peuvent jamais rendre la signification si nette et si accusée du locatif. Le datif Sala-mini a été d’abord un locatif. « Je demeure à Salamine » n’a jamais signifié «je demeure vers ou dans la direction de Salamine ». Le datif, au contraire, dans une phrase telle que « je le donne au père », a été originairement un locatif ; et après avoir commencé par exprimer la relation, pour ainsi dire, palpable de « je le donne, je le place sur ou dans le père »,. ce cas finit par revêtir peu à pe.u le caractère plus général, et moins précis et déterminé que les logiciens et les grammairiens attribuent, a leurs datifs (1).
Si l’explication que nous venons de donner dé certains cas en grec et en latin paraît trop artificielle ou trop forcée, nous n’avons qu’à regarder le français pour voir le même procédé s’appliquer encore sous nos yeux. Les rapports les plus abstraits du génitif et du datif, comme dans l’immortalité de l’âme, et dans cette phrase/e me fie à Dieu, sont exprimés par les deux prépositions de et ad qui signifiaient en latin « en naissant de, en sortant de »,.et « vers, du côté de », comme les prépositions of et to, qui ont remplacé dans l’anglais les désinences germaniques s et m marquaient aussi à l’origine un rapport de direction.. La seule différence entre nos cas et ceux des langues anciennes consiste en ce que l’élément déterminatif est placé . maintenant devant le mot, tandis qu’il
(I) « Les Algonquins n’ont qu’un seul cas, qu'on peut appeler le locatif. » — Du Ponceau, p. 158.
« Il n’y a qu’un seul cas. IL se forme par l’addition d’un i, et signifie dans, à, ou près de la chose mentionnée. — Collections for a Bandbook af lhe Shambala Language, p. 3 : Zanzibar, 1867.
. SIXIÈME LEÇON. - 274
O
s’ajoutait à la fin du mot dans le langage originel des Aryens.
Ce qui est vrai des cas des noms ne l’est pas moins des terminaisons des verbes. 11 peut paraître difficile de retrouver, dans les désinences des différentes personnes des verbes grecs et latins, les pronoms mêmes qui furent, ajoutés à un thème verbal pour exprimer/aime, tu aimes, il aime ; mais notre raison nous dit qu’à l’origine ces désinences ont dû être, dans toutes les langues, des pronoms personnels. Nous pouvons également être embarrassés par les terminaisons de thou lovest, he loves, et il n’est guère facile d’identifier st et s avec le thou et le he modernes ; mais nous n’avons qu’à placer en regard tous les dialectes aryens pour voir au premier coup d’œil qu’ils nous reportent à une série unique de désinences dont nous pouvons, sans peine, pénétrer le sens et découvrir l’origine. ‘
Examinons. d’abord quelques formes modernes, afin d’avoir plus de lumière pour suivre la marche obscure et parfois capricieuse du langage.: ou,, mieux encore, commençons par un exemple imaginaire, par ce que nous pourrons appeler une langue de l’avenir, afin de comprendre clairement de quelle manière peuvent prendre naissance certaines formes que nous appellerions des formes -grammaticales.
Supposons que l’heure de la délivrance sonne enfin pour les. esclaves d’Amérique, et que, fuyant bien loin de leurs persécuteurs, ils retournent dans la patrie de leurs pères, et s’établissent tous ensemble dans quelque contrée de T Afrique centrale, où, mettant à profit ce qu’ils auraient appris jadis dans la terre de leur captivité, ils pourraient, avec le temps, élaborer une civilisation à eux. Il serait très-possible que quelques siècles plus tard, un nouveau Livingstone découvrît chez leurs descendants une langue,
une littérature, des lois et des mœurs ayant une ressemblance frappante.avec celles de son pays. Quel problème intéressant s’offrirait alors aux historiens et aux ethnologues futurs 1 Eh bien 1 dans.l’histoire du monde antique il ÿ a des problèmes non moins intéressants, dont la science du langage nous donne ou nous donnera un jour là solution. Dans l’hypothèse que je faisais tout à l’heure, je suis convaincu que l’élude attentive de la langue parlée par les descendants de ces esclaves d’Amérique suffirait pour constater avec une complète certitude les principaux faits de leur histoire, quand même aucun document écrit ni aucune tradition n’auraient conservé le souvenir de leur captivité et de leur délivrance. Au premier abord on se trouverait, sans doute, en face de difficultés qui sembleraient insurmontables. Un missionnaire ou un voyageur surprendrait les savants d’Europe en envoyant, une notice sur cette nouvelle langue africaine. « Cette langue, dirait-il peut-être, est fort imparfaite et d’une'pauvreté telle qu’elle n’a souvent qu’un seul et même mot pour exprimer les idées les plus disparates : c’est ainsi que le son raü\ sans le moindre changement d’aCcènt, y signifie vrai, cérémonie, artisan et écrire (nght, rite, wright, Write). Quant aux flexions grammaticales, elle en . est presque aussi dénuée que le chinois: et elle n’attribue jamais de genre aux choses inanimées, excepté dans un nombre extrêmement restreint de cas, comme par exemple, en parlant d’un navire ou d’une locomotive qui sont toujours du genre féminin. Un fait très-curieux à relever, c’est que ces Africains, bien que n’ayant pas de désinences particulières pour le masculin et pour le féminin, attachent néanmoins une terminaison masculine ou une terminaison féminine à la particule affirmative, selon qu’ils s’adressent à un homme ou à une femme ; ils disent dans le premier cas yesr, et dans le second yesm. »
Si absurde que tout cela vous paraisse, il y a parfois, jé puis vous l’assurer, quelque chose déplus bizarre encore dans les descriptions que nous donnent missionnaires et voyageurs de la langue des tribus sauvages avec lesquelles ils se trouvent en contact pour la première fois. Voyons maintenant ce que le linguiste aurait à faire si des formes telles que yes’r et yesm étaient soumises pour la première fois à son examen. Il devrait d’abord les faire remonter historiquement àr leurs types les plus primitifs, et s’il parvenait à les rattacher à -y es sir q t à y es ma’m, il ferait observer que c’est surtout dans un dialecte vulgaire que l’on doit s’attendre à trouver de semblables contractions. Après avoir rapporté le yesr et le yesm des nègres d’Afrique, à l’idiome des Américains, les maîtres de leurs ancêtres, i’étymologiste aurait, ensuite à se demander comment ces expressions étaient venues à être usitées sur Je continent d’Amérique.
Comme il n’y trouverait rien d’analogue dans les dialectes des aborigènes de l’Amérique, il serait amené par une simple comparaison des mots, d’abord aux langues de l’Europe, et puis à celle de l’Angleterre. Quand même tous les documents historiques auraient péri, les mots, à eux seuls, prouveraient que la race blanche, dont les ancêtres de nos Africains avaient adopté le langage pendant leur captivité, était venue originairement d’Angleterre ; et dans de certaines limites, il serait même possible de déterminer l’époque de son arrivée en Amérique. Cette émigration a dû être postérieure au temps de Chaucer, car nous trouvons chez ce poète deux particules affirmatives,
yea slyes, et il ne les emploie pas indistinctement. Il ne
* s t j
mettes qu’après les interrogations qui contiennent une négation: par exemple, pour répondre à cette question, « n’y .va-t-il pas ? » il dirait yes. Partout ailleurs il emploie
yea. Chaucer fait la même distinction entre no et nay, • 48
\ ‘
répondant par la première de ces particules aux interrogations accompagnées d’une négation, et par la seconde à toutes les autres. Cette distinction s’est effacée peu de temps après l’époque de sir Thomas More (-1), et il faut qti’on ait cessé de l’observer avant que yes sir et yes madam , aient pu devenir des expressions consacrées par l’usage pour tous les cas.
Mais ces mots nous fournissent, encore d’autres renseignements historiques. Le mof yes, étant anglo-saxon et identique avec l’allemand ja, nous apprend que cette race blanche qui a traversé l’Atlantique après le temps de Cbaucer, avait traversé la Manche à une époque antérieure, lorsqu’elle quitta la patrie des Angles et des Saxons sur le continent d’Europe. Sir et madam sont des mots normands, et. ils n’ont pu être imposés aux Anglo-Saxons de la Grande-Bretagne que par des conquérants normands. Mais ce n’est pas tout : ces Normands ou Nortbmans parlaient dans l’origine un dialecte teutonique étroitement apparenté à l’anglo-saxon, et dans ce dialecte les mots sir et madam n’auraient jamais pu prendre naissance. Nous arrivons alors à celte conclusion qu’avant la conquête normande, lesNorthmans teutons ont dû faire dans une des anciennes provinces de l’empire romain un séjour assez long pour oublier leur propre iàngue et adopter celle de cette province.
Nous pouvons maintenant rattacher le normand madam au français.où nous reconnaissons une corruption du latin mea domina. Domina a donné domna, donna, et dame, et ce même mot dame a aussi été employé au masculin, dans le sens de « seigneur », comme corruption de domino, domno et donna. Celui qui anciennement tenait des terres d’un évêché, à condition de défendre le temporel de
(i) Marsh, p. 579.
î
1
l’évêque, et de commander ses troupes, était appelé vi-daine, comme le vidame de Chartres, etc. L’interjection dame ! signifie simplement seigneur ! Dame-Diex, cette exclamation si fréquente dans le vieux français, est Seigneur-Dieu (;I) I De domina on tira le dérivé dominicella d’où nous viennent le français demoiselle t l’anglais dam-sel. Plus tard on substitua au nom masculin dame, forme altérée de domino, le latin senior, qui était une traduction du mot germanique elder, plus âgé. Elder était un titre d’honneur et nous le retrouvons encore dans alderman et dans l’anglais earl (le norrois/a.W), qui est un comparatif analogue à l’anglo-saxon ealdor. Le titre de senior, qui signifiait originairement « plus âgé, » n’était donné que rarement aux dames (2). Senior se changea en seigneur, seigneur en sieur, d’où l’on tira ensuite l’anglais sir. .
. Nous voyons de celte sorte comment dans deux simples expressions telles que yesr et yesm, on peut lire de longues pages d’histoire. Quand même tous les documents historiques, et tous les livres seraient détruits, ainsi que cela s’est vu en Chine sous l’empereur Thsin-chi-hoang-ti
(1). Dame-Dieu :
<f Ja dame Dieu non vuelba .
Qu'en ma colpa sia ’l départîmeus. »
(Que jamais Je Seigneur Dieu ne veuille . Qu’en ma faute soit la séparation.)
« Grandes miracles fit dames Dex par lui. » Roman de Garin, Du Cange, t. II, col. 10, 19 ) — Raynouard, Lexique, au mot Don. .
Le latin dominus était devenu en vieux français damne, dan; mais c’est en catalan que cè mot atteignit les dernières limites de l’ecthi* Iipse, car il se réduisit à deux et même à une seule lettre. On disait tantôt En, tantôt N, avec un nom propre.d’homme : En Ramon, N Aymes, don Raimon, don Aimes. On dirait Ena, Na, de domina, avec un nom dô femme : Ena Maria, Na Is abc lia-, dame Marie, dame Isabelle. — Terrien Poncel, Du Langage, p. 791 ; Chevallet, t. II,
p. 161.
(â) Dans le vieux portugais, Diez cite Senhor rainha, mia sennor formosa, ma belle maîtresse.
\
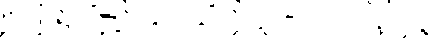
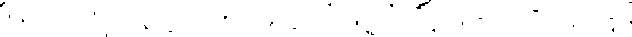
r m + S " p '

, 1 - * ^ f . - - * s ' r
276 LEÇONS SUR. LA. SCIENCE DU LANGAGE.
(2IB ay. J.-C.), le langage, si dégénéré qu’il fût,, conserverait encore les secrets du passé, et ferait connaître aux . générations futures la patrie et les migrations de leurs . ancêtres depuis les . Indes Orientales jusqu’aux Indes Occidentales.
Au premier abord il peut paraître, étrange de trouver aux deux extrémités des migrations aryennes ce même nom des Indes orientales et des Indes occidentales ; mais ces noms contiennent aussi leur enseignement historique. Ils nous disent que les races qui ont peuplé l’occident de l’Europe, les plus vigoureuses et les plus entreprenantes de toutes les races aryennes, ont appelé .Mes ces régions que, dans leurs rêves qui embrassaient le monde entier, elles croyaient être unprolongement.de l’Inde elle-même ;
. que plus tard elles reconnurent leur erreur et disfinguè-. rent alors les Indes occidentales des Indes orientales ; qu’elles formèrent de vastes États dans l’ouest; et que dans le lointain Orient un puissant empire fut fondé par . l’une d’entre elles, à qui il a été donné de saluer les lieux mêmes où habitait la. famille aryenne dans son . .unité .encore indivise, avant, quel le.se séparât pour, aller, à la découverte du monde. Tous ces faits et bien d’autres
encore, nous pourrions les retrouver dans les riches archives du langage. Le nom même de l’Inde nous donne
' plus d’une leçon, car ce n’est pas. un nom indigène. 11
*
nous vient des Romains, qui le tenaient des Grecs, les. t '
quels à leur tour l’avaient reçu des Perses..Mais comment savons-nous que ce nom a passé de la Perse en Grèce ? parce que c’est dans l’ancien perse seulement qu’un s initial se change en h ; les Grecs ont laissé tomber cet h selon leur habitude. C’est seulement dans le vieil idiome de l’Iran que le pays du 'Sindhu (sindhu est le mot sanscrit pour rivière), ou des sept sindhus, a pu être appelé Eindia ou ïndia au lieu de Sindia, Ainsi n’élait-ce que les disci-

pies de Zoroastre prononçaient tous les s comme des h, nous n’aurions jamais entendu parler des Indes occidentales !
Maintenant que nous avons vu par un exemple imaginaire ce que nous devons nous attendre à trouver dans le développement du langage, il nous sera plus facile de comprendre pourquoi il faut poser comme principe fondamental de la grammaire comparée, qu’aucune partie du langage ne doit être considérée comme purement formelle jusqu’à ce que la science ail échoué dans toutes ses tentatives, pour faire remonter ces éléments formels à leurs types primordiaux et substantiels. En supposant que l’anglais n’eût jamais été écrit avant le temps où fut composée la Vision de Fiers Ploughman, comment pourrions-nous nous rendre compte de là forme nadistou (I), au lieu de ne hadst l/iou, ou de l’expression ne rechi au lieu de 1 reck not ? Dans le dialecte du Dorsetshire nous trouvons al ô’m pour ail of lhem ; I midden pour Imay not ; 1 cooden pour 1 couldnol. Ce sont là sans doute des altérations bien sensibles ; mais les altérations que le sanscrit a subies avant de devenir une langue fixée par l’écriture, ont dû être bien plus profondes encore (2).. .
Examinons maintenant les langues classiques modernes, telles que le français et l’italien, où la plupart des désinences grammaticales sont les mêmes qu’en latin, à part les modifications apportées par la corruption phonétique. J'aime répond à ego amo, tu aimes à tu amas, il aime k.ille amat ; cette troisième personne du singulier
(1) Marsh, p. 387. Bar nés, Poems in Dorsetshire Dialect.
(2) Nous trouvons en angîo-saxon not pour ne woU je ne connais
pas ; nist, pour lie- did not Imow ; nisten^ pour they did not knovj nolde, pour ne ivolde, I looulcl not, je ne voudrais pas; nyie, pour 1 will not; naebbe, pour I hâve not ; naefth, pour he lias not ; nae-ro?i, pour they ivere not ; etc. ' •
r
était terminée dans l’ancienne langue française par un t qui réparait encore dans aime-t-il. De même l’imparfait français répond à l’imparfait latin, et le passé défini au parfait latin ; mais quand nous arrivons- au futurt nous ne trouvons plus aucune analogie entre arnabo etf aimerai. Yoici donc une nouvelle forme grammaticale, que nous avons, pour ainsi dire, vue venir au monde sous nos veux, ou qui, tout au moins, est née au grand jour de l’histoire. Eh bien, cette désinence mi est-elle sortie du corps du mot ainsi que les fleurs s’épanouissent au printemps ? ou bien, quelques esprits supérieurs se sont-ils réunis pour créer cette terminaison nouvelle et pour convenir de l’employer, à partir de ce jour, aù lieu de l’ancienne terminaison du futur latin ? Assurément il ne s’est rien passé de semblable. Nous voyons d’abord que dans toutes les langues romanes les désinences du futur sont identiques avec celles du présent de l’indicatif du verbe auxiliaire avoir (4). Ainsi nous avons en français :
■l H
|
• 9 * J .ai |
et |
je chanterai |
nous avons |
et |
nous chanterons |
|
tu as |
et |
tu chanteras |
vous avez |
et |
vous chanterez |
|
il a |
et |
il chantera - |
ils ont |
et |
ils chanteront. |
En espagnol et en provençal nous rencontrons la désinence apparente du futur,, employée comme mot indépendant non encore incorporé avec l’infinitif. En espagnol, au lieu de lo hare, je le ferai, nous trouvons la formé plus primitive hacer lo lie, c’est-à-dire fctcere id habeo ; et en
provençal air vos ai au lieu de je vous dirai, et dir vos em
■+r
au lieu.de nous vous dirons. Il est donc hors de doute que l’on forma originairement le futur des verbes romans en attachant à l’infinitif le verbe auxiliaire avoir ; et l’expression fai à dire ou je dire ai en est venue facilement à
(1) Survey of Languages, p. 21.
SIXIÈME LEÇON. 279
' . - - ■ l L 4 - a
rendre l’idée que nous exprimons aujourd’hui par je dirai (i). .
Cet exemple nous montre bien clairement comment les formes grammaticales prennent naissance. Un Français qui ne s’est jamais occupé d’études philologiques regarde les. terminaisons de ses futurs comme des formes purement grammaticales, et il ne lui vient pas à l’idée de les identifier avec le présent de l’indicatif du.verbe avoir...Les Romains ne soupçonnaient pas davantage que amabo fût un mot composé, et pourtant ce temps était formé à l’aide d’un verbe auxiliaire aussi sûrement que l’est le futur français, Le futur latin succomba aux ravages de l’altération phonétique. Quand les lettres finales perdirent leur
. - v
prononciation distincte, il devint impossible de ne pas confondre l’imparfait, amabam avec le futur amabo. Le procédé que nous avons déjà appelé le renouvellement dialectal fournit alors un futur nouveau ; en effet habeo se rencontrait quelquefois, en latin, uni à un infinitif, comme,
: par exemple, dans habeo dicere, et l’union de-ces mots est arrivée insensiblement à exprimer l’idée du futur (2). De quelque , côté que nous jetions les yeux, nous Voyons le futur exprimé au moyen de la composition. L’anglais
(1) Le premier, si je ne me trompe, qui ait ainsi expliqué l’origine du futur roman, c’est Castelvetro dans sa Correltione (Bâle, 1577). Il dit : « Cio è con lo ’nfinilô del .verbo, e col présente del verbo Iio, corne Amare Ho, Amare liai, Amare Ha. Leggere Ho, Leggere Hai, Leggere Ha, e cosi gli al tri. » P. IM. .
[Une citation intéressante, que nous empruntons à la Mammaire historique de la Langue française de M. Bracliet, met sous nos yeux l’origine du futur du verbe français être : Dans le Recueil d'inscriptions romaines de Gruter (n° 106'?, 1), on lit cette épitaphe trouvée à Rome dans une église du septième siècle : Cod eslis fui et quod sum essere abêtis, c’est-à-dire quod estis, fui : et quod sum, esse habetis ; ce que vous ôtes, je le fus, et ce que je suis, vous le serez. (Tr.)l ' •’ . _
(2) Fuchs, Romcmische Spracheny p. 344.
280 LEÇONS SUR LA. SCIENCE DU LANGAGE.
. , ' - * '
emploie 7 shall ei 1 will, « je dois » et « je veux. » L’allemand forme son futur à l’aide de werclen (le gothique vairthwi) qui signifiait primitivement « aller, se diriger vers » ; le grec moderne à l’aide de lhelô, « je veux, » comme dans thelô dôsei, je donnerai; el le roumain à l’aide de vegnir, venir, comme dans veng a vegnir, je viendrai ; tandis qu’en français cette expression je viens de dire équivaut à un passé. Je vais dire est presque un futur, bien que cette expression vienne originairement de vado dicere. Le verbe'£o go, « aller, » est employé dans un sens tout à fait analogue dans le dialecte duDorsetshire, comme dans cette phrase : I be gwâin to goo a-pinkèn siuones, je vais ramasser des pierres. Il est non moins certain que dans les deux dernières lettres de amabo nous retrouvons l’ancien auxiliaire bhû, « devenir » de même que dans cra, désinence du futur en grec, nous retrouvons l’ancien auxiliaire as être (t). .
(!) Le futur se dit en grec ô jaeXXcov, et le verbe piXXw est employé eu grec comme auxiliaire pour former, certain s futurs.. Ce verbe a des significations diverses, mais on peut les rattacher toutes au sanscrit man (manyale), penser. De même que anya, autre, se change en «XXoç, ainsi ma n ye, je pense, se retrouve dans l/.eXXo) . J l., II, 39 : 6'^GEtv IV ejj.eXXev Itt’ âXyea te cTOVccyccç te Tptocri te xal Àavaotjt, « il pensait encore à causer des maux et des souffrances aux Troyens et aux Grecs »> 7/., XXIII, 544- : (aéXXecc asfztp^cecQai «e0Xov, «Ui penses que lu m’aurais enlevé le prix. » 0<L,‘XIÏI, 293 : oux ap’ Ep.£)sXeç X'^Eeiv; « ne pensais-Lu pas à l’arrêter? c’est-à-dire n’allais-tu pas l’arrêter ? » Ou bien encore dans cette phrase : 77., 11, 36 : toc ou TE>v£cr£<70at £{jceXXov, « ces choses ne devaient pas s’accomplir, « littéralement, « ces choses ne voulaient pas être accomplies. » Ainsi on employait piXW en parlant de choses qui devaient probablement arriver, comme si ces choses voulaient elles-mêmes s’accomplir ou ne pas s’accomplir. Et quand plus tard les Grecs oublièrent la signification originelle de [jce'XXw. ce verbe devint un simple auxiliaire marquant la probabilité. MéXXm et piXXou.cc t, dans le sens d'hésiter^ trouvent également leur explication dans.le sanscrit man, penser du considérer. L’ancien norrois formait également le futur à l’aide de piun, « se proposer, vouloir. » •
(Dans tout le centre de la France, les paysans font un usage f ré-
ISTo'us retournons maintenant sur nos pas et nous nous adressons pour la dernière fois cette question dont nous avons dû différer Ja solution jusqu’à présent : Gomment se fait-il que la simple addition du d dans le prétérit anglais îloved, ait pu exprimer la transformation d’un amour présent en un amour passé? Puisque la langue anglaise dérive de l’anglo-saxon, et qu’elle est étroitement apparentée au saxon du continent et au gothique, nous nous
s x
reportons immédiatement au prétérit gothique, afin de voir si nous n’y pouvons pas découvrir quelques traces de la manière dont ce temps fut composé dans l’origine : car après tous les exemples qui nous ont passé sous les yeux, nous devons bien nous attendre à ce que, dans ;çe cas-ci comme dans les: autres, les désinences grammaticales ne soient que des débris de mots indépendants. .
Il y a en gothique un verbe nasjan,.-nourrir, qui fait au
|
indicatif : |
<* | |
|
singulier |
. duel |
pluriel |
|
nasfi-da |
nas-i-dèdu |
nas-i-dêduïn |
|
nas-i-des |
nas-i-dêtuts |
nàs-i-dêduth |
|
nas-i-da |
. - ■ |
nas-i-dêdun. |
- . t F ■
Le même verbe fait au prétérit du subjonctif:
nas-i-dêdjau nas-i-dêdeiva 'nas-i-dêdeima nas-i-dêdeis nas-i-dêdeits nas-i-dêdeith nas-i dêdi nas-i-dêdema.
En anglo-saxon ces deux temps ont été réduits de la manière suivante : .
quent de vouloir pour exprimer le futur. Des phrases comme il ne veut pas :mourir encore, elle ne veut pas nous quitter, sont, constamment employées pour dire : « il ne mourra pas encore, elle ne nous quittera pas. » Tr.) .
Prétérit de l'indicatif
|
. singulier . |
. pluriel |
|
ner-ë-de |
ner-ë-don |
|
‘ ner-ë-dest . |
ner ë-don |
|
• " ner-ë-de |
ner-ë-don |
|
Prétérit du |
subjonctif |
|
. ner-ê-de |
ner-ë-don |
|
ner-ë-de |
ner-ë-don |
|
ner-ë de |
ner-ë-don |
|
Yoyons maintenant le prétérit du verbe | |
|
en anglo-saxon : | |
|
t singulier |
pluriel |
|
dide |
didon |
|
didest . |
didon |
|
dide |
didon. |
. Si nous, ne connaissions que le prétérit anglo-saxon nerëde et l'anglo-saxon dide, il ne serait pas très-facile de constater l’identité de ce dernier mot avec le de de nerëde. Mais ici vous remarquerez combien le gothique remporte
sur tous les autres dialectes teutoniques pour tout ce qui
# •
tient à la comparaison et à l’analyse grammaticales. Ce n’est qu’en gothique, et encore aux personnes du pluriel seulement, que' nous trouvons le verbe auxiliaire avec ses formes pleines et entières dédnm, dêduth, dêdun; car les formes du singulier, nasida, hasidês, nasida sont mises pour nasideda, nasidedês, nasideda,. Cette même contraction a eu lieu en anglo-saxon, non-seulement au singulier, mais aussi au pluriel. Pourtant telle est la similitude entre le gothique et l’anglo-saxon qu’il n y a point à douter que leurs prétérits n’aient été coulés dans le même
moule. Si nous pouvons avoir foi au raisonnement par induction, il a du y avoir originairement un prétérit anglo-saxon (f) ainsi constitué :
singulier pluriel
ner-ë-dide ner-ë-didon
ner-ë-didest . ner-ë-didon
ner-ë-dide ner-ë-didoîi.
. Et de même que ner-ë-dide s’est réduit à nérëde, ainsi nerëde donnerait nereden anglais moderne. Par conséquent, le d du prétérit qui changé J Zone en I loved, était dans l’origine le verbe auxiliaire to do, et I loved équivaut à I love did, ou 1 did love. Dans certains patois anglais, comme par exemple dans celui de Dôrsetshire, on forme le prétérit à l’aide de did (â), quand on veut exprimer une action qui dure ou qui est souvent répétée.; on distingue ainsi entré « }e died eesterdae, il est mort hier, » et « the vo’ke did die by hundreds, on mourait par centaines, » bien que died soit originairement identique avec die did. ;
i - ^ ' if*
Ici nous devons aller au-devant d’une question qui se présentera tout naturellement à l’esprit, et.expliquer comment a été formé le prétérit anglais did (l’anglo-saxon dide), et comment il est venu à signifier le passé. Dans dide la syllabe de n’est pas une désinence, mais la racine elle-même, dont di est Un redoublement. Effectivement les prétérits dë.tous les verbes anciens ou forts, ainsi que les: appellent les grammairiens modernes, étaient formés dans les langues teutoiliques de même qu’en grec et en sanscrit, au moyen du redoublement, qui est un dès principaux procédés grammaticaux pour donner aune ra-
\(i) Bopp, Gi'ammaire comparée, § 620; Grimm, Grammaire allemande, II, 843. - . ..
(2) Barnes, Dôrsetshire Dialect, p. 39. .
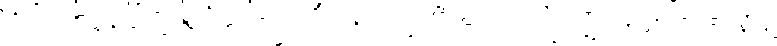
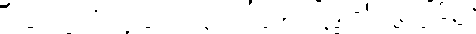
LEÇONS SUR LA. SCIENCE DU LANGAGE.
cine la force d’un verbe (-î). La racine do en anglo-saxon est la même que la racine ihe-dans le grec tûhemi, et que la racine sanscrite d h â dans d a d h à mi. L’anglo-saxon dide répondrait donc au sanscrit d a dhau, je plaçai.
C’est de la même manière que la plupart des formes grammaticales dans les langues aryennes ou indo-européennes ont été rattachées à des mots indépendants,- et que les plus légers changements, tels que celui de foot en feet, ou de jlncl en found, qui a première vue semblaient devoir échapper à toute analyse, ont reçu leur explication claire et complète.-Nous voyons donc maintenant ce qu’on entend par la grammaire comparée, qui est l’analyse scientifique des éléments formels du langage, précédée par l’étude comparative de toutes les formes diverses qu’a revêtues une seule et même désinence dans les nombreux dialectes d’une même famille de langues. Les dialectes qui sont du plus précieux secours pour la grammaire comparée de là famille aryenne, sont le sanscrit, le grec, le latin et le gothique ; mais bien souvent le zend et les . dialectes celtiques ou,slaves répandent un jour.inattendu sur certaines formes qui resteraient obscures et inintelligibles, si on neTpouvait les étudier que dans les quatre langues principales. Les résultats obtenus par des travaux
. tels que la Grammaire comparée de Bopp peuvent se résu-
■■ ,►
mer en quelques mots. Les lignes essentielles de la grammaire indo-européenne étaient fixées avant que la famille -aryenne se fût brisée en nationalités distinctes. C’estpour-;quoi les grands faits grammaticaux, la dérivation, la déclinaison et la conjugaison, sont en réalité les mêmes dans le sanscrit, le grec, le latin, le gothique et les langues congénères; les dissemblances apparentes trouvent leur
(1) Voir Max Millier, Leüer on ihe Turdnicm Languagès, pages 44,46. . .
explication dans les, particularités phonétiques propres à chaque nation, et, ainsi que nous l’avons fait observer dans une leçon précédente, ce qu’on ppelle l’histoire ou le développement des langues aryennes n’est après tout que la marche de la corruption phonétique. Lorsqu’on est parvenu à faire remonter les désinences grammaticales de toutes ces langues à leur forme la plus primitive, il est possible, dans bien des cas, d’en retrouver la signification originelle. Toutefois ces découvertes ne peuvent reposer que sur des inductions seulement, car la période durant laquelle les parties constitutives de la grammaire aryenne primitive gardèrent, dans le parler et dans l’esprit des Aryens, cette existence distincte que nous avons j observée dans le futur provençal dir vos ai,,cette période était arrivée à son terme avant que le sanscrit fût. le sanscrit ou que le grec fût grec. Quant à la réalité de cette période antéhistoriqüe, il nous est tout aussi impossible,; d’en douter que de l’existence des antiques forêts qui ont précédé la formation de nos bassins houillers. : :
Mais nos inductions nous permettent de pénétrer plus profondément dans la vie de ces premiers: âges. En sup-. posant qu’il ne nous restât aucun fragment du latin, et. que le nom même de Rome et celui de l’idiome qui s’y parlait nous fussent inconnus, la comparaison des six dialectes romans nous permettrait d’affirmer qu’il y eut un temps où tous ces dialectes se confondaient en une’ langue parlée par une peuplade peu nombreuse ; et eni rassemblant les mots qui sont communs à ces dialectes, nous pourrions, dans une certaine mesure, reconstruire le langage originel, et tracer un tableau de: la civilisation, des Romains telle qüe nous la trouverions reflétée par ces" mots communs. C’est ainsi que la comparaison du sanscrit, du grec, du latin, du gothique, du celtique et du, slave, nous révèle la situation matérielle, politique et mo-raie de nos ancêtres. Les mots qui ont, autant que cela est possible, la même forme et la même signification dans toutes les langues indo-européennes, ont dû exister avant la dispersion de la famille aryenne, et si nous les interprétons avec soin, ils nous feront connaître le degré de civilisation qu’avaient atteint les Aryens avant de quitter leur patrie commune. Le langage seul suffit pour prouver qu’à l’époque dont nous parlons- les Aryens menaient la vie d’agriculteurs nomades, semblable à celle que nous dépeint Tacite dans son De moribus Germaniœ. Iis connaissaient le labourage, le tissage et la couture ; ils savaient faire des routes, et bâtir des maisons et des navires ; ils avaient compté au moins jusqu’à cent. Ils avaient rendu domestiques les animaux les plus utiles, la vache, le cheval, la brebis et le chien; ils connaissaient les principaux métaux, et ils se servaient de haches de fer, soit pour la guerre, soit pour les travaux, de la paix. Ils avaient reconnu les liens du sang et du mariage ; ils obéissaient 'à des chefs ou rois; ët iis avaient sanctionné par des coutumes et par des lois la distinction entre le bien et le mah Ils avaient concu l’idée de la divinité et ils l’.invo-
.................O
quaient sous des noms divers. Tous ces faits nous sont révélés par le langage. Car si nous trouvons dans le grec, le latin, le gothique, le celtique ou le slave qui, une fois détachés de la souche commune, n’ont guère eu de contact avec le sanscrit, le même mot que dans cette dernière langue pour exprimer le fer, n’est-ce pas la preuve péremptoire que le fer était connu avant la séparation de la.famille aryenne? Or- fer se dit en gothique aïs et en sanscrit ayas , et puisque ce mot n’apuêtre emprunté par les Indiens aux Germains, ni par les Germains aux Indiens, il s’ensuit nécessairement qu’il existait au temps où les •ancêtres de ces deux peuples vivaient en commun. Nous ne rencontrerions pas le même nom pour maison en sans-
? ,
m
i
crii, en grec, en latin, en slave et en celtique (4), si les : maisons n’avaient pas été connues avant la séparation de . ces dialectes. C’est en procédant de la sorte qu’il a été possible dé tirer de l’étude attentive du langage une histoire de la civilisation aryenne- remontant bien au-delà
. ' - V ' -
des temps où les documents historiques peuvent atteindre (2). . . , ;
Le nom même d’Âry a appartient à cette histoire, et je consacrerai le reste de cette leçon à raconter l’origine de ce vieux mot et comment il s’est répandu dans le monde.: Si le temps me l’eût permis, j-aurais voulu dire quelques mots, aujourd’hui de la Mythologie comparée, cette branche de notre science qui fait pour les mots altérés ce que fait la grammaire comparée, pour les désinences, èn décorn vrant leur forme et leur signification primitivës : mais ces explications nous entraîneraient trop loin ; et comme on m’a souvent demandé d’où est venu le nom à!aryenne \ à la famille de langues dont nous venons de nous occuper,
r ■
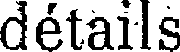
je sens qu’il- est de mon devoir d’entrer à ce sujet dans certains
Ârya est un mot sanscrit, et dans le sanscrit de l’épo-; que que nous appellerons moderne il signifie noble, de bonne famille. Mais originairement c’était un nom-national, ? et nous le trouvons encore avec cette signification dans le « recueil des lois des Mânavas, où l’Inde est appelée Ârya-^ avaria, la demeure des Âryas (3). Dans le sanscrit archaïque, dans les hymnes des védas, ârya se rencontre fréquemment comme le nom d’une nalion, comme un titre :
(1) Se. dama ; grec oojxoç ; lat. domus ; slav. domü: celt. daimh. î
(21 Voir .Max Müller, Essay on Comparative Mytfiology, Oxford Essays, 4 856 ; traduit en français, par M. George Perrot, dans les Essais sur là Mythologie comparée, les Traditions et les Coutumes, Paris, Didier, 4873. -
(3)Ârya-bhûmb et Ârya-desa,.sont usités dans le même sens.

6
d’honneur, qui désigne les adorateurs des dieux qu’invoquent les brahmanes, et qui les disiingue.de leurs ennemis ; ceux-ci sont appelés dans les védas Dasyus. Ainsi dans le Rig-veda, I, 57, 8, nous lisons l’invocation suivante à l’un des dieux, Indra, qui, sous certains rap-• ports, répond bien au grec Zeus : « Connais les Àryas, ô Indra, etÆceux qui sont Dasyus ; punis les impies, et livraies aux mains de ton serviteur ! Sois le puissant auxiliaire -de ceux qui adorent, et. je célébrerai les bienfaits aux jours de fête. »
Dans la littérature dogmatique des derniers temps de . l’âge védique, irya est le nom distinctif des trois premières classes, les Brahmanes, les Kshatriyas et les Yaisyas, pour les séparer de la quatrième classe les Sûdras. Dans la sata-;patha-Brâhmana il est écrit en terme précis : « Les Brahmanes. les Kshatriyas et les Yaisyas sont seuls iryas, car ils sont admis aux sacrifices. Ils n’adresseront pas la parole à tout le monde, mais seulement au Brahmane, au . Kshatriya, et au Yaisya. S’ils ont à parler avec un Sûdra,
: qu’ils disent à un autre homme : Dis ceci à ce Sûdra. Telle est la loi. »
Dans FÂtharva-veda (ÏY, 20, 4 ; XIX, 62, 4) nous rencontrons celte expression « voyant toutes choses, le Sûdra comme l’irya, » où Sûdra et irya sont mis .pour le genre ’ humain tout entier. ' '
Ce mot âry a avec un â long est dérivé de ary a avec un a b ref e t d an s 1 e san s cri t m o dérn e ce n oih d e a r y a a v ec a b ref s’applique au Yaisya ou membre delà troisième caste (1). Ce qu’on appelle la troisième caste a dû se composer ‘à l’origine de la grande majorité de la société brahmanique, puisque tous ceux qui n’étaient ni soldats ni prêtres étaient des Yaisyas. On comprend donc facilement qu’un nom, qui
(i) Pânini 111, 1,103. Encyclopaedia Britannica, au mol Ary an.
s’appliquait primitivement aux propriétaires et .aux cultivateurs du sol, ait pu être usité par la suite pour désigner tous les Aryens en général (4). Mais d’où ce nom de arya était-il venu dansle principe, c’est là une question dont l’examen approfondi nous demanderait trop de temps. Pour le présent je dois me contenter de dire que la signification étymologique d’Àrya semble être « celui qui laboure ou: cultive, » et que ce mot se rattache à la racine de arare(\). Il semblerait que les Aryens eux-mêmes firent choix de ce nom pour se distinguer des races nomades, les Touraniens, • dont le nom primitif Toura exprime la vitesse du cavalier.
Dans l’Inde, ainsi que nous l’avons vu, ce nom d’Arya,-
, „ j
en tant que nom national, tomba plus tard dans l’oubli, et ne fut conservé que dans le mot Âryavaria, le séjour des Aryens (2). Mais il a été gardé plus fidèlement par les Zoroastriens qui émigrèrent de l’Inde vers le nord-ouest, ;
(1) Dans un des védas, arya avec un a bref, est employé comme ; âry a et opposé à sudra. Nous lisons (Vâg-Sanh, XX,17) :
« Quelque faute que nous ayons commise dans le village, dans la forêt, dans la maison, en plein air, contre un Sudra, contre un ; Arya, tu es notre salut. » .
(2) Bopp dérivait âry a de la racine ar «aller» ou de arA".
« vénérer. » La première étymologie donnerait un sens complète- . ment insuffisant; la seconde est phonétiquement impossible. Lassen pense que âry a signifie adeundus, comme à A™ arya « le maître qui enseigne, « ce qui n’expliquerait pas arya. Cet arya ne déut pas être un participe futur passif, parce qu’il faudrait alors que là racine prît le vridd hi ; nous pourrions expliquer âry a, mais non arva (Pâ?t. ilf, r, IM). Je regarde arya comme formé par le suffixe taddhila y a, de même que d i v - y a, cœlestisi c’est-; à dire divi-bhava, de div, cœlum, ou de même que sît-yam « labouré, » de sîtâ « sillon ; » tandis que arya, avec le v?'iddhi,.: dériverait de arya, ou serait formé comme vais-y a « maître de maison, » de vis « maison. « Dans ar, on arà, je trouve un des plus anciens noms de la terre, envisagée comme labourée, nom perdu en sanscrit, mais conservé dans le grec tp-oc(gothique air-lha), : de sorte que arya aurait signifié originairement un propriétaire foncier, un cultivateur du sol,-tandis que vais-3ra, de vis, dési-; gnait un maître de. maison. Ida, fille de Manon, est un autre nom de la terre cultivée, et probablement une modification de arâ* ;
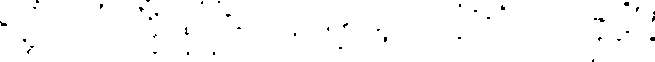
H,
K'
' /

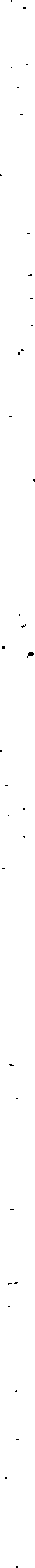
r
” _ B r y ■
290 LEÇONS SUR LA SCIENCE DU LANGAGE.
et dont nous pouvons étudier les doctrines religieuses dans les fragments du Zend-Avesta, qui sont parvenus jusqu’à nous. Or en zend le mot Airya signifie vénérable, et il est en même temps le nom du peuple (4). Au premier chapitre du Vendidâd, dans lequel Ahouramazda explique à Zarathoustra Tordre dans lequel il créa les différentes parties de la terre, nous trouvons l’énumération de seize contrées qui étaient, toutes pures et parfaites au sortir des mains d’Ahouramazda, mais qui furent souillées, successivement par Angro mainyus. ou Ahriman. La première de ces contrées est appelée Airyanem va ego, Arianum semen, la semenceou la souche des Aryens, et l’on suppose qu’elle était située sur les versants occidentaux du Belourg-. lagh et du Mustagh, près des sources de l’Oxus et de Tlaxarte, sur le plus haut plateau de l’Asie centrale (2). De cette contrée qui est. appelée leur souche, les Aryens, d’après leurs propres traditions, se dirigèrent vers le sud et vers l’ouest ; et dans le Zend-Âvesta toute la région occupée par les Aryens est également appelée Airya. L’horizon général du monde zoroastrien serait marqué par une ligne qui, partant de l’Inde, suivrait la chaîne du. Paropamise à l’est, et après avoir remonté vers le nord entre TOxus et Tlaxarte (3) longerait la mer Caspienne de façon à com-
(1) Cependant le révérend docteur Wilson nous apprend, dans ses Notes sur les éléments constitutifs de la langue 51 a r à l li I. p. 3,
. que Âïyâr « Aryen » est le nom donné à un Marâî.hâ par son voisin du Canara, et que ce même nom de Aryâr est aussi donné aux MarâZ/iàs par la tribu dégradée des Mangs, qui est établie ! sur leur territoire. Le même savant .distingué fait remarquer que ' Ariake est le nom donné à une grande partie du pajrs de Mâraîàâ par le commerçant et navigateur Arrien, que l’on croit contempo' rain de Ptolémée. — Vincent, Periplus, vol. II, pp. 397, 428-433.
(2) Lassen, Ind. Alt., t. I, p. 526.
. (3) Ptolémée connaît les ’Apioxai, près de l’embouchure de
Tlaxarte. Ptol. VI, 44; Lassen, toc. citI, 6. Dans Pline, VI, 50, on • doit changer Ariacæ en Asiotæ. Voir Müllenhoff, Monatsberichte der.
. Berliner Akademie, 4866, p. 551.
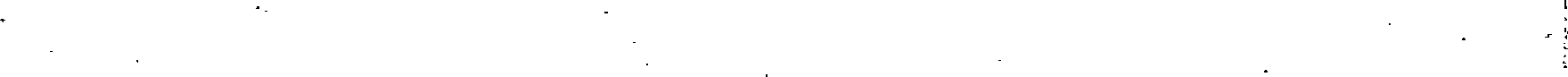
prendre l’Hyrcanie et le Râgha, et qui descendrait,ensuite
vers le sud-est par les frontières de. la Nisæa, de l’Àrie
, . - _■ •_ . .
(c’est-à-dire Haria) et des contrées arrosées par lEtyman-der et l’Àrachotos, Ce serait là ce qui est appelé dans le quatrième cardé du Yast de Mithra « toute la région de-l’Àrie, » vispem airyô-sayanem (totum Àriæ situm) (4). Le : Zend-Âvesta distingue les contrées aryennes des contrées
- +- " ■ .1
non-aryennes (anaîryâo dainhâvô) (2), et nous trouvons le vestige de ce nom dans les zAv<xptaxai qui habitaient sur les frontières de THyrcanie (3). Les géographes grecs ' donnent au nom d’Àriana une signification encore plus étendue que le Zend-Avesta. Tout le pays entre l’océan In-dién au sud, l’Indus à l’est, THindou-lCoush au nord, les Portes caspiennes, la Caramanie et l’embouchure du golfe Persique à l’ouest,: est compris par Strabon. (XY* 2) sous le nom d’Âriana; c’est ainsi qu’il a pu appeler la Bactriane « l’ornement de toute l’Àriana » (4). La religion de Zoroas-tre s’étant répandue vers l’ouest, la. Perse, l’Élymaïde et Ja
Mèdie tinrent à honneur de s’appeler aryennes. Hellanicus, qui écrivait avant Hérodote, cite Arya comme un nom de la. Perse (5). Hérodote (YIÏ, 62) nous apprend que les
(!) Burnouf,• Yaçna, Notes, 61. Le Zend-Avesta emploie, dans le même sens, l’expression « provinces aryennes, » airyandm da-, qxjunâm, gén. plur., ou airyào dainhdvd, provincias Arianas. Burnouf, Yaçna : 442, et Notes, p. 70.
(2) Burnouf, Notes, p. 62. . ;
(3) Strabon, XI, 7,11; Plin., Hist. nat., Vï, 19; P toi., VI, 2 ; De Sàcy, Mémoires sur diverses antiquités de la Perse, p. 48 ; Làssen, r Indische Alterihumskunde, I, 6.
(4) Strabon, Xï, 11 ; Burnouf, Yaçna, Notes, p, 110, « Dans un
autre passage, Ératostliène est cité comme prenant pour limite occidentale une ligue qui séparerait la Parthiène de la Médie, et la Caramanie de la Parétacèrie, comprenant ainsi la ville de Yezd et le Kerman, mais non pas la province de Fars. — Wilson, Ariana an. tiqua, ’p. 120. . _ .
(5) Hellanicus, frag. 166, éd. Muller : yÀpta Hepdx'Vx«pa-.. .
Mèdes s’app elaient At-ii ; ;et Etienne de Byzance nous a conservé le nom d’Âriana (non pas Aria) pour l’Atropatène, la partie septentrionale de la Médie. Quant à l’Elymaïde, on l’a fait, venir de Aüama qu’on a supposé être une corruption de Airyama (1). Les habitants de la Perse, de la.Médie, de la Bactriane et delà Sogdiane parlaient tous à peu près le même idiome (2) ; il n’est donc pas extraordinaire qu’ils aient youIu avoir une dénomination commune qui les réunît contre les tribus hostiles du Touran.
Les inscriptions cunéiformes de Darius nous fournissent la preuve évidente que le nom d'Aryen était donné comme titre d’honneur dans l’empire des Perses. Darius lui-même s’appelle Ariya el Ariya-chitra, « aryen » et « de descendance aryenne; » et dans la traduction touranienne de l’inscription de Behistoun, Ahouramazda ou Àuramazda, ainsi que l’appelle Darius, est rendu par « le dieu des Aryens. » Ce même mot se retrouve dans beaucoup des noms historiques des Perses. Dans les inscriptions l’aïeul de Darius est appelée. Àfiyârâmnas le grec Ariaramnës (Hérod. YII, 90).. Àriobarzanës (c’est-à dire Euergetës), Ariomanës (c’est-à-dire Eumenës), Àriomardos nous reportent tous à la même origine (3).
Dans un passage cité par Damascius, Eudémus, disciple d’Aristote et presque contemporain des inscriptions de
(1) Joseph Müller, Journal asiatique, -1839, p. 298. Lassen, ouvrage cité, I, G. C’est de ce mot que vient l’Élam de la Genèse. Voir Mélanges asiatiques^ I, p. 623. Dans les inscriptions cunéiformes qui reproduisent la-prononciation du persan sous la dynastie des Achéménides, la lettre l manque complètement relie est remplacée par un r dans les noms de Babylone et d'Arbela. Mais le l reparaît dans les inscriptions des Sassanides où l’on, rencontre Ailân et Airân., Anilâ et Auirân.
(2) Heeren, Ideen, 1, p. 337 : ôp.oyXto'rroc -rrapà ixtxpov. Strabon, p. 4054.
(3) Chez les Mèdes, une des classes était appelée ’ApiÇcomoi, où nous retrouvons peut-être le mot âryajantu. Herod., I, loi.
Darius, emploie cette expression « les Mages et toute la race aryenne » (-1), évidemment dans le même sens que le Zend-Àvesta donne à « toute la région d’Àrie. » .
Et lorsque, après avoir subi pendant de longues années l’invasion et l’occupation étrangères, la Perse recouvra son indépendance sous le sceptre des Sassanides, nous
_ -■ ‘ - " " T - " _ "
voyons les nouveaux rois nationaux, .adorateurs de Mas-danes, prendre dans les inscriptions déchiffrées par De. Sacy (2) Je titre de « Rois des Aryens et des non-Aryens; » , en pelilvi, Zra?i va Anitân; en grec, JÀpidmv -Aal ’Avapiâvw, ;
Le nom moderne de la Perse,Iran, rappelle: encore cet
ancien titre. ' - •
■* ,
On a supposé que le nom de Y Arménie contient le même élément Arya (3). Toutefois Arménie ne se rencontre pas dans le zend, et le nom d[Armina qui désigne l’Arménie dans les inscriptions cunéiformes' est d'étymologie dou-leuse (4). Dans la langue .de l'Arménie, ari est employé dans le sens le plus étendu pour signifier Aryen ou Iranien ; il a aussi le sens de brave et il s’applique particulièrement aux Mèdes (5). Nous voyons donc que, tout en
(1) Mcr/oi oè'xat tïkv to vAp£tov ylvoç, wç y.ai touto ypaœei ôEucrju.oç,
Oi U£V TOTïOV, 01 Ot Y60VQV XaXoUCl TO VOr,TÇfV a~0CV xal TO y;vOJa£VOV * IL
o ii oiaxptOxvai vj (kov aya0ov y ai Ôxiu.ova xaxov y cpcoç xal gxoto; ttpo tou-
TtOV, (.OÇ IvLuÇ À£V£!.V. OûTOl ûï . OüV XCtl aé-TCt (X£-à -yy àoïKXpiTOV ZVGl'J
oiaypivou.lvyv Ttoiouor T7jv oyrtyv cucTOtyyjy tÎ)v xpTtTTOvoJv, %rjr u.iv vp/ct-
c9ai to/ Opopiajo'/j, Trie et tcv Àpctaaviov. Damascius, Qusesiiones de primis Principiis, ed. Kopp, 1826. cap. 125, p. 384. .
(2) De Sacy, Mémoire. p. 47 ; Lassen Ind. Alt -, I, 8. '
(3) Burnouf, Yaçna, Notes, 107; Spiegel, Beitræge zur vergl.
SprachfI, 31. Anquelil n’a aucune autorité pour traduire le zend Airyaman par Arménie. . ■
(4) Bochart montre {niialeg., I, 4, ch 3, col. 20) que le para-phraste cbaldaïque traduit le Mini de Jérémie par Har Mini, et, comme le même pays est appelé Miiwas par Nicolas Damascène, il en infère que la première, syllabe est de sémitique har montagne. (Voir Kawlinson, Glossary, à ce mot.)
(5) Lassen, Ind. Alt., I, 8, note. Arikh est aussi usité en armé-
admettant que le mot aryu n’entre pas dans la composition du nom de l’Arménie, nous ne pouvons douter qu’il ait existé dans la langue arménienne comme nom national et comme titre, d’honneur. ■. •
À l’ouest del’Arménie, sur les bords de la mer Caspienne,
nous trouvons le vieux nom d’Àlbania. Lés Arméniens
. * _ '
appellent les Albaniens Aghovan, et .comme gh est mis eii
arménien pour r ou l, Boré a cru retrouver dans Âghovan
, ► ■
le nom de l’Ane. Cette conjecture laisse beaucoup à désirer; mais dans les vallées duCauca.se nous trouvons une race aryenne parlant un idiome aryen, l’os des Ossètes qui s’appellent eux-mêmes Iron (4).
Sur les rivages de la mer Caspienne et dans la région baignée par l’Oxus et Tlaxarte, des peuplades aryennes et non-aryennes vécurent côte à côte pendant des -siècles. Quoique les Aryens et les Touraniens fussent ennemis et constamment en guerre les uns avec les autres, ainsi que
■ t
nous l’apprend le grand poëme épique persan, le Shâ-nâ-meh, il ne s’ensuit pas que toutes les bordes nomades qui
■ t
infestaient les établissements des Aryens aient été tartares de sang et. de langage. Dans les épopées indiennes de l’époque moderne, Tourvasa et ses descendants quirepré-- sentent les Touranien s, sont, maudits et privés de leur héritage dans l’Inde ; mais dans les Yédas, Tourvasa est-un adorateur des dieux aryens. Même dans le Shâ-nâmeh,
méprise manifeste et ne peut dater que d’une époque beaucoup plus récente où l’on en avait oublié la signification primitive. -
nien pour désigner les Mèdes, et il a été rattaché par Joseph Muller à Aryaka, un des noms de la Médie (Journal asiatique, 1839* p. 298). Si. comme Quatremère l’affirme, les Mèdes et les Perses sont ap^ pelés tantôt ari et tantôt anari, l’emploi de ce dernier'nom est une
(1) Sjœgren, Grammaire ossèle, p. 396. Scylax et Apollodore . connaissent, au sud du Caucase, un peuple et un pays qu’ils appellent ÿÀpiot. et’Apiavia. Pictet, Origines, p. 67 ; Scylax, Perip., p. 213, édition klausen ; Apollodori Bibliolh., p. 443, édition Heyne.

des héros persans passent aux Touraniens elles conduisent ' contre. Iran, à peu près comme Coriolan marcha contre Rome avec les Samnites. Ceci nous explique pourquoi un si grand nombre des noms lourâniens ou Scythes mentionnés parles autres grecs, portent l’empreinte évidente deleur origine aryenne. Aspa était le mot perse signifiant cheval, et il n’est guère.possible de ne pas reconnaître ce mot dans les noms scylhes Aspabota, Aspakara et Âsparatha (1). Le nom même des monts Àspasiens, placés par Ptolémée en Scythie, nous reporte à la même étymologie. Le mot Àvya n’est pas inconnu au-delà de l’Oxus, où nous trouvons un peuple appelé les Ariacæ (2), et un autre appelé les Anta-riani (3). Au temps de Darius il y avait un roi. des Scythes, nommé Ariantës. Un contemporain de Xerxès est connu sbuslenom d’Anpithës (le sanscrit aryapati; lé zend ai-ryapaiti) ; et Spargapitïiës ne semble pas sans rapport avec le sanscrit s vargapali « maître du ciel. »
Nous avons ainsi suivi à la trace le mot Àrya depuis
l’Inde jusqu à la Perse et à la Blédie, depuis l’Aryavarta jusqu’à l’Àriana; nous y avons rattaché les noms de certaines tribus nomades de. la Transôxiane et.des Iron du Caucase ; et nous avons vu que quelques écrivains croient le retrouver dans Arménie et dans Aîbania. A mesure que nous approchons de l’Europe, les vestiges de ce mot s’effacent davantage sans cependant disparaître entièrement.
Deux routes s’ouvraient aux Aryens de l’Asie dans leurs migrations vers l’Occident. L’une, parlant du Khorassan (4.)
(4) Burnouf,Notes, p. 405. . ,
(2) Plol., VI, 2, et VI, 44, Il y a des ’Avaptaxat sur les frontières
de rHyrcanie. Strabon, XI, 7 ; Pline, Hîst. nàtVI, 49. .
(3) Sur les Arismapi et les Aramæi, Cf. Burnouf, Yaçna^ Notes,
(40 Qairizam, dans le Zend-ÂYesla, Uvârazmis^ dans les inscriptions de Darius.
dans la direction du nord, passait par le sud de la Russie et menait de là aux rivages de la mer Noire et de la Thrace. L’autre, partant de l’Arménie et suivant les .défilés du Caucase ou traversant la mer Noire, arrivait au nord de la Grèce d’où, en longeant le Danube, elle remontait ensuite vers la Germanie. Sur la première de ces deux routes, les Aryens laissèrent la marque de leur passage dans l’ancien nom de la Thrace qui était Àrva (1 ) ; sur la seconde, nous rencontrons dans l’est de l’Allemagne, près de la Yistule, une peuplade germanique appelée les Arii; et de même qu’en Perse nous avons trouvé beaucoup de noms propres dans la composition desquels Arya entrait pour une part notable, de même dans l’histoire de la Germanie nous retrouvons des noms comme celui d\lriovisle (2).
Nous chercherions en vain des traces de cet antique nom national chez les Grecs et chez les Romains, mais certains savants ont cru le retrouver au terme même des migrations aryennes vers l’occident, dans le nom deY Irlande. L’interprétation commune du mot Erm, « l’île de l’ouest, ■» est donnée par ceux qui le font venir de iar-innis, iar-în, la terre de l’ouest : mais celte étymologie est évidemment
fausse (3). Dans l’ancien irlandais, la forme de ce mot au
' / ■■ ■
nominatif est toujours Eriu qui se changera plus tard en
_r L " * ■ -
Etre : un n final paraît aux cas obliques, de même que dans le latin regio, regionis. On a donc pensé que Evin dérive de Er ou En que l’on suppose avoir été l’ancien nom des Celtes irlandais, lequel serait conservé dans le nom anglo-
(1) Étienne de Byzance.
(2) Grimm, Reclitsalterfhümer, p. 292, fait remonter Arii et Ario-vis tus au gothique harji, armée. Si cette étymologie est bonne, nous devons renoncer à celte partie de notre argument.
(3) Piclet, les Origines indo-européennes, p. 21. « lar, l’ouest, ne s’écrit jamais er ou cir,et la forme larin ne se rencontre nulle part pourÉrin. » Zeuss donne iar-rend, insula occidentalisé mais rend (plus correctement rind) fait rendo au génitif singulier.
saxon de leur pays, Iraland ('!). O’Reilly prétend que er ■ est usité en irlandais dans le sens de noble, absolument comme le sanscrit ârya; mais cette assertion est combat-, tue par d’autres écrivains (2 ].
(1) Dans l’ancien norrois, nous trouvons îrar, des Irlandais; en
anglo-saxon, ira un Irlandais. .
(2) Quoique j’avance ces faits d’après. l’autorité de M. Pictet, je
1 * v
Le nom ordinaire de l’Irlande, dans les plus vieux manuscrits irlandais, est (/t) ériu, gén. (h) êrenn, dat. \h) êrinn. Le h initial est .souvent omis. Avant de chercher, l’étymologie de ce mot, il faut d’abord lâcher d’en: reconstituer la forme dans l’ancien celtique. . De tous les noms anciens de l’Irlande qui se rencontrent dans les auteurs grecs et latins, le seul qui puisse être représenté par hériu est Hiberio, dont nous trouvons l’ablatif singulier, Hïberione, dans le livre d’Àrmagh, manuscrit latin du commencement du neuvième siècle. Le même manuscrit nous apprend également qu’un des noms du peuple irlandais était Iiyberionaces, qu’il n’est pas difficile de dériver du radical Hiberio. Si maintenant nous nous rappelons que les anciens copistes irlandais mettaient souvent un h devant les mots commençant par" une voyelie" (comme dans lï-abundë, h-drünâo, h-erimus, h-ostium), ét qu’ils écrivaient souvent b au lieu de v (comme dans bobes, fribulas, corbus, fabonius) ; si nous observons en outre que les noms ’de l’Irlande en gallois et en breton, Tv'ercl-donn et Iverdon, nous reportent à un mot de l’ancien celtique commençant par 1VER, nous n’aurons pas de peine à donner à Hiberio sa forme latine correcte, e’est-à-dire Iverio dont la forme correspondante, dans l’ancien celtique, serait Iveriu, gén. Iverioncs, de même que la forme de Fronto, dans l’ancien celtique, était Frontfà, ainsi que nous le savons par l’inscription gauloise de vieux-Poitiers. Gomme le v entré deux voyelles disparaît toujours en irlandais, îveriû aurait donné ieriu, et, les deux premières vo3relles s’étant fondues en une seule, il ne serait plus resté que èriu. « Absorbitur v in î in îar (occidens) in formula adverbial! aniar (in, ab occi-denle) Wb., Ci\, cui adnumeranda præp.. iarn (post) adverb. iarum (postea), siquidem recte confero nomina louecviot (n. po-puli in angulo Hiberniæ verso contra occidentem et meridiem); ’loüepvtç (oppid. Hiberniæ, et’louepvta (nomen insulæ) ap. Ptolem. quæ Romani accommodaverint ad vocem suam hibernus, i. e. hiemalis. « Zeuss. Gram, Celtica, I, p. 67.) Quant au double n, dans les cas obliques de èriu, le génitif êrenn, par exemple, est à Iverionos dans un rapport analogue à celui qui existe entre l’ancien irlandais anmann, «noms », et le sanscrit nâm an i latin nomina. Le redoublement du n vient peut-être de l’accent dans l’ancien celtique. Quelle étymologie pouvons-nous maintenant offrir
Il s’en faut de beaucoup que ces -recherches sur le nom primitif de la famille aryenne aboutissent toutes à un résultat également certain, et j’ai eu soin d’indiquer les points faibles de la chaîne qui rattache le nom de l’antique Àrie à celui de l’Irlande moderne; mais les principaux' anneaux en sont solides et peuvent nous inspirer toute confiance. Rien n’est plus vivace et plus durable que les noms des pays, des peuples, des rivières et des montagnes, et bien souvent ils demeurent alors quedegrand.es cités et des nations tout-entières disparaissent sans quel-
i * ► _ ■■
quefois laisser de trace de leur existence. Rome porte encore aujourd’hui, et elle portera probablementtoujours, le nom qui lui fut donné par les premiers colons latins et sabins ; et partout où nous rencontrons ce mot, soit dans Roumania, ainsi que les Yalaques appellent leur pays ;
pour Iveriû? J’incline à penser qu’il se rattache (de même que le latin, Avernus et le grec ^AFop-voù an sanscrit a vara, postérieur, occidental. C’est ainsi que l’irlandais des, le gallois de heu, droit, sud, est le sanscrit, daksh in a, « des.ter » ; et. l’irlandais âir (dans an-âir) , s’il est nais pour pair, orieut, est le sanscrit pur va, « antérieur ».
. « M. Pictet regarde P’IouÉovia (Ivernia) de Ptoléméecomme le nom qui se rapproche je plus de la forme du mot en question dans l’ancien celtique. Il croit trouver dans la première syllabe ce qu’il appelle finlandais ibh, terre, peuplade, et il pense qu’il doit y avoir une connexion entre cet ibh et le védique ibha, famille, et même l’ancien haut allemand eiba, district. Mais je ferai remarquer d’abord que, d’après les lois phonétiques de l’irlandais, ibha aurait donné eb dans l’ancien irlandais et eabh dans le moderne. En second lieu, fiei de eiba est une diphthongue qui équivaut au gothique ai\ à l’irlandais ôi, ôe, aü sanscrit ê ; et, par conséquent les formes ibh et ibha ne sauraient être identifiées avec eiba. En troisième lieu, le mot ibh n’exisîe pas comme nominatif, singulier, bien qu’on le trouve dans lé dictionnaire d’O’Reilly, où l’on peut lire aussi, entre beaucoup d’autres erreurs, son explication du préfixe intensif er, qu’il traduit, par « noble. » Sans doute il est possible de citer des phrases où se rencontre celle forme ibh, mais ce n’esl autre chose que le datif pluriel, de date très-récente, de üa, descendant. Les districts de l’Irlande recevaient souvent.les noms des clans qui les occupaient, et les clans eux-mêmes étaient souvent appelés « les descendants {hui, lü, i)d’un tel », De là l’erreur de ce lexicographe. » Whitley Slokes.
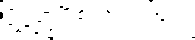
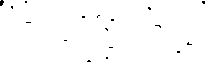
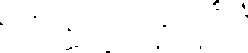
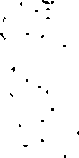
SIXIÈME LEÇON. . . 299
■ ' O , '
dans roumansch,d’idiome des Grisons; dans la dénomination des langues romanes; dans le nom de Roumœi, donné par les Arabes aux Grecs ; ou dans Roumélie; grande province de l’empire ottoman, nous savons que nous de-vous pouvoir remonter de là à la Rome de Romulus et de Rémus, qui servit d’abri aux vieux guerriers du Latium. La ville dont' on voit les ruines près de l’embouchure du Grand Zab, . et qu’on, nomme généralement aujourd’hui Kimroud, est appelée Âihur par les géographes arabes, et dans Athur nous reconnaissons l’ancien nom de l’Assyrie que Dion Cassius écrit Àtyria, en faisant observer que les
+ s ■ ■ „
barbares changeaient le 2 en T. L’Assyrie est appelée Athurâ dans les inscriptions de Darius (1). Lorsque nous lisons le récit des batailles entre les Anglais et les Sikhs -sur les rives du Sulledgé, nous ne songeons guère qu elles Ont été données presque sur les lieux où Alexandre défit autrefois .1 es. rois-du .PendiAb. Pourtant le Sutledae est
. d . U
YResudrus d’Alexandre et le .Sa ta dru des Indiens, et parmi les plus anciens hymnes des védas composés environ 1500 ans avant notre ère, nous trouvons un chant de guerre qui célèbre un combat livré sur les deux bords de la même rivière.
Il y a danger, sans aucun doute, à fonder des arguments sur une simple ressemblance de noms. Il se peut que Grimm ait raison quand il dérive les Arii de Tacite de Harii, et qu’il nie toute connexité entre ces Arii et notre Arya. xMais puisque des deux côtés on ne peut produire . que des conjectures, cette question doit encore rester indécise, Cependant, dans la plupart des cas, l’observation
étroite des lois phonétiques particulières à chaque langue mettra fin à toute incertitude. Grimm, dans son Histoire de la Langue allemande (p. 228), suppose que Raviva, le
(I) Cf. Rawlinson, Glossary, à ce mot. . .
nom de ïïéral dans les inscriptions cunéiformes, doit être rattaché h Àrii, le nom donné par Hérodote aux Mèdes : mais cette hypothèse est. inadmissible, car l'aspiration initiale de Raviva présuppose un mot commençant en sanscrit par s et non pas par une voyelle, comme Àrya. Les remarques suivantes feront mieux ressortir l’importance de cette observation. • '
La ville de Hérat porte aussi le nom de Heri (1), et la rivière sur laquelle elle est bâtie est appelée Herivud. Cette rivière est appelée par Ptolémée ’ApeUc (2), par d’autres auteurs Ârius ; et Aria ou l’Àrie est le nom donné à la contrée située entre la Parthie (Parthuwa) à l’ouest, la Margiane (Slarghush) au nord, la Bactriane (Bakhtrish) et l’Arachosie (Harauwatish) à l’est, et la Drangiane (Zaraka) au sud. Cette Aria-, bien qu’écrite sans un A initial, n’est pas YAriana décrite par Strabon, mais une région indépendante qui en fait partie. On a cru retrouver dans Aria YEaraiva (Hariva) des inscriptions cunéiformes, .mais cette conjecture est très-incertaine. Dans le Zend-avesla, ce pays est mentionné sous le nom de Ilarôyu (3), comme étant la sixième contrée créée’par Ormuzd. Il nous est
O) W. ouseley, Oriental Geography of Ebn Haukal. Cf. Burnouf,
Yaçna, Notes, p. 102. . ..... .....
(à) P Loi., YI, cli. .17.. . .
(3) On a supposé que harôyûm, dans le Zend-Àvesta, est mis pour haraêvem, et que îe nominatif n’était pas Ilarôyu, mais Iiaraêvô (Opperl, Journal asiatique, 1851, p. 28Ü) Tout en reconnaissant que cette supposition peut être vraie, car elle est confirmée jusqu’à un certain point par l’accusatif vidôyû/m, de vidaêvo, ennemi des Divs, je ne vois aucune raison pour ne pas regarder Harôyûm comme l’accusatif régulier de Earôyu, Yû de l’accusatif étant rendu long par la nasale finale, (Burnouf, Yaçna, Notes, p. 103). Harôyu serait au nominatif une forme aussi régulière que Sara y u en sanscrit, et même plus régulière, attendu que harôyu présupposait un mot sanscrit, sarasym ousarovu, de s ara s. .On trouve aussi S a ray û avec un u long. V. Wilson, à ce mol. M, Opperta raison d’identifier les habitants (YHaraiva avec.les 'Àpeîot et non avec lès vÀptoi comme le fait Grimm. .
possible de faire remonter ce nom, précédé du A initial, au-delà du temps de Zoroastre. Les Zoroastriens étaient une colonie partie de,l’Inde, et pendant quelque temps ils cohabitèrent avec le peuple dont les chants sacrés nous sont parvenus dans les hymnes védiques. Puis une rupture eut lieu, et les Zoroastriens émigrèrent vers l’ouest et s’établirent dansEArâchosie et dans la Perse. Dans leurs migrations ils firent ce qu’ont, fait les Grecs quand ils établissaient de nouvelles colonies, etles Américains, quand ils fondaient de nouvelles villes. Ils donnèrent à leurs nouveaux établissements et aux rivières qui les baignaient les noms qui leur étaient familiers et qui leur rappelaient la patrie qu’ils venaient, de quitter.- Or, comme un h en persan présuppose un s en sanscrit, Iîarâyu serait en sanscrit S ar o vu. Effectivement, une des rivières sacrées
1/ * - .
de l’Inde,.qui est citée dans les Yédas et célébrée dans-les poèmes épiques, comme étant la rivière d’Ayodhyâ, une des plus anciennes capitales de l’Inde (aujourd’hui Auoadh ou Ilanuman Garhi, la ville que nous connaissons sous le nom d’Oude), porte le. nom de Sa ray u, le Sardju moderne (1). : -
, Gomme- la philologie comparée a pu de cette manière suivre à la.trace l’antique nom à’krya depuis l’Indejusqu’à l’Europe, et constater que c’était le titre originel pris par les Ariens avant leur dispersion, il est tout naturel quelle ait choisi ce nom comme désignation distinctive de cette famille de langues qu’on appelait auparavant la famille indo-germanique, indo-européenne, . caucasienne,, ou j ap h étique. • .
(1) Ce nom est dérivé de la racine sa r ou s ri, aller, courir, d’où saras, eau, sarit, rivière, et Sarayu, la rivière d’Oude, qui coule près de la capitale du royaume. Il est probable que de Sarayu ou Sarasyu sont venus Arius ou Heri, et Làpta ou Hérat. En tous cas,
pta, comme nom de Hérat,.ne se rattache aucunement! ”Âpta, la vaste région des Âryas. : '
LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU LANGAGE.
Home Tooke indique le premier le caractère véritable des désiueuces grammaticales. —Les éléments constitutifs du langage sont les racines attributives et les racines démonstratives. Définition du terme racine. Racine AR, àrya, arare, apouv, aralrum, àpo-pov, aratio, apoc'.ç, t’pa, earlh, armentum, apoupa, arvurn, ars, arlis. — Racine SPAG. • Respectable, speclare, specere, spy, espion, uy.é'jzTO’j.a.i, cxstîtixoç, linoxonoe, évêque, respect, répit, dépit, soupçon, auspice, espiègle, espèce, épice, épicier. — Classes de racines : racines premières, secondaires, tertiaires.
— Nombre des racines en sanscrit, en hébreu, en gothique, en allemand moderne. Nombre des mots en chinois, dans les inscriptions cunéiformes de Perse, dans les inscriptions hiéroglyphiques de TÉgypte, en anglais, dans Shakespeare, Milton, l’Ancien Testament. — Modification du sens des mots chinois, selon leur place dans la proposition. — Désinence vepoç, sanscrit, tara, irans, très. — Origine du s, terminaison de la troisième personne singulière de l’indicatif présent des verbes anglais. — Toutes les langues, sans aucune exception, qui nous sont connues, composées des deux mêmes éléments constitutifs.
— Problème dé l’origine du langage si obscur pour les anciens philosophes, beaucoup plus clair pour nous. ‘ • -
L’analyse à laquelle nous avons soumis quelques désinences de noms et de verbes.dans la famille des langues, aryennes ou indo-européennes, nous a montré que, si mystérieuses et compliquées que paraissent à première vue ces formes grammaticales, elles résultent en réalité
d’un procédé fort simple. Au premier abord il semble presque vain de demander pourquoi la terminaison ai ajoutée à aimer donne l’idée de l’amour à venir, ou pourquoi la simple addition d’un à au verbe anglais I love change un amour présent en un amour passé : mais dès qu’on les place sous la loupe de la grammaire comparée, toutes ces formes se présentent sous un aspect très-différent et bien plus facile à saisir.
En effet, n avons-nous pas vu que les désinences grammaticales, ainsi qu’on les appelle aujourd’hui, furent originairement des mots indépendants, lesquels se sont agglutinés à la fin d’autres mots qu’ils étaient destinés à modifier, et se sont réduits peu à peu àn’être plus que de simples syllabes ou de simples lettres, sans signification
par elles-mêmes, mais révélant encore leur ancienne force
*
et indépendance par les modifications qu’elles continuent d’apporter au sens des mots auxquels on les ajoute? Cette explication de la nature véritable de nos désinences fut donnée pour la première fois par un philosophe dont nous ne prétendons pas justifier toutes les théories hasardées , mais qui, du moins , entrevit souvent la vie et le développement, réels du langage : je veux parler de Home Tooke. Yoici ce qu’il dit des terminaisons : « Bien que je pense avoir de . bonnes ' raisons pour croire qu’on peut remonter également à l’origine de toutes les terminaisons, et que, quelque artificielles quelles nous paraissent aujourd’hui, elles n’étaient pas primitivement l’effet d’un art prémédité et réfléchi, mais des mots distincts qui se sont altérés avec le temps et se sont fondus dans les mots dont on •les regarde maintenant comme les terminaisons ; cependant, cette conjecture était moins facile à faire pour les autres langues que pour la nôtre, et ceux qui l’auraient faite auraient eu à parcourir une route bien plus longue et plus difficile que nous ,• pour arriver au terme de leurs recherches, vu que raltération de ces lan-
SEPTIEME LEÇON. 305
* fl
gués est beaucoup plus profonde et plus ancienne que celle de l’anglais (4). »
Cependant Horne Tooke, bien qu’il vît la vraie route à suivre pour remonter à l’origine des désinences grammaticales, était, lui-même dépourvu des moyens d’atteindre le terme de celte recherche. La plupart de ses explications sont complètement insoutenables, et il est curieux d’observer, en lisant son livre, comment un homme d’un esprit lucide, pénétrant et vigoureux, qui part- de principes justes et solides, peut néanmoins, par suite de sa connaissance imparfaite des faits, arriver à des conclusions directement opposées à la vérité.
En voyant qu’on peut faire remonter les terminaisons
# *■
grammaticales à des mots indépendants, nous avons appris que les éléments constitutifs du langage qui restent dans notre creuset après une analyse grammaticale complète, sont de deux espèces, les racines attributives et les racines démonstratives. -
Nous appelons racine ou radical tout ce qui, dans une langue ou famille de langues, ne peut se réduire à une forme plus simple ou plus primitive. Il peut être bon de donner ici quelques exemples comme éclaircissements. Mais, au lieu de prendre un certain nombre de mots en sanscrit, en grec et en latin, et de remonter jusqu’à leur source commune, il sera plus instructif de commencer par une racine déjà connue et de la suivre dans ses pérégrinations à travers les différentes langues d’une même famille. Je prends la racine ÀR, d’où vient le mot Arya, et dont j’ai parlé dans notre dernière leçon : en .examinant ses ramifications, nous apprendrons pourquoi ce nom fut choisi par les agriculteurs nomades, ancêtres de la race aryenne.
(1) Diversions of Purley, p. 190.
Celle racine ÂR (4) signifie labourer, ouvrir le sol. Delà nous viennent le latin ar-are, le grec - ar-oun,- l’irlandais ar, le lithuanien ar-li, le russe ora-ti, le gothique ar-jan, î’anglo-s.axon. er-jan, et l’anglais moderne io ear. Shakespeare dit (Richard II, a. III, sc. 2) : « to ear lhe land. that has some liopelogrow»; et la traduction anglaise du Deutéronome, XXI, 4 : a rough Yaîley which is neither eared nor sown ». .
De. là nous vient aussi le nom de là charrue, l'instrument du labour: en latin, ara-trum; en grec avoir on ; en hohémien, oradlo ; en lulhuanien, arkla-s ; en comique-, aradaa' ; en gallois, arad (2) ; dans l’ancien norrois, ardhr. Cependant, dans cette dernière.langue, ardhr, qui signifiait originairement « la charrue », en est venu plus tard à signifier le « gain ou la richesse » ; la charrue ayant été, dans les premiers âges, la propriété la plus importante et Je meilleur gagne-pain. De même le mot. latin pour argent, pecunia, était dérivé depecus, bétail ; le mot anglais fee, qui ne s’emploie plus que pour les honoraires payés à un médecin ou à un homme de loi, était dans le vieil anglais feh, et. en anglo-saxon feoh, signifiant bétail et richesse. ; car feoh , et le gothique faihu, sont en réalité le même mot que le latin pecus, et que l’allemand moderne Vieh.
. Le labourage est appelé aratio en latin, arosis en grec : et je crois, que arôma, dans le sens de parfum, avait la même origine. Dériver arôma de la racine g lira, sentir, présente des difficultés, parce qu’il n’y a pas d’autres cas
M ' -
£• ‘ ■
(1) On peut faire remonter AR à la racine sanscrite ri. aller (Pott
E tymo logis die Fo rschungen, I, 218) ; mais pour ce qui. nous occupe, en ce moment la racine AR suffit.
(2) Si comme on l’a supposé, ces deux mots du comique et du
gallois étaient des altérations du latin aratrum, ils auraient donné areuder et arawd. '
analogues ou un gh initial soit tombé et ail été remplacé en grec par uii a. Blais arôma ne se trouve pas employé seulement pour désigner des herbes odorantes ; ce mot indique parfois les fruits des champs en général, tels que l’orge et d’autres céréales. Il est possible toutefois que le sens général du mot ait été peu à peu restreint par l’usage, comme celui du mot épices, qui n’est à l’origine qu’un synonyme d[espèces : ainsi arômata, les herbes des champs, particulièrement celles que l’on offrait dans les sacrifices, aurait peu à peu pris le sens d’herbes odorantes (1).
Un dérivé plus primitif de la racine ar semble, être le -grec era, terre, le sanscrit ira ou idâ, l’ancien haut-allemand ëro, le gaélique ire, irionn. Ce qui signifiait dans le principe- terre labourée est venu ensuite à signifier la terre en général. Blême le mot anglais earth, le gothique airtha (2), l’anglo-saxon eorthe, ont dû primitivement être pris dans le sens de terre labourée ou cultivée. Le dérivé ar-mentum, formé comme ju-mentum, se serait naturellement dit de tout animai, propre au labourage et aux au-
(1) Je retire une conjecture que j’avais mise en avaut.dans les éditions précédentes, et d'après laquelle aroma aurait désigné primitivement Todeur d’un champ labouré. Que Codeur d’un champ fraîchement labouré était appréciée par les anciens, c’est ce dont témoignent les paroles que la Bible met dans la bouche de Jacob .(Genèse, XXVli, 27) : « L’odeur de mon fils est comme l'odeur d’un champ que le Seigneur a béni. » Mais il est clair qtiaromala désignait d’abord certaines substances avant de prendre le sens moderne d’odeur. Voyez l'hesaw'us linguæ Græcæ, ed. Didot, à ce mot.
- *
(2) Grimm remarque avec justesse que airtha ne saurait dériver
de arjan, à cause de la différence des voyelles. Blais airtha est une forme beaucoup plus ancienne, et vient de la racine ar, qui, elle-même, était originairement ir ou ri (Benfey, Kurze Gr., p. 27). De cette racine primitive ir ou ri, ilfautdériyer le sanscrit ira oii i <2a et le gothique airtha. Cette dernière forme répondrait au sanscrit rita. Le véritable sens du sanscrit idâ est « terre » Les brahmanes le traduisent par prière ; mais ce n’est pas là sa signification primitive.
très travaux des champs, soit le bœuf, soit le cheval (l).
-■ Comme l’agriculture était, le travail principal dans ces premiers temps de la société où il faut supposer que la plupart de nos mots aryens se sont formés et ont reçu leurs significations précises, il nous est facile de comprendre comment un mot, qui désignait dans l’origine un genre particulier de travail, en est venu par la suite à signifier le travail en général. C’est surtout en passant du sens particulier au sens général que les mots tendent naturellement à modifier et à développer leur signification : c’est ainsi que regere et gubernare. qui signifiaient primitivement gouverner un vaisseau, en sont, venus à signifier gouverner dans tous les sens. Equiper (esquif, de sckifo, barque) signifiait dans le principe pourvoir un vaisseau, et signifie maintenant pourvoir en général. Dans l’allemand moderne, Arbeit, signifie simplement le travail ; arbeitsam signifie laborieux. Dans le gothique aussi, ar-baiths n’est employé que pour signifier le travail et la peine en général. Mais, dans l’ancien norrois, erfidhi signifie principalement lelabourage, et plus tard le travail en général; et le même mot en anglo-saxon, earfoclh ou earfedhe, veut dire le travail. Bien entendu, nous pour-
w * - J "
rions également supposer que le mot qui. désignait d’abord le laboureur, après avoir signifié travailleur en général, est venu à avoir le sens particulier de celui qui travaille à la terre, et que de même arbeit, après avoir signifié le travail d’une manière absolue, est venu à s’appliquer dans l’ancien norrois au travail de la charme (2). 9 10
' SEPTIÈME LEÇON.
_ ^
Mais, comme la racine de erfidhi semble être ar, notre première explication est la plus plausible. En outre, la forme simple ar signifie dans l'ancien norrois labourage et travail, et l’ancien haut-allemand art a également le sens de labourage (4).
On doit rapporter le grec aroura et le latin arvum, champ, à la racine ar, labourer : et, comme le labourage n’était pas seulement le premier genre de travail, mais encore un des premiersjuds, je ne doute nullement que le latin ors, artis, notre mot art, ne signifiât originairement l’art des~ârts, le premier qui ait été enseigné aux
• 4 »
hommes par la déesse de toute sagesse, l’art de cultiver la terre. Dans l’ancien haut-allemand, arwnti (en anglo-saxon aerend), signifie simplement travail ; mais ces deux mots aussi ont dû signifier dans le principe le travail de l’agriculture, et, dans l’anglais errand et errand-boy, le
même mot existe encore.
æ
- _ . ' ' i
Mais ar ne signifiait pas seulement labourer, ou tracer \ des sillons sur la terre ; de très-bonne heure, on lui a donné le sens de sillonner la mer, ou ramer. C’est ainsi que Shakespeare dit :
Make the sea' serve lhem; winch the}7 car and wound With keels. 11
En français, faucher le grand pré veut dire ramer ou faire une trouée dans la verte mer (2).
310 LEÇONS SUR LA SCIENCE DO LANGAGE. •
' T O , ■
De-même nous trouvons que le sanscrit dérive de ar le substantif arit.ra, non pas dans: le sens de charrue, mais dans le sens de gouvernail. En anglo-saxon, nous trouvons la forme simple âr, l’anglais oar « rame, » pour ainsi dire le soc qui sillonne l’eau. Le grec a aussi employé la racine ar dans le sens de ramer ; car ereies (1) en grec est un rameur, et leur mot Iri-ër-ës signifiait originairement une galère* à trois rames, ou à trois rangs de rames, une trirème (S).
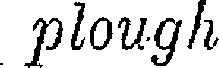
Ge rapprochement de labourer et de ramer est très-fréquent dans les langues anciennes. Le mot anglais , le slave ploug, a été identifié avec le sanscrit p lava (3) «vaisseau, » et le grec ploion qui a la même signification. Comme les Aryens parlaient d’un vaisseau sillonnant la mer, ils parlaient aussi d’une charrue voguant sur .un champ, et c’est ainsi que les mêmes mots étaient employés dans les deux cas (4-)..Dans certains pa- 12 13 14 15
lois anglais, on emploie encoreploughDû plow dans le sens général de chariot ou moyen de transport (I).
JNTous pourrions observer encore d’autres rejetons de celte racine ar, mais le nombre de mots que nous avons examinés dans différentes langues suffira pour montrer ce que nous entendons par une racine significative. Dans tous ces mots ar est l’élément radical, tout le reste n’est qu’une série d’éléments formels, employés pour modifier en diverses manières le sens de la racine. On appelle là racine ar racine attributive, parce que, dans quelque composé, qu’elle entre, elle attribue à l’être qu’elle désigné une même qualité première, elle traduit, elle rappelle une seule et même conception, l’idée de la charrue oü du gouvernail, du bœuf ou du champ. Même dans un mot comme artistique, on peut encore apercevoir la force attributive de la racine ar, mais seulement* si l’on me permet cette image, à l’aide d’un puissant télescope. Les brahmanes qui s’appelaient ârya dans l’Inde ne connaissaient pas plus la véritable; origine de ce nom et sa dérivation des travaux de l’agriculture, que l’artiste qui de notre temps parle de son art comme.étanf une inspiration divine, ne soupçonne que le mot dont il se sert s’appliquait exclusivement, dans l'origine, à un art aussi primitif que celui du labourage. . .
. . . 1 r
la.terre » est un autre nom de la charrue en sanscrit. Le gothique hoha « charrue « répond'bien au sanscrit koka « loup, n Voir Grimm, Deutsche Sprache, et Kuhn, Indische S Indien, vol. 1, p. 321.
(1) Dans la vallée de Blacktnore, chariot se dit plough ou ploib ; et zuU (l’anglo-saxon syl) est usité pour aralrum (Barnes, Dorsel Dialect, p. 369.) Plough ne se rencontré pas dans les écrivains anglo-saxons; et tes auteurs dü sud de rÀngletefre, au treizième et au quatoi’zième siècle, ne remploient que dans des composés, tels que plow-land, etc Dans les dialectes du sud, charrue se disait zuolz, l’anglo-saxon sulh, Voir R. Norns, Âye7ibite of lnwyt, Préface, p. LXXI. .
Nous examinerons : maintenant une autre famille de mots afin de voir par quel procédé on a d’abord découvert les éléments radicaux des mots, .
, Prenons le mol respectable. C’est un mot d’origine latine et non saxonne. Dans respectabilis nous distinguons facilement le verbe respeclare, et la terminaison bilis. Nous retranchons ensuite le préfixe re, ce qui nous laisse spe-clare, et nous faisons remonter spectare au verbe latin spicere ou specere qui signifie voir, regarder, spectare n’étant qu’un verbe fréquentatif tiré, par un procédé dont le mécanisme est connu, du verbe simple qui l’a précédé. Puis, dans specere nous distinguons la terminaison mobile ère de la partie invariable spec, que nous nommons la racine. Cette racine, nous nous attendons à la trouver en sanscrit et dans les autres langues aryennes, et nous l’y trouvons en effet. En sanscrit la forme la plus ordinaire est pas, voir, sans le s initial ; mais nous trouvons aussi s pas dans spasa, espion, dans spash£a et dans vi-spasfUa, clair, manifeste, et dans le védique s pas, gardien. Dans la famille teulonique nous trouvons spëhôn en. ancien .haut-allemand avec la .signification de. voir, épier, contempler; et spëha, l’anglais spy et le- français espion (1). En grec, la racine spek s’est changée en skep, qui existe dans skeptomai, je regarde, j’examine; d’où skeptikos, qui. examine ou qui' s’informe, en langage philosophique, sceptique : et episcopos, qui surveille, évêque. Examinons maintenant les différentes ramifications de cette racine. Commençant par respectable, nous avons trouvé qu’il signifiait dans l’origine digne de respect, le respect signifiant , le regard jeté en arrière. Nous passons près des choses ou des personnes ordinaires sans les re-
(1) Pott, Etymologischè Forschungen, p. 267 ; Benfe-y, Chiechisches Wurzehoôrterbuck,]}. 236.
marquer, mais nous nous retournons pour considérer celles qui méritent notre admiration, nos regards, notre respect. Telle était la signification primitive de respect et de respectable, et cela ne nous paraîtra pas surprenant si nous réfléchissons que noble, le latin nobilis, n’exprimail originairement d’autre idée que celle d’une personne
digne d’être connue.; car nobilis est mis pour gnobüis

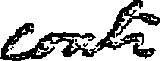
' . ■ ’ ■ * '
comme nomen pour gnomen, ou natus pour gnalus. mite La locution anglaise with respect lo} où nous voyons la même image que dans le français concernant, est devenue une sorte de préposition. Car « willi respect to this point
En outre, cdmnae, en jetant les yeux en arrière, nous
distinguons un individu de la foule, l’adjectif respectif et
■■ ^ _
l’adverbe respectivement sont presque synonymes des mots
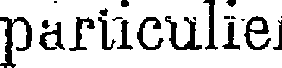
r et spécialement.
L’anglais respile est la modification normande de res-
m, ‘ ' r
pectus, le français î’eyùL Répit signifiait primitivement l’action de regarder en arrière,, de revoir toute la procédure. On accordait à un prévenu tant de jours ad respec-ium, pour examiner T affaire à nouveau. Plus tard, on dit qu’il avait été donné un répit à un prisonnier, c’est-à-dire qu’on lui permettait de subir un nouvel interrogatoire ; et enfin on dit qu’une personne était répiiée, et on forma le . verbe anglais to respile.
Comme specere, regarder, précédé de l'a préposition ?*e,
- * r- ’ . ... * _
en est venu à exprimer le respect, ainsi, avec la préposition de, du haut de,, il a formé le latin despicere, regarder d’en haut, 1’anglaisdespise (lj. Le français dépit (en
(t) [Despiler était usité dans le vieux français dans le sens de mépriser. Ti\] .
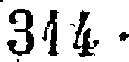
vieux français despil)'ne signifie plus mépris, quoiqu’il vienne du latin despectus, mais"chagrin mêlé de colère. Se dépiter signifie concevoir du dépit, se fâcher. En dépit de lui, qui signifiait primitivement « fâché contre lui », est venu à signifier « malgré lui » ; et le substantif anglais spite, l’adjectif spüeful, la locution in spite of ne sont que des abréviations de despüe, despile fui, in despüe of, et. n’ont pas plus de rapport, avec des chats qui crachent (t) que le français une souris (sorex) n’en a avec sourire (su-bridere). :
Gomme de signifie d’en haut, sub signifie d’en bas, et ce
mot placé devant specere, regarder, nous donne suspicere, suspicari, regarder d’en bas, dans le sens de suspecter, soupçonner (2). De là aussi suspicion, suspect. et soupçon, ' même dans le sens familier de la plus petite quanlité possible d’.une chose, comme dans la phrase « un soupçon de thé ». .
Comme circum signifie à l’entoür, circonspect signifie nécessairement prudent, qui prend garde.
Avec in, signifiant daus, specere donne inspicere, inspec-
Avec ad, vers, specere, devient adspicere, regarder : d’où aspect, vue d’une personne ou d’une chose, ou manière' dont une personne ou une chose s’offre à la vue. ;
Ainsi avec pro, en avant, specere est devenu prospicere, d’où notre mot prospectus, programme qui. donne à
(1) [M. Max Müller fait allusion à l’étymologiste .Junius qui proposait de. dériver l’anglais spite, despüe de l’allemand spillen, spuere, despuer e Tr.] ^ •
(2) Le grec ô-ïroSpoc, avec un regard en dessous, est dérivé de utîo; ët ôpa, qui se rattache à oepxop.ai, je vois; le sanscrit dris, En sanscrit, cependant, la racine primordiale dri ou dar, a également été conservée, et se trouve souvent surtout en composition avec la préposition à ; lad âdrîtya , concernant ceci.
l'avance- des renseignements sur un ouvrage ou.sur un établissement. Avec per, à travers, specere donne perspi-cere, d’où perspective, perspicace, perspicacité. Nous avons déjà vu, en pariant de respectable, qu’un nouveau mot spectare s’était formé du participe de spicere, et avait donné, à l’aide de ex, le latin expectare, d’où expectant, expectative. .
Auspice est un autre mot où nous retrouvons notre racine. Le latin auspicium est une abréviation de avispicium, et signifiait la manière de connaître l’avenir d’après le vol ou le chant des oiseaux ; et par suite on entend par heureux ou fâcheux auspices les circonstances qui présagent quelque succès ou quelque revers. Haru spex était le devin qui prédisait l’avenir en consultant, les entrailles des victimes. Nous avons aussi le féminin haruspica, formé comme vestispica, la servante chargée de la'garde-robe.
De plus, de specere, on a fait spéculum signifiant miroir, et de là speculari, d’où nous viennent spéculer, spéculatif spéculateur, spéculation.
Mais il y a bien d’autres rejetons de cette racine. Ainsi le latin spéculum* miroir, est devenu specchio en italien ; et, par un long détour, le même mot a pénétré en français, sous la forme de l’adjectif'espiègle. L’origine de ce mot est curieuse. Il existe en allemand un recueil célèbre de facéties et de tours que débite ou joue un personnage demi-historique et demi-mythique nommé Eulenspiegeî, ou Miroir, des chouettes. Ces facéties furent-traduites en français, et le héros fut connu d’abord sous le nom de
O - _ - ■ . ■ '
Ulesp.iègle, qui contracté en Espiègle, en est-venuà signifier plaisant, et se dit aujourd’hui d’enfants ou de jeunes gens qui font de petites malices.
Comme le français a fait des emprunts non^seulement au latin, mais aussi aux langues leutoniques, nous y trouvons, à côté des dérivés du latin specere, l’ancien haut-
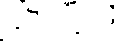
s
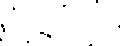
y
1
t- -r f ,

y
I
346
LEÇONS, èüR LA SCIENCE DU LANGAGE.
allemand spëhôn, sous le léger déguisement de épier, l’italien spiare. Le mot allemand pour espion est spëha, en vieux français espie.
Une des ramifications les plus fécondes de là même racine est le latin species. Soit qu’avec Jussieu nous prenions species dans le sens d’une succession perpétuelle d'individus semblables dans des générations continues, ou que nous le comprenions avec Agassiz comme une catégorie de la pensée, ce mot n’était originairement que la traduction littérale du grec eidos opposé à genos ou genus. Les Grecs classaient primitivement les choses d’après le genre et la forme, et, bien qu’Àristote. ait plus tard défini ces termes en langage technique, leur sens étymologique est en. réalité leur signification propre. On peut ranger des choses dans la même classe, soit à cause de leur identité de genre, c’est-à-dire d’origine, et c’est ce qui nous donne une classification généalogique; soit parce quelles ont une même apparence, eidos ou forme, sans leur attribuer une origine commune, et c’est ce qui nous donne une classification que nous appellerons morphologique, de pop®'/j, .forme.. C’était: cependant dans son sens aristotélL
s. ^ r ■
que, et non pas étymologique, que le grec eidos fut traduit en latin par species signifiant la subdivision d’un genre, la classe dune famille. De là viennent le substantif. espèce, et l’adjectif spécial, ce qui est exclusivement déterminée quelque chose en particulier. Dans ces locutions, un train spécial, uu messager spécial, on ne songe point d’abord à chercher la racine s pas voir ; mais la connexion, quoique non apparente, peut- être rétablie avec une certitude parfaite. Nous entendons souvent le mot spécifier. Un homme spécifie par un contrat les choses-qu’il veut garder. Que signifie cette expression 1 Le latin du moyen âge specifîcus est une traduction littérale du grec eidopoios, signifiant,ce qui.fait ou constitue un eidos ou une espèce.
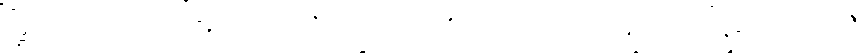
f
Or, dans la classification, ce qui constitue une espèce, c’est cette .qualité particulière qui, surajoutée à d’autres qui appartiennent en commun à tous les individus d’un genre, distingue une classe de toutes les autres. Ainsi le caractère spécifique qui distingue l’homme de tous les autres animaux, c’est la raison ou le langage. Spécifique a donc fini par avoir le sens de distinctif, et spécifier a fini par vouloir dire : « exprimer en particulier, en détail ». Je termine par épicier, nom donné dans le principe à celui qui vendait des drogues. On appelait avec un certain air de science les différents genres de drogues que le droguiste avait à vendre, species ; ce n’était pas l’idée de drogues en général, mais celle de substances dont chacune avait son rôle à part et son utilité spéciale. C’est, pourquoi pharmacien se dit encore en italien speziale, et une pharmacie speziera (1). En français le mot species, qui avait donné régulièrement espèce, prit une nouvelle forme pour exprimer les drogues et devint épices ; l’anglais spices, et l’allemand Spezereien. De là aussi le célèbre pain dépice et' enfin Yépicier. Si maintenant, du point où nous sommes arrivés, vous reportez les yeux jusqu’à la racine specere, vous comprendrez cette merveilleuse puissance du langage qui avec quelques éléments simples a créé une variété de mots que surpasse à peine l’inépuisable fécondité de la nature elle-même ( 2 ).
J’ai dit « quelques éléments », car le nombre de ce que nous appelons racines attributives, comme ar, labourer, ou sp as, regarder, est fort limité.
(!) Generi coloniali, denrées coloniales. Marsh, p. 253. En espagnol, qeneros, marchandises.
(2) Nous pourrions ajouter une longue liste de dérivés, comme spécimen, spectateur, spectacle, spécialité, spécieux ^ spectre, etc. .
\
318 LEÇONS SUR LA. SCIENCE DU LANGAGE. '
s ' ' .
Une racine est nécessairement monosyllabique (i). On . peut toujours prouver :que. les racines composées dé plus d’une syllable sont-dérivées., et même dans les' racines monosyllabiques il faut distinguer ce qüenous appellerons les racines premières, secondaires et tertiaires :
*
Les racines premières se composent : '
1° D’une voyelle ; par exemple, i, aller; .
%° D’une voyelle et d’une consonne; par exemple, ad, manger; r
. 3° D’une consonne et d’une voyelle ; par exemple, dâ, donner..
Les racines secondaires se composent :
D’une consonne, une voyelle et une consonne ; par exemple, tud, frapper,
Dans ces racines la première, ou la dernière consonne est modificative, c’est-à-dire sert, par les modifications quelle subit, à marquer les différentes nuances du sens ■- général’ que conserve l’idée première que rappelle la racine en question.
■ , r *
Les. racines tertiaires se composent : -
4° D’une consonne, une consonne et une voyelle; par exemple, couler;' .......: " " ; ;.....
2°-D’une voyelle, une consonne et une consonne ; par exemple, ard, blesser ; .
3° D’une consonne, une consonne, une voyelle et une
"" «■ _
consonne ; par exemple, spas, regarder ;
4° D’une consonne, une consonne, une voyelle, une consonne et une consonne ; par exemple, spand, trembler. ^ . .
Les racines premières sont les plus importantes pour
l’histoire des commencements du langage ; mais leur force
(1) Cf. -W. von Hnmboldt, Verschied., p. 376; Polt, Eïymotog. Forsohwagen, II, pp. 216, 31 î.
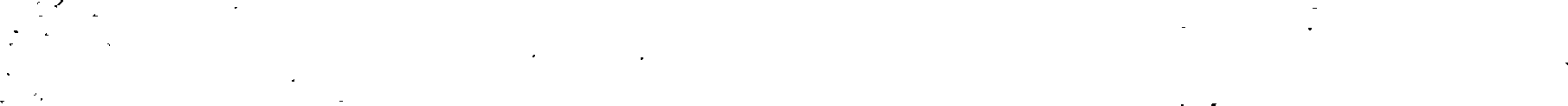
■ SEPTIÈME LEÇON. -349
, " J- ■
d'affirmation. étant. généralement trop indéterminée pour satisfaire aux progrès de la pensée, elles ont. bientôt été envahies et presque supplantées par les racines secondaires et tertiaires.
Dans les racines secondaires nous pouvons souvent observer que. l’une des consonnes, et généralement la finale, dans les langues aryennes, est sujette à changement. La racine conserve sa signification générale qui est légèrement modifiée et déterminée par les changements de cette consonne. Ainsi, outre tud (tudati), nous avons en sanscrit lup (topati, tupati, et tumpati), signi-fiantfrapper; le grec typ-tô. Nous trouvons aussi tubh (tubhnâti, tubhyati, tobhate), frapper, et, selon les grammairiens sanscrits, tuph (tophati, tuphati, tumphati). Puis, il y a une.racine tu# (tun#ati, to#ati), frapper, exciter ; une autre racine tur.(tutorti) à laquelle on attribué la même signification ; une autre lu r (tûr y a te), blesser. Il y a ensuite le dérivé turv (tûrvati), frapper, conquérir; tuh(tohati), affliger, chagriner; et tus (tosate) qui selon les grammairiens sanscrits aurait le sens de frapper.
Bien que nous puissions donner le nom de racines à tous ces thèmes verbaux, elles sont par rapport à la pre-, raière classe à peu près ce que sont les racines sémili-ques trilitères aux racines bilitères plus primitives (4).
Dans la troisième classe nous trouverons que l’une des ; deux consonnes est toujours une semi-voyelle, nasale ou sifflante, attendu que ces consonnes sont plus mobiles que . les autres ; et nous pouvons presque toujours en indiquer une comme étant d’originé plus récente et ajoutée à une
(t) Benloew, Aperçu général, p. 27 seq. [E. Renanydans son H'is-. toire des Langues sémitiques, s'écarte tout à fait, sur ce point, de M. Max Maller. Tr.] .
racine à deux consonnes pour en particulariser la signification.. Ainsi, outre spas, nous avons pas, que Polt a même fait remonter a une racine plus primitive as. De même vand n’est qu’une forte plus forte de la racine vacj,'. comme mand de raad , et yu-na et yu-n-g de yu#. La racine yu#, joindre, et yudb, combattre , indiquent toutes deux une racine yü, se mêler, et cette racine simple s’est conservée en sanscrit. Il nous est facile de. comprendre qu’une racine avec la signification générale de se mêler ou être ensemble, fut employée pour exprimer le serrement amical des mains et la mêlée dans les combats ; mais nous pouvons également comprendre que le langage dans sa progression vers la clarté et la précision, désirant une distinction entre ces deux sens, ait aimé à la marquer par les deux dérivés yu# et yudb (t).
. Les grammairiens sanscrits ont attribué à dix-sept cent vingt racines toute la floraison si riche et si variée de leur langue ; c’est là le nombre de radicaux irréductibles qu’ils out cru reconnaître, et desquels ils prétendent tirer, selon leur système- de dérivation grammaticale, tous les noms, verbes, adjectifs, pronoms, propositions;.adverbes et conjonctions qui. se rencontrent en sanscrit (2). Mais, d’après la définition que nous avons donnée de ce qu’il
(1) [M. Max Muller pénètre ici plus profondément dans les conciles primitives du langage qu’cm ne l’avait fait avant lui. Peut-être la science du langage n’est-elle pas encore assez avancée pour que ce classement des racines en racines premières, secondaires et tertiaires, paraisse à l’abri de toute contestation. Ce qui est certain, c’est que nous trouvons des racines déjà composées de trois et quatre lettres, à l’époque la plus reculée que l’observation philologique puisse atteindre. Nous citerons star, étendre ; ster-nere, axop-swujju ; skand, marcher, scend-ere ; vart, tourner, vsri-ere} wefd-en, lithuanien wart-an. Tr.]
(2) Benfey ; Kurze Grammatik, § 151 :
' . • SEPTIÈME LEÇON. 324
- - -d ■
faut appeler une racine, ce nombre devrait être considérablement réduit, et, tout en ajoutant quelques racines nouvelles qui ont échappé aux grammairiens sanscrits, le nombre de sons primitifs ayant des significations définies et nécessaires pour l’analyse étymologique de tout le dictionnaire sanscrit ne s’élèverait pas au tiers de celui qui. a été donné. . '
Les racines de l’hébreu ont été réduites à environ cinq cents (1), et je. doute qu’il en faille davantage pour le sanscrit. Ce fait prouve une sage économie dans Je langage primitif, car la facilité de créer de nouvelles racines pour toutes les impressions nouvelles était presque infinie.. Même en ne prenant que vingt-quatre lettres, le nombre possible des racines bilitères et trilitères monterait à quatorze mille quatre cents (2); et le-chinois, bien que n’ad-. mettant ni la composition ni la dérivation, - et demandant par conséquent plus de racines qu’aucune autre langue,
Racines des classes 2, 3, 3, 7, 8,9..... 226
. Racines des classes 1, 4, 6, 40......... 1480
Comprenant 143 de la 40e classe.
Voir aussi § 61 ; Pott, Etymolog. Forsclmngen (deuxième édition), II, p. 283 ; Bopp, Grammaire comparée, § 409a, 3; lô9b, 4, Note. . • . .
(1) Renan, Histoire des langues ^sémitiques, p 138. :— Selden.a compté cinq, mille six cent quarante-deux mots hébreux et clial-daïques dans TAncien Testament. Benloew évalue à six cents les racines nécessaires du gothique, et à deux cent cinquante celles de l’allemand moderne (p. 22). Pôlt pense que chacune de ces langues a environ mille racines (Elymol. Forsch., Il, p. 73). Grimm a dressé, pour la famille teutonique, une liste de quatre cent soixante-deux verbes forts. (Cf. Grammalih, I, 4030 : Pott, EtymoL Forsch. , II, p. 75.) — Dobrowksy {Inst. ling. Sla-vicæ, p. 256) donne pour les langues slaves mille six cent cinq, racines. .
■* -' (2) Leibniz {De arte combinatoria, Opp., t. II, pp; 387-388, édit. Dutens : Quoties ortus litterarum in alphabetô sit variabilis) :
2i
s'est contenté d’environ quatre cent cinquante (i). Avec ces quatre cent cinquante sons, que la diversité d’accents et d’intonations a portés à douze cent soixante-trois, les
' J s ■
Chinois ont créé un vocabulaire de quarante à cinquante mille mots (2). ■
Il est clair, cependant, qu’outre ces racines attributives, il nous faut une autre classe d’éléments radicaux pour nous permettre d’expliquer l’entier développement du langage. Avec ces quatre ou cinq cents racines à sa disposition, le langage n’eût pas été embarrassé pour donner des noms à toutes les choses qui peuvent tomber sous notre connaissance. La parole humaine est comme
23 litterarum îinguæ lalinæ vafiationes sunt 25,852;016, 738,884,976, 640,000 ; 24 litterarum germauicæ linguæ 620,448,401,733,
239,439,360,000. (Cf. Pott, Ftym. Forscà., II, p. 9 ; Jean-Paul, Leben FibelS) p. 160.) Plut. Quæst. Conviv. VIII, 9, 3. ËsvoxpaTr,ç oè tov tSv ctAXaêtov àpiÔuov ov toc p.iyvu.u.£va crpoe âXXyjXa 'xc/.péyei, p.vpta&wv à-rceWjVcV slxocaxcç y,cu p.upiaxcç [/.upuov.
(!) Morrison donne le chiffre de 411, Edkins celui de 652, différence qui provient surtout de ce que Morrison ne compte pas les mots aspirés à part des non-aspirés. Le nombre de eus mots serait beaucoup plus grand si le m final et les lettres initiales douces, g, d, ù, .v,. existaient encore,, comme sons la dynastie mongole. Il y aurait alors au moins 700-radicaux. Les sons attachés aux caractères chinois dans le treizième siècle sont exprimés alphabétiquement dans les vieux manuscrits mongols. Edkins, Mandarin Grammary pp. 44, 45. ........
(2) Le nombre exact dans le Dictionnaire impérial de Khang-hi en est de quarante-deux mille sept cent dix-huit. Un quart environ a vieilli, et là moitié du reste ne s’emploie que rarement, ce qui laisse seulement environ quinze mille mots pour l’usage actuel. « Le nombre exact des caractères classiques èst de quarante-deux mille sept cent dix-huit, dont un grand nombre ne sont plus usités dans la langue moderne, mais se trouvent dans les livres canoniques et classiques. Ils s’emploient quelquefois dans les documents officiels où l’on cherche à-imiter le vieux style. Ce sont principalement des noms de personnes, de lieux, de montagnes, de rivières, etc. Les candidats au poste d’historien impérial étaient ténus de connaître neuf mille caractères, qui étaient contenus dans un manuel séparé. » — Stanislas Julien. .
SEPTIÈME LEÇON. 323
if
une bonne ménagère : considérez la multiplicité d’idées quelle a exprimées par la seule racine spas, et vous verrez qu’avec cinq cents racines pareilles elle arriverait à former un dictionnaire suffisant pour satisfaire aux exigences, même excessives, de l’esprit humain, aux besoins duquel elle a été chargée de pourvoir. Si chaque racine donnait cinquante dérivés, nous aurions vingt-cinq mille mots. Or un ecclésiastique de campagne nous assure que plusieurs de ses humbles paroissiens n’avaient pas un vocabulaire composé de plus de trois cents mots (i). Les inscriptions cunéiformes de Perse ne contiennent que trois cent soixante-dix-neuf mots, dont cent trente et un sont des noms propres. Le vocabulaire des anciens sages de l’Egypte, autant du moins que nous re connaissons par les inscriptions hiéroglyphiques, ne monte qu’à environ six cent cinquante-huit mots (2). Le libretto d'un opéra italien offre rarement une plus grande variété (3). Un An-
(1) The Study ofthe English language, by A. d’Orsey, p. 45.
(2) C’ést le nombre des mots dans le vocabulaire donné par Bunsen, dans le premier volume de son Égypte, pp. 453-491. Cependant plusieurs de ces mots, bien qu’identiques pour le son, doivent être distingués pour l’étymologie, et des recherches postérieures en ont encore augmenté le nombre. Le nombre de groupes hiéroglyphiques dans les Egyptian Hieroglyphics de Sharpe, 1861, s’élève à deux mille trente.
(3) Marsh, Lectures, p. 182. — M. Thommerel a donné le nombre des mots contenus dans les dictionnaires anglais de Robertson et de Webster comme étant de quarante-trois mille cinq cent soixante-six. On dit cependant que l’édition du dictionnaire de Johnson par Todd contient cinquante-huit mille mots, et les dernières éditions de Webster ont donné jusqu’à soixante-dix mille mots, y compris les participes présents et passés comme vocables indépendants. Flügel évaluait à quatre-vingt-quatorze mille quatre cent soixante-quatre les mots de son dictionnaire, dont soixante-cinq mille quatre-vingt-cinq simples et vingt-neuf mille trois cent soixante-dix-neuf composés. C’était en 1843, et. il exprimait alors son espoir que dans sa prochaine édition le nombre des mots dépasserait de beaucoup cent mille. C’est ce que M. Marsh ap-
glais de bonne société, qui a été au Collège et à l’ümyer-sité, qui lit sa Bible, son Shakespeare, le Times, et. se tient au fait de la littérature courante, n’emploie guère dans la conversation plus de trois ou quatre mille mots. Les- personnes qui aiment les pensées exactes et les raisonnements serrés, et qui, écartant les expressions vagues et générales ne se contentent que du mot propre, ont une provision- beaucoup plus grande de mots, et des orateurs éloquents eii peuvent avoir dix mille à leur disposition. Shakespeare, qui a probablement déployé une plus grande
t _
variété d’expressions qu’aucun autre auteur dans aucune langue, a composé toutes ses pièces avec environ quinze mille mots. Nous n’en trouvons qu’environ huit mille dans les ouvrages de Milton ; et l'Ancien Testament dit tout ce qu’il a à dire avec cinq mille six cent quarante-deux (1). •
Cinq cents racines, vu leur fécondité et leur souplesse., étaient donc plus que suffisantes pour le dictionnaire de nos premiers ancêtres. Et cependant il leur fallait encore quelque chose. S’ils avaient une racine exprimant la lumière et l’éclat, elle pouvait être la racine attributive
pelle le Copia vocabulorum en anglais. (Yo)rez Saturday Review,
2 nov. 1861.) ......
Adamantinos Koraïs a trouvé, dans la cinquième édition du Dictionnaire de VAcadémie, vingt-neuf mille .sept cent douze mots ; trente-six mille sept cent quatre-vingt-quatre dans le Dictionnaire anglais de Johnson; cinquante mille dans un vocabulaire de la langue arménienne, et jusqu’à cent cinquante mille dans l’édition de Londres du Thésaurus d’Henri Etienne. (Cf. Pott, Etymol. ForsckIl, 78; Yarron, A. L., YI. 35 : Horum verborum si primigenia sunt ad mille, ut Ciconius scribit, eo-rum decîinationibus verborum discrimina quingenta mil lia esse possunt, ideo quia singulis verbis primigeniis circiler quingeutæ species decîinationibus fiunt. Primigenia dicuntur verba ut lego,, scribo, sto, sedeo et cetera, quæ non sunt ab alio quo verbo, sed suas habent radices.)
(.1) Renan, Histoire des Langues sémitiques, p. 138.
\
’+ ’ /
, ^

325
SEPTIEME LEÇON.
dans les noms du soleil, dé là lune, dés étoiles, du ciel, du jour, du matin, de l’aurore, du printemps,,de la joie, de la beauté, de la majesté, de l’amour, de l’amitié, de l’or, de là richesse, etc. Mais, s’ils avaient voulu dire ici et là, qui, quoi, ceci, cela, tu, lui, il leur eût été impossible de trouver des racines attributives pour le faire. On a cherché, il est vrai, à faire remonter ces mots à des racinès attributives ; mais, si on nous, dit-que la racine démonstrative ta, ceci ou là, peut être dérivée dune racine attributive tan, étendre, nous trouvons que, même dans nos langues modernes, les pronoms et les particules démonstratives sont d’une nature trop primitive et trop indépendante pour qu’une interprétation aussi artificielle soit acceptable. Le son ta ou .sa, exprimant ceci ou là, est une expression aussi involontaire, aussi'naturelle et aussi indépendante qu’aucune racine attributive, et, bien qu’on puisse faire remonter à une racine attributive quelques-unes de ces racines démonstratives, pronominales ou locales (car toutes ces dénominations leur ont été données), il faut admettre Une petite classe de racines indépendantes, non pas attributives dans le sens ordinaire du mot, mais indiquant ou exprimant simplement l’existence dans certaines limites plus ou moins définies de temps ou d’espace. .
Il convient de donner au moins un exemple d’une racine pronominale et de son influence sur la formation des mots.
Dans certaines langues et surtout en chinois, la même racine attributive peut être employée comme verbe, comme nom, comme adjectif ou comme adverbe. Ainsi le son chinois ta signifie, sans aucun changement de forme, grand, grandeur et être grand (4). S’il est placé devant un 16
substantif, c’est tin adjectif : ainsi ta jin signifie « un grand homme ; » s’il est - après un substantif,- c’est un. verbe : jin ta (ou jin ta ye) signifierait « l’homme est grand (4). » De la même manière, jin. ngo ye (2), U pu ngo, signifierait « homme mauvais, loi non mauvaise. » Ici nous voyons qu’il n’y a pas la moindre distinction extérieure entre une racine et un mot, et qu’un substantif n’est distingué d?un verbe que par sa place dans la proposition. . ' ‘
Dans d’autres langues, cependant,'16 et particulièrement dans les langues aryennes, aucune racine attributive ne peut à elle seule former un mot. Ainsi, il y a en latin la racine lue, briller. Pour avoir un substantif, comme lumière, il fallait ajouter une racine pronominale ou démonstrative qui déterminât le sujet général auquel était attribuée la qualité marquée par la racine. Ainsi par l’addition de P élément pronominal s nous avons le nom latin ^ luc-s, lumière, littéralement brillant-là. Introduisons-y un pronom personnel, et nous avons le verbe luc-es, brillant-tu, lu brilles. Ajoutons d’autres dérivés pronominaux,
V -
et nous obtenons les adjectifs- lucidus, luculentus, lu-
cèrhd, etc. ' " . ’ - . . • '
" ' *
Ce serait cependant une grande erreur que de supposer qu’on puisse faire remonter à des racines pronomi- 17 18
nales tous les éléments formatifs, tout, ce qui reste d’un mot après qu’on en a dégagé la racine attributive. Nous n’avons qu’à regarder quelques-uns de nos dérivés modernes pour nous convaincre que beaucoup d’entre eux étaient originairement des racines attributives qui se sont soudées à la racine attributive principale et . qui ont fini par se réduire à n’être plus que de simples suffixes. Ainsi le'suffixe scape dans l’anglais landscape, et la forme plus moderne ship dans hardship, dérivent également de la
* b.
même racine que nous avons en gothique^. skopa, skôp, skôpum, créer; en anglo-saxon, scape, scâpe, scopon (4). C’est le même mot que le dérivé allemand schafl, dans Gesellschcift, etc. De même dom dans wisdom ou christen-dom, dérive de la même racine que nous avons dans to do'. C’est l’allemand ihum dans Christenthum, l’anglo-saxon dôm dans cyning-dôm, Eomgthum. L’anglais hood, l’anglo-saxon hâd, signifie « état» ou « rang » ; mais dans man-
hoçd « âge mûr, » child-hood « enfance,.» brother-hood
« fraternité, » neîghbour-hoùd « Voisinage, » ce mot est devenu un simple suffixe abstrait (2).
Le même fait se produit dans les langues plus anciennes. Ainsi en sanscrit maya est employé comme suffixe secondaire pour former des mots tels que asmamaya « fait de pierre, » mrinmaya « fait de terre ou de glaise, » et sa signification originelle se fait à peine sen-
(!) Grimm, Deutsche Gramrnatik, liv. H, s. 521. .
(2) Spenser, Shepheard's calender, Febmarie, v, 85 (éd. Collier, I, p. 25) : ' .
Cuddïe, I vtole Ihou kensi ïiltle good
. So vaînly fadvaunce thy headlesse liood ; -
for thy lieadlesness ; hood is a terminaison denoting estate, as man-hood.— T. Wàrton.) .
Dans l’ancien haut allemand deoheit et deomiiaï onl, le même sens: l’allemand moderne n’a conservé que Demuthi littéralement condition servile, humilité. .
tir. Cependant, on ne peut guère douter, que maya ne vienne de la racine ma, mîy at-e « mesurer-, faire,.» et', n’ait été primitivement un mot indépendant, comme mita, ou vimita, «fait de. » Nous voyons ceci plus clairement encore dans go maya, qui ne signifie-pas seulement bovinus, mais aussi « fiente de vache. » En grec, une trace de ce même suffixe est resté dans ay^po-p.scc,
originairement « fait d’hommes, » mais employé pour si- -i - - ^
gnifier « humain, » comme dans l’Odyssée . îx, 297 : àvjpoy.eec zpë ’é&û-v, « mangeant la chair humaine ; » et dans l’Iliade, xi, 538 : og.dov â.vbpogsôv, « une foule d’hommes » (1). . ■
. La plupart des désinences des déclinaisons et des conjugaisons sont des racines démonstratives, et nous pouvons prouver, par exemple, que le s qui termine les troi-
* ■
sièmes personnes du singulier de l’indicatif présent des verbes anglais, était dans l’origine le pronom démonstratif de la troisième personne. C’était primitivement un t et non pas un s. Ici quelques explications deviennent nécessaires : la terminaison de la troisième personne du singulier de l’indicatif présent est ti en sanscrit; ainsi dâ, donner, devient d ad âti, il donne : dh.â, placer, da-dhâti, il place. En grec, ce ti s’est changé en si, de même que le sanscrit tvam (le latin lu) apparaît en grec avec la forme sy. Le grec clidôsi répond donc au sanscrit dadâti; tilhësi à dadliâti.. Avec le temps, cependant, les sigma placés entre deüx voyelles dans une terminai- . son se sont élidés; ainsi genos ne.forme pas le génitif . genesos, comme le latin genus, genesis ou generis, mais geneos, genous ; le datif n’est pas genesi (latin generi), mais genei, genei: de même tous les verbes réguliers ont ei pour terminaison de la troisième personne du singulier :
0) Pâmni, v, -4, 21,
mais cet eï remplace esi ; typleti est pour typtesi, qui luï-même est mis pour typleti. .
Le latin laisse tomber Yi final, et au lieu de li a t. Nous obtenons, ainsi amat, dicü.
Or, d’après cette loi de Grimm, dont j’ai déjà parlé, les muettes douces du latin sont représentées en gothique paries fortes du même ordre, elles fortes par les aspirées. Nous devons donc. nous attendre à voir le l rem. placé par le th : effectivement nous trouvons en gothique habaith, au lieudu latin habet. Nous 'retrouvons également . cette aspiration en anglo-saxon, où << il aime, » lie loves de l'anglais moderne, se dit lufath; et aujourd’hui encore nous la. rencontrons en poésie, dans la traduction de la Bible, et dans le style élevé où cette troisième personne est très-souvent terminée par th : ce n’est que dans l’anglais .moderne que cette terminaison s’est changée en s. Dans le s de he loves nous avons donc une racine démons-tralive, agglutinée à la racine attributive love, et qui est originairement .le sanscrit qu’il faut rattacher à la ra
cine démonstrative ta, ceci ou.là, laquelle existe dans le pronom démonstratif sanscrit lad, le grec to, le gothique
■ t _
thata, l’anglais that, et se retrouve encore dans le- latin laits, laiitus, tune, tam; et même dans tamen, ancien adverbe de.lieu en men. Nous voyons donc que ce que nous appelons la troisième personne du singulier de l’indicatif présent est en réalité un composé d’une racine attributive et d’une racine démonstrative. C’est, un composé comme tout autre, si ce n’est que la seconde partie n’en est pas attributive, mais simplement démonstrative. De même que dans le composé anglais pay-master, payeur,-nous attribuons l’action de payer à master, ainsi dans dadâ-li, donne-t-il, les premiers créateurs du langage attribuaient simplement l’action de donner à une troisième personne, et cette proposition synthétique donne-
t-ü est ce que nous appelons, maintenant la troisième personne du singulier de l'indicatif présent de la voix active (1). ' . ' \
bious nous sommes nécessairement Lomé, dans notre analyse du langage, a cette famille de langues qui. comprend la nôtre et celles que nous connaissons le mieux : mais ce qui est vrai pour le sanscrit, et pour les autres membres delà famille aryenne Test également pour'tout le domaine du langage. Toutes les langues, sans aucune exception, qui ont passé par le creuset de la grammaire comparée, se sont trouvées composées de ces deux éléments constitutifs, les racines attributives et les racines démonstratives. Dans la famille sémitique, cës deux éléments sont même plus faciles encore à distinguer quen sanscrit et en grec. Avant, la découverte du sanscrit et la naissance de la philologie comparée, les savants versés dans la connaissance des langues sémitiques avaient dérivé tout lé Dictionnaire hébreu et arabe dhm petit nombre de racines, et, comme dans ces langues chaque racine se compose de trois consonnes, on a quelquefois donné -aux langues sémitiques le nom de trilitères. . .
Mais dans la famille touraniënne, les éléments constitutifs apparaissent bien mieux encore, à la surface, pour ainsi dire, du langage. C’est.un des traits caractéristiques de ces langues que, quel que soit le nombre des préfixes et des suffixes, la racine doit toujours être en relief et n’être jamais obscurcie par son contact avec les éléments formels. .
Il y a une langue, le chinois, dans laquelle aucune analyse n’est requise pour en dégager les éléments. C’est
(1) Chaque verbe grec, conjugué à toutes ses Voix et à tous ses temps, modes et personnes, donne, y compris les participes, environ treize cents formes.
une langue où nulle fusion de racines n’a jamais eu lieu, où tous les mots sont des racines, et toutes les racines des mots. Elle nous présente, en fait, l’état le plus primitif où nous puissions nous imaginer que le langage ait existé, et elle nous offre le mécanisme que nous nous serions naturellement attendus à trouver dans toutes les langues.
Il y a, sans doute, en Asie, en Afrique, en Amérique et dans la Polynésie, de nombreux dialectes qui n’ont pas encore été disséqués par le scalpel du grammairien ; mais nous pouvons nous contenter du moins de cette preuve négative, que jusqu’à présent toutes les langues qui ont passé par l’analyse grammaticale n’ont jamais donné que ces deux éléments constitutifs.
Pour nous, donc, le problème de l’origine du langage, que les anciens philosophes trouvaient si compliqué et si mystérieux, prend un aspect bien plus simple et bien moins obscur, Kous avons vu de quoi le langage se compose, et que tout, dans le langage, excepté les racines, peut se comprendre et s’expliquer. Il n’y a rien qui doive nous surprendre dans ce procédé de la combinaison des racines attributives avec les racines démonstratives , procédé au moyen duquel ont été formées toutes les langues que nous connaissons, depuis le chinois jusqu’à la. nôtre, il n’est pas seulement concevable, comme le remarque le professeur Polt, « que la formation du sanscrit, tel qu’il nous est parvenu, ait été précédée d’une période d’extrême simplicité et d’entière absence de flexions , laquelle nous est encore représentée par le chinois et les autres langues monosyllabiques. » Il est absolument impossible qu’il en ait été autrement. -
Après, avoir vu que ce monosyllabisme chinois a du
_ _ h ' r
être le point de départ de toutes les langues, il 11e nous -
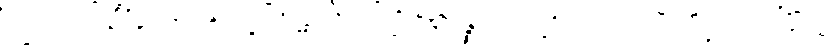
-s
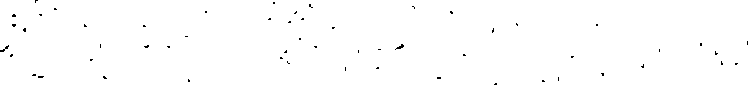
332 • LEÇONS SUR LA. SCIENCE DU LANGAGE.
à _
reste plus, pour résoudre le problème dë l’origine du langage, qu’à expliquer l’origine de ces racines attributives et démonstratives qui constituent tout langage et qui ont jusqu’à présent résisté à toute tentative d’analyse. Cette étude formera le sujet de ugs deux prochaines leçons. '
f
?
A,
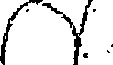
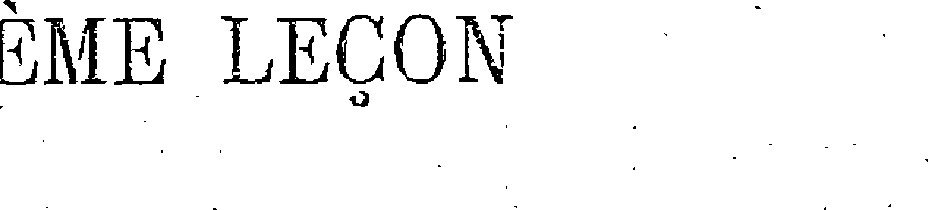
CLASSIFICATION MORPHOLOGIQUE DES LANGUES.
Exposé sommaire des langues sémitiques : leur division en trois branches, Ja branche araméenne, la branche hébraïque et la branche arabique.— Le syriaque et le chaldèen, les deux principaux dialectes de l’araméen. Monuments écrits du syriaque du deuxième et du quatrième siècle : cet idiome se parle encore chez les Nestoriens du Kurdistan. Le chaldèen, langue de Jésus-Christ et de ses disciples ; des fragmentsdu livre d’Ezra,
. et les Targums, nous en donnent des spéciméns : les Talmuds de Jéru-. salem èt de Babylonë, et la Massore, rédigés en chaldèen altéré. Inscriptions cunéiformes de Bâb>lone et de Ninive. Livre, d’Adam. Les Nâbatéens, Âgricüllurè nabàiéënne. — h’iïébréü, rànciennè langue de la. Palestine depuis le temps de Moïse ; sa parenté probable avec le phénicien et le carthaginois. — b'arabe, sorti de la péninsule arabique. Inscriptions himyaritiques. — L’abyssinien ou le ghez. Les Moallakâl, les plus anciens textes arabes. — Le berber, le haussa, le gaila, le copie, dont le caractère sémitique est indécis. — La dénomination de familles ne s’applique proprement qu’aux langues aryennes et sémitiques. Divers degrés de parenté entre les langues. — .Langues toura-niennes, celles qui sont parlées par les races nomades de l’Asie, le iongous, le mongol, le turc, le finnois, le samoyede, le lamoul, le bho-tîya, le laïen et le malais. Traits caractéristiques de ce groupe de langues. — Histoire abrégée de ces langues et des populations qui les parlent. — Problème de l’unité primitive du langage. .
Nous avons déterminé dans notre dernière leçon i’ana-
- „ ' . ■ ' 1 ' . , 1 ° '
tyse du langage-, et nous avons trouvé qu’il a pour seuls
éléments constitutifs les racines attributives elles racines
* r p
démonstratives. .
Nous reviendrons maintenant.sur nos pas pour chercher combien de formes possibles: du langage peuvent être
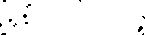
ï . ' ».

334 LEÇONS SUR LA SCIENCE Dü LANGAGE.
produites par la libre combinaison de ces éléments cons' ■ , j ■ ' *
litutifs, et nous tâcherons ensuite de découvrir si chacune de ces formes possibles , a son équivalent dans quelqu’un des idiomes parlés par l'humanité. Nous cher' ch on s, en effet, à établir une classification .du langage que nous sommes déjà convenus.d’appeler morphologique, fondée entièrement sur la forme des mots, c’est-à-dire sur la manière dont se combinent les racines, sur le procédé . par lequel elles se groupent et s’assemblent pour exprimer et coordonner les idées quelles représentent; par
conséquent, cette classification sera complètement indépendante de la classification généalogique qui, par sa
nature même, est fondée sur les mots eux-mêmes qui ont été transmis tout formés de génération en génération.
Avant, cependant, d’aborder ce sujet qui doit faire l’objet principal de cette leçon, nous avons encore à examiner, le plus brièvement possible, une nouvelle famille de langues, laquelle, comme la famille aryenne, a été établie d’après, les principes les plus rigoureux de la elassifica-Lion généalogique, à savoir la famille sémitique. Cette famille est divisée en trois branches: Yaraméenne, Yhé-
- braique et Yarabique (/I).......... • c - - .......
l’araméen occupe la partie septentrionale du domaine , que se sont approprié les langues sémitiques; il à été parlé dans la Syrie, la Mésopotamie, et dans une partie des anciens royaumes de BabySonie et d’Assyrie. Il nous' est surtout connu par deux dialectes le syriaque et le
chaldéen. On donne le premier nom à la langue qui nous
" T t ■ „ r 1 "
a été conservée dans une version de la Bible qu’on appelle Peschito (2)., dont on place ordinairement la date au
(1) Histoire générale et système compare des langues sémitiques 1 par Ernest Renan, seconde édition. Paris, i858.
(2) Peschito signifie simple. L’Ancien Testament fut traduit de
, )
HUITIÈME LEÇON. 335
* A - ,
deuxième siècle, et aussi dans la riche littérature chrétienne du quatrième. Elle s’est perpétuée jusqu’à nos jours, bien que sous une forme très-altérée, chez les Kestoriens du Kurdistan, aux environs des lacs deYan et d’Ourmia, et chez quelques populations chrétiennes de la Mésopotamie ; des missionnaires américains (I), établis à Our-mia, ont essayé de rendre à ce patois quelque régularité grammaticale en publiant des traductions et une grammaire du dialecte qu’ils appellent le néo-syriaque (2).
Le nom.de chaldéen a été donné à la langue adoptée par les Juifs pendant la. captivité deBabylone. Bien que les Juifs n’aient jamais oublié leur langue sacrée, ils commencèrent bientôt à se servir de l’idiome de leurs
- \ ■
conquérants, non-seulement pour la conversation, mais aussi pour la composition littéraire (3). Le livre d’Esdras
l’hébreu, le Nouveau Testament du grec, vers l’an 200, sinon plus tôt. Saint Éphrem vivait au milieu du quatrième siècle. Pendant le huitième et-le neuvième siècle, les Nesloriens de Syrie étaient les guides intellectuels des Arabes, mais cette suprématie commença à décliner au dixième siècle. Au treizième siècle, Gregorius Barhe-bræus (Abulfaraj) rendit un éclat momentané à la littérature de son pa\fs. voyez Renan, p. 257. ' .
(!) MM. Perkins et Sloddard, dont le dernier a composé la grammaire publiée dans le Journal of the- American oriental Society, vol. V.
(2) L’extrait suivant d’Alîon (Mémoires de Sherman) montrera avec quelle facilité des personnes, même intelligentes, se trompent ou se laissent tromper par d’autres, pour ce qui regarde les langues et leur parenté : « Je n’oublierai jamais le plaisir que ressentit M. Sherman quand il- découvrit que le docteur Nolan et Assaad y’Kijath, de Be}7routh, quand ils parlaient, l’un le patois cellique de l’Irlande, l’autre le syro-phénieien, pouvaient se comprendre et soutenir l’un avec l’autre une conversation. Par là se trouvait mis hors de doute, selon lui, le fait longtemps contesté de l’établissement en Irlande de colons phéniciens qui auraient été les premiers habitants de l’ile (p. 215). » - ,
(3) Renan, p. 2U seq.: « Le chaldéen biblique serait un dialecte araméen légèrement hébraïsé. »
contient, des fragments en chaldéeri, contemporains des inscriptions cunéiformes de Darius et de-Xerxès, et plusieurs des livres apocryphes, bien quils ne. nous soient parvenus qu’en grec, ont très-probablement été composés originairement en chaldéen et non en hébreu. Les Targuais (4), comme on les appelle, ou traductions et paraphrases de l’Ancien Testament, composés pendant -les siècles qui ont immédiatement précédé et suivi l’ère chrétienne, nous donnent, un autre spécimen de l’araméen ou langue babylonienne transplantée en Palestine (2). Cet araméen était la langue de Jésus-Christ et de ses disciples : les quelques mots qui nous sont conservés dans le Nouveau Testament, tels qu’ils ont été prononcés par Notre-Seigneur dans sa propre langue, comme Taliiha Kumi, Èphphatha, Abba, ne sont pas de l’hébreu, mais du chaldéen ou de l’araméeh qui était alors le dialecte vulgaire de la Judée (3).
Après la destruction de Jérusalem, cet idiome continua à être la langue littéraire "des Juifs. Le Talmud de Jérusalem du quatrième siècle, et celui de Bahylone du cinquième, nous présentent le chaldéen tel que le parlaient les Juifs lettrés établis dans ces deux contrées, .mais très-altéré et corrompu par un mélange d’éléments étrangers (4). Ce dialecte resta la langue écrite des Juifs
(1) De l’arabe tarjam, expliquer; Drogman se dit en arabe tar-
jamân. . .
(2) « Les plus anciens.Targums sont ceux d’Onkelos et de Jonathan, écrits dans le second siècle après Jésus-Christ. Quelques autres sont d’une époque beaucoup plus moderne et postérieurs même au Talmud. » — Renan, p. 220.
(3) Renan, pp. 220-222.
(4) Le Talmud (instruction) se compose de la Mis hua ‘et de la G&-mara. Mislma signifie répétition, à savoir de la loi La Mishna a été réunie et écrite, vers 218, par Jehuda. La Gemara est une continua-
jusqu’au dixième siècle, et vers celle époque la Massore fut. rédigée en chaldéen ('!). Bientôt, après, le chaldéen judaïque se vit dépossédé par l’arabe, et perdit toute existence, même littéraire.'En effet, quand l’arabe cessa à son tour d’être la langue des Juifs, au treizième siècle, ceux-ci revinrent à une sorte d’hébreu modernisé qu’ils emploient encore pour leurs compositions savantes.
Il est curieux que la branche araméenn-e de la famille sémitique, bien qu’à cette branche appartînt originairement la langue des grands empires de Babylone et de Kiniye, ne nous„ soit parvenue que dans la littérature des Juifs et des chrétiens de Syrie (2). Il a dû exister une littérature babylonienne, car la .sagesse des chaldéens avait acquis une réputation qui n’aurait pu guère se soutenir sans une littérature. Abraham a dû parler araméen avant d’émigrer en Chanaan. Laban parlait le même dialecte, et le nom qu’il donna au monceau de pierres qui devait être le monument de son alliance avec Jacob, Jegar-saha-duihâ, est syriaque, tandis que Galeed, le nom donné par Jacob, est hébreu (3). Si nous devons jamais connaître
cette ancienne littérature babylonienne, ce sera nécessai-
" » ' w -
renient par les inscriptions cunéiformes qui ont été dernièrement rapportées de Babylone et de Ninive. Elles sont évidemment écrites dans une langue sémitique ; sur ce point il ne peut plus y avoir de doute, et, bien que leur déchiffrement n’ait avancé que lentement, plus lentement même que l’on ne s’y attendait à une certaine époque,
lion et un commentaire de la Mishna; celle de Jérusalem fut achevée vers la fin du quatrième siècle, et celle de Babylone vers la fin du cinquième. ■ • ;
(1) Imprimée pour la première fois dans la Bible rabbinique.
Venise, 1525. ' .
(2) Voir cependant ce que nous avons dit du pehlvi.
(3) Qualremère, Mémoire sur les Nabatèens^ p. 139.
338 LEÇONS SCR LA SCIENCE DU LANGAGE.
*> '
nous avons tout lieu d’espérer que les efforts persévérants des assyriologues seront, un. jour couronnés de succès. Dans une lettre datée d’avril 4 853, sir Henry Rawlinson écrivait :
* »
« Sur les tablettes d’argile que nous avons trouvées à
Kinive, et qui se comjDtent maintenant par milliers, nous avons des traités didactiques qui embrassent presque tous les sujets sous le soleil; on y trouverait des grammaires et des dictionnaires, tout ce qui concerne l’art de l’écriture, la notation numérique, les poids et les mesures, les divisions du temps, la chronologie, l’astronomie, la géographie, l'histoire, la mythologie, la géologie, la botanique, etc. En un mol, nous avons maintenant à notre disposition une véritable encyclopédie de science assyrienne. » .
Considérant * le succès avec lequel on a déchiffré toute une classe d’inscriptions cunéiformes, celles, de la Perse, il n’y a nulle raison de douter que to i cette encyclopédie ne se lise un jour aussi facilement que nous lisons maintenant les annales de la montagne de Darius.
- Il y a cependant un autre misérable reste de ce qui était jadis la littérature des Chaldéens ou des Babyloniens, c’est le Livre d’Adam, et d’autres écrits du même genre conservés par les Mendaïtes ou Nasoréens, secte curieuse établie près de Bassora. Bien que la rédaction de cës livres soit aussi récente que le dixième siècle" avant Jésus-Christ, on a supposé que, sous une incrustation moderne d’extravagantes et folles imaginations, ils contiennent encore quelques germes de la véritable science babylonienne. En effet, ces Mendaïtes ont été identifiés avec les Nabatéens, qui sont mentionnés aussi récemment que le dixième siècle de notre ère, comme une race purement païenne, et distincte des Juifs, des chrétiens et des maho-
métans (1). En Arabe, le nom de nabatéen ($) est employé comme synonyme de babylonien, et ce nom est même donné à toutes les populations d’origine araméenne établies depuis les temps les plus reculés entre l’Euphrate et le Tigre (3). On suppose que les Nabatéens, qui sont cités vers le commencement de l’ère chrétienne, comme une race célèbre pour sa connaissance de l’astronomie et de toutes les sciences, étaient les ancêtres des Nabatéens du moyen âge, et les descendants des anciens Babyloniens et Chaldéens. Tous avez pu lire dernièrement dans des journaux littéraires des notices sur un traité intitulé Agriculture nabatéennequi n’existe que dans une traduction arabe écrite par Ibn Wahshiyyah le Cbaldéen vers l’an 900 de notre ère,ma is dont l’original, composé en araméen par Kouthami, a été rapporté au commencement du treizième siècle avant Jésus-Christ (4). Nous n’avons pas encore les éléments nécessaires pour nous prononcer sur l’âge de cet écrit, mais d’après ce que- nous savons il paraît plus probable que c’est une compilation faite par un Nabatéen qui vivait vers le quatrième siècle de. notre ère (5) ; et, bien qu’il renferme d’anciennes traditions qui
(1) Renan,.p. 24-i.
(2) Ibid., p. 237.
(3) Quatremère, Mémoire sur les Nabaléens, p. -H6. ■ -
(4) Ibn ’Wahshiyyah était musulman, mais sa famille n’était convertie que depuis trois générations, lia donné des traductions d’un certain nombre d’ouvrages nabatéens, et trois de ces traductions nous sont parvenues. Ce sont : 1° YAgriculture nabatéenne ; 2° le Traité des poisons; 3° le Livre de Tenltelusha (Teucros) le Babylonien, et des fragments du Livre des secrets du soleil et de la lune. VAgriculture nabatéenne a été rapportée par Quatremère (Journal asiatique, 4835) à la période qui s’est écoulée depuis Bélésis, qui délivra les Babjdoniens de la domination des Mèdes, jusqu’à la prise de Bab}done par Cyrus. M. Clrvvolsohn de Saint-Pétersbourg, qui a examiné tous les manuscrits, place Koulhami au commencement du treizième siècle avant Jésus-Christ.
. (5) Renan, Mémoire sur l'âge du livre intitulé Agriculture naba
téenne, p. 38. Paris, 1860 ', Times, Jan. 31, 1862.
remontent peut-être aux époques fioris.sant.es. de la monarchie babylonienne, on 11e serait guère fondé, à regarder ces traditions altérées comme une image fidèle de l’antique civilisation de la race araméenne,
La seconde branche de la famille sémitique est Y hébraïque, représentée principalement par l’ancienne langue de la Palestine. On peut dire que l’hébreu a été parlé et écrit dans cette contrée depuis le temps de Moïse jusqu’à celui de Kéliémie et des Machabées, quoique, à la longue, il ait subi d’importantes modifications et admis un mélange considérable de formes araméennes, depuis la captivité de Babylo'ne, et surtout depuis la naissance d’une puissante civilisation dans la Syrie voisine de la Palestine. L’ancienne langue de la Phénicie, à en juger par les inscriptions qui nous en restent, était très-étroitement alliée à l’hébreu, et la langue des Carthaginois doit, égalera eut
TÎ -
être rapportée à la même branche.
L’hébreu fut d’abord envahi par des dialectes araméens, par suite de la prépondérance politique de Babylone et encore plus par suite de l’ascendant que prit la Syrie ; puis il eut à s’effacer devant le grec, qui fut, pendant un certain temps, la vraie langue de la civilisation dans tout l’Orient; il fut enfin emporté par l’arabe, qui, depuis la conquête de la Palestine et dé la. Syrie en l’aimée 636, s’est emparé de toute la région occupée auparavant par les deux plus anciens rameaux de la tige sémitique, l’araméen et l’hébreu.
Cette troisième branche, l’arabe, est sortie de la péninsule arabique, où elle est encore la langue d’une masse compacte d’aborigènes. Ses plus anciens monuments sont, les inscriptions himyantiques. À une époque très-reculée, un rameau de celte branche arabique fut transplanté en Afrique, où, au sud de l’Égypte et de la Nubie, sur la côte qui fait face à l’Yemen, une des vieilles langues sémiti-
HUITIÈME LEÇON

<0.
ques s est maintenue'jusqu à nos jours : c est Y éthiopien ou Y abyssinien, ou, comme lés indigènes l’appellent,- le
' ■ ■ 4 i
'g lies. Bien qu’il ne soit plus parlé dans sa pureté par le peuple de l’Abyssinie, il s’est conservé dans leurs livres sacrés, dans les versions de la Bible, et d’autres ouvrages semblables qui datent du troisième et du quatrième siècle. La langue moderne de l’Abyssinie est Y'amharique.
Les premiers testes arabes remontent à une époque antérieure à Mahomet. On les appelle Moallakât, littéralement poésies suspendues, parce que, dit-on, elles étaient exposées aux yeux du public à la Mecque: ce sont de vieux poèmes populaires qui peignent la vie du désert et ses émotions. Avec Mahomet, l’arabe devint la langue d’une religion victorieuse, et établit son empire en Asie, en Afrique et en Europe.
Ges trois branches, l’araméenne, l’hébraïque et l’arabique, ont entre , elles une si proche parenté qu’il était impossible de ne pas reconnaître leur origine commune. Aussi loin que nous remontions dans l’histoire de ces langues et de leurs racines, nous trouvons chacune de ces racines nécessairement composées de trois consonnes ; chacune d’elles donne naissance à un grand nombre de mots qui en dérivent par un simple changement de Voyel- • les, la charpente des consonnes restant autant que possible intacte. 11 est impossible de ne pas reconnaître à première vue une langue sémitique; et, ce qu’il importe surtout de constater, il est impossible de s’imaginer une langue aryenne dérivée d’une langue sémitique, ou réciproquement. Le cadre grammatical est complètement dif-. férent dans ces deux familles ; ce qui n’exclut pas, cepen-. dant, la possibilité d’une origine commune (1), et la
.(1) Les théologiens qui.soutiennent encore que toutes les langues dérivent de l’hébreu feraient bien de lire un ouvrage de l’abbé
comparaison des racines des langues sémitiques, réduites à leur plus simple forme, avec celles des langues aryennes, est venue confirmer l’opinion des savants qui croient à l’identité primitive des éléments matériels d’où toutes ces langues sont sorties. .
D’autres langues que l’on suppose appartenir à la. famille sémitique sont les dialectes berbers de l’Afrique septentrionale, lesquels, avant l’invasion des Arabes, étaient parlés sur la côte depuis l’Égypte jusqu’à l’Océan Atlantique, et sont maintenant relégués dans l’intérieur. On a aussi rangé dans la même famille quelques autres langues de l’Afrique, telles que le haussa, le galla., et la langue de l’Égypte depuis les premières inscriptions hiéroglyphiques jusqu’au copte quia cessé d’être une langue parlée depuis le dix-septième siècle. Toutefois le caractère sémitique de ces dialectes est loin d’être aussi clairement défini, et leur degré exact de parenté avec les langues sémitiques, proprement dites, est encore à déterminer (1).
Rigoureusement parlant, lés familles aryenne et sémitique sont les seules qui méritent réellement ce titre de familles. Toutes deux présupposent l’existence d’un système grammatical complètement élaboré avant la séparation des dialectes. Leur histoire depuis le commencement
Lorenzo Iîervas, dont la dédicace fut agréée par le pape Pie VI, Saggio Pratico dette Lingue, 1787, particulièrement le quatrième chapitre, intitulé : « La soslanziale diversité degl’ idiomi nella sin-tassi addimostra essere vana l’opinione degli Àutori, che H credono derivati dall’ Ebreo. »
(!) Plusieurs excellents articles sur ces membres éloignés delà famille sémitique ont été publiés par le docteur Lottner dans les Transactions oflhe Philological Society, 1861, p. îO, sous ce titre : « Sur les familles de langues sœurs, particulièrement sur celles qui se rattachent à la famille sémitique. » Cependant la parenté de ces langues avec l’arabe, l’hébreu et le syriaque, n'est pas tout à fait aussi certaine et étroite que le terme de Familles de langues sœurs semblerait l’impliquer.
est plutôt celle de la décomposition que du développe-, ment; de là cet air de famille auquel il est impossible de se méprendre et qui distingue encore leurs derniers descendants. Le langage du cipaye indien et celui du soldat anglais sont, à parler strictement, une seule et même langue. Ils sont tous deux construits de matériaux qui avaient reçu leur forme définitive avant que la branche teutoni-que se fût séparée de la branche indienne ; aucune racine
nouvelle n’y a été ajoutée depuis cette époque, et les for, *
mes grammaticales qui se sont plus tard développées en anglais ou en hindouslani ne présentent; quand on les examine de près, que de nouvelles combinaisons d'éléments qui ont existé, dès le principe, dans tous les dialectes aryens. Dans la terminaison de l’anglais lie is, et dans les deux lettres qui terminent le mot français il est, lettres que la prononciation dissimule, mais, que récriture a conservées, nous reconnaissons le résultat d’un acte accompli une fois pour toutes avant la première dispersion de la racé aryenne, et dont les effets se sont perpétués jusqu’à nos jours : la combinaison de la racine attributive as avec la racine démonstrative
C’était l’habitude de Nabucliodonosor de faire imprimer son nom sur toutes les briques employées pour édifier ses immenses palais. Ces palais sont tombés en ruine, mais leurs débris ont été emportés pour bâtir de nouvelles villes, et, en examinant les briques dont sont formés les murs de 1 a ci té moderne de Bagdad, sur les bords du Tigre, sir lîenrv Rawlinson a découvert sur chacune d’elles les
v
traces évidentes de celle signature royale. C’est un exemple, de ce qui nous arrive quand nous examinons la structure des langues modernes : elles aussi ont été construites avec les matériaux enlevés des ruines des langues.anciennes, et chacun de leurs mots, quand nous les considérons attentivement, nous laisse voir clairement l’empreinte
r
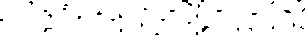
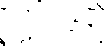
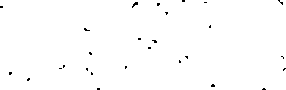
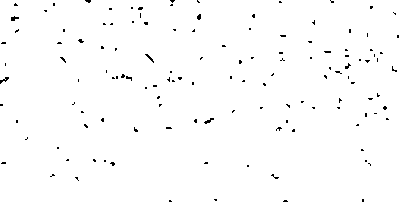
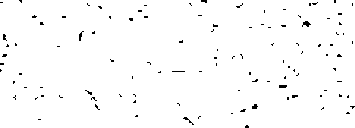
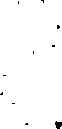
344 LEÇONS SUR LA SCIENCE DU LANGAGE.
T O . -
que lui ont donnée dès le commencement les pères des familles aryenne et sémitique, les fondateurs de ces deux grands empires du langage.
Les langues, cependant, ne sont pas toujours liées par une aussi étroite parenté. Elles peuvent se scinder avant que leursyslème grammatical se soit définitivement fixé, et, dans ce cas, nous ne pouvons pas nous attendre à y trouver les mêmes caractères évidents d’une descendance commune que, par exemple, dans les dialectes néo-latins, le français, l'italien et l’espagnol. Elles pourront avoir bien des traits de ressemblance, mais elles offriront aussi-un développement postérieur et particulier à chacune d’elles, dans les mots et dans les formes grammaticales. Quant aux mots, nous.voyons que même les langues,qui ont entre elles des rapports aussi intimes de fraternité que les six idiomes romans diffèrent pour quelques-unes des expressions les plus ordinaires. Au lieu du latin frater, et du français frère, nous trouvons en espagnol hermano, mutation pour laquelle il y avait une excellente raison : le mot latin frater, changé en fray et frayle, avait été employé pour signifier un frère ou religieux ; on sentit l’inconvénient de. n’ayo.ir; qu’un mot pour exprimer . deux', idées qu’il importait quelquefois de distinguer, et alors par une sorte d’élimination toute naturelle on écarta le mot frater dans le sens de frère, et on le remplaça par germanus, synonyme que fournissait, le riche fonds de la langue latine. De même le mot latin pour berger, pastor, était si souvent employé pour signifier le pasteur du peuple qu’il fallut un nouveau nom pour le pasteur des troupeaux; c’est ainsi que berbericuSi de berbex ou. vervex, bélier, remplaça pastor et devint berger. Au lieu, de l’espagnol enfermo, nous trouvons en français malade, en italien am-malalo. Des langues apparentées d’aussi près que le grec et le latin se sont arrêtées à des expressions différentes
pour fils, fille, frère, femme, homme, ciel, terre, lune, main,'bouche, arbre, oiseau, etc. (/I). C’est-à-dire que, sur une foule de synonymes fournis par les nombreux dialectes de la famille aryenne, les Grecs en ont conservé un, les Romains un autre. U est clair que ce principe de l’adoption spontanée des mots une fois admis et opérant librement, des langues issues d’une même source peuvent finir par avoir un vocabulaire tout à fait différent pour les objets les plus familiers. Le nombre des synonymes véritables est souvent exagéré, et quand on nous dit qu’en islandais il y a cent vingt noms pour île, en arabe cinq cents noms pour lion (2), et mille pour épée (3), il ne faut pas douter que beaucoup de ces mots ne soient purement des métaphores, des qualifications poétiques. Mais quand même une langue mère n’aurait que quatre ou cinq synonymes pour désigner les mêmes objets, il est. évident que quatre langues pourraient en -être- dérivées, dont chacune serait en apparence tout à fait distincte des autres (4). .
Ceci n’est pas moins vrai pour'la grammaire. Quand, par exemple, les langues romanes formèrent leur nouveau futur en plaçant le verbe auxiliaire habere, avoir, après l’infinitif, rien absolument ne les empêchait d’adopter quelque autre combinaison pour exprimer le temps à venir : le français aurait pu préférer je vais dire ou je dirvais, à je dirai, et dans ce cas le futur français eût été complètement différent du futur italien. Si de tels changements sont possibles dans des langues littéraires déjà aussi anciennes que le français et l’italien, nous devons nous . (1) Voyez Letter on Turanicm Languages, p. 62.
+ ■
(2) Renan, Hisloii'e des Langues sémitiques, p. -137.
(3) Pocoeke, Notes tp Abulfaragius, p. 133: Glossology, p. 332,
__ " * ■ ■» .
(4) Voir Terrien Poncel, Du Language, p. 213. ■
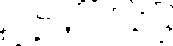
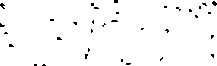
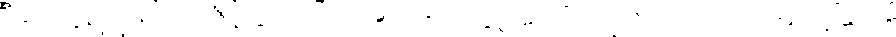
.346 LEÇONS SUR LÀ SCIENCE DU LANGAGE ! .
. ' ^ - -
attendre à en trouver de bien autres dans des langues qui, comme je l'ai dit, se sont séparées avant que leur grammaire et leur vocabulaire se fussent définitivement fixés.
Si nous pensions y rencontrer ces traits de ressemblance frappante qui prouvent la fraternité des membres des familles aryenne et sémitique, nous serions nécessairement désappointés, car ils ne peuvent exister dans ces langues. Mais il y a des règles pour déterminer les degrés de la parenté même la plus éloignée qui puisse exister dans le vaste domaine du langage, entre deux ou plusieurs idiomes ; ces règles suffisent, au moins, pour faire ajourner les conclusions trop hâtives de ceux qui voudraient
nier quil soit possible d’assigner avec quelque vraisemblance une origine commune à des langues qui diffèrent plus 1’ une de l’autre que le français et l’italien, le sanscrit et le grec, l’hébreu et l’arabe. Ceci yous paraîtra plus clair quand nous aurons examiné les principes de ce que j’appelle la classification morphologique du langage.
Comme toutes les langues, autant que nous pouvons en juger à présent, peuvent se réduire en dernière analyse à des racines attributives et démonstratives, il est manifeste que, selon la manière dont les racines sont unies, nous pouvons nous, attendre à trouver trois espèces de lan-gués, ou trois périodes dans la formation graduelle du langage.
4° Les racines peuvent être employées comme des mots, chaque racine conservant, toute son indépendance..
. â° Deux racines peuvent être jointes ensemble pour former des mots, et dans ces composés l’une des racines peut perdre, son indépendance.
3° Deux racines peuvent être réunies pour former des mots, et, dans ces composés, perdre toutes les deux leur indépendance. . .
. Ce qui s’applique à deux racines s’applique également
i
à trois ou quatre ou plus encore. Le principe est le même, seulement il mènerait à une subdivision plus .variée. . - -
. J'appelle période des racines la première/ où chaque racine conserve son indépendance et où il n’y a pas de distinction formelle entre une racine et.un mot; elle nous est représentée surtout par l’ancien chinois, el les langues comprises dans cette première période ont quelquefois été appelées monosyllabiques ou isolantes. J’appelle période des désinences la seconde, où deux ou plusieurs racines s’agglutinent pour former un mot, l’une conservant son indépendance radicale et l’autre serédùisant. à une simple désinence, ainsi que cela a lieu dans la famille louranienne ; etles langues qui y sont comprises ont pris le nom d’aggluti-ncinles, de gluten, glu. Enfin, j’appelle période des flexions la troisième, dans laquelle les racines se fondent de telle sorte qu’aucune d’elles ne conserve son indépendance, comme nous le voyons dans les familles aryenne et sémitique ; et les langues qui en font partie ont quelquefois été distinguées par le nom à’organiques ou amalgamantes.
La première période exclut toute altération, phonéti
La troisième admet l'altéra lion phonétique dans la racine principale et dans les désinences.
Quelques exemples feront mieux comprendre celle classification (1). .
Dans la première période, représentée par le chinois,
(I) [Comparez, sur ces trois périodes, sur les caractères que l’on peut faire entrer en ligne de compte, et sur la méthode que l’on doit suivre pour établir une classification naturelle
;
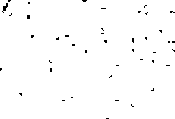
348 . LEÇONS SUR LÀ SCIENCE Dü LANGAGE.
O '
chaque mot est une racine, avec sa signification indépem-■ danle. Ainsi là où nous disons en latin baculo, avec'un bâton, nous disons en chinois y cang (4). Dans cette expression, on pourrait prendre y pour une simple préposition, comme le français avec: mais en chinois y est une racine : c’est le même mot qui, employé; comme verbe, signifierait « se servir. » En chinois, donc, ÿ cang signifie littéralement « se servir de bâton. » Ou bien encore, là où nous disons à la maison, en latin domi, les Chinois disent uo-li, uô signifiant maison, et li intérieur (2). Le mot pour jour est en chinois moderne gi-ise, primitivement /?.^ du
soleil (3). .
Il n y a, comme nous l’avon s déjà vu, aucune distinction formelle, en chinois, entre un nom, un verbe, un adjectif,
un adverbe et une préposition. La même racine, selon la place quelle occupe dans la proposition, peut être employée pour traduire les mots grand, grandeur, grandement, être grand. Tout dépend en chinois de l’arrangement convenable des mots dans la phrase. Ainsi ngo ta ni signifie « je te bats ; » mais ni là ngo signifierait « tu me bats, » ngo gin signifie .« un méchant homme; » gin ngo signifierait « l’homme est méchant. ». ..............
Tant que tous les mots ou parties de mots conservent
entre les langues, là où il n’y a point filiation directe, deux articles de M. F. Baudry, intitulés : De la Science du Langage et de son état actuel, dans la Revue archéologique, janvier et . lévrier 1864. Tr.]
. (1) Endlicher, Chinesische Grammatik,]). 223.
" (2) Ibid., p. 339. .
(3) Bans ce mot, tse (tseu) ne signifie pas fils ; c’est une addition qui se rencontre souvent après les noms, les adjectifs et les verbes. Ainsi lao, vieux, -j- tseu, signifie père ; nei, l'intérieur,.+ tseu, signifie femme : triang, odeur, -j- tseu, le clou de girofle ; hoa, mendier, -f- tseu, un mendiant ; hi, jouer, -j- tseu, un acteur. — Stanislas Julien.
. HUITIEME LEÇON. . 349
O p
sensiblement leur signification radicale, une langue appartient à la première période, celle des racines. Aussitôt que des mots comme tse dans gi-tse jour, U dans uô-li à la maison, ou y dans y-cang avec le bâton, perdent leur sens étymologique et deviennent des signes de dérivation ou de cas, la langue entre dans la seconde période, celle des désinences, à laquelle appartient la grande majorité des langues. Tout le groupe louranien se compose de langues à désinences ou agglutinantes, et il comprend, à l'exception du chinois et des dialectes congénères, toutes les langues parlées en Asie et en Europe qui 11e font pas partie des familles aryenne et sémitique. Sur lé vaste continent de l’ancien monde, lès langues sémitiques et aryennes n’occupent que ce qu’on peut appeler les quatre péninsules
occidentales, à savoir: l’Inde avec la Perse, l’Arabie,
. — ' *
l’Asie Mineure, et l’Europe ; et nous avons lieu de supposer que même ces contrées ont été habitées par des populations touraniennes avant l’arrivée des nations aryennes et sémitiques. ’
Cette classe de langues qui forment le groupe touranien a le droit de réclamer toute l’attention du linguiste qui veut écrire Thistoire de la parole humaine. .Quelques savants lui. refusent le nom de la famille ; et en effet, si ce nom ne peut s’appliquer qu’aux dialectes aussi étroitement apparentés que le sont entre elles les langues aryennes ou sémitiques, il serait préférable de parler de la classe ou du groupe touranien. Mais que l’on n’abuse pas de cette concession pour fausser notre pensée ; nous ne concluons, pas de là que les membres de ce groupe soient sortis de berceaux différents, et que le lien qui les unit, au lieu d’être une affinité généalogique,- soit seulement une similitude de conformation.
Ces langues ont en commun des éléments quelles ont dû puiser à la même source, et leurs coïncidences formel-
350 LEÇONS SUR LA SCIENCE DU LANGAGE.
-
les, bien que d’un caractère différent de celles qui se re. H
manquent dans les familles aryenne et sémitique, son*-cependant telles quil est impossible de les attribuer à des rencontres fortuites.
Le mot touranien est employé comme faisant antithèse à aryen, et s’applique aux races nomades de l’Asie en tant qu’on les oppose aux races agricoles ou aryennes.
La famille ou classe 1 ouranienne comprend deux grandes divisions : celle du Nord et celle du Sud.
Celle du Nord est quelquefois appelée ouralo-altcüque ou ougro-tartare, et elle se subdivise en cinq sections : la tongouse, la mongole, la turque, la finnoise, et la sa-moyède. .
Celle du Sud, qui occupe la partie méridionale de l’Asie,
est divisée en quatre classes : la tamoule, qui comprend
*
les dialectes du Deccan ; la bholîya, les dialectes du Tibet et du Bhotan : la taïenne, les dialectes de Siam, et la malaise, les dialectes de Malaçca et de la Polynésie.
Sans doute notre attente serait trompée si nous pensions trouver dans cette multitude innombrable de langues le même air de famille qui rapproche les langues sémitiques ou. aryennes : mais l’absence même de cet air de famille constitue un des caractères des dialectes touraniens (4). Ce sont des langues de nomades, langues qui, par ce caractère, se distinguent profondément des langues aryennes et sémitiques. Dans les langues de ces deux dernières familles, la plupart des mots et des formes grammaticales ont été produits une fois pour toutes, par la force créatrice d’une seule génération, et on ne les abandonnait pas légèrement, même quand leur clarté originelle avait été obscur-' cie par l’altération phonétique. Transmettre une langue de cette manière n’est possible que chez les peuples dont
' HUITIÈME LEÇON. . 351
» ^ '
l’histoire coule comme un grand fleuve, et chez qui la religion, les lois et la poésie servent de digues au courant du langage. Mais, chez les nomades touraniens il ne s’est jamais formé de noyau d’institutions politiques, sociales ou littéraires. Les empires n’étaient pas plus tôt fondés, qu’ils étaient dispersés de nouveau comme les nuages de sable du désert ; nulles lois, nuis chants, nuis récits ne survivaient à la génération qui les avait vus naître.
Dans une leçon précédente, en traitant du développement des patois, nous avons vu avec quelle rapidité le langage peut s’altérer quand il est abandonné à lui-même sans être fixé par des modèles littéraires ou des règles grammaticales. Les substantifs les plus indispensables, tels que père, mère, fille, fils, se sont souvent perdus et ont été remplacés par des synonymes dans les différents dialectes touraniens, et les désinences grammaticales n’ont pas eu un sort meilleur.
Néanmoins plusieurs des noms dénombré, des pronoms et beaucoup de radicaux-dans ces langues révèlent l’unité de leur origine ; et les racines et les mots appartenant en commun aux membres les plus disséminés de cette famille nous autorisent à reconnaître une parenté réelle quoique très-éloignée entre tous les dialectes touraniens.
Le trait le plus caractéristique de ces langues, c’est Y agglutination (1) : ce qui ne signifie pas seulement que, dans leur grammaire, les pronoms sont, pour ainsi dire, accolés aux verbes pour former la conjugaison, ou les prépositions aux substantifs pour former la déclinaison, car ce ne serait pas là un caractère distinctif de ces langues nomades, puisqu’en hébreu, aussi bien qu’en sanscrit la conjugaison et la déclinaison ont été originairement
constituées d’après les mêmes principes : mais ce qui dis-
+
lingue lès langues touraniennes, c’est que les mots que
■ *-
nous offrent leur conjugaison et leur déclinaison se prêtent toujours à. une décomposition facile ; et, bien qu’il s’en faille de beaucoup que les terminaisons aient toujours conservé leur valeur significative comme mots indépendants, on sent encore qu elles sont des syllabes modificatives, distinctes des racines auxquelles elles s’ajoutent. .
Dans les langues aryennes, les modifications des mots comprises sous les noms de déclinaison et conjugaison étaient aussi exprimées, dans l’origine, au moyen de l'agglutination. Mais les parties constituantes ne tardèrent pas à se fondre de manière à former un tout, sujet ensuite, à F altération phonétique, au point qu’il devenait impossible, après un certain laps de temps, de distinguer la racine de l’élément formatif qui s’y était ajouté. La différence entre une langue aryenne et touranienne est à peu près la même qu’entre une mosaïque bien ou mai faite : les mots aryens semblent formés d’une seule, pièce, les mots touraniens laissent voir les fentes et les sutures. ■
Il y a une raison qui suffit à expliquer comment les dialectes touraniens en sont restés à cette période secondaire ou d’agg]utination : il fallait de toute nécessité que le radical de chaque mot fît saillie, si l’on peut ainsi parler, et se dessinât en relief, qu’il- ne fût jamais ni obscurci ni absorbé, comme cela arrive dans la période des flexions.
Le français âge, par exemple, n’est plus qu’une terminaison, tout le corps du mot ayant* disparu. C’était en vieux français eage et edage, ce dernier étant, une altération du latin œtaticum, qui lui-même est dérivé de œtas, abréviation de œvilas : œvitas vient de œvum^et dans œvum, œ ■ .. " *
seul est le radical, le sanscritây dans ây-us, vie, où nous
' T '
trouvons Je germe qui a animé tous ces différents mots, et leur a donné leur signification. De œvum les Romains ont
HUITIÈME LEÇON. 353
tiré œviternus, contracté en œtemus, de sorte que âge et éternité découlent de la même source. Les langues toura-niennes ne peuvent posséder de pareils mots dans leurs glossaires. Pour la langue d’un peuple nomade, il est de nécessité absolue que les mots y restent intelligibles pour beaucoup d'individus , quelque rares que soient leurs relations mutuelles. La tradition, la société et la littérature peuvent seuls conserver des mots et des formes qu'un premier regard ne suffit pas à analyser ; de tels mots ne
' ' 4 "
pourraient naître que rarement dans les langues nomades, et dans tous les cas ils s’éteindraient avec chaque génération.
Le verbe aryen contient bien des formes où le pronom personnel ne paraît plus dune manière sensible ; et cependant la tradition, l’habitude et les lois conservent la vie de ces vieux débris, et font que nous n’aimons pas à les abandonner. Mais sur la scène toujours changeante d’une vie nomade, aucune monnaie.altérée ne peut jamais avoir cours» ni aucune légende effacée être accentée sur parole. Le métal doit être pur, et la légende lisible, pour que l’un puisse être pesé et l’autre sinon déchiffrée, du moins reconnue tout d’abord, comme l'authentique garantie de la pièce dont elle indique la valeur à tous les yeux. De là la faible proportion de formes irrégulières dans toutes les langues agglutinantes (1).
Un touranien aurait pu admettre le sanscrit : .
as-mi, a-si, as-ti, ’s-mas, ’s-tha, ’s-anti,
Je suis, tues, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont;
ou même le latin :
’s-um, e-s, es-t, ’su-mus, es-tis, ’sunt. ■
(1) L’abbé Mélina affirme qu’il ne se trouve aucune forme
. 23
354 LEÇONS SUR LA SCIENCE DU LANGAGE.
V
Dans ces formes, sauf peu d'exceptions, il est aussi facile de distinguer la racine et Taffixe que dans le verbe turc : : - ; . ■ ----- .
bakar, il regarde,
bakar-im, je regarde.
bakar-sin, tu regardes,
bakar-iz, • bakar-siniz, bakar-lar,
nous regardons, vous regardez, ils regardent.
Mais une conjugaison comme celle de l’hindoustani, un des dialectes aryens modernes,
hun, hai, bai, hain, ho, hain.
serait incompatible avec le génie des langues toura-niennes, parce qu’elle ne répondraitpas aux besoins dune
vie nomade. Les. dialectes touraniens, ou ne contiennent
■■ - * ^
aucune distinction de. désinences, comme le mantchou, dialecte tongous ; ou ils présentent un système complet et intelligible d’affixes, comme, par.exemple; la langue parlée de Nyertchinsk, qui appartient aussi à la branche tongous e. .
Mais une conjugaison dans laquelle, par suite de Taité-rarion phonétique, ï’affixe est le même pour la première personne du singulier et du pluriel et la troisième du pluriel, et où il n’y a aucune différence entre la seconde et la troisième personne du singulier, ni entre la première et la troisième personne du pluriel, conduirait nécessairement, dans un dialecte touranien, à l’adoption d’autres formes plus expressives. Il faudrait recourir à de nouveaux pronoms ou à quelque autre expédient, pour marquer la
irrégulière dans la-langue du Chili. (Du Ponceau, Mémoire, p. 90.) .
* HUITIÈME LEÇON. 355
o _ .
distinction des personnes. C’est ce qui fera encore mieux comprendre pourquoi les langues, touraniennes et même, toutes celles qui appartiennent à la période agglutinante, quoique moins exposées à l’altération phonétique que les langues aryennes et sémitiques, sont si sujettes aux changements produits par le renouvellement dialectal. Un, Touranien conserve pour ainsi dire la conscience de sa langue et de sa grammaire. L’idée, par exemple, qu’il rattache à un pluriel est celle d’un nom suivi d’une syllabe indicative de pluralité ; pour lui le passif est un verbe suivi d’une syllabe exprimant souffrir, manger ou aller (4).
Or ces idées déterminatives peuvent être énoncées de' diverses manières, , et bien que, dans une seule et même tribu et à une époque donnée, un certain nombre de ter -minaisons dussent rester stationnaires et être consacrées à l’expression, de quelques catégories grammaticales, telles que le pluriel, le passif ou le génitif, toutefois des hordes différentes devaient, en se séparant, se trouver libres de renouveler et de changer le procédé de la. composition grammaticale. Ainsi se produisaient d’incessantes varia-lions qui préparaient de grandes difficultés aux philologues, et qui semblaient devoir déjouer tous les efforts que tenterait la grammaire comparative pour prouver l’identité des terminaisons, même dans des dialectes aussi étroitement apparentés que le finnois et le hongrois, ou le tamoul et le telinga. .
Pourtant il ne faut pas supposer que les langues toura-
niènnes ou agglutinantes soient exposées à subir cons. w
tamment l’opération du renouvellement grammatical. Quand les tribus-nomades reçoivent une sorte d’organisation politique, leur langage, quoique touranien, peut se ' rapprocher du système de ces langues, qui, telles que ïe
p f
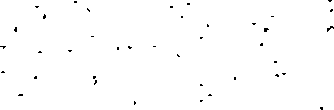
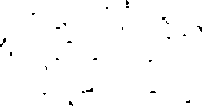
" 356 • ' ' LEÇONS SUR LA SCIENCE DU LANGAGE.
Û é (
sanscrit etThébreu, appartiennent aux nations où il y a des traditions et une vie politique ; c’est ce qui est arrivé pour les membres les . plus avancés de la famille toura-. nienne, le turc, le hongrois, le finnois, le tamoul, le le-linga, etc. .
• Beaucoup de leurs terminaisons grammaticales ont souffert de l’altération phonétique, mais elles n’ont pas été remplacées par de nouveaux mots plus expressifs. Dans le telinga la désinence du pluriel est lu, qui n’est probablement qu’une corruption de gai, désinence du pluriel en tamoul. Le seul trait caractéristique qui ne s’efface jamais dans la famille louranienne, c’est que la racine n’est jamais obscurcie. En outre, les syllabes déterminatives ou modificatives sont généralement placées à la fin des mots, et les voyelles ne sont pas aussi invariables pour chaque syllabe qu’en sanscrit ou en hébreu. Nous y trouvons, au contraire, ce qu’on appelle la loi d'harmonisation, d’après laquelle lés voyelles de chaque mot peuvent et doivent subir un changement qui les mette en harmonie avec le ton donné par la voyelle dominante. En turc, par exemple, les voyelles sont divisées en deux classes, les voyelles aiguës et les voyelles graves. Si un verbe contient une voyelle aiguë dans son radical, les voyelles des terminaisons sont toutes aiguës, tandis que les mêmes terminai-, sons, agglutinées à un radical contenant une voyelle grave, font passer leurs voyelles dans le ton grave. Ainsi nous avons sev-meh, aimer, et bak-mah, regarder, mek ou mak étant la désinence de l’infinitif. De même nous disons ev-ler, les maisons, et at-lar, les chevaux, 1er ou lar étant la désinence du pluriel.
Aucune langue aryenne ou sémitique n’a conservé une telle liberté pour modifier et échanger ses voyelles selon les lois de l’harmonie, 'tandis que nous retrouvons des traces de cette faculté chez les membres disséminés de la

. . HUITIÈME LEÇON. 357
. . . . . * . ■ , . ■ - '
famille touranienne, par exemple dans les idiomes hongrois, mongol, turc, dans le yâkut qui est parlé au nord de la Sibérie, dans le tuîu (4), et dans les dialectes des contrées qui touchent aux frontières orientales de l’Inde. . . •
Pour compléter cette étude, je tracerai en quelques mots le tableau de la famille touranienne, que je tirerai principalement de mon essai intitulé Survey of languciges., publié en 4 855 : '
►
CLASSE TONGOUSE.
La branche tongouse s’étend au nord depuis la Ghine jusqu’à la Sibérie, et à l’ouest jusqu’au 4 43e degré, où le fleuve Tougouska lui sert en partie de limite. Les tribus tongouses de la Sibérie sont sous la domination russe. D’autres tribus tongouses appartiennent à l’empire chinois, et sont connues sous le nom de Mantchoux quelles prirent âpres avoir conquis la Chine en 4 644, et fondé la ctynasti.e impériale aujourd’hui régnante. . . '
CLASSE MONGOLE.
Le berceau dès populations, qui parlent les dialectes mongols se trouve près du lac Baikal et dans les parties * orientales de la Sibérie, où nous les rencontrons dès le neuvième siècle après lésus-Christ. Elles se divisaient en trois classes : les Mongols proprements dits, les Burïales, et les Olotes ou Kalmouks. Gengis-khan (4227)
(4) « Eu tulu Vu final bref reste sans changement seulement à la fin des mots contenant des voyelles labiales (buàudu> a}rant laissé); il se change en il après toutes les autres voyelles (panàüdü^ ayant dit). » —. Le docteur Gundert.
S X 'X X X, X X X . 'V X N X v X X X 'X X . X X X_ XK X x X X X X 'X.
358 . LEÇONS SUR LA. SCIENCE DU LANGAGE. : . ; x
les réunit en une nation et fonda l’empire mongol qui
■ * -
comprenait, toutefois, non-seulement les Mongols, mais aussi des tribus tongouses et turques communément, appelées Tartares. .
Ce nom de Tartare ne tarda pas à devenir la terreur de l’Europe comme-.de'l’Asie, et il s’appliquait indifférent- ; ment à tous les guerriers nomades qui fondirent alors sur l’Europe. Primitivement il ne désignait que les races mongoles, mais, à cause de leur prépondérance politique en Asie après Gengis-Khan. on prit l’habitude de l’étendre à toutes les tribus qui se trouvaient sous leur domination. Dans les ouvrages de linguistique, tartare est pris dans deux significations différentes : suivant l’exemple des auteurs du moyen âge, il a été adopté, ainsique scythe en
' _ - . ?
grec, comme terme général comprenant toutes les langues parlées par les tribus nomades de l’Asie, c’est-à-dire dans le sens où j’emploie le mot touranien ; ou bien, il est devenu le nom de cet|_e classe de langues touraniennes où le turc occupe le premier rang : et tandis que le nom de tartare n’est jamais donné à la race- mongole, celle qui y à le plus de droit, c’est maintenant un usage presque universel-de l’appliquer à la branche turque, la troisième de la division Ouralo-Àltaïque ; et bien souvent les races appartenant à cette branche l’ont adopté elles-mêmes. Ces populations turques, ou, comme on les appelle plus ordinairement, tartares, étaient établies sur le rivage septentrional de la mer Caspienne et aux bords de la mer Noire, et étaient connues sous le nom de Koumanes, de Peche-negs et:de Bulgares quand elles furent subjugées par l’armée mongole du fils de Gengis-Khan,.qui fonda l’empire du Kaptchak, s’étendant depuis le Dniester jusqu’à la Yemba et. aux steppes des Kirghises. Pendant deux siècles, la Russie reconnut la suprématie de ces khans, connus sous le nom de khans de la Horde Dorée. Cet empire fut
HUITIEME LEÇON.
■ .
dissous vers la fin du quinzième siècle, et de ses ruines sortirent plusieurs royaumes plus petits, dont les plus importants furent ceux de la Crimée, de Kazan et d’Astrakhan. Les princes de ces royaumes se glorifient encore de descendre de Gengis-Eban, et avaient droit au nom de Mongols ou de Tartares. Mais leurs armées et leurs sujets-aussi, qui étaient d’extraction turque, recevaient le nom de leurs princes ; et leurs langues continuèrent à être appelées tartares, même après que les tribus turques qui les parlaient eurent passé sous l'empire des Russes, et quelles n’étaient plus gouvernées par des khans d’origine mongole ou tartare.. Il serait donc préférable d’appeler turc, au lieu de tartare, ce troisième rameau de la branche septentrionale de la famille touranienne, si un changement de dénomination n’avait généralement pour effet d’accroître la confusion à laquelle il était destiné à remédier. Il paraît que chez ces tribus de Kazan et d’Astrakhan que nous nommons Tartares, le souvenir de leur origine ne s’est point effacé. Quand on leur demande s’ils sont Tartares, ils répondent négativement, et ils appellent eux-mêmes leur langue iurlii ou turuk. lis regardent même le nom.de tartare comme un terme injurieux, synonyme de voleur, évidemment parce qu’ils n’ont pas oublié que leurs ancêtres avaient été vaincus et assujettis par des hordes mongoles, c’est-à-dire tartares. J’avance cés faits sur l’autorité de Klaproth, qui pendant son séjour en Russie s’est trouvé dans d’excellentes conditions pour étudier les langues parlées sur les confins de cet empire semi-asiatique.
Les conquêtes des Mongols, ou des descendants de Gengis-Khan, ne se sont pas bornées à ces populations turques. A l’est, ils ont conquis la Chine où ils fondèrent la dynastie mongole des Yuan, et à l’ouest, après avoir soumis les califes deBagdad elles sultans dTconium, ils se
rendirent maîtres de Moscou et dévastèrent la plus grande partie delà Russie. En 4240 ils envahirent la Pologne, en
4244 là Silésie. Là ils reculèrent devant les armées
réunies de l’Allemagne, de la Pologne et de la Silésie ; ils se retirèrent en Moravie, et, après avoir épuisé ce pays, occupèrent la Hongrie.
À ce moment, ils eurent à choisir un nouveau khan, ce qui ne pouvait se faire qu’à Karakorum, l’ancienne capitale de leurs États. Ils s’y rendirent donc pour élire le monarque dont la domination s’étendait alors depuis la Chine jusqu’à la Pologne, et de l’Inde à la Sibérie. Mais un si vaste empire ne pouvait être de longue durée, et, vers la fin du treizième siècle, il se décomposa en plusieurs États indépendants, tous régis par des princes mongols, mais n’obéissant plus au sceptre d’un seul khan des khans. Ainsi s’établirent de nouveaux royaumes en Chine, en Turkestan, en Sibérie, dans la Russie méridionale et en Perse. En 4360, la dynastie mongole fut chassée de Chine, et, au quinzième siècle, leur trône fut renversé en Russie. Dans l’Asie centrale, ils se rallièrent encore une fois en 4369 soüs le drapeau de Timour, qui lit reconnaître son autorité depuis Karakorum jusqu’en Perse et en Anatolie. Mais en 4468, cet empire s’écroula aussi, emporté par son propre poids et faute de mains puissantes, comme celle de Gengis-Khan et de Timour, pour le soutenir. Ce fut seulement dans le Jagalai. contrée qui s’étend du lac Aral à l’IIindoukoush, entre les fleuves Oxus et Iaxarte (Jihon et Sibon), et qu’avait autrefois, gouvernée Jagatai, fils de Gengis-Khan, que la dynastie mongole se maintint, et c’est de là que Baber, descendant de Timour, .partit pour conquérir l’Inde et y fonder une dynastie mongole qui a survécu jusqu’à notre.époque daüs les Grands Mogols dè Delhi. La plupart des peuples mongols sont maintenant soumis aux nations dont ils étaient
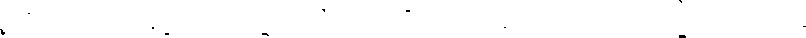
HUITIÈME LEÇON,' 361
' * 9 . .
La langue mongole, quoique parlée (mais non sans interruption) depuis la Chine jusqu’au Volga, n’a donné naissance qu’à peu de dialectes. Après le tongous, le mongol est la langue la plus pauvre de la famille toura-nienne, et le petit nombre de ses désinences grammaticales nous explique assez le fait que, comme langue, il est resté presque sans changements. Il y a cependant des différences à signaler entre les dialectes mongols que parlent les tribus de l’est, dè Loues! et du nord ; des indices d’une vie grammaticale qui s’éveille et qui commence ont été signalés dernièrement dans l’idiome parlé des Bu-riaies par .Castrén, le grand voyageur suédois, à qui nous devons de si précieux matériaux pour la philologie des langues touraniennes. Dans cet idiome, les différentes personnes du verbe sont marquées par des affixes, tandis que, selon les règles de la grammaire mongole, aucun autre dialecte n’établit de distinction entre amo. amas,
- # i
amaC -
Les Mongols qui habitent en -Europe ont dressé leurs tentes sur les deux rives du Volga, et sur la côte de la mer Caspienne près d’Astrakhan. On en trouve une autre colonie au sud-est de Sembirsk. Ils appartiennent à la branche occidentale, et sont des Olotes ou Ealmouks qui, après avoir quitté leurs demeures sur les bords du Roko-nour, sont entrés en Europe en 4662. Ils venaient de. la tribu des Dürbets et de celles des Torgodes, mais la plupart des Torgodes retournèrent en 4770, et leurs descendants sont maintenant dispersés dans les steppes des
t w
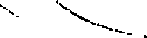
CLASSE TURQUE.
Un tout autre intérêt s’attache aux langues qui appartiennent à la troisième branche de la famille touranienne, au premier rang desquelles nous trouvons le turc ou l’os-manli de Constantinople. Les habitants turcs de la Turquie d’Europe sont fort peu nombreux: on en compte généralement deux millions ; mais Shafarik n’évalue qu’à sept cent mille le nombre des Turcs véritables, maîtres d’une population d’environ quinze millions d’hommes. La région
* T
sur laquelle s’étendent, les dialectes turcs dont l’osmanli fait partie est une des plus vastes du monde ; elle s’étend depuis le Léna et la mer Glaciale jusqu’à l’Adriatique.
Le plus ancien nom par lequel les peuplades turques de l’Asie centrale furent connues des Chinois était celui de Hiung-nu. Ces Hiung-nu fondèrent, en 206 avant Jésus-Christ, un empire qui comprenait une grande partie de l’Asie à l’ouest de la Chine. Engagés dans des guerres fréquentes contre les Chinois, ils furent enfin défaits vers le milieu du premier siècle de notre ère. Us se. divisèrent alors en deux États, celui du nord et celui du sud ; et, quand les Hiung-nu du sud furent devenus les sujets de la Chine, ils attaquèrent leurs frères du nord, de concert avec les Chinois, en les chassant des demeures qu’ils occupaient entre les fleuves Amour et Selenga, et les monts Allais; en les poussant vers l’ouest, ils donnèrent probablement le branle à ce grand mouvement des peuples qui précipita sur l’Europe les invasions barbares. Au commencement du treizième siècle, les tribus mongoles et tongouses qui setaieni emparées du pays des ÏÏiung-nu du nord étaient devenues assez puissantes pour attaquer les Hiung-nu du sud et les expulser de leur territoire ;
ce qui détermina une nouvelle-migration de peuplades asiatiques vers l’ouest.
Un autre nom par lequel les Chinois désignent ces tribus Hiung-nu ou turques est celui de Tu-kiu, que l’on supposé netre autre, chose qu’une transcription du nom de Turc. Quoique la peuplade qui portait ce nom ne fût, dans le principe, que peu nombreuse, elle commença, au sixième siècle, à se répandre depuis les monts .Allais jusqu’à la mer Caspienne, et il est probable que c’est vers elle que* l’empereur Justinien envoya Semarchos comme ambassadeur en l’année 569. L’empire. des Tu-kiu fut détruit au huitième siècle parles 'Hui-he (chinois Kao-che). Cette tribu, également d’origine turque, se maintint pendant environ un siècle, quand elle fut vaincue par les Chinois et repoussée des frontières septentrionales de la Chine. Une.partie des eHui-'he s’établit dans le Tangut, et,’les Mongols leur ayant fait subir une nouvelle défaite en 4527, les débris de la tribu se retirèrent vers l’ouest et se joignirent; aux Guigours qui étaient campés près dès villes
de Turfan, dekashgar, de Hàmil etd’Àksou.
r ■ ■ .
Ces faits, recueillis principalement dans les récits des
P " " * 1 "s
historiens chinois, nous montrent, dès les temps les.plus reculés, le mouvement qui emporte vers l’ouest les nations turques. En 568, des tribus. turques occupèrent la contrée entre le Tolga et la mer d’Àzof, et depuis lors de nouvelles migrations sont venues souvent renforcer cette
s
avant-garde. ■ . . .
La partie septentrionale de la Perse, à l’ouest delà mer Caspienne, l’Arménie, le sud de la Géorgie, le Schiryan et le Dageslan, servent d’asile à une population turque, connue .sous la dénomination générale de Turkmans ou Kisil-bash (Qazal-bâshî, c’est-à-dire Bonnets-rouges). Ce sont des brigands nomades, et leur arrivée dans ces régions date du onzième et du douzième siècle.
À l’est de la mer Caspienne, les tribus turkmanes sont sous les ordres des üsbek-khans de Khiva, de Ferganah et de Boukhara. Ils s’appellent, toutefois, les hôtes et non les sujets de ces khans. Plus à l’est, des Turkmans sont compris dans l’empire chinois, et au sud-ouest d’autres groupes de même origine sont répandus jusque dans le Ehorassan et d’autres provinces de Perse. .
t -
Les üsbeks, descendants des 'Hui-‘lie et des Ouigours,
c ^
et établis originairement dans le voisinage des villes de Hoten, de Kashgar, de Turfan et deBamil, traversèrent. l’Iaxarte au seizième siècle, et, après plusieurs campagnes heureuses, s’emparèrent des provinces de Balkh, de Kharism (Sliiva), de Boukhara et de Ferganah. Dans cette dernière contrée et dans celle de Balkh, ils se sont occupés d’agriculture ; mais ils mènent généralement une vie nomade, et trop martiale pour qu’on puisse l’appeler pastorale.
Une autre peuplade turque est celle des Rogaïs, à l’ouest
de la mer Caspienne, et aussi au nord de la mer Moire.
+ + ^
Âu commencement du dix-septième, siècle, ils habitaient
au nord-est de la mer Caspienne, et les steppes sur la rive _ «
gauche de l’Irtish portaient leur nom. Pressés par . les kalmouks, tribu mongole, les Nogaïs avancèrent vers l’ouest jusqu’à Astrakhan. Delà, Pierre Ier les transporta au nord du Caucase, où ils font encore paître leurs troupeaux sur les bords du Eouban et du Kouma. Une de ces hordes, celle des Kundours, est restée, sous la domination des Kalmouks, sur les rives du Yolga. . ’ .
Les Bazianes sont une autre peuplade d’origine turque, établie aujourd’hui dans le Caucase, près des sources du Eouban; mais, avant le quinzième siècle, ils habitaient la ville de Mhjari, sur lé Kouma.
Une troisième tribu turque du Caucase est celle des Kumoucks, sur le Sunja, l’Âktchaï et le Koisou; ils sont
HUITIÈME LEÇON. 365
O
maintenant sujets de la Russie, bien que gouvernés par des princes de leur race.
La partie méridionale des monts AltaïS est habitée depuis longtemps par les Bashkirs, race très-mélangée de sang mongol, féroce et ignorante, obéissant à la Russie, et professant la religion de Mahomet. Leur territoire est divisé par quatre roules, appelées les routes de Sibérie, de Kazan, de Nogai, et d'Osa, petite ville bâtie sur le Rama. Au milieu des Bashkirs, et dans les villages près d’Ufa, est maintenant établie une tribu turque, celle des Mescheraks, qui habitaient autrefois près du Yolga. ,
On appelle Kara-Iîalpaks (bonnets noirs) les tribus dans le voisinage du lac Aral, dont les unes sont soumises à la Russie, et les autres aux khans de Ehiva.
Les Turcs de Sibérie, communément, appelés Tartares, sont en partie les premiers habitants du pays, qui passèrent les monts Ourals et fondèrent le khanat de Sibir, et en partie des colons venus plus tard. Leurs principales villes sontTobolsk, Yeniseisk, et Tornsk. Les Uran’hat sur le Chulym, et les Barabas dans les steppes entre lTrtish et l’Ob, sont des populations tout à fait distinctes.
Les dialectes de ces Turcs de Sibérie sont fort mélangés de mots étrangers puisés aux sources mongole, samoyède • et russe; mais* pour tout ce qui tient au fond primordial de la langue, on trouve dans tous une ressemblance frappante.
Au nord-est de l’Asie, sur les deux rives du Léna, les Yakuts forment le premier anneau de la chaîne des peuplades qui parlent les langues turques. Leur population
mâle s’est élevée récemment à 100,000 âmes, quoique,
^ t
en 4795, elle ne montât guère qu a 50,066. Les Russes les connurent pour la première fois en 462Q-. Ils s’appellent Sakha, et sont généralement païens ; pourtant le christianisme commence à faire des progrès chez eux. Selon leurs
366 LEÇONS SUR LA SCIENCE DU LANGAGE.
X X v ^ ^ '' V ’s. ’v, V X ‘'v ^ ■'^ v„
traditions, leurs ancêtres cohabitèrent longtemps avec les tribus mongoles, et leur langage porte encore les traces de ce contact. Attaqués par leurs voisins, ils. construisirent des radeaux, et, ayant descendu le Léna, ils se fixèrent ■ dans le voisinage de ce qui est maintenant leur ville de Yakutzk. Leur berceau semble avoir été au nord- ouest du lac Baikal. Leur langue a conservé le type turc plus complètement qu’aucun autre dialecte turco-tartare. Détaché de bonne heure de la tige commune, et éloigné des influences auxquelles les autres dialectes furent exposés,, pendant la guerre ou en temps de paix, le yacutien a conservé tant de traits primitifs de la grammaire tartare, que même à présent, il peut servir de clef pour les formes grammaticales de l’osmanli et d’autres dialectes turcs plus cultivés.
La Sibérie méridionale est la mère-patrie des Kirghises. l’une des plus nombreuses peuplades d’origine turcô-tar-tare. Ils habitaient primitivement entre l’Ob et le Yenisei, où des tribus mongoles vinrent s’établir parmi eux. Au commencement du dix-septième siècle, les Russes rencontrèrent les Kirghises orientaux dont les demeures
étaient alors sur les bords du Yenisei. En 4606, ils étaient
*
devenus tributaires de’la Russie, et, après plusieurs guerres contre deux peuplades voisines, ils furent chassés de plus en plus vers le sud-ouest, jusqu’à ce qu’enfin ils quittèrent entièrement la Sibérie au commencement du dix-huitième siècle. Ils habitent maintenant à Burtit, dans le Turkestan de Chine, avec les Kirghises de la « Grande-Horde, » près de la ville de Kashgar, et au nord jusqu’à l’Irtish.
Une autre tribu est celle des Kirghises occidentaux, ou Kirghises-Kasak, qui sont en partie indépendants, en partie tributaires de la Russie et de la Chine. • •
Les trois hordes des Kirghises, entre la. mer Caspienne
et le lac Ténghiz, à l’est’, la Petite-Horde est établie à l’ouest, entre les fleures le Yemba et l’Oural, et laGrande-Horde, à l’est; tandis que la plus puissante occupe le milieu entre le Sarasou et le Yemba, et est appelée la Horde centrale. Depuis 481.9, la Grande-Horde est sujette de la Russie : d’autres tribus des Kirghises, bien que soumises de nom à la Russie, sont, en réalité, ses plus dangereux ennemis. .
Les Turcs d’Àsie-Miiieure et de Syrie sont venus du Khorassan et de l’est de la Perse, et sont des Turkmans, ou des restes des Seljouks, qui avaient été les maîtres de la Perse au moyen âge. Ce fut à cette époque que pénétrèrent dans le turc toutes ces locutions, tous ces mots persans qui y ont aujourd’hui droit de cité. Les Osmanlis, que nous avons l’habitude d’appeler les Turcs pâr excellence, et qui composent la classe dominante de l’empire, de Turquie, sont issus de la même source. Ils sont maintenant répandus dans tout l’empire turc en Europe, en Asie, et en Afrique. Ce sont les propriétaires fonciers, les nobles et les administrateurs de la Turquie; et leur langue, fos-
manli, est parlée par les hautes classes, par toutes les
’ ' ’ « 1 < _ ,
personnes qui ont reçu de l'instruction, et par les fonctionnaires publics en Syrie, en Egypte, à Tunis et à Tri-
T + _ t # ' ■
poli. Dans les provinces méridionales de la Russie d'Asie,
. sur les bords de la mer Caspienne et dans tout le Türkes-tan, l’osmànli est la langue du peuple : on l’entend parler ’ même à la cour de Téhéran, et les personnages officiels, en. Perse, le comprennent.
L’agrandissement de cette puissante tribu d’Osman, et l’extension de ce dialecte qui est maintenant appelé le turc, sont des faits historiques bien connus. Il n’est pas besoin de chercher des témoignages dans les annales delà Chine, ni d’essayer de découvrir, des analogies entre des noms qu’un auteur grec ou arabe a pu entendre par hasard et
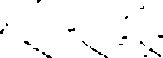
368
■v
LEÇONS SUR LA. SCIENCE DU LANGAGE.
X.*J ' ^ v ^ ■- v ..
nous a transmis, et ceux que plusieurs tribus ont conservés jusqu’à ce jour : les ancêtres des Turcs Osmanlis sont des hommes-aussi connus des. historiens européens que Charlemagne et Alfred. Ce fut en l’année 1224- que Soliman-Shah et la tribu dont il était le chef, serrés de près par les Mongols, quittèrent le Ehcrassan et se répandirent à l’ouest, dans la Syrie, l’Arménie, et l’Asie Mineure. Le fils de Soliman, Ertoghrul, entra au service d’Àlaëddin, sultan seljoukidede Konieh, l’ancien Iconium, et, après plusieurs expéditions heureuses contre les Grecs et les Mongols, obtint le don d’une partie de la Phrygie. Là, il fonda le petit Etat qui devait devenir plus tard la base de l’empire ottoman. Pendant les dernières années du treizième siècle, les sultans dTconium perdirent leur puissance, et leurs anciens vassaux devinrent des souverains indépendants. Osman,'après avoir pris sa part des dépouilles de l’Asie, s’avança en Bithvnie par les défilés de l’Olympe, et vain-quittes armées des empereurs de Byzance. Dorénavant, Qsmanli (fils ou sujet d’Osman), devint le nom national de son peuple. Son fils Orkhan, dont la capitale était Prusa, aujourd’hui Brousse, après s’être emparé de Kicomédie en 43£7 et de Ricée en 4330, menaça PKellespont. Il prit le titre de Padishah, et sa cour fut appelée la « Solime-Porte. » Son fils Soliman traversa l’Hellespont, et, les villes de Gallipoli et de Sestos étant tombées entre ses -mains, il devint maître des Dardanelles. Murad Ier prit
* a
Àndrinopîe, en 4362, et en fit sa capitale: il marcha ensuite à la conquête de la Macédoine, et, après une lutte sanglante, renversa, en 4389, à la bataille de Kossovapolye, les forces réunies des races slaves de la rive droite du Danube, les Bulgares, les Serbes et les Croates. 11 périt lui-même dans le combat, mais son successeur, Baj'ezid, connu en Occident sous le nom de Bajazet, continua sa marche, envahit la Thessalie, traversa les Thermopyles et ;
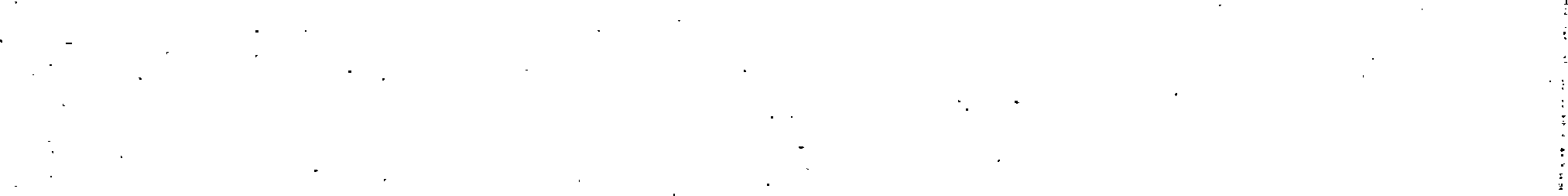
HUITIÈME LEÇON. 369
' a .
dévasta le Péloponnèse. L’empereur d’Allemagne, Sigis-mond, qui alla à sa rencontre avec une armée composée de soldais français, allemands et slaves, fut défait par Ba-jazet sur le Danube, à la bataille de Nicopolis en 1399. Bajazet se rendit maître de la Bosnie, et aurait pris Constantinople, si les mêmes Mongols, devant lesquels les premières tribus turques avaient été obligées de fuir, en 4244, et de se réfugier en ‘Perse, n’avaient menacé leurs nouvelles.possessions. Timour avait saisi les rênes tombées des mains de Gengis-Khan; Bajazet fut forcé de lui livrer combat, et perdit la bataille d’Angora (Àncyre), en Galatie, en l’année 1402.
L’Europe eut maintenant un peu de répit, mais non pas pour longtemps ; Timour mourut, et après lui s’écroula son empire, tandis que l’armée ottomane se ralliait de nouveau sous Mahomet Ier, en 1413, et retrouvait son ancienne puissance, sous Murad II (1421). Victorieux en Asie, Murad renvoya ses armées dans le Danube, et, après une vigoureuse résistance de la part des Hongrois et des Slaves, commandés par Hunyade, il gagna enfin deux batailles décisives, celle de Varna en 1444, et celle de JLossova, en 1448. Constantinople ne pouvait résister plus longtemps . En vain le pape s’efforça-t-il d’entraîner la chevalerie de l’Europe occidentale à une croisade contre les Turcs : Mahomet II succéda à Murad en 1451, eh le 26 mai 1453, après une vaillante défense, Constantinople tomba en son pouvoir, et devint la capitale de l’empire de Turquie.
Quant à l’idiome que parlent les Osmanlis, nous pouvons dire que c’est un véritable plaisir de lire une grammaire turque, quand même on n’a pas le moindre désir d’apprendre cette langue pour la parler ou l’écrire. La manière ingénieuse, dont y sont produites les formes grammaticales, la régularité qui règne dans tout le système de déclinaison et de conjugaison, la transparence et la sim-
U
plicité de la construction toute entière, ne peuvent manquer de frapper ceux qui ont le sentiment de cette merveilleuse puissance de Tesprit humain, qui s’est révélée dans
le langage. Etant donné un nombre si petit de racines
*
attributives et démonstratives qu’il suffirait à peine pour exprimer les besoins les plus ordinaires de l’homme, produire un instrument qui rende les nuances les plus délicates du sentiment et de la pensée; étant donnés un vague infinitif et un sévère impératif, en tirer des modes comme l’optatif et le subjonctif, et des temps comme l’aoriste et le futur antérieur: étant données des articulations incohérentes, les arranger en un système où tout soit uniforme et régulier, bien ordonné et harmonieux : telle est l’œuvre de l’esprit humain que nous voyons accomplie dans le langage. Mais, dans la plupart des langues, il ne reste plus de trace de ce procédé primordial. Elles s’élèvent devanl nous comme des roches compactes, et la loupe du philologue peut seule découvrir les, débris de vie organique dont elles sont formées. Dans la grammaire des langues turques, au contraire, nous avons sous les yeux une langue d’uûe structure parfaitement transparente, et une grammaire dont.nous pouvons étudier les opérations intérieures comme nous pouvons observer la formation dés cellules dans une ruche de cristal. Un orientaliste éminent a dit : « On pourrait se figurer que le turc est le résultat des délibérations de quelque illustre académie; » mais aucune société savante n’aurait pu créer ce qu’a produit l’esprit de l’homme, abandonné à lui-méme dans les steppes de la Tartarie, et guidé seulement par des lois inhérentes à sa nature ou par une puissance instinctive aussi merveilleuse' qu’aucune autre force de la nature. ‘
Examinons quelques-unes de ces formes. « Aimer, » dans le sens le plus général du mot, ou la racine signifiant « amour » est en turc sev. Cette forme ne signifie pas en-
■ HUITIÈME LEÇON. 37'1
- # & ■
core aimer, qui ■ se" dit semnek, ni amour, qui se dit sevgu ou sévi; elle n’exprime que l’idée générale et abstraite d’aimer. À cette racine, comme nous l’avons déjà remarqué, on ne peut jamais toucher. Quelque syllabe qu’on y ajoute pour en modifier le sens, la racine elle-même doit, toujours ressortir comme une perle enchâssée dans des diamants. Elle ne peut jamais être changée, ni brisée, ni assimilée, ni modifiée comme cela arrive pour l’anglais J take, I look, ou le français je prends, je pris, et autres
formes semblables. Avec cette seule restriction, nous
■ " ■
sommes libres d’en faire absolument tout ce que nous voulons. Supposons que nous n’eussions rien de semblable à notre conjugaison, et qu’il nous fallût exprimer, pour la première fois, des idées comme j’aime, tu aimes, il aime, etc. Il nous semblerait tout naturel de former un adjectif ou un participe, avec le sens de aimant, et d’y joindre les différents pronoms de la manière suivante : je aimant, tu, aimant, etc. Eh bien, c’est précisément ce que les Turcs ont fait. Il est inutile de nous demander, nour le moment, comment ils produisent ce que nous appelons un participe : c’était, néanmoins, loin d’être aussi facile que nous nous l’imaginons. En turc en a formé un participe à l’aide de er : sev fi- e?1 signifierait donc am + ant ou aim -j- anl. Tu, en turc, est sen3 et comme toutes les syllabes modificatives
sont placées après la racine, nous avons sev-er-sen,. tu
- * ■ ■
aimes. Vous, en turc, se dit sis; de là sev-er-siz, vous aimez. Dans ce cas, les terminaisons du verbe ne sont autres que les personnes eux-mêmes : à d’autres personnes, la conformité est moins parfaite, parce que les terminaisons ont été quelquefois modifiées, ou qu’on les a laissées entièrement tomber comme inutiles, ainsi que cela a eu lieu à la troisième personne sever. Toutefois un rapprochement avec d’autres langues congénères, dans lesquelles les terminaisons ont conservé une forme plus primitive.
nous permet de dire que dans le verbe lûrc originel, toutes les personnes du présent ont été formées à l’aide de pronoms agglutinés à ce participe sever. Au lieu de-: j’aime, tu aimes, il aime, le grammairien turc dit: aimant-je, aimant-tu, aimant. . .
Mais ces désinences personnelles ne sont pas les mêmes à l’imparfait et au présent. .
Présent.
sever-im, j’aime
seyer-sen
sever
seyer-iz
sever-siz
sever-ler
Imparfait.
sever7üi-m, j’aimais sever-di-n sever-di sever-di-k (miz; sever-di-ni z sever-di-1er.
Il n’est pas besoin de rechercher encore l’origine de .di, ajouté pour former l’imparfait : mais il faut observer qu’à la première personne du pluriel de l’imparfait une variante se présente dans d’autres dialectes tarlares où l’on trouve mis au lieu de k. Or, en examinant ces terminaisons m, n, i, mis, niz et 1er, nous voyons qu’elles sont, identiques avec les pronoms possessifs usités après les subtantifs. Gomme l’Italien dit fraiel-mo, mon frère, et l’Hébreu El-i, Dieu (de) je, c’est-à-dire mon Dieu, les langues tartares ont composé les phrases « ma maison,' ta maison, sa maison, » en agglutinant des pronoms possessifs aux substantifs. Un Turc dit :
|
bâbâ, |
père |
bâbâ-m, |
mon père |
|
aghâ, |
seigneur |
aghâ-n, |
ton seigneur |
|
eï, |
main |
el-i, |
sa main |
|
oghtou, |
fils |
oghlou-muz, notre üls | |
|
aoâ, |
mère - |
anâ-niz, |
votre mère |
|
kilàb. |
livre |
kitâb-leri, |
leiir livre. |
- D’où nous pouvons conclure qu’à l’imparfait, ces désinences pronominales étaient prises originairement dans un sens. possessif, et par conséquent que ce qui resté quand on a retranché les désinences personnelles, se~ ver-di, n’a jamais été, un adjectif ni un participe, mais a dû être,' dans le principe, un substantif susceptible d’avoir pour terminaisons les pronoms possessifs : ce qui revient à dire que l’idée exprimée originairement par l’imparfait n’a pas pu être « aimant-je, » mais << amour de moi. » '
Mais comment cette expression pouvail-elle donner l’idée d’un temps passé mis en contraste avec un présent ? Portons les yeux sur notre propre langue, ou, si nous voulons exprimer le passé, nous disons « j’ai aimé. » Ce « j’ai » signifiait primitivement je possède* et en latin « amicus quem amaium habeo » voulait dire, en réalité, un ami que je tiens pour cher, et non pas encore que j’ai aimé. Avec 1 e tem p s, cep en d a n t, des phrases comme « j’ai dit, j’ai aimé, » prirent, lé sens du parfait et du temps passé, et cela assez naturellement, puisque cè que je tiens, ou que j'ai fait, est réellement fait; fait comme nous disons, et passé. Au lieu d’un verbe auxiliaire exprimant la possession, la langue turque a recours à Un pronom possessif pour atteindre le même but. « Pa)?ement appartenant à moi » équivaut à « j’ai payé; » dans les deux cas, une phrase qui marquait originairement la possession en . est venue à exprimer un rapport de temps, et elle est devenue le parfait ou passé du verbe. Bien entendu, nous faisons ici l'anatomie de la grammaire, et assurément, un Turc, en disant severdim, n’a pas plus conscience de la force littérale de ce mot-« amour appartenant à moi, » que de la circulation de son sang. . .. — :
. La partie la plus ingénieuse du turc est, sans contredit, le verbe. Comme le verbe grec et sanscrit, il déploie une

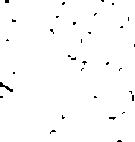
J ,

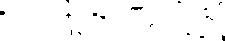
/
374 LEÇONS SUR LÀ SCIENCE DU LÀNGÀGE.
V, X N. X, X, N, x X, X »\, X N, X, 'x X x, x x. x XH x ’X 'X X, X, X. X, X -X x^
variété de modes et de temps, qui suffit pour reproduire les plus légères nuances de doute, de conjecture, d’es-- pérance' et de supposition.. Dans, toutes ces formes, la . racine reste immuable, et.se fait* entendre, comme la tonique, dans toutes les diverses modulations produites par les changements de personne, de nombre, de mode et de temps. Mais il y a une particularité du verbe turc, à laquelle nous ne pouvons rien trouver d’analogue dans aucune des langues aryennes, c’est la faculté de produire de nouveaux thèmes vèrb'aux par la simple addition de certaines lettres, qui ajoutent au verbe une idée de négation ou de causalité, ou en font un verbe réfléchi ou réci
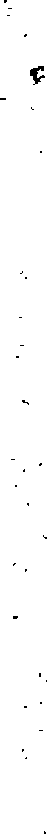
proque.
Sev-rnek, par exemple, en tant que racine simple, signifie- aimer. En y introduisant in, nous obtenons un verbe réfléchi, sev-in-mek3 s’aimer soi-même, ou plutôt se réjouir, être heureux, qui peut à son tour être conjugué à tous' les modes et à tous les temps, sevin étant parfaitement l’équivalent d’une nouvelle racine. À l’aide de ish, nous formons un verbe réciproque, sev-ish-mek, s’aimer l’un l’autre.
La syllabe dir ajoutera à chacune de ces trois formes
l’idée dé causalité. Ainsi :
î. Sev-mek, aimer, devient IV. Sev-dir-mek, faire aimer.
II. Sev-in-mek. se réjouir , devient Y. Sev-in-dir-mek, faire se réjouir.
III. Seu-isk-mek, s’aimer l’un l'autre, devient VI. Sev-ish-dir-mek, : faire s’aimer l’un Vautre. .
La syllabe il pourra donner la signification passive à chacune de ces six formes. Ainsi :
I. Sev-mek, aimer, devient YII. Sev-il-mek, être aimé.

IL Sev-in-mek, se réjouir, devient VIII. Sev-in-ü-mek, être . réjoui. . '
III. Sev-ish-mek, s’aimer l’un Paotre, devient IX. Sev-ish-ü-mek - (intraduisible).
IV. Sev-dir-mek) faire aimer, devient X. Sev-dir-il-mek, être amené
à aimer.
V. Sev-in-dir-meh, faire se réjouir, devient XI. Sev-in-dir-il-mek,
être amené à se réjouir.. .
VI. Sev-ish-dir-mek, les faire s’aimer l’un l’autre, devient XIÎ.
Sev-isli-dîr-il-mekêtre amené à s’aimer l’un l’autre.
Mais cette liste est bien loin de présenter toutes les modifications des verbes dont dispose le grammairien
turc.('!). On peut ajouter l’idée de négation à chacune de
’ 1 ■ . *■ .
ces douze racines secondaires ou tertiaires, par la simple insertion de me. Ainsi sev-mek, aimer, devientsev-me-mek, ne pas aimer. Et s’il faut exprimer l’impossibilité d’aimer, le turc a un nouveau verbe à sa disposition pour exprimer cette pensée. Ainsi, tandis que sev-me-mek nie
seulement le fait d’aimer, sev-he-me-mek en nie là possi-
. - " * * 1 - *
bilité, et signifie ne pas pouvoir aimer. Au moyen de ces deux syllabes modificatives, le nombre des racines dérivées s’élève tout de suite à trente-six. Ainsi :
I. Sev-mek,aimer, devient XII Sev-me-mek, ne pas aimer.
IL Sev-in-mek, se réjouir, devient XIV. Sev-in-mc-rnek, ne pas se
réjouir.
(1) Le professeur Polt, dans la seconde édition de ses Etymologis die Forschungcn, II, p. I l8, renvoie à des formations, verbales analogues dans l’arabe, dans la langue des Gallas, etc. Des formes analogues, suivant le docteur Gunderb existent aussi dans le tulin mais elles n’ont pas été analysées encore avec autant de succès que dans le turc. C’est ainsi que dans le tulu, malpuxe veut dire « je fais, » malpêve, « je fais habituellement p malpûrüwe, <> je fais tout d’un coup, g malpâoe, « je fais faire, » malpawâye} « je fais ne pas faire, » etc. .
/
W S

: *

376 * LEÇONS SUR LA SCIENCE DU LANGAGE.
' ^ -T
-S
X -X. X ’k -X v X -X -' X X X X X ■-. -,
III. Sev-ish-mek, s’aimer l’un l’autre, devient XV.. Seu-ish-me-mek,
ne pas s’aimer l’un l’autre. .
IV. Seu-dir-mek, faire aimer, devient XVI Sev-dir-me-mek, ne pas ’ faire aimer.
V. Sev-in-dir-mck, faire se réjouir, devient XVII. Sev-in-dir-me-mek, né pas faire se réjouir.
VI. Sev-ihs-dir-meli, les faire s’aimer l’un l’autre, devient XVIII.
Sev-ish-dir-mc-mek, ne pas les faire s’aimer l’un l’autre.
VII. Sev-ü-mek, être aimé, devient XIX. Seu-ü-me-mek, ne pas être
aimé.
VIII. Sev-in-ii-mek, qui mérite qu’on s’en réjouisse, devient XX.-
i ■
Sev-in-ilïmek, qui né mériLe pas qu’on s’en réjouisse.
IX. Sev-ish-il-melu si celte forme était usitée, deviendrait XXI. Scv-ish-il-mc-mek. Ces deux formes sont intraduisibles.
X. Sev-dir-il-mek, être amené à aimer, devient XXII. Sev-dir-me-
mek, ne pas être amené à aimer.
XI. Sev-in-dir-ü-mek, être amené à se réjouir, devient XXIll. Sev-
in-dir-il-me-mck, ne pas être amené à se réjouir.
XII. Sev-ish-dir-il-mek, être amené à s’aimer l’un l’autre, devient
XXIV. Sev-ish-dir-il-me-mek, ne pas être amené à s’aimer l’un l’autre. -
Plusieurs de.ces formes sont naturellement peu usitées, et, avec bien, des verbes, ces racines dérivées, tout-en étant possibles grammaticalement, seraient .logiquement-impossibles. Même un verbe comme aimer, le plus flexible, peut-être, de tous, ne se prête pas à quelques-unes des modifications qu’un grammairien turc aime à y opérer. Il est clair, toutefois, que partout où Ton peut formuler une négation, on peut y ajouter encore l’idée de l’impossibilité, de sorte qu’en substituant he-me k me, nous ferions monter le nombre de racines • dérivées à . trente-six, dont la dernière, sev-ish-dir-il-he-me~mek, serait parfaitement intelligible, et pourrait s’employer si, en parlant- par exemple du sultan et du czar, nous voulions
dire qu’il est impossible qu’ils soient amenés à s’aimer l’un l’autre. .
CLASSE 'FINNOISE ■
On suppose généralement que le berceau despeuplades finnoises était dans les monts Ourals ; de là est venue pour leurs langues la dénomination d’ouraliennes. De ce centre, ils se sont répandus à l’est et à l’ouest, et, dans les temps anciens, au sud, jusqu’à la mer Noire, où les-tribus finnoises, mongoles etturques furent probablement connues des Grecs sous le nom commode de Scythes, qui les comprenait toutes. Comme nous n’avons aucun monument écrit de ces nations nomades, il est impossible de dire, même quand les écrivains grecs nous ont con-■ servé leurs noms barbares, à quelle branche de l’immense famille touranienne elles appartenaient. Leurs mœurs étaient probablement les mêmes avant l’ère chrétienne et au moyen âge qu’aujourd’hui. ÏJne tribu prend possession d’un territoire, y reste pendant plusieurs générations peut-être, et donne son nom - aux prairies où elle garde ses troupeaux et aux rivières où ses chevaux s’abreuvent. Si le pays est fertile, il altire les yeux d’autres tribus ; les guerres commencent, et quand la résistance est vaine, des populations entières quittent les pâturages de leurs pères pour mener, quelquefois pendant plusieurs générations,, la vie errante, qu’elles préfèrent à-la vie sédentaire ; et, après un certain temps, nous pouvons retrouver leurs noms à des centaines de lieues plus loin.
L _ «
Ou bien encore, deux tribus peuvent continuer à guerroyer pendant des années, jusqu’à ce que, leurs forces étant diminuées, elles se voient obligées de faire cause commune contre quelque nouvel ennemi. -
Pendant ces luttes prolongées, elles perdent autant de mots que d’hommes tués sur les champs de bataille. Les uns, si l’on nous permet celte-image, passent à l’ennemi, d’autres sont faits prisonniers, et sont rendus en temps de paix. El puis, il y a des pourparlers et des défis, et enfin se forme un idiome qu’on peut, avec une justesse parfaite, appeler la langue du camp ('urdu-zeban, langue du camp, est le vrai nom de rhindoustani qui prit naissance dans les armées des empereurs mongols) ; mais il est difficile pour le philologue d’y ranger les vivants et de . compter les morts, à moins que quelques parties saillantes de la grammaire ne soient sorties intactes de la mêlée. Nous avons vu que d’innombrables peuplades peuvent parfois se lever tout à coup à l’appel d’un Gengis-Khan ou d’un Timour, comme les flots de l’Océan grossissent et se soulèvent à la voix de l’orage. Une de ces vagues, roulant depuis Karakorum jusqu’à Liegnitz. peut emporter tous les parcs et les bornes établis par les siècles ; et quand l’orage aura passé, il restera, comme après une inondation, une croûte légère dérobant à la vue toute une couche de peuples et de langues.. '
La philologie nous montre la tige finnoise se partageant
en quatre rameaux : .........
Le tchoude,
Le bulgare,
Le permien,
L’ougrien. .
Le tchoude comprend les dialectes finnois des côtes de la Baltique. Ce nom vient des Tchoudes, ainsi que les Russes appelaient originairement les peuplades finnoises du nord-ouest de la Russie : plus lard, il prit un sens plus général, et devint presque synonyme de Scythe, pour désigner toutes les tribus du nord et du centre de l’Asie. Les Finlandais proprement dits, ou, comme ils s’appel-
lent, Suomalamen, c’est-à-dire habitants des marais, sont établis dans les provinces de la Finlande (autrefois appartenant à la Suède, mais annexées à la Russie depuis 1809), et dans des parties des gouvernements d’Àrchangel et d’Olonetz.Un dénombrement récent nous donne 4,521,515 âmes comme chiffre de leur population. Les Finlandais sont les plus avancés de toute leur famille, et, à l’excep-lion des Magyares, sont la seule race finnoise qui puisse prétendre à un rang parmi les nations civilisées et civilisatrices du monde. Leur littérature et surtout leur poésie populaire témoignent d’un haut degré de développement intellectuel à une époque que nous pouvons appeler mythique, et dans des régions plus favorables à l’épanouissement des sentiments poétiques que leur demeure
* - -p '
actuelle, dernier refuge que l’Europe ait pu leur offrir. Les poésies épiques vivent encore dans les classes les plus pauvres, transmises seulement, parla tradition orale, et conservant, tous les traits d’une mesure parfaite et d’une langue plus ancienne. Malgré la prépondérance russe, le sentiment national s’est réveillé naguère chez les Finlandais. et a donné une impulsion énergique aux travaux de Sjôgern, de Lônnrot, de Castrén et de Kellgren, qui ont produit des résultats vraiment surprenants. De la bouche des .vieillards on a recueilli un poème épique, dont les dimensions sont à peu près celles deY Iliade, et qui a la même unité ; nous dirions qu’il est aussi beau, si nous pouvions oublier pour un instant tout ce que, dans notre jeunesse, nous avons appris à qualifier de ce nom. Un Finlandais n’est pas un grec, ni Wainamoinen un Homère ; mais s’il est permis à un poète de choisir ses couleurs dans la nature qui l’environne, et de peindre les hommes au milieu desquels il vit, le Kalewala possède des mérites qui peuvent rappeler ceuxdeY Iliade,-et il a le droit de réclamer sa place comme la cinquième épopée
LEÇONS SUR LA SCIENCE DU LANGAGE.
■ V v.
** ^ -v- V V -V
__ w ■ _ -s_^
nationale du monde, à côté des chants, ionien s, du Mahû-bhârata, du Shânameh, et des Niebelungen. Cette antique culture littéraire n’a pas été sans, une grande influence sur la langue. Elle a donné la permanence à ses formes et la fixité à ses mots, au point que nous serions presque tentés, à la première vue, de nous demander si la grammaire de celte langue n’est pas sortie de la période agglutinante pour passer dans celle des flexions avec le grec ou le sanscrit. Le type agglutinant subsiste encore, cependant, dans le finnois, dont la grammaire nous présente une fécondité de combinaisons grammaticales inférieure seulement à celle du turc et du hongrois. Comme dans le turc, nous y trouvons « l'harmonisation dés voyelles », qui est un des caractères des langues touraniennes, ainsi que nous l’avons expliqué plus haut. . •
Le karélien et le tavastien sont des variétés du finnois.
Les Esthes ou Esthoniens, voisins des Finlandais, parlent une langue qui se rapproche beaucoup de la leur. Elle se divise en dialecte de Dorpat (ville de Livonie) et en dialecte de Revel. Si l’on excepte quelques chants populaires, on peut dire que l’esthonien 11’a pas de littérature. L’Esthonie compose, avec la Livonie et la Cour-lande, les trois provinces de la Russie sur la Baltique. La population des îles du golfe de Finlande est en grande partie eslhonienne ; mais les hautes classes comprennent à peine l’esthonien, et ne le parlent jamais.
Outre les Finlandais et les Esthoniens, il faut comprendre dans la même famille les Livoniens et les Lapons : mais.ils sont peu nombreux. La population de la Livonie se compose principalement d’Eslhes, de Leltes, de Russes et d’Àllémands. Le nombre des Livoniens parlant leur propre idiome ne s'élève pas à plus de cinq mille.
Les Lapons habitent la région la plus septentrionale de l’Europe. Ils appartiennent à la Suède et à la Russie, et
. HUITIÈME LEÇON. .3.81
- â
leur nombre est évalué à vingl-huit mille. Leur langue a beaucoup attiré, depuis quelque temps, l'attention des savants, et nous lisons dans les voyages de Castrén une description de leurs mœurs, qui est pleine d’intérêt à cause de sa simplicité et de son exactitude.
Le rameau bulgare comprend les Tchérémisses et les Mordviniens, épars le long du Yolga et entourés de dialectes russes et tartares. Ces deux langues ont une grammaire extrêmement artificielle, et admettent une accumulation d’affîxes pronominaux à la fin des verbes, qui n’est surpassée qu’en basque, en caucasien et dans les dialectes dits polysynth étique s de l’Amérique.
Ce nom général de Bulgares, donné à ces tribus, ne dérive pas de la Bulgarie, sur le Danube : au contraire, la Bulgarie (l’ancienne Mésie) a reçu son nom des armées finnoises qui en firent la conquête au septième siècle. Des tribus -bulgares s’avancèrent du Yolga au Don, et, après avoir séjourné quelque temps sur les rives du Don et du Dniéper, sous la domination des Àvars, elles marchèrent jusqu’au Danube, en ô3o, et fondèrent le royaume bulgare, qui a conservé son nom jusqu’à nos jours, bien, que les Bulgares finnois aient été depuis longtemps absorbés par les habitants slaves, et que les uns comme les autres aient .passé sous le sceptre de la Turquie, en 1392. •
' Le troisième rameau, le permien, comprend les idiomes ; des Yotiakes,.des Sirianes et des Permiens, trois dialectes : d’une même langue. Perm était l’ancien nom de la contrée I qui s’étend entre le 61° et le 76° long. E., le 55° et le 65°
t ' -,
lat. K. Les peuplades permiennes, chassées vers l’ouest ! par leurs voisins de l’est, les Yoguls, vinrent se heurter contre les Bulgares du Yolga. On trouve les Yotiakes entre le Yyatka et le Kâma, et les Sirianes au nord, sur les
rives du haut Kâma, tandis que la région orientale est oc- \
cupée par les Permiens. Ces derniers sont entourés, au
382
X
.LEÇONS SUR. LÀ SCIENCE DU .LANGAGE.,
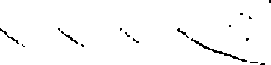
sud, par lès Tartares d’Orenburg et par les Bashkirs; au nord, par les Samovèdes ; et à l’est, par les Yoguls, descendus des monts Oural s. . • -
■■ -■
Ces Yoguls, avec les Hongrois et les Ostiakes, composent
le quatrième et dernier rameau de la famille finnoise, l’ou-grien. C’est en 462, après le démembrement de l’empire d’Attila, roi des Huns, que ces tribus ougriennes s’avancèrent vers l’Europe. On les appelait alors.Onagurs, Sara-gurs, et Grogs ; et nous les retrouvons plus tard dans les chroniques russes sous la dénomination d’Ugrv. Ce sont les ancêtres des Hongrois; ils ne doivent pas être confondus avec les Ouigours, ancienne tribu turque que. nous avons déjà mentionnée. .
Les rapporîs qui existent entre le hongrois et les dialectes d’origine finnoise ne sont pas Une découverte moderne. Dès '1253, un.prêtre, Wilhelm Ruysbrœck, qui voyagea au-delà du Danube, remarqua qu’une race, nommée les Pascatirs, et habitant sur les bords du Ya'ik, parlait la même langue que les Hongrois. Elle était alors établie à l’est de l’an tique royaume bulgare, dont la capitale, l’ancienne Bolgari, s’élevait sur la rive gauche du Yolga, sur P endroit où nous voyons aujourd’hui les ruines de Spask. Si. ces Pascatirs, la portion des peuplades ougriennes qui resta à l’ouest du Yolga, étaient identiques, avec les Bashkirs, comme Klaproth le suppose, il s’ensuivrait qu’ils ont renoncé, par la suite, à leur langue ; car les Bashkirs actuels ne.parlent plus un
dialecte hongrois, mais un dialecte turc. L’affinité des dialectes hongrois et ougro-finnois fut prouvée pour la première fois, d’après les règles de la philologie, par Gyarmathi, en -1799. . ' . .
Quelques exemples pourront suffire pour montrer cette connexion :
HUITIEME LEÇON.
. . *
t
|
' Hongrois. |
Tchérémissien. |
Français. |
|
a tva-m - |
atya-m |
mon père |
|
alya-d |
atyâ-t |
ton père |
|
alva •i |
atya-se |
son père |
|
atya-nk |
alya-ne |
noire père |
|
atva-tok |
alya-da |
voire père |
|
atva-uk |
atya-sl |
leur père. |
t
|
DECLINAISON | |||
|
Hongrois. |
Esihonien. |
Français. | |
|
Nom. |
vér |
werri |
le sang |
|
Gén. |
vére |
werre |
dn sang |
|
Bal. |
vérnek |
werrele |
au sang |
|
Ace. |
vert |
werd |
le sang |
|
Abl. |
vérestol |
werrist |
du sang |
|
CONJUGAISON | ||
|
Hongrois. |
Esihonien. |
Français. |
|
lelem |
leian |
je trouve |
|
lèled |
leiad |
tu trouves |
|
leli |
leiab |
il trouve |
|
leljük |
leiame |
nous trouvons |
|
lelilek |
leiale |
vous trouvez |
|
lelik |
leiawad' |
ils trouvent. |
GO
GO
. TABLEAU COMPARATIF
DES NOMS DE NOMBRE DES QUATRE RAMEAUX DE LA CLASSE FINNOISE
. MON TRA N T LE DEGRÉ DE LEUR PAHE N TÉ
|
I 'i |
2 |
O |
-î |
b |
6 |
7 |
8 . |
9 |
. -JO | |
|
Tclioude, finnois......... |
• yksi' |
kaksi |
kolme |
neljü |
. viïsi |
kuusi |
scitsenkin |
kahdcksan |
vh deksan |
kyninicnen |
|
— esthonien ,•....... |
... iits |
kats |
kolm |
nelli |
avüs |
kurs - |
seilze |
kallcsa |
ültesa |
kümmc |
|
Bulgare, tchdrémissien..... |
kok |
kurn |
niî |
vis |
kut. |
sim |
kilndiixe |
endexe |
lu | |
|
— mordvinicn....... |
.. vaike |
kavlo |
kolmo |
nile |
vate |
koto |
sisem |
kavsko |
vüikse |
kiimen |
|
Permien, sirïanien........ |
kyk |
kujim |
njolj |
vil |
levait |
sizim |
kokjâmys |
okmys. |
;das. | |
|
Ougrien, ostiake.......... |
... il |
kat |
eliudcm |
njeda |
vet |
chut. |
tabet |
nida . |
arjong |
jong |
|
— hongrois....... |
ket |
harom |
negy |
ol |
hat |
het. |
njolcz |
kilenez |
tiz |
LEÇONS SUR LA SCIENCE DU LANGAGE.
J ‘
Nous avons..ainsi examiné les quatre rameaux principaux de la famille tquranienne, le tongous, le mongol, le turc et le finnois. Au dernier rang se trouve le tongous, dont la grammaire n’est guère plus riche que celle du chinois, et qui, dans sa structure, ne renferme rien de cet appareil ardhitectonique, dans lequel les mots de cette dernière langue sont réunis sans ciment, comme les pierres des monuments cyclopéens. Toutefois, ceci est surtout vrai du mantchou; dans d’autres dialectes ton-gous parlés, non en Chine, mais dans la patrie primitive des Mantchoux, on voit apparaître, de nos jours, quelques formes grammaticales. .
Les dialectes mongols s’élèvent au-dessus des dialectes tongous, mais leur grammaire sait à peine distinguer les différentes parties du discours. Dans les idiomes parlés par les . Mongols comme par les Ton-gouses, il se fait évidemment un travail pour arriver .à une vie plus organique:, et Castrën a rapporté les preuves d’un développement naissant des mots, dans la langue des Buriates, et dans un dialecte tongous, parlé près de Nyertchinsk. Ce n’est, cependant, qu’un faible commencement auprès de l’exubérance de ressources grammaticales que l’on trouve dans les langues turques. Pour leur système de conjugaison, ces dernières ne peuvent guère être surpassées. Leurs verbes sont comme des branches, qui se courbent sous le poids des fruits et des. fleurs. Les dialectes finnois, se distinguent plutôt par la diminution que par T augmentation-' des formes Ver-baies; mais leur déclinaison est plus riche que celle même du turc. * . .
Ces quatre classes constituent, avec la samovède, la division septentrionale ou ouralo-alfaïque de la famille tou-ranienne. . .
■* ■- .. . T
La division méridionale se compose des dialectes ta-
LEÇONS SUR LÀ. SCiENCE DU LANGAGE,
'X
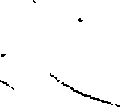
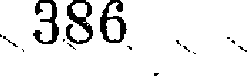
V X
' '' v s X -V v
mouls., gangétiques (le trans-himalayen et le sub-hima-layen), lohitiens, taïens et malais.(4). Ces deux divisions comprennent-, à bien peu de. chose près, toutes les. langues de l’Asie, à l’exception du chinois, qui, avec les dialectes circonvoisins, représente seul le langage radical ou monosyllabique. Quelques idiomes, comme le japonais (2), la langue de la Corée, des Koriakes. des Kamtschadales, elles nombreux dialectes du Caucase, etc., etc., ne sont encore rangés dans aucune classe; mais il est probable que quelques traces d’une origine qui leur serait commune avec les langues touraniennes y subsistent encore, et n’attendent que les recherches philologiques pour se.
révéler.
Je n’ai pas besoin de m’étendre longuement sur la troisième période, celle des flexions, puisque nous en avons examiné la formation, en analysant, dans nos précédentes leçons, un certain nombre de mots sanscrits, grecs et latins, ou de quelque autre langue aryenne. La principale distinction entre les langues à flexions et les langues agglutinantes consisté en ce que ces dernières conservent la conscience de leurs racines, dont elles n’admettent pas par conséquent l’altération phonétique; et tout en ayant perdu la conscience dé la signification primitive' de leurs terminaisons, elles sentent distinctement la différence entre la racine significative et les éléments qui la modifient. Mais il n’en est pas de même pour les langues à. .
(l)-Je ne pourrai que donner un tableau de ces dialectes, à la fin de ce volume, renvoyant pour d’autres détails à ma lettre sur les Langues îouraniennes. Les dialectes gangétiques ét lohitiens sont ceux qui sont compris sous la dénomination de Bholîav.
•S
(g) Si. Boller de Vienne, qui a publié une analyse três-eôm-plèle des langues touraniennes dans les Mémoires de l'Académie de Vienne, a démontré dernièrement le caractère touranien du japonais;
J
r ' ■ ' ■ . - ' - ' ' ’ - - ■ ‘ - j - - . ' ' -
| 1 ■ - , ' ■ : J ' ■’ 1 ■ - ' „ . ’ r 1 - . ( , , , - r ,
î . 1 ' * ■ ■ „ ■ " " " H
HUITIÈME LEÇON. 387
flexions : là, lés éléments divers qui entrent dans la composition des mots peuvent être si bien soudés ensemble, et si complètement changés par l’altération phonétique, que l’étude devient nécessaire pour reconnaître la distinction originelle entre une racine et une désinence, et que la grammaire comparée peut seule découvrir les soudures entre les parties constitutives.
Si vous considérez le caractère de notre classification morphologique, vous verrez qu’elle doit pouvoir s’appliquer à toutes les langues, et par là elle diffère de la classification généalogique. En effet, elle épuise tous les cas possibles. Si les éléments constitutifs du langage sont les racines attributives et démonstratives, il ne peut se présenter plus de trois combinaisons. Les racines peuvent rester simplement racines ; ou, secondement,, elles peuvent se joindre ensemble de façon que l’une détermine l’autre, et perde son existence indépendante ; ou, troisièmement, elles peuvent se joindre et se fondre ensemble, si bien que toutes deux perdent leur existence indépendante. Le nombre de racines entrant dans la composition d’ün mot n’y fait rien, et c’est pour cela qu’il est inutile d’admettre une quatrième classé, appelée quelquefois polysynthétique, et comprenant la plupart des dialectes d’Àmérique. Tant que,. dans ces composés d’une longueur démesurée, la racine significative se distingue i du reste, les langues appartiennent à la période, agglutinante ; mais elles appartiennent à la période des flexions,
! aussitôt que les racines sont absorbées par les terminaisons. Il est inutile aussi de distinguer les langues synthé-i tiques des analytiques, dont les premières comprennent les langues anciennes, et les dernières comprennent les langues modernes, appartenant à la période des flexions. La formation de phrases comme le français f aimerai pour fai à aimer, ou l’anglais 1 shall do, Ihou lotit do, peuvent
être appelées analytiques ; mais, envisagées sous le rapport de leur formation, ces phrases doivent rentrer dans la période des flexions. En analysant/e vivrai, nous trou-vous que c’était originairement ego (sanscrit ah&và) vivere (sanscrit jîv-as-e, dat. neutr.) habeo (sanscrit bhâ-vavâ-mi) ; c’est-à-dire que nous avons un certain nombre de mots où l'articulation grammaticale a été presque entièrement détruite, sans, cependant, qu’on s’en soit complètement débarrassé ; tandis que dans les langues touraniennes, les formes grammaticales sont produites par la combinaison de racines qui restent entières, et les anciennes désinences inutiles sont d’abord éliminées, avant toute combinaison nouvelle (1).
Maintenant que nous avons terminé notre classification morphologique, il se présente un problème que nous aurions pu éviter si nous nous étions limité à une classifica^ lion généalogique. À la fin de notre classification généalogique, nous avons dû reconnaître que jusqu’à présent on n’a pu dresser le tableau généalogique que d’un cer-
i.
tain nombre de langues, et que, par conséquent, le moment n’était- pas encore venu d’aborder la question de l’origine commune de toutes les langues. Maintenant cependant, sans avoir énuméré toutes les langues qui appartiennent aux trois différentes classes que nous avons reconnues,- celle des langues radicales, celle des langues agglutinantes, et celle des langues à flexions, nous avons établi solidement le principe que toutes les langues doivent rentrer dans l’une ou l’autre de ces trois catégories. Nous ne serions donc pas conséquents avec nous-mêmes, si nous reculions devant l’étude d’un problème qui, quoique enveloppé. de bien des difficultés, ne peut pas être banni de la science du langage. .
.V oyons d’abord clairement et distinctement l’état de la question. Le problème de l’origine commune des langues n’a aucune connexion nécessaire avec celui de l’origine commune de l’humanité. Quand il serait possible de prouver que le langage est sorti de sources différentes, on ne pourrait rien en conclure de contraire à l’uni lé primitive de la race humaine. Car, si nous regardons le langage comme naturel à l’homme, il a pu éclore à différentes époques et dans dès régions différentes chez les descendants épars ' d’un couple originel ; si, au contraire, nous . regardons le langage comme une invention artificielle, il y a encore moins de difficulté à ce que chaque génération successive ait pu former son propre idiome. . .
De même, si on pouvait prouver que toutes les langues du monde révèlent une origine commune, il ne s’ensuivrait aucunement que la race humaine doive descendre d’un même couple : car le langage a pu être la propriété dune race privilégiée, qui en aurait enrichi les autres
races dans le cours du temps et dans la marche de l’humanité. ;
En rendant solidaires et en mêlant 1’une à l’autre la science du langage et celle de l’ethnologie, on a porté à toutes deux une très-fâcheuse atteinte (4). La classification des races doit être tout à fait indépendante de celle des langues. Les races, en effet, peuvent changer de langues,, et l’histoire nous fournit plusieurs exemples d’une race adoptant la langue , d’une autre. C’est pourquoi dit-,
férentes langues peuvent être parlées par une même
■■ - ^ * _
race, ou différentes races peuvent parler une même langue; de sorte que toute tentative pour faire cadrer en-
(1) Voyez sur ce point un excellent article du professeur Huxley, publiédans la Forlnighily Review, 1869. .
. , T >
semble la classification des races et celle des langués doit nécessairement écliouer (4). ■
fc ' " . "F
En second lieu, le problème de l’origine commune’des langues n’est nullement lié aux récits de l’Ancien Testament concernant la création de l’homme et les généalogies des patriarches. Si nos recherches nous amenaient à admettre-des commencements différents pour les langues humaines, il n’y a rien dans l’Ancien Testament qui s’oppose à cette manière de voir. Car quoique les Juifs aient cru que, pour un temps, toute la terre ne parlait qu’une même langue, ce n’est pas d’aujourd’hui que d’éminents théologiens, en ayant particulièrement en vue les dialectes de l’Amérique, ont fait observer que de nouvelles langues ont pu prendre naissance à des époques postérieures. Si, au contraire, nous arrivions à la conviction qu’il est possible de faire remonter toutes les langues à une source commune, nous ne poumons jamais songera faire usage des généalogies de l’Ancien Testament pour dresser la classification généalogique du langage. Les listes généalogiques de l’Ancien Testament ont rapport à la race et non pas au langage, et comme nous savons que souvent des hommes, sans changer de nom, ont changé d’idiome, il est évidemment impossible que les généalogies de l’Ancien Testament puissent coïncider avec la classification généalogique des langues. Pour éviter toute confusion d’idées, mieux vaudrait s’abstenir entièrement d’employer, pour exprimer la parenté de langage, les termes consacrés dans la Bible pour exprimer la parenté de race. C’était l’usage autrefois de parler des langues
(1) La vue opposée,, à savoir qu’une classification généalogique des différentes races humaines fournirait la meilleure classification des différents idiomes maintenant parlés sur, la. surface de notre planète, a été soutenue par Darwin, Origine des especes, p. 422.
jap hé tiques, chamétiques et'sémitiques : mais ôn. a remplacé les deux premières dénominations par cellesd'aryennes et û*africaines; et, en gardant la troisième, on lui a donné une définition scientifique entièrement différente.de la signification qu’elle aurait dans la Bible. Voilà les points qu’il importe de ne pas oublier, afin d’empêclier céus qui
4 *
poursuivent toujours la Bible de traits qui ne peuvent l’atteindre, et aussi ceux qui la défendent avec des armes dont ils ne savent se servir, d’arrêter les progrès pacifiques et désintéressés de la science du langage. .
Abordons maintenant notre sujet sans dogmatisme et sans idées préconçues. Le problème de la possibilité d’une origine commune pour toutes les langues se divise.naturellement en deux parties, suivant, que l’on considère la formeou la matière: pour le moment, nous n’avons à nous
occuper que de la forme. Dans nos leçons précédentes,
* " r . ' '
nous avons examiné toutes les formes possibles que le langage peut revêtir ; nous avons reconnu qu’il y en a trois principales où se ramènent, toutes les variétés secondaires, et qui nous servent à établir trois grandes ca-. tégories : celle des langues où les racines restent -invaria-blés, celle des langues agglutinantes, et celle des langues à flexions; nous avons maintenant- à nous demander si, malgré les différences qui séparent l’un de l’autre ces trois systèmes, nous pouvons admettre une origine commune pour toutes.les langues humaines. Je réponds sans hésiter que nous.le pouvons. .
Le principal argument qui ait été avancé- contre l’unité d’origine du langage, c’est qu’aucune langue monosyllabique n’a jamais passé à l’état agglutinatif, et qu’aucune langue, agglutinante n’est jamais venue à avoir des flexions. Le chinois, dit-on, est encore aujourd’hui tel qu’il a été depuis le commencement ; jamais on n’y a vu ni agglutination ni flexions : et aucun dialecte touranien
V v
•n’a jamais perdu le trait caractéristique des langues à désinences, à savoir l’intégrité des racines. .
À cette objection nous répondrons _en faisant observer qu encore que toutes les langues, une fois fixées, conservent dans la formation de leurs mots le caractère qu’elles avaient au premier moment de leur existence individuelle ou nationale, elles ne perdent pas entièrement, pour cela, la faculté de produire des formes grammaticales appartenant à une période plus avancée. Dans le chinois, et surtout dans des dialectes chinois, nous découvrons des linéaments d’agglutination.' Ce li que j’ai déjà mentionné comme étant la désinence des adverbes de lieu, s’est, réduit à n’être plus qu’une simple aûlxe ; et un Chinois moderne ne sait pas plus que li signifiait primitivement intérieur, qu’un Touranien ne connaît l’origine de ses différents cas (1). Dans les dialectes parlés du chinois, les formes agglutinantes sont plus fréquentes : ainsi, dans le
(1) M. Stanislas Julieu remarque que les nombreux composés que nous trouvons en chinois prouvent l’influence étendue qu’a exercée sur cette langue le principe d’agglutination. Le fait est qu’en chinois chaque son a une fouie de significations: et pour éviter toute équivoque, on fait souvent suivre un mot d’un autre mot. qui s’y rapporte, dans le sens particulier qu’on veut lui donner. Ainsi :
chi-ÿouen ken-youen youen-chi ■ meï-miai meï-li. chen-yôuen ÿong-i tsong *yong
commencement
commencement
commencement
beau
beau
beau
aisément
aisémen t
(commencement- origine) signifie (racine-origine) —.
(origine-commencement) — (beau-remarquable) —
Pour dire & se vanter, » les Chinois se servent de king-kou-a, king-fa, etc, les deux mots ayant une seule et même signification. .
Ce système particulier de juxtaposition ne peut pas, cependant, être considéré comme l’agglutination dans le sens strict du mot.
dialecte de Shanghaï, wo signifie parler, et tooda, une parole, un mot; de woda, on a formé le génitif woda-kà, le datif pela-woda, l'accusatif tant-woda (1). D’un autre côté, nous trouvons dans les langues agglutinantes des rudiments de flexions : ainsi, en tamoul, le verbe tûngu, dormir, n’apparaît plus dans son intégrité dans le dérivé tûkkcmi, sommeil, et le mot tûngu lui-même pourrait probablement être ramené à .une racine simple, telle que tu, être couché, être suspendu, dormir. ;
Je cite ces exemples, auxquels j’en pourrais ajouter bien d’autres, pour prouver qu’il n’y a rien de mystérieux dans la persistance avec laquelle toutes les langues demeurent, en général, dans la période grammaticale où elles étaient arrivées au moment de leur fixation. Si une famille, ou une tribu, ou une nation, s’est une fois accoutumée à exprimer ses idées d’après un certain système de grammaire, ce premier moule reste, et ne fait que se consolider à chaque génération. Mais, tandis que le chinois s’est fixé dans cette période primordiale, celle où les racines restent immuables et indépendantes, d’autres dialectes l’ont traversée, en consenrant toute leur flexibilité : ils ne sont pas devenus des langues arrêtées et nationales avant que ceux qui les pariaient eussent appris à apprécier l’avantage de l’agglutination. Une fois cet avantage connu, quelques formes isolées, dans lesquelles l’agglutination était d’abord apparue, devaient étendre leur' influence irrésistible, à cause de ce sentiment de l’analogie qui est inhérent au langage. Les langues qui se sont fixées dans cette période devaient s’attacher avec une persistance non moins grande au système de l’agglutination. Un Chinois ne peut guère comprendre que le langage soit possible, si toutes les syllabes ne portent pas avec
(1) Turanian Languages, p. 24.
V
v-x
elles leur sens ; un Touranien méprise tous les idiomes où chaque mot ne laisse pas voir distinctement son élément radical et significatif ; tandis que nous, qui sommes habitués à nous servir de langues à flexions, nous sommes fiers d'une grammaire dont un Chinois et un Touranien ne feraient aucun cas.
Le fait que les langues, après s’être fixées, ne changent plus leur constitution grammaticale, ne prouve rien contre la théorie que nous défendons, à savoir que toutes les langues à flexions ont été auparavant ag~, glutinantes, et que toutes les langues agglutinantes ont commencé par être monosyllabiques. J’ai dit notre théorie, mais c’est plus qu’une théorie ; c’est la seule manière possible d’expliquer les phénomènes grammaticaux que nous offre le sanscrit ou -toute autre langue à flexions. En ce qui concerne la forme du langage, nous arrivons infailliblement à cette conclusion, que les flexions ont été précédées par Vagglutination, et Y agglutination par le monosyllabisme. Le grand fleuve du langage s’est déroulé en dialectes innombrables, et a changé sa couleur grammaticale en passant de temps à autre sur de nouveaux sédiments de pensée. Les différents bras du fleuve qui quittèrent le lit-principal' et se formèrent en lacs immobiles, ou, pour parler sans image, les langues qui devinrent littéraires et fixées, conservèrent pour toujours la couleur qu’avait le grand courant à l'endroit' de leur séparation. Si nous désignons par blanc l’âge monosyllabique, par rouge l’âge agglu-tinatif, et par bleu l'âge des flexions, il nous sera facile de comprendre pourquoi les canaux blancs contiennent à peine une goutte de bleu ou de rouge, et pourquoi les canaux rouges montrent à peine une faible nuance de bleu ; et nous serons préparés à trouver, ce que nous trouvons en effet, des teintes blanches dans les ca-
naux rouges, et dans les canaux bleus des teintes rouges et blanches.
Vous remarquerez que dans ce que je viens de dire j’ai cherché à établir 1a. possibilité, et non la nécessité, d’une origine commune du langage. Je regarde ce problème, lequel, ainsi que nous l’avons vu, n’a rien à faire avec celui de l’unité primitive de l’humanité, comme une ques-lion qui doit rester indécise le plus longtemps possible. Ce n’est pas, à mon avis, un problème tout à fait aussi insoluble que celui de la pluralité des mondes, sur lequel on a tant écrit dans ces dernières années ; mais on doit chercher à le résoudre à peu près de la même manière. Comme nous nepoüvonspas démontrer par le témoignage de nos sens que les planètes sont habitées, le seul moyen de prouver quelles le sont est de montrer qu’il estimpossi-ble quelles ne le soient pas ; et, d’autre part,, pour prouver que les planètes ne sont pas habitées, il faut démontrer qu’il est impossible qu’elles le soient. Quand l’une ou l’autre de ces impossibilités aura été établie, la question sêra résolue ; jusque-là, elle doit rester pendante, de quelque côté que nous entraînent nos prédilections particulières.
’ Je ne regarde pas comme tout à fait aussi décourageant le problème de l’unité primitive du langage, mais j’insiste fortement sur la nécessité de ne le laisser préjuger en i aucune façon. Or la tendance des. écrivains les plus dis-lingués, qui se sont occupés de philologie comparée, a ! été de poser en quelque sorte comme fait avéré et incontestable qu’après la découverte des deux familles aryenne et sémitique, et la constatation de l’étroite parenté qui, dans l’intérieur de chacune de ces familles, en rattache les uns aux autres les différents membres, il ne peut plus être question dorénavant d’une origine.commune du langage humain. Il était assez naturel, quand on fut parvenu, au
LEÇONS SUR LA SCIENCE DU LANGAGE.
v û ^ N . '* X V V . N. V '
moyen d’une analyse minutieuse des dialectes aryens et sémitiques, à fonder l’unité de ces deux familles sur cette identité de racines ou de formes grammaticales quien réunit les membres divers, que l’absence de conformités pareilles entre une langue aryenne et une langue sémitique, ou entre celles-ci et toute autre branche du langage, amenât à croire qu’aucune connexion n’était admissible entre elles. C’est ainsi qu’un disciple de Linné, qui a ses marques déterminées pour reconnaître les anémones, nierafl avec une égale assurance toute affinité entre cette espèce et d’autres fleurs qui ont été depuis réunies dans la même classe sans avoir les caractères que Linné attribuait à l’anémone. Mais il y a assurément divers degrés d’affinité dans les langues comme dans tous les autres produits de la nature, et si nous ne pouvons découvrir entre les différentes familles de langues les mêmes liens de parenté qu’entre les membres qui composent chaque famille, il ne s’ensuit pas comme une conséquence nécessaire qu’elles ont été complètement étrangères les unes aux autres, dès le principe.
Or j’avoue que, quand j’ai vu soutenir mainte et mainte fois qu’il n’est plus possible de parler de l’unité primitive du langage, depuis que la philologie comparée a prouvé l’existence de diverses familles de langues, j’ai senti que l’argument n’était pas' concluant, qu’il allait, en tout cas, beaucoup trop loin. Le problème, envisagé sous son véritable aspect, se réduit à ceci: — « Si vous voulez affirmer que le langage a eu des commencements différents, il faut prouver qui il est impossible que toutes les langues aient eu une origine commune. »
Cette impossibilité n’a jamais été démontrée pour une origine commune des dialectes aryens et sémitiques ; loin de là, l’analyse des formes grammaticales dans ces deux familles a fait disparaître bien des difficultés, et nous a
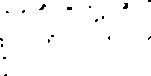
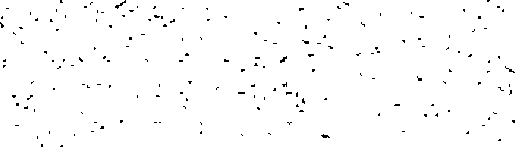
HUITIEME: LEÇON.

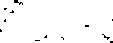
s T
397
permis au moins de comprendre comment, avec des matériaux identiques ou très-semblables, deux individus, deux familles ou deux nations auraient pu avec le . temps produire des langues aussi différentes pour la forme que l’hébreu elle sanscrit. Mais une lumière plus vive a été jetée sur la formation et les métamorphoses du langage par l’étude d’autres dialectes, qui n’ont aucun rapport avec le sanscrit ou l’hébreu, et qui nous permettent de voir de nos propres yeux le développement de ces formes grammaticales (grammaticales, dans le sens le plus étendu du mot), qüe dan s les famille s aryen ne et sémitique que nous connaissons seulement comme toutes formées, et non pas comme se formant; comme se décomposant, et non pas comme vivant: comme transmises par ceux
' ' T T '
qui s’en servent : je veux parler des dialectes touraniens. Les traces qui témoignent de la parenté primitive de ces langues sont bien "plus faibles que . dans les familles aryenne et sémitique ; mais elles doivent l’être nécessairement. Dans ces deux dernières familles, le procédé agglutinatif par lequel seul les formes grammaticales peuvent être obtenues, a cessé d’être appliqué, à unmo-ment donné, et cela sous des influences religieuses ou politiques. Par la même force qui fait qu’une civilisation absorbe dans sa marche les dialectes divers qui représentent naturellement tout idiome parlé, la première centralisation politique ou religieuse.. a dû nécessairement arrêter l’exubérance d’un langage agglutinatif. Parmi les nombreuses formes possibles, une seule devenait populaire, fixe et déterminée, pour, chaque mot et pour chaque catégorie grammaticale ; la poésie, la législation et la religion produisaient une langue littéraire ou politique.à laquelle il n’y avait plus désormais rien à ajouter, et qui, après un certain laps de temps, les; éléments de ses formes devenant inintelligibles, était sujette à l’altération
398
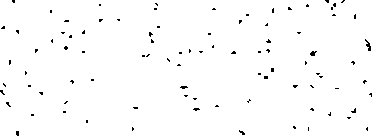
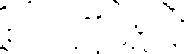
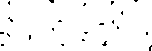
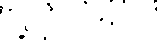
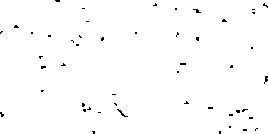
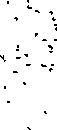
LEÇONS SUR LÀ SCIENCE DU - LANGAGE.
x ■ x x 'v x x x -v x. x. x. ' x. x. x. x xL x x '-x.
phonétique .seulement, sans avoir en [elle, pour les mots, un principe de vie nouvelle. Nous sommes forcésd’ad-mettre une con.centration.primilive .de cette .sorte pour les familles, aryenne et sémitique, car c'est la seule explication possible des rencontres entre les terminaisons grecques et sanscrites, formées les unes et les autres de matériaux qui ne sont ni sanccrits ni grecs, et qui sont encore identiques dans les deux langues. C’est dans ce sens que j’appelle ces langues, langues politiques, ou langues d’Élat, et l’on a dit avec vérité que les idiomes
appartenant à ces familles doivent pouvoir prouver leur
*
parenté par la communauté non-seulement, de ce qui est régulier.et. intelligible, mais aussi de ce qui est anomal, inintelligible et mort. . ; .
Quand cette concentration n’a pas lieu, les langues, bien que formées des mêmes matériaux et originairement identiques, doivent nécessairement se scinder en ce que nous pouvons appeler des dialectes, en prenant ce mot dans un sens bien différent des dialectes que nous trouvons dans les périodes ultérieures des langues politiques. Le-procédé de l’agglutination continue dans chaque peuplade, et les formes qui deviennent inintelligibles sont remplacées sans difficulté par de nouveaux composés faciles à comprendre. Si les cas sont formés à l’aide de suffixes, de nouveaux suffixes peuvent prendre la place de ceux qui vieillissent ; si la conjugaison est formée à l’aide de pronoms, de nouveaux pronoms peuvent être employés, quand les anciens ne sont pas suffisamment
distincts. .
Demandons-nous, maintenant, quelles ressemblances nous pouvons nous attendre à trouver dans les dialectes agglutinants qui se sont séparés, et qui tendent à se fixer, de plus en plus : ce sont seulement, il me semble, celles que Castrén et Schott ont réussi à découvrir dans le fin-
. HUITIÈME LEÇON. 399
’ ■ . - . ' ' * j
nois,.le mongol, le longous et le samoyède ; et que Hodgson, Caldwell, Logan, et moi-même, nous avons indiquées dans le tamoul, le gangétique, le lohitien, le taïen et le malais. Elles doivent porter principalement sur les racines ou sur ces parties du discours qu’il est le plus difficile de créer plusieurs fois : les pronoms, les noms de nombre et les prépositions. Ces langues ne se ressembleront presque jamais en ce qui est anomal ou: inorganique, parce que leur organisme repousse sans cesse ce qui commence à être de pure forme et inintelligible. Nous devons plutôt nous étonner de rencontrer dans Je fonds commun des langues touraniennes des mots ayant une signification conventionnelle, que de voir que la plupart des formes et des mots de ces langues leur sont particuliers à chacune. Il faut bien, cependant, que ceux qui nient l’origine commune des langues touraniennes rendent raison de ces ressemblances ; ils ne peuvent les expliquer que comme
étant le résultat du hasard, ou d’un instinct imitatif qui a
*■ * . ' '
amené l’esprit humain dans des régions diverses à former les* mêmes onomatopées ; mais on n’a jamais prouvé que cette explication fût. acceptable, et on aura bien de la peine à le faire. . - .
Pour ma part, l’étude de la famille touranienne m’intéressa surtout parce quelle me permit de voir jusqu’à quel.point les langues, auxquelles je supposais une origine commune, peuvent se scinder et devenir dissembla-, blés par suite de la libre opération du renouvellement dialectal.
Dans une lettre que j’adressai à mon ami le baron Bun-, sen, et qu’il publia dans son Esquisse de la philosophie de Vhistoire universelle (vol. I, pp. 263-521) (1), mon objet avait été de tracer démon mieux les principes qui ont
(i) Celte Esquisse forme lés tomes III et IV de l’ouvrage de B ou-.
LEÇONS SUR LA SCIENCE DU LANGAGE
-X -X -V
' x- x ■ V -v. X x X X X x,
présidé à la formation, des langues agglutinantes, et de montrer combien certaines langues peuvent devenir dissemblables pour, la grammaire .et je lexique, sans, que nous cessions pour cela d’être autorisés à les traiter comme des dialectes congénères : en réponse à l’assertion que cela était impossible, je tâchai, dans la quatrième, cinquième et sixième section de cet Essai, de montrer comment il était possible que des langues aussi différentes que le mantchou elle finnois, que le malais et le. siamois, après avoir eu un point de départ commun, arrivassent à leur état actuel, et pussent être regardées néanmoins comme étant de la même famille. Regardant cette opération de l’agglutination comme le seul moyen possible qui puisse donner à une langue une organisation grammaticale, et lui faire franchir la barrière qui a arrêté le développement du chinois, je me sentis justifié à appliquer aux familles aryenne et sémitique les principes tirés de la formation des dialectes touraniens. Elles aussi ont dû traverser une période agglutinative dans laquelle seule nous trouvons l’explication des modifications qu elles ont éprouvées en divergeant peu à peu l’une de l’autre, et en arrivant par degrés à ce caractère plus marqué, à cette existence individuelle et distincte que possèdent-, chacune de leur côté, la grammaire aryenne et la grammaire sémitique. Si.nous pouvons expliquer les différences entre le mantchou et le finnois, nous pourrons également nous rendre compte de la distance qui sépare l’hébreu et le sanscrit. Il est vrai que nous ne connaissons pas le langage aryen durant sa période agglutinative, mais nous pouvons juger par induction de ce qu’il était quand nous voyons des langues comme le finnois et le turc se rappro-sen : le Christianisme et l'Humanité, en sepL volumes. Londres, 18S4 ; Longman.
HUITIÈME LEÇON.
' O
cher de plus en plus dun type aryen. Telle a été la marche du turc vers les flexions, que M. Ewald réclame pour cette langue la dénomination de synthétique, qu’il donne aux dialectes aryens et sémitiques quand ils sont sortis de l’âge aggîutinatif, et devenus sujets à la corruption phonétique et à la décomposition. « Beaucoup des parties constitutives des mots turcs, dit-il, quoiqu’elles aient été primitivement, comme dans toutes les autres langues, des
mots indépendants, se sont réduites à n’être que de sim-
■#
pies voyelles ou se sont perdues entièrement, si bien que leur présence antérieure ne se fait plus sentir que par des Changements qu’elles ont apportés au corps des mots. Goz signifie œil, et gôr, voir ; ish, acte, et ir, faire ; ich, l’intérieur, gir, entrer (1). » Il va même jusqu’à admettre certaines formes qui appartiendraient en commun au turc et à la famille aryenne, et qui ne pourraient dater, par conséquent, que d’une époque où toutes ces langues étaient encore dans leur enfance agglutinative ; par exemple di, comme le signe caractéristique d’un passé, et ta, comme celui du participe.passé passif; lu, comme suffixe pour former des adjectifs, etc. (2) : mais je n’oserais m’avancer si loin. - ,
Envisageant de la sorte la formation graduelle du langage par l’agglutination, il est presque inutile de dire qu’en parlant des dialectes touranièns j'emploie le mot famille dans un sens bien différent de celui que je lui donne quand il s’agit des langues aryennes ou sémitiques. Dans ma lettre sur les langues touraniennes, qui a été si vivement attaquée par ceux qui ne veulent admettre l’unité primitive ni du langage ni du genre humain, je me suis souvent expliqué à ce propos, et j’ai préféré le.
« ^ ■ ' - ■
(!) Goltingische Gelehrte Anzeigen, 18o5, p. 298.
(2) Ibid., p. 302, note.
h.
X.
LEÇONS SUR LA SCIENGE DU. LANGAGE.
terme de groupe pour les langues touraniennes, afin d’exprimer le plus clairement possible que le rapport du turc au màutchou, ou du tamoul au finnois, ne - diffère pas seulement en- degré, mais même en nature, de celui que 'nous trouvons entre le sanscrit et le grec. « Ces langues touraniennes, ai-je dit (p. 216), ne peuvent être considérées comme ayant les unes avec les autres la même relation que l’arabe a avec l’hébreu, ou le grec avec le sanscrit. » — « Ce sont des rayons qui divergent d’un centre commun, et non pas des filles d’une même mère. » Et, néanmoins, elles ne sont pas séparées les unes des autres par la distance que nous voyons entre l’hébreu et le sanscrit, parce qu’aucune d’elles n’est entrée dans cette nouvelle phase du développement ou de la décomposition (p. 218). qu’ont traversée les langues sémitiques et aryennes, après qu’elles se furent fixées, et qu’elles furent devenues langues politiques et nationales.
En réalité jè ne voulais, dans mon Essai, que me tenir sur la défensive ; je voulais montrer combien il est téméraire d’attribuer au langage des commencements divers et indépendants, avant de proposer un seul argument qui établisse la nécessité de cette différence d’origine. Personne n’a jamais prouvé l’impossibilité de l’origine commune du langage ; mais, afin d’écarter les difficultés supposées qui portaient sur la théorie de cette unité primitive, je regardai comme un devoir de montrer par les faits, et par l’histoire même des langues touraniennes,
comment cette théorie est possible, ou, comme je l’ai.dit
■ ■■
pour un cas seulement, probable. Je tâchai de faire voir que les deux membres les plus éloignés l’un de,l’autre de la famille touranienne, le finnois parlé au nord, elle tamoul au sud de l’Asie, conservent encore dans leur organisation grammaticale des traces d’une unité antérieure ; et. si mes-antagonistes admettent que j’ai prouvé le ca-
HUITIEME LEÇON,
403
raclère touranien des habitants anté-bralimaniques ou tamouls de la péninsule indienne, il leur a sans doute échappé quen m’accordant ce fait, qui est le point extrême
de mon argument, ils sont bien obligés de reconnaître
1 1 *
que tout le reste s’y trouve impliqué et doit nécessairement s’ensuivre. .
Pourtant je n’ai pas intitulé le dernier chapitre de mon Essai De la nécessité, mais De la possibilité de l’origine commune du langage et, en réponse aux opinions avancées par mes adversaires, je résumai ma défense dans ces deux paragraphes: /
4° « Rien ne démontre la nécessité d’admellre des commencements divers et indépendants pour les éléments substantiels, que nous présentent les groupes touranien, , sémitique, aryen : il est même possible, encore aujourd’hui/de citer des radicaux qui, -sous différents changements et déguisements, n’ont jamais cessé d’avoir cours dans ces trois groupes depuis leur première séparation. ... . . . .
* t
2° « Rien ne démontre la nécessité d’admeltré des commencements divers pour les éléments formels que nous présentent les groupes, touranien, sémitique, aryen ; quoiqu’il soit impossible de dériver le système grammatical de la famille aryenne du système sémitique, ou réciproquement, nous pouvons parfaitement comprendre comment les différents systèmes grammaticaux de l’Asie et de l’Europe ont pu être produits, soit par des influences individuelles, soit par . la détérioration du langage dans son travail continu. » . .
On verra, par les expressions mêmes dont je .me suis servi dans ces deux paragraphes, que mon objet était de nier la nécessité de commencements indépendants et d’affirmer la .possibilité d’une origine commune du langage. J’ai été accusé de m’être laissé influencer dans, mes re-
404 ' ' LEÇONS SUR LA-SCIENCE DU LANGAGE.v. x x x . s x
£> . s . .
cherches par une croyance implicite, à'l’unité primitive de l’humanité. J’avoue que j’ai cette croyance, et, si elle avait eu besoin d’être confirmée, elle l’aurait été par l’ouvrage de Darwin, On tke origin of species (1 ). Mais je mets mes adversaires au défi de citer un seul passage où j’aie mêlé aux-arguments scientifiques des arguments théologiques. Seulement, si on me dit « qu’aucun observateur impartial n’aurait jamais conçu l’idée" de faire venir toute l’humanité d’un couple unique, si le récit de Moïse n'avait affirmé ce fait », on me permettra de répondre que cette idée est, au contraire, si naturelle, si bien en harmonie avec toutes les lois du raisonnement, qu’il n’y a jarhais eu, que je sache, de nation sur la terre, qui, ayant des traditions sur l’origine de la race humaine, ne l’ait pas tirée d’un seul
i
couple, sinon d’une seule personne. Quand même l’auteur du récit de la Genèse serait dépouillé, devant le tribunal des sciences physiques, de ses droits d’écrivain inspiré, il peut, du moins, prétendre au titre modeste d’observateur impartial ; et, si l’on peut prouver que sa
(I) « Ici les lignes convergent à mesure qu’elles s’éloignent dans les âges géologiques et nous conduisent à ces conclusions que, dans, la théorie de Darwin, nous ne pouvons éviter, soit qu’elles nous plaisent ou non. Le premier pas en arrière nous montre le Nègre et le Hottentot comme étant de notre race et de notre sang; et si cette parenté répugne à notre orgueil, la raison et l’Ecriture l’admettent, » — Asa. Gre}7, Natural Sélection not in-consistent ivit-li N atur al Theology, 1861, p. 5.
« Déjà nous apercevons un bon résultat de ces études ; elles permettent aux adversaires de l'unité primitive des races humaines de sentir la'double faiblesse de leur position. Quand on admet que ces races appartiennent à une même espèce, il semble qu'on doive accepter ce corollaire, qu’elles ont une origine commune Ceux qui reconnaissent qu'elles sont d’une espèce unique sont obligés d’admettre qu’elles ont donné des variétés permanentes et profondément caractérisées; tandis que, de l’autre c<Ué, ceux qui reconnaissent plusieurs ou de nombreuses espèces humaines auront de la peine à soutenir que de telles espèces furent primordiales et surnaturelles dans le sens ordinaire du mot. » (Asa Grey, ouvrage cité, p. 54.)
conception de l’unité physique de la race humaine soit fausse, c’est une erreur qu’il partage en commun avec d’autres observateurs impartiaux, tels que Humboldf, Bunsen, Pritchard et Owen (1). .
La seule question qu’il nous reste à résoudre est dç
: (t) M. Pott, le défenseur le plus distingué de la pluralité d’origine, a soutenu la nécessité d’admettre que la race humaine et le langage ont fait leur apparition sur plus d’un point à la fois, dans un article du Journal de la Société orientale d’Allemagne, IX, 403. Max Muller und die Kennzeichen der Spracliverwandtsdiaft, 1833 ; dans un traité intitulé : Die Ungleichlidt menschlicher Rassen, 1836 ; et dans la nouvelle édition de ses Etymologische Forschun-gen, 1861. ' . .
D’un autre côté, les recherches que poursuivent, chacun de leur côté, différents érudits, tendenL de plus en plus à confirmer, non-seulement l’étroite parenté qui existe, dans la branche méridionale comme dans la branche septentrionale des langues touraniennes,' entre les langues qui constituent chacune de ces branches, mais encore les rapports qui relient l’une à Fautrè ces deux branches, et en dernier lieu les ressemblances qui les rattachent au chinois. Ce ne sont pas des rapports purement formels ou grammaticaux qui témoignent de cette parenté; on peut la prouver aussi à l’aide des éléments dont se compose le vocabulaire. La lettre
suivante de M. Edkins, Fauteurd’une grammaire du chinois parlé (Gh'anvnîar of ihe Ckinese colloquial language, deuxième édition, Shang-Haï, 1864) montrera comment ses recherches sur l’état primitif de la langue chinoise ont établi que les idiomes mongoliques et tibétains convergent vers un centre commun, à savoir la langue primitive de la Chine, quand elle ri’était pas encore privée de ses consonnes finales, dont la plupart ont disparu dans la langue des Mandarins.
« Pékin, 12 octobre 1864.
« Je m’occupe en ce moment à comparer avec le chinois le mongol et le tibétain, et j*ai déjà ôbLenu quelques résultats intér ressants. ' . •
« I. Une grande quantité de mots mongols appartiennent au chinois. Il y en a peut-être un cinquième qui sont dans ce cas. C’est dans la première syllabe des mots mongols que se marque Tidentilé ; c’est là qu’est la racine. C’est dans les adjectifs que la correspondance est la plus frappante ; une moitié peut-être des plus communs sont absolument les mêmes qu’en chinois: ainsi min, bon; begen, bas ; ichH, droit; solagai, gauche; clïihe, droit; gadan, extérieur ; ch-ohon, peu ; laggon, vert ; hunggùn, léger.
LEÇONS SUR LÀ SCIENCE DU LANGAGE.
X n V V X X N. V X.-
N. .N-
V
savoir si une même source a fourni toute l'eau qui coule dans les éanaux parallèles du ; langage ou, pour parlet sans métaphore, si les, racines qui furent juxtaposées ou fondues ensemble d’après les systèmes du monosyllabisme, des désinences et des flexions, étaient identiquement les
Mais cette identité s’étend* aussi à d’autres parties du langage; elle paraît même, pour certaines racines communes, s’étendre jusqu’aux idiomes tartares : par exemple, sou, eau; tenri, ciel.
« IL Pour, comparer le, mongol avec le chinois, il est nécessaire de remonter au moins de dix sièclès dans l’histoire de la langue chinoise. Nous trouvons en effet dans des racines communes des lettres particulières à l’ancien chinois, par exemple le m final. Il faut aussi considérer les lettres initiales en se reportant à une époque antérieure à celle d’où date la prononciation des Mandarins. Si un grand nombre de mots sont communs au chinois, au mongol et au tartare, nous devons remonter d’au moins douze cents ans pour trouver un point de comparaison convenable.
« III. Tandis qu’il n’y a dans le mongol aucune trace d’accents, ils se montrent de la manière la plus distincte dans le tibétain. Csoma de Koras et. Schmidt ne mentionnent pas l’existence des accents. Mais l’oreille les reconnaît dé la manière la plus sensible, dans la prononciation d’indigènes du Tibet résidant à Pékin.
« IV. Comme pour la comparaison avec le mongol, il .est nécessaire, quand on étudie les relations du tibétain avec le chinois, de se reporter à la vieille forme du chinois, avec ses consonnes finales, plus nombreuses, et son système complet d’initiales douces et aspirées. C’est.là. un fait, dont la preuve est suffisamment fournie par les noms de nombre tibétains.
« Y. Tandis que le mongol se rapproche surtout du chinois, par la proportion des mots communs aux deux langues, le tibétain en est. plus près par tout l’ensemble de son système phonique, en ce qu’il est à la fois accentué et monosyllabique. Cela étant ainsi, il n’y a rien de surprenant à ce que le chinois et le tibétain aient beaucoup de mots semblables : on pouvait s’y attendre. Mais qu’il y en ait peut être autant dans le mongol avec ses longs poîysjdlabes non accentués, c’est là une curieuse circonstance. »
Un essai par M. Ëdkins sur le même sujet, intitulé : De l’origine commune des Langues chinoise et mongole, vient d’être publié dans la Revue orientale, n° 56, p. 75. Paris, 1865.
Voir aussi Max Müller, On the Stratification of Language, 1868. [Trad. en français par M. Louis Havet, dans la Bibliothèque de l’Ecole des Hautes-Études-, 1869.]
mêmes. La seule manière de répondre à celle question
ou du moins de chercher à le faire, c’est d’étudier. la na. * «
lure et l’origine des racines ; nous serons alors arrivés aux dernières limites où le raisonnement par induction puisse atteindre dans les recherches qui ont pour objet de jeter quelque jour sur les mystères du langage.
PÉRIODE DE LA THÉORIE. — ORIGINE DU LANGAGE.
Théories'diverses sur l’origine du langage.— Méthode à suivre pour arriver a la solution de ce problème. Nécessité de pénétrer la nature intime du langage. Différence entre l’homme et les bêtes. Facultés mentales des bêtes. L’instinct et l’intelligence chez les bêtes et chez l’homme. Les bêles ne possèdent ni la. faculté de former dés idées générales, ni le langage qui est le signe ou la manifestation extérieure de cette faculté distinctive de l’homme. — Les racines, éléments constitutifs du langage, —19 Comment les racines ont-elles été formées ? Deux théories principales proposées pour en expliquer la formation : la théorie de l’onomatopée et celle de l’interjection. Examen et réfutation de ces deux théories.— La faculté de connaître ou la raison, et la faculté de nommer ou le langage. Toutes les racines expriment une idée générale, et sont des types phonétiques produits instinctivement par une puissance inhérente à la nature humaine. — Élection primitive et élimination subséquente des racines. — Rien d’arbitraire dans le langage. — Gon-cînsion.
« En étudiant {'histoire de .l'humanité, de même qu’en cherchant à nous rendre compte des phénomènes du monde matériel, là. où nous ne'.pouvons déterminer par quel procédé un effet a été produit, il est souvent bon de montrer comment cet effet a pu avoir des causes naturelles. Ainsi, quoiqu’il. nous soit impossible de tracer avec, certitude la marche qui a été suivie dans la formation d’une langue particulière, si nous pouvons néanmoins, d’après les lois connues de l’esprit humain, montrer de quelle façon les différentes parties de cette langue auraient
pu naître graduellemeut, bon-seul ement notre intelligence' sera jusqu’à un certain.-point satisfaite, mais, nous aurons secoué cette indolence qui nous fait rapporter immédiatement à un miracle tous les phénomènes du monde ma' ' ' ■ i P
S 'v V,
v
tériel et du monde moral dont nous ne voyons pas, au premier abord, l’explication (4); » . :
Ces paroles, que nous empruntons à un éminent philosophe écossais, renferment le meilleur conseil qui puisse être donné au. linguiste quand il aborde la question que nous avons à agiter aujourd’hui, celle de l’origine du langage, Bien, que; nous ayons dégagé ce problème des nua-^ ges et du mystère qui l’enveloppaient aux yeux des philosophes anciens, cependant, alors même qu’il est présenté sous sa forme la plus simple, il semble presque échapper encore à la pénétration humaine. .
Si l’on nous demandait de rechercher comment les images qui se peignent au fond de l’œil, comment toutes nos sensations pourraient être représentées par des sons, et transformées en sons de.façon que ces sons traduisissent . nos propres impressions et éveillassent celles des autres,
• nous regarderions sans doute une pareille question comme venant d’un fou qui, mêlant ensemble les choses les plus
. " . É ' _ . . . _ _ _ _ _
hétérogènes, voudrait voir, changer la couleur en son et le
_ ' < ■■ ■
son en pensée (2). Pourtant telle est la question dont il
nous faut trouver aujourd’hui la solution.
• 0 • . .
: Il est très-clair que les données nous manquent pour résoudre historiquement le problème de l’origine du langage, ou pour expliquer le langage comme un fait qui se serait produit un jour en un certain lieu et à un certain moment. L’histoire ne commence que bien longtemps après que’ l’humanité eut acquis l’usage de la parole, et 19
NEUVIEME LEÇON.
*
441
les traditions les plus anciennes se taisent sur la manière dont l’homme entra en possession de ses premières pensées et de-ses premiers mots. Rien assurément ne serait plus intéressant que d’apprendre par des documents historiques le procédé même au moyen duquel le premier homme commença à bégayer ses premiers mots ; on en finirait ainsi une fois pour toutes avec les spéculations philosophiques sur. l’origine du langage. Mais cette connaissance, il ne nous sera jamais donné d’y atteindre, et d’ailleurs, quand même nous.pourrions porter nos regards sur ce premier âge, il est fort probable que nous nous trouverions dans la complète impossibilité de comprendre ces événements primitifs ■ de l’histoire de l’esprit humain (1). La religion nous dit que le premier homme était le fils de Dieu; que Dieu le créa à son image, le forma du limon de la terre, et souffla dans ses narines le souffle de . la vie. Ce sont là de simples faits, qui doivent être acceptés comme tels ; car notre intelligence se trouble et son regard s’obscurcit dès que nous voulons raisonner là-dessus. L’esprit de l'homme est ainsi constitué qu’il ne saurait concevoir ni le commencement absolu ni la fin absolue de quoi que ce soit. Si nous essayions de nous
représenter le premier homme créé à l’état d’enfance et
* ■
développant par degrés ses forces physiques et intellectuelles, il nous serait impossible de comprendre comment il aurait pu vivre un seul jour sans une aide surnaturelle.
(l) « Dans ces recherches, lorsque nous remontons- bien loin en arrière, l’aspect des âges primitifs devient tout différent de celui où nous vivons; et toujours le sentier se perd dans l’obscurité quand nous essayons de le suivre jusqu’à son point de départ. Si nous voulons rious enfoucer davantage dans ce passé obscur, non-seulement nos yeux mais notre imagination nous abandonnent. Ce n’est plus une interruption, c’est un abîme qui nous sépare de tout commencement intelligible des choses. » — AVhewelI, Indications of the Creator, p. 166.
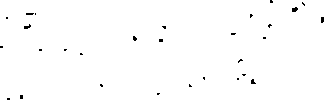
/
ih% LEÇONS SUR LA SCIENCE DU LANGAGE.
' N. „ X. 'N X X V °\ X X X ■ V X X X X X v X X
Et si nous voulions, au contraire, nous représenter le premier homme créé dans toute la plénitude de ses facultés, notre raison ne. serait-elle pas également impuissante à concevoir cet effet sans cause? Il en est de même pour les premiers commencements du langage. Les philosophes qui soutiennent la thèse de là révélation divine du langage tombent dans le plus dangereux anthropomorphisme, quand ils entrent dans des détails sur la manière dont ils supposent que Dieu aurait coniposé un vocabulaire et une grammaire, et les aurait enseignés au premier homme, comme un maître instruit les sourds-muets. Ils ne voient pas que, lors même que leurs prémisses leur seraient accordées, ils n’auraient fait qu’expliquer comment le premier homme aurait pu apprendre à parier, s’il avait trouvé une langue toute faite : le problème de la formation de cette langue resterait tout aussi obscur qu’auparavant. D’autre part, ceux qui prétendent que le premier homme, abandonné à lui-même, sortit- peu à peu de l’état de mutisme et inventa desmotspour les nouvelles idées qui naissaient dans son esprit, oublient que l’homme n’aurait jamais pu par ses propres forces se donner la faculté de la parole qui est la propriété caractéristique de l’humanité, et qui n’a.jamais existé ni ne pourra jamais exister chez les bêtes (r). Lorsque ces philosophes s’appuient sur ce fait que l’enfant vient au monde sans avoir de langage, et qu’il entre graduellement en pleine et entière possession de la parole articulée, ils prouvent par là qu’ils,ne saisissent pas bien le fond même de la ques-
(I) Der Mensch ist nur. Mensch dur.ch Spraehe; um aber die Sprache zu erlînden, müsste er schon Mensch sein. » — W. von Iiumboldt, Sammtliche Wèrke, IIÎ, 252. Le même argument est épuisé par SüssrmJch, Versuch eines Beweises dass die ersle Sprache ihren Ursprung nicht vom Menschen, sondern allein nom Schopfer crhalten habey Berlin, 1766. .. •
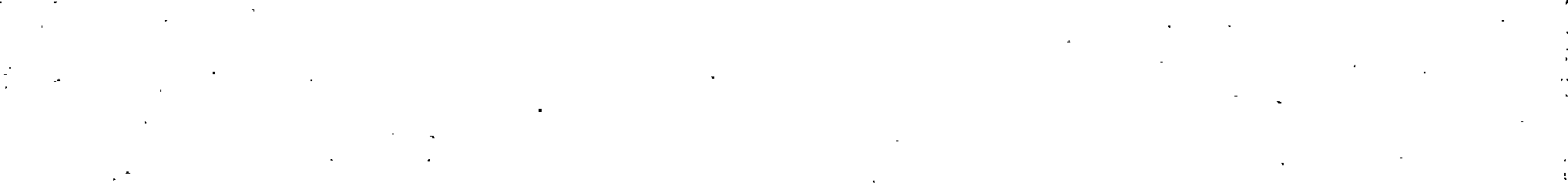
lion. En effet, nous ne demandons pas quon nous explique de quelle façon les oiseaux apprennent à voler, créés commeils le sont avec des organes propres à les porter dans l’air ; et nous ne recherchons pas davantage comment les enfants apprennent à faire usage des différentes facultés dont lame et le corps humains sont doués. Nous voulons, si c’est possible, obtenir une connaissance approfondie de la: faculté originelle de la parole ; et, pour cette fin, je crains bien qu?il ne soit aussi inutile d’observer les premiers bégayements de l’enfance qu’il le serait de répéter l’expérience de Psammétique, le roi d’Égyple, qui confia à un berger deux enfants nouveau-nés avec l’injonction formelle de les faire nourrir par des chèvres, d’empêcher qu’on leur fît entendre aucun langage, et de recueillir soigneusement le. premier mot qu’ils prononceraient (4). La même expérience fut ordonnée, dil-on, par l’empereur souabe, Frédéric II, par Jacques IY d’Écossé, et par un des empereurs niogols de l’Inde (2). Mais si l’on a voulu découvrir quelle avait été la langue primitive de l’humanité ou jusqu’à.quel point le langage était naturel à l’homme, les expériences précitées né répandent aucune lumière sur le problème qui nous occupe.
(4) Farrar, Originof Language, p. 40; —Griuim, Ursprung der Spraches p. 32. — La légende raconte que le premier mot prononcé par Ces enfants fut jkxo'ç, qui signifiait en ph.iygien pain ; d'où l'on conclut que le pluygien était la langue primitive de l’humanité, Bsxoç est probahlément dérivé de la même racine qui existe encore dans le mot anglais to balte, cuire au four. Gomment ces malheureux enfants étaient-ils venus à avoir, l’idée du pain cuit,, dans laquelle sont impliquées les idées de farine, de four, de feu, etc..? c’est ce qui semble avoir échappé aux anciens sages de rEg3Tpte. Quintilien fait une distinction très-fondée entre le pouvoir de prononcer quelques mots et la faculté de parler : <• Propter qnod infantes a mutis nutricibus jussu regum in soliludine educati, eliamsi verba quædâm emisisse tradantur, tarnen loquendi facultàle caruerunt. » Inst. orat. X, I, 4Ô.
J 1 » ■ .. * i , . - ■ •
(2) Hervas, Origine degV idiomi pp. 145 seq. '
Quand les enfants apprennent à parler, ils'n’inventent pas le langage qui est là tout formé, et qui l’est depuis des milliers d’années. Us acquièrent l’usage d’une langue, et, en grandissant, ils pourront en apprendre deux ou plusieurs autres. Inutile donc de nous demander si des enfants abandonnés à eux7inêmes inventeraient un langage. De telles expériences seraient non-seulement illicites et cruelles (1), mais impossibles, et à moins qu’on ne les renouvelât fréquemment, les assertions de ceux qui nient, comme de ceux qui affirment la possibilité pour, des enfants d’inventer un-langage à eux, seraient également sans valeur. Tout ce que nous pouvons tenir pour certain, c’est qu’un enfant anglais abandonné à lui-même ne commencerait jamais a parler l’anglais, et que l’histoire ne nous fournit pas d’exemple d’une langue qui ait été inventée de cette manière. .
Si nous voulons arriver à nous rendre compte exactement de la faculté de voler qui appartient en propre aux
- - . c J * v _ "
oiseaux, tout ce que nous pouvons .faire, c’est de comparer d’abord la structure des oiseaux avec celle des autres animaux qui.sont privés de cette puissance, et en second lieu d’observer les conditions dans lesquelles l’acte de voler devient possible., telle est aussi la marche à suivre dans l’étude apprbfondiè du langage. La parole est une faculté spécifique de l’homme : elle le distingue de toutes les autres créatures ; et, si nous voulons nous faire une idée plus précise de la nature véritable du langage, le mieux est de comparer l’homme avec les animaux qui semblent en approcher le plus, et de. tâcher dé
.. " - ' " T - J -f + ^
découvrir ainsi ce qu’il , a en commun avec eux et ce qui
(t) « Cioè a dire, si voleva porlo nella condizione più contraria alla natura, per sapere cio che naturaîmente avrebbe fatto; » ,Villari, Il Politecnico, vol. I, p. 22* Voir-aussi Pextrait du Wibhanga Atu-lodwa, note 22; p,146. 1 : . - •'
NEUVIÈME LEÇON
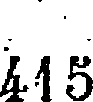
« r
est son privilège à lui seul. Une fois cette comparaison terminée, et la possession du langage constatée comme attribut distinctif de l’homme, nous pourrons rechercher les conditions dans, lesquelles le langage devient possible ; et alors nous aurons rempli notre tâche dans la mesure de nos forces, car. les instruments de nos connaissances, si admirables qu’ils soient, sont beaucoup trop imparfaits pour nous ouvrir toutes les régions où nous pouvons nous élever sur les ailes de l’imagination. .
En comparant les hommes avec les autres animaux, nous n’avons pas à nous préoccuper de la question physiologique de savoir si la différence entre le corps d’un singe et celui d’un homme est une différence de degré ou d’espèce. À quelque conclusion qu’arrivent les physiolo-logistes sur ce point, nous n’avons aucune inquiétude à
" 4
avoir. Si la structure d’un ver de terre suffit pour rendre muet d’étonnement tout esprit qui réfléchit ; si l’organisation de la plus chétive des créatures reflète la sagesse du créateur divin avec un éclat qui éblouit nos regards, comment, est-il possible de dépriser et de ravaler ces animaux qui sont placés aux plus hauts degrés de l’échelle des êtres organisés, et dont la conformation n’est pas moins merveilleuse que la nôtre? N’y a-t-il pas maint animal plus parfait par certains côtés que l’homme lui-même? N’envions-nous pas la force du.lion, l’œil de l’aigle, les ailes de tous les oiseaux ? Mais, quand il existerait.des bêtes qui nous égaleraient et nous surpasseraient sous le rapport des qualités physiques, aucun homme sérieux ne craindrait que sa dignité en fût compromise, car elle repose sur de tout autres fondements. « Je l’avoue, » dit Sydney Smith, « je me sens si parfaitement assuré 'de la supériorité de l’homme sur le reste de la création ; j’ai un mépris si marqué pour l’intelligence de
LEÇONS SDK LÀ SCIENCE DU LANGAGE,
X.
X.
X
* T
v
*X- ‘X X. X; ; x X X X X. x. X X x X X,
tous les babouins que j ai jamais rencontres ; je suis si ' convaincu que le singe bleu sans queue ne sera jamais notre rival en poésie, en peinture ni en musique, que je ne vois pas pourquoi on ne rendrait pas justice aiix quelques parcelles d’âme et aux lambeaux d’intelligence que les bêtes peuvent avoir. » On a blâmé la forme plaisante que cei écrivain spirituel aimait à donner à ses arguments, lors même qu’il traitait des sujets philosophiques et sacrés : mais l’enjouement ne. peut-il pas être un aussi sûr garant d’une profonde et inébranlable conviction que la réserve et la gravité ?
En ce qui concerne notre problème, il est hors de doute que certains animaux réunissent toutes les conditions physiques requises pour le langage articulé. Il n’y a pas une seule lettre de l’alphabet qu’un perroquet ne puisse être dressé à prononcer (1). Par conséquent, ce fait, que le perroquet n’a pas de langage, doit, s'expliquer par une différence entre les facultés mentales, et non entre les facultés physiques de la bête et de celles l’homme ; et c’est seulement par la comparaison des facultés mentales, telles que nous les trouvons en nous-mêmes et chez les bêtes, que nous pouvons espérer de découvrir ce qui
(1) « L’usage de la main, la marche à deux pieds,, la ressens blànce, quoique grossière, de la face, tous les actes qui peuvent résulter de cette conformité d’organisation, ont fait donner au singe le nom d’/loimne sauvage par des hommes à la vérité qui l’étaient à demi, et qui ne savaient comparer que les rapports extérieurs. Que serait-ce, si, par une combinaison de la nature aussi possible que toute autre, le singe eût la voix du perroquet, .et, comme lui, la faculLé de la parole? Le singe parlant eût rendu muette d’élon-nement l’espèce humaine entière, et l’aurait séduite au point que. le philosophe aurait eu grand’peine à -démontrer qu’avec tous ces beaux attributs humains le singe n’en était pas moins une bête. Il .est donc heureux pour notre intelligence que la nature ait séparé et placé dans deux espèces très différentes l’imitation de la parole et celle de nos gestes. » — Buffon, cité par Flourens, p, 77,
NEUVIÈME LEÇON.

* '
constitue la qualité indispensable pour posséder le langage ; celte qualité est propre à l’homme et ne se rencontre chez aucune autre créature sur la terre.
J’ai dit les [acuités mentales, et je prétends attribuer Une
" i
bonne part de ce que nous appelons nos facultés mentales aux animaux de l’ordre supérieur. Ces animaux ont la sensation, la perception, la mémoire, la volonté et Y intelligence ; seulement leur intelligence ne s’étend qu’à là comparaison ou à la combinaison de perceptions simples. Toutes ces assertions sont fondées sur des faits incontestables dont les preuves n’ont jamais été exposées, ce me semble, avec plus de lucidité et plus de force que par M. P. Flourensdansun de ses ouvrages récents (4). Certes, il ne manque pas de gens qui sont aussi tourmentés par l’idée que. les bêtes ont une âme, que d’autres le sont par « le singe bleu sans queue. » Mais ils 11e doivent s’en prendre
qu’à eux-mêmes de leurs alarmes. S’ils s’obstinent à se servir de ces mots âme et pensée sans comprendre clairement ni faire comprendre aux autres le sens qu’ils y attachent, il n’est pas étonnant qu’ils sentent un jour ces mots se dérober sous eux, et. qu’ils tombent alors dans le doute-et la perplexité. Si l’on demande simplement : « Les bêtes ont-elles une âme ? » il sera nécessairement impossible d’arriver à une solution ; car Y âme a reculant de défini. ■ O
lions différentes depuis Aristote jusqu’à Hegel, qu’on peut lui faire signifier à peu près tout ce que l’on veut. Telle a été la confusion causée par l’emploi dans les écoles de termes psychologiques mal définis, que nous voyons Descaries considérer les bêtes connue des automates-vivants, et Leibniz leur supposer non-seulement une âme, mais une âme immortelle. « Après l’erreur de ceux qui nient Dieu, dit Descartes, il n’y en a point qui éloigne plutôt les
(1) De la Raison, du Génie, et de la Folie; Paris, 1861.
✓
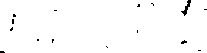
V
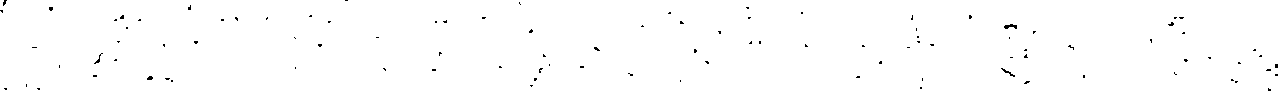
44 8 LEÇONS SUR LA SCIENCE DU LANGAGE. ‘
esprits faibles du droit chemin" de la vertu, que d’imaginer que l’âme des bêtes soit de même nature que la nôtre, et que par conséquent nous n’avons rien à craindre ni à espérer après cette vie, non plus que les mouches et les fourmis ; au lieu que, lorsqu’on sait' combien elles diffèrent, on comprend beaucoup mieux les raisons qui prouvent que la nôtre est d’une nature entièrement, indépendante du corps, et par conséquent qu’elle n’est point, sujette à mourir avec lui (1). »
L’esprit de ces remarques est. excellent, mais l’argumentation de Descartes est extrêmement faible. De ce que les bêtes n’ont pas une âme humaine il ne s’ensuit nullement quelles n’ont pas une âme ; et de ce que l’âme des bêtes est périssable on ne serait pas en droit de conclure que l’âme humaine n’est pas immortelle : d’ailleurs aucun philosophe, que je sache, n'a jamais prouvé la majeure, à savoir que l’âme des bêtes doive nécessairement être détruite et anéantie par la mort. « J’ai trouvé, » dit Leibniz, qui a défendu l’immortalité de l’âme humaine avec des arguments plus puissants que ne l’a fait Descartes lui-même, « comment les âmes des bêtes et leurs sensations ne nuisent pas à l’immortalité des âmes humaines, ou plutôt comment, rien n’est plus propre, à. établir notre immortalité naturelle que de concevoir que toutes les âmes sont impérissables (2). »
Au lieu de nous engager dans l’examen de ces contradictions qui proviennent, en grande partie de l’emploi vague de termes mal définis, voyons seulement les faits. Tout observateur impartial admettra l’exactitude des faits suivants : .
1. Les bêtes ont la vue, l’ouïe, le* goût, l’odorat et le
(i) Discours de la Méthode, ve partie (10). (-2) Leib., Opéra pliilosophica^ 1840, p. 205.
\
■ NEUVIÈME LEÇON. 419
toucher, c’est-à-dire les cinq sens que nous avons nous-mêmes, ni plus ni moins. Elles ont la sensation et la perception, ainsi que M. Flourens l’a démontré par les expériences . les plus intéressantes. Si on enlève les racines du nerf optique , la rétine de l’œil d’un oiseau cesse d’être sensible, l’iris n’est plus mobile; l’animal est aveugle, parce qu’il a perdu l’organe de la. sensation. Si les lobes cérébraux sont enlevés, ,1’œil reste sain et entier, la rétine est sensible, l’iris mobile. Dans ce cas l’œil est intact, mais l’animal ne; peut plus voir, parce qu’il a perdu les organes de la-perception.
2. Les bêtes ont des sensations de. plaisir et de
peine. Un chien qui est battu se conduit exactement comme un enfant qui est puni, et un chien que l’on caresse témoigne de sa satisfaction comme le fait un enfant dans les mêmes circonstances. Les philosophes reconnaissent que nous pouvons juger d’après des signes seulement : or, si les signes par lesquels les enfants traduisent au dehors leurs affections peuvent servir de fondement solide à nos jugements , il faut bien qu’il en soit de même des signes par lesquels les animaux manifestent leurs mouvements de douleur ou de joie. .
3. Les bêtes n’oublient pas ; ou, pour parler comme les
philosophes, les bêtes ont la mémoire. Les chiens con-
* - * . *
naissent leur maître et leur habitation ; ils laissent éclater leur joie en revoyant ceux .qui ont été bons pour eux, et ils gardent rancune pendant des années à ceux qui les ont outragés ou maltraités. Qui ne se rappelle le chien Àrgos qui fut le premier à reconnaître Ulysse quand il revint à Ithaque après sa longue absence (4)? ' . .
(-1) O'dyssêe* xvn. 300.
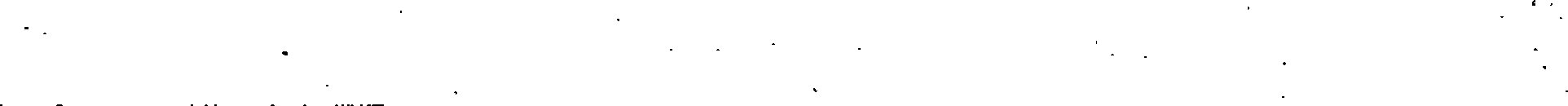
^ X v X v v v X X . N- X ' X, X 1 X v,„ 'x X * X V 'v ^ 'n v
4. Les bêtes savent établir des comparaisons et desdistinctions. Un perroquet prend une noisette, et la laisse . retomber : il a trouvé qu'elle est légère, et il n’a pu faire cette découverte qu’en comparant le poids des noisettes pleines avec celui des vides ; il la rejette, parce qu’il sait quelle n’a pas d’amande, et, pour arriver à cette conclusion, il lui a fallu faire cette combinaison d’idées à laquelle, les logiciens donneraient le titre pompeux de syllogisme,:/à savoir, « toutes les noisettes légères sont vides; celle-ci est légère, donc elle est vide. »
5. Les bêtes ont une volonté, et c’est ce que savent fort bien ceux qui ont jamais monté un cheval rétif.
6. Les bêtes donnent des signes de honte et de-noble orgueil. Quiconque a vu un chien, les yeux joyeux et étincelants, rapporter une pièce de gibier aux pieds de son maître* ou se dérober, la queue basse, à son appel, avouera que ces signes n’admettent qu’une seule interprétation. La difficulté commence' quand nous nous servons du langage philosophique, et que
nous attribuons aux bêtes le sens moral, la conscience,
•
et la faculté de distinguer entre le bien et le mal : puisqu’il n’y- a rien-à gagner à l’emploi de. ces. termes, des écoles, mieux vaut les éviter entièrement.
7. Les bêtes donnent des signes d’affection et de ressen
timent; Il y a des exemples bien avérés de chiens qui ont suivi leur maître à la tombe, et se sont ensuite laissés mourir de faim ; et il n’est pas moins certain'qu'ils guettent l’occasion de se venger de ceux qui sont devenus l’objet dé leur haine* .
Si, en présence de tous ces faits, on persiste à refuser aux bêles la sensation, la perception, la mémoire, la volonté et l’intelligence, il faut pouvoir avancer des raisons bien puissantes pour légitimer une interprétation si diffé-renie donnée aux signes observés chez les animaux et aux signés observés chez les hommes (4).
Certains philosophes s’imaginent avoir tout expliqué,
quand ils attribuent aux bêtes l’instinct au lieu de l’in tel-:
* *■ - .
ligence. Mais, assurément, si nous prenons ces deux mots dans leur sens ordinaire, les facultés qu’ils expriment ne s’exclüent pas l’une l’autre (2). Il y a des instincts dans l’homme aussi bien qûe chez les bêtes. C’est par instinct que l’enfant prend le sein de sa mère> de même que c’est par instinct que l’araignée file sa toile, et que l’abeille construit sa cellule. Il ne vient à l’idée de personne de supposer dans l’enfant la connaissance de la physiologie, parce qu’il met en jeu les muscles nécessaires pour téter ; pas plus que nous ne prétendons attribuer à l’araignée la connaissance de la mécanique,'ni à l’abeille la connais^ sance de la géométrie, parce, que, sans l’étude de ces sciences, il nous serait impossible à nous de faire ce qu’elles font. Mais si nous déchirons la toile de l’araignée, et que nous voyions le petit insecte examiner ces dégâts et chercher à les réparer, ou renoncer de désespoir à ce travail (3), n’est-il pas manifeste que l’instinct qui guida l’araignée quand elle tissa sa toile est maintenant, dirigé et modifié par l’observation, la: comparaison, la réflexion et le jugement ? L’instinct, soit mécanique soit moral, joue
un plus grand rôle chez les animaux que chez l’homme ;
. _ - * %
mais, de même que l’intelligence, l'instinct est commun à l’homme et aux animaux........ • ■
(1) Voj^ez toutes ces questions admirablement discutées par por
phyre, dans ses quatre livres sur. « VAbstinence de la nourriture animale, » 1. III.. . . .
(2) « Nous trouvons chez lés autres animaux des signes. manifestes de raisonnement; et de l'existence de ce. raisonnement..il m’est aussi impossible de douter que de celle des instincts qui s'y mêlent. « Brown, Works, I, 446.
(3) Flourens, De la Raison, etc., p. SI.' - ■- ^
Où. donc est la différence entre les bêtes et l’homme (4 )? Qu'y a-t-il que l’homme puisse faire, et dont nous ne dé
couvrions ni rudiments ni indices dans tout le reste du
règne, animal? Je réponds sans hésitation : la grande^ l’infranchissable barrière entre les bêtes et l’homme, c’est le langage. L’homme parle, et aucun animal n'a jamais proféré un mot : c’est là l’abîme qui nous sépare, et que rien ne pourra jamais combler. Voilà le simple fait par lequel nous répondons à ceux qui nous parlent de progrès et de développement; qui croient trouver chez les singes les rudiments, au moins, de toutes les facultés humaines^ et qui voudraient ne pas renoncer à la possibilité que l’homme ne soit qu’un animal privilégié, le vainqueur heureux dans la lutte vitale. Le langage est quelque chose de plus palpable qu’un pli du cerveau ou qu’un angle du crâne. Il n’y a pas de subtilités qui puissent ici nous faire prendre le change ; et toutes les analyses et tous les procédés du monde ne tireront jamais des mots significatifs du chant des oiseaux, ni des cris des ani
maux.
Le langage, toutefois, n’est que le signe extérieur. Nous pouvons, dans nos discussions, nous appuyer sur le fait du langage, et défier nos adversaires de nous citer rien
(i) « Accorder que l’on trouve chez les bêtes certaines opérations mentales qui leur sont communes avec l’homme ; que les bêtes ont des désirs, des affections, la mémoire, l’imagination simple où la faculté de reproduire dans des tableaux de l’esprit les sensations passées, et qu’elles forment des comparaisons et des jugements ; c’est reconnaître que l’intelligence des bêtes agit réellement, autant que nous pouvons en juger, comme l’intelligence humaine. En effet, les logiciens nous disent que tout raisonnement peut se réduire à une série de jugements simples; et Aristote déclare que lafréminiscençe elle-même (que nous prenons pour la reproduction, dans l’esprit des sensations passées), est une sorte.de raisonnement: to àvap.tiy.v^cîxso'ûat lemv oîov euXXoyt-e.uoç xiçc » Asa Grey, Natural Sélection, etc., p. 58, note.
. . NEUVIÈME LEÇON. . 423
- ' ' , « ■ ....
d’analogue chez les bêles : mais, si nos arguments n’allaient pas plus avant, si Fart d’employer des sons articu^ lés pour communiquer nos impressions était le seul trait qui témoignât de notre supériorité sur le reste de la création, on comprendrait que nous ne fussions pas sans inquiétude en voyant le gorile nous approcher, de si près. . ■ .
Il est hors de doute que les bêles, sans avoir I usagé des sons articulés, ont néanmoins le moyen de s’entendre entre elles. Quand une baleine est frappée, la bande tout entière, quoique disséminée au loin, est avertie immédiatement de la présence d’un ennemi ; et quand le nécro-phore rencontre le cadavre d’une taupe, il se hâte de faire connaître cette découverte, et on le voit bientôt revenir avec ses quatre compagnons (-1). Il est évident aussi que les chiens, quoiqu’ils ne parlent pas,peuvent .comprendre beaucoup de ce qu’on leur dit, et qu’ils connaissent leur propre nom et exécutent les ordres de leur maître ; d’autre part, certains oiseaux, tels que. les perroquets, peuvent prononcer tous les sons articulés. Par conséquent, bien que dans les discussions philosophiques sur la dignité de l’âme humaine, nous puissions nous retrancher derrière le.langage articulé comme dans une position inexpugna-
■ ^ H. T
ble, il est tout naturel, cependant, que pour notre Satisfaction propre nous tâchions de découvrir en quoi consiste réellement la force de notre argument ou, en d’autres termes, que nous nous efforcions de pénétrer jusqu’à cette faculté interne dont le langage est la manifestation ou le signe extérieur. .
Pour arriver à cette connaissance, nous n’avons rien dé
(1) Conscience, Boekder Natuei\ VI, cité par Marsh,, p. 32, Voyez 3ussi quelques exemples curieux recueillis par Porphyre, dans le troisième livre de son traité sur VAbstinence cle la nourriture animale. . •
,42 i
's.
LEÇONS SUR LA SCIENCE DU, LANGAGE.
V v N N ■ N r'v V v \ '
mieux à faire que d’examiner les opinions des philosophes qui ont abordé notre problème par un autre, côté, et quij au lieu de rechercher les signes extérieurs et sensibles de la différence entre l’homme et la brute, ont étudié les facultés de l’esprit humain, et essayé de déterminer le point où l’homme s’élève au-dessus de la limite de rin-telligence des bêtes. Ce point, si on parvient à le déterminer exactement, devra coïncider avec l’apparition du langage; et dans cette coïncidence nous devrons trouver la solution du problème qui nous occupe en ce moment, •
Ici je demanderai la permission de lire, un extrait de Y Essai de Locke sur V entendement humain,
Après avèir expliqué comment sont formées les idées universelles ; comment T esprit, ayant observé la même couleur dans la craie, dans la neige et dans le lait, comprend ces perceptions simples sous la conception générale de blancheur, Locke ajoute : << Si l’on peut douter que les bêtes composent et étendent leurs idées de cette manière, à un certain degré, je crois être en droit d’affirmer que la puissance de former des abstractions ne leur a pas été accordée, et que cette faculté de former des idées générales est ce .qui met une parfaite distinctionentre l’homm e et les brutes, : et ce qui donne à rintelligence humaine une excellence à laquelle les brutes ne sauraient atteindre (4). »
Si Locke est dans le vrai en considérant la puissance de former des idées générales comme la prérogative qui distingue l’homme des autres animaux, et si nous-mêmes nous ne nous trompons pas en donnant le langage comme la grande et palpable distinction entre l’homme et les bêtes, ne s’ensuit-il pas que le langage est le signe exté-
(I) Liv. II, chap. xi, § ÎO.
NEUVIÈME LEÇON. 425
r ' « O ■
rieur et la réalisation de cette faculté interne que l’on nomme souvent la faculté de l’abstraction, mais qui est encore plus connue sous le nom familier de raison ?
Rappelons-nous maintenant le résultat auquel nous sommes arrivés dans nos leçons précédentes. Après avoir donné l’explication de tout ce qu’il est possible d’expliquer dans le développement du langage, il nous est resté, en dernière analyse, comme seul résidu inexplicable,' ce que nous avons appelé les racines, lesquelles composent les éléments constitutifs de toutes les langues connues. Cette découverte simplifie singulièrement la question que, nous nous proposons de résoudre, et ôte tout fondement à ces descriptions poétiques et à ces transports d’admiration qui servent invariablement de préambule à la thèse de la révélation divine du langage. Pour nous il ne peut plus être question désormais de « cet instrument merveilleux, qui reproduit avec fidélité tous les objets-de nos sens -; qui est l’image vivante de l’univers ; qui donne une forme aux sentiments les plus délicats de notre âme, et un corps aux rêves les plus sublimes de notre imagination ; qui place sur divers plans, selon les règles de la perspective, le passé, le présent et le futur, et répand sur tout le tableau les nuances variées de la certitude, du doute et de la contingence. » Il est très-vrai que le langage accomplit toutes ces belles choses, mais il le fait sans le secours du merveilleux, du moins si nous prenons ce mot dans le sens qu’on lui attribue dans les Contes dés mille et une nuits. « L’esprit méditatif, dit le docteur Fer-guson, en contemplant les plus sublimes conceptions exprimées par le langage et en se reportant à ses humbles débuts, est saisi d’étonnement, comme un voyageur qui, après avoir gravi insensiblement une montagne élevée, viendrait tout à coup à plonger ses regards dans l’espace d’une hauteur où il aurait peine à croire qu’il fût arrivé
sans mi secours surnaturel. » Certaines personnes éprouvent un désenchantement quand l’histoire leur fait perdre les nobles illusions où elles se complaisent. Elles préfèrent l’inintelligible qu’elles peuvent admirer à l’intelligible quelles peuvent seulement comprendre : mais, pour un esprit sérieux et mûr, la réalité a plus de charmes que la fiction, et la simplicité plus de merveilles que la complexité. Auprès de la poésie de Gœthe, des racines peuvent sembler fort arides ; et pourtant, il y a quelque chose de plus vraiment admirable et étonnant dans une racine que dans tous les poèmes lyriques du monde.
Qu’est-ce donc que ces racines ? Dans nos langues modernes, les racines ne peuvent être dégagées , de leur enveloppe que par une analyse scientifique; et, en.remontant même jusqu’au sanscrit, nous pouvons dire que nous ne trouvons aucune racine qui soit employée comme nom ou comme verbe. Mais tel était, à l’origine, le rôle des racines ; et par bonheur pour nos études, le chinois nous représente encore cette période monosyllabique, qui a été le commencement du langage humain aussi sûrement. que les roches granitiques ont formé la première des couches terrestres. La. racine aryenne DA, donner, se retrouve comme substantif dans le sanscrit dâ-nam, le latin donurn, don; comme verbe dans le sanscrit dada-mi, le grec di-dô-mi, le latin do, je donne : mais la racine DA ne peut jamais être employée toute seule. En chinois, au contraire, la racine TA est usitée comme substantif, pour signifier grandeur ; comme verbe, pour signifier être grand ; et comme adverbe, pour signifier grande-mént ou beaucoup..Les racines ne sont donc pas, ainsi
" T
qu’on l’affirme souvent, de pures abstractions scientifiques : elles ont été originairement, dès mots véritables. Voici donc la question que nous nous posons, et à laquelle nous voulons trouver la réponse : Quelle est la phase de
notre esprit à laquelle répondent ces racines, envisagées comme les germes de la parole humaine ? •
Deux solutions ont été proposées pour ce problème : la théorie de. l’onomatopée ou imitation, et celle de l'interjection.
Dans la première hypothèse, les racines seraient des imitations de sons ; dans la seconde, elles seraient des interjections ou des cris involontaires. La théorie de l’onomatopée fut en grande faveur dans l’école du dix-huitième siècle, et, comme elle est encore adoptée par beaucoup de savants et de philosophes distingués, elle mérite notre examen le plus attentif. -On suppose donc que l’homme, étant encore dans l’état de mutisme, entendit les cris des oiseaux et des animaux, le mugissement de la mer, le bruissement de la forêt, le murmure du ruisseau, le souffle de la brise et le grondement du tonnerre. Il s’efforça d’imiter ces bruits, et, trouvant que ces cris imitatifs étaient utiles comme signes des objets qui les avaient suggérés, il poursuivit cette idée et élabora le langage^ Cette doctrine fut développée et défendue avec grand talent par Herder (4), «L’homme, dit-il, fait preuve d’une réflexion consciente quand son âme agit librement pour que, dans cette mer de sensations qui l’inonde par tous les sens du corps, elle puisse séparer une vague de toutes, les autres, et la fixer du regard en ayant conscience quelle considère cette seule et unique vague. L’homme fait preuve d’une réflexion consciente lorsqu’au milieu de ces images innombrables qui flottent confusément autour de
lui comme dans les rêves de son sommeil, il peut, en
■ - , \ ■
(I) Pour plus de détails sur les opinions de Herder et d’autres philosophes, concernant l’origine du langage, voir l’opuscule de M. Steinthal, Ber Ursprung der Sprache. [Sur la théorie de l’onorhatopéé, voir également M. Renan, Origine du Langage^ pp. 13S-149. Tr.J ;
quelque sorte, se réveiller tout à coup, s’arrêter à une seule de ces images, y attacher un regard Iran quille et
■ ■ _ * h '
pénétrant, et y découvrir les signes distinctifs qui lui serviront à la reconnaître à l’avenir. Enfin l’homme fait preuve d’uiie réflexion consciente quand, après avoir saisi
^ * A *
vivement et nettement tous les traits d’un objet, il y sait
r *
discerner les traits caractéristiques qui l’empêcheront de confondre cet objet avec tout autre. » Ainsi, par exemple,
« l’homme voit un agneau. Il ne le voit pas comme le verrait le loup vorace. À la vue de l’agneau, l’homme n’est troublé par aucun instinct irrésistible : il veut connaître cet animal qu’il voit pour, la première fois, mais il ne se sent pas attiré vers lui par ses appétits sensuels. L’agneau est là, tel que les sens de l’homme le lui représentent, c’est-àrdire couvert d’une laine blanche et douce. L’âme consciente et réfléchie cherche dans l’agneau une marque distinctive ; — l’agneau bêle ! —Voilà la marque trouvée. Le bêlement, qui fit sur l’âme l’impression la plus forte et toute distincte des autres impressions soit de la vue soit du toucher, reste dans l’esprit de l’observateur comme irait caractéristique de l’agneau. L’agneau revient avec sa toison blanche et douce.. L’homme le regarde, le. touche, réfléchit et y cherche une marque. L’agneau se met à bêler, el maintenant Thomme l’a reconnu* Àh ! tu es ranimai qui bêle 1 se dit l’âme en elle-même ; et le son du bêlement qui l’avait frappée comme signe distinctif de l’agneau devient l’appellation de l’animal. Ce son était la marque comprise par l’esprit, c’est-à-. dire le mot; et qu’est-ce que le langage humain tout entier, sinon une collection de mots formés de cette manière?» .
À cela, nous répondons qu’encore que toutes les langues possèdent un certain nombre de mots formés par onomatopée, ces mots ne constituent dans aucune langue qu’une
bien faible minorité du vocabulaire entier. Ce sont les jouets et non les outils du langage; et toute tentative pour ramener à des racines imitatives les mots-les plus communs et les plus nécessaires, ne pourra jamais être qu’en pure perte. Herder lui-même, après avoir été le vigoureux défenseur de la théorie de l’onomatopée, et avoir obtenu le prix offert par l’Académie de Berlin pour le meilleur essai sur l’origine du langage, renonça ouvertement à ce système sur la .fin de sa vie, et se jeta de désespoir dans les bras de ceux qui regardaient le langage comme ayant été révélé à l’homme par un miracle. Nous ne nions, pas, et nous ne pouvons pas nier la possibilité de la formation d’une langue par Je procédé de l’imitation : tout ce que nous affirmons, c’est que jusqu’à présent on n’a découvert aucune langue qui ait été ainsi formée. . . . •
On raconte (1) qu’un Anglais voyageant en Chine,- et désirant savoir si un plat qui lui. était servi, et qui lui inspirait certaines inquiétudes, était du canard, demanda à un Chinois : Quack-quaek ? et qu’il en reçut immédiatement
i-
cette réponse très-clairè et nette : Owah-ouah! Cette demande et cette réponse valaient bien sans doute la conversation la plus éloquente sur le même sujet entre un Anglais et un garçon d’hôtel français, mais je doute qu’elles méritent le nom de langage.
En effet, nous disons un chien et non un ouah-ouah, une vache et non un meum, un agneau et non un bêê; et nous pouvons, constater le même fait dans les langues anciennes, telles que lé sanscrit, le grec et le latin. S’il est une classe de mots à la formation desquels a dû présider la loi de l’onomatopée, c’est- sans contredit celle des noms d’animaux cependant nous chercherions en vain la
(1) Farrar, Essay on the Origin of Language, p. 74,
■/-
\
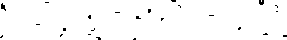
LEÇONS SUR LA.SCIENCE DB: LANGAGE.
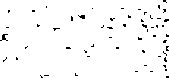
430
X X.
moindre ressemblance entre poule et gloussement ou caquetage, entre pigeon et roucoulement, entre pourceau et grognement, entre chien et aboiement ou glapissement.
Il y a assurément certains noms, tels que coucou (f), qui ont été évidemment formés par l’imitation des sons. Mais tous ces mots, comme des fleurs artificielles, n’ont ni racine ni sève. Ils sont stériles, et ne servent jamais qu’à exprimer l’objet unique qu’ils imitent. Si vous vous rappelez la quantité de rejetons qu’a donnés la racine spas, voir, vous serez frappés de la différence qui existe entre la création d’un nom comme coucou et la végétation naturelle des mots.
Comparons ensemble les deux mots anglais cuckoo, coucou, et raven, corbeau. Cuckoo n’est évidemment qu’une imitation du cri de l’oiseau, tandis que dans les appellations correspondantes en sanscrit, en grec èt en latin, nous voyons un suffixe dérivé s’ajouter à l’élément imitatif; nous avons en sanscrit kokila, en grec kokkyæ, en latin cuculus (2). Cuckoo est un mot moderne qui s’est substitué à l’anglo-saxon geac (l’allemand gauch), et puisque ce mot est une onomatopée pure et simple, il ne peut pas être sujet à la loi des permutations de Grimm : én
(1) [M. Max Millier cite encore whip-poor-will (liu. « fouettez le pauvre Guillaume »), nom donné à un oiseau de l’Amérique du-Sud, dont le cri ressemble à ces Lrois mots anglais. Le poète Wordswortli en parle dans une charmante pièce de vers où il montre l’imagination trouvant « dans un simple cri de la foret l’écho de la misère humaine : « . :
, Througli border wlds wliere rmked Iudians slray, .
Myriadé of notes attest ber subtle skili ; *
A feathered task-masler cries, « Work away ! n . And» in thy itération, « Whip poor Will, »
Is heard the spii il of a ioil-worn slave, *
Lashed ont of life, not quiet in the grave I
(Wôrdsworth, Pcetical Works, i83ô3 lï, p, l. Tr.]
- (2) Pott, Elymologische For&chungen, I, p. 87. ; Zeitschrift, ill, p. 43.

outre, comme il n*exprime uniquement que le cri d’un oiseau particulier, il ne saurait jamais signifier une qualité générale appartenant à différents animaux ; et s’il était possible de tirer des dérivés de ce mot, ils ne pourraient en aucun cas exprimer autre chose qu’une ressemblance métaphorique avec le coucou. Les mêmes remarques s’appliquent au mot anglais code,coq, le sanscrit kuk-ku£a. Ici également, nous ne devons pas nous attendre à voir observer la loi de G-rimm, car les deux mots n’étaient destinés qu’à reproduire le cri de l’oiseau ; et, cette intention continuant à se faire sentir, ces mots n’étaient guère exposés aux ravages de l’altération phonétique. Le sanscrit kukku^a n’a pas été produit par une racine ; il répète simplement le cri du coq : par conséquent ce mot ne peut donner naissance qua des expressions métaphoriques, telles que coquet, originairement celui qui se pavane, qui fait le beau comme le coq; coquetterie, cocarde, primitivement touffe de plumes de coq que les soldats de certaines nations portaient sur leurs bonnets ; et coquelicot, qui signifiait d’abord crête de coq, et s’est dit ensuite du pavot sauvage à cause de sa ressemblance avec la crête du coq. •
Examinons maintenant le mot raven. Au premier moment, on peut être tenté de croire que ce nom n’est, également qu’une onomatopée. Certaines personnes s’imaginent entendre dans raven une sorte d’écho du cri rauque poussé par le corbeau ; et celte ressemblance paraît encore plus sensible quand nous rapprochons raven de l’anglo-saxon hrafn, l’allemand robe, l’ancien haut-allemand raban. C’est ainsi que l’on suppose également que le sanscrit kârava, le latin corvus, l’anglais crow et le grec korônë rappellent tous plus ou moins le ramage peu mélodieux de maître corbeau. Mais en y regardant de plus près, nous trouvons que ces mots, tant semblables qu'ils
soient pour le son, sont issus de sources toutes différentes. L’anglais crow ne peut en aucune façon être rattaché à corvus., pour cette simple raison que d’après la loi de Grimm un c anglais ne saurait représenter un c latin. Quoique raven diffère beaucoup plus, en apparence, de corvus que le mot crow, il y aurait cependant beaucoup moins de difficulté réelle à le faire remonter à la source d’où est sorti le latin corvus. Car raven est l’anglo-saxon
' ■ 9
hraefen ou hraefn, dont la première syllabe liras serait une permutation régulière pour le latin cor. Les axis des linguistes sont fort partagés sur la racine ou les racines d’où sont dérivés les différents noms du corbeau dans les
h
dialectes aryen si Ceux qui regardent le sanscrit comme la forme la plus primitive du langage aryen, sont disposés à admettre que le sanscrit kârava est le type originel de toutes ces appellations; et. comme les étymologistes indiens font venir kârava de kâ-rava, faire un bruit désagréable (i), on a donné ru, faire un bruit, racine de rava. bruit, comme, étymologie des mots correspondants en latin, en grec et en allemand. Ce n’est pas ici le lieu d’examiner si ces composés tels que kâ-rava, dans lesquels on attribue à. l’élément initial kâ ou ku le rôle du grec drys ou de l’anglais mis, sont aussi: communs en
sanscrit que certains savants le supposent. Cette question
r ■ ••
a été souvent débattue, et quoiqu’il soit impossible de nier l'existence de tels composés en sanscrit, et surtout en sanscrit moderne, je ne connais aucun exemple bien constaté dun mot ainsi formé qui ait pénétré en grec, en latin ou en allemand. Si donc kârava, corvus, korônë et
w
hraefen sont des mots congénères, il faut nécessairement regarder le k comme faisant partie du radical, et dériver tous ces mots d’une racine kru, forme secondaire de la
(1) Voir Boehtlingk et Roth, Dictionnaire sanscrit, à ce mot.
racine ru. Celle racine km, ou sous sa forme plus primitive ru (rauti et ravîti), n’esl pas une simple imi-lation du cri du corbeau ; elle comprend beaucoup de cris, depuis les plus doux jusqu’aux plus désagréables, et elle aurait pu tout aussi bien désigner le rossignol que le corbeau.
En sanscrit la racine ru s’applique, dans ses dérivés verbaux et nominaux, au gazouillement des oiseaux, au bourdonnement des abeilles, à l’aboiement des chiens, au 'beuglement.'des vaches, au chuchotement de l’homme et aux sourds gémissements des arbres (1). Cette même racine a donné en latin mucus, rauque, elrumor, cri, murmure ; et en allemand rumen, parler à voix basse, et runa, mystère. Le latin lamentum présuppose une formeplus primitive, lammentwn ou ravimenlum, car il ne me semble pas que nous devions nécessairement dériver ce nom de la racine secondaire kru, kr.a v, krâ v, et puis admettre qu’on a laissé tomber la gutturale initiale de crammentum, d’autant plus que cette même gutturale est restée dans clamare. Il est Vrai, cependant, que nous retrouvons cette racine ru sous bien des formes secondaires. Par l’addition d’un k initial, elle nous donne la racine kru, klu , bien connue par ses nombreux rejetons, tels que les mots grecs klyô, klytôs ; les mots latins cluo, mclüus, cliens ; l’anglais loud, à haute voix, et le slave slava, gloire (2). Par l’addition d’une lettre finale, ru devient en sanscrit
t , ■ ,
rud , crier, et en latin rugdans le verbe rugirè, rugir. En ajoutant à ru une initiale et une finale, nous obtenons le sanscrit 1er us,, pousser des cris, le grec kraugë, cri et le-
(i) Cf. Hitopadèsa, 1, 76. où rauti est employé pour exprimer le bourdonnement des moucherons et les flatteries adressées doucement à Poreille par un ennemi.
(à) Le causatif de sru, entendre, serait sràvayâmi, je fais-gothique hrukjan, chanter (en parlant au coq) (■!). Dans le sanscrit s ru et dans le grec klyo, nous retrouvons encore la même racine avec la signification à’entendre, et nous n’avons pas de peine à comprëndre comment a dû lui venir ce sens dérivé, puisque, quand il s’agissait de choisir un bruit dans le lointain, l’homme qui l’entendait le premier pouvait tout naturellement dire « je résonne, » car ses oreilles étaient frappées et résonnaient ; et quand une fois ce verbe eut pris un sens transitif, il pouvait bien être usité dans des expressions telles que le y.)S/QL y.îv d'Homère ou que le sanscrit srudhi, écoutez !
Toutefois , quoique la. signification de le ara va, de corvus, de korônêet de hraefen ne s’oppose aucunement à ce que nous fassions dériver ces mots d’une racine kru, signifiant résonner, je n'ai rencontré nulle part une explication qui rende un compte exact du procédé étymologique au moyen duquel kâ ravà a pu être formé de kru. Nul doute que kru aurait pu donner brava; mais si nous admettons une corruption dialectale de krava en karva, et de karva en k ara va, il faut dès-lors renoncer à toute dérivation étymologique. S’ensuit-il que nous devions regarder kârava comme n’étant pas un dérivé grammatical, mais une simple imitation de cor cor, le cri du corbeau ? je ne le pense pas, car kârava pourrait bien être un dérivé régulier du sanscrit kâru. Ce mot kâru se trouve dans les hymnes védiques et signifie
■ .. * _ ■ j L
« celui qui chante les louanges des dieux, » littéralement
entendre Est-ce l’ancien haut-allemand hruofan, l’allemand moderne rufen? Voyez Grimm , Deutsche Grammatik, vol. I, seconde édition, p. iOü'3. Heyse, Handioorterbuch der Deutschen Sprache, s. v Rufen. Heyse compare le latin crcpare, qui, dans increpare, blâmer, a le même sens que le mot de l’ancien islandais, hrôpa.
(1) Voyez Curlius, Grundzüoe der Griechischen Eiymoloqie, 2* édition, p.,468. . , •
« celui qui crie. » 11 vient de la racine kar, crier, louer, raconter, d’où dérivent également le mot védique kîri, poète, kîrti, gloire, et kîrtavali, il loue (1). Kâru, venant de kar, signifiait donc originairement un crieur (comme le grec kêryæ, hérault) (2), et son dérivé kâ r a va se disait par conséquent du corbeau dans le sens.général de l’oiseau qui crie.
Il nous est possible de rattacher tous les autres noms du corbeau à cette même racine ka r. Ainsi cornus vient
■s.
de kar comme tor-vus de tar (3); kor-ônê de kar comme chelônë de har(l-), etc. L’anglo-saxon hraefen, de même que l’ancien haut-allemand hraban, seraient représentés en sanscrit par des formes telles que kar-van ou kar-van-a; tandis que l’anglais rook « freux », l’anglo-saxon hroc, l’ancien haut-allemand hraoh, sembleraient venir d’une racine complètement différente, à savoir le sanscrit k ru s.
Ainsi que je l’ai déjà fait observer, nous ne saurions faire venir de la même racine kar l’anglais crow, l'anglo-saxon crww. Comme ce mot commence en anglo-saxon par une muette forte, les formes correspondantes en sanscrit devraient commencer par une douce du même ordre. Or il existe en sanscrit une racine gar, signifiant crier, louer, d’où viennent le sanscrit gir, voix, le grec gërys, voix, le latin garrulus. De celte même racine dérivenlle grec géranos, grue, l’anglo-saxon mm, et le nom latin du coq, gallus au lieu de gar rus. On a cherché à faire remonter à
(1) Voir Boehllingk et RoLh, Dictionnaire sanscrit, au mol kar, 2. Lassen, Anthot., 203.
(2) Bopp, Grammaire comparée, § 949. ■ •
(3) Bopp, Grammaire comparée, §9i3. '
(4) Bopp,' Grammaire comparée, § 837. — Curlius, Grundziige, I,
p. 167. — Hugo Weber, dans Kuhn, Zeitschrift, X, p. 257. . ;
£36 LEÇONS SUR LA SCIENCE DU LANGAGE.
: x x '' v x X X -, -, , N -, -, v
cette même source Je nom : anglais du rossignol nightingale, l’ancien haut-allemand nahtigal, mais la loi de Grimm ne nous permet pas .d’adopter cette étymologie (-1). Crow a pu venir de cette racine gar ou gai, mais non de corvus, de kordx ni de kârava, encore moins de cor: cor, le prétendu cri du corbeau. . :
Ces remarques feront ressortir la différence qui existe entre la.formation du mot raven et celle du mot coucou. Raven signifie le crieur, et aurait pu par conséquent servir de désignation à beaucoup d’autres oiseaux, mais il devint le terme consacré par la tradition pour en désigner un seul. Coucou au contraire n’a jamais pu être que le nom de l’oiseau dont il imite le cri ; et tandis que raven appartient a une tige d’où sont sorties tant, de branches diverses, coucou reste stérile et sec comme , un pieu planté dans une haie vive (2). ..
Il est curieux de remarquer combien on s’abuse facilement dès que l’on adopte ce système de l’onomatopée. Quel est l’Ànglaisquine s’imagine entendre danslemoU/«mde?% tonnerre, une imitation de ce sourd roulement que les anciens Allemand s attribuaientà leur dieu Thor jouant aux quilles? Pourtant thunder, l’anglo-saxon thunor, a évidemmentla
(1) Cultras, Grundzüge, 1, pp 143,147. -
(u2) On ne lira pas sans intérêt les observations suivantes sur la théorie de l’onomatopée que j’extrais du Nirukta, de Yâska, ouvrage antérieur à Pànini, et qui, par conséquent, date au moins du quatrième siècle avant notre ère. : • ■
Après avoir fait remarquer que certains noms, tels que lion et tigre, ou chien et corbeau, peuvent s'appliquer à l’homme, soit comme termes d’admiration ou de mépris, Yâska ajoute : a Itâka est une imitation du cri du corbeau (kâku-kâku, selon Durga), et beaucoup de noms d’oiseaux ont été formés de la même manière. Cependant Aupamanyâva dit que les mots ne sont jamais formés par imitation de sons. 11 dérive donc kâka, corbeau, de apakâl ajritavya. c’est-à-dire Pbiseaù qu'on doit chasser. De même, il fait venir'tittiri, perdrix, de.tar, sauter, ou de. tila-mâtra/citra, tacheté,, etc,.» ... . . : . .
même origine que le latin tonitru. Leur racine commune est tan, tendre, étendre, d’où viennent le grec fcmos(le ton étant produit par la tension et la vibration des cordes) et le latin ^o?zft?'e (/l). En sanscrit le bruit du tonnerre est', exprimé à l’aide de cette même racine tan, mais, dans les dérivés tanyu, tan y alu et tanayitnu, il ny a rien qui nous rappelle ce grondement que Ton croit entendre dans le latin tonitru et dans l’anglais thunder (2). La même racine tan a donné naissance à d’autres dérivés qui ne sont rien moins que rudes et bruyants; il nous-suffira de citer le latin tener, le français tendre, l’anglais lender; De.même que tennis, que nous retrouvons dans le sanscrit ta nu et dans l’anglais thinr ce mot tener a signifié originairement ce qui était étendu sur une plus grande surface, et il est venu par la suite à signifier mince etpu is délicat. Si le tonnerre avait frappé les hommes primitifs comme étant un sourd grondement, if serait difficile d’expliquer les liens de parenté qui rattachent thunder ou tonitru à thin et à tener.
N’est-on pas disposé également à trouver je ne sais quoi de doux et d’agréable dans les mots français sucre et sucré? cependant le sucre nous est venu'de l’Inde, et là ;son nom était sarkhara qui ne sonne pas fort doucement à l’oreille. Ce sarkhara est le même mot que sucre et que l’anglais sugar: il avait passé en latin sous forme , de saccharum, et nous disons encore une substance sac-
T p
(1) Homère, IL xvi, 365 : ote ts Zeuç XcdÀaTca Cf. Grimm,
Namen des Donner s, p. 8. - •
(2) Une racine secondaire est stan, résonner, qui nous a donné en sanscrit slanitam, le craquement du tonnerre ; s tana.j’-itnu, tonnerre, éclair, nuage (voir lé Dictionnaire de Wilson, à ce mot) ; ie grec gtsvm, je gémis, et ses nombreux rejetons. Bopp {Grammaire comparée, § 3) et Kuhn {Zeitschrift, IV, 7) regardent stan comme étant la forme primitive. Au contraire, P oit {Etym. Fors'ch., It, 293) fait dériver stan de tan.-
charine (1). Qui ne serait disposé à voir un rapport entre l’anglais stirrup « étrier » et le yerbe to s tir « remuer. » ? Mais la plus ancienne forme anglo-saxonne de stirrup es stige-râp « corde pour monter », l’allemand steig-riemen.
Dans le mot anglais squirrel, écureuil, certaines personnes s’imaginent aussi entendre une imitation des mouvements vifs et alertes de l'intéressant petit animal. Mais nous n’avons qu’à nous reporter au grec, et là nous trouvons que skiouros est formé de deux mots parfaitement distincts, dont l’un signifie ombre et l’autre queue, l’écureuil étant appelé par les Grecs l’animal qui s’ombrage de
1 v
On a supposé également que le mot allemand kalze,
chat, est une imitation du bruit que fait le chat en soufflant et en montrant les dents quand il menace. Mais si ce bruit était représenté par la consonne sifflante, il faut remarquer que cette sifflante n’existe ni dans le latin catlus, ni dans l’allemand hâter, ni dans les mots anglais cal et külen(Z). On pourrait croire de même que Je sanscrit m â r^âra, chat, imite le rourou que font entendre tous les chats pour exprimer leur satisfaction; mais mâr^âra
dérive de la racine m ri^, nettoyer, et signifie par con-
■- - ■ - - - .. _. . .
- ■ ■ » .d séquent l’animal qui se nettoie toujours.
Il serait facile de multiplier les exemples pour montrer
avec quelle facilité nous nous laissons induire en err'eur
par la connexion constante qui s’établit pour nous entre
certains sons et certaines idées exprimées par des mots
de notre langue, et combien nous sommes disposés à
(1) « Do nome d;Amorc è si do!ce a ndire, che impossihile mi
pare, che la sua opcrazione* sia nelle più cose allro che dolce, cou-ci ossiacosachc i nomi seguilino le nominale cose, siccome è scritto : Nomina sunt consequentia rerum. » — Dante, Vita Nuova, Opéré Minori, Firenze, 1837, t. III, p. 289. .
(2) Voir Pictet, Aryas primitifs, p. 381. ; . .
trouver dans le son même des mots quelque chose qui nous révèle la signification. « Les mots eux-mêmes, dit Pope, doivent sembler l’écho delà pensée. » La plupart de ces prétendues onomatopées en anglais disparaissent dès que. nous les rapprochons des mots anglo-saxons et gothiques dont ils sont dérivés, ou des mots congénères en grec, en latin ou en sanscrit. Quand le linguiste soumet à un examen attentif tous lés mots qui sont censés avoir été formés par Limitation de certains sons, il trouve que
- ' ■ i +
le nombre des,onomatopées véritables est fort restreint, et il ne tarde pas à arriver à cette conviction, qu encore qu’un langage aurait pu être composé en reproduisant les innombrables cris et bruits de la. nature, néanmoins toutes les langues qui nous sont connues décèlent une origine différente (1). -
Aussi beaucoup de philosophes, et entre autres Con-dillae, ont-ils protesté contre un système qui placerait l’homme au-dessous même des bêtes. Pourquoi supposer, nous disent-ils, que l’homme soit allé demander des leçons aux oiseaux et aux autres animaux? ne pousse-t-il
(1) En chinois, le nombre des sons imitatifs est fort considérable. 11s sont pour la plupart écrits phonétiquement, et suivis du signe déterminatif « bouche. » Nous en citerons quelques-uns que nous mettrons en regard des sons correspondants en mantchou La différence entre les onomatopées de ces deux langues montrera combien les mômes sons frappent diversement des oreilles différentes, et avec quelle diversité ils sont reproduits par lé langage articulé : .
en chinois en mantchou
dchor dchor kôr kôr ch or chor
koungour koungour kalang kalang tsiang-lsiang kiling kiling tsiang-tsiang tang tang . -
Le chant du coq kiao kiao
Le cri de l’oie sauvage kao kao
Le bruit du vent et de la pluie siao siao
— des chariots lin lin
— des chiens attachés ensemble ling-ling
— des chaînes •
— des cloches
kan kan tung tung.
— des tambours

■N. -, S.
LEÇONS SUR LA SCIENCE DU LANGAGE.
V X. . X. x X -X. X .x.. 'V. X X. X. v X. \ X.
- v.
pas lui-même des gémissements et des cris divers que lui arrachent la douleur, la crainte ou la joie ? Ces interjections., .ces cris n’ont-ils pas été. le commencement naturel et réel du langage, et .toutes les langues humaines n ont-elles pas été formées par un procédé analogue? — Tel est en quelques mots l’argument proposé par les philosophes qui prétendent expliquer l’origine du langage par la théorie de l’interjection,
Notre réponse à cette hypothèse ne diffère point de celle que nous avons faite à la théorie précédente. Il n’est pas douteux qu’il n’y ait dans toutes les langues des interjections, dont quelques-unes peuvent devenir traditionnelles et entrer dans la composition des mots. Mais ces interjections ne se trouvent, que sur les confins, et non pas dans le cœur même du langage véritable. Le langage commence là où finissent les interjections. Il y a autant, de différence entre un véritable mot tel que « rire » et l’interjection ah 1 ah ! entre « je souffre » et rinterjection aie. aie! qu’entre le verbe « éternuer » et l’acte involontaire ou le bruit de.
I’éternUment. Nous éternuons . nous toussons et nous
. ’ ' ' ■ ‘ / P * ■
crions de la même manière que le font les animaux ; mais si Epicure nous assure que nous parlons de la même manière que; les chiens aboient, c’est-à-dire y étant poussés par la nature, notre expérience nous dit que cette assertion est erronée (4).
Horne Tooke nous fournit une excellente réponse à cette théorie de l'interjection. « Le trône du langage, dit-il, s’élève sur les ruines des interjections. Sans les admira-
(I) O y*p 3E7r(xoupoç ÏXeytv, oti .oùyi i7ïtCT-/][7.ovcoç o-jioi I'Ôsvto Ta ôvoaaTa àXXa œucrtîcwç y.ivoujisvot wç ov f^ccov-se >;a\ TiTocîpovtsç V.al jxuxoSu.£voi xat OXaKxouvTEç /.où cTEvatov-eç. — Lersh, SprachphUosoptde der Allen, J) 40, Cf. Diog. Laert., X, § 75. Cette citat'on est tirée de Produis, mais je doute qu’il ait rendu exactement la pensée d’Epicure,
NEUVIÈME LEÇON. 44f
J ’ ,tï ' '
blés ressources que nous offre le langage, les hommes n’auraient jamais eu que des interjections pour exprimer de vive voix les sensations et les sentiments de leur âme. Le hennissement du cheval, le beuglement de la vache, F aboiement du chien, le miaulement du chat, l’éternu-ment, la toux, les gémissements, les cris de terreur ou de douleur, et tous les mouvements convulsifs des muscles accompagnés de bruit, méritent, presque au même titre que les interjections, d’être appelés des parties du discours. Les interjections volontaires ne sont employées que quand l’impétuosité et la véhémence de quelque affection ou de quelque passion font revenir tout à coup l’homme à son état naturel, et lui font oublier pour un moment l’usage de la parole ; ou bien encore, quand, pour une raison ou pour une autre, l’homme n’a pas le temps de se servir du langage (4). »
Nous devons reconnaître qu’un certain langage aurait pu êlré formé avec des interjections de même qu'avec des onomatopées-; mais il ne ressemblerait aucunement aux mille langues diverses que nous trouvons répandues sur le globe. Il est évident aussi qu’une simple interjection peut être dans quelques cas plus expressive, plus concluante, plus profonde et plus éloquente qu’un long discours ; et il n’est pas moins certain que les interjections, venant s’ajouter aux gestes du corps et au jeu de la physionomie, suffiraient amplement pour atteindreie but qu’atteint le langage chez la majeure partie de l’humanité (2).
(1) Diversions of'Purley, -p. 32. ‘ .
(2) Sæpe tacens vôcem verbaque vultus habet :
. Me specta nutusque meos, vultùmque loquacem Excipe, fnrtivas et refer.ipso notas. .
Verba superciliis sine voce loquenlia dicam :
Verba legam digiüs, verba nolala mero.
. Ovide.
4
Dans son Traité sur la danse; Lucien raconte qu’un roi dont les Etals bordaient le Pont-Euxin, étant Tenu à Rome sous le règne de Néron et ayant-assisté'au spectacle donné par un pantomime, pria l’empereur de lui en faire présent afin que cet homme lui servît d’interprète auprès des peuples, ses voisins, avec qui il n’avait jamais pu entrer en relation à cause de leur diversité de langage.
Les anciens, comme tout le monde le sait, appelaient pantomime l’acteur qui savait tout exprimer sans proférer aucune parole ; et il est à peine un sentiment ou même une idée qu’on ne puisse ainsi rendre. Dans nos pays on a négligé cet art de parler sans se servir de mots ; mais dans le midi de l’Europe il est encore florissant aujourd’hui. —- S’il est vrai, donc, qu’un seul regard en dise quelquefois autant que de longs discours, il est clair que nous pourrions en mainte circonstance éviter la peine que nous impose l’emploi du langage proprement dit. Néanmoins il 11e faut, pas oublier que oh ! hem / chut ! bah ! sont tout aussi loin d’être des mots véritables, que les gestes expressifs qui accompagnent généralement ces exclamations.
Quant aux étymologies qu’on prétend donner de certains mots qui seraient dérivés de simples interjections, elles ne reposent guère que sur des illusions analogues à. celles que nous avons déjà signalées en parlant des onomatopées. On dit, par exemple, que l’idée du dégoût a son origine dans les deux sens de l’odorat et du goût, probablement dans l’odorat seul.en premier lieu ; et l’on ajoute qu'en cherchant à repousser une mauvaise odeur, nous sommes portés instinctivement à relever le nez, à expirer fortement l’air en avançant et eh comprimant les lèvres, produisant par là un bruit qui est représenté par les interjections anglaises faugh! foh! fie ! De cette interjection on propose de faire venir non-seulement les mots
fiUh, ordure, et foui, sale, impur, mais aussi, en passant
du dégoût physique à l’aversion morale, l’anglais fiend,
» ■ "
démon, l’allemand Feind. — Si cette théorie était fondée, il faudrait supposer que le mépris est surtout exprimé à l’aide d’un.F aspiré, et en soufflant avec force à travers Jes lèvres entrouvertes. Mais le fait est que fiend est un participe formé de la racine flan, haïr (le gothique fijcui) ; et comme une muette aspirée en gothique répond toujours à une forte en sanscrit, la même racine ne pourrait pas avoir dans cette dernière langue sa force expressive. Effectivement cette racine existe en sanscrit sous la forme pîy , haïr, détruire. C’est ainsi que friend, ami, est dérivé d’une racine que nous retrouvons dans le sanscrit prî, réjouir-(4). ‘
Il ne reste plus qu’une seule remarque à faire sur ces deux théories de l’interjection et de l’onomatopée, c’est que, si les éléments constitutifs du langage étaient ou de simples cris, ou des imitations des bruits de la nature, il serait difficile de comprendre pourquoi les bêtes ne posséderaient pas le langage. IXon-seulement le perroquet,
(1) La liste suivante d’interjections chinoises pourra offrir au
lecteur un certain intérêt :
* «
hu, pour exprimer la surprise:
fu, même sens; ‘ .
tsai, pour exprimer l’admiration et l’approbation ;
i, pour exprimer la détresse;
tsie, pour appeler ;
tsie tsie, pour exhorter ;
a’i, pour exprimer le mépris ;
. u-hu, pour exprimer la douleur;
shin-i, ah ! en vérité ! . •
pu sin, hélas! .
ngo, halte-là !..
Beaucoup d’interjections ont été originairement des mots ; c’est ainsi que hélas ! est dérivé de lâssus, las, fatigué, malheureux. Diez, Lexicon Elymologiçum, au mot Lasso.
f , r ► ‘,r*
' " I,
mais l’oiseau moqueur et beaucoup20 d’autres oiseaux; peuvent imiter avec une exactitude frappante20 les sons articulés et- inarticulés ; en outre, il n’est: presque pas d’animal qui ne puisse faire entendre quelques interjections telles que hiss, bêê, etc. Quelle est donc la-différence entre ces interjections, qui n’ont jamais donné naissance à un langage chez les animaux, et les racines, qui sont les germes vivants du ; langage humain ? Il est manifeste que, si la faculté d’avoir des idées générales est ce qui établit une parfaite distinction entre l’homme et la brute, un langage qui serait formé d’interjections ou par Tirni-tation des cris des animaux ne pourrait prétendre en aucune façon à être le signe extérieur de cette prérogative distinctive de l’homme. On me permettra de citer un passage de Rosenkranz : « Si la parole, dit-il, est considérée simplement comme une imitation sensible d’objets
perçus par les sens; si Ton oublie, dans sa, définition,
1 - t *
l’articulation logique qui seule, étant inhérente, fait des sons les messagers-de la pensée, alors le langage serait l’exemple le plus frappant et le plus parfait à l’appui de cette hypothèse que la connaissance résulte de la coopération mécanique de la sensation et de la réflexion. » (i).
One telle hypothèse est directement opposée au fait que nous révèle l’analyse du langage conduite d’apres les principes de la philologie comparée. Nous avons vu effectivement que les racines composent le résidu donné par cette analyse, et que chacune d’elles exprime une idée générale et non pas individuelle. Tous les noms contiennent un attribut par lequel étaient connus les objets qu’ils
désignent. : . . .
Il y a un point depuis longtemps controversé parmi les philosophes, à savoir si le langage a eu son , origine dans
NEUVIEME LEÇON.
445-
des appellations générales ou dans des noms propres (1). C’estla question du jrrimum cognitum, pour me servir du terme des écoles, et, en tâchant de l’approfondir, nous arriverons peut-être à découvrir la véritable nature de la racine, le primum appellatum.
Certains, philosophes, parmi lesquels je citerai Locke, Gondillac, . Adam Smith, Brown* et avec quelques restrictions Dugald Stewart, soutiennent que tous les termes, dans leur acception originelle; expriment des objets individuels. « Le choix de mots spéciaux, dit Adam -Smith, pour désigner des objets particuliers,: -c’est-à-dire la création de noms substantifs, a du être probablement un des premiers actes par où l’homme-a débuté dans , la formation dulangage. Deux sauvages qui auraient été élevés loin de la société des hommes, et qui n’auraient jamais appris à parler, commenceraient naturellement à composer un langage qui leur permît de se communiquer l’un à l’autre leurs besoins mutuels, en proférant certains sons toutes les fois qu’ils voudraient désigner certains objets. Les choses seules qui leur seraient les -piüs familières, et qu’ils auraient le plus souvent occasion dé nommer,: recevraient d’abord des appellations spéciales. La caverne qui- les abriterait contre les intempéries- des saisons, l’arbre dont.les fruits apaiseraient leur faim, la fontaine dont l’eau étancherait leur soif, seraient d’abord désignés par les mots caverne, arbre, fontaine, où par toute autre appellation qu’il leur plairait d’adopter dans ce jargon primitif. Plus tard, quand leur expérience s’étendrait,: et qu’ils auraient l’occasion de remarquer d’autres cavernes, d’autres arbres et d’autres fontaines* -ils donneraient tout naturellement à chacun des nouveaux objets., le. nom par;lequel ils avaient coutume d’expri-
(1 ) Sir W. Hamillon,. Lectures, Itv p ; 3Î9,

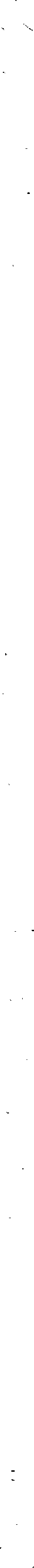
mer l’objet semblable qui les avait frappés le premier, et dont le souvenir se présenterait alors vivement à
leur mémoire____C’est de cette manière que les mots,
après avoir été originairement des noms propres consacrés à .des individus, deviennent des noms communs et s’appliquent à un grand nombre. Un enfant qui commence à parler appelle papa ou maman toutes les personnes qu’il voit venir dans sa maison, et il applique ainsi à l’espèce, tout entière les noms qu’on lui avait appris à donner à deux individus. J’ai connu un paysan qui ne savait pas le nom de la rivière qui coulait devant sa porte. C’était la rivière, disait-il, et il ne l’avait jamais entendu appeler autrement. Son expérience, à ce qu’il semble, ne lui avait fait connaître aucune autre rivière. Le mot rivière était donc évidemment pour lui un nom propre signifiant un seul objet ; et si on lui avait fait voir un autre cours d’eau, nul doute qu’il ne l’eût immédiatement
nomme une mviere.
« Si nous pouvions supposer qu’un habitant des bords de la Tamise fût assez ignorant pour ne pas connaître le mot général fleuve, et ne connût que le nom particulier Tamise, n’appellerait-il pas une Tamise tout autre fleuve qu’il verrait pour la première fois ? D’ailleurs, nous pouvons observer le fait inverse chez les hommes à qui le mot général est parfaitement connu. Un Anglais, décrivant un grand fleuve qu’il aurait vu en pays étranger, dirait tout naturellement que c’est une autre Tamise... C’est l’application du nom d’un individu à une grande multitude d’objets semblables qui rappellent par cette ressemblance l’idée de cet individu et de la dénomination qu’il a reçue, qui semble avoir suggéré l’établissement des classes et des catégories que, dans le langage scolastique, on appelait généra et species. »
La citation que nous venons de lire nous expose claire-
NEUVIEME LEÇON
447
ment une des manières de comprendre la formation de la pensée et du langage. D’autres philosophes, au contraire, soutiennent la contre-partie de ce système, et regardent les termes généraux comme constituant l’essence même du langage. « Les enfants, dit Leibniz (1) et ceux qui ne savent que peu la langue qu’ils veulent parler ou la matière dont ils veulent parler, se servent des termes généraux, comme chose, plante, animal, au lieu d’employer les termes propres qui leur manquent. El il est sûr que
tous les noms propres ou individuels ont été originaire- » . '
ment appellatifs ou généraux. » Un peu après il ajoute(2): « Ainsi, j’oserais dire que presque tous les mots sont originairement des termes généraux, parce qu’il arrivera fort rarement qu’on inventera un nom exprès sans raisons pour marquer un tel individu. On peut donc dire que les noms des individus étaient des noms d’espèces, qu’on donnait par excellence ou autrement à quelque individu, comme le nom de grosse tête à celui de toute la ville qui l’avait la plus grande ou qui était le plus considéré des grosses têtes qu’on connaissait. »
Il peut sembler présomptueux à nous de vouloir nous faire l’arbitre d’une question sur laquelle des hommes tels que Leibniz et Adam Smith ont prononcé d’une manière si affirmative et si contraire. Mais il y a deux méthodes pour juger les philosophes qui nous ont précédés. Nous pouvons écarter tout simplement leurs opinions comme erronées, et n’en tenir aucun compte, toutes les fois qu elles diffèrent des nôtres ; et c’est là assurément la manière
' "■ »
la moins satisfaisante d’étudier l’histoire de la philosophie : ou bien, nous pouvons nous efforcer d’entrer entièrement dans la pensée de ces auteurs, de nous assimiler
(1) Leibniz, Nouveaux Essais, liv. III, ch. i, p. 297 (Erdmann).
(2) ldemi ibid., c. ni. Sir "W. Hamillon, Lectures, II,- p. 324.
'V %
v s. X
en quelque sorte leurs opinion s et de les adopter au moins pour un temps, jusqu’à ce que nous découvrions le point de vue où chaque philosophe s’est placé pour observer les faits qu il a étudiés, et: que nous . voyions nous-mêmes ces faits dans le jour sous lequel ils se sont présentés à ses égards. Nous trouverons alors qu’il y a dans les divers systèmes philosophiques beaucoup moins d’erreurs grossières qu’on ne le suppose communément, et nous comprendrons, que rien n’est plus utile pour nous conduire à la connaissance'exacte de la vérité qu’une juste appréciation de l’erreur à laquelle elle est mêlée.
Or, dans la matière qui nous occupé, Adam Smith a évidemment raison de dire que la première caverne individuelle qui reçut celte appellation donna son nom à toutes les autres cavernes. C’est ainsi que tous les palais portent le nom de la première résidence impériale sur le mont Palatin, et que iown, après avoir désigné primitivement un simple enclos, est devenu en anglais l’appellation générale de toutes les villes. On néglige facilement les différences légères qui distinguent les cavernes, les
- i
villes elles palais divers, et le nom primitif se généralise de plus en plus à mesure qu’il est appliqué à des objets nouveaux. Tout cela est incontestable, et l’histoire de presque tous les substantifs confirmerait pleinement cette théorie d’Adam Smith. Mais Leibniz est également dans le vrai lorsque, remontant au-delà de l’apparition des noms tels que caverne, palais, etc., il nous explique comment ces noms ont pii être-formés.
Reportons-nous à la langue d’où nous vient :le mot caverne. Caverne se dit en latin antrum, cavea, spelunca. Or anirum a en réalité la même signification que inter num. Antar signifie en sanscrit entre et en dedans (\). Antrum
(1) Polt, Etymologische Forschungen, pp. 324 et süiv.
, - ' ‘ ' L h " - ' . ■ '
- ' . * , * , ■ ' ", - -
NEUVIÈME LEÇON. 449
a donc signifié originairement ce qui est au-dedans ou à l’intérieur soit de la terre, soit de toute autre chose. Il est donc évident que ce nom n’a pu être donné à une caverne particulière avant que l’esprit de l’homme eût conçu l’idée générale de l’existence au-dedans de quelque chose. Une fois cette idée générale conçue par l’esprit, et exprimée par la racine pronominale an ou antar, l’origine de l’appellation devient très-claire et très-intelligible. Le creux du rocher où l’homme primitif pouvait se mettre à couvert de la pluie ou se défendre contre les attaques des bêtes sauvages, était appelé son dedans, son antrum ; et dès lors les cavités semblables, qu’elles fussent creusées dans la terre ou dans un arbre, devaient être désignées par le même nom. En outre, la même idée générale devait donner .naissance à d’autres noms : aussi voyons-nous que les entrailles (inlrania in lex Salica) étaient appelées en sanscrit antra (neutre), et en grec entera, originairement choses en dedans. .. .
Passons maintement à un autre nom de la caverne : cavea cu caverna. Ici encore Adam Smith aurait parfaitement raison de dire que ce nom, lorsqu’il fut donné pour la première fois, s’appliquait à une caverne particulière, et fut ensuite étendu à d’autres cavernes. Mais Leibniz ne serait pas moins fondé à soutenir que la première cavité n’avait pu être appelée ca.fen, avant que l’idée générale du creux eût été formée dans l’esprit et eût reçu son expression phonétique çav. Nous pouvons même pénétrer -encore plus avant dans cés couches primitives de la pensée et du langage, car cavus ou creux est une idée secondaire et non pas primaire. Avant qu’une caverne reçût la dénomination de camas chose creuse, beaucoup d’autres choses creuses avaient passé sous, les yeux de l’homme. D’où donc est venu le choix de la racine cav pour désigner
une chose creuse ou un trou ? De ce que cette cavité de-
■ • 29
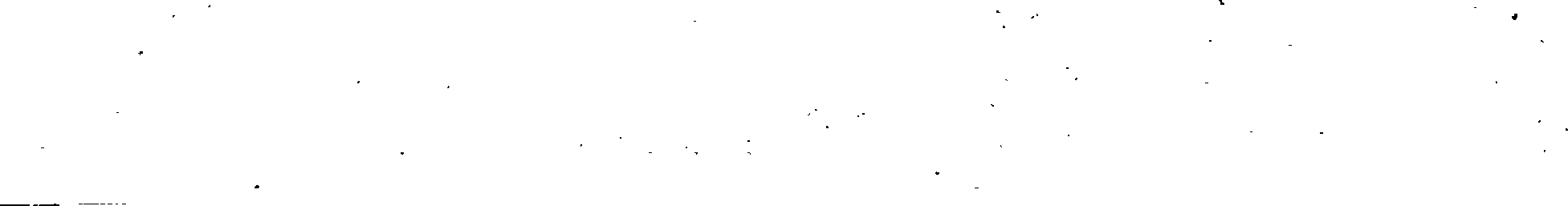
450
N. \
V -v
LEÇONS SUR LA SCIENCE DU LANGAGE.
r\ \ ^
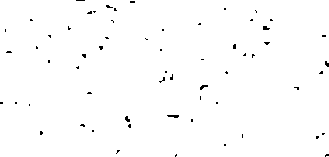
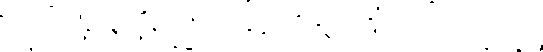

;
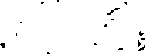
v
vait servir d’abord de lieu dé sûreté, ou de protection, el d’abri où l’on serait à couvert ; et c’est pourquoi elle fut désignée par la racine ku.ou sku qui exprimait l’idée de couvrir (4). L’idée générale de couvrir existait donc déjà dans l’esprit avant d’être appliquée aux retraites dans les rochers ou dans les arbres, et c’est seulement quand eut été créée une expression générale pour suggérer l’idée d’ün endroit sûr, d’une retraite protectrice, que les cavernes en particulier purent être appelées cavea.
Une autre forme de cavus était koîlos, signifiant également creux. La conception était originairement la même : une cavité était appelée koîlon. parce qu’elle servait a mettre à couvert. Mais ce sens de hotlon ne - tarda pas à s’étendre, et ce mot désigna successivement une caverne, une caverne voûtée, une voûte, et enfin la voûte céleste qui semble recouvrir la terre ('cœlum, ciel).
Telle est l’histoire de tous les substantifs. Ils ont tous exprimé originairement un seul des nombreux attributs qui appartiennent à un même objet, et cet attribut (que ce fût une qualité ou une action) était représenté nécessairement par Une idée générale. D’abord le mot ainsi formé ne désignait que le seul et unique objet qui l’avait suggéré; mais il ne pouvait manquer de s’étendre presque aussitôt à toute la classe dont cet objet semblait faire partie. Quand le mot nuits fut d’abord formé, nul doute qu’il ne désignât une rivière particulière, dont le nom était tiré de la racine r u ou sr-u-, courir, à cause de son eau courante. Quelquefois, cependant, un mot signifiant rivière est resté comme nom propre d’un seul cours
(I) Benfey, Griech. Wufzcl Lex., p. Ci4. De sku ou ku vien
nCttt gtxutoç 6t CÜtiSjpGSLU,
1
NEUVIÈME LEÇON. . . 451
' _ ■
* _ r
d’eau, sans jamais s’élever à la dignité d’un nom appellaiif. Ainsi Rhenus, le Rhin, signifie une chose qui se meut, qui court ; mais ce nom s’attacha à un .fleuve, et dès lors ne pouvait guère être employé pour en désigner d’autres (•]). Le Gange est le sanscrit Gangâ, littéralement le Va-va; c’est le nom du fleuve sacré et aussi de plusieurs rivières moins importantes de l’Inde (2). L’indus, le sanscrit Sindhu, de syand, arroser, signifie Yirrigatcur ; toutefois, dans ce dernier cas, le nom propre n’a pas laissé de s’étendre, et il a pu être employé comme appellation de tout grand fleuve.
La question de l’origine de nos connaissances s’offre donc à nous sous un jour nouveau et parfaitement clair. Nous commençons réellement par connaître les idées générales, et c’est par elles que nous connaissons et que nous nommons ensuite les objets individuels auxquels il nous est possible d’attacher une idée générale. Ce n’est que dans une troisième phase de notre esprit que ces objets individuels, après avoir été ainsi connus et nommés, viennent à leur tour à représenter des classes
(1) Dans le comté de Somerset, en Angleterre, les canaux qui
servent de déversoirs aux eaux trop abondantes du district de Sedgemoor sont appelés dans le pa3T.s « r bines, » de l’allemand « Rinne. » .
[Il est probable que dans les noms de l’Arno, de l’Orne, de l’Arnon et d’autres rivières de l’Europe, nous retrouvons encore la racine de Rhin. Cf. p. 710 de l’élude très-intéressante que M. Albert Réville a publiée dans la Revue des Deux-Mondes, 1er février 1864. sur les Ancêtres des Européens aux temps antéhisto-riques. Tr.] . •
(2) Le renseignement suivant m’a été envoyé d’Écosse : « Près du village de Largs, sur la côte de rA}7rshire, il y a une petite rivière que l’on appelle Gogo. La tradition locale est que ce nom provient des paroles que prononçaient7 les Écossais quand, à la bataille de Largs, ils poussaient à la mer les soldats de Haco. »
452 LEÇONS SUR LA SCIENCE DU LANGAGE. •
^ V ^ sx > sx x v- ^ N, X X X X X N. x X -X V X X X X X,
entières, et- que leurs noms propres se changent, en noms" appellatifs (1). .
. Il j a dans le langage toute une philosophie pétrifiée. Ainsi, que nous examinions le plus ancien mot qui signifie nom, nous trouvons que c’est nam an en sanscrit, ! nomcn en latin, et namo en gothique. Ce nam an est | mis pour gnâman, lequel nous a été conservé dans , le latin co-gnomen : on a laissé tomber le g dans nâman, de même que dans natus pour gnatus. Nâman dérive ; donc de la racine gnâ, connaître, et a signifié originai- ; rement ce par quoi nous connaissons une chose. Et com- i ment connaissons-nous les choses extérieures ? Nous les i apercevons par nos sens, mais nos sens ne nous ins- ; truisent de rien, si ce n’est des phénomènes qui les frappent dans les objets individuels seulement. Or la connaissance est quelque chose de plus que la sensation, \ que la perception, que le souvenir et que la comparaison.
Il est vrai que nous faisons, souvent abus des mots : nous disons qu’un chien connaît son maître, qu’un enfant à la mamelle connaît sa mère, sans que cela implique, dans : notre pensée, rien autre chose qu’une simple reconnaissance. Mais reconnaître un objet n’équivaut assurément pas à le connaître. À parler avec justesse, nous ne connaissons que ce que'nous pouvons comprendre, soit en
i
totalité, soit en partie, sous une idée plus générale. Nous
(1) Sir William Hamillon (Lectures on Metaphysics, H, p. 327) adopte une théorie intermédiaire entre celle d’Adam Smith et celle de Leibniz « Comme notre entendement, dit-il, procède du confus au distinct, du vague au défini, ainsi, dans la bouche des enfants, le langage n’exprime d’abord ni ce qui est absolument général, ni ce qui est nettement individuel: il n’exprime que le vague et le confus, desquels on déduit l’imiversel au moyen de la généralisation, et le simple et le particulier au moyen de l’individualisation. » On peut lire d’autres observations sur ce même sujet dans la Literary Gazette, 1861, p. 173.
disons alors que nous avons, non pas la perception/ mais la conception d’une chose, ou que nous en avons, une idée générale. Les faits de la nature sont perçus par nos sens : les pensées de la nature, pour emprunter une expression d’Oersted, ne peuvent être conçues que par notre raison seule (i). La base première de cette connaissance vraie, c’est une faculté de notre esprit, plus humble en apparence que certaines autres, mais qui sépare à tout jamais l’homme des autres animaux : la puissance de nommer les choses, ou de- faire que les choses puissent être connues. Nommer, c’est classer, c’est-à-dire c’est ranger les faits individuels sous des faits généraux ; et tout ce que nous connaissons, soit par notre propre expérience, soit par la science, nous ne le connaissons qu’à Laide de nos idées générales. Les autres animaux ont la sensation, la perception, la mémoire, et, en un certain sens, l’intelligence ; mais chez les bêtes toutes ces facultés ne s’exercent que sur des objets individuels. L’homme a la sensation, la .perception, la mé-moiré, l’intelligence et la raison ; et c’est sa raisoii Seule qui conçoit les idées générales (2).
(1) « Nous recevons par exemple l'impression de la chute d’une
grande masse d’eau, qui descend toujours de la même, hauteur et avec la même difficulté. Les gouttes d’eau qui jaillissent dans tous les sens, la formation de l’écume, le fracas de la chute et le bruissement des flots, sont autant de phénomènes qui sont produits par L'action constante des mêmes causes, et qui, par conséquent, sont toujours les mêmes. L’impression que tout cela produit sur nous est sans doute d’abord ressentie comme multiple, mais elle finit bientôt par ne donner qu’une impression collective, ou, en d’autres termes, toutes cés impressions isolées et diverses se présentent à nous, dans leur ensemble, comme l'œuvre d’une grande activité pl^sique dont le caractère est déterminé par la nature spéciale du lieu. Nous pouvons peut-être, - jusqu’à plus ample informé, appeler ‘pensées de la nature tout ce qui, dans les phénomènes naturels, a un caractère fixe. » Oersted, Esprit dans la Nature, p. 152. • .
(2) « Ce qui trompe l’homme, c’est qu’il voit faire aux bêtes plu-
4-54
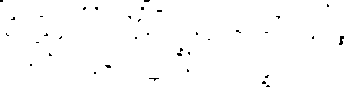
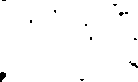
t ■ S
?
LEÇONS SUR LAsSCIENCE DU LANGAGE..
La raison ne nous élève pas seulement dun degré au-dessus de la brute : elle fait que nous appartenons a un monde différent, Nous pouvons analyser et étudier les phénomènes divers de notre vie animale, et sentir que nos sensations, nos perceptions, notre mémoire et notre intelligence font partie de nous-mêmes, mais qu elles ne constituent pas notre être intime et impérissable. Nos sens, notre mémoire et notre intelligence sont comme les lentilles d’un télescope : mais il y a un œil qui, à travers tout cela, regarde les réalités du monde extérieur : c’est notre âme raisonnable et consciente, puissance aussi distincte de nos facultés percevantes que le soleil est dis-linct du.monde qu’il remplit de lumière et de vivifiante chaleur. .
À la ligne même de séparation entre l’homme et les bêtes, là où le premier éclair de la raison révèle la lumière qui est en nous, nous voyons la genèse véritable du langage. Analysez le mot que vous voudrez, et vous trouverez qu’il exprime une idée générale appartenant à l’individu que le mot désigne. Que signifie lune? — Celle qui luit. Que signifie le mot anglais moonf— Le mesureur (I). Sun « soleil?. » — Celui qui fait naître. Earth
' " ' L " " " ’ *■ T - - - , ^ _ i _
« terre ?» — Celle qui est labourée. L’ancienne appellation des animaux, tels que les vaches et les moutons, était pasu en sanscrit, en latin pecus, et signifiait ceux que paissent. Le nom animal est de formation plus récente, et dérive de anima, âme. Ce mot anima lui-même signifiait originairement souffle ou respiration, étant dérivé de la racine an , souffler, qui nous a donné an il a, sieurs des choses qu’il fait, et qu’il ne voit pas que, dans ces choses-là même, les bêles ne mettent qu’une intelligence grossière, bornée, et qu’il met, lui, une intelligence doublée d’esprit. » — Flourens, De la Raisonne te., p. 73.
(1) Voir Première Leçon, p. 7.
NEUVIÈME LEÇON. 455
^ ■ .
vent, en sanscrit, et mémos, vent, en grec : de même sjnrüus, esprit, vient de spirare, respirer. L’anglais ghostt esprit, l’allemand Geisi, a été formé d’après la même conception, et vient de la racine qui nous a donné gust, coup de vent, yeast, levure, ferment, gas, gaz, et même les geysers de l’Islande d’où l’eau bouillante jaillit avec sifflement. Soûl, âme, est le gothique saivâla, qui est évidemment apparenté à un autre mot gothique, safys,.lamer('I). Saivs venant de la racine si ou siv, d’où est venu également le grec seio, agiter, signifiait donc l’eau agitée, par opposition à l’eau stagnante ou courante. Par conséquent, le nom de saivala nous indique que les Teutons se représentèrent originairement 3’âme humaine comme une mer qui s’agite en nous, se soulevant et retombant avec chaque mouvement de la poitrine, et reflétant le ciel et la terre ■ dans le miroir des yeux. "
L’amour se dit en sanscrit snïara, qui est dérivé de smar, se souvenir; et il est possible que cette même racine, nous ait donné l’allemand schmerz, douleur, et l’anglais smart (2). .
Si le serpent est appelé en sanscrit sarp a, c’est qu’on l’avait rangé sous l’idée générale de ramper, laquelle était exprimée par le mot srip. Mais le serpent était aussi appelé en sanscrit ahi, en grec echis ou eckidna en latin anguis. Ce nom est dérivé d’une racine et d’une idée toutes différentes : la racine, en est en sanscrit a h ou a??ih, qui signifie comprimer, étouffer, étrangler. Ici, la marque distinctive qui fit donner au serpent le nom que nous rappelons, fut l’habitude.qu’il a d’étouffer sa proie; et ahi désigna! le serpent, en exprimant l’idée générale de l’animal qui étouffe. C’est une curieuse racine que cette
\ .
t
(1) Iieyse, System der.Sprachwissenschaft., p. 97.
(-2) Pott, Etym. For s ch., II, 290. '


T ■
\ \ \
t
^ '
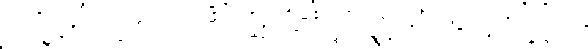
x.
X 'V
t
1
S- ï
/
N
456
LEÇOKSSÜRLÀSGIENGÉDÜ LAIS G AGE.
racine amh, et qui subsiste encore dans plusieurs mots modernes ; et elle mérite que nous nous y arrêtions un nïomenl. Nous la trouvons en latin dans ango, anxi, an-ctum, étrangler ; dans angina, angine (1) ; et dans angor, suffocation. Ângor n’a pas seulement signifié esquinàncie ou suffocation : en passant du sens physique au sens moral, ce mot a exprimé aussi l'anxiété ou l'angoisse. De cette même source sont issus les deux adjectifs angusius, étroit, resserré, et anæi.us, inquiet. En grec, notre racine a conservé son sens naturel et propre dans eggys, près, et dans echis, serpent, vipère: mais, en sanscrit, elle a été employée au figuré, et a été choisie avec une extrême justesse pour rendre de la manière la plus vive et la plus saisissante l'idée du péché. Certes le mal s’est présenté à l’esprit humain sous des aspects bien divers, et les dénominations qu’il a reçues sont fort nombreuses : mais aucune d’elles n’est aussi expressive que celles qui dérivent de la racine amh , étouffer, étrangler. Àmh as en sanscrit signifie le péché, mais son sens primitif fut étranglement, la conscience du péché étant comme l’étreinte de l’assassin étranglant sa victime. Ceux à qui il a été donné de contempler le groupe de Laocoon et ses fils enlacés des replis des deux serpents et se tordant sops leur étreinte terrible, ont vu devant leurs yeux ce que voyaient dans leur esprit les hommes primitifs qui appelèrent le péché amhas, l’étrangleur. Le mot amh as est le même que le grec agos, péché, souillure. La racine ah a donné en gothique agis, crainte, et en anglais awe, terreur, et ug
(!) Le mot anglais, quinsy, esquinàncie oti angine, nous offre un exemple frappant des ravages de l’altéralion phonétique.. Dans ie mot moderne, la racine amh a complètement disparu; mais --elle s’y trouvait originairement, car quinsy est le.grec xuvayyji, étranglement de chien. Voyez Ricbardson’s Diclionary, s. v. Qui-nancy. • - ... .
NEUVIÈME LEÇON. 4ST
■ - , £ ?
dans ugly\ laid. Le français angoisse elTitalien angoscia sont des corruptions du latin angustiœ, lieu resserré (4).
Comment ces premiers penseurs, ces premiers créateurs du langage ont-ils distingué l’homme des autres animaux? Quelle idée générale ont-ils rattachée à la première conception qu ils ont eue de leur propre identité ? Le mot.latin homo, homme (qui s’est réduit à la forme on dans on dit), dérive de la racine qui nous a donné humus, sol, et humüis, humble. Homo signifie donc celui qui a été formé du limon de la terre (2).
Une autre antique appellation de l’homme était le sanscrit m art a (3), le grec brotos, le latin mortalis (dérivé secondaire), notre mortel. Marta signifie celui qui meurt ; et c’est un fait curieux- à relever qu alors que tout dans la nature changeait sans cesse, se flétrissait et mourait, ce nom de mortel ait été choisi comme appellation distinctive de l’homme. Si ces poètes des. premiers âges se sont appelés mortels, c’est qu’apparemment ils croyaient à l’existence d’autres êtres à qui ils attribuaient l’immortalité. .
Il y a un troisième nom qui désigne l’homme en i’appe- -lant le penseur ; et ce nom, qui est le , titre véritable de notre race, nous Je trouvons encore dans , le mot anglais man.la en sanscrit signifie mesurer ; de là on a tiré la racine dérivée man, penser, laquelle à son tour a donné le substantif sanscrit manu, qui signifia d’abord le penseur, et puis l’homme. Dans le sanscrit moderne nous rencontrons d’autres dérivés, tels que mânava, mânusha, manushya, qui ont tous la même signification. En gothique
(1) Kuhn, Zeitschrift,!, 152, 355.
(2) Le grec yjx\ux.l, le zend zem, le lithuanien zeme et zmenes, hommes. Voir Bopp, Glossarium sanscritum, à ce mot.
(3) Voir Windischmann, Forischritt der Sprachenkund.e, p. 23,
H*
'"h '
i
I
/
nous trouvons : man, et manisks, qui sont devenus dans
T ■■ -
l’allemand moderne mann et mensch.
Il y a eubien d’autres noms pour exprimer l’homme, de même qu’il y a eu une foule d’appellations diverses pour toutes choses dans les langues primitives. Chaque trait d’un objet quelconque, qui frappait les premiers nomenclateurs comme particulièrement caractéristique. pouvait leur fournir pour cet objet un nom nouveau. .
Ainsi les dictionnaires sanscrits ordinaires nous donnent cinq mots pour main, onze mots pour lumière, quinze pour nuage, vingt pour lune, vingt-six pour le verbe faire, trente-trois pour carnage, trente-cinq pour feu, trente-sept pour soleil (1).
On pouvait appeler le soleil « l’éclatant, l’ardent, le globe d’or, le conservateur, le destructeur, le loup, le lion, l’œil du ciel, le père de la lumière et de la vie. » De là cette exubérante synonymie des langues primitives ; de là aussi cette lutte entre les mots, qui s’est terminée.par la disparition de ceux qui étaient les moins heureux, les moins féconds et les moins vivaces, et par le triomphe d’un seul mot devenu dès lors le nom propre de chaque objet dans chaque dialecte. Sur une échelle bien réduite, il nous est. possible d’observer cette élimination des mots qui se fait encore sous nos yeux dans les langues modernes, comme l’anglais et le français, qui ont déjà .tant de siècles d’existence. Mais, si nous voulons nous faire une idée de ce qu’a été cette surabondance, de synonymes au premier épanouissement du langage, ’il faut nous rappeler certains cas particuliers, comme, par exemple, les cinq mille sept cent quarante-quatre mots
(j) Cf. Yales, Sanskrit Grvammar.5 p. -18.
relatifs au chameau, énumérés par M. de Hammer dans un mémoire spécial (4).
Nous avons donc vu que tous les mots ont exprimé originairement un attribut, et que tous les noms sans aucune exception, quoique désignant des objets concrets, des individus, présupposent une idée générale à laquelle ils empruntent leur force significative; cette découverte a été de la plus haute importance pour la science du langage. On savait déjà que le langage est la prérogative caractéristique de l’homme ; on savait aussi que la faculté de former des idées générales est ce qui établit une distinction absolue entre l'homme et les bêtes : mais qu’il existât une connexité si complète entre ces deux faits qu’ils ne sont en réalité qu’un seul et unique fait envisagé sous deux faces différentes, voilà ce que l’on ignorait tant qu’on n’eut pas compris que le langage a été formé de racines et non pas composé avec des onomatopées ou des interjections. Toutefois, ce qui a échappé à nos philosophes modernes, avait sans doute frappé les créateurs du langage, car en grec le langage se dit logos, qui signifie aussi la raison, et alogon fut adopté comme lë terme propre pour désigner la brute. Aucun animal ne pense, et aucun animal ne parle, excepté l’homme seul. Le langage
(\) Bas Kamel. (Extrait des Mémoires de l’Académie de Vienne, classe de philosophie et d’histoire, t. VII.) Un philosophe arabe composa, dit-on, un livre sur les noms du lion, au nombre de cinq cents ; un autre sur ceux du serpent, au: nombre de deux cents. Firuzabadi, l’auteur du Kamous, dit avoir écrit un livre sur les noms du miel, et avoue qu’après en avoir compté plus de quatre-vingts, i! était resté incomplet. Le même auteur assure qu’il existé au moins mille mots pour signifier l’épée, et d’autres (ce qui est plus croyable) en ont trouvé quatre cents pour exprimer le malheur. Bervas (Dell’ Origine delle lingue, '§ 233) prétend que les Tartares Mantchoux ont plus de cent mots pour désigner le cheval suivant son âge et ses qualités diverses. Mais il y â beaucoup d’exagération dans de telles affirmations. Voir Renan, Histoire des Langues sêmi-tiques, p. 377. . ‘
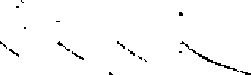
et la pensée ne se peuvent séparer, La pensée sans les mots n’est rien ; les mots sans la pensée ne sont que : de vains bruits. Penser, c’est parler tout bas ; parler, c’est penser tout haut. Le mot, c’est la pensée revêtue d’un corps.
Et maintenant il ne me reste plus que quelques instants
pour résoudre le dernier problème que nous présente
■ (
notre science, à savoir : comment le son peut-il exprimer la pensée? Comment les racines sont-elles devenues les signes d’idées générales ? Comment l’idée abstraite de mesurer a-t-elle été exprimée par ma, et celle dé penser par m an? Comment la racine gâ est-elle venue à signifier aller, et comment. ! es racines sthâ, s ad, dâ, mar, k&v et kar ont-elles pu signifier respectivement se tenir debout, s’asseoir, donner, mourir, marcher et faire ? .
Je tâcherai de répondre à ces questions le plus brièvement possible. Les quatre ou cinq cents racines qui nous restent, après l’analyse la plus minutieuse, comme éléments constitutifs des différentes familles de langues, ne
■ ’ , * ■ ^
sont ni des interjections ni des onomatopées. Ce sont des types phonétiquesproduits par une puissance inhérente à ï’esprit humain. Ces racines , ont.été " créèes.par la nature, comme dirait Platon ; mais avec le même Platon nous nous
hâtons d’ajouter que par la nature nous entendons'la main de Dieu (1).
11 y a dans le monde physique une loi presque universelle : tout ce qui est frappé résonne. Chaque substance rend un son particulier. Nous pouvons reconnaître la pureté plus ou moins grande, la composition plus ou moins parfaite des métaux, à leurs, vibrations, à la réponse qu’ils nous donnent. L’or ne sonne pas comme l’étain; le bois
0) ©rçcto toc [xàv ou<?£! leydixsvcx ‘rcoislcôea Ôeîcç Tzyyy
ne sonne pas comme la pierre ; et des sons différents sont produits par différentes percussions. Cette même loi atteint également l’homme, la plus délicatement organisée de toutes les œuvres de la nature (1). L’homme reod aussi des sons : dans son état primitif et parfait il n’était pas seulement doué de la puissance de traduire ses perceptions par des onomatopées, ni, ainsi que le font les bêtes, d’exprimer ses sensations par des cris. Il possédait en outre la faculté de donner une expression articulée aux conceptions de sa raison. Cette faculté, il ne se l’était pas donnée à lui-même. C’était un instinct, un instinct mental aussi irrésistible que tout autre. En tant qu’il a été produit par cet instinct, le langage appartient clairement au domaine de la nature. Mais l’homme perd ses instincts à mesure qu’ils lui deviennent inutiles, et ses sens s’atrophient dès qu’ils cessent d’être exercés. Ainsi la faculté créatrice qui donna une expression articulée à toutes les conceptions de notre esprit lors de leur première écïo-sion, cette faculté, dis-je, disparut sitôt quelle fut dénuée
d’objet. - . ...... ......
Des spéculations de cette espece peuvent avoir quelque valeur, mais je n aimerais pas à en assumer la responsabilité, car nous n’avons pas le droit de présenter de vagues analogies comme une'solution du problème de l’origine des racines. S’il y a quelque vérité dans les résultats
(4) Cette vue fut proposée, il y a.bien des années, par M. Heyse, dans les leçons qu’il donna à Berlin, et qui, depuis sa mort, ont été publiées avec un soin religieux par un de ses élèves, le docteur Steinthal. Il va sans dire que rien n'est plus loin de notre pensée que de prétendre donner le fait de la sonorité des corps comme une explication de l’origine du langage, ou de vouloir nous en servir autrement que comme d’uue comparaison ou d’une image qui fasse mieux comprendre comment le langage a pu être produit. La faculté particulière à l’homme primitif, au moyen de laquelle chaque impression du dehors avait son écho dans l’âme humaine et y recevait son expression phonétique, doit être acceptée comme
S S. V, \ S V V
\L V V --- '
■V. 'N. V ''S V V
L.
v v' v s~ v V 'v X V X X X. X. x. X
"X JX
auxquels nous sommes arrivés après une analyse soi
11 '
"■ '.Il
gneuse de tous les faits qui s’offraient à nous, après des recherches commencées sans parti -pris, . tout ce que nous avons le droit d’affirmer est que le langage débute par des racines , et que ces racines* ne. sont ni plus ni moins que des types. phonétiques ou des sons typiques. Ce qu’il y a au-delà n’est plus, ou, pour suivre l’ordre historique, n’est pas encore du langage, quelque intérêt que ces éléments primordiaux puissent avoir pour les recherches psychologiques. Mais tout ce qui ‘existe dans le langage réel n’est autre chose que des tiges sorties de ces racines. Les mots sont des épreuves tirées au moyen de ces moules phonétiques et variées en diverses manières ; ce sont, si vous l'aimez mieux, des variétés et des modifications, parfaitement intelligibles dans leur structure, de ces sons typiques en lesquels nous avons reconnu, guidés par d’infaillibles expériences, ce qu’il y a au fond de tout langage humain, les corps . simples qui résistent à toute décomposition. . ; .
Aux premiers âges de l’humanité, le nombre de ces types phonétiques a dû être presque infini : c’est seulement peu à peu et au moyen de ce procédé d’élimination naturelle dont l’histoire'primitive des mots nous fournit un autre exemple, que les groupes de racines plus ou moins synonymes se sont réduits à un seul type déterminé. Loin de dériver toutes les langues de neuf racines, avec le docteur
un fait primordial, au delà duquel il ny a pas à remonter, tandis que la formation des racines, en tant qu’exposants des conceptions générales, sera toujours envisagée différemment par les différentes écoles philosophiques. Quand on sera parvenu à mettre d’accord Platon et Aristote, Kant et Iîume, sur l’origine des conceptions ' générales, nous pourrons espérer arriver à un même résultat pour l’origine des racines, ces premières incorporations des idées
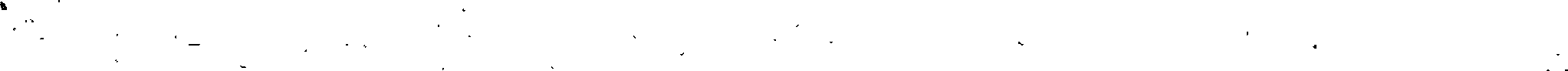

Murray (-1), ou d’une seule racine, ainsi qu’a prétendu le faire le docteur-Schmidt (2), nous devons supposer que l’élection définitive des éléments radicaux du langage fut précédée d’une période de végétation luxuriante, premier printemps du parler humain auquel devaient succéder tant d’automnes.
Avec ce procédé de l’élimination ou de l’adoption de
•a s ■
certaines racines à l’exclusion des autres, l’élément his-. torique entre dans la science du langage. Tout primitif que soit le chinois en comparaison des langues agglutinantes et des langues à flexions, il est manifeste que ses racines ou mots ont traversé une longue période pendant laquelle ils ont cherché, si l’on peut ainsi parler, à se-louffer et à se remplacer l’un l’autre. Le rôle de la tradition est évident même dans le chinois. La règle d’après laquelle, dans une proposition simple, le premier mot est le sujet, le second mot est le verbe, et letroisième mot.est l’attribut ou le régime, est une règle traditionnelle. C’est la tradition qui donne à ngô gin la signification de « mau
vais homme »,-et-à gin ngô celle, de «l'homme est mau
vais. » Les Chinois eux-mêmes distinguent entre les racines 'pleines ellesracines vides (3), les premières étant attributives, les autres répondant à nos particules qui modiSent le sens des racines pleines et déterminent leurs rapports entre elles. Ce n’est que par la tradition que des racines deviennent vides. Bans l’origine, toutes les racines, soit attributives, soit démonstratives, ont été pleines, et puisqu’il y a en chinois des mots vides qu’il n’est pas
(•]) Les racines primitives auraient été, au dire du docteur Murray, ag, bag, clwag, cwag, lag, mag, nag, rag, swag..
(2) Curtius, Griechische Etymologie, p. 43. — Le docteur Schmidt
dérive tous les mots grecs de la racine e, et Lous les mots latins du radical hi. .
(3) Endlicher, Cldnesische Grammatik, p.163. :
possible'dé faïreremontei aux motspleins" qui furent
leurs prototypes, nous devons en conclure que le chinois, même dans sa forme la plus archaïque, avait déjà traversé différentes périodes de dëveloppément. Les coin-mentateurs chinois admettent que tous les mots vides .ont été primitivement des mots pleins, de même que les gram- - ^ mairiens indiens reconnaissent que tout ce qui est aujour- \ d’hui formel dans la grammaire a commencé par être \ indépendant et substantiel. Mais nous ne pouvons fonder • ce principe général que sur des preuves partielles, et il ; faut nous attendre à rencontrer autant d’étymologies de ; pure fantaisie en chinois qu’en sanscrit. Cet autre fait, [ qu’en chinois on ne peut plus employer indifféremment \ toutes les racines comme substantifs, comme verbes et ! comme adjectifs, nous prouve aussi que, même dans cet j état, le plus primitif qui nous soit connu, le langage pré- i suppose encore un développement antérieur. Fu signifie ! père, mu mère, fu-mu parents ; mais ni fu ni mu ne sont \ jamais employés comme racines dans leur acception ori- ! ginelle et attributive. Quoi qu’il en soit, la preuve la plus i convaincante des phases diverses qu’a dû traverser même ; une langue aussi primitive que le chinois, nous est four- \ nie par le nombre comparativement restreint de ses ra-cinés et par la signification précise et déterminée qui est attachée à chacune d’elles, — résultat qui n’a pu être ! donné que par cette longue lutte entre les mots que nous ; avons déjà décrite en empruntant une-comparaison à : l’histoire naturelle. .
-» ■ i
Bien qu’il nous soit impossible d’attribuer uniquement à l’opération de la nature ou de nos instincts naturels ce : triage des racinés et surtout la combinaison subséquente des racines conservées, nous sommes encore moins fon- ; dés à supposer que ces faits furent produits par un art 1 réfléchi et prémédité, comme l’ont été, par exemple, les
- ' ■ ■ . " ' "r ' " _ , . /
' = ' . NEUVIÈME LEÇON. . : . . 465
• tableaux de Raphaël ou les symphonies de Beethoven. Etant données deux racines, dont lune signifie voler ou oiseau, et dont l’autre signifie tas ou quantité, la réunion de ces deux racines pour exprimer plusieurs oiseaux est un effet naturel de la puissance synthétique de l’esprit humain, ou (pour laisser de côté ce terme psychologique) delà puissance qui nous permet de combiner deux ou , plusieurs choses ensemble! Certains philosophes prétendent, il est vrai, que cette explication n’en est pas une, et que le véritable mystère à éclaircir est desavoir comment notre esprit peut former une synthèse, ou concevoir plusieurs choses comme n’en faisant qu’une seule : ils . entrent alors dans des profondeurs où nous ne pouvons les suivre. D’autres philosophes s’imaginent que cette combinaison des racines par laquelle ont été formées les langues agglutinantes et les langues à flexions, a été, de meme que la première formation.des racines, l’effet d’un instinct naturel. Ainsi M. Heyse soutenait que « la philoSophie doit expliquer les différentes formes de développe-ment-que nous observons dans les langues humaines comme étant des évolutions nécessaires, qui ont leur rai. son d’être dans l’essence même du langage » . (-1). Cela n’est pas exact. Nous pouvons suivre des yeux le dévelop-peinent du langage, et nous pouvons comprendre et expliquer tout ce qui résulte de ce développement : mais nous ne saurions prétendre prouver que tout ce qui existe dans : ‘ le langage y existe nécessairement et n’aurait pas pu revêtir une forme différente.........
Quand nous avons, comme en chinois, deux mots tels que kiai et lu, signifiant tous deux tas, assemblée;, quantilé, nous pouvons parfaitement comprendre que l’on se soit servi de l’un ou de l’autre de ces mots pour former le
(i) System der Sprachwissenschafl, p. Cl..
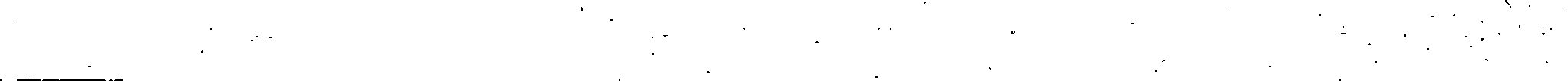
pluriel : mais si F un des deux est adopté par l’üsàgè et devient traditionnel, tandis que l’autre tombe en désuétude, nous pouvons alors enregistrer ce fait comme un fait historique, mais il n’y a pas de philosophie au inonde qui puisse en démontrer l’absolue nécessité. Il nous est également facile *de comprendre qu’avec deux racines telles que kuô, empire, et cung, milieu, les Chinois aient formé ce que nous appelons un locatif, Mo cung, dans l’empire : mais dire que c’était là la seule manière d’exprimer cette conception, c’est mettre en avant une. assertion que contredisent les faits et la raison.
Nous ayons vu les différentes manières de former le futur. Elles sont toutes au même degré intelligibles et possibles ; mais aucune d’elles n’est inévitable et nécessaire. En chinois ÿao signifie vouloir, et ngo je : ngo ÿaà signifie donc je veux. La même racine ÿao ajoutée à kiû aller, nous donne ngo ÿaà kiû, je veux aller, le premier germe des futurs anglais. Soutenir que ngo ÿao kiû était la forme nécessaire du futur en chinois, ce serait introduire dans le langage un fatalisme qui ne repose sur aucun-fondement. La construction du langage ne ressemble pas à celle des cellules d’une ruche, ni à la construction d’un édifice .élevé par. un architecte humain. .Le langage est l’effet de causes innombrables agissant toutes conformément à certaines lois, et laissant, à la fin le produit de leurs forces combinées débarrassé de tout ce qui était superflu ou inutile. Depuis la juxtaposition primitive de deux mots comme gin homme et kiai beaucoup, pour former le pluriel gin kiai, jusqu’à la grammaire si parfaite du sanscrit et du grec, tout s’explique dans le langage comme résultant des deux principes de développement que nous avons étudiés dans notre seconde leçon. La formation des
O . .
racines est l’œuvre de la nature ; ce qui suit cette formation est l’œuvre de l’homme considéré non pas comme
agent individuel et libre,, mais comme agent collectif et modérateur. •
Je suis bien loin de dire que l’on soit parvenu à expliquer toutes les formes du grec ou du sanscrit. Il y a dans ces langues comme dans toutes lés autres certaines formes qui ont résisté jusqu’à présent à toutes les analyses; et il est plusieurs procédés grammaticaux, tels que l’aug-ment en grec, Je changement des voyelles en hébreu, l'inflexion (Umlaut) et la déflexion (Ablaut) dans les dialectes teutoniques, qui nous feraient presque supposer que le langage admet des distinctions de pure euphonie lesquelles répondent à des distinctions très-réelles et palpables de la pensée. Pourtant une telle supposition n’est fondée sur aucune induction légitime. Il peut nous sembler impossible d’expliquer pourquoi l’allemand bruder fait bruder au pluriel, ou pourquoi brethren est le pluriel de l’anglais brother, frère. Mais ce qui est inexplicable et en apparence artificiel dans nos langues modernes, devient intelligible dès que nous étudions ces langues à des époques plus primitives. Ce changement de u en ü que nous avons observé dans bruder, brikler, n’a pas été intentionnel ; encore moins fut-il introduit pour exprimer la pluralité. C’a été un changement, phonétique dû à l’influence d’un i ou d’un / (1) qui existait réellement dans la dernière syllabe et qui a réagi régulièrement sur la voyelle de la syllabe précédente : ici donc i’eflet a subsisté après que la cause elle-même eut disparu. Par une fausse analogie, un pareil changement, parfaitement régulier dans une certaine classe de mots, peut s’étendre à d’autres mots où rien ne le justifie ; et alors il peut sembler que l’on ait voulu exprimer un changement grammatical au moyen d’un changement arbitraire de voyelles. Mais la
(I) Schleicher, Deutsche Sprache^ p. 144.
X X
LEÇONS SUR LA. SCIENCE DP LANGAGE.
L - '■ ‘ ' - x v x ■ s '
O
X.
x X. x X
philologie comparée peut suivre le langage jusque dans ces recoins obscurs, et découvrir la raisou de ce qui a été en réalité une méprise et une faute........ .... . ■
Il semble difficile de croire que Taugmenl en grec ait eu originairement une existence indépendante et substantielle ; cependant toutes les analogies nous le font présumer. Supposé que l’anglais n’eût jamais été écrit avant le quatorzième siècle, nous trouverions que dans certains cas le temps passé était exprimé à l’aide d’un a bref. AVyclifie prononçait et écrivait I knowlech to a felid and seid thus (1), au lieu de l’anglais moderne I achiowledge to hâve felt and said thus, je reconnais avoir pensé et parlé ainsi. Aujourd’hui encore, dans certaines, parties de l’Angleterre, le peuple dit de même I should a doue it, pour Ishould hâve done it,. j’aurais dû le faire. Dans quelques vieux livres anglais cet a et le verbe qui le suit sont im--primés comme ne faisant, qu’un seul mot, si bien qu’une grammaire anglaise faite d’après ces éditions anciennes nous donnerait to afailen comme infinitif passé du verbe to fait. Je n’ai pas besoin de taire remarquer quil ne peut pas être question dans ma pensée d’établir aucune connexion entre cet a qui est une contraction du verbe to hâve, et l’augment qui est placé devant les temps passés en grec. Je veux seulement dire que si jusqu’à présent on n’a pu trouver aucune explication satisfaisante de l’origine de l’augment en grec, ce n’est pas une raison pour désespérer d’en trouver une jamais, ou pour admettre que l’augment ne soit autre chose qu’une voyelle que l’on serait convenu de placer devant certains temps des verbes, comme signe conventionnel pour exprimer le passé. . .
Si nos. inductions peuvent avoir quelque portée, nous
(I) Marsh, p. 388.
NEUVIÈME LEÇON.
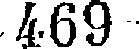
" *
sommes assurément-autorisés à croire que des lois dont on a.constaté l’opération dans un si grand nombre de cas et jusque dans les faits qui semblaient les moins soumis à leur influence, régissent tout le domaine du langage. Il n’est pas besoin d’intervention surnaturelle ni de conventions entre les sages pour rendre compte des réalités du parler humain. Tout ce qui est formel dans le langage est le produit de combinaisons rationnelles ; tout ce qui est substantiel, tout ce que nous avons appelé racines attributives, est le produit d’un instinct mental, dune puissance p " * ~ '■
innée qui ne se révèle plus à nous directement et ne se laisse plus guère étudier que dans ses effets. Dans Détonnante fécondité de la première émission des sons installe-tifs et naturels, et dans le triage différent de ces racines que firent ensuite différentes tribus, nous pouvons trouver l’explication la plus complète de la divergence de langues , toutes issues d’une même source. Nous pouvons comprendre non-seulement comment le langage s’est formé, mais aussi comment il a dû nécessairement se scinder en une foule de dialectes ; et nous arrivons à cette conviction
que, quelque diversité qui existe dans les formes et dans les racines des langues humaines, on ne peut tirer de cette diversité aucun argument concluant contre la possibilité de l’origine commune de ces langues. .
C’est ainsi que la science du langage nous conduit jusque sur cette cime élevée d’où nous pouvons contempler l’aurore même de la vie de l’homme sur la terre, et où ces paroles delà Genèse que nous avons si souvent.entendues
depuis notre enfance, « toute la terre n’avait qu’un seul
” ’ - / ’ . '
langage et un seul parler », nous offrent un sens plus naturel', plus inteJligible, et plus scientifique que nous ne leur connaissions auparavant. ;
470 LEÇONS SUR LA SCIENCE DU LANGAGE.
v V "v 'v. V. 'v s N. . V N V X “X ^ ( V. V X '■'■ ^ ^ \ '' ^
Et ‘maintenant, ' en terminant ces leçons, je ne puis qu’exprimer mon regret de ce que l’esquisse que je me suis efforcé de vous présenter de la science du langage ait été nécessairement si légère et si imparfaite. Il y a bien des points auxquels il m’a été impossible de toucher, et beaucoup d’autres que je n’ai pu qu’effleurer ; et parmi tant de questions diverses à peine m’a-t-il été possible d’en approfondir une seule comme je l’aurais voulu. Néanmoins je suis heureux et reconnaissant de l’occasion qui m’a été donnée d’appeler rallention du public sur une science qui, je le crois, a un grand avenir devant elle ; et je me réjouirai si j’ai pu exciter, même sans la satisfaire, la curiosité des personnes qui m’ont fait l’honneur de suivre ces leçons, et si je leur ai inspiré le désir d’étudier de plus près les couches diverses dont est composé notre
. langage et d’analyser les éléments dont est formé le granit de nos pensées. - .
Dialectes de l’Inde ............... ...... Prâkril et pâli - Sanscril moderne—Sanscrit védique
_ des Tziganes..................
— ■ de la iYrse ................... Parsi — Pelilvi — Inscriptions cunéiformes — Zend
— de l'Mghanislan------*....... •
— du Kurdistan..................
— de l'Arménie.................... Ancien arménien ,
— des Ossètes.................. • •
— de la Bretagne française..........
, ^ — ........... Comique . .
— de l’Écosse...................
— de l'Irlande..................... ; ‘
— de l'île de Man................. '
— du Portugal................... \
— de 1 Espagne.................... _ j i 0SqUe
— de la Provence................. fSp H’nï! 1 Ungua vulgaris j latin
— de a France................. Langue doil f f ombrien
. — de 1 Italie...................... ,
— de la Valadiie................. <'
— des Gnsons...................
— de l’Albanie..................... , , . ...
y ( donen — éolien
— de la Grèce..................... lvoivv] | attîque — ionien
— de la Lithuanie................. .
. Ancien prussien
— delaCourlandeetdelaLivonie(lelette) . .
— de la Bulgarie........_........ Slave ecclesiastique
— de la Russie (Grande-Russie, Petite-
Russie, Russie-Blanche).......
— de ITHyrie (le Slovène, le croate, le
serbe).......................
— de la Pologne................ , . ....
. — de la Bohême (le slovaque}........ Ancien bohémien
_ d@ Ig ] usarc . ., ■......... Polabe
__‘ de l'Allemagne.................. Moyen haut-allemand, ancien haut-allemand
— de rAngleterre................. Anglo-saxon
— de la Hollande.................. Ancien hollandais
- - de la Frise..................... Ancien frison
— de PAlleningne septentrionale (le '
platt-deutsch).............. Ancien saxon
— du Danemark............. ....
” Ï!lède,..................} Ancien norrois
— de la Norvège ..............
- ' — de l1 Islande............... - • ■ •
Kymrique
Gadhélique
Lctte
Indienne
\
■
Iranienne
Celtique
i
Itilique
/ ■
] Illyiienne
Hellénique
Slave (sud est} / Windiquc
Slave (de l’ouest)^! du haut-allemand \
du bas-allemand
Scandinave-
Teutoniquo
O P
‘O
Ï=1
P
<<
53*
o"
en
-D
CS
a
o
o
r
r
M
>
&
Kl
M
55
55
H
'-3
>-
tjd
fcU
>
cU
CP
tu-
tef
tu-
b>
fH
o
CP
I—I
£=>
eu
td
tu
tu
t-1
>
hd
tu
o
tr-
tr*
tu
td
tu
oo
tr»
>■
te!
cp
tu
GO
>-
tu
►<1
tU
S
tu
GO
£P
KJ
N
m
xL L
! ,
LEÇONS' SB R LA- SCIENCE'DU. LANGAGE.
V
v
11
TABLEAU GÉNÉALOGIQUE DE LA FAMILLE DES LANGUES SÉMITIQUES.
LANGUES VIVANTES.
LANGUES MORTES.
CLASSES.
Dialectes de l’Arabe .. ,
Âmharique..........Éthiopien '
— .......... Inscriptions himyaritiques
Àrabiqu! ou
Méridionale
is
Dialectes des Juifs ... Hébreu biblique *
— ... Samaritain (Pentateuque)
— ... Carthaginois, Inscriptions phéniciennes
1
Hébraïque
ou
Centrale
: — . ‘ . Chaldéen(Massore,Talmud,Targuni.ehaldéenbibiique)j Aramaïque
Néo Syriaque .. ____ Syriaque (Peschilo, deuxième siècle après J.-C.) | ou
..... — . ’., ... Inscriptions cunéiformes de Babylone et de Ninive ) Septentrional
.I
fi ; v /.
FAMILLE SEMITIQUE
. TABLEAU GÉNÉALOGIQUE DE LA FAMILLE DES LANGUES TOURANIENNES
DIVISION SEPTENTRIONALE.
LANGUES VIVANTES. LANGUES
‘ MORTES.
Jectes des Chapogires (Tongouska supérieure)...........
— des Orolongs (Tongouska in
férieure).............
— des peuplades de Nyerlchinsk
— des Lamutes (côte de O’hotsk)
— des Mantchoux (Chine)...
— des Mongols-Sbarra (au sud
du désert de Gobi).
— des Khalkas (au nord du dé • sert de Gobi)..........
— des Sharaigol (Tibet et Tan
goût).......
— des Khochot..
— des Dzoungar...
— dès Torgoout
— des Durbet..
— des Aimâks fc’est-à-dire tri
bus de la Perse)......
— des Sokpas (Tibet).......
— des Buriales (lac Baïkal)..
— des Ouigours....... '____
— des Romans .....____...
— des tribus du Djagalhaï....
— des Usbeks ,
— des Turcoroans ■.
— des habitants de la province
de Cassan .......
— des Kirghises . ...
— des Bashkirs ,.....
— des NogaTs.......
— des Eouiniens......
— .des Karatchais.....
— des Karakalpaks .
— des Mesbcbervaks..-
— des tribus sibériennes
— des Yakuts.......
— des habitants du Dourbènd
— des habitants del’Aderbaïdjan
— des habitants de la Crimée..^
— • des habitants de l’Anatolie..
— des habitants de la Roumélie
— des Yourazes ......
— des Taugi..........
— des Ÿenisei----- ...
— des Ostiako-Samoyèdes
— des Ramas ..—
— dés Hongrois .....
— des Vogouls......
— des Ongro-Osliaks.
— . des Tchérémisses..
— des Mordviniens...
— des Permiens .....
— des Siriaines..... .
— des Votiaïkes.....•
— des Lapons........
— des Finnois .
— des Esthoniens.....
BRANCHES.
CLASSES.
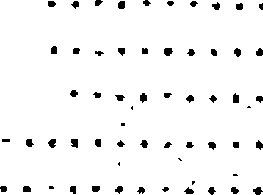
4 4* +
» t
Occidentale
Orientale
)
Tongouse
Des Mongols orientaux
Qlotes
ou / \ Mongole
Ralmouks \ j)es Mongols occidentaux!
Mongols septentrionaux /
Du Djagalhaï, S. E.
Turque, N.
Turque, 0.
Septentrionale
j Orientale Ougrienne
t
) Bulgare Permienne
Tchoude
1
1
i
i
'ï
\
L-
/
Turque
Samoyède
Finüois&
(ouralieime)
d
r d
H O. d
ES pJ
S >
° ^ es 2;
* d
%
. d
g
LO
O*
t3
\ S
L
*74 ■ ' LEÇONS SUR LA SCIENCE DU LANGAGE. '
V , , - - - , - -
1 - ' T * , _ . I t
IV. TABLEAU GÉNÉALOGIQUE DE LA FAMILLE DES LANGUES TOURANIEM
v
-X -x ’-n
DIVISION MÉRIDIONALE.
.V -V
■N 1 -X. N -X •'■h
LANGUES VIVANTES.
Siam.....
Ahom
Laos......,,
Khamli.....
LANGUES MORTES BRANCHÉS.
» t ^ < * » * < t < ■
* » ( ***-*****-*tfl*»»t l*t.
( I l I 1 I '-t I I # . .4 1 * i ('-■ * i a *.«
Shan (Tennaserim) ...........................
Dialectes de la Malaisie et de la Polynésie (voir Eum-
.boldt,- Kavi-Sprache)......................
Tibétain.....................................
Horpa (au nord-ouest du Tibet et de la Bulgarie)..
Thotchou-Sifan (au N.E. du Tibet et de la Chine).. ______
Gyaroung-Sifan (su N.E. du Tibet et de la Chine)..( himaïavenne
Manyak-Sifan (au N.E- du Tibet et de la Chine).... ) *
Takpa (ouest de Koumbo) ...
Kenaveri (bassin de Seiledj) ..
Sarpa (ouest du bassin du Gandak; . ..
Sounwar (bassin du Gandak). . . ....
Gouroung (bassin du Gandak).........
Magar (bassin du Gandak)...........
Neouar (entre le bassin du Gandak et celui du Cosah)
Mourrai (entre le bassin du Gandak et celui du Cosah)
Limbou (bassin du Cosah).........( ... ......(
Kiranti (bassin du Cosah) .....................
Lepcha (bassin du Tistah) .................. ,
Bo'utanais (bassin du Manasé) ..................J
Tchepaug (NeypakTerai)......................./
Barman (Birman et Aracan)...................
Dhimal (entre Konki et Dnorla).......:.......
Katcbari-bodo (de î>0» à 95° L-. el de 2> à 27°V.
Garo (90°-^i° long. E.; 23° 20° lat. N )....... /. .
Tcbanglo (9i°-92u loi!g._E.)..;____ .... .......
Mikir (district de Naugong)...................«
Dophla (92° 50’ 97° lat. N.) ............. .....
JVïiri (94o-97° long E.?)......................
Abor-Miri....................... ... , ......
Abor (97°-99° long. E.).......................
Sibsagor-Miri. ... ........... .........
Singpho (27°-28“ lat. N.).. ...................
Dialectes iîes tribus Naga <93-97° long. E. 25e kl.
N. (Mithan) E. de Sibsagor;......... ;
‘ — des tribus Nagâ (Namsang)L . '.. '...'..'.
—: des taibns Naga (Naugong). .........
— des tribus Naga (Tengsa). .
— des tribus Naga (Tabloung. N. de Sibsagor
—- des tribus Naga (Kbaou, Djorbat).......
_ — des tribus Naga (Augarai)... .... ...
liouki (N.E. de ChittagCtng) ........ ........ ..
Khyeng (Sliyou) d9c-21Jat. N. Àrarân)......'. .■..
Kami (Aracan).............................
Khoumi (Aracan)...........................
Chendous (22--25°: 95°~94*)........... . .....
Mrou (Chiltag&ng. Aracan).. ........ .........
Sak (sur la rive occidentale du Neuf)............
Tounglhou (Tennaserim).................. ....
Ho (KolehanL .............................
Sir.hhhoum-Kole (Cltyebossa)..................
Sont ai (Cbyebossa)...........................
Bhoumidj (Chyebtissa) w..................
Moundala (Chôta Ne.gTranrïXx.,. ■
Canara ...... X ts\:U.
Trans-
CLASSES.
>■ Taïunne
!:
Sub-
himalayenne
\
\ Malaise
$
Gangétique
Lohitiecne
J Motmda t (voir Lam
î
l
) -
Division .méridionale
tradi
L.UUIIVPS
iovrartiiiincs, > p. 173.)
i
Tamoul... .......
/ >>
Gond.....! .X-Xx ::x<
Telînga Malavalam
' Ÿy^x * *
* * % t
J t I t * I t
—r ^ j V.
jr t
' \......
*
\ \ ' : • * ■ a *■ • * 4'
X /
Brahvi.....t.
Toulouva.* ............. w y
Todava.... .\,?T. .-,x.xX/........:...
Draon-Roie.. \^... .. —........
Tamoule
■* * + *
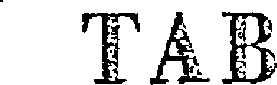
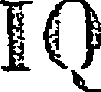
O
h.
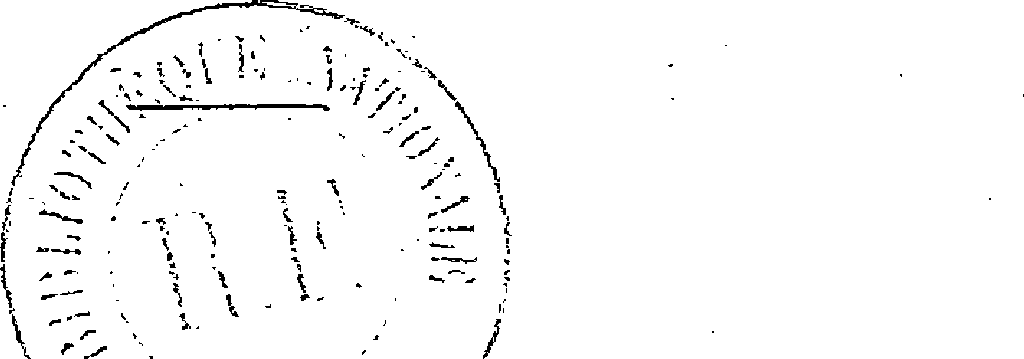
"V'tV / j !
Abd-ul-kâdir Maîuk (Mullu), slïahJ. de Badâün ; son Histoire générale. de l'Inde el autres ouvrages, 176, noie,
Ab h ira, à l’embouchure de l’Indus,
Abiria 0’) de Ptolémée, 244.
Ablatif ; César, auteur présumé de ce terme, 124. •
Ablatif, manières d’exprimer ce cas en chiribis, 156, note.
Àboul Wàiid, ou Rabi Jonû, auteur de la première grammaire hébraïque, 99, noie.
Àbrahani (langue d’), 557.
Abou Saleh traduit un ouvrage du sanscrit en arabe, 174.
Abou Zàccariya ’Hayoudi, sa théorie des racines hébraïques, 99, noie.
Abyssinien (P; ancien et moderne, 541..
Académie (doctrines delà nouvelle), très-suivies à Rome, 121.
Accusatif (formation de P), en chinois, 156, noie.
Achéménides (inscriptions de Ja dynastie des), 235.
AD, manger, racine première, 518.
Adelung, son Mithridatc, 164.
Adjectifs formation des) en tibétain, 128, note.
— leur place en chinois, 156, noie.
-Adorateurs du feu, voir Parsis.
: »iésinence du génitif de la lre
L_Idé'clinaison en latin, sa forme
primitive, 266-268.
Ælius Stilo (Lucius) donne à Rome des leçons de grammaire latine, 124.
Affinité (indications de la véritable) dans le règne animal et dans le règne-végétal, 17. "
Afghanistan (langue de 1’), 234.
Afrique méridionale (dialectes de P), 63.
Age, histoire de ce mot, 532.
Agglutinantes (langues), composent une des trois ^divisions de la classification morphologique des langues, 547, 549.
— d’où leur vient celte dénomination, 547. . •
— en quoi elles diffèrent principalement des langues à flexions,586.
Agglutination dans la famille des ""langues louraniennes, 53t, 236.
— traces rudimentaires d’agglutination, même en chinois, 592.
Aglossoi (les) des Grecs, 102.
Agriculture (traité de 1’) chez les Chaldéens, 559.
— (traité de Magon sur F) écrit eu langue punique, 106, noie.
Ahi, étymologie de ce nom du serpent en sanscrit, 433.
Ahirs (les) de la province de Coutch, 244,
476 LEÇONS SUR LÀ SCIENCE DU LANGAGE.
V -’v -'V. .V .'■v. -V, .-v -V -“V -V -V .N. -V -V -X 'V V -X Jv
Akbàr (l’empereur), ses études reli* gieuses, 175.
— fonde la religion IlaJii, 175.
— livres qu’il fait traduire en persan, 1-76. -
— ne peut obtenir une traduction des Védas, 176-178.
Albanais, origine de ce dialecte, 257. ,
Albanie-, origine de ce nem, 294.
Albert le Grand, cité, 148, note.
Albirouni, son Tarikhu-l-Hind, 175.
Alchimie, pourquoi celte science s’est éteinte, 11.
Alexandre le Grand, son expédition en Asie fait connaître aux Grecs les nations et les langues étrangères, 104-
—'converse avec les brahmanes de Ftnde par Fenlrennse de plusieurs interprètes, 104.
Alexandrie, avantages qu'elle offrait pour l’étude des langues étrangères, 107.
— (travaux critiques de l’école d’), 108-110.
Algèbre (traité célèbre d’) traduit du sanscrit en Arabe, 175.
Algonquins (le cas unique des), 270, noie. _
Atgum où almug, signification probable de ce mot ; rapproché du sanscrit valguka-, bois de sahdal, 241. .
Allemand (histoire de 1’), 2H et suiv. . *
Altération phonétique, une des ohases du développement du angage, 48. .
-4* exemples d’altération phonétique, 49-54.
— elle ronge quelquefois tout le corps d’un mot, 54.
Amalgamantes (langues), nom donné quelquefois aux laugues à flexions, 547.
Amérique centrale, grand nombre de langues qui s’y parlent, 65. •
— rapidité extraordinaire avec laquelle ces langues se modifient, 62.
— Hervas réduit ces langues à onze familles, 65.
Amharique, ou abyssinien moderne , 541. •
Àmhas, nom du péché en sanscrit, étymologie de ce mot, 456.
AN, souffler, rejetons divers de cette racine, 454.
Analyse (F) grâmmalicale, résultats certains et complets qu’elle devra donner avec le temps, 264'
Anatomie comparée (science de Pi,
. 20. - . - - . - . - - . .
Angina, angor, anguis, angustus, etc-, rattachés à la racine ali ou amh, étrangler, 455-456.
Anglais (F), changements survenus dans cette langue, 58-41.
— richesse de ses patois, 59.
— sources véritables de cette langue, 71.
— travaux d.u prince L. Bonaparte sur les patois anglais, 71.
— est une langue leutonique, 89.
— ses nombreux emprunts aux langues étrangères, 95.
— nombre total des mots, anglais
venant du saxon et de ceux qui viennent des langues classiques, 94. ‘
— critérium qui établit l’origine teulonique de celte langue, 95.
-■— le génitif en anglais, 154.
— origine des formes grammaticales en anglais 159.
— nombre total des mots anglais, -525, note. '
— nombre des. mois employés par Miiton, par Shakespeare et par les traducteurs de l’Ancien Testament, 524.
Anglo-saxon, le plus ancien poëme
. épique écrit dans cette langue, 209.
Angora (bataille d’) en Galatie, 569,
Anima, âme, étymologie et signification originelle de ce mot, 454.
Anquetil-Duperron traduit en français la traduction persane des Ùpanisbads, 178.
— traduit les ouvrages de Zoroas-tre, 248.
Antrum, étymologie et signification.originelle de ce mot, 448.
Apollon, (temple d’) à Rome, 115.
AR, rejetons divers de celte* racine et leurs ramifications, 506-511.
Arabe (F), son contact avec le persan, résultat de ce contact, 92.
— devient la langue de la Palestine et de la Syrie, 540.
— son berceau primitif, 540.
— ses plus anciens monuments littéraires, 541.
— sa parenté avec l’hébreu, 541.
Àraméenne (branche) des langues
sémitiques, 554.
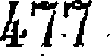
— composée de deux dialectes prih- ' . cipaux, 554.
Avare, apoîiv, arvum, etc., tous dérivés de îa racine AR, 506.
ARD, blesser, racine tertiaire, 518. Argi-izari, nom de la lune en Basque, 7, note.
AriaDa (1’) des géographes grecs, 291. ...
Ariaramnès, père de Darius, orïgi-ne de ce nom, 292.
Aristote, sur les catégories grammaticales, 108,109. r ménie, origine de ce nom, 295. r morieain (i’j, 254. rpinum, latin provincial qui y était parlé, 69.
Article, origine de ce mot, 110.
— Zénddote rétablit l'article devant les noms propres dans l'Iliade ' et dans l'Odyssée, 110.
Arya. Voir Aryen. ‘
Ârÿa-âvarta, nom de l’Inde, 287. Arvennes (la famille des langues), 209-257. .
— méthode pour faire remonter les formés grammaticales des lan: gués aryennes à des mots indépendants, 281, 284.
— la grammaire aryenne, 284. .
— division septentrionale et division méridionale des langues aryennes, 253.
— berceau primitif des .Aryens dans l’Asie centrale, 290,291.
— dispersion de la fainille aryenne
... 257. ' . .'
— tableau de la civilisation aryem
ne primitive d’après les mots communs aux divers dialectes aryens, 286. # _
— origine et pérégrinations du mot Arya, 287.
— la famille des langues aryennes et celle des langues sémitiques composent les deux seules véritables familles de langues, 542.
— formation du locatif dans toutes les langues aryennes, 265.
-r- tableau généalogique des langues aryennes, 472.
AS (la racine), 256. /
As, â, am, Hervas identifie ces désinences sanscrites avee- les dé
sinences grecques- oç, ri5 ov, 164 Asiatique (fondation delà Société) à Calcutta, 187.
— premières publications de cette
société, 187. .
Asie-Mineure (origine des Turcs d'R 567. .
Asmi, asi, asti, formes sanscri tes identifiées par Hervas avec auA, , eîç, Ictl, 164 ; et par lord Mon-boddo, 194.
Asolia (le roi), ses inscriptions sur les rochers de Dhauii, de Gitnar, et de Eapurdigiri, 168.
Assyrie, formes diverses de ce nom, 299.
Astrologie, pourquoi cette science . s’est éteinte, M.
Attributives (racines), d’où leur vient celte dénomination, 511.
— éléments constitutifs du langage.
505. -
Aujourd'hui renferme deux fois le mot latin dies, 54.
Auramazda H’) des inscriptions cu-. néifprmes. Voir Ormuzd.
Âuspice, étymologie de ce mol, 315. Auxence, sa vie d’Ulfilas, 214.
B
Baber fonde une dynastie mongole dans l’Inde, 560.
Babylonie (littérature de la), 558.
Bani, origine de cette désinence' des imparfaits latins, 206.
Barabas-ihorde des) dans Jes steppes, entre l’irlish et l’Ob, 565.
Barbares (les) des Grecs, 102.
— les barbares semblent avoir eu pius de facilité pour apprendre les langues que les Grecs et les Romains, 105.
— populations auxquelles les aur-
■ leurs grecs donnaient le nom de
barbares, 144, note.
— influence malheureuse de ce terme de barbare. 146.
Bas-Allemand (le), dialectes qu’il comprend, 210.
— rameau indépendant de la bran-' che teulonique, 227.
Basblrirs (race des) dans les monts. Altaïs, 565. .
Basile (saint) attribue l’invenlion du langage aux facultés que Dieu a mises dans l’homme, 54, note.
Bazianes (horde des) dans le Caucase, 564.
Bebar, le pâli était autrefois l’idiome populaire de cette province, 168.
.-V .-N-nX. - v X.
' r
O
'U
-\..-x. -V on -'n-.-x -'x'-x. n_.-n. -n-.:n -N.
Beovyülf, le plusâneien poëmeépU que anglais, 209. ' ' ; ;
Berber (dialectes) de l’Afrique sep-tenlrionale, leur origine, 542:
Berger,étymologie de ce mot, pourquoi il:' à été adopté en français,
. 544. . . .... . .
Berners (Juliana), citée, 74, note.
Bérose écrit en grec l’histoirè de Babylone, sa patrie, 106.
— savait* lire les documents cunéiformes de Babylone, 106. ’
Bêtes (faculté des), 416 et suiv.
— leur instinct et leur intelligence,
— le langage élève une barrière
infranchissable entre les bêtes et l’homme, 422. ■
Bibliander, ses travaux philologiques, 150, noie.
Bienfaisance, par qui ee'-môt fut. introduit en français, 45, note.
Birman (dialectes du), 64.
Birouni (Abou-Rihan-al), 172. :
Bo, origine de celte désinence du futur en latin, 280
Boèce (le chant de), siècle auquel on le rapporte, 250.
Bohémien (le), les plus anciens fragments de cette langue, 257.
Bonaparte- (le prince Lucien), ses travaux sur les patois anglais, 71. .
Bopp (François), ses travaux de philologie comparée, 498.
— principaux faits mis en lumière
par sa Grammaire comparéef 284. . - .
Botanique, origine de ce mot, 6.
— quand commence-réellement la science de la botanique, 46,17.
Bouddhisme, date de son introduction en Chine, 470. .
Brâhman, - l’Êtré suprême connu par la parole, 98.
Brahmanes (les) élèvent la parole au rang d’une divinité, 98.
— leurs travaux d’analyse grammaticale, 99.
— leurs entretiens avec Alexandre,
404. ; : V •
Bréal (M. Michel),' sa traduction de Bopp , note 49 et passim. .
— son ouvrage sur les Tables eu^ gubines, 254 fnote.
— son étude sur les noms perses dans les auteurs grecs, 249, nole^
— remet en lumière les titres du P. Cdeurdoux à l’honneur d’avoir
"N -X. N. :N. N X.. -N. -N.. -X., N N N .-X^
le premier clairement indiqué la parenté du sanscrit avec le latin et le grec, 489. - '
Brennus, signification présiimée de ce nom, 255. . ,
Brewster (David), sùr îe; rôle de l’if maginâlion dans les sciences, 21. Buffon, sur lés ressemblances entre l’homme et les bêles, 416, note. Bulgare (royaume) sur le Danube,
. 581. ' . » ' ■ ‘ ' ' '
— langue et littérature des Bulgares, 256.
rameau bulgare de la branché des dialectes finnois, 581. "
Buriates (les), leurs dialeetes commencent k entrer dans une nouvelle période de vie grammaticale.' 65.. '
Burnouf (Eugène) déchiffre le prêt . mierie texte original du Zeiid-Avesla, 199, 248.
— ses travaux sur les inscriptions cunéiformes de Darius et de Xer-xès, 199, 248.
- ■ \ _ , - *■ ■ -
Calmette (lé P,), missionnaire dans l’Inde, ses lettres sur la connais-sauce que les jésuites possédaient du sanscrit, dans la première moitié du dix-huitième siècle, 485. .
Cariens (les), opinions des auteurs grecs sur leur origine, 444, note. Carnéade est empêché par Caton de . donner des leçons à Borne, 424. Carthaginois (le),- étroitement apparenté à l’hébreu, 540. - -
Cas, histoire de ce terme, 426. "
Cas (formation des) dans les langues aryennes, 265, 269. .
Gassius Dionysius d’Utiquè traduit le traité de Magon sur l’agriculture, 406,v note. - .
Castor et Pollux, les premiers dieux grecs qui eurent leur temple à Rome, 445. . ;
Castrèn,' son exploration de l’Asie septentrionale et centrale, 65.. Catalogue (le} des langues d’Hervas, 464.
Catherine (la grande) de Russie, son « Dictionnaire comparé, » 167.
— sa lettre à Zimmermann, 465.
Caton,, son histoire de Rome en latin, 447. Y
— apprend le grec dans sa vieillesse, HS.
— fait une guerre acharnée à la philosophie et h la rhétorique grecques, H8.
Caucasien (isthme) appelé « la montagne des langues, » 104.
— trihus qui y sont établies, 564-
Cavea, caverna, de quelles racines
ces mots sont dérivés, 449.
Celles (les), leur ancienne autonomie politique, 254.
— les divers dialectes celtiques, 254.
César dédie à Cicéron son traité de
• Jnalogiâ, 124.
— emploie le premier le terme d'ablatif, 124.
Chaldéen (le), par qui ce dialecte a été parlé, 53b.
— fragments en chaldéen contenus dans le livre d’Esdras, 555.
— langue des Targums, 556.
— les "Me.ndaïles ou Nasoréens ont conservé quelques restes de l'ancienne littérature des Chaldéens, 558.
Chameau (le), nombre des mots qui le désignent en arabe, 459.
Changements opérés par le temps dans toutes les langues 57.
— Changement rapide des dialectes des peuplades non civilisées, 58, 61-65.
— changements survenus en anglais depuis 1611, 59.
— changements analogues en français, 41, note.
— quelques changements grammaticaux en anglais, 41.
— lois du changement dans le langage, 75. . .
Chat, étymologie de divers noms du chat, 438. .
Chili (langue du), 555, note.
Chine, époque où le bouddhisme y fut introduit, 170.
— pèlerinages des bouddhistes chinois dans l’Inde, 171.
— la Chine conquise par les Mongols, 559.
Chinois (le), aucune trace de grammaire dans l’ancien chinois, 155.
— note de M. Stanislas Julien sur les substantifs et les adjectifs en chinois, 155.
— formation du locatif en chinois,
265 et 156, note. ”
— formation du cas instrumental en chinois, 265..
— nombre des racines en chinois, 521,522.
— Note de M. Stanislas Julien sur le nombre des mots en chinois, 522. .
— aucune analyse n’est nécessaire pour dégager les éléments constitutifs du chinois, 550.
— rôle des racines attributives en chinois, 525.
— les racines en chinois, 548.
— les parties du discours sont déterminées en chinois par la place des mots dans la proposition, 548.
— traces rudimentaires de l’agglutination en chinois, 592.
— onomatopées en chinois, 459.
— liste d’interjections en chinois, 445, note.
— sélection naturelle des racines
. en chinois, 465. .
Cicéron cite comme faisant autorité
en matière de grammaire,. 124.
— Yarron lui dédie quatre de ses livres sur la langue latine, et César son traité De Jnalogiâ, 124.
Classification (la) dans les sciences physiques, 16.
— objet de la classification, 18.
Classiques (langues) ou littéraires,
leur origine, 66.
— leur“ dépérissement inévitable, 69.
Cocarde, étymologie de ce mot, 451. .
Codex argenteus, manuscrit de la Bible d’Ulfilas, 220.
Ccelîtm, ciel, étvmoJogie de ce mot, 450. ‘
Cœius, origine de la fable qui le fait père de Saturnus, 115.
Cœurdoux (le P.), sa correspondance avec Ànquelil-Duperron, 182. ‘
— adresse, en 1767, à l’académie des inscriptions et belles-lettres, un Mémoire sur les ressemblances entre le sanscrit et le latin et le grec, 188.
Colchide (dialectes de la'!, d’après Pline, 61. '
Commune (origine) dès langues humaines, examen de ce problème. Voir Origine.
Comparée (la grammaire), 284.
Concernant nous olfre la même
LEÇONS SUR LA SCIENCE DU LANGAGE.
480
'image que la locution anglaisé' luilh respect to, 515.
Conjugaisons des verbes, la plupart des désinences des verbes sont des racines démonstratives, 528. Constantinople (prise dé), 569. - -Copernic, comment il fut amené à découvrir son système du monde, 20.
Copte (le), à quellei époque cette langue de l’Égypte1 a cessé d’étre parlée, 54-2
Coquet, étymologie de ce mot, 451.
Corniquë (Je), quand celte branche des langues celtiques s’est éteinte, 88.'
Corvus, corbeau, étymologies diverses proposées pour ce mot, 455. 459.
Coucou, ce mot, 450.
Cralès de Pergame visite Rome, 125.
— y donne des leçons publiques de grammaire, 125.
Cunéiformes (inscriptions) déchiffrées pour la première fois par Burnouf, 199, 251.
— importance de la découverte des inscriptions cunéiformes de Da-rius.et de Xerxès, 248.
-^inscriptions cunéiformes de Ba-bÿione et de Ninive ; leur importance ; leur déchiffrement n’avance que lentement, 357. -,
— lettre de sir Henry - Rawiinson sur ces inscriptions, citée, 558.
D
D, origine de cette désinenee des prétérits anglais, 285.
BA, donner, racine première, 518,
Dacé (ancien dialecte), 228, note.
Dame, origine de ce mot, 275.
Ddme-Diex, signification de cette
* exclamation dans le vieux français, 275. .
Dmaé, étymologie du mythe de Danaé, 15.
Danois (le), développement de cette langue, 72, 225.
Darius prenait le litre de descendant des Aryens, 292,
Datif, ce cas en grec, 269.
— en chinois, 155, note.
Daugfiter, origine de ce mot, 54.
Déclinaisons, la plupart de leurs
v ter minâlsôns^sônt dés racines-dé- . . monstratives, 528. . î
Del, dello., origine dé ces mots, 77. Démocrite, ses voyages,* 105. Demoiselle, étymologie de ce mot,
- -275. - - ■ - . . - . -
Démonstratives (racines),-leur rôle dans le langage, 525.
—^ la plupart des désinences des déclinaisons et des conjugaisons sont des racines démonstratives, 528.
Denys le Thraec, auteur de la première grammaire grecque, 412. Dépit, étymologie de ce mot, 513. Désinences grammaticales, remarques de Rorne Tooke, 504. Despiter, signification de ce mot dans le vieux français, 515, noie. Deva, Hervas rapproche ce nom
sanscrit de 0soç. 164. Développement du langage, 44, 68.
— si l’hômme peut perfectionner le langage, 45.
—. causes du développement du . langage, 48.
— le développement du langage . comparé à la formation successive des couches terrestres et non à l'accroissement des plantes, 85.
Dialecte, ce qu’on entend par ce mot, 55.
Dialectes de l’italien, 55.
— du français, 56.
— du gréé moderne, 56.
— du frison, 56-58.
— de l’anglais, 58.
— les dialectes alimentent les ïan-
■ . gue.s littéraires, 59.. . .
—"Grimm, sur forigine des dialectes en général, 59.
— difficulté qu'il y a à suivre 1 histoire des dialectes, 60. ;
Dialectes de l’Amérique, 62. .
*— du Birman, 64. v
— des Ostiaks, 65. ;
— des Mongols, 65.
de l’Afrique méridionale, 65.
— de certaines classes dans chaque société, 67.
— intarissable fécondité des dialee-tes, 75.
— le développement des dialectes est indépendant de la volonté dés individus, 76.
Dictionnaire comparé de la grande Catherine de Russie, 167.
Did, origine de ce prétérit, 284.
Biëz, sa Grammaire comparée Ses six langues romanes, 250.
Discussion, étymologie dé ce mot, 50. .
Divination (là), son utilité dans les recherches scientifiques, 20, 21.
Dorpat (dialecte de), une des divisions de l’esthonien, 580.
Du, origine de ce mot, 76;
Duel (te), Zénodote fut le premier à en remarquer l’emploi dans les poëmes homériques, 111.
Dumàresq, son vocabulaire, comparatif des langues orientales, 165.
Durel (Claude), son ouvrage sur le langage, 151, note.
Dyaus, forme sanscrite de Zens, si-gniflcation dé ce iriôt, 15.
lÉqrL, îè norrois jarl, origine de ce ' titre, 275. ; .
jEarth, sens primitif de ce mot anglais, 507.
à quelle racine il faut rat-lâcher ce nom du serpent en grec, 455.
Eddas (les deux), 224 et suiv.
— Origine du npnï û'Edda, 226. Egger (M. E;), ses travaux cités,
: 110,,nj>te et 255,noie. : Égyptien (Pancien), nombrëde ses mots d’après les inscriptions hié-rôglyphiqués, 525.
— à quelle famille de langues il faut le rattacher, 542.
EtpA, elç, Ic-tv. Voir asmi. -Êidèr, origine dé ce mot, 275. Éléments (les) constitutifs du langage, 505. .
Enfants, leur langage contribue probablement à faire disparaître graduellement les conjugaisons et les déclinaisons irrégulières, 77. : .......
i^i -
Enluminure des manuscrits, art oublié: de nos jours, 12. .
Ennius s’établit a Home comme _ professeur de grec, 118.
’ ^ ses traductions,-117,118.
Dos, signification originelle de ce mot, 12.
Ephrem (saint), 555, note. . . Épieharme, sa philosophie traduite , en latin par Ennius, 118. •
Epicier, étymologie de. ce mot, 517.
Ëpicure, faveur dont ses doctrines , jouirent à Home, 121. -
Equiper, étymologie de ce riiot, 508. • ,
3ÉplT7(Ç, rameur, dérivé de là ràci-, ne AR, labourer, 510. .
Erin, étymologie de ce nom donnée par Pictet, 296 et nàte.
— remarques de M. SVhilley Stokès sur ce nom, 297, note.
Esdras (fragments du livre d’), écrits en Chàldéen, 555.
Espèce, étymologie de ce mot, 517. Espiègle, origine de ce mot, 515. Est , étymologie de celle fdrme grammaticale, 204, 562; .
Esihdniehs (lès), leur langue, 580.
— dialectes de cette langue, 580. Estis et sets, formes plus primitives que la forme correspondante
„ en sanscrit, 204. .
Etes. Voir Sommes.
Éthiopien (1’) ou abyssinien, ber. ceau de celte langue, 540. ' Étienne (Henri), son idée de réduire une langue touL entière h un petit nombre de racines, familière aux brahmanes de l’Indè, 99.
— son travail sur les rapports entre le français et le grec, lot, note.
— nombre dé mots contenus dans l’édition de son Thésaurus, pu* bliée à Londres, 524, noté.
Étoiles (les), à quelle époque elles forent divisées en étoiles errantes
(-);av7jTK), et en étoiles fixes {&-: ososp-eva), 9, note..
Éudémus, disciple d’Aristote, con-. naît la race aryenne, 295 .
Éulaiie (cantique d’), à quel siècle-il faut le rapporter, 250. ,
Euripide, traduit pour la première fois en latin par Ennius, 117. Evêque et sceptique, dérivés tous deux de la .même racine, 512. -
Evhémere dé Méssèné, son ouvrage ^ sur les dieux, .traduit en latin par Ennius, 118
Éwald, sur les rapports entré les .. langues touraniennes et lès làn-, gués aryennes, .401.
Ézoîir-Véda.(!’), 181, noie. .
F
Fabius .Piçtor,. écrit en grec son hisidifëdé Rbmëi416.
482 LEÇONS SUR LA SCIENCE DU LANGAGE,
O ’ ■
- v
" classification " généalogique des' langues, 206. .
— les différences entre les éléments formels de diverses langues ne sont pas incompatibles avec la communauté d’origine de ces langues, 208.
— les philosophes qui regardent le langage comme une invention humaine fondent leurs princi
Fa-hian, le pèlerin chinois j ses voyà-ges dans l’Inde, .471. , .
Faible, étymologie de ce mot, 142. *
Familles de langues, critérium pour rattacher les principaux dialectes de 1 Europe et de l’Asie à certaines familles, 202.
Fatum., signification originelle de ce mot, 12.
Fée, étymologie tie ce mol, 76.
Fee, honoraires, étymologie de ce mot anglais, 506.
Fer (nom du) en sanscrit et en gothique, 286. . -
Feu, étymologie de ce mol, 141.
Fiend, "étymologie de ce nom anglais du démon, 445.
Fiezi et le brahmane, leur légende, 177.
Fille et mère, ce qu’il faut entendre par ces noms appliqués aux langues, 68.
Finnois (dialectes), 578 et suiv.
— le « Falewala, » l’Iliade des peuples finnois, 579.
— berceau primitif des peuples finnois, 577. .
— leur langue et leur littérature,
579. .
— réveil de leur sentiment national, 579.
—' tableau des noms de nombre dans les dialectes finnois, 584.
Firdusi, langue dans laquelle il écrivit son Shâ-nameh, 254.
Firoz Shah fait traduire en persan des ouvrages sanscrits, 174. t
Fixes (étoiles), Aristote emploie le premier cette dénominationacrpa IvoEospiw., 9, note.
Flamande (langue et littérature),
210.
Flamininus, sa connaissance du grec, 116.
Flexions (langues à), différence entre ces langues et les langues agglutinantes, 586.
— ce qu’on entend par langues â flexions, 347.
Flotter, rapproché du sanscrit plu, îtXeo). 5i0, noie.
Flourens (M. P.), sur les facultés mentales des bêtes, 417.
Formels (éléments) du langage, ce qu’on entend par ce terme, 206, 261. ; • . .
— ils sont la base principale de là
paux arguments sur ces éléments formels, 262, et note.
Formes grammaticales, hypothèse pour montrer comment elles prennent naissance, 271 et suiv.
— elles résultent de combinaisons rationnelles, 469.
— on n’est pas encore parvenu à expliquer toutes les formes grammaticales, 467.
Frais et défrayer, étymologie de ces deux mots, 142, note.
Français (dialectes), leur nombre, 56.
— lois qui ont présidé au passage
du latin au français, 75. "
— changements qui se sont opérés en frauçais à des époques récentes, 42, note.
— origine des désinences grammaticales en français, 277.
— origine du futur français, 278.
Fredum, origine et signification de
ce mol, 142, note.
Friend, à quelle racine il faut rattacher ce mot anglais, 445.
Frisons (dialectes), leur grand nombre, 56-58.
— caractère et histoire du langage des Frisons, 210, note. . .
Fromage,. étymologie de ce mot,
Furicha, sillon, en allemand, rat--taché à farah, porc, 5i0, noie. Futur (le) en français, 278. .
— en latin, 280.
— en grec, 280.
— en chinois, 466.
— dans d’autres langues, 280.
G .
Gadhélique (le), un des deux grands rameaux des langues celtiques, 254. "
Gaélique (le), sa place dans la famille celtique, 254.
Galalie (idiome de la), 235.
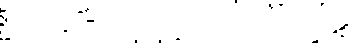
;

TABLE ANALYTIQUE. 483
Galla (le), dialecte de l’Afrique, famille à laquelle il appartient, 542.
Gallus, étymologie de ce nom latin du coq, 455.
Gatias (les), ou listes des mots remarquables en sanscrit, 155.
Gange (le), signification de ce nom, 451.
Garderige (le), 225, note. _ #
Garo (le), formation des adjectifs dans ce dialecte, 128, note.
Gâlhâs (les), ou Chants de Zoroas-tre, 252. _
Gébelin (Court de), son Monde primitif, 161. . *
— comparé avec Hervas, 161.
Généalogique (classification), à quelles langues elle s’applique proprement, 206.
— pourquoi certaines langues échappent naturellement à cette classi-Ication, 206-208.
— tableaux généalogiques des principales langues humaines, voir l’Appendice.
Génitif (le), origine de ce terme grammatical, 127;
— les désinences du génitif sont le plus souvent identiques avec les suffixes dérivés au moyeu desquels les substantifs sont changés
. en adjectifs, 128, note.
— manières de former le génitif en chinois, 15b, noie.
— manières de former le génitif en
latin,.266-269. '
— quelle est la force réelle du génitif, 128.
Gengis-Khan fonde l’empire mongol, 558.
Géométrie, étymologie de ce mot, 6.
Ghez (le), dialecte de l’Afrique, 541.
Ghiaour, signification-du mot, 147.
Glossarium comparativum lingua-rum lotius or bis, de l’impératrice Catherine, 167, note.
Gordon (le capitaine) sur les dialectes du Birman, 64.
Goropius, écrit un ouvrage pour prouver que le hollandais avait été la langue du paradis, 156.
Gospel, étymologie de ce mot, 140.
Gothique (le), le plus ancien monument de cette langue remonte au quatrième siècle de Jésus-Christ, 218.
— à quelle classé dé langues appartient le gothique, 222.' . '
— nombre des racines en gothique, 521 note.
Goths1(les) et l’évéque Ulfilas, 21 Gel suiv.
Grammaire (la), critérium pour établir la parenté de presque toutes les langues, 94. '
— la grammaire anglaise est évi-
— demment d’origine tèuloniquê, 89, 95.
— aucune trace de grammaire dans l’ancien chinois, 95.
— travaux grammaticaux des brah-
, mânes, 99.
--des Grecs, 99.
— origine de la grammaire, 101.
— ardeur avec laquelle les éludes grammaticales furent poursuivies à Rome, 119-126.
— rencontres entre la terminologie grammaticale des Hindous et celle des Grecs, 155.
— origine et histoire de la grammaire sanscrite, 155. '
— origine des formes grammaticales, méthode à suivre pour faire remonter les formes grammaticales à leur source, 158-145 et 281-285.
— utilité de la classification généalogique des langues pour découvrir . Horigine des formes grammaticales, 142.
— importance de l’étude comparative des formes grammaticales pour la classification des langues, 202.
—.la grammaire comparée, objet de cette science, 259 et suiv.
— la Grammaire comparée, de Bopp, 198.
— les désinences grammaticales ont été à l’origine des mots indépendants, 264.
— principaux faits mis en lumière par des travaux tels que la Grammaire comparée, de Bopp, 284.
— la grammaire, aryenne, 284.
— la grammaire turque, 391 et suiv.
Grammatici (les) à Rome, 116.
Grec (le), étudié et cultivé par les barbares Bérose, Ménandre le Phénicien et Manéthon, 106.
— étude critique du grec dans l’école d’Alexandrie, 108.
— première grammaire grecque
iù
-V
X. -N.
LEÇONS SUR LA SCIENCE BÙ LANGAGE.
'-N. -'h 'v -N. "■'s. -X- X X, -x,. -X -V, X, -X
o
X -X
X -X
-X X
composée à Borne par Deriÿs le
— Thrace, 112. .
X là connaissance du grec très^ré-
pandue à Rome, 115. . -
-principes -qui ont présidé à la formation des adjectifs et dés gé-iiitifs en grec, 129, note.
— la terminologie de la grammaire grecque enseignée à Rome se répand dans le inonde* entier, 129.
— le principe de la classification .n’a jamais été appliqué par les Grecs aux variétés du langage,
145.
— les Grecs et les Barbares, 145.
—' remarques de Platon sur la lan-
gué grecque, 145.
— conformité grammaticale entre le grec et le sanscrit, 164.
— affinité entre le grec et le sanscrit, 188 et suiv.
-- formation du datif en grec, 269.
— le futur en grec, 280. X
— nombre de formes données par
— chaque verbe grec conjugué à tous ses temps, etc., ooO, note.
— nombre des dialectes du grec moderne* 58.
Grecs (les philosophes), leurs voyages supposés, 105, note.
Grégoire de Nyssa (saint), sa défense de saint Basile, 54, note:
Grimm, sur'l'origine des dialectes
' en général, 59. .
sur l’idiome des tribus nomades,
JUt r . . -
— sa Grammaire teiiionique, 199. Guèbres. Voir Parsis.
Guichard (Etienne), son ouvrage sur le langage', loi, note. ' " ; •
Gutlà-pércha, étymologie de cemôt, 241, note.
... . . . ^ . , ... ■
Hahn (J.-G.), ses travaux sur l’alba-nàiis, 258, note. _
Halhed, ses remarqués sûr l’affinité entré le grec, le latin ét le sanscrit, 190. .. .
— son Code des lois Gèntoo, 190.
noie. . ....
Ramiltoh (sir W.), sur l’origine des noms appelîatifs et des ndms pro-près* 452, note. .
Hanxleden (le P.), sa connaissance du sanscrit * 186. •
Harmonisation (loid’), ce qu’ori entend par ce terme, 556. . '
Harold Ilaarfagr, roi de Norvège;
sôn régné despotique, ’0o. Haroun-al-Raschid _ fait traduire, en . persan des ouvragés sanscrits.
ns. • . - . '
î{arù-épéx, origine de ce mot, 545. Haug, ses travaux sur le zend, 247, note, 251.
Haussa (lé), dialecte d’Afriqué, à quelle fainiïie de langues il. ap-p'àrtient, 542. .
Haut-allemand (le), son histoire,
211.
— ne peut pas être regardé comme
étant dérivé dû gdthiqüe, 222, 227. X .. . . :
Hébreu (P), les Pères de l’Eglise l’ont regardé comme la langue primitive de riiifmahiié, 152. ~
— travaux savants mais stériles, pour prouver que toutes les langues étaient dérivées de l’hébreu, 154.
— Leibniz se défait le premier de ce préjugé, 155.
— première grammaire hébraïque,
99, note. ~ ’
— nombre des racines en hébreu,
— l’hébreu, l’ancienne langue de la Palestine, 540,
— l’hébreu est d’abord envahi par
des dialectes araméens et emporté enfin par l’arâbe, 540. . .
Hécate, ancien nom de la lune, 45. Hecatos et Hecalebdios, signification de ces noms, 45.
'UéijcLnd (le), le plus ancien poème en bas-allemand, 240. ' Hellénique (branche) des langues indo-européennes, 255. .
Hérât, origine de ce nôm, 500. lierculns, lé dieu des enclos, est confondu avec Héraclès, 144. Ilerder, sa théorie de la formation du langage, 427. .
Hermano, pourquoi ce mot a été • adopté en espagnol, au lieu d’un dérivé de [rater, 544,
Hermippus traduit Zdroàsfre en grec, 108,
Hérodote, ées voyages, 105.
— sur les Pélasges, 144, noie. . . Ilefvas, sa vie.et ses travaux,, 160'.
— rédu il à oiize familles. le's nbm-breüses îanguès dé FÀm'ériqbe, 65.
sa liste d’ouvrages, publiés sur la science du langage, 150, note. "
— comparé avec Court de (Sébelin,
164. ' ' '
— établit la famille des langues ■malaises et polynésiennes, 465.
Hëÿse, ses vues sur l'origine du langage, 464, note. •
— son explication du développe- ; ment du langage, 46p.
Hiéroglyphiques (inscriptions), nombre des mots que leur déchiffrement a donnés jusqu’à présent, 525.
Himyaritiques (inscriptions), 540. :
Hindoustani (1’), origine de cette langue, 71.
— le génitif et les adjectifs en hin-
doustani, 129, note. ' .
— date des plus anciens monu-
nienls du hollandais, 210. '
Homère, étude, critiqué de ses poèmes dans lécole d’Alexandrie, , .410,.141, .
—. influence de* celte étude sur le
•276. .
Indo-européennes (famille des langues). Voir Aryennes. Instrumental (pas), formation de ce cas en chinois, 265.
Interjection (théorie de 1’) pour expliquer la formation des racines,
. MO et sviv. ■
Interprètes (les) dans l'antiquité,
Iran, le nom moderne de la Perse, étymologie de ce noih, 295. _
Iraniennes (langues),. 246 et saiv. , Irlandais (!’), sa placé dans la fà-
mille celtique, 254'.:
t r *
— Urdîi-zehan est le véritable nom de l’hindouslani, 578.
Hiouen-lhsang, le pèlerin chinois, ses voyageadans l’Inde, 471.
. Iliram, sa flotte, 259.
Histoire (F) et le langage, leur çon-nexion, 85, 86.
Hiung*nu, le plus ancien nom par lequel les peuplades turques de l’Asie centrale furent connues des Chinois, 562. : '
— histoire de ces peuplades, 562.
IIliod Qes) ou Quida de la'Norvège,
216. ' . \ • réunis au. douzième siècle par . Saemund Sigfusson, 226. .
Hoeï-seng, le pèlerin chinois, ses voyages dans l'Inde, 471.
Ho ha, nom de la charme, en gothique, rapproché du sanscrit koka, loup, 540, note.
Hollandais (le), ouvrage de Goropius pouf "prouver que celte langue avait été pariée dans le paradis,
. 456.
développemenlde la terminologie grammaticale,: 111.
Homme, étymologie de ce nom, 457, ... ; -
— noms . divers, de l'homme, 457. w différences entre l’homme et les. bêtes. Voir Bêles.
Hongrois.(les), leurs-ancêtres, 582, leur langue, 582.
— affinité de cette'langue, avec lès dialectes ougro-fiïinois, 582. Horace, sur les changements que le . latin avait subis de son temps,
69. ...... ■
Hors, étymologie de ce mot, 144. Humanité (1’), ce mot ne se rencontre ni dans Platon ni dans Aristote, 447.
Humboldt (Alexandre de), ci té, 20. Humboldt (Guillaume deh services rendus par lui aux.étudès philologiques, 499; /.
Hiirons (lés), remarques de Gabriel Sagard sur leur langue, 62. Hnzvaresh (Je), 255. ‘
Hyades, étymologie de ce. nom, 9.
I
1, aller, racine première, 548, ,
î bn Wahshiyyah traduit èn arabe . l’Agriculture nabatéenne et d’au-
1res ouvrages écrits en araméen, 559, note, *"
Iconium (sultans turcs d’), 568. Ilahi, la religion fondée par l’empereur Akbar, 175.
Illyrien (l’ancien), 228, note.
— dialectes slaves appartenant au rameau illyrien, 256,
Imagination "(rôle de T) dans les ‘ découveries' scientifiques, 20/24, Inde, étymologie de ce nom, 276. ' *— histoire générale de i’Indé, par Mulia Ahdu-l-Kadir Maluk, 76, note. • .
Indiens (philosophes), il est difficile d’admettre qu’ils aient exercé de l’influence sur les philosophes grecs, note, 405.
Indes orientales et occidentales, signification historique de ces noms,
-X. -X. -X'
LEÇONS SUR LÀ .SCIENCE DTK LANGAGE;
' . ^ O ' 'V V ' V K,t X -V 'N " V 'N % -
X
x- -X
Iron, nom que prennent les Ossèles du Caucase, 294.
Islande (F), les réfugiés norvégiens y fondent une république au"neu-' Vième siècle, 224. - -
activité intellectuelle et littéraire des Islandais, 22o.
Italien (F), son développement naturel, 68. ‘
—.‘.nombre des dialectes italiens, 55, 231.
les Italiens doivent aux Grecs les rudiments mêmes de la civilisation, 115.
— branche italique de la famille aryenne, 228.
— dialectes parlés en Italie avant la prépondérance de Rome, 251.
fts, époque où ce pronom possessif a pris naissance en anglais, 41.
J
Jàrl, signification de ce litre nor-, rois, 275.
Jérôme (saint), cité, 152.
Jones (sir William), ses remarques ■ sur l’affinité entre le sanscrit et le grec, 190.
Juifs (les), leur langue littéraire au siècle qui a précédé et au siècle qui a suivi la naissance de Jésus-Christ, 556. •
— leur langue littéraire depuis le quatrième jusqu’au dixième siè-
lé de notre ère, 336.
— ils adoptent ensuite l’arabe jus. qu’au.treizième siècle, époque où
ils reviennent à une sorte d’hébreu modernisé, 557.
Jupiter Virgarius ou Viminius, 9, note.
K
Kalewaia (le), l’Iliade des Finnois, 579. •
Ealmôuks (les), 557, 561.
Eapchakien (empire) fondé par un fils de Gengis-Elian, 558.
Eara-Kalpaks (horde des), près du lac Aral, 565
Earélien (le), un des dialectes finnois, 580.
Kemp (André), son ouvrage sur la langue' du paradis, 156. •
Képler, cité,148, note. .
Ehang-hi (Dictionnaire impérial de)s nombre exact des mots qu’il contient, 522, note. ’
Ehi-nie, le pèlerin chinois, 171. Eirghises (les trois "hordes des'1, 566.- . '
Eirghises-Easak (hordes dés), 566. Eouthami le Nabaléen, son traité de l'Agriculture nabatéenne, 539. Eymri (le), dialecte celtique, 234.
1
Laban, sa langue, 557.
Lady, étymologie de ce mot, 140, note.
Langage (la science du) est une des sciences de la nature, 124.
— date récente de cette science,
4. "
— ses noms divers, 4.
— celte science n’a pas beaucoup k offrir à l’esprit positif de notre temps, 12.
— le langage élève une barrière infranchissable entre l’homme et les bêtes, 15, 422.
— importance de la science du langage, 27, 28.
— le règne du langage, 26.
— la distinction à faire entre le dé
veloppement du langage et l’histoire du langage, 51. ■ .
le docteur 'Whewell, sur la classification de la science du langage, cité, 52, note......<-
— objections contre la classification de là science du langage parmi les sciences de la nature, 52 et suiv.
— le langage considéré comme
étant- une invention humaine ,
' . ,
- 00, t *
— la science du langage considérée
comme étant une des sciences historiques, 56. .
— changements que le temps opère dans le langage, 57-41.
— les langues des peuples très-ci
vilisés deviennent fixées et stationnaires, 59. .
— le développement du langage, 44. 5
—-'le langage peut-il être modifié et perfectionné par l’homme ? 45.
— causés du développement du
langage, 47. - •

le développement du langage résulte de deux opérations : i° Taltération phonétique, 48.
2° le renouvellement dialectal, 55. •
lois qui régissent le développement du langage, 75. inanité des'lentalives des grammairiens et des puristes pour perfectionner le langage, 77., connexion entre le langage et l’histoire, 86.
la science du langage indépendante de l’histoire, 88.
les langues ne se mêlent pas, 89.
période empirique dans la science du langage, 100. spéculations métaphysiques des brahmanes et des Grecs sur la nature du langage, 98, 99. période de là, classification dans la science du langage;-15 J. la grammaire empirique, 132.
la classification généalogique dans la science du langage, 145. services rendus à la science du langage par Leibniz, 155 et suiv. — par Hervas, 160 et suiv.
— par Catherine de Russie, 165.
importance de la découverte du sanscrit pour les progrès de la science du Langage, 'ÎOÛ et suiv.
- services rendus à la science du langage par la grammaire comparée, 202.
coup d’œil jeté sur l’histoire de quelques langues modernes, 202.
- distinction entre les racines et les formes du langage, 261.
- lumière que l’étude du langage répand sur les temps anté-histo-riques, 286.
- les éléments constitutifs du lan-, gage, 505.
- la classification morphologique
dans la science du langage, *■**#■» ' ddOi . ’
- trois périodes dans la formation du langagecelle du monosyllabisme ou des racines, représentée par le chinois; celle de {'agglutination,,représentée parles langues touraniennes, et celle des flexions représentée par les familles aryenne et sémitique, 546.
le problème de l’origine commune des langues, 588.
le problème de l’origine du langage, 410.
— théories diverses de l’origine du langage, 412 et suiv
— méthode à suivre pour arriver à la solution de ce problème, 414.
— les facultés de l’homme et celles des bêles, 415.
— la différence entre l’homme el les bêles, 422.
— quelle est la faculté interne dont le langage est le signe ou la manifestation extérieure ? 425.
— les idées universelles, 424.
— les idées générales et les racines, 444 et suiv.
— l’Origine de nos connaissances,
45 J. s
— la faculté de connaître ou la raison: la faculté de nommer ou le langage, 452.
— le son et la pensée, 460.
— sélection naturelle des racines,
458,462. .
-- rien d’arbitraire dans le langage, 468. .
. —- la diversité actuelle des langues humaines n’est pas incompatible avec la croyance de leur origine commune,469.
Langues (nombre des) connues,
20. , _
— pourquoi les anciens Grecs n’ap
prenaient pas lès langues élrân-gères, 102. . 1
— la Montagne des langues, 104.
— la. classification généalogique des
langues, .197. .
— critérium pour reconnaître les degrés de parenté entre les lan-gués, 202.
— le principe de la classification généalogique n’est pas applicable à toutes les langues, 205 208.
— les racines des langues diverses appartenant à une même famille ne sont pas nécessairement identiques, 208.
— divers degrés de parenté entre des langues congénères, 545 et suiv.
— toutes les langues peuvent être
réduites en dernière analyse b un certain nombre de racines, 53i, 425. .• .
Langue d’oïl (le plus ancien monu-. ment de la;, 230.
Lapons (les), leur pays et leur langage, 580!
r*


■V
*
, <
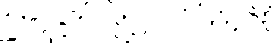
/

V - X
LEÇONS Süft LA SCIENCE DÛ LANGAGE.
x -x -s -v -x x/x; x x. x'x -x x - ■
. Latin (le), ce qu’on entend par le latin classique, 68. !
— fluctuation du latin, 68.
— par qui le latin fut fixé, 69-
-f— ressemblance entre le latin et -la-langue des Germains; pourquoi : les Romains ne remarquèrent pas celte ressemblance., 146..
— relation généalogique du grec et du latin, 204.
— le futur en latin; origine de la désinence bo, 280.
Lecce (P. Francesco Maria da), son ouvrage sur l’albanais, 258, note. Leibniz se défait le premier du préjugé qui faisait regarder l’hébreu : comme la langue primitive de fhumanité, 455. .
— applique le premier les principes : d’une induction.rigoureuse à l’élude du langage, 457,
— sa lettre à Pierre le Grand, 458.
— ses travaux philologiques au milieu de ses occupations diverses, 459.
—:,sa théorie de la, formation de la pensée, et du langage, 447. *
-Lélèges (les), opinion des auteurs grecs sur leur origine, 444, note. Lêshos, diversité des dialectes qui y sont parlés, 56. ;
Lette (le), rameau des langues sla* ves, 255. .
Lewis (Cornewaîl} combat une théorie de Raynouard, 205. Linguistique (la) un des noms de la science du langage, 4. . ;
Linné, services que s;on système a . rendus à la. science malgré ses. ‘ erreurs, 18.
Lileratores (les), distingués des.
grammatici, 416. :
Lithuanien (lé-, dialecte slave, dont certaines formes grammaticales avoisinent plus le sanscril que les formes correspondantes en grec et en latin, 256.
Littéraires (langues), leur origine,
66. '
— leur dépérissement inévitable,
69. . ' ‘
— comparaison pour, faire comprendre ce que sont les langues littéraires par rapport aux dialectes vulgaires, 69, 70..
Livius Andronicus, 447.
Livoniens (les), leur dialecte, 380. Locatif, formation de ce cas dans toutes les langues aryennes, 265.
rr. — en chinois; 439» 26.5. -
Locte, sur la distinction .entre l’homme et les bêtes, 46, 424;
— sa théorie -de la formation du langage, 54. . .
Lord, étymologie de ce mot, 440, -250. "
Lucilius veut réformer l’orthographe latine, 124. . .
Lucina, nom de la lune, 45.
Luna, étymologie de ce mot, 45. Lusace (la), dialecte qui y est parlé, 257. . .
Lycurgue, ses voyages, 405,
Macédoniens (les), opinions des anciens sur leur origine, 444, note. Madame, étymologie de ce mot, 274. ' ' ' '
Magon le Carthaginois, son traité sur l’agriculture écrit en langue. punique, 1:06, note.
Maison, les différentes branches de la famil le aryenne expriment cette idée par le même nom, 287.
Jfan, étymologie de ce mot, 457. Manéthôn écrit en grec l’histoire de l’Égypte, sa patrie, 406.
Hanta" l’Indien traduit en persan des ouvrages sanscrits, 4 75. Manîchoux (les) parlent une langue tongouse, 557^ .
grammaire du mantchou, 585.
^ onomatopées en mantchou, 459, note. .
Maux (le\ dialecte de l’île de Man, 254. . • - .
Marta, mortel, un des noms de l’homme en sanscrit, 457.
Mas, nom de la lune en sanscrit, sa .signification, 8.
Massore (la), langue dans laquelle elle fut composée, 537.
Maulâna. ïzzu-d-din Khalid-Kham traduit en persan des traités de philosophie écrits en sanscrit, 474. -
Ménandre le Phénicien, 406.
Mendaïtes (les) ou Nasoréens, 558.
Ment, origine de cette désinence des adverbesfrançais, 53.
Mère et fille, ce qu’il faut entendre par ces mots appliqués aux lan-gueSjèS. .
Mescherats (horde des), 365,
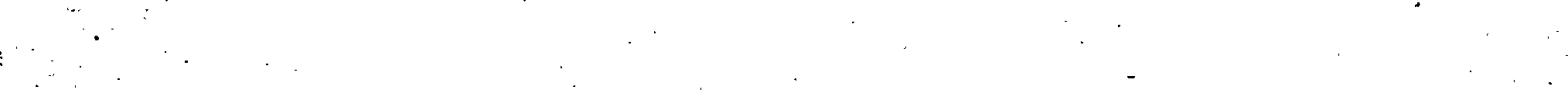
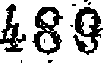
Mil.lon, nombre des mots qu’il à employés, 524. ■
Ming-ti, l'empereur de Chine, per-metl’introduction du bouddhisme dans son empire, 470.
-7- envoie de hauts fonctionnaires dans l’Inde pour s’y instruire de la doctrine de Bouddha, 171.
Missionnaires (les), services qu’ils rendent à la science du langage, 62, 150. 1
Miè&Ma, barbare, 105.
Moallakâl (les) ou poèmes suspendus des Arabes, 541.
Moffat (Robert), sa description de certains dialectes de l’Afrique méridionale, 65.
SIohammed-ben-Musa traduit en
arabe un traité sanscrit d’algèbre, 172. . ,
Monbo.ddo (lord) reconnaît que le langage distingue l’homme des bêles, 15. •
— cité, 191.
Mongols (les dialectes), commencent à entrer dans une nouvelle période de vie grammaticale, 65.
— grammaire de ces dialectes, 585.
Mongols (les), leur berceau primitif, 557, ■
h- leurs hordes principales, 557.
— dissolution de leur empire, 560.
— leur état actuel, 561.
Moon, antiquité dé ce mot, 7.
Moravie (la)- dévastée par les Mongols, 560. : ;
Morphologique (classification), cè . qu’on entend par ce terme, et sur quoi celte classification est fondée, 554. . .
principes de la classification morphologique, 546.
—- elle diffère de là classification généalogique en ce qu’elle s’applique nécessairement à tontes les langues, 587.
Mortel, origine dé ce mot, 457.
Mue h et ver y, emploi de ces deux ; mots, 45. . . .
Mythologie (la), ce qu’elle est réel-lernenl, 12.
r * ' Æ * L '
Nabatéens (le s , dè qui ils descendent, 559. - .
— traité de Koulhami sur ŸÀgricul-ture nabatéemie, 539.
Nab u chodonosor, son n ornemprei n .1 sur les briques, de Bagdad, 545:.
Nationales (langues1, leur origine, 66, 67. . :
Naturelles (sciences), aucune d’elles ne se rattache aussi étroite ment à l’histoire de l’homme que la science du langage, 87.
Natus mis pour g 7} a tus ; comme nom en pour gnomen, 452.
Negré (le parler), 79-85.
jNep.e'rÇibt, quicenom désignait, 1(12, note. ' .
Néo-latines (langues)* 228.
— l’étude comparée de ces langues nous révèle, indépendamment de toute preuve historique, qu?ii, y eut un temps où elles se confondaient en une seule, 285;.
Nestoriens (les)'de Syrie, leur ancienne prépondérance , 555, noie. .
Niçopolis (bataille de), 569.
Niemiec, étymqiogie de ce nom, parlequel lesPoionais désignaient les Allemands* 402>
Ninive (tablettes d’argile de), ce qu’elles contiennent, 558, . ■
No et nay, emploi de ces deux particules dans Ch.aucer, 275;
Nobili (Roberlo de), sa vie et ses travaux dans l’Inde, 480 et suiv.
— ses. ouvrages, 479, note.
Nogaïs (les), histoire de ces tribus*
• 564.: .
Nomades (peuples), caractères qui distinguent leurs langues, 350 et suiv. . .
— richesse de leurs idiomes; 75.
Nombre (noms de), affinité entre
ces noms en sanscrit et leurs,corrélatifs en grec et en latin, 493.
— tableau comparatif des noms de
nombre dans les langues finnoises, 584.......
Nominalisme '(le) et le réalisme au moyen âge, 45.
Nôrmans (mots) dans la langue anglaise, 94.
Norvège (lai), l’ancienne langue qui y était pariée, 225.
— la poésie eh Norvège, 225 et
suiv. ' v .
— l’ancien norvégien est resté s ta* tio.nnaire en Islande, 72,.
mo
N
■X
LEÇONS SUR LÀ SCIENCE DÛ LANGAGE.
x, «X, -X, X -N, -x, ■-X'-X. -N. -X -X, -n -X, -V -X ■
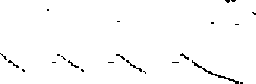
Olotes (les) ou Ealmouks, 337.
Ombrien (!’?, ancien dialecte de l’italîe, 251. '
. Onomatopée (théorie de T), pour expliquer la formation des raci-nés, 427 et suiv. ■ . ■
Ophir (pays dj, sa position, 259 et. suiv. *
Optique (!) une des sciences de la nature, 25, note.
Origène regardait l’hébreu comme la langue primitive de l’humanité, 152. •
Origine commune des langues humaines; ce problème doit être soigneusement distingué de celui de l’origine commune de liiuma-nité, 589, 590.
— examen de ce problème et preuves de là possibilité de l’origine commune des langues humaines 491 et suiv., 469.
— nous ne pouvons résoudre histo
riquement le problème de l’origine du langage, 410. ;
Origine du langage, théories diverses pour l’expliquer, 412.
Ormuzd, le dieu des Zoroâstriehs, connu de Platon, 249. découverte du nom d’Âuramazda dans les inscriptions cunéiformes 249.
— signification de ce nom, 231.
Osmânlis (les) leur histoire et leur
langue, 567.
Osquê(l’), ancien dialecte de l'Italie, • • 231; :......
Ossètes (les), leur langue, 23i.
— s’appellent eux-mêmes Iron,
■ 294.
Ostiaks (les), leurs dialectes, 64.
Ougrien (rameau) des langues vfin-noises, 582.
Guraliens (dialectes), 577.
t ■
P
Pâli (le), était autrefois l’idiome populaire du Behar, 168.
Panætius, le philosophe stoïcien, à Rome,’120.
Pânini, sa grammaire sanscrite, loo. .
Pantomime (le) et le roi d’Asie Mineure, 442, .
Paon (le), son nom en hébreu et eh tamoul, 242. :
Paris (M. Gaston), ouvrages cités, 250 et 255, notes.
• Patois, leur richesse, 59. -
Paülinus à Santo Barlhoîomeo, publie la première grammaire sanscrite, 186.
Paradis (le), langues que certains auteurs prétendent y avoir été parlées, 156, note. ■ '
Parsi (le), époque où ce dialecte était parlé en Perse, 254.
Parsis (les) ou adorateurs du feu 24.7 et note. '
Pascatirs ;les), 582.
Payer, étymologie de ce mot, 142. Péché (je), son nom en sanscrit, 456. ' .
Pecunia, étymologie de ce mot, 506. . .
Pecus, troupeau, forme corrélative eu sanscrit, et signification originelle de ce mot, 456.
Pedro (le P.), missionnaire à Cali-cut, 178. i
Pehlvi de), 235.
Peinture (la), une des sciencs hîslo-riques, 25, noie.
Percussion, étymologie de ce mol, 50.
Père, différentes manières d’exprimer celle idée dans les diverses îles du Friesland, 56x Perion, son traité de l’origine du français et de sa parenté avec le grec, loi, note.
Permiennes (les tribus) cl leur lân-gue, 581. :
Perrot (G.), ses Souvenirs d'un voyage en Asie Mineure, sur . les , religions secrètes de certaines parties de l’Asie, 176, note.
— sa thèse De Galatia provincia, . citée, 255, note.
Persan (le), influence de cette langue sur l’arabe et le turc, 92.
— ancien perse. Voir Zend et Zend-
. Jvesta. ,
—■ histoire du persan depuis l’époque des Àehéménides jusqu'à nos jours, 255. . .
Perspective, perspicace, étymologie de ces mots, 515.
Peschilo (le), version de la Bible, 554 et note.
Phénicien (le), son - étroite parenlé avec l’hébreu, 540. ::
Philolaüs.le pythagoricien, sa côn-jecture sur Je mouvement de la terre, 20. *
Philologie (la) , comparée, objet de cette science, 27, 28 et 90.
— un des noms de la science du langage< 5 et 25.
. — différence entre la philologie coiii-parée et la philologie proprement dite, 25-25.
— que celui qui s’occupe de philologie comparée n'a pas besoin de savoir un grand nombre de lan-guesj 25.
pourquoi nous la rangeons parmi les sciences de la nature, 25.
Phonétique (l’altération), une des deux opérations d’qu résulte le . développement du langage, 48.
— exemples des ravages causés par l’altération phonétique, 49-54.
— elle ronge quelquefois tout le corps d’un mot, 48.
Phonétiques, (types), les racines sont des types phonétiques, 460.
Pierre le Grand, lettre que Leibniz lui adresse, 58. .
Planète, étymologie de ce nom, 9, note.
Platon ne connaissait d’autres par. lies du. discours que le nom et le verbe, 18.
ses essais d’étymologie, 144.
— connaissail ZOroa.stre,_248, noie.
— ce qu’il entendait par la nature,
460. ;
Piaule, ses pièces sont des. tradue-lions on des remaniements de : comédies grecques, 117.
— emploi affecté de mots grecs dans ses pièces, 117.
Pléiades, étymologie de ce nom, 8.
Pleines (racines), ce qu’on entend par celte dénomination, 465.
Plougli, nom anglais de la, charrue, identifié avec le, sanscrit plava, vaisseau, et avec tîAoTov, 510.
PLU, couler, racine tertiaire, 518.
Pluriel (le), comment on le forme en chinois et en tibétain, 51.
— Aristote ne connaissait pas. ce
Pologne (la) envahie par les Mongols, 560. .
Polonais (le) appartient au rameau occidental des langues slaves,
— le plus ancien-monument du polonais, 257. -
Polybe, sur les changements survenus en latin, 69.
Pons (le P.), sa lettre écrite en 1740 sur la. littérature sanscrite, 185. Popularité, changement qu’a subi la signification de ce mot, 45 j note. .
Porca, champ labouré,, rattaché â porcus, cochon, 510, note.
Pott, ses Recherches étymologiques, 199.
— défenseur de la pluralité d'origine des races et des langues humaines, 405, note. .
Poushlou (le), dialecte de l’Afghanistan, 254. .
Prairie, étymologie de ce mol, 76. * V
Prâkrits (les idiomes), 169. :
Prâtisâkhyas (les) des brahmanes.
Premières (racines), de quoi elles sont composées, 518. .
Prêtre, élvmologie de ce mot, 139. '
Priscien, ses travaux, 150. 'Professeurs (les) de langues, les véritables fondateurs de la science grammaticale, 101.
: Pronominales (racines), nom donné aux racines démonstratives, 526. Protagoras, critique le texte d’Homère, 45.
Provençale (la- langue) est fille du ..latin, 202. .
— est la sœur des autres langues
romanes et non pas leur mère, ainsi que l’avait soutenu Ray-noua.rd, 202 et suiv. :
— les troubadours font arriver le
provençal à un haut degré de per-feclion littéraire, 230. 1
— le plus ancien poëme p7’ovençaI,
—^ la poésie provençale de nos jours, 250, note. . .
Prussien (l’ancien), un des dialectes;, slaves, à quelle époque il s’est éteint, 256.
Psammétique, roi d’Égypte, expérience qu’il fait faire pour découvrir quelle avait été la langue ; primitive, 415.
Ptolémée, services que.son système . a rendus à la science malgré les erreurs qu’il contenait, 18. Ptolémée Philadelphe et la version des. Septante, 407, note.
Ptosis, signification de ce mol dans
- X
' ! ■
LEÇONS SUR LÀ SCIENCE DU LANGAGE
X -X^-.X -N. '-X. -'V X/ -X. - X X. -X. X X -X. X -X.
; X
réfutation de ce suiv.
\
J
-N
îa langue des stoïciens , ' .426. Publius Crassus connaissait les dif-; férents dialectes du grec, 419. ; Pvrrha, signification originelle de - ce nom, 15. . .
Pyihagore, ses. voyages d’après la légende, 405. * .
Q
Quatreiiière, son opinion sur la po-Sitiôn dii pays d’Opliir, 244, note. Quiüa ou Hliod, 226.
Quïnsy, étymologie de ce mol, exemple des ravages de l’altération phonétique, 456, «oïe. Quinlilien, ses remarques sur les changements que le latin avait subis, 69.
--sur l’omission du s final en
latin, 69, note.
Quittance, étymologie de ce mot,
m. ■
R
Racines (les), ce qu’on entend par
. mcAne, 505. .
• division des racines en racines at tributives et en racines démonstratives, 505. . •
— pourquoi certaines racines sont appelées^ attributives, 51 i. exemples des nombreux rejetons de la racine ÀR, et de leurs ra-mificalions diverses,,.506: et suiv..
— la- racine spas, 512 et suiv. .
— ce qu’on entend par racines démonstratives, 525.
x .exemples de; racines démons-tra tives, 525 et suiv.. lés racines sont nécessairement monosyllabiques ; et, envisagées soifs le rapport du nombre des lettres qui Jes composent* elles se divisent en trois classes ; les ra-cinés premières, secondaires et letïiaires, 548; .
-— exemples de ces trois classes de racines, 548, 349:
— nombre des racines en hébreu,
■ 52L. ;
r- — en sanscrit, 520.
— — en chinois* 524. '
—-en gothique, 524, note— ' en allemand, 524, noie.
-X, -X "X -X. -Xv
- rôle des racines' attributives
en chinois, 325. . .
toutes les langues.connues sont composées, de ces deux éléments constitutifs, les racines attributives et les racines démonstratives-, 550. ^
* les trois modes d’après lesquels les racines peuvent être rassemblées pour composer lè langage, constituent trois espèces, de langues: les langues nionosyllabi-ques, les langues agglutinantes et les. langues organiques ou à flexions, 546.
rôle des racines dans les langues monosyllabiques, 547. .
- rôle des. racines dans les langues agglutinantes, 550. .
- rôle des racines dans les langues â flexions, 552.
-problème de la formation des racines; théories diverses : théorie de l’onoma lopée, 427.
te théorie, 428 et
— théorie de l’interjection, 440.
— réfutation de cette théorie,. 440 et suiv.
toutes les racines ont exprimé originairement une idée générale, 444.
— exubérance des racines dans les premiers, âges, et leur élimination postérieure* 458, 462
— les racines sont des types plio-neliques produits par "une puissance. inhérente à la nature hu-
. maine, 460...... . .. .. . . .
Rae (le docteur), ses remarques: sur les changements rapides qui s’opèrent dans le vocabulaire des sociétés peu nombreuses,. 62, note. . . .
Raison (lab, elle fait que nous appârr tenons à un monde différent de celui des bêtes, 45i.
Rask (Erasme), ses travaux sur le
Raven, étymologie de ce mot, 454.
Raynouard, ses travaux philologiques, 202. ,
— crilique.de sa théorie concernant les rapports entre le provençal et les autres langues romanes, 205.
Réalisme (le) et le nominalisme au moyen âgé, 15. '
Reinaudj sur le Sindhind,; cité,; 172, note.
sur; Âlbirdûfii, 472, ï75,.noté. ' Remus,pour résinas, rattaché à ipExdoçj ôiÔ, note,
Renan (E. ), son Histoire dès Langues sémitiques, et son Origine du ... tangage, citées, 459 etpassim. Renouvëliemènt (le) dialectal* une .ides deux opérations d'où résulte le dévelcppemeût dü langage , 49. . ■ .. - .
— ce qu’on entend par 1 è rénouvel-■ temént dialectal-, c’est-à-dire là , régénération des langues par
leurs dialectes; 55-74.
Répit, étymologie dé çé mot, 543. Respect, étymologie de ce mot, 512. Riiih (le), ëtÿmologiè dé ce nom, ,451.. y
Rig-Vëda de), cité, 98, noie.
Mm~s, à quelle racine il faut ralta-élïer ce mot, 450. .
Romains (les), redevables aux Grecs de leur civilisation, 115 .et suiv.
— leur éludés grammaticales, 119 et suiv.
— leurs abus du terme de barbare,
146. ,
Roman (le), nom donné au latin qui fut parlé pendant la période de transition , du septième au neuvième siècle, 202. . ..
Romanche (langue) ou roumanche, idiome des Grisons de la Suisse,
— traduction de là Bible en rou-
manche, 250, note. ...
— bas roumancbe ou langue de l’Engadine, 250, note. ,
Romanes (langues) Ou néo-latines*
. sont toutes issues du latin,.202, 228. ; . .
— le latin classique ne peut pas
nous fournir Implication complète de l’origine dé ces langues, dont beaucoup d’éléments dérivent. des anciens dialectes de Tltalie, 251. .
— les dérivations divergentes dans
lés langues néo-latines et particulièrement en français, 252> note: t . , \ ' •
Rome, la connaissance du grec y était trè's-rëpàndue, 115. .
— l.à vie religieuse à. Rome vers la fin des guerres puniques, 121.
— les-études grammaticales àRome*
~ commencements de la-littérature à'Romë, 417. "
Rôstrum, étymologie de cè mot, 510, ilote.
Roth(Heinrich), pendant son séjour à Agia, ce missionnaire àpprênd .. à fond le sanscrit, 182. ..
Riisse (le), uné dès iangùes slavès, 256. . ■„ .
Russie (là) dévastée par les ‘Mongols, 560.
S
Sabius, ce mot ne se rencontré pas dans lé lâtîn classique* lis, note.
Sæmuncl Sïgfusson, son récueil de
, poèmes islandais, 226.
Sâgàrd (Gabriel), ses remarques sur lès dialectes des Hiiroiis, 62.
Sage, étymologie de ce mot, 115, noté. -
Saliens (les poèmes), n’élaiérit plus compris du temps d’Horace, 69.
Salomon, objets que s à flotte rapportait de Tarsis, 259. .
Sâldtar, le traité de médecine vétérinaire qui lui est attribué, traduit dti sanscrit en persan, 174 ël noté. .
Sanscrit (le), comment lés àdjéëtifs y sont formés, 12S, note. :
— la gramniairé sàiïscrité dans
l’Inde, 155. ;
histoire uii sanscrit, 468 ëi siiiv.
— le sanscrit connu des Chinois ;
170, 171. ' , . .. .^
— traductions d’ouvrages sànsèrils,
. faites en persan et ën arabe,
172.. i • ' . - . .
— premiers Européens qui aient connu le sanscrit, 178 et sidv.
— les missionnaires français èn-voyés dans l’Iiidé pàr Louis XIV attirent lés premiers l’aiteMion des savants dé l’Éurçpë sur. là lariguéét là littérature sanscrites,
-, 182. .....
— premières gramniàirés sahscri-
tes manuscrites, 185.......
— publication dé la préihièrë gràin-maire sanscrite en 1790, 186.
— premières publications, de la
Société asiatique dé Calcutta, 187, note. : ; .
— découverte des fessembiancés entre le. sanscrit, le grec et le
. latin, 18’8elsüiv., .. ,
publication, eu 1.8Ô8 dé) i’bhVra ge dé Frédéric Schlegèl, qui dbviîltle
■X. '-V -V
-x. -x xx
X,X'X
point dé départ dés études ~philO-; logiques modernes, 195, 197.
— travaux sur le sanscrit, 198. .
— la découverte du sanscrit opère un changement complet. dans l’étude'de la ' classification des
siftcàtwn, etcelleÜela 'théorie, •&:--T- période de l’empirisme, 5-iOx
— nécessité pour toutes les sciences d’avoir un objet pratique, 10.
— période de la classification, 1618. - ■ ■ ' • ■- ' / • •
langues, 200 et suiv. '
— relations généalogiques du sans’ crit, du grec et du Iatiii déter- .
minées par la comparaison de . leurs formes grammaticales, 205, 204. X . .
— haute antiquité du sanscrit, 258 ~
• et suiv. X ■
Sassanides (les), langue parlée en Perse à l’époque où cette dynastie y régnait, 254. . .
Sassetti (Filippo), savant italien établi k Goa en 1581, sa connaissance du sanscrit, 179.
Saturnus, est confondu avec Kro-• nos, 145. :
Saüvages (tribus), rapidité avec laquelle leurs dialectes se modifient . et changent, 58, 65.
Saxons (mots), nombre de ces mots en anglais, 94.
Scaliger (J.-J.), son ouvrage sur les langues dé l'Europe* 152, note. Scandinave (rameau) des langues teutoniques, 225. /■ .
— histoire des langues qui le composent, 225-227. ..
S cape, origine de ce suffixe anglais,
’ 527. . . ,
Schlegei (Frédéric), étudie le sans-/ crit, 195.
'— publié son essai sur la langue et la sagesse des indous, 195.
— les-savants de l’Allemagne .pour- .
suivent l'idée de Schlegei, 198 et . suiv. . ; - x. X
— théorie de Schlegei sur la formation du langage, 262 et noie.
Schlegei (Auguste-Guillaume), frère du précédent, son Indische Bi-bliotlieli,'i 98. :
— combat la théorie de Raynouard sur les rapports entre le provençal et les au 1res langues romanes,
' 205.. X. X
Sciences (les), divisées en sciences : historiques et en sciences de là
— utilité d’étudier l’Iiisloire des ■ sciences, 5.
— trois périodes dans l’histoire de la plupart des sciences : la période^l'empirisme^ celle de la clas-
— période de la théorie ou de la
Scipions (les), leur maison est le rendez-vous des écrivains célèr b res de Rome, 120.
Scipion (Publius), le protecteur d Ennius, J.18. '
Scythes (noms) mentionnés par les auteurs grecs, 295. . .
— dans quel sens le nom de Scythe
était pris par. les auteurs grecs, 558. .'
Secondaires (racines), de quoi elles sont composées, 518.
Seigneur, étymologie de Ce mot, 275. . ..
Sémitiques (langues), 554.
— facilité d’en distinguer les éléments constitutifs, 550.
— la famille sémitique divisée en
l’araméenne, 554: l’hébraïque, 540 ; '
: l’arabique, 540. '"■■ ■
— étroite parenté entre ces trois : branches, 541.
— membres plus éloignés de la famille sémitique, 542. :
— les familles sémitique et aryenne sont les seules qui méritent réèl-
. lement . ce titre de familles, 542.
— tableau généalogique des langues
Senior, origine de ce .litre, 275. - ...
. Septante (les) et Ptolémée Philadel-plie, 107, noie. ;
Serpent : étymologie de divers noms du serpent, 451.
Shâ-mameh (le)* le grand poëme épique de la Perse, 254. ’ -
Shakespeare, nombre des mots qu’il a employés, 524.
Siiip, origine de ce suffixe anglais, 527. .
Sibérie (la), les tribus tongouses qui y sont établies, 557.. .
— les Turcs de Sibérie et leurs dialectes, 565, 566.
Sibÿlla ou sibultà, étymologie de ce nom, 115, note.
— les oracles de la sibylle de Cü-mes, écrits en grec, 115.
Sieur, étymologie de ce moi, 275.
Sigfusson, voir Saemund. . .
Sigismond (l'empereur) et le moine au concile de Constance, 44.
Silésie (la), envahie par les Mon-, gols, 560.
Sindhind (le), traité d’astronomie composé en sanscrit, 472, note.
Sindhu, signification de ce mot sanscrit d’où est venu le nom de l'Inde, 276.
Sir, étymologie de ce mot, 275.
Sirianès (tribus), leur langue et la région qu’ils habitent, 584. .
Skatda (le), l’art poétique de Snorri Sturluson, 226.
2x£TïTou.ca, <7/.£7îTtxoç, à quelle racine il faut rattacher ces mots, 542.
Slaves (tribus), leur entrée en Mésie, 229, note.
— langues slaves, 256.
Slovène (Je), un des dialectes slaves, 257.
Smith (Adam), sa théorie de l’origine du langage, 54.
— Sur la formation de la pensée et le langage, cité, 445.
Smith (Sydney), sur la suprématie intellectuelle de l’homme, cité, 415.
Snorri Sturluson, auteur présumé de l’Edda en prose, 226.
— son Heimskringla, histoire des peuples Scandinaves, 226.
— son Skalda ou ÀrLppélique, 226.
2w, origine de cette désinence du futur en grec, 280.
Sœur, formes de ce mot en sanscrit, en pelilvi et en ossèle, 54,
Sollicitude, histoire de ce mot, 45, note.
Sommes, êtes, sont, formes plus voisines du latin que les formes correspondantes en provençal, 205.
Song-yun, un des pèlerins chinois qui ont visité l’Inde, 174.
Sons (les) de la nature, n’ont suggéré qu’un petit nombre de mots, 459.
Soûl, âme, étymologie de ce mot, 455.
Soupçon, suspect, etc., étymologie de ces mots, 514. *
Spand, trembler, racine tertiaire, 518.
Spas, nombreux rejetons de cette racine, 542 et suiv.
Species, une des ramifications les
plus fécondes de spas, 516 et suiv. : •
Spéculer, spéculatif, etc., étymologie de ces mots, 5 ! 5. ’
Spy, espion, à quelle racine il faut rattacher ce mot anglais, 512. .
Squirrel, étymologie de ce mot, 458.
Stewart (Dugald), sa théorie de l’origine du langage, 54. •
— ses doutes sur l’antiquité et l’authenticité du sanscrit, 194.
— sur la formation du langage, cité, 409. .
Sllm, forme sanscrite moins primitive que le grec sut/, et que le latin estis, 204.
Stoïcisme (le), à Rome, 124.
— la logique des stoïciens, 126.
— ce que signifie ptosis (casus) dans leur langue philosophique, 126.
Strabon, sur les barbares, 448, note.
Sturluson, voir Snorri. _
Sucre, étymologie de. ce mot, 457.
Suédois (lej, un des dialectes Scandinaves, son développement, 72, 225.
Smn, sumus, formes moins primitives que les formes correspondantes en grec, 205.
Sunt, forme latine plus primitive que eicri, 205.
Synonymes (les), -leur importance 'pour expliquer les dissemblances entre des langues qui ont eu une origine commune, 545.
— exubérante synonymie dû Ian-gage primitif, 458, 462.
— exemples de synonvmes en arabe, 459. ‘ *
— en sanscrit, 458.
Syriaque (le), un des dialectes ara-méens, 554.
— date de la version de la Bible en syriaque, appelée le Pesehito, 554.
— cette langue s’est perpétuée jusqu’à nos jours,-555.
Syrie (la), les Turkmans de Syrie, 567.
T
T, origine dé cette désinence de là troisième personne du singulier
. V
-,x
_V ' “V
- dés-verbes latins ; fàppTocliéde la forme corrélative, en grec, 328.
— origine du t dans àime-t-it, 2/8.
Talmud (le) de Jérusalem et cëlui
de Babylone, 556.
Targums'{les), ce qu’ils sont ét en quelle langue ils sont composés, 556. . . ,
Tarihhü-l-Hind (le), Ouvrage d’Albi-rouni, 175.
Tàrta fe, ce mot est pris par lologües dans deux significations différentes, 558. ,
Tarlares (les), leur berceau, 558.
~ à quelles' populations ce hoiii appartenait primitivement et à qui il s’étendit par la Suite, 558.
— aisloire des Tarlares, 558.
— leurs dialectes, 561.
Tavastien (le)^ dialecte du finnois,
580.
Tchoude(le\ un des rameaux des dialectes finnois, 578.
Tendre, rattaché à la racine qui a donné tonnerre, 457.
Terminaisons grammaticales, voir Désinences.
Terminologie (la) grammaticale des Hindous^ ses ressemblances avec celle des Grecs, 155. . .
— Comment là terminologie grammaticale dé l’école d’Alexandrie s’est répandue dans le monde en-
Terre (la), conjecture dé Philoîaüs concernant son mouvement autour du soleil., 20. ’
Tertiaires (racines), de quoi elles sont composées, 518. ;
Testament (Ancien)-, en anglais, nombre de mots qu’il contient, 524.
— traduit en grec par les Septante;
107. , ... : . '
— traduit en syriaque, 555, note.
Testament (Nouveau), traduit en
persan par ordre d’Akbar, 176.
Te.utoniqües (langues), 209 et siriv.
— malgré l'introduction de mots . étrangers enanglais, la grammai-
rë anglaise est purement teuto-nique, 89. ■
Thémistocle, sa connaissance du perse, 104. .
identifié avec le sanscrit Deva,
Thommerelj sur le nombre total
, des mots anglais; et- sur leurs sources diverses, 94, 525.
Thraees (les)*' leur origine :éî lëur ' langue, d’après lés auteurs sh-eiens, 145, note. .
Tibère (l’empereur) èt les deux grammairiens, 44. , ,
— ce que racontent Didn CasSius ët Suétone -aü sujet de sa connaissance du grec, 120, note.
Tibérius Gracchus, sa connaissance . du grec, 116.
Tibétains: (dialëctéS), comment lés adjectifs ÿ sont formés, 128. •Timour, son .énipire mongol; 560. Tôkèi, observations sur ce nom. du paoii en tamoul; 242. , .
Tongouses (tribus et langues), 557.
— grammaire tongouse, 585. Tonnerre, origine de ce mdl, 457. Tooke (Borne), son explication des
désinences grammaticales, 504.
— réfute la théorie d’après laquelle
le langage aurait été formé d’in-} terjonctions ou cris involontaires,5 440. _
Touvanieii, étymologie de ce nom, 289. - .
— le groupe des langues lûürauieîi-
— races touraniennes, leurs luttes • avec les races aryennes, 294.
— noms touraniêns mentionnés par j
— mécanisme des langues toura-
— les langues touraniennes sont
des langues agglutinantes, 549, 551. " ■' .
— divisions principales de ces langues, 550. .
— histoire sommaire des populations touraniennes, 557.et surû.
— tableau généalogique des langues . touraniennes, 474, 475.
Tourvasa, son rôle dans les épopées. indiennes, 294. ’
Traire, signification de. ce mot- dans le vieux français, 508, note. Trilitères (langues), pourquoi cette dénomination a été donhée quelr quefois aux langues sémiliques, 550. • '
Ttid, frapper, racine secondaire, 518. ... / ... ;
r- modifications de cette racine^oiff. Turc (le), influence du persan.et de l’arabe sur le vocabulaire turC.; 91,92. '
— deux classes,de vovelîes en turc, 356.
— grammaire .turque, 91.
. manière ingénieuse dont sont produites lès formes grammati-ticales du turc, 569 et suiv.-Turcs (les), ; leur histoire, 562 et suiv.
Turkmans (les), ou Kisil-bash de la. Perse, 565.
Turner (Sharon), sur le rapport entre les mots d’origine saxonne et les mots d’origine normande en anglais, 94. ,
Twenty, étymologie de ce mot, 50. Tziganes (lès), leur langue, 255. .
. u ■
Ulfiïas, évêque des Golhs, son histoire, 215. ;
— sa traduction de la Bible en gothique, 218.
— sa langue, 221.
*rYytçetuvvtç, soc de char rue,, étymologie de ce mot d’après Plutarque, 510, iiote.
Upanishads (les), traités philosophiques, composés en sanscrit et traduits en persan par le prince Dara, dont la traduction fut retraduite en français par Ànquetil-Duperron, 178.
Ura'hat (les), sur le Chulym, 565.
Urdu-zeban (T)", véritable nom de l’hindoustani, 578.
üsbeks (les), région qu’ils occupent, 564. '
Védas (les), 155. .
— différence entre le sanscrit védique et le sanscrit moderne, 155
— soins jaloux des brahmanes pour empêcher qu’on ne traduisît les védas, 177.
Vénètes (les) ce que Polybe rapporte de leurs mœurs et de leur langue, 145, note. .
Verbes (les), formation de leurs désinences dans les dialectes aryens, 271, 277 et suiv. “
Vergiliæ, étymologie de ce nom, 8.
Fer y et much, différence entre ces deux mots, 45.
Fidame, étymologie de ce mot, 275.
Vides (racines), ce qu’on entend par cette dénomination, 465.
Vingt, étymologie de ce mot, exemple d’altération phonétique, 50 et suiv. •
Virgarius (Jupiter), 8, note. -
Yinsati, mot sanscrit pourvingt, exemple d’altération phonétique, 50. •
Voguls (les), branche de la famille finnoise, 582.
Votiakes (les), leur dialecte, 581.
Vrika, nom du loup en sanscrit, employé pour désigner, la charrue, 510, note.
Vulgarité, à qui nous devons ce mot, 45, note. '
Yyâkara?ia, nom de la grammaire en sanscrit, 15o.
V
Yâch, déesse de la parole, versets prononcés par elle dans le Rig-véda, 98, note.
Valachie (la), ses populations, 228, note.
Valaque (le), un des dialectes néolatins, 228 et note.
Valaques (les) de l’Olympe, du Pinde et de l’Acarnanie, 229, note.^
Yarron, sur Magon le Carthaginois, cité, 106,note.
— son traité de la ■ langue latine, cité, 125,524, note. ^
.— César lui offre la direction de la bibliothèque qu’il voulait fonder à Rome, 125.
Vasco de Gama débarque un missionnaire à Galicut, 178.
W
JVelsh, gallois, origine de ce nom, 105.
Wendes (les) de la Lusace, 257.
Whewell (le docteur), sur là science du langage, 52, noté. _
Wilkins, indique la ressemblance qui existe entre le sanscrit et le grec, 191-195.
— ses travaux sur la langue et la littérature sanscrites, 187, note.
Windiqüe (branche) ou slave des langues aryennes, 255. '
Winiaæ (les), 255.
Witsen (Nicolas), voyageur hollandais, envoie h Leibniz la traduction de l’oraison dominicale dans l’idiome des Hottentots, 157.
— ses voyages, 158) note.
Xavier (saint François-), ses travail^ 'apostoliques dans l’Inde, 179V
Y
Yaküts (les),;-ièùr langue ét la ré' gion qu’ils habitent, 565. ,
Yea et y es, .différence .que Ghaueer ■ établit entre ces deux particules, 275. . . ' - ...
Z
Zend (le), travaux de Rask et d’Eü-• gène Burnoùf sur le zend, 199V 200. .
-r- travaux de Haug, 251. Zend-Avesta (le), 217 et note. ,/Y* V — a peut-être été traduit en- gréc par Hermippus, 108. ' / ‘
— Ànquetü-Dupérroù traduit en
français la traduction persane du Zend-Avesta, 248! ; - :
— Hask et Eugène Burhouf déchif
frent’les prëmiers lé texte même du Zend-Avesta, 248. ; '
Zéno'dote, premier • bibliothécaire d’Alexandrie, services-qu’il rendit • à la science grammaticale, 110.:
Z eus, signification originelle dé ce ce nom, 15. .
Zimmermann ? lettre où Timpéra-tricè Catherine lui annonce qu’elle travaille à un dictionnaire comparé, 165.
Zoroastre ou Zarathustra, ses écrits; voir Zend-Avesta. -r
— ses Gâthâs, 252. ,
— connu de Platon, 248. . 7
v^-ëpoque où il vivait, 252 ét note. Zoroa.êtriens, (les), voir Parais.,
— patncprimitive et migrations des Zoroaàtrrens. 501.
î
f
J
.y,
""7
- _ *
f J ; i 1 t ■ WV f /. J I I y 1 ' V»
■f/ ( i '--T* ' /
FIN DE LA TABLE AïsÂLVTIQUE
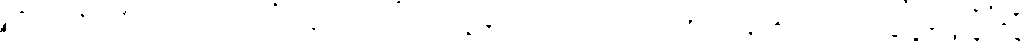
EN VENTE Â LÀ MEME LIBRAIRIE
■ -• .'"p
-'-V; V.1
r • r|^r.b >ll-jT
DU MÊME AUTEUR : '
. ■:
' i ■' - : ^ t-
Nouvelles Leçons sur la Science du Langage, traduit de l’anglais par MM. G..;parris;A^^ et G. Penot. ïS67-6S, 2 vol. iu S, ' 14
* % , y .JS" JP#'
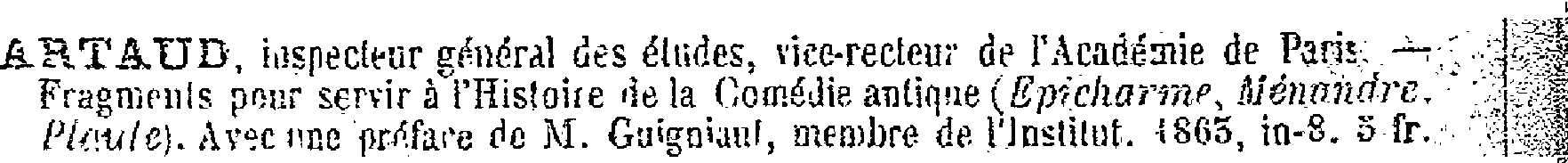
v'-K ‘ttj-s
: J x
BAIL.!, Y (.-L), ancien élève de TE rôle normale supérieure, professeur agrégé au lyréê d'Orléans, lauréat de l’Association pour r encouragement des études grecques en France —Grammaire grecque élémentaire rédigée d’après les plus récents travaux de Philologie grecque et suivant les principes de la méthode comparative (Grammaire complète)..-1875, in-8. ■ 4 fr.
BAUDRY (F.).- — Grammaire comparée des Langues classiques, contenant la théorie élémentaire de la formation des mois en sanscrit, en grec ei en latin, avec références aux langues germaniques, îie partie. Phonétique. !S68, ïn-S. 6 fr.
BBLOTqi;!}'. professeur. — Hisloiie des Chevaliers romains considérée dans ses rapports avec iss différentes Constitutions de Home. OuYragecourcimépar fÀca--: déjnie, 1-809-1875, 2 vol. mÙ. 16 fr.
GAVANIGL (U ). — Kîdintabe!, la Perse ancienne. )S6S. iu-8. ■ "■ • y 6 fr.
— Les Monuments en Chaidée, en Assyrie et à Pabylone, d’après les récentes découd vertes archeo logiques, avec 9 p î an chès li th ogra phi ées 1L>705 in * 8-. 7 fr. S h
1 j j ("
■ ,-j
|ï
• iM
w + f* ’ ’ _
:{
4
'** f •
■Cr
-ùi
■Lil
U:|
t
i
■!
EGGBR, membre de l’Institut, profrssair à la.Faculté desXeÜres. — Notions éid-
•f'-l
•LM
■■■ .lïL-l
■Liai
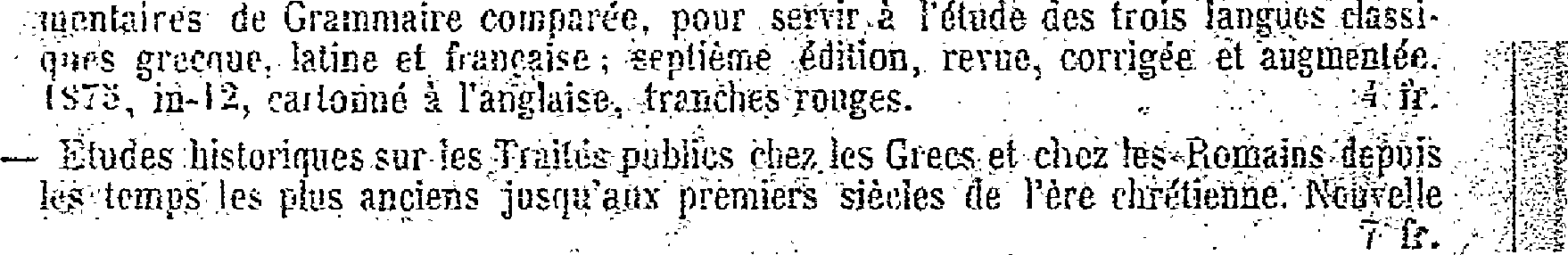
édition, 1869, in-8,
l ' r *
-- rwa
. f
■ Mémoires de Littérature ancienne. -1862, in S.
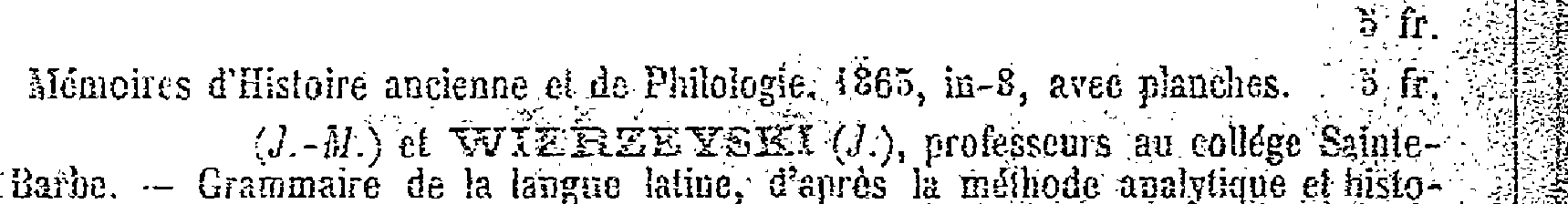
GUARDIA ,
près la méthode analytique et hisfo- ; riduc. 4870, 4 volume in-IO de~:pîus de 900 pages, cartonne à l'anglaise,
=*&*#*• - ..... . 'WïLiflf
4
. I
ut
i
- J
' i
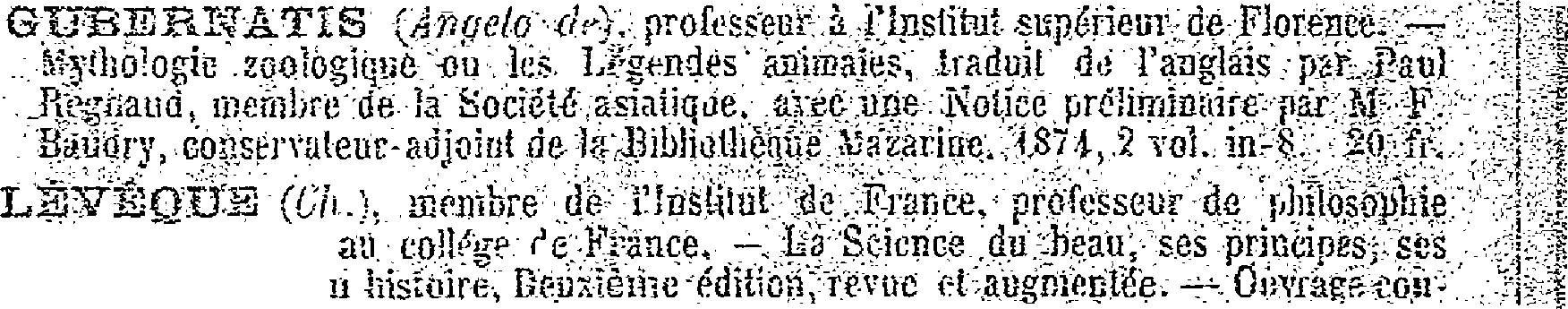
gracquo.Aff; latine applications et so
ronnë par PAciidénifè des Sciences morales et politiques,; par TAcadénlic française et.
pârl^éëdénîie des Reanx-ArtsUdS/S, 2 voLqn^8. L - ( ; ; i2 fr,
ME UHTBR. (F.r.), do c'têur ès - lettre s. — Études.( dle Gramryake - comparée. —; Les composés -syêfaÇtiques en grec, en latin, euTrançLis çtjsubsidi ai cément en zendet en indien. 4 875, m-8. Epuisé. 'VA ' v-y ■ 5 fr. S0-
— 'Lès composés qui contiennent un verbe à unmiode personnel en latin, en français, en italieh et en espagnbL 4 875, În-S. -, 6 fr.
(Ouvrage gui a partagé ie prix de UnguiHique au concours Volney, en 1873.)
- RA'HGABÉ, ministre du royaume de Grèce. — Grammaire abrégée du grecac-U;V®l,Lpr ^édée/d’une préface sur laA|jrpBonciâtipn(::et; ^ui|^e ?idTun clioîx de morceaux de 1er t j re ;v Peu xiè m e édition, 4 STo,, in - S. ; '. : A ‘ 5 fr.

. \ :4
* i ’c
\< -S
’■ î }
N
t. ^
: ] ûJ
I •m-?r
i '
va
CJ
■ïor\
C h a u mon t, I m pri iïie rie Charles CAVAIXI O L.
[
Comme plusieurs de mes critiques ont trouvé à redire à remploi que fait le moine dû génitif neutri, je demande la permission de renvoyer à Priscien, liv. VI, chap, 1 et chap. vin. Il n’y a pas,: que je sache, d'autorité dans l’ancien latin, pour l’expression generis. neutrius, si souvent usitée dans les grammaires modernes. Voyez Ausone, Epig., 50.
Beaucoup d’exemples de celle abondance primitive sont réunis dans VoWs Etyniologische Forschungen p. 128, 169 ; Griram, Geschichte der deùlschen Sprache,-.p. 25 « Wir sagen : die Slute
fohlt, die Kuh kalbt, das Scbaf lammt. die Geiss zickelt, die Sau frischt (von Frischling), die Biindin vrelft (m. h. d. envirfct das Welft) ; nicht anders heist in franzosisch. la chèvre chevrote ; la brebis agnèle ; la truie porcèle; la louve louvèle, etc » — Marsh, Lectures, p. 181, 590, cite deux extraits curieux de Juliana Berners, prieure du.couvent de Sopwell au quinzième siècle, et auteur supposé de The Book of Saint-Albans; elle nous dit que nous ne devons pas employer indifféremment les noms qui servent à désigner
L’adverbe est généralement suivi d’une particule qui produit le même effet que e dans bene ou que ter dans celeriter. Ex., me-jen, en silence, silencieusement\ ngeoü~jen^ par hasard; kiu-jen, craintivement. .
(]) Par une raison semblable, les Indiens de l’Amérique septentrionale ont des verbes innombrables pour exprimer toutes les.. nuances de l’action ; ils ont des mots pour exprimer manger', selon qu’il s’agit de poisson, de viande, de chair humaine, de soupe, de légumes, etc. Mais ils ne peuvent dire ni je suis, ni j'ai. (Yov. Du Ponceau, pp. 195, 200.) .....
Si nous possédions mi arbre généalogique exact et complet de toute l'humanité, ce serait en groupant d’après leur généalogie les différentes races d’hommes que nous obtiendrions la meilleure classification des différents langages parlés aujourd’hui sur toute la surface du globe; èt si toutes les langues mortes, et tous les dialectes intermédiaires et soumis à.de lentes modifications devaient être compris dans ce. tableau, un tel arrangement serait, je pense, le seul possible; Il pourrait cependant se faire que quelque idiome très-ancien ne se fût que peu modifié, et n’eût donné naissance qu’à peu.de langues nouvelles, tandis que tel autre, par suite de la dispersion et de l’isolement où ont ensuite vécu des groupes issus d'une même .race, par un naturel effet des différents éLals de civilisation où sont parvenus ces différents groupes, s’est profondément modifié, et a donné naissance à de nombreux idiomes et dialectes nouveaux. L’importance relative des différences qui sépareraient les langues issues du même tronc aurait toujours à être exprimée par la subordination d’un groupe à un autre groupe ; mais le seul arrangement convenable ou, pour mieux dire, le seul arrangement possible serait toujours l’arrangement généalogique, et cet arrangement serait strictement naturel, car il rattacherait toutes les langues, mortes et vivantes, les unes • aux autres, par leurs plus intimes affinités, et il donnerait la filiation et l’origine de chaque langue. Darwin, Origin ofspedes, p. 422.
Cf. Càldwell, Grammaire, dravidienne, p. 66. Ce savant émP nent fait observer que iôkei ne. peut pas être une corruption du sanscrit sikhin, crête, ainsi que je l’avais supposé, attendu que sïkfiin existe en tamoul sons Informe de sigi, paon. Tôgei ne se rencontré ni dans le canara, ni dans le leliuga, ni dans le malayàlim. Le docteur Gundert, qui a consacré bien des années à l'élude des langues dravidiennes, dérive lôgei d'une racine îô ou tu. De là, on forme en tamoul, par l’addition de ngu, une base secondaire, tongu, qui signifie « pendre, être pendant.. » De tongu vient le tamoul tonggl, la queue du paon, ornements, etc., et nous trouvons dans le ma-layâlim tongal, plumage, pendants d’oreilles, draperie; etc. En ajoutant à la racine tô le suffixe kei on gei, nous obténons tôgei, ce qui pend, queue, etc. Si cette étymologie est vraie, elle nous fournit une excellente preuve de l’antiquité des langues tamoules, qui furent parlées dans l’Inde avant l’arrivée des Ar}7as. M. Gundert signale e nom ordinaire du paon en tamoul, may-il « maison bleue », comme étant l'étymologie probable du “sanscrit mayûrà « paon «.Toutefois, m a ÿûr a se trouve dans le Vëda.
Voyez l’article Tarshisli par E. T., dans le'Dictionnaire de lu Bible de Smith, t. III, p. 1440. Il est étrange, qu’au second livre des ■ Chroniques (eh. II, vers. 8). les arbres algum soient mentionnés comme poussant sur le .Liban avec les cèdres et les pins,
Farrar, Origine des Langues% p. 3S. - . '
- " _ - _ ' . " n ‘ J " 1
« Beaucoup de grammairiens, dit l’auteur d’un Mémoire dans les Traiisactions of the Philological Society, regardent ces désinences comme sortant du corps dés mots par quelque évolution mystérieuse, ainsi que les branches sortent du tronc de l’arbre, ou
Corssen combat cette dérivation dans ses Krïüsche Beitræge, p. 241.
[De la même façon, « traire, qui dans tout l’ancien français
a le sens général de tirer, a fini par prendre le sens particulier défaire sortir le lait. » Littré, Histoire de lo.Langue française, I, 90. Tr.] .
Grimm dérive directement arbeit, le gothique arbaühs, l’ancien haut allemand arapeit, le nouveau haut-allemand arbeit, du gothique arbja, héritier; mais il admet une parenté entre arbja et la racine arjan, labourer. Il - établit l’identité de arbja avec le slave rab, serviteur, esclave, et de arbeit avec rabota, corvée, supposant que les fils et les héritiers étaient les premiers esclaves naturels. Il suppose même une parenté entre rabota et le latin labor. (Dictionnaire allemand, au mot Arbeit.)
(î) PoLl, Sludien zur Mythologie, p. 321.
Le latin remus (ancien irlandais ram) pour resrnus se rattache
à Ips-ji.o;. De IpETTjÇ viennent Ipeo'coj et ô^rjceV/jç, serviteur, aide. Ro~ slrum vient de. rôder e. ...... ..............
Cf. Eur., Hec., 455, xwtt/j cDayprjç, àao^p'/;ç, signifie « qui a des
ramies des deux côtés. » . -
Du sanscrit plu, tcXeco : Rapp. flotte, flotter, et l’anglais flecL
float. . ■
. É
Voici d’autres rapprochements : Plutarque fait venir 6vtç èt uwvç « soc de. charrue » de-jç « cochon . » ,Quæst. Conv. IV, 5, 2,
TTjv oà vv a-oypriC-Tjca' xai Tty.acrÔo:' \Éyo\)Gi ' TiptOTr, y “P cyisaca tco 'Kpo'r/o'jTi tïjç 6puyy;ç, &ç cpacri, -rrv yrjv, ïvvoç apoff£03ç eOtjXS, -xa': to TTj’ç ôvsijjç uoTjyyjcciTO epyov * oGev y.ai Touvoy.a yevEaOai toi loyodisup Xsyouci aTiù
ttjç ôcç. Ou dit que la charrue est appelée un groin de cochon. Le latin porccby la partie proéminente du champ entre deux sillons, est dérivé de porcus « pourceau ; ». et l’allemand furicha « sillon » se rattache à far ah « porc. « Jmporcitor élait un dieu italien qui présidait à l’alignement des sillons. Fab. Picfcor. Ap. Serv. Virg. G. I, 21, « imporcitor qui porcas in agro facit arando. » Le sanscrit vrika « loup, » de v r a s k « déchirer, « est employé pour signifier la charrue (Rigvéda, 1, 117 2i). Godarana « qui déchire
Eudliclier, Chinesische Grammatik, § 128.
Deux mots employés comme substantifs peuvent être placés l’un à côté de l’autre, le premier déterminant le second. Ainsi jin ia pourrait signifier la grandeur de l’homme, mais dans ce cas il est plus ordinaire de dire jin tel ta. .
« Autre exemple : chen, signifie vertu; jin tchi chen, la vertu de l’homme; chen, vertueux; chen jin, l’homme vertueux;; chen, approuver; chen tchi, le- trouver bon ; chen, bien ; chen ko, chanter bien. » — Stanislas Julien.
Ye est mis à la fin pour montrer le caractère verbal de ngo; sans ye il faudrait traduire : « la perversité de l’homme, » tandis que jin ou li signifierait a l’homme hait la loi, » :
Dugald Stewart, Works, vol. III, p. 35. .
(à) Herder, cité par Steinthal, Ursprung der Spracfie, p. 39.
Kant, Werke. vol. XII, p. 20.